Texte intégral
Jeanne d’Arc
drame historique
en cinq actes, avec prologue
par
(1890)
Éditions Ars&litteræ © 2021
Dédicace
À la mémoire de ma mère.
Préface
Ce drame, longtemps choyé, est le couronnement de mes travaux sur Jeanne d’Arc.
Si une scène ne le recueille, il sera une voix perdue. Mais il est la voix d’une âme, et il redit un nom qui est le plus grand de la patrie.
Personnages
- Jeanne d’Arc ;
- Agnès Sorel ;
- Isabeau de Bavière, mère de Charles VII ;
- Romée, mère de Jeanne ;
- Mengette, amie de Jeanne ;
- Charles VII, roi de France ;
- Mengette, amie de Jeanne ;
- Dunois, prince de France ;
- Lahire, chef de guerre ;
- Richemont, connétable de France ;
- Duc de la Trémouille, favori du roi ;
- Jean de Metz, écuyer ;
- Frère Richard, prédicateur franciscain ;
- Frère Martin Billorini, dominicain, inquisiteur ;
- Le Chancelier-Archevêque de Reims ;
- Alain Chartier, archiprêtre de Paris ;
- Jean Fournier, curé de Vaucouleurs ;
- Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs ;
- Philippe le Bon, duc de Bourgogne ;
- Bedford, régent d’Angleterre ;
- Talbot, général en chef de l’armée anglaise ;
- Robert, fils de Talbot ;
- Warwick, gouverneur de Rouen ;
- Pierre Cauchon, évêque de Beauvais ;
- Loiseleur, chanoine de Rouen, confesseur et espion de Jeanne ;
- Manchon, greffier du procès ;
- Thomas de Courcelles, théologien, accusateur au procès ;
- Frère Isambard de La Pierre, assesseurs au procès ;
- Frère Jean Lefèvre, assesseurs ;
- Le vieux Laxart, villageois de Domrémy ;
- Jacques, villageois ;
- Gérard, villageois ;
- William Luthold, soldats anglais ;
- Roger Berwoit, soldats anglais ;
- John Gris, soldats anglais ;
- Page, héraut d’armes, bailli, deux bourgeois d’Orléans, seigneurs, soldats, femmes, enfants, assesseurs au procès, le bourreau.

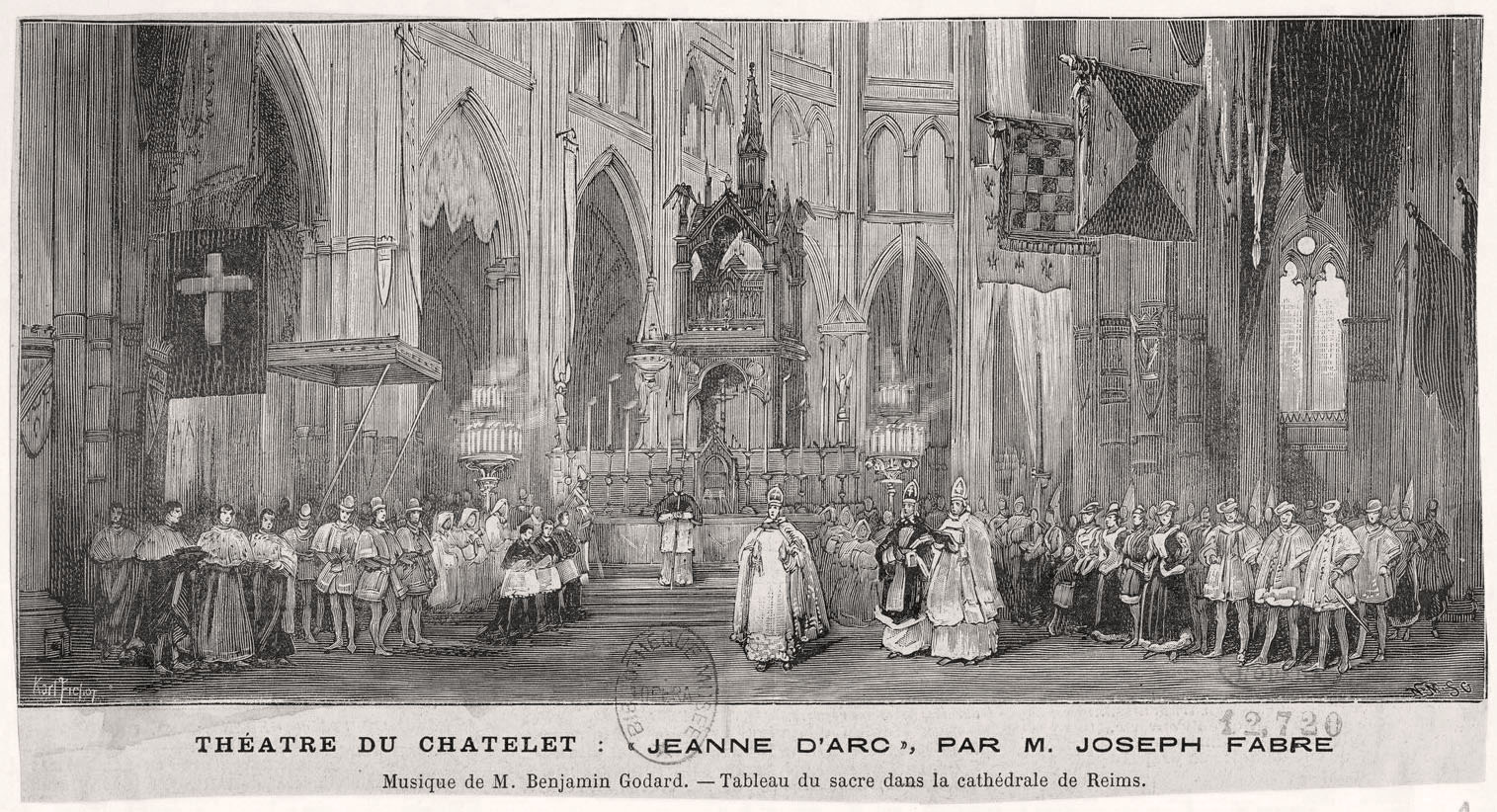
Prologue La vocation de Jeanne d’Arc
Premier tableau À Domrémy. — La mission.
Prairie du Bois-Chênu. Arbre des fées.
Scène première
Mengette, Romée.
(Sur le fond, paysans et paysannes fêtant le mai. — Ronde de jeunes filles. — Jeanne est assise au pied du grand hêtre. — La jeune fille qui conduit la ronde chante.)
Vieil air : En passant par la Lorraine.
Je ne suis pas si vilaine
Avec mes sabots,
Puisque le fils du roi m’aime
Avec mes sabots ;
Il m’a donné pour étrenne,
Avec mes sabots,
Un bouquet de marjolaine,
Avec mes sabots ;
S’il fleurit, je serai reine
Avec mes sabots ;
S’il meurt, j’en suis pour ma peine
Avec mes sabots.
(La ronde s’éloigne.)
Mengette.
Voici le doux mai. L’air est tiède et le ciel serein. N’est-ce pas, mère d’Arc, qu’il fait bon près de l’arbre des fées ? Le hêtre est beau comme un lys, et ses rameaux viennent toucher terre.
Romée.
Merci à Dieu, qui ramène la saison des fleurs ; mais je n’aime pas l’arbre des fées. Les dames fées sont filles du diable.
Mengette.
Que dites-vous ? C’est sous l’arbre des fées que Dieu fait ses miracles. Elles guérissent les malades, chassent les maléfices, font revoir aux vivants les morts qu’ils ont aimés.
Romée.
Ah ! on ne dit pas le mal qu’elles font. Ce sont elles qui ont jeté un sort sur ma fille. Le temps n’est plus où Jeanne jouait, dansait, chantait comme un ange. Regarde-la, assise à l’écart. Tout à l’heure, elle enguirlandait de fleurs les branches du hêtre. Maintenant elle reste à son ombre, les bras croisés sur la poitrine, toute perdue dans ses pensées.
Mengette.
Il est vrai, Jeanne est bien changée. Cela date de la dernière fois où les bandes bourguignonnes vinrent enlever nos bestiaux, piller nos maisons, brûler notre église. Jeanne s’écriait : Il faut remède à tant de maux ! Il faut remède à tant de maux !
Et depuis, il y a sur son front une ombre de tristesse. Mais elle n’est triste que parce qu’elle est bonne.
Romée.
Oui, Jeanne a le cœur bon et vaillant… Elle n’en ira que plus loin, si sa tête s’égare.
Scène II
Romée, Mengette, Gérard, puis villageois et Jeanne.
Mengette.
Enfin ! tu arrives de Vaucouleurs !
Gérard.
Le temps m’a paru long, Mengette. Mais maintenant tout est réglé. Nous n’avons plus qu’à fêter nos épousailles.
(Les villageois se rapprochent.)
Laxart.
Eh bien, Gérard, quelles nouvelles de la ville ?
Gérard.
Mauvaises pour le roi Charles.
Jeanne, qui s’est vivement rapprochée.
Que dis-tu, cousin ?
Gérard.
Jeannette, il faudra devenir Anglais.
Jeanne.
Jamais ! jamais ! L’étranger ne peut s’établir à demeure sur le sol de France. Il n’y campera qu’un jour. Mais parle.
Gérard.
Le terrible Talbot fait rage. Il vient de remporter une nouvelle victoire à Verneuil. Devant lui, tous fuient ou meurent.
Jeanne.
Pauvre roi ! pauvre France !
Gérard.
Puis on raconte qu’Orléans va se rendre… Si Orléans cède, c’en est fait.
Jeanne.
Cela ne se peut ! cela ne se peut !
Gérard.
On ajoute que Charles songe à fuir ; qu’il se réfugierait en Espagne.
Jeanne.
Le dauphin désespérerait ! Saints et saintes du ciel, rendez-lui courage ! Que ne suis-je un homme ! Je pourrais endosser une armure, brandir une lance, aller à l’ennemi.
Gérard.
Nous traversons de tristes jours. La France n’est plus qu’un champ de bataille. Dans chaque maison, deuil et pleurs. Vignes, champs, prairies, tout languit, tout périt. À la place du pays qui était le jardin de l’univers, il n’y aura bientôt qu’un cimetière.
Laxart.
Halte-là ! Les Anglais ne sont pas arrivés où ils pensent ! L’oiseau de France, c’est l’alouette : quand on la croit à terre, elle prend son vol en chantant et monte droit au plus haut des airs. N’entendez-vous pas dire que, sur tous les points du royaume, il y a des personnes qui ont des extases ? Quelque chose se prépare. Je me souviens de prophéties anciennes où il était dit : Quand les hommes auront tout perdu, une femme viendra tout sauver.
Le vieil enchanteur Merlin a annoncé que cette femme serait une pucelle. Qui sait si cette pucelle ne sera pas une Lorraine ?
Romée.
Vous dites des folies, compère.
Jeanne, à part.
N’est-ce pas moi, celle qu’on attend ?
Jacques.
Que cela finisse donc ! Henri ou Charles, qu’il n’y ait qu’un maître ! Quel que soit le maître, nous aurons à peiner et à gagner dans la douleur notre pauvre vie. C’est le lot des petits de pâtir pour les grands. Le jeu des batailles est leur amusement ; mais il est notre ruine. Par bonheur, la terre est bonne mère. Après l’hiver, le printemps. Sur les champs saccagés le blé du bon Dieu repoussera. Qu’importe que celui à qui nous devrons payer la taille s’appelle Henri d’Angleterre ou Charles de France ? Il faudra toujours payer.
Jeanne.
Qu’as-tu dit, Jacques ? Quoi ! tu regarderais du même œil le voleur et le maître du logis ? Un roi venu du dehors, un homme qui n’a pas été élevé avec les enfants de notre terre, qui a été nourri sous un autre ciel, qui parle une autre langue, le Henri de ces Goddems, tu l’accepterais ! La France ne serait donc plus aux Français ? Non ! Il ne peut être notre père, celui qui n’est pas de notre sang.
Jacques.
Pourquoi détestes-tu plutôt les Goddems ? Grands d’Angleterre et grands de France, ça se vaut. Ils sont tous bêtes de proie. Les gens d’ici nous font autant de mal que les gens de là-bas. Ils crient aux armes contre l’Anglais ; mais c’est sur nous que tombent les coups. Dès qu’ils paraissent, sauve qui peut ! Ils vont à travers semailles et moissons, frappant, coupant et taillant, mangeant et buvant, et à leurs trousses marche la famine. Maudits ces affameurs qui nous dépouillent pour défrayer leurs belles passes d’armes ! Ils vivent de nous, et nous mourons par eux.
Jeanne.
Tais-toi, Jacques ! tais-toi ! Ne maudis personne. Maudis la guerre !
Gérard.
La guerre ! Nous allons sans doute la connaître de plus près. On annonce la venue de Lahire à Vaucouleurs.
Jeanne, à part.
Lahire à Vaucouleurs ! Le brave Lahire à quelques heures d’ici !
Romée.
Mes enfants, vous oubliez la fête. Il faut se réjouir en l’honneur du bon Dieu qui fait si bien travailler pour nous son soleil. Jeanne, chante-nous une chanson.
Jeanne.
Aucune chanson ne me vient, ma mère.
Romée.
Tu sais bien la chanson du duc d’Orléans ?
Jeanne.
Ce que je sais, c’est que le pauvre duc est aux mains des Anglais.
Mengette.
Chante-nous son rondel, Jeannette. Il est de circonstance :
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie…
Jeanne.
Je ne puis chanter. Mais je vous dirai le cantique de Débora, que j’ai entendu à la veillée. C’est lorsque Dieu confondit les Chananéens, qui avaient envahi le pays d’Israël :
En ces sombres jours, les grandes routes étaient désertes ; les voyageurs suivaient des sentiers détournés ; il n’apparaissait plus de héros en Israël.
Il n’en apparaissait plus, jusqu’au moment où je me suis levée, moi, Débora, moi, la mère d’Israël.
Debout ! debout ! Anime-toi, anime-toi, Débora ! Réveille l’esprit, et mène les bataillons à la victoire !
Le Seigneur a inauguré de nouveaux combats. En avant, lances et boucliers ! Levez-vous, héros d’Israël ; voici l’heure !
Et nos héros ont joué leur vie contre la mort. Et les ennemis d’Israël ont lutté ; mais ils ont lutté en vain. Le ciel combattait contre eux !
Debout ! debout ! Anime-toi, anime-toi, Débora ! Réveille l’esprit, et chante la victoire !
Bénie soit entre les femmes Jaël ! Elle à frappé Sisara, le chef des Chananéens. Elle lui a transpercé et broyé la tête. Il s’est affaissé ; il s’est tordu sous ses pieds ; il est tombé. Là où il s’était tordu, il s’est soulevé, il est retombé ! Il est resté étendu, pâle et sans vie.
Qu’ainsi périssent tous tes ennemis, ô Israël ! Mais toi, mon peuple, resplendis comme le soleil, quand il se lève en sa magnificence !
Laxart.
Voyez comme ses yeux brillent ! Pour sûr, au regard de Jeannette, Jaël c’est elle.
Jeanne.
Jaël est cruelle. Je ne voudrais pas être Jaël ; mais je voudrais bien être Débora !
Jacques.
Elle se fait des idées, notre Jeannette. C’est une visionnaire. Eh ! qu’on nous laisse vivre dans ce coin de terre où nos corps ont poussé comme des plantes au soleil ! Est-ce que le reste nous importe ? C’est à Domrémy que je suis né ; c’est à Domrémy que j’ai vécu ; c’est au sol de Domrémy que je tiens par les entrailles. Tous ces pays que j’ignore et qui m’ignorent ne me sont rien.
Jeanne.
Blasphème ! Tous ces pays et le nôtre sont frères. N’ont-ils pas une mère commune, la France ? Hommes, pouvez-vous penser à vos champs, quand il n’y a pas dans le royaume un pouce de terre qui ne soit menacé ? Femmes, pouvons-nous penser à nos ménages quand l’étranger dépeuple tous les foyers ? Il y a œuvre plus pressante que de faucher nos épis et de faire nos gerbes, c’est d’abattre l’Anglais. Oh ! une seule idée, un seul vouloir, chasser l’étranger ! Tournons contre l’étranger nos faucilles et nos fourches !
Jacques.
Soit ! Que Dieu protège le royaume ! Mais nous, paysans, les pauvres gens de France, nous sommes nés pour pousser la charrue, non pour porter la lance. À chacun sa besogne. En attendant, fêtons le mai et les noces de Mengette. Jouez, flûtes et hautbois. Enfants, à la danse près de la Bonne-Fontaine-aux-Fées-Notre-Seigneur ! Jeannette sera ma danseuse.
Jeanne.
Laisse-moi, méchant Bourguignon.
Scène III
Jeanne, seule.
Mon cœur, oh ! mon cœur, comme il souffre ! comme il est serré d’angoisse ! J’entends là-bas l’appel des trompettes, le grondement des canons, les cris des mourants. Malheur ! Pourquoi suis-je une faible fille ? Je ne puis durer ici, et je n’ose partir. N’est-ce pas un signe de Dieu que cette venue de Lahire à Vaucouleurs ? Domrémy, Vaucouleurs, mère, roi, tout m’attire, tout me retient… Quand donc ne serai-je plus travaillée de sentiments contraires et en guerre avec moi-même ?
Scène IV
Jeanne, Romée.
Romée.
Tu me donnes du tourment, Jeanne ; et pourtant de toi je n’espérais que contentement. Je vois bien que tu as de folles idées en tête.
Jeanne.
Vous méritiez, mère, que je vous rendisse plus heureuse.
Romée.
Mais il n’est meilleure que toi. Laisse seulement tes visions.
Jeanne.
Je ne puis. Que de mal font ces Anglais ! que de pleurs ils feront couler !
Romée.
Les Anglais ! toujours les Anglais ! Tu n’es pas roi de France ; tu n’es pas capitaine. Tu es femme. Eh bien, fais œuvre de femme. Marie-toi, et sers ton pays en ayant de beaux enfants qui seront d’excellents sujets du roi.
Jeanne.
Ne m’en faites pas reproche, mère. Mais le mariage n’est pas ma destinée.
Romée.
Quel avenir rêves-tu donc ?
Jeanne.
Je ne sais.
Romée.
Tu ne sais !… je te le dirai, moi. J’ai démêlé ce qu’il y a au fond de tes songeries perpétuelles sous l’arbre maudit : tu rêves de partir.
Jeanne.
Bonne mère !
Romée.
N’est-ce pas, ma fille, je te garderai ? À quoi me servirait-il d’avoir tant peiné, si tu désertais ce logis dont tu es la joie ? J’ai grand labeur. Mais te voir emporte la peine. Tant que tu es là, tout me rit.
Jeanne.
Comme vous m’aimez !
Romée.
Il faut promettre que tu resteras. Sinon, j’aurai toujours peur. Cette nuit encore, je t’ai vue t’en allant malgré mes cris et mes pleurs.
Jeanne, vivement.
Vous avez rêvé cela, ma mère ?
Romée.
Par ton père qui dort sous la terre ; par la vie que je t’ai donnée ; par les saints et les saintes du paradis, je t’en supplie ; jure que tu ne me quitteras point !
Jeanne.
Ma mère, je vous respecte, je vous aime ; mais je ne puis faire pareil serment.
Romée.
Tu refuses ! C’est donc vrai ! Ma Jeanne, si douce, si pure, irait avec ces truands d’hommes d’armes ! Est-ce la place d’une fille qui a de la vertu ? Fées malfaisantes, vous avez perdu mon enfant !
Jeanne.
Ô ma mère, ne vous irritez point ; ma mère, ayez pitié ! Si je reste, je resterai pour vous servir ; si je pars, je ne partirai que pour revenir vous rapporter mes soins et mon amour.
Romée.
Si jamais tu pars, tu désobéiras à ta mère.
Jeanne.
Pour obéir à Dieu.
Romée.
Prends garde d’abréger ta vie.
Jeanne.
Que Dieu prolonge la vôtre des années qu’il m’ôtera !
Romée.
Ah ! ne parlons pas de ces choses, ma fille ! Tourne ailleurs ta pensée… Viens au mai.
Jeanne.
Pas encore ! pas encore ! Laissez-moi prier.
Romée, les yeux au ciel.
Dieu, sainte Vierge, envoyez-lui de bonnes inspirations !
(Elle part.)
Scène V
Jeanne, seule.
(Au moment où Jeanne et sa mère échangeaient leurs dernières paroles, les cloches ont commencé à sonner l’Angélus de midi. Jeanne s’agenouille. Chant lointain de l’Ave Maria [vieil air lorrain]. La sonnerie des cloches continue. Jeanne se relève et s’assied près de l’arbre des fées.)
Tintez, chantez, cloches aimées à la voix argentine ! Vous pleurez quand trépasse quelqu’un du village ; vous saluez gaiement l’enfant qui naît ; vous célébrez les tendres fiançailles ; vous souhaitez la bienvenue au jour qui se lève et dites adieu au jour qui meurt ; aux grands dimanches, vous fêtez à pleines volées la Vierge et les saints ; les pères de nos pères vous ont entendues, et d’autres vous entendront quand nous serons sous terre ; tintez, chantez, cloches, musiciennes du bon Dieu… Comme cette heure du jour est majestueuse et douce ! Le soleil verse à flots sa lumière. À peine si un léger souffle soulève les feuilles. Tous les bruits se taisent. Il semble que la terre, radieuse et recueillie, écoute parler le ciel !
Voix.
Jeanne !
Jeanne, se redressant vivement.
La voix ! encore la voix qui me parle !
Voix.
Jeanne ! Jeanne !
Jeanne.
Parlez, sainte vision, parlez. Votre servante écoute.
Voix.
Jeanne, Jeanne, que tardes-tu ? Vois la grande pitié qui est au royaume de France ; va t’offrir au roi et délivre le pays !
Jeanne, se répétant à chaque fois, comme en un rêve, les paroles de la voix.
Jeanne, Jeanne, que tardes-tu ? Vois la grande pitié qui est au royaume de France ; va t’offrir au roi et délivre le pays ! — Mais, sire saint Michel, je ne suis qu’une bergerette ; je ne sais ni chevaucher ni guerroyer. Le roi me repoussera.
Voix.
Va, va, va !
Jeanne.
Va, va, va ! — Mais comment pourrai-je quitter ma mère, mon village, mes amies ?
Voix.
Va, va ! Il ne faut pas gémir ; il ne faut pas pleurer ; il faut agir.
Jeanne.
Va, va ! Il ne faut pas gémir ; il ne faut pas pleurer ; il faut agir. — Oui, pourquoi quérir le repos ? Je suis née pour le labeur. Mais de telles actions réclament un homme. Que peut une pauvre fille ?
Voix.
Dieu te veut.
Jeanne, vivement.
Alors me voici !
Voix.
Iras-tu à travers les armes, au milieu des morts ?
Jeanne, avec force.
J’irai.
Voix.
Jeanne, ne t’endors pas en tes désirs. Les bons desseins, sitôt conçus, doivent être accomplis. C’est tout de suite l’heure de bien faire.
Jeanne.
Jeanne, ne t’endors pas en tes désirs. Les bons desseins, sitôt conçus, doivent être accomplis. C’est tout de suite l’heure de bien faire. — Ange de Dieu, je ferai tout à votre commandement. Combien douces et délectables sont vos paroles ! Je les ai bien en révérence et affection. J’inclinais tant aux choses que me mande votre bouche ! Vous m’ouvrez le sens de mes pensées secrètes, et mon cœur s’enflamme à vous ouïr. Vous qui me montrez la route, vous me donnerez la force pour y cheminer hardiment. Gardez que je n’y fasse de faux pas et soutenez toujours votre pauvre servante !… Je n’entends plus rien. Je ne vois plus rien. Mais j’ai bonne assurance ! Les saints du ciel ne trompent pas. Ils sont véritables comme Dieu même1.
(Les chants et la musique du mai se font entendre.)
Scène VI
Jeanne, Mengette.
Mengette.
Jeanne, parais enfin à la fontaine des groseilliers ; viens fêter mes épousailles !
Jeanne, qui est restée à genoux, d’un ton solennel.
Non ; car l’heure est venue d’aller à mes devoirs.
Mengette.
Explique-toi, de grâce.
Jeanne, avec des hésitations.
Mengette, si je ne vais pas au mai, c’est que j’ai mission ailleurs ;… si je me tais, c’est que je voudrais bien parler ailleurs ;… si je laisse mes amis de la terre, c’est que je voudrais rester en la compagnie de mes amis de là-haut…
Mengette.
Pourquoi réponds-tu par énigmes ? Que signifient ces mains jointes, ces regards tournés vers le ciel ? Je suis ton amie. Dis-moi ce que tu vois.
Jeanne.
Hélas ! mes yeux le cherchent encore, et je ne le vois plus. Mais, tout à l’heure, Mengette, j’ai vu l’archange saint Michel. Je l’ai vu comme je te vois. Il me parlait et je lui parlais.
Mengette.
Tu rêves !
Jeanne.
Ah ! que mon rêve ne dure-t-il ? Que ne vois-je toujours saint Michel ? J’ai si grande liesse à sa venue ! Mais son départ me laisse en grande tristesse.
Mengette, ironique.
Et saint Michel te parle du roi, n’est-ce pas ?
Jeanne, mystérieusement.
Oui. Il m’a dit de partir pour Vaucouleurs, d’où je me ferai mener au roi.
Mengette.
Pauvre Jeannette ! ta France te tourne la tête. C’est toi qui donnes une figure et une voix aux songeries de ton esprit. Laisse là tes visions. Tu y échapperais si tu avais comme moi un doux ami. Être aimée, Jeanne, voilà le bonheur ; mais quand on sait aimer.
Jeanne.
Non, Mengette, je ne rêve pas de mettre sur mon front la couronne des épousées… Anglais altérés de sang français, méchants meurtriers de la patrie, c’est contre vous que je dois aller, parmi les mourants et les morts… Plaisante terre où je suis née, à toi je suis fiancée : fais-moi tienne, et donne-moi pour filles des victoires !
Mengette.
Hélas ! ta pensée court après une ombre, quand tu as ici le bonheur sous la main !
Jeanne.
Oui, j’irai ; j’irai, par Notre-Seigneur ; j’irai, dussent mes jambes s’user jusqu’aux genoux !… Adieu, champs où revit mon enfance ; adieu, maisons où me riaient des figures amies ; adieu, bel arbre des fées où je me faisais seule et songeais ; adieu, église dont les saintes images semblaient descendre de leurs cadres pour parler à mon âme ; tendres causeries, douces caresses, rêves de tranquillité et de bonheur, adieu ! Je vais où Dieu m’appelle.
Mengette, la retenant.
Reste, si tu m’aimes !
Jeanne.
Je t’aime plus que moi, mais moins que mon devoir.
Mengette.
Quoi ! malgré ta mère !
Jeanne.
J’irai quand j’aurais cent mères ! (Joignant les mains.) Ô ma mère, pardonnez-moi !… Mengette, tu sécheras ses pleurs… Saints du paradis, envoyez-lui la résignation et envoyez-moi la force !
Mengette.
Mais tu entreprends l’impossible !
Jeanne.
On peut plus que tu ne crois quand on a foi et amour.
Mengette.
Je t’en prie à genoux, n’affronte pas ainsi la souffrance et la mort !
Jeanne.
Souffrir est doux, mourir est doux, quand c’est pour son pays.
Mengette, cessant de la retenir.
Eh bien, Jeanne, va. Je trouve dans ton fait témérité et folie. Mais tu es en vérité bonne et grande. L’admiration de tous t’accompagnera.
Jeanne.
Que les anges de Dieu m’accompagnent !
(Elle part.)
Second tableau À Vaucouleurs. — L’épreuve.
Salle de la capitainerie.
Scène première
Baudricourt, Jean de Metz, chevaliers.
Baudricourt.
Eh bien, Jean de Metz, nous apprenez-vous enfin l’arrivée de Lahire ?
Jean de Metz.
Hélas ! messire, tout va de mal en pis. Lahire a été surpris, près d’Auxerre, par un parti de Bourguignons. Il est mort ou prisonnier ; et mort ou prisonnier comme lui doit être l’archevêque-chancelier qui l’accompagnait.
Baudricourt.
Maudits Bourguignons !
Jean de Metz.
Maudissez-vous plutôt vous-même ! Que n’avez-vous fait accueil à la bergerette Jeanne ? En frappant Lahire, Dieu vous punit de l’avoir rejetée.
Baudricourt.
Tu es fou !
Jean de Metz.
Pas plus que le bon peuple qui la plaint et l’admire.
Baudricourt.
Elle n’est donc pas repartie ? Je vais la faire ramener à ses parents avec recommandation de lui administrer quelques bons soufflets, à moins que la sainte Inquisition ne lui mette la main dessus comme sorcière.
Jean de Metz.
Écoutez-la plutôt.
Baudricourt.
Encore une femme dans nos affaires ! Merci. C’est assez de cette Agnès qu’on appelle la dame de Beauté, et que, moi, j’appelle la dame de Malheur ; car elle fascine notre roi, absorbe toute l’ardeur de ses vingt ans et l’endort dans ses bras2. C’est assez de la reine Isabeau, une scélérate qui, tour à tour maîtresse de Louis d’Orléans et de Jean de Bourgogne, venge sur la France le meurtre de ses amants, tend la main à l’Anglais, mène son fils à la perdition et le royaume à la ruine. Pas besoin d’une Dalila qui, sous couleur de visions, vienne leurrer notre bonne foi et briser la force de nos gens de guerre. Princesse ou paysanne, la femme est toujours la fille d’Ève, légère, volage, lascive, fausse, brouillant tout, perdant tout. Elle aveugle ; elle énerve ; elle affole. Le venin de l’aspic est moins redoutable. Au diable la femme !
Scène II
Les mêmes, Frère Richard.
Baudricourt, à frère Richard, qui entre.
N’est-ce pas, frère Richard, qu’on se rirait de moi si j’écoutais la pastourelle le Domrémy ?
Jean de Metz.
Soit ! J’en appelle volontiers du capitaine au franciscain… Ô vous qui courez a France en prêchant la bonne parole aux petits et aux humbles, ne pensez-vous pas que, pour confondre l’orgueil des grands, Dieu a pu faire son messie de la bergère Jeanne ?
Frère Richard.
Qu’il l’ait pu, je le crois : qu’il l’ait voulu, je le nie. On ne rencontre aujourd’hui que visionnaires. Visionnaire aussi votre Jeanne ! La folie du feu roi a gagné ce peuple. Les coups de la démence se joignent aux coups de la défaite pour nous punir de nos péchés… Partout mauvais vices, parjures, voleries, meurtres. Cela criait vengeance. Qui a bu à la coupe des iniquités doit boire à la coupe des colères. De longue date, Dieu avait amassé ses foudres. L’éclair a brillé ; le tonnerre a éclaté. Français coupables, prosternez-vous et priez !
Jean de Metz.
Comment Dieu ne mettrait-il pas enfin un terme à nos malheurs ?
Frère Richard.
Nos malheurs sont bien grands, mais moindres que nos crimes.
Jean de Metz.
Alors, bon frère, il faut désespérer ? Nous deviendrons Anglais ?
Frère Richard.
Les Français faits Anglais ! Non ; pas cela : ce serait le cours des choses humaines changé. Vous ne le voudrez pas, ô mon Dieu ! Nos pères n’ont-ils pas été sur tous les champs de bataille les soldats du sacrifice ? Non, non ; il ne passera pas aux mains de l’étranger, l’héritage sacré des Clovis et des Charlemagne !
Jean de Metz.
Puisque vous avez si bonne confiance, frère Richard, marquez-nous donc les moyens de nous sauver.
Frère Richard.
Reprenez les vertus de vos pères, et vous retrouverez leurs victoires. Il faut des coups d’aiguillon aux bœufs pour qu’ils tirent voitures et chars hors des fondrières. Ainsi faut-il à ce peuple de douloureuses épreuves pour qu’il sorte de la mare de boue et de sang où l’ont mis ses péchés. Le grain, jeté en terre, y pourrit, puis monte en épis. De même la France : elle semble mourir ; c’est pour renaître plus belle… N’a-t-elle pas sa mission à travers les âges ? Là-bas, la chrétienté gémit. Apparais, saint Louis ! pars avec tes légions de preux ; éblouis l’Orient de ta magnanimité, et fais planer tes chevaliers, comme des dieux, sur l’Afrique étonnée… Les barbares s’agitent. Montre toi, Charlemagne ! prends dans tes fortes mains le sceptre des Césars, et fais sortir du chaos un grand empire… Les multitudes sarrasines se précipitent. Debout, Charles Martel ! arrache au joug du turban la France et l’Europe… Les hordes d’Attila vont entrer dans Paris et étouffer la France au berceau. Quitte les bords de la Seine où tu pais tes troupeaux, Geneviève ! sois l’ange de la patrie et arrête l’envahisseur… Méritons le salut ; il viendra à son heure.
Scène III
Les mêmes, Jeanne.
Jeanne, entrant.
L’heure du salut est venue. J’ai quitté les bords de la Meuse où je paissais mes troupeaux, et je dois arrêter l’envahisseur.
Frère Richard.
Sacrilège ! Qu’y a-t-il de commun entre les arrêts du Ciel et tes folles visées ? Tant s’en faut, hélas ! que la mesure de nos maux soit comble. Dieu même te dément. Quand tu parles de délivrance, il fait mourir Lahire.
Jeanne.
Cela ne peut être ; cela n’est pas.
Jean de Metz.
S’il n’est mort, il est prisonnier.
Jeanne.
Ni mort, ni prisonnier ! Lahire est vivant ; Lahire est libre. Il vient. Il est là.
Scène IV
Les mêmes, Lahire, l’Archevêque.
Lahire.
Sire de Baudricourt, salut !
Baudricourt.
Vous êtes donc sauvé, Lahire ?
Lahire.
Que n’ai-je sauvé aussi mes hommes ! Mais je n’ai pu arracher que l’archevêque-chancelier aux griffes de ces satanés Bourguignons.
Jeanne.
Noble Lahire, écoutez-moi.
Lahire.
Jarnidieu ! la charmante fille !… Que vous faut-il, mamie ?
Jeanne.
Il faut qu’au plus tôt j’aille avec les hommes d’armes donner secours au roi, contre ces déloyaux Anglais, pires que Turcs et Sarrasins.
Lahire.
Quoi ! une fillette qui doit avoir peur de son ombre prétend aller en guerre ? Retourne à ton logis, mignonne. Nous n’avons que faire de femmelettes.
Jeanne.
Messire, il le faut.
L’archevêque.
Allons donc ! Tu es faite pour manier l’aiguille, non pour tenir la lance. Comment s’allumerait l’audace guerrière dans cet œil si doux ?
Jeanne.
Quand c’est son bon plaisir, Dieu donne à la colombe la hardiesse de l’aigle.
Lahire.
Il ne se fait plus de miracles.
Jeanne.
Il s’en fera encore, tant qu’il y aura des injustices à réparer, des vainqueurs à humilier, des vaincus à venger.
Lahire.
Quelle animation ! Tu me plais, bergerette. Mais nos luttes ne sont pas ton affaire. Tu es destinée à de gentils combats qui ne se livrent pas sur le champ de bataille. J’aimerais fort jouter avec toi.
Jeanne.
Messire, joutez avec l’Anglais, à qui vous avez souvent frotté les oreilles… Le regard qui me convoite m’insulte.
Lahire.
Fille étrange ! Elle m’impose respect.
Frère Richard.
Il y a là-dessous du démon ou de l’ange !
L’archevêque, pensif.
Qui sait ?
Scène V
Les mêmes, l’inquisiteur, le curé Fournier.
L’inquisiteur.
Messeigneurs, moi frère Martin Billorini, inquisiteur du mal hérétique au pays de France, je me présente à vous, instruit par le bruit populaire et mandé par messire Jean Fournier, curé de Vaucouleurs, ici présent. J’ai mission d’interroger une nommée Jeanne, suspecte de se donner comme messagère de Dieu par égarement d’esprit ou inspiration du diable. Veuillez présider à cet examen, monseigneur le chancelier.
L’archevêque.
Volontiers. Mettez-vous à ma droite, sire inquisiteur ; vous, moine et curé, serez nos acolytes. Or çà, Jeanne, approche, qu’on t’interroge.
Jeanne.
Allons, de par Dieu !… Saints du Ciel, secourez-moi !
L’archevêque.
Qui es-tu ?
Jeanne.
Fille de pauvres laboureurs, loyaux et bons Français.
L’archevêque.
Pourquoi as-tu quitté ta mère ?
Jeanne.
Pour obéir à Dieu, notre père, qui a autorité par dessus tous.
L’inquisiteur.
C’est faute grave d’abandonner sa mère.
Jeanne.
J’ai lavé ma faute dans mes larmes et je la laverai encore mieux dans le sang des Anglais.
Frère Richard.
Que prétendez-vous donc faire ?
Jeanne.
Mettre hors de peine les pauvres gens qui sont assiégés à Orléans ; renvoyer l’étranger outre-mer, et aller à Reims faire sacrer le roi en grande dévotion.
L’inquisiteur.
Si Dieu veut abattre l’Anglais, il n’a que faire d’un secours humain.
Jeanne.
Les preux batailleront ; Dieu donnera victoire.
Frère Richard.
Bien dit ! L’homme fait les efforts, et Dieu fait le succès.
L’archevêque.
Du moins, Dieu peut-il se passer de toi.
Jeanne.
Dieu le peut ;mais il lui plaît autrement. J’ai mission d’être son bon chevalier.
Le curé.
Vous ne pouvez aller, fille, au milieu des hommes.
Jeanne.
Qu’ai-je à craindre, quand je fais le vouloir de Dieu ?
L’archevêque.
Ne compte pas, fillette, sur le respect des soudards.
Jeanne.
Je mériterai qu’ils me respectent, et ils me respecteront.
Lahire.
La brave fille !
Le curé.
Jeanne, vous montrez beaucoup de suffisance ; rappelez-vous que vous êtes devant des théologiens, qui ont étudié dans tous les livres.
Jeanne.
Messire Dieu a un livre où nul clerc n’a jamais lu aussi bon clerc soit-il.
L’inquisiteur.
Vous prétendez avoir lu dans le livre de Dieu ?
Jeanne.
J’ai entendu des voix qui venaient de Dieu.
Le curé, avec son accent limousin.
Diableries que tout cela. Quelle langue parlaient vos voix ?
Jeanne.
Une langue meilleure que la vôtre.
L’inquisiteur.
Jureriez-vous que vous n’êtes pas sorcière ?
Jeanne.
Je ne jure pas. J’ai été apprise à parler simplement. Je, dis : C’est vrai
quand c’est vrai ; c’est faux
quand c’est faux. Or, je vous dis : Il est faux que je sois sorcière. Il est vrai que je me sens soutenue par une force d’en haut. Ah ! que ne voyez-vous dans mon cœur comme dans un miroir ! Je vous parle aussi sincèrement que je parle à Dieu quand je fais ma prière.
L’archevêque.
Et quelle prière fais-tu à Dieu ?
Jeanne.
Je dis Notre Père et Je vous salue, que ma mère m’a appris. Puis j’ajoute : Mon bon Seigneur, venez en aide au roi et à la France !
Lahire.
Brave fille !
L’inquisiteur.
Si Dieu voulait qu’on vous crût, il vous donnerait le moyen de le manifester par des signes.
Jeanne.
Que j’aille à Orléans, et je vous donnerai des signes les armes à la main !
Frère Richard.
Voilà qui est parler !
Lahire.
Jarnidieu ! la petite me plaît.
Jeanne.
Ah ! si je vous plais, menez-moi au roi, seigneur Lahire. Je suis lasse de combattre les docteurs ; je demande à combattre les Anglais.
Le curé.
Si nous étions sûrs…
Jeanne.
Vous doutez ! Croyez aujourd’hui. Vos yeux verront demain.
Jean de Metz.
Des prophéties annoncent bien qu’il viendra une pucelle…
L’archevêque.
Elles annoncent aussi que cette pucelle mourra de male mort.
Jeanne.
Ah ! que je meure et que la France soit sauve !
Frère Richard.
Noble fille, la grâce est sur toi. Que prétendrait ici l’orgueilleuse raison ? Elle n’a qu’à se taire quand un cœur parle avec de tels accents. On cherche des miracles. Le miracle, c’est ta parole inspirée, ton âme illuminée d’une clarté d’en haut ! En conscience, je le déclare, il y a dans cette fille un rayon du paradis.
Baudricourt.
Vous ne parliez pas ainsi tout à l’heure.
Frère Richard.
Mes yeux étaient fermés : ils se sont ouverts.
L’inquisiteur.
Allons donc, cette fille est possédée.
Frère Richard.
Oui, de l’esprit de Dieu.
L’inquisiteur.
Pourquoi Dieu serait-il allé choisir une paysanne derrière ses moutons ?
Jean de Metz, enthousiaste.
Parce que cette paysanne a un cœur royal ; que les larmes de sa bonté ont coulé comme une rosée du ciel sur toutes les souffrances ; qu’elle a été secourable au pauvre qui avait faim et soif ; qu’elle a abandonné sa couche au fugitif sans asile ; qu’elle s’est tendrement assise au chevet des malades ; qu’elle a été la sœur de tous les orphelins ; qu’elle a aimé la France comme une fille sa mère.
Frère Richard.
Que ne peut une vierge ? Où n’entrent pas les terrestres amours, là descendent les révélations célestes. Jeanne, devant ton pudique regard, le buisson du Sinaï s’est allumé. Comme la vierge de Judée porta en son sein le salut de l’humanité, toi, vierge de Lorraine, tu portes en ton cœur le salut de la France !
Le curé.
Tout cela est grande matière à controverses. Je voudrais bien l’interroger sur des points de théologie, démêler au juste ce qu’elle croit.
Frère Richard.
Qu’elle croie ce qu’elle voudra et sauve la patrie3 !
L’inquisiteur.
C’en est trop ! Moine, vos propos sont soufflés par Satan, et c’est Satan qui a suscité cette fille. Belle, sa beauté m’effraye. Belle aussi était celle qui écouta le serpent. Eh quoi ! une gardeuse de bêtes prétend communiquer avec Dieu sans l’intermédiaire du prêtre ! D’où a-t-elle pris sa mission ? Quelle autorité a-t-elle consultée ? Par la sainte messe ! adhérer à cette fille, c’est adhérer au diable. De toutes les forces de ma foi, je la réprouve.
Lahire.
Jarnidieu ! peut-on entendre…
L’archevêque.
Lahire, laissez les hommes d’Église juger ce qui ressort de l’Église… Cette pucelle est trop honnête pour que je l’estime fille du diable. Je ne prononce pas non plus qu’elle soit fille de Dieu. Mais elle a vaillant propos et peut servir monseigneur le dauphin en sa juste querelle. Toute impression ébranle fortement les gens de France. Vaincus, ils imaginent tout désespéré. Victorieux, ils imaginent tout aplani. Que du cœur de cette paysanne l’espoir passe au cour de tous ! Ils seront enflammés, et, croyant au triomphe, ils l’auront.
Le curé.
Je pense comme le seigneur cardinal.
Lahire, joyeux.
Et de trois !
L’archevêque.
Or donc, nous déclarons que, vu l’urgente nécessité où on est, Jeanne doit être menée au roi.
L’inquisiteur.
Je n’ai plus affaire ici, puisque Satan y a le dessus… Devant la croix, à la lueur des cierges bénits, je tonnerai contre les sortilèges de cette fille, et j’en appellerai de vous à Dieu. Anathème sur l’hérétique et sur les fauteurs de l’hérésie !
(Il sort.)
Scène VI
Les mêmes moins l’inquisiteur.
Jeanne, se jetant aux pieds de frère Richard et de l’archevêque.
Soyez bénis de Dieu et bénissez-moi !
Frère Richard.
Vous êtes ici pour apporter la bénédiction, et non pour la recevoir. Soyez pourtant bénie ! Béni soit l’éternel justicier dont le bras s’étend pour sauver les uns et perdre les autres. Comme l’éclair dans un ciel serein, elle luit dans ce pur visage de jeune fille, la foudre de Dieu, la foudre vengeresse par qui l’envahisseur sera exterminé.
Jeanne.
Et maintenant, chez le roi !
Lahire.
Je vous y mènerai à mon retour de Nancy.
Jeanne.
Y a-t-il donc à Nancy Anglais et Bourguignons à combattre ?
Lahire.
Non. Mais il y a le duc Philippe de Bourgogne, venu, ainsi que Richemont et autres seigneurs, aux fêtes du duc de Lorraine. Le chancelier et moi avons mission de le voir en ce pays neutre ; d’adoucir ses ressentiments du meurtre de son père le duc Jean, tué à Montereau par les gens du dauphin, et de le détacher, si possible, des Anglais.
L’archevêque.
Que le duc Philippe nous revînt, voilà véritablement ce qui serait le salut, Jeanne.
Jeanne, avec force.
Tôt ou tard, il faudra bien que le duc Philippe revienne à son vrai seigneur… Mais, messire, en même temps que lui, n’entreprendrez-vous pas de ramener le bon connétable de Richemont, que le dauphin a chassé, ce dit-on, pour complaire à de mauvais courtisans ? Il est, lui-aussi, enfant de France. On doit tous se donner la main contre l’étranger.
L’archevêque.
S’il consentait à revenir, notre sire Charles ne consentirait pas à le recevoir.
Jeanne.
Le dauphin le recevra. Ayez là-dessus fiance entière.
Lahire.
Soit ; nous verrons le connétable.
Jeanne.
Mais moi je ne saurais durer ici. La fièvre me brûle.
Lahire.
Quand donc voulez-vous partir ?
Jeanne.
Aujourd’hui plutôt que demain, demain plutôt qu’après.
Jean de Metz.
Mamie, je vous emmènerai.
Frère Richard.
Moi aussi. Où vous irez, Jeanne, j’irai.
Lahire.
Eh ! eh ! frère Richard, je vais être jaloux. Ne savez-vous pas que je me réserve Jeanne pour bonne amie ?
Jeanne.
C’est trop d’affaires. Mais je serai, si vous voulez, votre frère d’armes, et vous accompagnerai comme le petit cadet son aîné. Çà, hâtez notre départ, frère Lahire.
Baudricourt.
Mais c’est folie ! Pour aller à Chinon, près du roi, il y a à traverser des pays où Anglais et Bourguignons gardent tous les passages. Vous vous ferez prendre et pendre.
Jeanne.
N’ayez souci. En nom Dieu, nous échapperons à tout mal.
Lahire.
Pauvre Jeanne, il vous faudra suivre des sentiers perdus.
Jeanne.
Nous les suivrons.
Lahire.
Passer par monts et ravins.
Jeanne.
Nous passerons.
Lahire.
Franchir à gué des rivières.
Jeanne.
Nous les franchirons.
Baudricourt.
Quelle assurance ! Vous devrez en rabattre, fillette.
Jeanne.
Dieu, qui m’a donné la volonté d’entreprendre, me donnera la force d’aboutir.
Baudricourt.
Enfin advienne que pourra ! Vous partirez demain. On va vous équiper.
Jean de Metz.
Le bon peuple, qui a foi en elle, a déjà pourvu à son équipement.
L’archevêque.
Gare les femmes et les hommes de la cour, encore plus que les Bourguignons !
Jean de Metz.
Que d’ennemis sur notre chemin !
Jeanne.
Dieu y est aussi.
Le curé.
Pauvre fille !
Jeanne.
Ne me plaignez pas. Je vais faire ce pour quoi je suis née4.
Acte premier
À Chinon. — L’adoption.
Salle des fêtes.
Scène première
Charles, La Trémouille, le page, gentilshommes.
Charles, jouant aux tarots.
Mon jeu devient bon.
Le page.
Ici votre jeu s’arrange… Il s’est terriblement gâté ailleurs.
Charles.
Tu m’ennuies, petit page… Duc, je me moque de vos cavaliers et de vos reines. J’ai la main pleine d’atouts. Atout ! atout ! Je gagne encore.
Le page.
Vous gagnez dix ducats ; vous perdez un royaume.
Charles.
Page, je te tirerai les oreilles… Au diable les tarots ! C’est un amusement fade. Faites approcher un jongleur… (Le jongleur exécute des tours.) Ces jongleurs, c’est toujours la même chose ! Amenez une morisque… (La morisque danse.) Cette danse est trop vive. Il faudrait une danse qui me berce… Mais non. J’en ai assez de la ballerine. Rapportez les tarots.
Le page.
Sire, monseigneur Dunois vient d’arriver, bride abattue. Il demande à vous voir.
Charles.
Dunois ! J’ai peur… Dis qu’il attende… Non, introduis-le… Que va-t-il m’apprendre ?
Scène II
Les mêmes, Dunois.
Dunois.
Sire, sire !
Charles.
Qu’y a-t-il ? Ton accent annonce un malheur.
Dunois.
Mon accent trompe s’il n’annonce qu’un malheur. Les malheurs sont nombreux. Dieu veuille qu’ils ne soient pas irréparables !
Charles.
Que dis-tu ?
Dunois.
L’Anglais vient de nous battre encore. La Champagne est perdue ; la Guyenne est perdue ; la Normandie est perdue ; Poitiers est perdu ; Orléans va l’être. L’ennemi sera ici demain. C’est fait de nous !
Charles.
Les déplaisantes choses !
Dunois.
Sire, les mauvaises nouvelles vous importunent ; mieux vaudrait qu’elles vous profitassent.
Charles.
Quelqu’un a trahi, n’est-ce pas ?
Dunois.
Tous vos hommes sont fidèles. Pour vous défendre, les meilleures épées de la chevalerie se sont donné rendez-vous. Mais il en manque une.
Charles.
Laquelle ?
Dunois.
La vôtre !
Charles.
Que faire ? Il n’y a qu’à se résigner.
Dunois.
Vraiment ! Vous trouvez bon de jouer aux tarots avec des muguets de cour, et vous vous désintéressez de la partie sanglante que nous jouons avec l’Anglais, quand l’enjeu de cette partie est votre couronne ! J’admire votre force d’âme. Vous êtes héroïque. Mais c’est d’autre façon qu’étaient héroïques les Philippe Auguste et les saint Louis.
Charles.
Eh ! cousin Dunois, manger, boire, aimer, se divertir, c’est la vie. Que chacun en fit autant, cela ne coûterait aucune larme.
Dunois.
Certes, jamais roi ne perdit plus gaiement son royaume… Ah ! sire, je vous en supplie, au nom de vos serviteurs gisant aux champs de Verneuil, de Cravant, de Rouvray, et attendant vengeance, pensez à l’Anglais !
Charles, après un silence.
Nous verrons plus tard.
Dunois.
Plus tard ! Et aujourd’hui la défaite pour vos armées ; la mort pour vos capitaines ; la honte pour vous ; la ruine pour la France !
Charles.
Tu t’exaltes, cousin ; calme-toi… Apportez une coupe ; emplissez-la jusqu’au bord et offrez-la à notre cher Dunois… (D’un ton découragé.) Nous boirons à la victoire.
Dunois.
Arrière cette coupe ! Je ne viens pas ici pour banqueter ; je viens pour savoir si dans l’enfant d’hier on peut trouver un homme.
Charles.
Hélas ! que Dieu ait pitié de nous !
Dunois.
Ayez vous-même pitié de vous-même, et agissez.
Charles.
Ne dois-je pas plutôt arrêter l’hécatombe ? N’ai-je pas trop coûté déjà à ce pays ? Je désespère, Dunois.
Dunois.
Le désespoir n’est beau que quand il est vaillant et demande à la mort l’honneur ou le salut. Honte à qui n’oppose pas au malheur un cœur plus grand que lui ! Quels combats avez-vous livrés ? Quels périls avez-vous bravés ? Quel sang avez-vous versé ? Sire, un roi se montre ; un roi préfère son peuple à ses plaisirs ; un roi sauve son royaume ou s’ensevelit glorieux sous ses débris !
Charles.
Eh bien, mon bon La Trémouille ?…
La Trémouille.
Sire, il faut parlementer avec l’Anglais. Il faut lui donner… de bonnes promesses… qu’on ne tiendra pas.
Dunois.
Il y a mieux à faire : organiser une belle chevauchée, prendre des rameaux d’olivier, et aller supplier Talbot et le duc de Bourgogne de vouloir bien laisser vivre, dépouillé de son trône et de ses biens, monseigneur Charles, comte de Ponthieu.
Charles.
Tu railles, Dunois, et tout à l’heure tu invectivais… Qui te rend si audacieux ?
Dunois.
Mon amour pour vous et pour le pays… Faire ce qu’on vous propose, c’est prolonger l’agonie ; ce n’est pas éviter la mort. À cheval, sire ! Venez remplir votre office de roi, qui est d’être le premier soldat de France.
Charles.
Pourquoi faut-il que j’aie à établir mon droit par la force ?
Dunois.
Ah ! vous n’êtes pas vrai roi, puisque de tels coups de tonnerre ne vous réveillent pas… Voici mon épée, que j’ai plus employée à votre défense qu’à la mienne. Prenez-la ! Vous m’ôtez le droit de m’en servir pour vous, par le plus lâche abandon de vous-même… Mais non ; je la garde. Je mourrai en combattant pour la France. Bienvenue la mort qui m’exemptera d’avoir à pleurer votre honte !
Charles.
Que fais-tu, Dunois ?
Dunois.
Mon roi tourne le dos à l’honneur ; je tourne le dos à mon roi.
(Il part.)
Charles, à La Trémouille et aux seigneurs.
Laissez-moi seul et faites venir Agnès.
Scène III
Charles, seul.
Ainsi les meilleurs m’abandonnent. Quel poids que la majesté royale ! Régner, n’est-ce pas servir ? Régner… Mais je ne règne pas ; j’ai à gagner mon royaume… Et ce royaume est-il mien ? Né d’Isabeau… (Avec un accent de profonde pitié et de désespoir.) quelle mère !… suis-je bien l’héritier du feu roi ? Ne suis-je pas le fils de l’adultère ?… Ah ! la voilà, la crainte qui me torture, que je ne confie à personne, dont je tâche de m’étourdir, toujours avide, toujours lassé de plaisirs ! (S’agenouillant.) Pitié, mon Dieu ! Si je suis vrai roi, assurez-moi le trône ! Si j’usurpe, signifiez-le-moi ! La vie où je languis est horrible ; et, plus tristes que mes jours, mes nuits sont faites de rêves effrayants… Le feu roi était fou. Son mal ne m’a-t-il pas gagné ? La lèpre fatale développée dans son sang n’est-elle pas passée dans le mien ? Mais alors ce que je crois être ne serait pas ? Ah ! plût au Ciel que ce spectacle de la France agonisante ne fût qu’un mirage de ma folie !… On vient… (Il se relève.) Pauvre fantôme de roi, remets un masque sur ton visage et un sceau sur ton âme !…
Scène IV
Charles, Agnès.
Charles.
Enfin !
Agnès.
Sire, je me faisais belle pour vous plaire.
Charles.
Qu’as-tu besoin de t’embellir ? C’est toi qui embellis ta parure. Laisse tes cheveux d’or frissonner sous mes doigts ; laisse-moi te regarder. La caresse de tes yeux est si douce !
Agnès.
Charles, je te dois le bonheur. Que n’ai-je des royaumes à te donner en échange ! Je voudrais que tu fusses un laboureur, et moi la souveraine du monde. Je mettrais mon sceptre à tes pieds.
Charles.
Les couronnes ne sont que des hochets. Le meilleur emploi de la vie est de faire ce que je fais maintenant. (Il l’embrasse.) Mon royaume pour un baiser d’Agnès !
Agnès.
Vous avez mon cour ; et vous aurez votre royaume.
Charles.
Agnès, je n’étais pas fait pour un tel temps et pour une telle œuvre. Il me fallait une époque de paix, une royauté de fêtes et d’amour.
Agnès.
Réjouissez-vous donc et aimez ; vos capitaines vaincront pour vous.
Charles.
Ils ne savent que mourir ; et, lâche, je n’ai pas le cœur de mourir avec eux… Arrière, arrière, pensées lugubres ! Belle Agnès, entoure-moi de tes bras, et que j’oublie !… Mais non ; j’ai toujours devant les yeux Dunois : lui si grand, moi si petit ! S’il avait pu sentir ce que cache de tristesse mon indifférence ! Je suis insupportable à moi-même. Je n’ai de repos que dans tes caresses, et quelquefois tes caresses me font peur… Agnès, tu pleures !
Agnès.
Je pleure le malheur de mon prince.
Charles.
Pleure le malheur de ce pays auquel je suis fatal ! Mon père était maudit ; et il est mort fou. Son frère était maudit ; et il est mort assassiné. Je suis maudit aussi. N’est-ce pas par ma faute que tout ce peuple pâtit ? Ô Dieu ! adressez votre colère là seulement où est la malédiction ! Frappez-moi seul, et que la France vive !
Scène V
Les mêmes, Dunois.
Dunois.
La France vivra, et vous régnerez !
Charles.
Cher Dunois !
Dunois.
Sire, c’est un miracle qui me ramène. Je partais, sentant gronder encore l’indignation en mon âme, quand, sur ma route, s’est présentée une jeune fille. Elle était entourée de pauvres gens qui la regardaient avec des yeux amis. Elle se jette à mes pieds et me dit : Beau sire Dunois, arrêtez !
Malgré moi, je la regarde. Son air pur et candide me frappe… Qui êtes-vous ? — Je suis une pauvre fille qui voudrait empêcher que nous devenions Anglais. — Eh ! que pouvez-vous ? — Beaucoup, avec l’aide du Ciel. Il y a plusieurs jours que je suis ici, cherchant à voir le dauphin. Mais il n’a souci de moi. Et pourtant il faut que j’aille à lui. Mon Seigneur le veut. — Quel seigneur ? — Dieu.
Je suis étonné ; je ne sais quel charme me domine. En même temps, la jeune fille me remet un message de Lahire, qui l’a vue et qui l’appelle un prodige du ciel. J’ai pris ses mains dans mes mains en lui disant : Vous verrez le dauphin.
— Recevez-la !
Agnès.
Comment est cette fille ? Elle a sans doute la figure ascétique d’une visionnaire ?
Dunois.
Point. L’œil est vif, les joues roses, les cheveux noirs. C’est une paysanne de gaillarde allure. La bonté est sur son visage, et dans son regard l’enthousiasme rayonne.
Agnès.
Laissez-la ! Une fille inconnue…
Dunois.
Elle se fera connaître.
Charles.
Où les Dunois et les Lahire ont échoué, une paysanne ne réussira pas.
Dunois.
Elle réussira !… Sire, accueillez l’ange du salut.
Agnès.
À quoi bon ?
Charles.
Nous écouterions bien un oiselet chanter…
Dunois.
Elle est là.
Charles.
Page, qu’on amène la jeune fille.
Agnès.
Cher sire, ne serait-il pas sage de l’éprouver ? Que le sire de La Trémouille revête votre costume et prenne votre place : vous verrez si elle vous reconnaîtra. Pendant que vous vous déguisez, je vais la recevoir.
Charles.
C’est votre plaisir : soit ! Venez, Dunois.
Scène VI
Agnès, Jeanne, Jean de Metz, frère Richard.
Frère Richard, à part.
Voici la vierge sage devant la fille folle. Grand Dieu ! que va-t-il advenir ?
Jean de Metz.
Madame, nous amenons au roi une fille qui nous inspire grande révérence et foi entière. Elle a traversé en onze jours cent cinquante lieues, par des contrées où l’ennemi promène le fer et le feu. À tous moments nous étions sur le point d’être pris. Mais elle ne craignait rien, et disait : Allons !
Quand vous la connaîtrez, vous l’aimerez, tant elle est plaisante en dits et en faits. Qui est près d’elle se sent près de Dieu ; et pour lui la terre se fait paradis !
Agnès, à part.
Quel charme a donc cette fille ? Son regard me frappe et me captive… (Haut.) Bergerette, que veux-tu ?
Jeanne.
Voir notre sire, le dauphin.
Agnès.
Explique tes intentions. Je suis Agnès.
Jeanne.
Agnès Sorel !
Agnès.
Comme tu dis mon nom !
Jeanne.
Avec horreur pour vos œuvres et pitié pour vous. Ce nom, comme celui de madame Isabeau, est mêlé à tous nos malheurs.
Agnès.
Voilà un langage nouveau à mes oreilles ! Pourquoi m’en veux-tu ?
Jeanne.
Parce que c’est vous qui livrez le pays à l’étranger en tenant le dauphin sous votre bon plaisir.
Agnès.
Tu voudrais que je l’envoie à la mort ?
Jeanne.
Je veux qu’il aille à la victoire. Mais vous êtes le premier ennemi qu’il doit vaincre avant de vaincre l’Anglais.
Agnès.
Charles ne saurait m’effacer de son cœur.
Jeanne.
Il faudra bien qu’il vous en efface pour y mettre la France.
Agnès.
Et tu veux que je t’aide ?
Jeanne.
Non, certes. Qu’y a-t-il de commun entre vous et moi ? Nos voies ne sont pas les mêmes. Encore plus que l’Anglais, j’abhorre le péché. Votre main tendue m’effrayerait ; je préfère à votre appui votre colère. Vous n’aurez de moi que reproche ou silence, vous qui perdez le roi, et qui, avec vos diamants, portez au cou la solde de milliers d’hommes d’armes… Laissez-moi aller mon chemin, et que Dieu vous assiste !
Agnès, très émue.
De quel esprit, fille, es-tu donc animée ? Tu m’injuries, et je ne puis le haïr… Qui sait ?… Ne viens-tu pas sauver celui que j’aime ?
Le page, annonçant.
Le roi !
(Entrent La Trémouille, sous le costume du dauphin, et plusieurs seigneurs auxquels le dauphin s’est mêlé. Agnès fait un premier mouvement vers le dauphin, puis se rend auprès de La Trémouille, comme s’il était le roi.)
Scène VII
Jeanne, La Trémouille, assis à la place du roi, Agnès, à ses côtés, seigneurs de la cour, Charles.
Jeanne, les yeux au ciel.
Saints et saintes, mes bons amis du Paradis, inclinez vers moi votre gracieux visage et soufflez de bonnes paroles à votre pauvre servante.
La Trémouille.
C’est toi qui me demandes ?
Jeanne.
Vous n’êtes pas notre sire. Voici mon roi et le vôtre !
Charles.
Je ne suis pas le roi.
Jeanne.
Gentil sire, c’est vous et non un autre qui êtes le dauphin, vrai roi de France. Dieu vous donne vie et honneur !
Charles, à Agnès.
Elle m’a reconnu. C’est étrange.
Agnès.
Oui, bien étrange.
(Pendant toute la scène, Agnès tient les yeux fixés sur Jeanne et se montre de plus en plus saisie.)
La Trémouille, au dauphin.
De quoi vous étonnez-vous ? Elle aura vu votre portrait sur quelque médaille.
Charles, à Jeanne.
Que veux-tu ?
Jeanne.
Vous servir. Je vous apporte meilleur secours que de roi ou de capitaine : le secours de Dieu.
Charles, ironique.
Vraiment !
Jeanne.
Croyez-moi, sire ; Dieu a pitié de vous et de votre peuple, tant l’ont prié saint Louis et saint Charlemagne agenouillés devant lui !
Charles.
Qui es-tu, toi qui parles ainsi ?
Jeanne.
Je ne suis qu’une pauvre paysanne qui ne sait ni A ni B ; mais, sous les armes, je serai votre servante, et Dieu sera votre salut.
La Trémouille.
Quel est ton but ? Veux-tu donc devenir duc, comte, baron ?
Jeanne.
Je ne demande qu’à redevenir bergère en mon village, une fois l’Anglais chassé.
Charles.
Femme, tu ne saurais guerroyer.
Jeanne.
J’aurai le cœur d’un homme. Jugez-moi par mes faits, et non point par mon sexe. On éprouve l’or à la fournaise ; vous m’éprouverez au combat. En nom Dieu, Orléans sera délivré ; je vous mènerai à Reims pour votre digne sacre ; et en France il ne restera plus d’Anglais qui ne soient morts ou pris.
Charles.
Quoi ! ce que mes capitaines ne peuvent, toi, paysanne, tu le pourrais ?
Jeanne.
Notre-Seigneur Dieu le peut et le fera par moi. Il se servit du petit berger David pour abattre le géant Goliath.
Charles.
Et comment te sais-tu envoyée de Dieu ?
Jeanne.
Par mes voix. J’étais depuis longtemps tourmentée de la grande pitié qui est au royaume de France. Je pensais à votre détresse et je vous avais fait un trône dans mon cœur. Un jour, je m’étais endormie sous le vieux hêtre que nous appelons l’arbre des fées, quand soudain je me sentis comme tirée par la main. Je me réveillai ; et voici que j’entendis une voix qui criait : Jeanne !
Je regardai autour de moi. Il n’y avait personne. Seulement le ciel resplendissait d’un éclat inaccoutumé. La voix reprit : Jeanne ! Jeanne !
Je vis que cette voix n’était pas une voix humaine, et j’eus grand-peur. Jeanne !
cria encore la voix. Et moi, à genoux, je dis en tremblant : Que voulez-vous de moi ?
Or, voici que j’aperçus saint Michel, tel qu’il est représenté dans notre église, tenant à la main son épée flamboyante et déployant ses ailes d’or. Un cercle de feu illuminait son front ; le souffle embaumé des fleurs s’exhalait sous ses pas, et sa voix avait un charme que n’ont ni l’orgue ni les cloches. Quelle joie de le voir ! Quelle joie de l’entendre ! Il me disait : Jeanne, sois bonne fille. Aime toujours de tout ton cœur le roi et le royaume. Garde-toi pour eux. Le salut viendra.
Plus tard, à la même place, j’ouïs encore la voix ; l’ange m’apparut encore, et il me dit : Jeanne, tu es la pucelle par qui doit être chassé l’Anglais et mené à Reims le roi très chrétien. Va !
— Me voici.
Charles.
Fille naïve !
Dunois.
Fille sublime !
La Trémouille.
Paysanne, tu rêves ou tu mens.
Jeanne.
Je sais ce que je dis, et je dis la vérité.
Dunois.
Mentir ! cette fille ! Ne voyez-vous pas qu’elle n’est que simplesse et candeur ?
Frère Richard, désignant Dunois.
Quand on est un grand homme, on croit aux grandes choses.
La Trémouille.
Eh ! sire ! souvenez-vous de cette femme qui annonçait aux Flamands la victoire sur votre père. Elle aussi entendait des voix. Or les Flamands furent écrasés ; et parmi les morts se trouva la misérable qui leur servait de porte-bannière.
Jeanne, se jetant aux genoux du roi.
Doux sire, n’écoutez pas cet homme ! Je vous supplie qu’il vous plaise me prendre à votre service et ne pas vous soustraire à votre salut ! Si je faux en mon chemin, il vous sera facile d’avoir justice de moi ; et ma mort ne causera de trouble à personne.
Charles.
Pour que je me décide à telle folie, il faudrait un miracle.
Jeanne.
On ne doit pas tenter Dieu. Mais, sire, vous me croirez peut-être si je vous révèle une chose si secrète qu’elle n’est sue que de vous… et de Dieu qui sait tout.
Charles.
Sortez, tous !… (Se ravisant.) Dunois, restez… là… un peu à l’écart. (Dunois, tout en restant, s’écarte du dauphin et de Jeanne.) Je veux lui parler seul à seul.
Scène VIII
Charles, Jeanne, Dunois.
Charles.
Fille, que veux-tu dire ? Tu as vu sur mon visage que j’étais le roi. Vois-tu aussi dans mon âme ?
Jeanne.
Sire, une crainte vous tourmente.
Charles, vivement.
Parle !
Jeanne.
Tout à l’heure encore vous avez requis Dieu à genoux que ce fût son plaisir de vous tirer d’angoisse.
Charles, très ému.
Achève ! achève ! Quelle est cette pensée qui me persécute ?
Jeanne.
Vous vous dites : Suis-je bien le fils du feu roi ? Si je suis son fils, n’ai-je pas hérité de sa folie ? Si je ne suis pas son fils, ne dois-je pas être déshérité de son trône ?
Charles.
Prodige ! prodige ! (Avec la plus grande anxiété.) Eh bien ?…
Jeanne.
Sire, vous êtes vrai roi. Charles VI est bien votre père. Vous n’avez pas hérité de sa folie. Mais vous êtes bien l’héritier de son trône. Ayez foi ; ayez foi !
Charles, s’écriant.
Ah ! tu es véritablement fille du Ciel ! Dunois, c’est le Saint-Esprit qui vient de me parler par cette bouche… Je désespérais. Je croyais qu’il ne me restait plus aucun appui. Il restait Dieu !… Jeanne, parle-moi ! conduis-moi !
Jeanne.
Votre armée vous réclame.
Charles.
Quitter Agnès !
Jeanne.
Il le faut, doux sire.
Dunois.
Préférez la gloire à l’amour.
Jeanne.
Préférez la France à Agnès.
Dunois.
Votre bonne noblesse vous applaudira.
Jeanne.
Votre bon peuple vous bénira.
Dunois.
Vous serez grand.
Jeanne.
Vous serez selon Dieu.
Dunois.
Votre honneur sera sauf.
Jeanne.
Et votre royaume conquis.
Charles, à demi ébranlé.
Ainsi, pour être roi, il faut cesser d’être homme ?
Dunois.
La voici.
Charles.
Laissez-moi avec elle.
(Dunois et Jeanne sortent.)
Scène IX
Charles, Agnès.
Agnès.
Sire, je vous quitte.
Charles.
Quoi ! Quand ton amour à mes yeux met tout en balance…
Agnès.
Sire, jamais vous ne me fûtes plus cher. Je souffre, je gémis ; mais je cède au devoir. Depuis que cette miraculeuse fille a parlé, ma conscience me parle encore plus sévèrement qu’elle. Je me vois vous retenant à l’heure ou vous devriez combattre. Je vois votre mère… hélas ! votre pire ennemie,… établissant sur nos faiblesses la force du mari de sa fille, le roi d’Angleterre, qu’elle veut roi de France. Déjouez ses calculs. Que ma retraite vous rende la liberté ! Et allez là où l’honneur marque votre place.
Charles.
C’est donc la destinée. Nous devons nous séparer, Agnès…
Agnès.
Oui, sire… Vous avez donné assez de temps au plaisir ; donnez votre vie au royaume. Ma présence vous avait réduit à n’être que le roi de Bourges ; mon départ va vous faire roi de France !
Charles.
Ah ! tu resteras dans ma pensée ; et, si la lance de l’Anglais perce mon cœur, elle y trouvera ton image.
Agnès.
Sire, ne parlez pas ainsi. Plus je me sens aimée, plus je souffre à vous perdre… Que n’êtes-vous détaché de moi ! Il me serait moins dur de m’éloigner de vous… Isabeau…. Je me retire… Restez fort !
Scène X
Charles, Isabeau.
Isabeau.
Qu’est-ce, Charles ? La dame de Beauté vous quitte quand j’arrive ! Elle devrait plutôt s’unir à moi pour réprouver l’entrevue dont m’avise La Trémouille… Quoi ! vous le dauphin, vous avez fait accueil à une bergère, venue on ne sait d’où pour vous conter ses songeries !… Donnez-lui bonnement une panetière et renvoyez-la garder les moutons.
Charles.
C’est une envoyée de Dieu ; elle m’a annoncé la délivrance d’Orléans.
Isabeau.
Chimère ! À cette heure, Orléans est aux mains des Anglais.
Charles.
Orléans aux Anglais ! Que m’apprenez-vous ? Qui leur en a ouvert les portes ?
Isabeau.
Moi ! Tout était perdu ; j’ai fait savoir aux Orléanais qu’ils étaient déliés de leur serment d’obéissance et pouvaient se rendre.
Charles.
Vous avez fait cela ! De quel droit ?
Isabeau.
De par mon double droit de mère et de reine.
Charles.
Vous, ma mère ! Vous en avez le nom ; vous n’en avez pas le cœur. Vous la reine ! Allons donc ! Pas plus reine que mère. La France a cessé d’être vôtre du jour où vous l’avez ouverte à l’étranger.
Isabeau.
Eh bien, oui, j’ai attiré ici l’Anglais et je m’en vante. J’ai vengé, je venge le meurtre du duc Jean de Bourgogne, que j’aimais et qui m’aimait.
Charles.
Il est beau, en effet, de vous faire le fléau de votre fils et de votre pays,… et pour quelle vengeance !
Isabeau.
Mon pays ! Je n’en connais pas d’autre que la Bavière, où je suis née. Le peuple de France m’est étranger, depuis qu’il m’est ennemi. La maison de France m’est odieuse, depuis qu’elle s’est souillée du sang le plus pur. Tu te fais le juge de ta mère ! Fallait-il, par hasard, que je m’ensevelisse vivante, quand, jeune et belle, je me voyais unie à un homme malade, rachitique, à un fou ? Ce que j’ai fait, j’ai eu raison de le faire… Vainement tu es sorti de mon sang. Depuis la mort du duc Jean, Charles, tu ne m’es rien. À Henri d’Angleterre, à l’époux de ma fille, mes conseils, mon or, mon cour. C’est lui le véritable héritier… Pour être né de moi, tu te crois né de Charles VI… Détrompe-toi ! le feu roi n’était pas ton père.
Charles.
Marâtre !… Mais non, vous mentez. Je jure que vous mentez… Vous me haïriez moins, si je n’étais le fils de Charles VI.
Isabeau.
Eh bien ! oui, tu es son fils…
Charles.
Je le savais bien, Jeanne, que tu avais dit vrai !
Isabeau.
Tu es son fils ; tu as ses traits ; tu auras son esprit ; et je compte bien te voir fou comme lui. C’est un paysan qui, arrêtant soudain son coursier, déchaîna la démence du père. Puisse cette paysanne que tu accueilles déchaîner la démence du fils !
Charles.
Horreur ! Comme vous vous démasquez ! Partez ! quittez ce pays qui vous vomit.
Isabeau.
Roitelet qui, dans ton ombre de cour, prétends régenter une ombre de royaume que va bientôt te ravir la puissance anglo-bourguignonne ! c’est moi qui te bannis !… Je pars avec joie pour aller vivre dans un autre air que celui que tu respires.Mais, avant de partir, j’avais besoin de faire éclater mon ressentiment. C’est fait… Reste avec ta bergère. Écoute les contes de cette fille de village. Le temps est proche où tu succomberas, et où tous ceux qui me bravent reconnaîtront qu’il n’y a de maîtres en France que ceux qu’il plaît à Isabeau de protéger… Adieu…
Charles.
Partez, madame !… Où vous êtes, là est Satan ; et ou est cette fille, là est un ange de Dieu.
Isabeau.
Eh bien ! nous verrons qui peut plus, de l’enfer ou du Ciel… Une juste vengeance guide mes pas.
Charles.
Un saint amour conduira les siens.
Isabeau.
Adieu et reçois ma malédiction ! Malheur à toi ; car tu es le fils d’un homme que j’ai abhorré. Malheur à toi ; car tu es l’assassin d’un homme que j’ai adoré. Je te hais ; je te hais ; je te hais, d’autant plus que j’aurais pu t’aimer davantage. Tu es mon ennemi… et tu es mon fils !
Scène XI
Charles, Dunois, puis Jeanne, Lahire, Richemont, frère Richard, Jean de Metz.
Dunois, retenant le roi, qui veut aller du côté où est partie Isabeau.
Laissez partir cette furie, sire ! En même temps qu’une ennemie vous quitte, un ami vous revient. C’est le connétable de Richemont.
Charles.
De quel droit ? Ce Breton ne veut faire qu’à sa tête. Il a insulté La Trémouille. Je l’ai chassé.
Dunois.
Mais Jeanne l’a fait ramener par Lahire.
Charles.
Lahire est donc de retour ? Apporte-t-il une bonne réponse du duc de Bourgogne ? (Entrent Lahire, Jeanne, Richemont, frère Richard et Jean de Metz. — À Lahire.) Qu’attendre ?
Lahire.
Rien du duc ; tout de nos épées… Je n’ai tiré de sa bouche que ces mots : Guerre à mort aux assassins de mon père !
Mais si je n’ai pu gagner votre grand vassal, du moins je vous ramène un homme qui vous vaudra une armée.
Charles.
Richemont ! Qu’il reparte et nous laisse !
Dunois.
Sire, ne vous privez pas d’un Breton qui sera pour l’Anglais un second Duguesclin !
Jeanne.
Sire, de par le Ciel, je vous supplie… En attendant le jour où vous vous donnerez la main avec le duc de Bourgogne, faites paix à votre bon serviteur monsieur le connétable.
Charles.
Il le faut donc, Jeanne ?
Richemont.
Sire, je me soumets. Employez-moi comme vous voudrez… Connétable ou simple chevalier, n’importe ! J’ai besoin de batailler, et je ne saurais batailler autrement qu’à votre service… Faut-il que je me jette aux pieds du sire La Trémouille ? Je m’y jetterai, moi qui jamais n’ai plié devant personne. Rien ne peut me coûter pour reconquérir l’affection de mon roi et le droit de mourir pour mon pays.
Charles.
Dans mes bras, Richemont !
Scène XII
Les mêmes, La Trémouille, puis Agnès.
La Trémouille, entrant.
Que vois-je ?
Charles.
La Trémouille, donnez la main à notre loyal et vaillant connétable ! Plus d’amertume dans les cœurs ! Préparons-nous à mener une forte guerre en compagnie de cette fille, dont la présence fait des miracles.
La Trémouille, à part.
Maudite sorcière ! (Haut.) Mais, sire, le trésor est vide.
Charles.
Quoi ! plus d’argent !
Lahire.
Il vous reste nos cœurs.
La Trémouille.
Les cœurs ne peuvent être monnayés.
Dunois.
Nos châteaux peuvent l’être. Je vendrai les miens.
La Trémouille.
Impossible de payer les Écossais. Ils veulent partir.
(Agnès entre.)
Agnès.
Auguste sire, je viens remettre en vos mains ce qui est vôtre. Voici mes bijoux, mes parures, mon collier de diamants, le premier qu’un roi ait offert à sa dame. Faites-en de l’or !
Charles.
Ah ! il a la royauté désirable, celui qui règne sur un tel cœur !
Agnès.
Jeanne, je vous rends grâce. Vos dures paroles m’ont réveillée… J’étais le fléau du roi ; vous en serez la providence. Allez vaincre avec lui. Dans ma retraite, je prierai pour lui et pour vous.
Jeanne.
Soyez bénie du Ciel, dame au grand cœur !
Agnès.
Fille de Dieu, si mon sacrifice me rapproche de toi, laisse-moi maintenant te tendre la main et donne-moi la tienne… (Jeanne va vivement vers Agnès. Agnès, très émue, prend ses mains dans les siennes.) Ô toi qui es toute pureté, sois toute-puissante pour le bien du royaume et du roi… Adieu, sire.
Scène XIII
Les mêmes moins Agnès, le page.
Jeanne.
Et maintenant, sire, à Orléans !
Charles.
Mais l’Anglais y est déjà…
Jeanne.
Sire, n’insultez pas les Orléanais. Ils se sont gardés à leur seigneur et maître.
(Sonnerie de trompettes et de clairons.)
Le page.
Monseigneur Pierre de Beauvais est là de la part des Anglais.
Dunois.
Ils ont bien choisi leur ambassadeur : un renégat !
Le page.
D’un autre côté, il vient d’arriver deux bourgeois d’Orléans.
Charles.
Ah ! qu’ils entrent ! Monseigneur de Beauvais sera admis après eux.
Scène XIV
Les mêmes, deux bourgeois d’Orléans.
Premier bourgeois.
Sire, vous nous avez déliés du serment de fidélité ; mais nos consciences ne nous en déliaient point. Plutôt que de céder, nous périrons. Fi de conserver notre vie, ne conservant pas notre cité ! Nous nous ferons un bûcher de nos maisons en feu, et c’est sur nos cendres que l’ennemi devra passer pour planter son drapeau là où fut Orléans.
Second bourgeois.
Mais avant d’en venir à cette extrémité nous venons vous dire : Sire, accourez défendre cette bonne ville où s’est réfugiée l’âme de la France…
Sauvez-nous !
vous crient nos femmes et nos enfants.
Charles.
Bons amis, soyez bénis d’avoir si bien besogné. Le renom des Orléanais durera éternellement… Je ne vous manquerai pas en votre besoin… (Au page.) Introduisez messire Cauchon.
Scène XV
Les mêmes, Cauchon.
Jeanne, à Frère Richard.
Quel homme est cet évêque ? Il a un regard qui glace. En le voyant, j’ai frémi.
Cauchon.
Moi, Pierre Cauchon, évêque de Beauvais…
Lahire.
Et renégat !
Cauchon.
Je suis envoyé par Henri VI, noble roi de grand renom, et par le sire de Bedford, illustrissime régent du royaume, pour parler à Charles de Valois, comte de Ponthieu…
Dunois.
Dites roi de France ! Qui vous rend si hardi de renier votre roi ?
Cauchon.
Donnez foi et hommage au roi Henri : sinon, famine, fer et feu auront raison de vous. Il a le droit, et il l’appuie par la victoire.
Jeanne.
Ah ! sire, dites que les Anglais choisissent de déguerpir ou de périr.
Cauchon.
Que veut cette paysanne avec sa cotte rouge ?
Jeanne.
À l’heure des horions, vous le saurez.
Cauchon.
À vous de choisir, Monseigneur. Ou l’abandon au roi Henri de tout ce qu’il a conquis ; ou de nouveaux combats qui vous feront tout perdre.
Charles.
Va donc pour de nouveaux combats qui nous feront tout regagner !
Cauchon.
Monseigneur, songez qu’Orléans va se rendre, et que Paris, ivre de joie, vient de couronner le roi Henri.
Charles.
Quoi ! mon bon peuple de Paris !
Dunois.
N’accusez pas le peuple. Il ne sait pas : il suit. Accusez les nobles intrigants et les prêtres avides, (en regardant Cauchon) les prêtres renégats qui l’aveuglent et le mènent.
Cauchon.
Paris en fête a reçu dans ses murs notre jeune roi ; les clefs de la ville lui ont été solennellement remises ; il trônait sous un dais d’azur ; les cloches sonnaient à toute volée ; des arcs de triomphe se dressaient à tous les coins de rue ; les maisons étaient tendues de draperies blanches et bleues ; et clercs de l’Université, magistrats du parlement, nobles, bourgeois, manants, tout le peuple l’a salué de mille cris : Noël ! Noël !
Jeanne, solennellement et avec force.
Les mêmes clefs seront un jour présentées à notre sire Charles, fils de Charles, seul roi ; il trônera sous le même dais d’azur ; les mêmes sonneries de cloches rempliront les airs ; les mêmes arcs de triomphe se dresseront ; les mêmes draperies blanches et bleues pareront les maisons en fête ; et clercs de l’Université, magistrats, nobles, bourgeois, manants, tout le peuple, converti à son vrai seigneur, le saluera de mille cris : Noël ! Noël5 !
Cauchon.
Fille, la folie parle par ta bouche, à moins que ce ne soit le démon.
Jeanne.
Évêque, je suis venue ici de par Dieu, et je parle selon Dieu. Voici mon message à ceux qui vous envoient : Roi d’Angleterre et duc de Bedford, qui vous dites régent de France ; et vous, Talbot, Glasdale, Suffolk, qui commandez les armées anglaises, faites raison au roi du Ciel ! Je suis la Pucelle ayant mission d’obtenir justice. Disparaissez ; sinon, vous allez me voir front à front. Et ce sera pour fuir ou mourir. Dieu le veut !
Tous.
Dieu le veut !
Cauchon.
Le canon répondra.
Scène XVI
Les mêmes moins Cauchon.
Charles.
Or çà, Jeanne, voulez-vous être armée ? Tout le long du jour porter un harnois sur vos épaules, vous en serez bientôt lassée.
Jeanne.
En nom Dieu, je le porterai bien. Qu’il soit pesant ! je me sens forte.
Charles.
Essayez-le. Et maintenant que je vous ceigne de votre épée à cinq croix !
Jeanne.
Faites. Mais je n’userai pas de l’épée… Mon étendard ?
Dunois.
Le voilà, tout blanc et semé de fleurs de lis.
Jeanne.
Je prie qu’on y peigne un soleil d’or avec un ange de chaque côté, et au milieu le nom de Jésus.
Richemont.
Vierge du ciel, dont la chevalerie a fait sa patronne, tu revis dans cette humble fille ; et voici que tu veux sauver la France sous les auspices de Jésus qui a sauvé le monde !
Jeanne, solennellement, les yeux sur son étendard.
Dieu aidant, cette bannière fera tomber plus d’ennemis que la faux d’un moissonneur ne fauche d’épis en un jour… Prêtre de Dieu, bénissez-la !
(Jeanne s’agenouille, en tenant son étendard. Frère Richard étend les mains et le bénit.)
Voix.
Va, Jeanne, va !
Jeanne, répétant comme en un rêve les paroles de la voix.
Va, Jeanne, va !
(Hormis La Trémouille, tous les assistants regardent Jeanne avec émotion. Elle reste les yeux au ciel, en extase.)
Frère Richard.
Va, brille sur nos champs de bataille, douce étoile de la France ! Sois le foyer sacré où s’allumeront les âmes !… Paysans, quittez vos sillons. Nobles, quittez vos donjons. Tous à la rescousse pour le pays !
Dunois.
Debout, France, debout ! Sous son talon l’Anglais croit te tenir. Redresse-toi, et que devant les lis s’enfuient les léopards ! Debout ! Quand la foi te soulève, tu soulèverais le monde.
Charles, gravement.
Voici l’enfant fait homme par cette noble fille. Je vais revêtir mon armure : je ne la quitterai pas qu’Orléans ne soit délivré… Ce royaume, que mes ancêtres ont reçu de Dieu et que j’ai reçu d’eux, je jure de le défendre jusqu’à la mort !
(Jeanne, sortie de son extase, se relève et agite son étendard. Tous agitent leurs épées.)
Jeanne.
À la victoire !
Acte deuxième
Premier tableau À Janville. — Les appels à la paix.
Camp anglo-bourguignon.
Tente de Talbot, le général en chef.
Scène première
Luthold, Roger, John, soldats anglais en sentinelle devant la tente.
Luthold.
Pourquoi ai-je passé le détroit ? Que ne suis-je resté dans nos gais cottages avec ma mère et mes sœurs ?
Roger.
Nous régnions sur la Loire ; Orléans allait être à nous… Cette furie a paru ; et voilà nos triomphes changés en défaites. Les Français marchent au combat avec l’assurance de chasseurs qui poursuivent lapins ou perdreaux.
John.
Ce n’est pas aux Français qu’est la victoire. La victoire est au diable, qui combat de leur côté. Jeanne n’est qu’un démon sous un corps de fille.
Luthold.
Que dis-tu ? Les saints et les saintes du paradis se montrent à elle face à face et lui parlent comme à une amie.
Roger.
Elle fait des prodiges. Je puis en parler, car voici ce que j’ai vu. C’était la veille du combat des Tourelles. Vers l’heure de minuit, un tourbillon enflammé vint s’abattre sur notre camp, devenu soudain rouge comme du feu. Le lendemain nous étions battus, Glasdale était tué, et il fallait abandonner Orléans.
Luthold.
Moi, en plein midi, j’ai vu tout à coup s’ouvrir une route flamboyante qui allait du ciel à la terre et par où cheminaient des légions de guerriers… Je mis la main devant les yeux et je tombai la face contre terre. Mais, si je ne voyais plus, j’entendais. Et il me sembla que, dominant l’épouvantable cliquetis des armes, une voix criait : Au dehors l’étranger ! au dehors l’étranger !
Le soir, Jargeau était pris et Suffolk prisonnier.
John.
Décidément vous rêvez éveillés. Il était temps que Talbot, avec une nouvelle armée, arrivât de Normandie pour redresser vos têtes et remettre nos affaires. La sorcière a pu battre ses lieutenants ; mais elle rentrera sous terre dès qu’il faudra affronter l’Achille anglais… Rangeons-nous. Le voici qui revient dans sa tente.
Luthold.
Il se mord les lèvres et tourmente son épée. On lui aura encore appris quelque mauvaise nouvelle.
Scène II
Talbot, seul.
L’angoisse m’étreint de voir nous advenir tels dommages. Orléans abandonné, Jargeau perdu, ce n’était donc pas assez ? Nous voilà délogés de Beaugency et battus à Meung. Funestes journées ! En fuite tant de gens de haut lignage et de haute vertu ! Que n’étais-je là présent ! Eux, les vainqueurs de vingt batailles, une sorcière leur fait tourner les talons ! Ah ! je suis courroucé à outrance ! Angleterre, voilà pendue à ton drapeau une loque d’infamie. Je ne dormirai point qu’elle n’en ait été arrachée par une éclatante revanche… Dieu, rends-nous la victoire, ou ôte-moi la vie !
(Arrive Falstoff.)
Scène III
Talbot, Falstoff.
Talbot.
Quoi, Falstoff, tu as reculé devant une fille !
Falstoff.
C’est une magicienne.
Talbot.
Sa magie est votre lâcheté… Poltrons, à qui une femme fait peur, quittez donc l’armure du soldat et allez dans un cloître, en robes de moines, marmotter des patenôtres.
Falstoff.
Sire Talbot !
Talbot.
Pardonne-moi, vaillant Falstoff. Mais ce m’est un grand déplaisir que vous n’ayez plus longtemps tenu. Un jour encore, et vous aviez des renforts, et nous avions la victoire.
Falstoff.
Talbot, je ne sais que dire. Je suis maté, navré, honteux. Ma tête se perd quand je songe à tant d’ignominie. Et je voudrais être mort, comme Rameston, Chabot, Sommerset.
Talbot.
Pauvre Chabot ! pauvre Rameston ! pauvre Sommerset ! fleur des preux, honneur de la chevalerie ! Que Dieu prenne vos âmes au ciel l… Mais quoi ! Les morts sont morts. Rien ne sert de se lamenter. On les ensevelira honorablement en terre bénite et on leur chantera des psaumes. Nous ne pouvons que cela pour eux… Falstoff, ne sois plus appesanti et triste. À l’action ! Préparons la revanche.
Falstoff.
Talbot, le cœur me saigne de penser que, si nous n’avons pas été écrasés, il faut en savoir gré au duc de Bourgogne, à un Français !
Talbot.
Ce Français est notre allié, et sa haine du dauphin l’a fait Anglais. Puis, il avait près de lui un Anglais, mon fils.
Falstoff.
Fils digne de son père et qui a glorieusement gagné ses éperons ! Mais voici le duc de Bourgogne. Il m’a vu fuir. Je ne veux pas soutenir son regard… Talbot, fais que nous soyons bientôt en belle bataille, et ménage-moi une occasion de bien mourir.
Scène IV
Talbot, le duc de Bourgogne.
Talbot.
Duc, comme toujours vous avez besogné à merveille.
Le duc.
Sire Talbot, je n’ai qu’arrêté le désastre. Maintenant, hélas ! les échecs vont se succédant pour l’Angleterre. Il fallait s’y attendre. La défaite est pour nos Français une école de victoire. Tombés, ils se relèvent plus grands.
Talbot.
Ces échecs ne comptent pas, duc. Notre gloire est trop haut montée pour en être atteinte. Ne sommes nous pas les vainqueurs de Poitiers, de Crécy, d’Azincourt ? À Cravant, à Verneuil, à Rouvray, combien n’étaient-ils pas contre nous, ducs, barons, comtes, tout chamarrés, avec de belles armes reluisant comme le soleil ? Quand vinrent les horions, ils s’enfuirent piteusement comme brebis ou moutons. Ils aiment à combattre en manants, à l’abri de solides remparts. Mais vienne l’heure où on se mesurera en rase campagne ! C’est la vraie guerre des gentilshommes : c’est la nôtre. Nous nettoierons cette truandaille ; et dans mille ans il sera encore parlé de nos coups d’épée.
Le duc.
Puissiez-vous être prophète ! En attendant, trêve aux soucis ! Une jeune fille m’a fait demander un sauf-conduit pour venir au camp. Je me suis hâté de le lui envoyer. C’est sans doute une belle française, désireuse d’amuser mes loisirs. Je vous avise, afin qu’il ne lui soit fait aucun mal.
Talbot.
Toujours léger, duc. Mais, si vous êtes grand viveur, vous êtes bon batailleur.
Le duc.
Pas meilleur que votre fils, qui a fait des prodiges sous mes ordres.
Scène V
Talbot, Robert, puis Luthold.
Talbot.
Embrasse-moi, Robert. En ces jours de deuil, tu es ma consolation.
Robert.
Attendez pour me louer que j’aie fait quelque chose de grand. N’était-il pas naturel qu’arrivés assez tôt nous empêchions l’écrasement des restes de l’armée de Falstoff ? Aussi violentes qu’un torrent qui s’engouffre dans un précipice, les masses bourguignonnes ont fondu sur les bataillons français. Au premier rang il y avait Jeanne la Pucelle. Après avoir tenu quelques minutes, elle s’est retirée à pas lents, en retournant fièrement la tête, avec l’allure d’une lionne généreuse qui abandonne à regret sa proie.
Talbot.
Que ne l’a-t-on enveloppée ?
Robert.
La terreur qu’elle inspirait lui faisait un rempart. Devant son regard, la vaillance de nos soldats se fond comme la cire devant le feu. Il serait plus facile de considérer fixement le soleil à son midi que de soutenir l’éclair de ses yeux.
Talbot.
Une femme ! Tu dis cela d’une femme ! Est-ce toi, Robert, qui parles ainsi ? As-tu perdu la raison ?
Robert.
Mon père, j’ai tout mon bon sens. Mais ce que j’ai éprouvé, je le dis. Ô mon père, il ne faut pas s’étonner que les Français soient transfigurés par cette fille. Jamais je ne vis personne de mine plus haute. Elle a dans les combats l’air majestueux de la déesse des batailles. Quand il s’agit de venir aux mains, son cil étincelle ; sa voix crie : À l’ennemi !
son geste le désigne ; et la bannière qu’elle porte devient le drapeau vivant de la victoire. Aussitôt que des rangs français la mort s’élance, on la voit, partout présente, dresser son étendard là où le péril est le plus grand. Sa tête brille comme une étoile sur le nuage noir des combattants ; et elle semble commander à la foudre qui va çà et là frapper les nôtres. Non, tant que je vivrai, jamais je n’oublierai comme la vierge de France plane, ardente et sereine, au-dessus du carnage, tandis qu’autour d’elle tout est à feu et à sang.
Talbot.
Truande qui, non contente de gâter nos affaires, as ensorcelé mon fils ! tu es sûrement fille de l’Antéchrist. Quand pourrai-je te renvoyer à l’enfer d’où tu sors ? Si tu tombes entre mes mains, tu maudiras le jour où tu es née et la mère qui t’a enfantée. Je veux qu’on me mette au gibet si je ne te mets pas à la raison. Va, ta force n’est que vent et fumée… Que ne t’ai-je là pour te faire étrangler par mes chiens ou écarteler par mes chevaux !
Luthold, entrant.
Sire Talbot, une fille est là qui demande à être introduite.
Talbot.
Qu’elle entre !
Scène VI
Talbot, Robert, Jeanne.
Talbot.
Que voulez-vous ?
Jeanne.
Parler au sire Talbot et au duc de Bourgogne.
Talbot.
Je suis Talbot. Qui êtes-vous ?
Jeanne.
J’ai un nom que l’Anglais déteste.
Talbot.
Quel est ce nom ? Parle.
Jeanne, découvrant son visage.
Je suis Jeanne la Pucelle.
Robert.
Elle !
Talbot.
La sorcière d’Orléans !
(Les soldats se reculent. Talbot met instinctivement la main à son épée.)
John.
La sorcière d’Orléans ! Dieu nous sauve !
Talbot.
Tu ne crains donc pas la mort ?
Jeanne.
Je ne crains que Dieu ; et une voix de Dieu m’a dit : Va !
Talbot.
Enfin ! je te tiens… Le voilà, Anglais, l’épouvantail qui paralysait vos courages !… Où sont tes saints et tes saintes pour te défendre ? Tu vas mourir.
Robert.
Arrêtez, mon père.
Jeanne, avec un calme solennel.
Ni une balle ne m’approchera, ni une épée ne me touchera, tant qu’il y aura des Anglais en France.
Talbot.
Vraiment ! le destin t’a donc conté ses secrets ? Eh bien ! dis-lui qu’il a menti. Au clair mon épée ! À mort la sorcière !
Robert.
Mon père !
Jeanne.
Noble Talbot, je vous estime plus que vous ne vous estimez en ce moment ; et je sais que vous ne frapperez pas une femme sans défense.
Robert.
Par votre salut éternel, par votre honneur, au nom de ma mère, ne frappez pas cette fille.
Talbot.
Laisse-nous. Va-t-en loin des regards qui t’ont jeté un sort ! Sous peine de malédiction, je te l’ordonne.
Robert.
Je sortirai ; mais assurez-moi que vous ne la frapperez pas. Épargnez sa vie, si vous tenez à la mienne ; et consentez à l’écouter.
Talbot.
Femme ou démon, rends grâce à mon fils. Je veux ta perte à cause de lui, et à cause de lui je la diffère. Robert, cette ribaude aura la vie sauve, et je l’entendrai. Mais pars !
(Robert sort.)
Scène VII
Jeanne, Talbot.
Jeanne.
Sire Talbot, je viens à vous de la part de Dieu, le roi du ciel, pour vous requérir de faire la paix…
Talbot.
Faire la paix sans tirer vengeance ! J’aimerais mieux être à cent pieds sous terre. L’Anglais ne fait la paix que quand il est vainqueur. Jamais il ne cède à la menace.
Jeanne.
Cédez au droit ! Rendez les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez violées… En mettant la mer entre la France et l’Angleterre, Dieu a dit aux deux peuples : Voilà vos limites !
Nous les respectons ; respectez-les.
Talbot.
Déloger, nous ! ce serait une honte plus intolérable que tous les maux que nous veut ta haine.
Jeanne.
Je ne vous veux aucun mal ; mais retournez en vos pays ! Vous n’avez ici nul droit. Vous serez ici déconfits. Rendez le royaume au roi ; rendez la France aux Français. Écoutez les plaintes des pauvres gens qui vont criant par les rues : Quand donc finira si douloureuse vie et si damnable guerre ?
Pitié, monseigneur ! Au lieu de soldats qui se combattent, qu’il n’y ait plus que des hommes qui s’aiment ! Donnez la paix, le sourire de Dieu !
Talbot.
La paix que je prétends vous donner est celle des cimetières. Je ne repasserai pas la mer que je n’aie marché jusqu’aux genoux dans le sang français et mis le royaume au pillage.
Jeanne.
Prenez garde, sire Talbot, qu’il n’y ait témérité à vous adjuger de son vivant la peau du lion de France.
Talbot.
Si j’étais fanfaron, ce serait un effet de l’air de ce pays. Mais on verra ce qui en est quand il s’agira de croiser le fer, vachère, paillarde, mécréante !
Jeanne.
Calmez-vous, doux seigneur ! Qui ne peut lancer injures et menaces ? Ayez le dessus en vilains propos. Il nous suffira d’avoir le dessus les armes à la main. Je prends Dieu à témoin que nous guerroyons par pure contrainte. Je prends Dieu à témoin que vous seul devrez compte du sang versé. Les corps couchés à terre se redresseront au jour du jugement ; et des milliers de victimes crieront en vous désignant : C’est lui qui nous condamna à mourir ! Honte sur lui et damnation !
Sans doute vous préférez à vos brouillards notre ciel ensoleillé. Mais ici pas une motte de terre n’est à vous. Vous n’êtes que des loups ravisseurs violemment entrés dans la bergerie. Vous détacherez du ciel les étoiles pour en faire des joyaux, plutôt que vous ne morcellerez la France pour en faire votre proie. Déjà la déroute vous poursuit ; la mort vous épie. Où elles cherchent un empire, vos armées ne trouveront qu’un tombeau.
Talbot, avec un trouble qu’il domine.
Calme à ton tour ce tonnerre de paroles. Il ne m’émeut aucunement, pas plus que le tonnerre de vos canons.
Jeanne.
Nos canons ! Ils vont vous foudroyer ; et l’écho en retentira longtemps dans les chaumières de votre Angleterre. Déjà à Saint-Loup, à Saint-Jean-le-Blanc, aux Tourelles, à Jargeau, à Beaugency, à Meung, nous vous avons décimés.
Talbot.
Fille d’enfer, ton dauphin verra bientôt si les hommes nous manquent.
Jeanne.
Vous en aurez toujours trop pour la mort, jamais assez pour la victoire… Que Dieu soit miséricordieux à ceux qui tueront et à ceux qui seront tués !
Talbot.
Invoque la miséricorde de Dieu tant qu’il te plaira ; tu n’auras pas la mienne. J’ai promis d’épargner ta vie, mais tu resteras notre prisonnière… Nous te montrerons au roi Henri ; et bientôt, à Reims, tu assisteras au sacre de Sa Majesté.
Jeanne.
Majesté usurpée !
Talbot.
Qu’on l’enchaîne !
Jeanne.
Vous pouvez m’enchaîner ; vous n’enchaînerez pas la fortune de la France.
Scène VIII
Jeanne, Talbot, le duc de Bourgogne.
Le duc.
Halte-là !
Talbot.
On doit vous avoir appris qui est cette fille. Nos ressentiments sont trop justes. Ni scrupules, ni pitié.
Le duc.
Aurait-elle tué mon frère, je revendiquerais sa liberté, du moment où elle est venue à l’abri d’un sauf-conduit signé de moi. Ma parole doit demeurer sacrée.
Talbot.
Duc, je suis le général en chef. J’ai droit de décider.
Le duc.
Décidez. Moi, pour peu que vous touchiez à cette fille, je viderai sans délai le pays.
Jeanne.
Ah ! que je périsse et revenez à nous ! Haut et redouté prince, ce me sera joie et liesse d’être la proie des Anglais si la France recouvre un si bon défenseur.
Talbot.
Duc, je défère à votre vœu… La colère m’égarait ; et vous faites votre devoir… (À Jeanne.) Adieu, démon, jusqu’au jour où je te rencontrerai au bout de mon épée.
Jeanne.
Sire Talbot, Dieu vous garde !
Scène IX
Jeanne, le duc de Bourgogne.
Jeanne.
Haut et puissant prince, très sage, très vaillant duc de Bourgogne, veuillez m’écouter, moi Jeanne, l’humble servante de Dieu.
Le duc.
Parle. Je ne crains pas la magie de tes discours, pas plus que la magie de tes armes.
Jeanne.
De par le roi du ciel, je viens, les mains jointes, vous adresser une prière. Ce n’est pas la supplique du vaincu au vainqueur ; c’est l’appel de la France victorieuse à son meilleur fils. Voyez la détresse des Anglais, et décidez-vous à prendre votre part de nos victoires.
Le duc.
Trahir mes amis dans la défaite !
Jeanne.
Croyez-vous que l’Anglais manque d’être ingrat dès qu’il pourra l’être sans crainte ? Battez les buissons, lui prendra les oisillons… Messire, il ne peut y avoir pour vous sécurité et honneur que si vous servez Charles, votre seigneur légitime. Pardonnez-vous l’un à l’autre, de bon cœur et entièrement, en loyaux chrétiens. Qu’il n’y ait plus ni Armagnacs ni Bourguignons : qu’il n’y ait que des Français ! Le Ciel est du côté de la France ; soyez du côté du Ciel.
Le duc.
Oses-tu bien parler du Ciel, toi inspirée du démon ?
Jeanne.
Que la concorde règne ; que les fils d’une même terre s’embrassent : ce n’est pas là le vœu de l’enfer, mais la volonté de Dieu. Et c’est Dieu qui me dicte ce que je vous dis, moi pauvre villageoise qui ne suis rien que par lui.
Le duc.
J’ai pris les armes contre les bourreaux de mon père, tué en trahison ; et je veux à leur crime égaler ma vengeance.
Jeanne.
Pour les frapper vous frappez la France.
Le duc.
Comment l’aimerais-je ? Elle m’a méconnu, outragé, persécuté, fait orphelin. Le sang de mon père est encore tout fumant sur les mains de ses assassins ; et je pardonnerais !… Non ! non ! Puissent les Anglais porter partout la ruine et la mort ! Que ce soit mon bras qui leur ouvre la route et attise l’incendie ! C’est avec joie que je verrai tout plier devant l’ouragan vengeur. Je ne demande pour moi ni terres ni butin. Mais que mon père soit vengé !
Jeanne.
Domptez votre colère ! Dieu, qui est tout-puissant, se laisse pourtant fléchir. Voulez-vous n’être grand que pour le malheur de votre pays ? Duc Philippe, on vous appelle le Bon : justifiez ce titre ! Sachez oublier ; sachez pardonner. Nous sommes faits pour aimer, non pour haïr.
Le duc.
Tu hais bien les Anglais, toi !
Jeanne.
Non, je ne les hais point. Mais j’aime mon pays et je le défends.
Le duc.
Par saint Georges ! tu es une bonne fille. J’ai joie à te voir et à t’ouïr. Prends ma main.
Jeanne.
Messire, je ne puis la toucher, car elle est souillée de sang français. Lavez-la dans le sang anglais et je la baiserai, cette vaillante main. Bon duc, regardez qui vous avez contre vous : vos anciens compagnons de péril et de gloire, Dunois, Richemont, Lahire. Le ciel se voile devant ce spectacle de frères qui s’entre-tuent, quand ils devraient s’entre-secourir. Par grâce, entendez la grande clameur du pauvre peuple qui crie miséricorde ! L’Anglais doit aux Français ses succès sur la France. Quittez-le, et la victoire l’aura quitté pour toujours.
Le duc, ébranlé.
Mais c’est une juste vengeance qui m’a mis les armes à la main.
Jeanne.
Que la pitié vous les fasse déposer ! Elle seule est juste.
Le duc.
Non. Loin de moi cette lâcheté ! Bonne ou mauvaise, j’ai choisi ma route. Un serment me lie à l’Anglais.
Jeanne.
Il y a un premier serment qui vous lie à la France et que la nature a prêté pour vous en vous faisant Francais. Respectez-le !
Le duc.
Qui es-tu, fille, pour me remuer ainsi ? Tu ne saurais m’arracher mon ressentiment. Le soleil disparaîtrait plutôt du ciel. Mais je jure que jamais, sur le champ de bataille, tu ne me trouveras en face de toi.
Jeanne.
Bon duc, voilà une promesse que je prise à l’égal de dix combats gagnés. Mais je vous plains de ne vous décider au bien qu’à demi.
Le duc.
Ah ! je t’ai déjà trop écoutée. Adieu.
Jeanne.
Monseigneur, je vous rends grâce de votre bénignité. Vous n’êtes plus contre nous ; bientôt vous serez avec nous.
(Elle s’en va lentement, les yeux au ciel et les mains jointes sur sa poitrine.)
Le duc, la regardant avec émotion.
Soldats, saluez !…
Acte troisième
À Patay. — La victoire.
Une colline où s’élèvent plusieurs tertres et où est érigée une croix.
Scène première
Charles, Dunois, Richemont, Lahire, La Trémouille, Jean de Metz et officiers du roi.
Lahire.
En avant ! toujours en avant ! et l’étranger sera exterminé !
Charles.
Lahire, vous êtes toujours de l’avis de Jeanne. Vous avez entendu les autres capitaines. Il n’y a qu’elle et vous qui pensiez qu’il faut quitter nos bonnes positions et accepter la bataille que nous offre l’Anglais.
Scène II
Les mêmes, Jeanne.
Jeanne.
Vous délibérez encore ! Ce n’est plus l’heure de parler ; c’est l’heure de vaincre.
Charles.
Mon conseil est contre la bataille.
Jeanne.
Sire, le conseil de messire Dieu est plus sûr que le vôtre. Allons rabattre l’arrogance anglaise.
Dunois.
Vous êtes trop zélée, Jeanne.
Jeanne.
Et vous trop prudent.
Charles.
Les Anglais ont à leur tête le grand Talbot.
Jeanne.
S’ils ont Talbot, ils n’ont plus le duc de Bourgogne.
La Trémouille.
À sa place il y a une furie, l’implacable Isabeau, qui va de rang en rang et chauffe contre nous les haines bourguignonnes.
Lahire.
Elle est le démon ; nous avons l’ange.
La Trémouille.
L’avant-garde est sous les ordres du redoutable La Poule.
Jeanne.
Nous plumerons donc la poule en son poulailler !
Richemont.
Tous les gentilshommes d’Angleterre sont là réunis.
Jeanne.
C’est donc qu’il ne manquera aucun épi à la moisson.
La Trémouille.
Quelle folie ! S’aventurer ainsi en plein champ !
Jeanne.
Il n’y aura donc ni murs ni palissades qui nous gênent pour bien besogner.
Jean de Metz.
Pourtant, regardez, Jeanne ; à voir l’étendue qu’ils occupent, ne sont-ils pas six fois plus nombreux que nous ?
Jeanne.
Par leurs morts et leurs prisonniers vous en ferez le compte.
La Trémouille.
Eh ! Jeanne, vous si pieuse, oubliez-vous que c’est aujourd’hui dimanche ?
Jeanne.
Tout jour est bon pour battre l’ennemi.
La Trémouille.
C’est aller à la boucherie.
Jeanne.
Dites à la victoire.
La Trémouille.
Pour vaincre, il faut savoir attendre.
Jeanne.
Pour vaincre, il faut savoir oser.
La Trémouille.
Des renforts doivent nous venir.
Jeanne.
Le renfort efficace est venu de par l’aide de Dieu.
La Trémouille.
Dieu ne veut pas qu’on s’expose témérairement.
Jeanne.
Dieu veut que les faibles s’estiment forts quand ils ont bonne cause et le Ciel pour eux.
Richemont.
Vous avez raison, Jeanne. L’esprit de Dieu est en vous. Puissé-je me conduire dans la bataille aussi bien que vous savez nous y pousser !
La Trémouille.
Mais…
Richemont.
Jeanne n’a-t-elle pas toujours bien conseillé ? Et de puis qu’elle est là, tout n’a-t-il pas été en accroissement ? Sire, messeigneurs, écoutons la Pucelle.
Dunois.
Oui, écoutez-la, messeigneurs. Notre cause est sainte. Triomphons ou mourons !
La Trémouille.
Je dis…
Charles.
À la bataille !
(Ils partent. Jeanne se met en prière.)
Scène III
Jeanne, frère Richard, puis Lahire.
(On entend sonner trompettes et clairons. Jeanne est restée agenouillée devant la croix. Elle se relève au moment où arrive frère Richard.)
Jeanne.
Comme c’est plaisant à ouïr, la sonnerie des trompettes et des clairons ! Comme c’est beau, une armée défilant par la plaine !… On m’amène mon cheval noir, et Lahire m’apporte ma bannière. Allons !… (Lahire arrive et remet à Jeanne sa bannière.) Frère Richard, priez pendant que nous bataillerons. Demandez que capitaines et soldats soient tous bien repentants de leurs fautes, bien purifiés de cœur. Ce sont là de bons armements qu’il faut ajouter aux armements de fer et d’acier pour avoir sûreté de vaincre.
(Elle monte à cheval et s’élance.)
Scène IV
Lahire, frère Richard.
Lahire.
Jeanne a raison. Donnez-moi l’absolution, frère Richard.
Frère Richard.
Il faut d’abord confesser vos péchés.
Lahire.
Mettez que j’ai fait tout ce que les gens de guerre ont accoutumé de faire.
Frère Richard, ironiquement.
Hors jurer et piller, n’est-ce pas ?
Lahire.
Eh ! jarnidieu, si Dieu le père se faisait homme d’armes, il deviendrait pillard.
Frère Richard.
Allons, je vous absous. Faites votre prière.
Lahire.
Sire Dieu, je te prie de faire aujourd’hui pour Lahire autant que tu voudrais que Lahire fit pour toi, s’il était Dieu et que tu fusses Lahire.
(Il part.)
Scène V
Frère Richard, seul, à genoux devant la croix.
Esprit-Saint, esprit de salut, descends sur les soldats de France ! Sois leur épée, sois leur bouclier ! Guide-les sous ton aile, et disperse, comme au vent la fumée, l’armée des envahisseurs ! (Il se relève, monte sur le tertre le plus élevé et regarde la bataille.) La plaine s’ébranle sous les pas des chevaux ; le ciel résonne du cliquetis des armes ; les vagues des combattants s’amoncellent. En ayant, piques, hallebardes, becs-de-faucon, arcs, arbalètes, lances, dagues, épées ! Quelle forêt de casques et de cuirasses que fait reluire le soleil ! Déjà mugit la bataille. C’est l’heure de montrer hardiesse et courage. Poussez ferme, gentils compagnons de France ! Que chacun de vous fasse bon labeur comme si la victoire dépendait de lui seul !… Avec quelle furie se choquent les deux armées ! Des multitudes de cavaliers vont et viennent. Les armures se heurtent ; les lances se croisent ; Anglais et Français poussent de grands cris ; le sang doit couler à flots… Voilà l’air obscurci des flèches que lancent les archers. Je ne vois plus… Ils se rapprochent… Oh ! cette aigrette qui flotte en large crinière, c’est lui ; c’est le grand Talbot ! comme il est furieux ! Devant sa rage tout fléchit… Au secours, mon Dieu ! Terrasse cet homme superbe ! Brise les flèches aux mains des archers ! Romps le cercle de lances qui nous enveloppe ! Déchire le vautour anglais, qui croit tenir sa proie dans son bec dévorant !… Malheur ! les Français reculent. Jeanne veut les retenir et agite son étendard. En vain ! Nos rangs sont dispersés. Ciel ! Talbot fond sur elle… Dieu, prenez-moi, et sauvez-la !… La poussière s’est accumulée. Je ne vois plus que la confusion d’une horrible mêlée… Ah ! j’aperçois… Horreur ! Jeanne laisse échapper de ses mains sa bannière. Elle chancelle ; elle tombe ! Nos hommes l’entourent… Trop tard ! Elle est donc venue ici pour mourir ?… Les trompettes sonnent la retraite. On emporte la Pucelle. Pitié, Seigneur ! pitié !
Scène VI
Frère Richard, Jeanne, blessée, Lahire et Jean de Metz, qui portent Jeanne et la déposent au pied d’un arbre.
Frère Richard, étanchant le sang qui coule de la blessure de Jeanne.
Un nuage est sur ses yeux. Elle a perdu connaissance ; mais elle est vivante.
Lahire.
Jeanne ! Jeanne !
Jeanne, rouvrant les yeux.
Sommes-nous vainqueurs ?… (Elle fait un effort pour se soulever et s’affaisse.) Ah ! les forces me manquent. Mes genoux fléchissent… Ma bannière ? où est ma bannière ?
Jean de Metz.
La voici, Jeanne.
Jeanne.
Sommes-nous vainqueurs ?
Frère Richard.
Jeanne, vous êtes blessée. La lance de Talbot vous a percée au cou. Soyez calme !
Jeanne.
Sommes-nous vainqueurs ?
Jean de Metz.
Force nous est de battre en retraite.
Jeanne.
Jamais ! Je ne veux pas fuir. Que je meure plutôt !
Lahire.
Vive Dieu ! il serait plus facile de déplacer une montagne que de faire reculer cette fille !
Jeanne.
Et le roi ?
Lahire.
Le roi est sain et sauf.
Jeanne.
Saints et saintes, m’avez-vous abandonnée ? Jésus, je vous supplie, remettez-moi debout ! S’il vous plaît que je meure, la victoire d’abord, la mort après !
Frère Richard.
Pauvre Jeanne, laissez-nous panser votre blessure. Elle n’est aucunement dangereuse, mais elle saigne encore.
Jeanne.
Que ne peut chaque goutte de mon sang enlever un ennemi à la France ! Je le verrais tout couler avec joie.
Lahire.
Jarnidieu !…
Jeanne.
Ne reniez pas Dieu, bon Lahire !
Lahire.
J’enrage…. Que, n’ai-je là quelqu’un qui aille jurer pour moi, puisque vous me le défendez !
Jeanne.
Eh bien, pauvre Lahire, reniez votre bâton…
Lahire.
Ah ! je préférerais mourir que vous voir ainsi souffrir !
Jeanne.
Ne veuillez pas la mort pour vous. Portez-la plutôt à l’ennemi.
Lahire.
Je le voudrais bien. Mais je doute qu’aujourd’hui l’attaque soit de saison. Vous savez, Jeanne, si je le dis par couardise.
Scène VII
Les mêmes, Richemont.
Richemont.
Non, Lahire, tout n’est pas désespéré. L’artillerie fait merveille là où Jeanne l’a fait placer6, et elle tient l’ennemi en respect. Nous pouvons reformer nos rangs.
Jeanne.
Allez donc sans désemparer !
Lahire.
Jarni… bâton ! Que je te rencontre, Talbot, et tu me payeras la blessure de la Pucelle !…
Richemont.
Mais, Jeanne, vous souffrez…
Jeanne.
N’en soyez pas ému. Mon mal n’est rien… Jean de Metz, tenez toujours mon étendard ! (À Lahire et à Richemont.) Vous deux, à l’ennemi ! Faites incontinent sonner les trompettes. Attaquez à toute outrance !
(Ils partent.)
Scène VIII
Jeanne, Jean de Metz, frère Richard, Dunois, puis La Trémouille.
Dunois, accourant.
Jeanne, vous êtes donc blessée ?
Jeanne.
Je ne suis pas si fort blessée que je ne retourne au combat, bannière déployée. Les trompettes sonnent. Le corps-à-corps recommence. Je veux en être…
(Elle fait un effort et retombe.)
La Trémouille, survenant.
Jeanne, saint Michel fait un somme et t’oublie…
Dunois.
Que dites-vous, sire La Trémouille ?
La Trémouille.
Que mes prévisions sont réalisées, et qu’il faut accuser cette fille de la défaite.
Dunois.
Silence !… Voyez, elle pleure !
Jeanne.
Je ne vous en veux pas de m’offenser, sire La Trémouille. Ce qui me touche, c’est que nous soyons tant lésés et que je puisse si peu !
La Trémouille.
Pourquoi faire l’entendue, quand vous n’étiez bonne qu’à coudre et à filer ?
Dunois.
Quoi ! vous parlez ainsi à la Pucelle, à la fille de Dieu !
(Il le frappe du plat de son épée.)
La Trémouille, menaçant Dunois de son épée, puis se retenant.
Prince, vous me rendrez raison.
Dunois.
Duc, je vous méprise… Mais volontiers je verserai votre sang pour me faire la main contre l’Anglais.
Frère Richard.
Contenez-vous, messeigneurs !
Dunois.
Moine, laissez-nous vider notre querelle.
Jeanne.
Il n’y a qu’une querelle à vider : la grande querelle entre la France et l’Angleterre. Pour ce but, toutes dissensions doivent se taire. Chacun de vous songe à servir sa vengeance. Il s’agit de servir son pays.
Frère Richard.
Votre sang n’appartient-il pas à la France ? Avez-vous le droit de déserter le devoir commun ? Pouvez-vous dérober au royaume deux cœurs et deux bras, quand ce n’est pas trop de tous les cœurs pour l’aimer, de tous les bras pour le défendre ?
Jeanne.
Allez au combat ! L’honneur est là. Vengez-vous chacun sur l’Anglais !
Dunois.
Soit ! Que notre querelle profite au pays ! Vengeons-nous l’un de l’autre en nous dépassant l’un l’autre… Duc, je te somme d’être plus brave que moi. Aura eu raison celui des deux qui aura fait le plus de mal à l’ennemi. Frère Richard, et toi, Jean de Metz, je vous recommande Jeanne.
(Il s’élance. La Trémouille s’élance aussi.)
Scène IX
Jeanne, Jean de Metz, frère Richard.
Jeanne.
Montez là, au plus haut, Jean de Metz, et agitez mon étendard.
Jean de Metz.
Nos hommes reviennent à la charge. On se bat avec fureur des deux côtés.
Jeanne.
Dieu, protégez les Français ! protégez le roi !
Jean de Metz.
Dunois fait des prodiges. Je le vois en vingt endroits à la fois.
Jeanne.
Dieu, guidez-le ! Jean de Metz, agitez toujours la bannière !
Jean de Metz.
Malheur ! nos premiers rangs sont encore culbutés.
Jeanne.
Ah ! nos gens souffrent martyre et je ne suis pas là ! Il faut que j’aille avec eux. Il le faut ! (Elle se soulève et retombe.) Mon Dieu, soutenez-moi ! J’irai… j’irai… (Avec force.) Si mes jambes ne veulent pas me porter, mon cœur me portera… J’irai ! (Elle fait un suprême effort et tient debout.) Jean de Metz, ma bannière ! Donnez-moi ma bannière !
Frère Richard.
Saint Michel, défendez-la ! Rangez-vous autour d’elle, anges du Paradis !
(Jeanne s’est précipitée, accompagnée de Jean de Metz. On entend de loin sa voix.)
Jeanne, de dehors.
Soldats, où courez-vous ? Qui m’aime me suive ! Sus aux Anglais ! Notre sire Dieu les a condamnés. Seraient ils pendus aux nues, nous les aurons !
Scène X
Frère Richard, seul.
Que fais-je ici ? Ne faut-il pas tous s’aider pour que Dieu nous aide ? La meilleure prière, c’est de me battre comme les autres. J’y vais. C’est pourtant affreux de se jeter dans cette mêlée… Allons ! Ne tremble pas, frère Richard. La mort fuit qui l’affronte et cherche qui la fuit. Je vais échanger mon froc contre une armure ; et en avant d’estoc et de taille ! Me mette en morceaux qui me verra reculer d’un pas !
Scène XI
Luthold, John, puis Talbot.
John.
Quel prodige ! Jeanne est arrachée à la mort ! Talbot l’avait tuée. Mais les démons l’ont remise sur pied. C’est en fait. Quel élan ont ces Français ! Ils se croient donc immortels ?
Luthold.
Ah ! c’est Jeanne qui nous fait tout le mal, rien qu’en brandissant sa bannière. Devant cette bannière tous nos soldats frissonnent, comme frissonnent les petits oiseaux lorsque Dieu sur les nues promène son tonnerre. Seul, Talbot tient toujours, et, avec son épée rouge de sang, il fait autour de lui tourbillonner la mort… (Apercevant Talbot.) Capitaine, tout est perdu. La Pucelle ressuscitée est là qui mène le carnage. Il s’est fait une épouvantable boucherie de nos gens. Fuyez !
Talbot.
Moi fuir ! Allez-vous-en, poltrons ! Je tiendrai. L’enfer déchaînerait-il toutes ses légions, je resterai debout. Mais mon fils ? J’ai perdu de vue mon fils. Il allait comme un ouragan qui courbe les chênes. L’avez-vous aperçu ? (L’apercevant.) Enfin !
Scène XII7
Talbot, Robert.
Robert.
Ô mon père, comme ils ont un lugubre aspect tous ces cadavres par terre semés ! À côté du sire La Poule j’ai aperçu le pauvre Falstoff, que tant j’aimais et qui tant m’aimait. Hélas ! que Dieu ait son âme ! Je suis transi de douleur, et je ne demande plus qu’à mourir en bien combattant.
Talbot.
Ne parle pas ainsi. Ne fais pas de moi ton assassin. Va-t’en loin de cette fête de mort où t’a attiré ton père !
Robert.
J’ai nom Talbot. Et je fuirais ! Le monde dirait que je ne suis pas votre fils !
Talbot.
Tu n’es qu’un enfant ! Va-t’en aujourd’hui. Tu reviendras me venger demain.
Robert.
Pour qui fuit ainsi, plus de retour !
Talbot.
Mais demeurer tous deux, c’est la mort pour tous deux !
Robert.
Eh bien ! partez, et que ce soit moi qui reste ! En vous sauvant, vous sauvez l’Angleterre.
Talbot.
Veux-tu donc que ta mère perde en un jour tout ce qu’elle aime ?
Robert.
Mieux lui faire manque que lui faire honte !
Talbot.
Ton père t’ordonne de partir.
Robert.
Soit ! Pour combattre… Je ne puis me séparer de vous, pas plus que vous ne pouvez vous séparer de vous-même. Restez, partez ; ce que vous ferez, je ferai ; et, si vous mourez, je mourrai.
Talbot.
Alors, mon fils, disons-nous adieu.
Robert.
Auguste Angleterre, vieille citadelle de vertu et d’honneur, toujours victorieuse, aujourd’hui vaincue, accepte-nous comme victimes et, au prix de notre double mort, recouvre ta gloire !
Talbot.
Adieu, Robert !
Robert.
Adieu, mon père !
(Ils partent, chacun de son côté.)
Scène XIII
Robert, Richemont, puis Jeanne.
Richemont.
Halte-là, bouillant jeune homme !
Robert.
Sois le bienvenu, valeureux Richemont ! Le fils de Talbot est fier de se mesurer avec toi.
Richemont.
Tu cherches donc la mort ?
Robert.
Je regarde à l’honneur et non pas au danger.
(Ils se battent. Robert tombe. — Jeanne survient et voit Robert expirant.)
Jeanne, émue.
Malheureux fils du grand Talbot ! vous aurez bien peu vécu…
Robert.
Trop peu pour mon pays, mais assez pour ma gloire.
Jeanne.
Loi exécrable de la guerre !
Robert.
Comment ai-je eu pour devoir de vous haïr, vous qui méritiez tant d’être aimée !… Adieu, ma mère… Adieu… Jeanne !
(Il meurt.)
Richemont.
Il ne respire plus. C’est fini. Un portrait à son cou. Mêmes traits que les siens. C’est sa mère, sans doute. Elle sourit. Ah ! belle dame, quand vous souriiez ainsi, votre fils n’avait pas ce teint décoloré et ces yeux clos.
(Il s’en va.)
Scène XIV
Jeanne, seule.
Pauvre jeune homme, arraché à ton foyer pour trouver ici la mort, sois pleuré par moi, en attendant que ta mère te pleure… (Se tournant vers la croix.) Bon Jésus, prends-le en ton paradis ! Ô bon Jésus, tu es mort pour sauver les hommes ; et voici que des hommes tuent des hommes, que des chrétiens tuent des chrétiens. Il fait jour de beau soleil. Les oiseaux volettent et chantent si doucement qu’il n’est cœur qui n’en soit joyeux. Et nous, nous nous donnons la mort, au lieu de jouir tranquillement des biens de la vie ! Ah ! je sens mes cheveux se dresser sur la tête à voir ainsi le sang couler. Maudite la guerre ! Égorgeurs qui avez fait passer la mer à tant de braves Anglais pour venir chez nous faire des veuves et des orphelins et puis y périr, soyez maudits ! Ou plutôt, Dieu vous change et vous pardonne !
Scène XV
Jeanne, Isabeau.
Isabeau.
À moi ! à moi !
Jeanne.
Quels sont ces cris ? C’est Isabeau !
Isabeau.
À moi ! pitié ! Hélas ! les Anglais me dédaignent, et les Français m’insultent. Je vais donc mourir dans les pires tortures ? Qui m’arrachera ce dard empoisonné ?… Je ne puis… je ne puis… Ah ! la Pucelle ! C’est toi la cause de nos malheurs, abominable sorcière ! Tu as vaincu aujourd’hui ! mais demain ! Je t’abhorre. (Voyant avancer Jeanne.) Que viens-tu faire ? M’insulter aussi ? me porter le dernier coup ? Arrière !
Jeanne.
Malheureuse femme !
Isabeau.
N’approche pas ! Arrière ! arrière !
Jeanne.
Laissez-vous assister.
(Jeanne retire le dard. Isabeau pousse un soupir de soulagement.)
Isabeau.
Tu m’as soulagée ; mais je ne te remercie point. J’aurais voulu ne rien te devoir. Puissé-je être ton mauvais génie ! Malédiction sur le dauphin !
Jeanne.
Malheureuse !
(Elle s’en va.)
Isabeau.
Malédiction sur toi ! malédiction aussi surmoi !
(Elle se traîne, expirante, et disparaît.)
Scène XVI
Talbot, seul.
(Il arrive blessé et aperçoit le corps de son fils.)
Qu’ai-je vu ?… Robert, te voilà donc inanimé ! C’était pourtant à toi de m’ensevelir… Mort, tu es cruelle, tu es injuste d’épargner le père et de frapper le fils… Encore si, au prix d’une telle perte, nous avions la victoire ! (Regardant le champ de bataille.) Lamentables débris ! Irréparable deuil ! Morts tous mes capitaines ! Morts mes meilleurs amis ! Mort mon enfant ! Eh bien ! heureux sont-ils d’être morts, pour ne pas voir l’abîme de nos maux… Et moi, pourquoi suis-je encore vivant ? Frappez-moi, Français ! tuez-moi ! Ou plutôt, que je me frappe, que je me tue moi-même !… Mais quoi ! ma main ajouterait une autre perte aux pertes de l’Angleterre ? Non ; vis, Talbot : résigne-toi à vivre. Et toi, patrie, reçois mon plus grand sacrifice. Pour toi, je consens à voir mourir ma gloire et mon fils, et à ne pas mourir.
Scène XVII
Talbot, Lahire, Jeanne.
Lahire.
Tu mourras, Talbot. Ne va pas plus avant. Tout à l’heure, tu avais la fureur de l’orage : te voilà affaissé.
Talbot.
Tu n’as pu me trouver qu’à la trace du sang des tiens que j’ai répandu. Maintenant mes forces trahissent mon vouloir. Jean de Metz m’a blessé. (Montrant le cadavre de son fils.) Mais voilà d’où vient ma plus grande blessure.
(Ils combattent. Talbot est désarmé.)
Lahire.
Fais ta paix avec Dieu. Assez longtemps tu t’es rassasié de notre sang. Mon épée a soif du tien.
Talbot.
Tais-toi et frappe.
Jeanne, survenant.
Arrêtez, Lahire. Le grand Talbot a droit à la vie.
Lahire.
Il n’a droit qu’à la mort.
Talbot.
À la mort et à l’immortalité !
Jeanne.
Lahire, arrêtez.
Talbot.
Va, Lahire, ta pitié me serait rigueur. Puisque c’est la défaite, que la mort suive ! Je t’aurais frappé. Frappe-moi.
Jeanne, lui prenant les mains avec force.
Lahire, arrêtez, arrêtez ! Ne frappez pas le grand Talbot.
Lahire.
Talbot, je te fais grâce de la vie. Tu es d’ailleurs de bonne prise et tu nous donneras belle rançon.
Jeanne.
Lahire, la guerre n’est pas un trafic.
Lahire.
Jarni… ! Qui remporte l’honneur a bien droit au profit… Mais, Jeanne, vous êtes ma souveraine, et je vous livre Talbot.
Jeanne.
Sire Talbot, Lahire vous a octroyé la vie ; je veux vous octroyer la liberté. C’est dû à votre vertu. Partez. Mais promettez de ne pas combattre contre la France.
Talbot.
Vous pouvez me garder, mais non obtenir que, libre, je ne me batte pas pour mon pays.
Jeanne.
Eh bien ! faites selon votre pensée et soyez libre.
Talbot.
Jeanne, je vous avais méconnue. Vous êtes grande.
Scène XVIII
Les mêmes, Charles, Dunois, Richemont, frère Richard.
Charles.
Voici donc le fier Talbot en nos mains !
Talbot.
C’est la fortune… Vainqueurs, profitez-en puisque aujourd’hui vous l’êtes. Les Anglais l’étaient hier et le seront demain.
Dunois.
Que vois-je ? Votre fils est mort ! Noble vaincu !
Talbot.
Sire Dunois, n’appelez pas ainsi mon fils. Ayant été frappé les armes à la main, il n’est pas un vaincu. Qui meurt dans le combat en a tout l’honneur et n’a point part aux hontes de la défaite… Il n’y a de honte que pour les survivants.
Jeanne.
Sire, notre souverain bien-aimé et bien obéi, j’ai dit au noble Talbot qu’il serait libre, et sans rançon.
Dunois, regardant Jeanne avec admiration.
Héros dans la mêlée, ange après la victoire !
Charles.
Comme vous voulez, Jeanne, il doit être fait. Tout pour l’honneur ; rien pour la haine !… Talbot, vous êtes le plus valeureux des Anglais. Il faut que vous connaissiez la générosité des gens de France. Soyez libre8. Votre fils mérite de pieuses funérailles. Emportez son corps.
(Jeanne baisse sa bannière ; le roi et les seigneurs baissent leurs épées et leurs lances, et tous saluent le corps de Robert, que des hommes d’armes mettent sur une civière pour l’emporter.)
Jeanne.
Frère Richard, de bon soldat redevenez bon prêtre, et bénissez-le.
Frère Richard.
Restes sacrés d’un vaillant chevalier, soyez bénis ! Ô fils du grand Talbot, ton âme, impatiente d’immortalité, a brisé ses liens. Laisse tes ennemis rendre hommage à ta vertu. Dieu te prenne en son saint paradis ! Tu fus un héros.
Talbot.
Jeanne, messeigneurs, je garderai un éternel souvenir de votre courtoisie et magnanimité.
Scène XIX
Les mêmes, moins Talbot.
Richemont.
Frère Richard, comment appelle-t-on le village qui est à notre droite ?
Frère Richard.
On l’appelle Patay.
Richemont.
Voilà un nom dont il sera toujours mémoire. Nos arrière-petits-fils se souviendront qu’ici l’Anglais fut abattu sous les auspices de la glorieuse Pucelle.
Jeanne.
Ne parlez pas ainsi, Richemont, ou je vous fais couper la langue. Tout l’honneur est dû au glorieux Seigneur du paradis.
Charles.
Jeanne, il n’y a chose où vous ayez votre pensée que je ne voulusse vous donner.
Jeanne.
Sire, il n’est si beau joyau que la terre de France ; et il me semblera l’avoir quand vous l’aurez.
Charles.
Tu ne veux donc ni biens ni éloges ?
Jeanne.
Récompensez et louez vos gentilshommes et hommes d’armes, tous gens d’âme vaillante. Ils ont fait de belles prouesses et vous aiment jusqu’à mourir… Doux sire, il me tarde bien d’être à Reims, d’entendre sonner les cloches à grandes volées, et d’entonner à toute voix : Te Deum laudamus. Ne différons ni heure ni demie. Reims est la clef de tout.
Charles.
Folie qu’une telle marche ! Il n’y a sur le chemin que places garnies d’ennemis.
Jeanne.
Sire, je vous certifie, sur ma vie, que nous entrerons en toutes les villes qui doivent être de votre obéissance.
Dunois.
N’ayez doute, sire. Nous arriverons, quelques forces qui marchent contre. J’ai foi. Nous avons tous foi ! À cette heure, les plus vaillants partis sont aussi les plus sages.
Jeanne.
À Reims ! Votre heure est venue, gentil dauphin. Les saintes légions des anges combattent avec nous. Dieu du haut du ciel vous tend votre couronne. Soyez roi !
Charles.
À Reims !
Acte quatrième
Premier tableau À Reims. — Le sacre.
Salle du château de Reims.
Scène première
Frère Richard, Jeanne.
Frère Richard.
Comme vous êtes parée, Jeanne !
Jeanne.
J’aurais voulu me couvrir d’or et de joyaux. Ce jour n’est-il pas le grand jour ? Je sens mon cœur bondir d’allégresse comme une jeune épousée.
Frère Richard.
Des flots d’hommes, de femmes, d’enfants, se pressent par la ville et assiègent la cathédrale. Le roi revêt le manteau du sacre ; les douze pairs en grand costume vont lui faire cortège.
Jeanne.
Il y a douze pairs ? Sans doute en souvenir des douze disciples qui étaient autour de Notre-Seigneur. Parmi les douze il y eut un traître. Puisse parmi ces douze n’y avoir pas un Judas !
Frère Richard.
Il y en a un, Jeanne, et depuis longtemps vous l’avez deviné : c’est La Trémouille. Des papiers trouvés à Reims le montrent vendant aux Anglais des vivres et des munitions. La guerre qui nous appauvrit l’enrichissait. Pourquoi étiez-vous si ardente à vouloir tout conclure par la victoire et la paix ? Vous gêniez le petit commerce du sire La Trémouille9.
Jeanne.
Vous êtes méchant, frère Richard.
(Entre La Trémouille.)
Scène II
Jeanne, frère Richard, La Trémouille, puis Charles, Dunois, Richemont, Lahire, Jean de Metz, seigneurs.
La Trémouille.
Une femme au sacre, à côté des pairs et du roi ! Ce serait en dehors de toutes les traditions, absolument contraire à l’étiquette !
Frère Richard.
L’Anglais, qui était partout vainqueur, n’a été vaincu que quand cette femme s’est montrée. Et cela aussi n’a pu avoir lieu qu’au mépris de toutes les traditions, par grand outrage à l’étiquette.
La Trémouille, à Jeanne.
Du moins est-il sûr que l’oriflamme doit seule figurer au couronnement. Remportez votre étendard.
Jeanne.
Il était à la peine, il doit être à l’honneur !
Charles.
Gardez-le, Jeanne. Il fera vis-à-vis à l’étendard royal qui est aux mains de notre fidèle et aimé Dunois, premier prince de France. Vous, Dunois, serez à ma droite ; et vous, Jeanne, à ma gauche.
La Trémouille.
Sire, après Dunois je suis le premier seigneur de France. À vos côtés est ma place. Je crois la mieux remplir qu’une femme, et, qui pis est, une femme sans nom.
Dunois.
Vraiment ! vous reprochez à Jeanne d’être une femme ! D’elle et de vous, d’elle et de nous tous, quel est l’homme, quel est le héros ? Sans nom, elle, Jeanne l’Inspirée, Jeanne la Victorieuse ? Son nom est d’Orléans
. L’oubli nous couvrira tous, que les siècles glorifieront encore la Pucelle d’Orléans !
La Trémouille.
Jeanne a eu courage et succès : il lui manque la race, donnant seule des droits.
Dunois.
Si basse est sa naissance, haute est son âme. Ses services lui font une lignée d’ancêtres. En d’autres une race s’enterre ; en elle une race se fonde.
Charles.
Vous reprochez à Jeanne d’être roturière ? Eh bien, je l’anoblis… Jeanne, je ne puis rien pour ta gloire. Ton cœur et tes œuvres t’ont conféré une noblesse devant laquelle pâlit la noblesse des barons et des marquis, des comtes et des ducs. Mais, du moins, laisse-moi honorer mes gentilshommes en te faisant de leur famille. Fléchis le genou : je te donne l’accolade. Roturière, relève-toi noble. Je déclare que tu es d’un sang le plus généreux de France.
Jeanne.
Sire, merci.
Charles.
Quelle sera ta devise ?
Jeanne.
Sire, les miens ont toujours travaillé, et moi-même j’ai tâché de faire bon labeur à votre service. Ma devise sera : Vive labeur !
Charles.
Quant à vous, sire La Trémouille, si fier de la noblesse de votre lignage, je voudrais que vous pussiez l’être de la noblesse de vos actes. Je viens d’apprendre avec grande déplaisance et douleur vos mauvais comportements. C’est vilaine chose à qui est des premiers par le rang d’être des derniers par la conduite.
La Trémouille.
Gentil sire, on m’a vu devant l’ennemi…
Charles.
Laissez là votre parler cauteleux. Je sais que vous êtes brave ; mais je sais aussi que vous avez fait commerce avec l’Anglais. Jeter le filet dans la commune détresse pour y pêcher une fortune, est-ce faire œuvre de gentilhomme ? Non. Vos marchandages vous ont rendu indigne de prendre rang parmi mes pairs. En votre lieu et place j’installe cette fille, qui s’est ennoblie à l’heure où vous dégénériez. Vos aïeux furent grands, mais vous êtes petit ; et vous n’avez qu’un nom quand elle a des vertus.
La Trémouille.
Sire, la calomnie me frappe aujourd’hui ; vous me rendrez mieux justice demain.
(Il se retire avec un air de dignité.)
Un héraut d’armes.
Sire, monseigneur l’archevêque de Reims vient de quérir à Saint-Rémi la sainte ampoule et vous attend aux portes de la cathédrale.
Charles.
Au sacre !
Scène III
Le chœur de la cathédrale de Reims.
Romée, Mengette.
(Elles se détachent de la foule qui se presse au fond du chœur. — On entend les sons de moins en moins lointains de la musique, qui joue une marche triomphale.)
Mengette.
Quelle peine nous avons eue, mère d’Arc, pour nous frayer un passage ! On dirait tout le peuple de France ici réuni. Jeanne nous reconnaîtra-t-elle ? Quelle joie de penser que c’est votre fille, que c’est mon amie !
Romée.
La musique approche ; le cortège est là, Mengette. Je ne puis parler, tant j’ai d’émotion.
(Des hérauts d’armes font ranger la foule, ainsi que Romée et Mengette. Le cortège défile solennellement le long de la grande nef, vers le maître-autel, pendant que la musique continue à jouer la marche triomphale. Le roi, avec Jeanne, Dunois, Richemont, Lahire, Jean de Metz, pairs et seigneurs, l’archevêque avec ses assistants, et enfants de chœur, prennent place.)
Scène IV
CHARLES, sous un dais, Jeanne et les pairs à ses côtés, l’archevêque et ses assistants, devant le maître-autel, enfants de chœur, jeunes filles, jeunes gens, vieillards, prêtres, nobles, bourgeois et manants, soldats.
(On entend orgues et cloches.)
Enfant de chœur, tournés vers la foule et chantant.
Adeste, fideles, læti et precantes,
Venite, venite in hunc cœtum ;
Magno Franciæ regi applaudite.
Venite coronemus, venite coronemus, venite coronemus Carolum.
Jeunes filles et jeunes gens, qui arrivent en chantant.
(Air du Venite.)
La France est triomphante ! (Ter.)
Gloire au roi !
Vieillards.
La France est triomphante ! (Ter.)
Gloire à Dieu !
Tous, en chœur.
La France est triomphante ! (Ter.)
Gloire à Dieu !
(Cortège de prêtres, de nobles, de bourgeois et manants.)
Un prêtre.
Beau sire, nous vous saluons, nous, les prêtres, qui prions pour tous.
Un noble.
Beau sire, nous vous saluons, nous, les nobles, qui combattons pour tous.
Un homme du peuple.
Beau sire, nous vous saluons, nous, bourgeois et manants, qui travaillons pour tous.
(Tambours et trompettes ; puis joueurs de flûte et de hautbois. Hallebardiers, piquiers, arbalétriers, archers, et autres gens d’armes.)
Scène V
Les mêmes, Alain Chartier.
L’archevêque.
Avant que je m’acquitte de mon ministère, comme interprète de Dieu, nous devons, selon les vieux us, entendre un interprète des hommes de France. Çà, messire Alain Chartier, archiprêtre de Paris, père de l’éloquence française, parlez.
Alain Chartier, s’adressant au roi.
Noble sire, qui relevez en son gai parterre le beau lis de France, salut à vous ! C’est le privilège des rois d’être trop grands pour envier ou être enviés et de travailler à leur propre bien en se dévouant au bien de tous. Méritez d’être béni dans la cabane comme dans le château. Tant que l’amour des plus humbles fait la garde autour des trônes, les trônes sont inébranlables. Puisse votre race durer autant que la France, et la France autant que le monde !… Et toi, douce paix, descends sur ce royaume, comme la rosée sur les prairies qu’elle fertilise ! Qu’enfin l’épée se repose, et qu’il n’y ait plus que des frères, s’entraidant sous l’œil paternel de Charles le Victorieux.
(Musique.)
Alain Chartier, s’adressant à Jeanne.
Salut, Vierge de la délivrance !… C’est toi qui, femme en face d’hommes, ignorante en face de doctes, seule contre tous, parlas en inspirée du Saint Esprit. C’est toi qui, mettant un frein à la fierté anglaise, as réveillé la française audace. C’est toi qui, prenant le roi au fort de la tempête, l’as ramené au port. Merveille de magnanimité et de grâce, tu n’es pas seulement la gloire de la France, qui te fera un jour sa patronne ; tu es la gloire de l’humanité10.
(Musique.)
L’archevêque.
Maître Alain Chartier, pour achever le quadriloge, célébrez, à côté du roi et de la libératrice, les guerriers qui sont morts, et la France… qui ne meurt pas.
Alain Chartier.
Salut à vous, guerriers morts pour préparer cette fête ! Le bonheur du jour qui nous luit ne saurait effacer les deuils de la veille. Les champs dévastés reverdiront ; les murs renversés se relèveront ; mais les morts ne peuvent être réveillés dans leurs tombes… Héros du devoir, vous saviez que la prospérité d’un pays réside dans son indépendance, et que son indépendance réside dans le courage de ses fils ! Et vous vous êtes donnés… Par vous est sauf notre patrimoine d’honneur. Que votre gloire nous console de votre perte, et qu’en nos âmes revivent vos vertus !
(Musique.)
Alain Chartier, reprenant.
Salut à la France ! Est-il pays plus beau que le pays de France ? Qu’il soit à jamais mortel aux envahisseurs, ce pays aimé de Dieu, envié des hommes, où les champs se parent d’épis et les arbres de fruits, sans craindre ni les feux de l’été ni les glaces de l’hiver ; où les rouges grappes de la vigne versent aux cœurs, avec le bon vin, la gaieté et le courage ; où des milliers de héros et de martyrs, ensevelis les uns sur les autres, ont fait des entrailles du sol un temple sacré ; où le génie prodigue ses créations, la vertu ses sacrifices, (désignant Jeanne) le patriotisme ses miracles11.
(Musique. — L’archevêque prend solennellement la sainte ampoule que tient frère Richard.)
Scène VI
L’archevêque, Charles, Richemont, Jeanne, seigneurs, soldats, peuple.
L’archevêque.
Monseigneur, que demandez-vous ?
Charles.
La couronne de France.
L’archevêque.
En quel nom ?
Charles.
Au nom de Dieu qui élève et détruit les empires, qui m’avait fait roi par la naissance et qui vient de me consacrer roi par la victoire.
L’archevêque.
Que l’huile sainte, coulant sur votre front, vous oigne comme un bon athlète se préparant au combat pour le bien contre le mal, pour le droit contre l’injustice, pour le pays contre l’envahisseur ! Par la vertu de cette onction sainte, puissiez-vous régner en joie et prospérité, avoir longue vie et grande gloire, environné de l’invisible milice des anges et sous la garde de Dieu !… Si vous devez délaisser le service du Christ et de son Église ; si vous devez ravir son denier à la veuve, son patrimoine à l’orphelin, ne touchez pas à cette couronne.
Charles.
Je me souviendrai que le souverain de tous doit être le père et le modèle de tous.
L’archevêque, donnant au roi l’épée, qui jusque-là a été tenue par Richemont, debout devant l’autel.
N’emploierez-vous l’épée que contre la rapacité et la déloyauté ?
Charles.
Oui, avec l’aide de Dieu.
L’archevêque, donnant au roi la main de justice, qui jusque-là a été tenue par Jean de Metz, debout devant l’autel, à gauche de Richemont.
N’emploierez-vous la main de justice qu’en faveur de l’équité et de la miséricorde ?
Charles.
Oui, avec l’aide de Dieu.
L’archevêque, donnant au roi le sceptre, qui jusque-là a été tenu par Lahire, debout devant l’autel, à droite de Richemont.
N’emploierez-vous le sceptre que pour maintenir les bonnes coutumes et établir de bonnes lois ?
Charles.
Oui, avec l’aide de Dieu.
L’archevêque.
Quels sont les garants de votre parole ?
Charles.
Mes ancêtres, Philippe-Auguste, saint Louis.
L’archevêque.
Au nom de la sainte Trinité, nous vous sacrons roi de France… Nobles pairs, voici votre roi. Promettez vous fidélité et obéissance ?
(Les pairs élèvent leurs épées ; Jeanne élève sa bannière ; Dunois élève l’oriflamme.)
Richemont.
Nous, pairs de France, frères du royaume, les yeux fixés sur les étendards des vainqueurs de Poitiers, de Bouvines, de Taillebourg, de Damiette, qui flottent sur ces murs, promettons fidélité et obéissance, déclarant accepter pour notre légitime seigneur et roi Charles, fils de Charles. S’il y a quelqu’un qui veuille y contredire, nous sommes et serons là pour faire justice.
(Éclats de fanfares.)
L’archevêque.
Sire, au temps de Clovis, un ange descendit poser lui-même la couronne sur sa tête… L’ange est ici ! Approche, Jeanne, et couronne ton roi.
(Jeanne met la couronne sur la tête du roi, et, se jetant à ses pieds, elle embrasse ses genoux dans un élan enthousiaste et extatique.)
Jeanne.
Gentil sire, maintenant est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que vous vinssiez à Reims recevoir votre digne sacre, montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume doit appartenir. Dieu vous donne le bonheur sur terre, et son beau paradis où est joie infinie !
L’archevêque.
Jeanne, ce n’est pas assez de vos vœux. En couronnant le roi, vous lui devez des conseils.
Jeanne, toujours à genoux.
Sire, ayez toujours présent à la mémoire que le royaume de France appartient à Dieu, et que vous l’avez en garde pour faire prospérer le règne de Dieu.
Charles.
Et qu’est-ce que le règne de Dieu, bonne Jeanne ?
Jeanne.
Là où fleurissent paix, droiture, justice, débonnaireté, là fleurit le règne de Dieu.
Charles.
Jeanne, n’as-tu pas de requête à m’adresser ?
Jeanne.
Doux sire, je voudrais bien vous requérir en faveur des pauvres gens de mon village. Tandis qu’ici il y a profusion, j’ai vu là-bas des paysans n’ayant ni lits ni meubles en leurs réduits, économisant sur leur faim pour ensemencer un coin de terre, et obligés de s’arracher de la bouche leur morceau de pain d’avoine pour payer la taille aux gens du roi. Veuillez les exempter des impôts, qui, après qu’ils ont tant sué et peiné, viennent rogner le peu qu’il leur faut pour ne pas mourir.
Charles.
Ce sera fait. Mais pour toi, Jeanne, pour toi qui m’as donné un trône ?
Jeanne.
Pour moi, je n’ai de requête à faire qu’au Ciel.
Charles.
Et que demandes-tu au Ciel ?
Jeanne.
Le salut de mon âme.
(Elle est toujours à genoux, les mains sur le visage et en larmes.)
L’archevêque.
Ne pleure pas, Jeanne… Seigneurs, bourgeois, manants, hier c’était l’heure de semer et de gémir. Aujourd’hui c’est l’heure de moissonner et de se réjouir. Roi, venez sur le parvis vous montrer au peuple qui veut vous acclamer, et que le Te Deum apporte à Dieu nos bénédictions !
(On chante :)
Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.
Te æternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, tibi cœli et universæ potestates,
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cœli et terra majestatis gloriæ tuæ.
(Le chœur se vide. Jeanne, toujours agenouillée et pleurant, fait signe qu’elle ne veut pas suivre le cortège. Restée seule, elle ôte lentement les mains de dessus son visage et regarde autour d’elle.)
Scène VII
Jeanne, seule ; puis frère Richard.
Jeanne.
Est-ce bien moi, Jeanne, qui suis ici et qui viens de voir sacrer le roi ? Ne me suis-je pas endormie sous l’arbre des fées ? Ne viens-je pas de faire un long rêve ?… Non, c’est réel. Et le dauphin, et les seigneurs, et ma bannière, et les batailles, et le sacre, tout cela n’est pas un songe. Les voix ne m’ont pas trompée… Mais vous, ma mère, où êtes-vous ? Où êtes-vous, collines de Domrémy, avec vos verts sommets où luisait l’or du soleil couchant ? Où êtes-vous, blancs agneaux qui broutiez l’herbe tandis que je cousais et filais ? Où es tu, claire fontaine dont l’eau me désaltérait ? Gai carillon des sonnettes de nos bœufs et de nos brebis, suave musique des cloches sonnant l’Angélus, chants lointains des pâtres, ne vous entendrai-je plus ? Ici, dans cette pompe, au milieu de ces seigneurs, je me sens dépaysée. C’est là-bas, là-bas, près de ma mère, près de la bonne terre, qu’est la vie. Joies du foyer, paix du village, mon cœur soupire après vous, comme la plante après la rosée, comme l’hirondelle après son nid. Quand reverrai-je la maison où je suis née et, tout auprès, l’église entourée de tilleuls ? Mon Dieu, achevez vite la délivrance et renvoyez-moi où m’attend le contentement…Mère bien-aimée, que faites vous ? Ne pensez-vous pas à moi ? Ne reviendrai-je plus vous servir et partager votre douce vie ?
(Au moment où Jeanne prononçait ces dernières paroles, frère Richard a amené Romée et Mengette. Il s’approche de Jeanne, tout absorbée en ses pensées, et la prend par le bras.)
Frère Richard.
Vous êtes triste, Jeanne. Manque-t-il rien à votre bonheur ?
Jeanne.
Il y manque le regard de ma mère.
Frère Richard.
Voyez-la12 !
Scène VIII
Jeanne, Romée, Mengette.
Romée.
Jeanne !
Jeanne.
Ma mère ! C’est donc vous !… Pardonnez-moi ma désobéissance !
Romée.
Te pardonner le salut du royaume ! c’est à moi de te demander pardon. J’ai toujours cru que les démons t’égaraient… Comme je craignais de mourir avant de t’avoir revue !… C’est donc ma fille, cette guerrière que tout le monde acclame et qui fait le dauphin roi !
Jeanne, apercevant Mengette.
Et toi aussi, Mengette !
Mengette.
Ah ! je ne sais comment, de te revoir, cela me tire des larmes.
Jeanne.
Laisse les larmes aux pauvres femmes d’Angleterre, qui ont à pleurer leurs fils et leurs maris.
Mengette.
Comme on t’aime, Jeanne ! Il semble que le roi n’est à Reims que pour mener ton triomphe. Tu es bien heureuse.
Jeanne.
Je le suis de te revoir et de revoir ma mère.
Romée.
Je voudrais bien que tu reviennes au village, Jeannette.
Jeanne.
Plût à Dieu !
Mengette.
Je te montrerais mon fils.
Jeanne.
Tu es donc mère, Mengette ?
Mengette.
Oui, et c’est la plus grande joie. Si tu voyais notre enfantelet s’essayant à marcher ! Il fait un pas, deux pas, les mains tendues vers moi ; puis chancelle et tombe dans mes genoux. Et ses caresses quand, assis sur mes bras, il sourit et nous baise tour à tour ! Cher petit, il réjouit la maison et nous remplit le cœur !
Jeanne, essuyant des larmes.
Mengette, la main dans la main de ton mari, votre enfant sur tes genoux, quand tu tressailleras de bonheur, pense quelquefois à moi.
Romée.
Repars avec nous, Jeanne.
Jeanne.
Impossible ! On a annoncé que les Anglais assiègent Compiègne. Je ne saurais abandonner cette cité, si bonne française. Où est le péril, là est ma place.
Mengette.
Comment peux-tu aller ainsi au milieu des tueries ?
Jeanne.
Ne parlons pas de ces exterminations d’hommes, même doucement et à voix basse… Que les Anglais n’ont-ils quitté tout le pays !
Romée.
Ma fille, ils te tueront !… Crains-les !
Jeanne.
Je ne crains que la trahison.
Scène IX
Les mêmes, femmes et enfants ; puis, ne se montrant que quelques instants, La Trémouille et Cauchon.
Première femme.
Jeanne, daignez toucher ce chapelet.
Jeanne.
Touchez-le vous-même ; l’effet sera aussi bon.
Seconde femme, tenant une petite fille dans ses bras.
Je vous en conjure, bénissez ma fille, qui est malade, mourante.
Jeanne.
Que Notre-Seigneur la bénisse ! Je ne puis que prier avec vous pour elle.
(Elle s’agenouille et prie. À l’autre bout du chœur, sur les bas-côtés, apparaissent La Trémouille et Cauchon, déguisé en moine.)
Cauchon.
N’ayez peur, sire La Trémouille. Sous ce capuchon de moine, on ne reconnaîtra pas l’évêque Pierre Cauchon. Eh bien ! vous décidez-vous ?
La Trémouille.
Entendu. Flavy, le gouverneur de Compiègne, m’appartient. Je la ferai prendre.
Cauchon.
Et moi, prise, je la ferai brûler.
La Trémouille.
Charles est changeant. Je redeviendrai le maître.
Cauchon.
Bedford est reconnaissant. Je deviendrai cardinal.
(Ils s’éloignent.)
Première femme.
Voyez : l’enfant rouvre les yeux ; son visage se recolore ! Ne devons-nous pas vous baiser les pieds ? N’êtes-vous pas la sainte de la France ? N’est-ce pas vous…
Jeanne.
Excusez-moi ; je ne puis vous laisser continuer. L’assaut des Anglais était plus facile à soutenir que de tels éloges… (Elle va vers un groupe d’enfants et les caresse.) Je vous aime bien, mes petits enfants. Aimez toujours bien le roi notre sire et le bon royaume de France… Mes petits enfants, chers amis, je ne durerai plus longtemps. Quand je serai morte, dites dans vos prières : Mon Dieu, ayez pitié de votre pauyre servante, Jeanne la Pucelle !
Romée.
Ma fille, ma fille, que dis-tu ? Pourquoi cette tristesse ?…
Scène X
Les mêmes, Lahire.
Lahire.
Jeanne, le peuple vous réclame ; le roi vous attend. Venez vous montrer sur le parvis. Venez.
Jeanne, soucieuse, se parlant à elle-même.
L’avenir est douteux ; mon devoir ne l’est pas. J’irai à Compiègne… Maintenant que Dieu a donné la victoire, je puis bien donner ma vie.
Lahire.
À quoi rêvez-vous, Jeanne ?
Jeanne, prenant sa bannière.
Allons !
(On entend l’orgue et les derniers versets du Te Deum.)
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
Quemadmodum speravimus in te.
Acte cinquième À Rouen. — Le martyre.
Premier tableau Dans la prison.
Scène première
Jeanne, Loiseleur.
Jeanne.
Messire Loiseleur, pourquoi me regarder ainsi, tristement et en silence ? Parlez-moi.
Loiseleur.
Priez, Jeanne.
Jeanne.
N’y a-t-il donc rien à espérer ?
Loiseleur.
Rien.
Jeanne.
Que dois-je craindre ?
Loiseleur.
Tout.
Jeanne.
Quoi ! on voudrait me tenir à jamais dans ce cachot ?
Loiseleur.
Pis que cela. On pense à vous faire mourir.
Jeanne.
Mourir ! ce n’est pas possible. Qu’ai-je donc fait ? Vous me connaissez… J’étais ici enterrée vivante. Aucune figure, aucune parole amie. Rien que cet évêque et ces clercs, qui de temps en temps apparaissaient comme des ombres lugubres et m’interrogeaient, la menace à la bouche. Vous êtes venu, vous, prêtre de mon parti. Vous m’avez entendue au tribunal de la pénitence. Eh bien, dites si je ne suis pas innocente ; dites si on peut me frapper… Ne suis-je pas prisonnière de guerre ?… Les miens me rachèteront ; les miens me délivreront.
Loiseleur.
Les nôtres sont perdus, Jeanne… Vous avez été prise devant Compiègne. Eh bien, demain peut-être, dans cette même ville, Dunois et Lahire seront tués.
Jeanne.
Quoi ! Lahire et Dunois en danger de périr !
Loiseleur.
Oui… Compiègne ne peut plus se défendre, et les Anglais, dans leur rage, ont juré que tous les habitants, hommes, femmes et enfants, depuis l’âge de sept ans, seraient exterminés.
Jeanne.
Oh ! je ne survivrai jamais à une telle destruction de pauvres gens ! Mon Dieu ! mon Dieu ! les laisserez-vous mourir ?
(Elle se laisse tomber sur un escabeau et sanglote, la tête dans ses mains.)
Loiseleur, à part.
Fille d’enfer, je te trompe, de même qu’avec les ruses de Satan tu as trompé le monde. C’est œuvre pie de trahir qui trahit et de recourir aux trames infernales contre le suppôt des esprits infernaux… La voilà bien préparée à douter de ses voix. Allons avertir monseigneur Pierre Cauchon pour qu’il l’interroge. Peut-être sera-t-il enfin plus heureux.
Scène II
Jeanne , seule.
Pauvres amis de Compiègne, pauvres amis…. (Elle va à la fenêtre de sa prison.) Ces nuages que porte le vent vont là-bas vers les régions où peinent les nôtres. Que ne puis-je suivre ces nuages….. Ah ! quand reparaîtrai-je sur le champ de bataille, droite sur mon cheval, agitant ma bannière et jetant le cri de France : Montjoie et Saint-Denis !
J’entends d’ici les plaintes et lamentations de ces braves assiégés, si loyaux à leur seigneur. Les trompettes sonnent l’alarme ; on se bat ; mes compagnons se font tuer ; et moi je suis prisonnière… Hélas ! on pense à me faire mourir… Je n’aurais donc plus puissance de servir le roi et le royaume ?… Eh bien, non ! Que mon corps aille là où est mon âme !.. Ciel ! quelle hauteur13 !… Mais ce n’est pas cela qu’il faut regarder. Allons ! finisse ma prison ! Ce sera la guerre avec l’Anglais ou la douce paix du paradis. Autant mourir que vivre inutile à la France… Anges de Dieu, portez-moi sur vos ailes !…
(Elle fait le signe de la croix et s’élance.)
Scène III
Cauchon, puis Loiseleur.
Jeanne ! Jeanne !… Elle a sauté… Elle sera morte… Ah ! elle se relève… On l’arrête… Ce beau procès ne m’échappera pas… L’heure est venue de frapper les grands coups. Le régent d’Angleterre n’ordonne point, mais il désire. Sans vouloir s’expliquer, il compte être entendu… C’est dur pourtant de condamner cette fille. Mais la robe rouge ne se gagne pas en disant des Pater noster… Moi, le fils du boucher de Reims, marcher l’égal des plus grands, voir les évêques m’encenser, être prince de l’Église !… Quand un vaisseau fend l’eau, il y fait des sillons qui aussitôt parus disparaissent, et il ne reste aucune trace montrant par où il est passé. Ainsi de mon ambition. Qu’elle aboutisse, et on ne verra que ma pourpre de cardinal.
Loiseleur, entrant.
Que viens-je d’apprendre ?… Et il paraît qu’elle ne s’est pas tuée ! Le doigt de Satan est là.
Cauchon.
Dieu la réserve pour un juste supplice… Cette tentative de suicide est un grief de plus. Il figurera parmi les griefs que nous avons résumés en douze articles d’après ses réponses, et sur lesquels une centaine de clercs viennent de nous envoyer leurs consultations.
Loiseleur.
Et comment ont-ils prononcé ?
Cauchon.
Coupable ! coupable ! C’est la conclusion de tous, hors quatre… Nous n’attendons plus que l’inquisiteur pour interroger et juger en séance publique… Avez-vous tiré d’elle quelque nouveau secret ?
Loiseleur.
Non ; mais j’ai d’excellentes nouvelles sur le bon effet de la lettre que je lui ai fait écrire, ou plutôt que j’ai écrite pour elle au duc de Bourgogne… Elle me pria d’écrire au duc des paroles bien françaises, bien touchantes… et qu’il daignât venir la voir… J’eus soin d’écrire en termes révélant bien en elle l’hérétique vendue au démon ; et de sa main, guidée par la mienne, notre prisonnière signa : Jehanne.
Cauchon.
Parfait !
Loiseleur.
Or, voici que le duc, qu’elle avait jadis fasciné, répète tout haut qu’elle est décidément une fille d’enfer… à telles enseignes que, pour confirmer sa foi à Bedford, il lui a donné en mariage sa sœur, Anne de Bourgogne. Quant à Jeanne, je lui ai expliqué que le duc refusait toute entrevue et l’anathématisait… Voyant tout tourner contre elle, comment ne finirait-elle pas par renier ses voix ?
Cauchon.
Décidément vous êtes un homme, chanoine. Jamais l’inquisition n’eut pareil serviteur. Continuez la besogne si bien commencée. Épiez tous les faits et gestes de cette fille ; menez-la doucement et fortement au but où il faut tendre… Qu’elle se livre, et que l’orthodoxie soit vengée !
Loiseleur.
On ramène Jeanne… Je pars… Il ne convient pas qu’elle nous sache d’accord.
Scène IV
Cauchon, Jeanne, ramenée par John et Roger ; puis l’inquisiteur.
Cauchon.
Vous vouliez vous ôter la vie ?
Jeanne.
Je voulais me soustraire aux Anglais.
Cauchon.
C’est un crime de chercher la mort.
Jeanne.
C’est un devoir de fuir la honte.
Cauchon.
Quelle honte ?
Jeanne.
La honte d’être ici oisive quand là-bas coule le sang de France.
Cauchon, apercevant l’inquisiteur qui entre.
L’inquisiteur ! enfin !… Soyez le bienvenu, frère Mar tin Billorini… Voici notre hérétique.
L’inquisiteur.
Oui, authentiquement hérétique… Dès l’origine, à Vaucouleurs, je l’avais pressentie et dénoncée. Aujourd’hui l’hérésie est manifeste… Si cette fille eût été inspirée de Dieu, comment des hommes auraient-ils pu en triompher ? Avec l’appui du Très-Haut elle devait prévoir tout mal et l’éviter.
Cauchon.
En effet… Jeanne, vous ne saviez pas être prise à Compiègne ?
Jeanne.
M’est avis, sire évêque, que vous en saviez là-dessus plus que moi.
L’inquisiteur.
Vous ne pensiez pas non plus être reprise après le saut de tout à l’heure ?
Jeanne.
Tout est bien que Dieu veut.
L’inquisiteur.
Mais vous voyez que vous avez contre vous le Ciel.
Jeanne.
C’est faux. J’ai pour moi le Ciel.
Cauchon.
Ou l’enfer.
Jeanne.
L’enfer peut bien guider qui trahit son pays, mais non qui le défend.
Luthold, annonçant.
Sa Seigneurie le régent d’Angleterre, duc de Bedford.
(Bedford entre, accompagné de Warwick. Cauchon s’incline profondément devant Bedford ; l’inquisiteur s’incline légèrement.)
Scène V
Les mêmes, Bedford, Warwick.
Cauchon, à Jeanne.
Pliez les genoux, Jeanne. Vous êtes devant le très illustre régent d’Angleterre, notre souverain.
Jeanne.
Excusez-moi, évêque ; mais je ne me courbe ainsi que devant Dieu et mon roi.
Cauchon.
Pardonnez, milord… C’est la nature la plus indocile qui soit.
Jeanne.
Moi ! j’ai obéi toute ma vie, d’abord à mon père et à ma mère, puis à mes voix et à Dieu.
Bedford.
(À Cauchon.) Laissez… (À Jeanne.) Te voilà donc retombée en nos mains, amazone de France… Ici comme à Compiègne, tes saints t’abandonnent.
Jeanne.
Dieu, mieux que nous, sait ce qui nous convient.
Bedford.
À quand le jugement, évêque ?
Cauchon.
Au premier jour, très illustre seigneur. Voici messire l’inquisiteur appelé à présider avec moi.
Bedford.
Sire inquisiteur, sire évêque, vous jugerez selon votre sagesse et pour le bien de l’Église…. Laissez-moi avec cette fille.
Scène VI
Jeanne, Bedford, Warwick. — Près de la porte, restée ouverte, on aperçoit les deux gardiens : John et Roger.
Jeanne.
Ah ! le pire tribunal présidé par mes pires ennemis !… Ne dites pas qu’ils ont charge de me juger ; dites qu’ils ont charge de vous venger14.
Bedford.
Eh ! Jeanne, je voudrais ton salut.
Jeanne.
Mon salut, vous !
Bedford.
Écoute ; tu vois bien que le temps des miracles est passé, puisque Dieu t’a livrée à nous.
Jeanne.
Mieux vaut qu’il vous livre ma personne que s’il vous livrait nos bonnes villes.
Bedford.
Mais tu suivais une voie mauvaise, puisque Dieu te punit.
Jeanne.
Dieu m’éprouve.
Bedford.
Par ta prise Dieu s’est prononcé pour nous.
Jeanne.
Non !… Je suis prisonnière ; mais le royaume est debout, et on pense toujours à vous en mettre dehors. N’êtes-vous pas encore tout saignants des blessures que nous vous avons faites ? Vous m’avez ; mais vous n’avez pas ce qui était ma force, les soldats de France.
Bedford.
Comprends-moi, Jeanne. J’estime avec toi les soldats de France, et, loin de leur en vouloir, je rêve de les voir unis avec nos soldats d’Angleterre sous la protection du même sceptre. Notre Henri, fils du grand Henri cinquième du nom, a une adolescence qui annonce un souverain aussi parfait que feu son père. Qui mieux que lui peut être roi de France ?
Jeanne.
Un Français… Charles, fils de Charles.
Bedford.
Eh ! Charles et les siens t’ont déjà oubliée.
Jeanne.
Que tous m’oublient, si n’oublierai-je mon roi !
Bedford.
Quoi ! Jeanne, tu ne désires pas la liberté ?
Jeanne.
Ah ! je la souhaite de tout mon cœur.
Bedford.
Eh bien, tu auras la liberté ; tu auras, avec la liberté, grande abondance de choses plaisantes et délectables. Renie seulement ce soi-disant roi.
Jeanne.
Renier le roi ! Ah ! que plutôt mon cour cesse de battre ! Milord, si ma langue était tentée de proférer pareil reniement, je la broierais de mes dents et vous la jetterais au visage… Par grâce, cessez de me proposer ma honte ! Tuez-moi, mais ne m’outragez pas. Une fois pour toutes je vous le dis, mon affection n’est pas aux biens que vous pouvez me donner, ni ma crainte aux maux que vous pouvez me faire. Promettez, menacez, vous n’aurez rien de moi.
Bedford.
Alors, hérétique, prends garde !…
Jeanne.
Je sais bien que vous pensez à me faire mourir, croyant qu’après ma mort tout sera aux Goddems. Mais seriez-vous cent mille et cent mille de plus, non, vous ne l’aurez pas, le beau royaume de France !
Bedford, bas à Warwick.
Ne dirait-on pas que c’est elle qui nous tient prisonniers ? Cette fille est sublime. Que n’est-elle Anglaise !
Warwick.
C’est un être diabolique. Il faut la tenir bien enchaînée en attendant que le clergé en finisse.
Bedford.
Non, pas de chaînes… (À Jeanne.) Jure que tu ne tenteras plus de t’échapper.
Jeanne.
Je ne rêve que de me rendre libre.
Bedford.
Promets… Tu éviteras qu’on t’enchaîne..
Jeanne.
Jamais ! Je ne veux pas que, lorsque je m’échapperai, vous puissiez m’accuser d’avoir faussé ma foi.
Bedford.
Eh bien, Warwick, faites pour le mieux.
(Il sort.)
Warwick.
Fille inflexible !… (À John et à Roger.) Liez-la par les pieds et par la ceinture… (À Jeanne.) Nous finirons bien par te dompter.
Jeanne.
Ce n’est jamais que mon corps que vous mettrez aux fers.
Warwick, s’en allant.
Satan !
Scène VII
Jeanne, Roger, John, puis Luthold.
John.
À l’œuvre ! Toi, Roger, mets-lui les fers aux pieds. Moi, je vais lui fixer cette chaîne autour de la ceinture.
Roger.
Accroche le dernier anneau à la poutre.
John.
C’est cela. N’as-tu pas les clefs de la serrure ?
Roger.
Les voici.
John.
Fermons la chaîne à double tour. Cette truande est subtile. Elle n’aurait qu’à s’échapper encore.
Roger.
Sorcière du Bois-Chênu, vive l’Angleterre !
John.
Diablesse d’Orléans, vive l’Angleterre !
Roger.
Ce n’est plus ici Patay.
John.
Ce n’est plus ici Reims.
Roger.
À bas Charles VII !
John.
Vive Henri VI !
Roger.
On te torturera.
John.
On te brûlera.
Roger.
Invoque tes saints, qu’ils viennent te déferrer.
John.
Et plains-toi à eux d’être houspillée par nous.
Luthold, qui vient d’entrer, portant une cruche d’eau, deux harengs et du pain.
Lâches ! N’avez-vous pas de honte ? Libre, vous la fuyiez ; ne l’insultez pas, captive.
John, ricanant.
Ah ! ah ! ah !
Luthold.
Soyez au moins touchés de son silence…
Roger.
Prends garde… Si tu as souci d’elle, Warwick te fera jeter en Seine.
(Ils sortent.)
Scène VIII
Jeanne, seule.
Comme ils m’ont vilainement injuriée ! Comme me voilà dans la peine et l’angoisse ! Les plus méchants m’auraient en pitié s’ils voyaient ma misère… Doux sire Dieu, mon vrai et seul ami en cet abandon, ne me donnerez-vous pas assistance ? Vous mettez le fardeau sur les épaules ; mais vous mettez aussi au cœur la force pour le porter. J’ai grande volonté d’être votre loyale et docile enfant. J’acceptai d’aller dans les batailles ; j’accepterai d’aller à la mort. Voyez cependant si je ne mérite pas de vivre encore… S’il faut que je suive jusqu’au bout le chemin des douleurs, du moins ne frappez que moi. Je suis folle d’amour pour ce bon peuple de France. Soyez-lui propice !… Quand viendra la douce consolation des paroles de l’ange ? Comme est la terre sans l’eau qui l’arrose, ainsi suis-je sans la voix qui me conforte. Ah ! c’est sans doute ces clameurs et noises des gardes qui empêchent que je ne l’entende. Je l’entendrais si j’étais en quelque forêt !… Si je devais ne plus l’ouïr !… Oh ! je me sens troublée, triste, dolente, à en pleurer, à en mourir… Pitié, bon Jésus, qui ne saviez où reposer votre tête ! Pitié, bon Jésus, qui avez été flagellé et couronné d’épines ! Pitié, bon Jésus, qui expirâtes sur la croix en criant : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’avez-vous abandonné !
Et moi aussi je m’écrie : Voix du ciel, voix du ciel, pourquoi m’avez vous abandonnée ?
Voix.
Jeanne !
Jeanne, tressaillant.
La voix !
Voix.
Jeanne, prends en gré ton martyre ; tout ceci finira par grande victoire.
Jeanne, avec un élan enthousiaste.
Tout ceci finira par grande victoire !
Voix.
Et tu t’en viendras enfin au royaume du paradis.
Jeanne.
Au royaume du paradis !……… Ah ! j’ai grande paix et douceur !
Deuxième tableau Au tribunal.
Une salle longue et étroite. Sur le mur un grand crucifix avec celle inscription : Caritas Christi urget nos.
Scène première
Cauchon, l’inquisiteur, Thomas de Courcelles à la gauche de Cauchon, Lefèvre à la droite de l’inquisiteur, Isambard, quarante autres assesseurs alignés sur des bancs ; le greffier Manchon, Loiseleur, Jeanne, John, Roger.
L’inquisiteur.
Qu’on fasse entrer l’accusée.
(Jeanne est introduite par John et Roger.)
Cauchon, patelin.
Jeannne, comment vous portez-vous ?
Jeanne, montrant les fers qu’elle a à la ceinture et aux pieds.
Comme vous voyez.
Cauchon.
Vous voici en présence des juges les plus vénérables qui soient, tous clercs de haute sagesse.
Jeanne.
Je ne relève pas de votre tribunal.
Cauchon.
C’est un tribunal ecclésiastique, et vous êtes fille de l’Église.
Jeanne.
C’est un tribunal anglais, et je suis fille de France.
Cauchon.
Nous aussi, prêtres, moines, abbés, prieurs, chanoines, nous sommes tous fils de France.
Jeanne.
Oui, mais vendus à l’Angleterre.
Cauchon.
Quel langage ! Qui te l’a soufflé ?
Jeanne.
Mes voix. Elles m’ont dit de parler hardiment et de ne pas vous craindre.
Cauchon.
Es-tu donc sûre que nous ne te condamnerons pas ?
Jeanne.
Si vous me condamnez, Dieu m’absoudra et vous condamnera.
Cauchon.
Maître Thomas de Courcelles, accusez !
Courcelles.
Premier grief : Par présomption diabolique, cette fille a affecté le commandement des hommes de guerre.
Jeanne.
Tout mon fait n’a été qu’un humble ministère. J’étais aux mains de Dieu une arme de combat.
L’inquisiteur.
Il est interdit aux femmes d’aller à la guerre.
Jeanne.
J’ignore s’il y a des lois de votre façon qui le défendent ; mais je sais bien que Dieu me l’a ordonné.
Cauchon.
Vous outragez les saints canons de l’Église. Ce que vous dites est hérétique.
Jeanne.
Ce que vous faites est-il chrétien ?
Courcelles.
Deuxième grief : Elle ensorcelait les soldats et les menait par magie.
Jeanne.
Ma magie, c’était mon exemple. Je leur disais : Allons !
Et j’allais la première.
Courcelles.
Troisième grief : Elle blasphème Dieu, en le taxant de partialité contre les Anglais.
Cauchon.
Vous pensez bien, en effet, que Dieu s’est mis du côté de la France ?
Jeanne.
Dieu se met où est le droit. Il est pour l’envahi contre l’envahisseur.
Lefèvre.
Est-ce que Dieu n’aime pas les Anglais ?
Jeanne.
Dieu aime les Anglais en Angleterre. En France, il les extermine.
Cauchon.
Quoi ! vous croyez à leur extermination ?
Jeanne.
Je ne crois pas : je suis sûre. Aussi vrai que vous êtes ici, aussi vrai que le soleil se lèvera demain, aussi vrai que l’Évangile est le livre de Dieu, le jour de l’entière délivrance est proche.
Cauchon.
Vous voyez qu’elle fait la devineresse. Autre grief confirmé.
Courcelles.
C’était le quatrième… Cinquième grief : Cette fille s’est montrée sanguinaire.
Jeanne.
C’est faux… J’allais droit devant moi, me donnant à la mort sans jamais la donner.
Cauchon.
Vous n’en étiez pas moins altérée de sang… N’avez vous pas vu tomber des Anglais ?
Jeanne.
Oui, j’en ai vu tomber, et beaucoup, beaucoup plus que des Français.
Cauchon.
Vous vous plaisiez à voir des Anglais mourants ?
Jeanne.
Je me plaisais à voir les Français victorieux.
Courcelles.
Sixième grief : Cette fille a violé les prescriptions de Dieu et de l’Eglise en portant l’habit d’homme.
Jeanne.
Tant que j’aurai près de moi des hommes, je porte rai l’habit d’homme.
Cauchon.
C’est déshonnête.
Jeanne.
N’est pas déshonnête ce qu’on fait pour rester honnête.
L’inquisiteur.
Fi ! vous violez la loi de Dieu : Non induetur mulier…
Courcelles, en même temps.
Et le précepte de saint Paul : Mulier debet velare…
Lefèvre, en même temps.
Et les prohibitions ecclésiastiques : Simulier vestem…
Jeanne.
Beaux seigneurs, parlez l’un après l’autre.
Cauchon.
Bref, nos livres de théologie sont pleins de textes latins qui vous condamnent.
Jeanne.
M’est avis que votre théologie ne parle ni latin ni français. Elle parle anglais.
Courcelles.
Septième grief : Par les artifices du diable, cette fille a usurpé le culte dû à Dieu.
Jeanne.
Moi !
Cauchon.
N’est-il pas vrai que le menu peuple vous était dévot ?
Jeanne.
Les pauvres gens venaient volontiers à moi parce que je les aimais et leur donnais secours selon mon pouvoir.
Lefèvre.
Cette idolâtrie des foules vous constituait en orgueil.
Jeanne.
J’aurais eu peine à m’en garder, si Dieu ne m’eût gardée.
Courcelles.
Même maintenant, ne vous croyez-vous pas en état de grâce ?
Frère Isambard.
C’est grande chose de répondre à telle demande.
Cauchon.
Taisez-vous, frère Isambard…
Courcelles, bas à Cauchon.
La voilà prise, quoi qu’elle réponde. Si oui, quelle outrecuidance ! Si non, quel aveu !
Cauchon.
Jeanne, répondez, êtes-vous en état de grâce ?
Jeanne.
Si j’y suis, Dieu m’y tienne ! Si je n’y suis, Dieu m’y mette !
Courcelles.
Huitième, neuvième et dixième griefs : Fille dénaturée envers sa mère ; Criminelle complotant le suicide ; Aventurière de toutes hontes pleine.
Cauchon.
Défendez-vous de ces accusations.
Jeanne.
Défendez-m’en vous-même ; car vous n’y croyez point.
Cauchon.
Ce silence ne vous justifie pas de vos crimes.
Jeanne.
Mes crimes, c’est nos victoires. Si nous étions vaincus, je serais innocente.
Courcelles.
Onzième et douzième griefs : Superstitieuse et hérétique, elle croit à ses voix, et, n’alléguant que Dieu, fait mépris de l’Église.
L’inquisiteur.
Voilà le point capital.
Lefèvre.
Les esprits du ciel visiter une fille de néant !
Jeanne.
Dieu sur terre fut parmi les humbles, et il aime les humbles.
Courcelles.
Jeanne, vos esprits sont de mauvais esprits, des démons. La très sacrée et très docte faculté de théologie de Paris, dont je suis ici le représentant indigne, s’en est catégoriquement expliquée. Elle les a même nommés, dans sa consultation. Ils sont deux : Bélial et Béhemmoth.
Jeanne.
Eh ! mes révérends, pour l’amour de Dieu, parlez moins du diable !
L’inquisiteur.
Et vous, Jeanne, croyez à l’Église. Vous auriez dû la consulter avant de croire à vos voix.
Jeanne.
Je révère les clercs, mais n’obéis qu’à Dieu.
L’inquisiteur.
Hérétique ! hérétique !… Où irions-nous, Ciel ! si chacun se fiait à son inspiration ?
Cauchon, à Manchon.
Écrivez, greffier, écrivez.
Courcelles.
Ainsi vous avez votre croyance à vous ?
Jeanne.
J’ai toujours cru simplement et humblement selon la foi catholique. Mais de ce que j’ai fait et dit, je ne m’attends qu’à Celui qui m’a envoyée.
L’inquisiteur.
Hérétique ! dix fois hérétique !
Cauchon, au greffier.
Maître Manchon, écrivez, écrivez !
Manchon.
N’ayez crainte, monseigneur. Je sais écrire.
Frère Isambard.
Jeanne, ne vous soumettriez-vous pas au concile de Bâle ?
Jeanne.
Qu’est-ce ?
Frère Isambard.
C’est une réunion de l’Église universelle ; et il s’y trouve autant de clercs de votre parti que du parti anglais.
Jeanne.
En ce cas, je m’y soumets.
Cauchon, à Isambard.
Taisez-vous, de par le diable !
(Cauchon fait signe au greffier de ne pas écrire.)
Jeanne.
Maître Manchon ne sait donc plus écrire ?… Ah ! je récuse votre grimoire. Vous notez ce qui est contre moi, et non ce qui est pour.
L’inquisiteur.
Greffier, écrivez tout. Il faut être réguliers.
Courcelles.
Eh bien, si une réunion de l’Église universelle vous donnait un commandement contraire à celui de vos voix, y souscririez-vous ?
Jeanne.
Jamais !
Frère Isambard.
Mais, Jeanne, vous êtes sujette de l’Église.
Jeanne.
Oui, Dieu premier servi.
Cauchon.
L’affaire est entendue… Vous devez quitter le tribunal, Jeanne, pendant que nous délibérerons.
L’inquisiteur.
Au surplus, vous avez le droit d’avoir un défenseur qui, vous absente, tienne votre cause. Qui voulez-vous ?
Jeanne.
Personne. Je n’ai pas fiance aux hommes. J’attends mon aide de plus haut.
Scène II
Les mêmes, frère Richard.
Frère Richard.
Jeanne, je serai votre défenseur.
Jeanne.
Frère Richard !
Frère Richard.
Ah ! que je baise vos chaînes, noble fille en qui bat le cœur de la patrie !
Jeanne.
Et le roi, que fait-il ?
Frère Richard, à voix basse.
Le roi est aux mains de conseillers qui aiment mieux la France perdue par eux que sauvée par d’autres ; le roi vous oublie, et monstrueusement ingrat…
Jeanne, mettant un doigt sur sa bouche.
Nous devons le servir, et non pas le juger.
Cauchon.
Jeanne, sortez. Nous allons délibérer… Messire Loiseleur, vous pouvez accompagner votre pénitente.
(Jeanne sort, accompagnée de Loiseleur et conduite par John et Roger.)
Scène III
Les mêmes, moins Jeanne et Loiseleur.
Cauchon.
Défenseur, que pouvez-vous avoir à dire ?
Frère Richard.
Qu’il ne doit pas être donné suite à ce procès.
Cauchon.
Par la Saint-Jean ! vous nous la baillez belle…
Frère Richard.
Évêque, ce n’est pas à vous que je veux parler. Vous n’êtes pas un juge ; vous êtes un ennemi. Vous pouvez opprimer cette fille : vous ne pourrez la noircir. Sa vie répond pour elle. (Se tournant vers l’inquisiteur.) Mais vous, sire inquisiteur, sans vous ce procès ne serait pas valable. Vous n’avez qu’un mot à dire, et il se trouvera annulé. C’est à vous que je m’adresse. Je vous connais. Point cupide, point vénal, point luxurieux, frugal et simple, faisant toujours des charités et pardonnant tout méfait qui vous touche, comment auraient pu agir sur vous les amorces de l’Anglais ?
L’inquisiteur.
Je ne désire rien hors le triomphe de Dieu ; je ne crains rien hors le triomphe du démon.
Frère Richard.
Absolvez donc cette fille.
L’inquisiteur.
Ma conscience me le défend.
Frère Richard.
Le devoir de juger vous fait-il un besoin de condamner ? Que cette fille soit malheureuse, qu’elle soit accusée, cela ne la fait pas coupable.
L’inquisiteur.
Elle n’aurait pu choir si le Ciel l’eût conduite… Demandez-lui plutôt qu’elle abjure.
Frère Richard.
Je ne puis demander à l’innocence de se renier pour obtenir qu’on la reconnaisse.
L’inquisiteur.
Innocente, cette fille qui s’attribue des révélations et ne s’en rapporte pas à l’Église !
Frère Richard.
Quand le Ciel a parlé, l’Église doit se taire15… Ne l’avez-vous donc pas examinée ? Quelle inspiration dans son regard !
L’inquisiteur.
L’inspiration de Satan.
Frère Richard.
Quelle force dans son cœur !
L’inquisiteur.
La force de Satan.
Frère Richard.
Quels prodiges dans ses actes !
L’inquisiteur.
Les prodiges de Satan.
Frère Richard.
Et moi, je la proclame fille de Dieu de par sa pureté, son amour, sa foi et ses œuvres. Ah ! retenez des coups qui retomberont sur vous-même. Ne frappez pas en elle la sainteté… Grâce, sire inquisiteur, grâce. ! Au nom du Christ, ne soyez pas inflexible !
L’inquisiteur.
Tel je dois être, tel je suis. Il m’appartient d’être le bras de Dieu frappant l’hérésie. Qu’il m’en coûte, c’est mon affaire… Les pleurs qu’il fera couler n’empêchent pas les coups du soldat. Nous sommes les soldats de la sainte Église.
Frère Richard.
L’Église n’a pas soif de sang.
L’inquisiteur.
Elle a soif de fidèles.
Frère Richard.
Vous défiez-vous donc de la vérité ?
L’inquisiteur, avec une exaltation croissante.
Il faut l’aider. Elle ne triomphe que si nous sommes puissants, et nous ne sommes puissants que si nous sommes terribles… Le Dieu bon est aussi le Dieu sévère. N’est-ce pas lui qui dit aux enfants de Lévi : Prenez le fer, et massacrez vos frères
? Elle était jeune, elle était belle, elle était pure, la fille de Jephté ; et pour complaire à Dieu Jephté dut l’immoler. C’est ce même Dieu qui nous dit : Taillez, taillez dans le vif ; coupez, coupez les membres gangrenés, et guérissez le corps de l’Église.
Frère Richard.
Ainsi où Christ disait : Aimez
, vous dites : Exterminons !
L’inquisiteur.
C’est le feu de la charité qui allume le feu des bûchers. Nous ne frappons les corps que pour sauver les âmes.
Cauchon, solennellement.
Or çà, prêtres, consultez-vous, et formulez, en le devançant, le jugement du Dieu que vos mains font chaque jour descendre sur l’autel… Aussi dure soit-elle, la sentence par nous portée sur la terre ne sera pas infirmée dans le ciel.
Frère Richard.
Iniquité ! vous ne demandez pas un avis, vous dictez un arrêt… Cessez de mettre la majesté du sacerdoce au service de vos basses œuvres. Ni vous ni vos valets, évêque, n’êtes dignes de chanter messe. Vous n’êtes qu’une faction ensoutanée, étrangère à la sainte Église… D’autres redouteraient les motifs de condamner ; vous, vous redoutez les motifs d’absoudre. Vous parlez religion ; vous pensez ambition. La cupidité vous mène… ou la peur.Ne vous dites pas prêtres du Christ. S’il reparaissait, le Christ vous foudroierait de son antique anathème : Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! serpents, race de vipère, malheur à vous !
Cauchon.
Moine, tu seras châtié… D’abord, je t’excommunie.
Frère Richard.
Évêque, je suis hors de ta communion sans que tu m’y mettes. Ton tribunal prétend représenter la chrétienté, et je n’y vois pas un chrétien.
Cauchon.
Crains…
Frère Richard.
C’est à vous de craindre, assassins de Jeanne… Pour grand que soit le mal qui frappe la victime, pire est le mal qui attend les bourreaux.
L’inquisiteur.
Gardes, faites sortir cet homme.
Cauchon.
Qu’il soit emprisonné !
Assesseurs.
Qu’il soit jeté en Seine !
L’inquisiteur.
Frère Richard a abusé du droit de défense, mais ce droit est sacré. Si vous l’inquiétez, je ne prends plus part au procès… Qu’on l’emmène… Et délibérons !
Scène IV
Les mêmes, moins frère Richard.
Cauchon.
À vous, maître Lefèvre.
Lefèvre.
Je crois cette fille coupable. Mais, serait-elle innocente, je me dis que nous ne ferons que l’envoyer devant le tribunal de Dieu, son juge suprême. Je condamne.
L’inquisiteur.
À vous, frère Isambard.
Frère Isambard.
Hélas ! l’hérésie existe. La nier serait un véritable péché mortel. Je condamne16.
Cauchon.
À vous, maître Thomas de Courcelles.
Courcelles.
Ma charité me sollicite à opiner qu’il convient qu’elle soit brûlée en ce monde pour n’être pas brûlée dans l’autre.
Les autres assesseurs.
C’est cela ; c’est cela.
L’inquisiteur.
Il y a unanimité ?
Tous.
Unanimité.
Frère Isambard.
À moins qu’elle n’abjure…
Cauchon.
C’est entendu.
L’inquisiteur.
Je crains bien que cette fille ne soit trop endurcie. Mais enfin, essayons. La torture la convertira peut-être.
Frère Isambard.
Elle peut encore se sauver par là.
Courcelles, bas à Cauchon.
Par là elle se condamnera… D’abord, avec des menaces de mort faites-la avouer ; puis, avec le démenti de ses aveux vous la ferez mourir… Elle est trop entêtée de ses voix pour ne pas être relapse.
Cauchon, bas.
À merveille !… Qu’elle se diffame, et avec elle son roi ; c’est l’Anglais qui sera content… (Haut.) Introduisez l’accusée… Vous, maître Thomas de Courcelles, préparez la formule d’abjuration.
Scène V
Les mêmes, Jeanne.
Cauchon.
Jeanne, examen fait de tout devant Dieu, les maîtres ici présents vous condamnent. Avouez, enfin ! Faut-il vous torturer pour vous ramener dans la voie de la vérité ?
(Sur un signe de Cauchon, deux sergents de l’inquisition ouvrent les portes de la chambre de la torture, attenante à la salle du tribunal.)
Jeanne.
Dieu !
Cauchon.
Voyez les instruments de torture. Les tourmenteurs sont là, n’attendant que notre ordre pour remplir leur office17.
Jeanne.
Quand vous me devriez arracher les membres, encore ne vous dirais-je autre chose ; et si je disais autre chose, après je dirais toujours que vous me l’avez fait dire par force.
Cauchon.
Eh bien, on te tenaillera, on te disloquera, et puis on te brûlera.
Jeanne.
Quand je verrais le feu allumé, que je serais dans les flammes, encore soutiendrais-je ce que j’ai fait et dit jusqu’à la mort !
Frère Isambard.
Jeanne, prenez donc pitié de vous-même.
Cauchon.
Abjure, te dis-je, ou tu périras dans les plus atroces supplices.
Jeanne.
Mon choix est fait.
Cauchon.
L’abjuration ?
Jeanne.
La mort.
Cauchon.
Faut-il torturer ?
Courcelles.
Oui.
L’inquisiteur.
Non. Elle a l’âme trop dure pour que la torture lui profite. Il n’y a qu’à faire droit.
Courcelles, bas à l’inquisiteur et à Cauchon.
Attendez. Un espoir reste… Ce que n’a pu la crainte de la mort du corps, la crainte de la mort de l’âme le fera peut-être… (Haut.) Jeanne, vous voulez donc mourir comme une sarrasine ?
Jeanne.
Je mourrai bonne chrétienne.
Courcelles.
Non, car vous mourrez délaissée de l’Église.
Loiseleur.
Jeanne, voulez-vous ainsi mourir sans confession ?…
Jeanne.
Sans confession !
Loiseleur.
Sans communion ?…
Jeanne.
Sans communion !
Loiseleur.
Voici que le beau mai s’achève et nous amène demain la fête de la Pentecôte. Se passera-t-elle pour vous seule sans la visite d’en haut ? Rappelez-vous la prière de ce grand jour : Venez, dispensateur des grâces ; venez, lumière des cours…
Jeanne, continuant la prière.
Venez, père des souffrants, consolateur plein de bonté, doux hôte de l’âme. Vous êtes notre repos dans le labeur, notre rafraîchissement dans la fièvre, notre soulagement dans les larmes. Lavez nos taches ; arrosez nos sécheresses ; pansez nos blessures !
Loiseleur.
Oui, Jeanne ; et sans sa visite rien de bon, rien de pur dans l’homme… Vous lui direz : Venez
; et il ne viendra point.
Jeanne.
Cependant, pour être visitée de Dieu je ne puis pas offenser Dieu.
Loiseleur.
Vous ne l’offenserez pas… Voyez le nombre si grand des docteurs du dehors qui, commeceux d’ici, se sont prononcés contre vous.
Jeanne.
Qu’importe combien sont contre moi, quand la vérité est pour moi ?
Loiseleur.
Mais parmi ces docteurs il y a les plus hautes autorités de l’Église, des prélats. N’est-ce pas à eux que Dieu a dit : Qui vous écoute, m’écoute ; qui vous méprise, me méprise
?
Jeanne.
Alors, qu’on me mène au pape de Rome !
Loiseleur.
Le pape est trop loin… Jeanne, faites acte d’humilité. Ne pouvez-vous pas dire : Il me semble
, au lieu de : Je sais
? Voici la cédule d’abjuration. Elle ne nie pas qu’il vous a semblé ouïr des voix de Dieu ; mais elle porte que vous croyez en Dieu seul, et que vous voulez tenir tout ce que l’Église ordonne, tout ce que que vos juges voudront dire et sentencier.
Jeanne.
Mais c’est leur donner mon âme.
Loiseleur.
C’est la sauver.
Cauchon.
Abjure, ou tu seras brûlée et damnée.
Lefèvre.
Abjurez… Voulez-vous votre mort ?
Assesseurs.
Abjurez, Jeanne, abjurez.
Loiseleur.
Ma très chère amie, soumettez-vous.
Jeanne.
J’abjure.
(De sa main, guidée par celle de Loiseleur, Jeanne fait une croix au bas de la cédule.)
L’inquisiteur.
Que l’accusée soit donc admise à la pénitence !
Frère Isambard.
Elle est sauvée !
Cauchon, bas.
Nous la rattraperons.
John, à Roger.
Par la morbleu, ces prêtres volent l’argent du roi.
L’inquisiteur.
Greffier, lisez l’acte d’abjuration.
Loiseleur, vivement.
C’est inutile… c’est inutile…
L’inquisiteur.
Lisez.
Manchon, lisant.
Moi, Jeanne, je déclare ne croire désormais qu’en Dieu, non à mes voix et révélations prétendues…
Jeanne.
Ah !
Manchon.
Je confesse qu’hérétique et criminelle, j’ai désobéi à l’Église, trompé les hommes, voulu l’effusion du sang…
Jeanne.
C’est faux ! c’est faux !
Manchon.
Invoqué de mauvais esprits…
Jeanne.
C’est faux ! je n’ai pas dit cela ! (Elle saisit la cédule d’entre les mains du greffier.) Aussi vrai qu’il y a un Dieu, ce papier a menti18.
Frère Isambard.
Jeanne, c’est votre vie que vous tenez dans vos mains.
Jeanne.
Advienne que pourra. Je déchire ma honte.
(Elle met en morceaux la cédule d’abjuration.)
Frère Isambard.
Pauvre fille, vous venez d’allumer votre bûcher.
Jeanne.
Ah ! j’ai bien mal fait d’être infidèle à mes voix19.
C’est grande pitié et trahison. Que Notre-Seigneur me pardonne !
L’inquisiteur.
Ainsi vous reprenez vos aveux ?
Jeanne.
Je conserve ma foi et vous donne ma vie.
Loiseleur.
Mais, Jeanne…
Jeanne.
Traître, à qui j’avais livré toute mon âme ; imposteur, qui, par vos feintises, avez pu sur moi ce que ne pouvait la torture, quelle raison aviez-vous de me tromper ainsi ?
Loiseleur.
Ma haine de Satan et de ses œuvres.
Jeanne.
Malheureux !
Cauchon, solennel.
Jeanne, avant de vous condamner, nous devons constater, en face du Ciel et des hommes, que vous vous êtes tout à l’heure condamnée vous-même, et qu’en vous accusant vous nous avez d’avance justifiés… Or donc, puisque vous voilà redevenue pourriture, nous vous livrerons à la puissance séculière, la priant de ne pas faire couler votre sang ni mutiler vos membres.
Les quarante-deux assesseurs.
Amen.
Jeanne.
J’aurai donc la vie sauve ?…
Courcelles.
L’Église, en sa charité, veut bien que vous ne soyez pas tuée par le fer. Vous périrez par le feu.
Jeanne.
Brûlée ! brûlée vive ! Mon corps, toujours resté pur, sera livré aux flammes ! Ah ! j’aimerais mieux être décapitée sept fois que d’être ainsi réduite en cendres. J’en appelle à Dieu, le grand juge, des cruautés et injustices qu’on me fait !
Cauchon.
L’exécution aura lieu après-demain, lundi de la Pentecôte.
L’inquisiteur.
Pourquoi sitôt ?
Cauchon, bas.
Il faut se hâter, parce qu’on attend l’arrivée de Talbot ; et Talbot est pour elle.
L’inquisiteur.
Soit !
Jeanne.
Du moins, me laisserez-vous me confesser et recevoir mon Dieu ?
Cauchon.
Non.
L’inquisiteur.
Évêque, les derniers sacrements ne sont pas refusés à l’assassin sur le gibet. Je veux bien la brûler, mais non pas la damner…. Qui voulez-vous, Jeanne, pour confesseur ?
Jeanne.
Frère Richard.
Cauchon.
Tout autre, mais pas lui.
L’inquisiteur.
Il sied qu’elle ait le prêtre de son choix… Puisse-t-il l’induire à vraie contrition et pénitence !.. Jeanne, allez en paix… Nous, prions pour elle.
Troisième tableau Au Vieux-Marché.
En face, le bûcher, très élevé. — À droite, l’estrade des seigneurs, avec un siège haut pour le bailli chargé de la formalité de l’arrêt séculier. — À gauche, l’estrade des juges et assesseurs. — Du même côté, à peu de distance du bûcher, l’estrade de la condamnée pour l’audition de la sentence et l’exhibition au peuple.
Scène première
Bedford, Warwick.
Warwick.
Toutes les maisons sont tendues de noir ; et on ne voit que gens qui s’abordent les larmes aux yeux, en disant : Elle va mourir.
Quand on lui a porté l’eucharistie, il y avait autour de la prison une foule immense qui se prolongeait par longues files dans les rues avoisinantes. Hommes, femmes, enfants, agenouillés sur le pavé, les mains jointes, psalmodiaient les litanies des agonisants… La fureur pourrait bien suivre la pitié. Il est temps que cette fille périsse.
Bedford.
Plutôt qu’un soulèvement du populaire, j’appréhende la colère de Talbot… Le voici.
Warwick.
Je vous laisse avec lui et vais au-devant du duc de Bourgogne, qui veut assister au supplice.
Scène II
Talbot, Bedford
Talbot.
Bedford, cette fille ne doit pas mourir.
Bedford.
Quoi ! Talbot champion de la Pucelle !
Talbot.
Ce que je fais pour elle, elle le fit pour moi. Je mériterais le feu éternel si j’abandonnais cette fille. La supplicier est un crime.
Bedford.
C’est le salut. Je diffame le sacre de Charles VII, rends courage à nos soldats, et fais de cette mort notre résurrection…
Talbot.
Et l’humanité, qu’en faites-vous ?… Moi qui ai gagné plus de vingt batailles rangées, qui ai forcé plus de cent villes, c’est moi, Talbot, qui aujourd’hui vous implore… Grâce pour Jeanne !
Bedford.
Non… Grâce pour l’Angleterre !
Talbot.
Vous la déshonorez.
Bedford.
Je la sauve… et nous venge.
Talbot.
La vengeance, milord, je la veux comme vous, mais glaives aux mains, drapeaux déployés, sur le champ de bataille. C’est dans les plaines de France, non ici autour du bûcher d’une pauvre fille, qu’est la place de guerriers tels que nous. Vainqueurs, nous nous serons vengés sans honte ; vaincus, nous serons encore glorifiés… (Aux soldats qui arrivent à la tête du cortège amenant la condamnée.) Anglais, arrêtez !
Bedford.
Ces soldats obéissent. Les voulez-vous rebelles ?
Talbot.
Je les voudrais héros. Vous les faites bourreaux.
Bedford.
Talbot, j’ai mérite à être patient quand le sang bout dans mes veines…
Talbot.
Eh bien, faisons parler nos épées… Ma vie pour sa vie !…
Bedford.
Non certes. Je ne suis pas assez fou pour commettre aux hasards d’un combat singulier la sécurité de l’Angleterre, ni assez ingrat pour m’exposer à répandre un sang aussi précieux que celui du grand Talbot. Qu’il me suffise de vous dire ceci : Vous êtes sujet fidèle, soldat loyal, chrétien pieux. Or je suis le régent du royaume, et vous m’avez juré sur les saints Évangiles entière obéissance.
Talbot, après un silence.
Il le faut donc… (s’agenouillant.) Ah ! le bûcher devient un autel quand il y monte une telle victime.
Bedford, prenant la main de Talbot.
Talbot, ne me croyez pas indifférent à une vertu si haute. Mais, si je sens en homme, je dois agir en chef d’État. Je plaindrai cette fille quand nous n’aurons plus à la craindre… Périsse l’ennemie de l’Angleterre… et advienne que pourra de ma mémoire !
Talbot.
Vous achevez sa gloire en la faisant martyre.
Bedford.
Eh ! qu’elle soit grande et encore plus grande, pourvu qu’elle ne nous soit plus funeste !
Talbot.
Elle arrive… Je ne pourrais supporter sa vue… Adieu, fille héroïque !… Quand tu seras là-haut devant le Dieu juste, sois-nous miséricordieuse ; n’attire pas de châtiment sur l’Angleterre !
Scène III
Bedford, Warwick, le duc de Bourgogne, Cauchon, l’inquisiteur, Courcelles, Loiseleur, Jeanne frère Richard, frère Isambard, Luthold, John, Roger, le bailli, le bourreau, prélats, assesseurs, moines, soldats, peuple.
(Entrée du cortège. — Des dominicains, dont le premier porte une bannière blanche, avec les mots Justitia, Misericordia, écrits autour du portrait de saint Dominique, chantent : Dies iræ, dies illa solvet sæclum in favilla, etc. — Pendant le chant du Dies iræ, Cauchon et l’inquisiteur, ayant à leurs côtés les évêques de Noyon, de Thérouanne, de Norwich et le prélat abbé de Fécamp, prennent place sur deux fauteuils élevé au-dessus des, gradins qu’occupent à gauche soixante assesseurs au procès. Bedford, les seigneurs anglais et bourguignons, le cardinal de Winchester et le bailli prennent place sur l’estrade de droite. — Warwick arrive par la gauche avec le duc de Bourgogne, qu’escortent des gentilshommes et soldats bourguignons. Il se trouve sur le passage de Jeanne au moment où, à la suite du cortège, elle entre par la droite, vêtue d’une chemise longue et les cheveux épars, accompagnée de frère Richard, suivie de frère Isambard, de Luthold, de John et de Roger.)
Warwick.
Bonne mort, ma prisonnière.
Jeanne.
Sire Warwick, vous avez été pour moi un geôlier méchant et dur. Mais je vous pardonne… (Apercevant le duc de Bourgogne.) Ah ! duc de Bourgogne, ce n’est pas ici que j’espérais vous revoir.
Le duc.
Pauvre fille, tu as beau être hérétique ; je te plains de toute mon âme.
Jeanne.
Duc, je ne changerais pas mon sort contre le vôtre. Il m’est plus doux de mourir brûlée que de vivre comme vous vivez, en trahison.
John, à Jeanne.
Avancez… avancez…
Jeanne, voyant tout à coup le bûcher.
Ah !… Frère Richard, que ce bûcher me fait peur !… Soutenez-moi.
Frère Richard.
Soyez forte, Jeanne.
Jeanne.
Rouen ! Rouen ! Mourrai-je donc ici ?… (À frère Richard.) Mon père, la délivrance ne viendra-t-elle pas ?… Oui, elle peut venir encore. Que ce soit le plaisir de Dieu, et Dieu me sauvera. N’est-ce pas lui qui préserva Daniel dans la fosse aux lions ? N’est-ce pas lui qui ressuscita Lazare ? Dieu, délivrez-moi ! délivrez-moi à grande victoire ! Saint Michel ! saint Michel ! priez Dieu pour moi ! Saint Michel ! saint Michel20 !
Cauchon, aux sergents de l’inquisition.
Faites-la monter sur l’estrade des condamnés.
(Jeanne éclate en pleurs et en gémissements. Elle gravit les degrés, appuyée sur frère Richard. Cauchon déroule un parchemin et lit :)
Jeanne, attendu que tu as été convaincue d’hérésie, d’invocation des démons, et autres erreurs et crimes ; Attendu qu’après avoir abjuré, tu es retombée ; Au nom du Seigneur, et ayant devant les yeux l’honneur de la foi orthodoxe, nous te déclarons arrachée du corps de l’Église et livrée au bras séculier.
Jeanne.
C’est donc fini !… Évêque, quel mal vous avais-je fait ?
Cauchon.
Il est dit : L’homme sacrifiera tout à son Dieu et au bien de l’Église.
Jeanne.
Ah ! j’ai bien peur que vous n’ayez à souffrir de ma mort !… Évêque, je meurs par vous.
Cauchon, après un silence.
Accuse ton roi, qui t’a induite à mal faire.
Jeanne, avec force.
Si j’ai mal fait, le roi n’y est pour rien. Il est le meilleur chrétien qui soit. Je lui demeure fidèle, à la vie, à la mort.
L’inquisiteur, ému.
(À part.) Ô religion, que ta défense coûte cher ! Si tu n’étais si sainte, je me ferais horreur. (Haut.) Pauvre fille, d’une main ma piété vous livre, de l’autre ma charité vous bénit… Vade in pace !
(Au moment où l’inquisiteur prononce la formule funèbre, un tressaillement se produit dans l’assistance, et Jeanne se reprend à pleurer. Cauchon a quitté son siège et est venu en face de l’estrade de la condamnée.)
Cauchon, aux sergents de l’inquisition.
Çà, jetez sur ses épaules la tunique de flétrissure ; coiffez-la de la mitre infamante, et inscrivez dessus ces mots : Hérétique ; relapse ; apostate ; idolâtre… (S’approchant du duc de Bedford pendant qu’on exécute ses ordres, bas.) Mon seigneur, vous voyez que j’ai su accommoder notre théologie à votre politique. Ne ferai-je pas un bon cardinal ?
Bedford.
Ah ! tu songes à la robe rouge, évêque ?… Ce bûcher va t’en faire une… dont il faudra te contenter.
Cauchon.
Mais, monseigneur…
Bedford.
On t’a donné de l’argent, beaucoup d’argent… Que tes remords complètent ton salaire !
Cauchon, à part.
Ciel et enfer !…
(On a mis sur les épaules de Jeanne une casaque de laine jaune où sont représentés les démons s’agitant dans les flammes, et sur sa tête une mitre avec l’inscription prescrite.)
Courcelles, monté à côté de Jeanne et la désignant du doigt.
Gloire à Dieu au plus haut du ciel !… Peuple, celle ci est Jeanne, vulgairement dite la Pucelle, présomptueuse, abuseresse de simples gens, blasphématrice de Dieu, devineresse, cruelle, dissolue, idolâtre, pernicieuse, superstitieuse, malcréante en la foi de Jésus Christ, invocatrice de diables, schismatique et hérétique. L’Église ne peut plus rien pour elle.
(Aussitôt l’exhibition finie, on ôte à Jeanne la tunique et la mitre, sur un signe de l’inquisiteur.)
Frère Richard.
Pauvre Jeanne, il faut mourir !
Jeanne.
Mon Dieu ! mon Dieu !… Voilà donc le dernier soleil levé sur ma tête… Je n’embrasserai plus ma mère… Ah ! il me semble que ce n’est qu’hier que je suis venue au monde… En sortir sitôt, et par une si horrible mort !… Oh ! oh !… Pourtant, je ne suis pas une pécheresse… Bonnes simples gens, je suis innocente. Soyez-moi témoins que je meurs innocente…
Loiseleur, à part.
À quoi lui servirait-il de mentir devant la mort ?
Jeanne.
Je vous supplie, hommes, femmes, petits enfants, que vous vous souveniez de moi en vos dévotes oraisons et requériez mon salut. Octroyez-moi une messe chacun, si vous pouvez… Frère Richard, vous vous souviendrez de moi devant l’autel de Notre-Seigneur…
Frère Richard.
Oui, Jeanne… Jeanne, je vous pleurerai tant que je vivrai. Mais aujourd’hui je veux être ferme ; je veux être digne de vous. Ne m’attendrissez pas !
Jeanne.
Je vous pardonne, duc de Bedford. Évêque de Beauvais, je vous pardonne. Quels que soient ceux qui ont voulu me nuire et quelque mal qu’ils m’aient fait, je donne pardon à tous. Si j’ai offensé tels ou tels, qu’ils me donnent pardon !
Le duc de Bourgogne
Ah ! c’est grande pitié et grande édification !
L’inquisiteur.
C’était une hérétique. Mais elle fait la mort d’une sainte. Puisse mon âme aller où va être son âme !
Loiseleur.
Qu’ai-je fait ! Qu’ai-je fait !
Lefèvre, à Cauchon.
Vous pleurez aussi ?…
Cauchon.
Je ne suis pourtant pas de pierre.
Warwick.
À votre office donc, bailli.
Le bailli, très ému, faisant signe de la main.
Menez, menez.
(Un lugubre roulement de tambours donne le signal du départ de la condamnée, qui descend de l’estrade, soutenue par frère Richard.)
Jeanne.
Hélas ! hélas !… Frère Richard, ce n’est plus comme autrefois, quand les tambours battaient pour la bataille !…
Roger et John, poussant Jeanne par derrière.
Allons ! allons vite !
Frère Richard, les écartant avec force.
Arrière, soudards !
Jeanne, allant vers le bûcher.
Mon Dieu, ayez pitié de ma pauvre âme ! (À frère Richard.) Ah ! mon père, si les anges pouvaient me prendre avant que le feu s’allume !
(Pendant que Jeanne gravit le bûcher et qu’on l’attache au poteau par le cou, par la ceinture et par les jambes, on entend le glas funèbre des cloches, et les moines chantent : Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. — Et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam.)
Jeanne, sur le bûcher.
Une croix ! qu’on me donne une croix ! (Frère Richard parle à l’oreille de frère Isambard, qui sort. — Luthold coupe une baguette en deux morceaux et, les liant avec une cordelette, en fait une croix qu’il donne à Jeanne.) Merci… J’en désirerais bien aussi une où fût l’image de notre Sauveur… Ô croix, tu es ma vertu et ma force. Je te veux là, sur mon cœur, jusqu’à ce qu’il cesse de battre. (Elle met la croix entre ses vêtements et sa chair, puis joint les mains.) Sainte Vierge, douce dame du paradis, en souvenir des souffrances de votre cher fils, ayez pitié de moi !
Frère Isambard, apportant un crucifix d’argent.
Jeanne, voici la croix bénite de l’église Saint-Sauveur.
Jeanne, embrassant le crucifix.
Ah ! que je baise ces pieds qui si cruellement furent percés, et ce pauvre corps qui, pour nos péchés, pendit sur le bois du supplice… Très aimé Seigneur qui m’avez faite ici votre compagne en la peine, faites-moi la grâce que je sois là-haut votre compagne en la gloire !
Warwick.
Dînerons-nous ici ?… (Au bourreau, qui a allumé aussitôt le bûcher.) Allons, que ça flambe !
(Le feu commence à serpenter à travers les couches inférieures du bûcher, qui est échafaudé très haut.)
Jeanne, vivement à frère Richard.
Mon père, descendez, descendez ! Le feu est au bûcher… Ah ! que je baise encore une fois le crucifix !… D’en bas tenez-le haut devant mes yeux jusques au pas de la mort, et dites-moi de pieuses paroles… Hélas ! où serai-je tout à l’heure ?
Frère Richard, au bas du bûcher, élevant le crucifix.
Confiance, ma fille ! Le prix de vos peines vous attend. Entrez, l’âme sereine, dans l’éternelle paix.
Loiseleur, se jetant à genoux devant le bûcher.
Malheur à moi ! J’ai été traître envers Jeanne, traître envers la France, traître envers Dieu ! Cette fille est le Christ de la patrie ; et j’ai été son Judas… Reprenez votre or, Anglais ! Que ne puis-je aussi vous jeter ma honte au visage !… Duc de Bourgogne, je vous ai trompé, odieusement, abominablement trompé… Cette fille était une sainte… Je suis damné ! je suis damné !
Jeanne.
Mon Dieu, faites-lui miséricorde !
Warwick.
Cet homme est fou. Qu’on l’entraîne !
((La nappe des flammes monte petit à petit.)
Jeanne, à voix très haute, élevant au ciel ses mains jointes et absorbée en une sorte d’extase.
Mes voix ne m’ont pas trompée !… La France a Dieu pour elle…
Le duc de Bourgogne.
Elle m’aura aussi !… Je renonce à ma haine et recouvre ma gloire.
Bedford.
Quoi ! duc Philippe, vous, un traître !…
Le duc.
Je cesse de l’être… Jeanne, ton agonie peut sur moi ce que ne purent tes prières. J’en jure par ma part du paradis, je n’aurai plus d’ami que mon roi Charles VII, et ses ennemis seront mes ennemis. Reconquis soit le royaume sans qu’il y manque le plus petit hameau !
Bedford, à part.
Partie perdue !… C’est mon coup de mort21… (Haut.) Soit ! parjurez-vous… La force de l’Angleterre est dans l’Anglais. Il n’y aura qu’un vaincu de plus.
Frère Richard, à genoux, les mains tendues vers Jeanne.
Ah ! les Français unis, c’est la France sauvée !… Jeanne, Jeanne, tu triomphes dans ta mort !
Jeanne, déjà environnée de flammes.
Mes voix ne m’ont pas trompée !… J’ai cru ; je vois… Oh ! oh ! j’étouffe !… Oui, mes voix étaient de Dieu… Jésus !
Fin
Notes
- [1]
Je m’empruntai à moi-même un passage de la scène ci dessus quand j’écrivis, en 1888, les versiculets suivants, qui font partie des additions que je me suis permises pour relier entre eux divers fragments du Mystère d’Orléans :
Jeanne.
Dieu pleinement de moi dispose.
Mais il faut, pour si grande chose,
Un homme aux périls endurci.
Michel.
Dieu vous veut !
Jeanne.
Alors me voici !
Michel.
Irez-vous à travers les armes,
Dans le sang, parmi les alarmes ?
Jeanne.
J’irai. Dieu m’ait en sa merci !
- [2]
Bien curieuses les divergences des historiens sur Agnès. Capefigue, dans son livre Agnès Sorel, place aux environs de 1426 les premières entrevues de Charles VII et de la fille d’honneur d’Isabelle de Lorraine, se voyant dès lors, comme dit Jean Chartier,
cautement et en cachette
. M. de Beaucourt exclut, non moins que cette date, la date 1431, condamne le quatrain très significatif de François Ier, et reporte lesdites entrevues à 1441. - [3]
C’est un fait digne de remarque que les mots de patrie et de patriote ont commencé à être employés en France au temps de Jeanne d’Arc. On les trouve notamment dans Jean Chartier, nommé historiographe de France par Charles VII.
- [4]
Bravant les répugnances du patriotisme, un Français vient d’avoir le courage d’affirmer ce qu’aucun Anglais n’oserait soutenir.
Cet écrivain exhume la vieille légende, jamais accréditée, toujours réfutée, qui fait de Jeanne une suggestionnée, ni vierge ni martyre.
Jeanne un instrument aux mains des capitaines ! Lisez, dans l’acte authentique, irrécusable, où elles sont consignées en latin, les dépositions, si nombreuses, si explicites, des témoins de ses faits et gestes, celles surtout des grands chefs de guerre d’alors, Dunois, d’Alençon, inclinant leur génie devant les inspirations de l’humble fille et mettant en relief sa prodigieuse personnalité.
Jeanne déchue de sa pureté ! Parcourez tant de témoignages signalant son incomparable vertu, le merveilleux respect qu’elle inspirait, et aussi ses emportements de vierge rigide contre les femmes de mauvaise vie ; voyez les constatations faites à Rouen comme à Poitiers et à Chinon ; notez enfin le silence significatif des accusateurs, si intéressés pourtant à montrer que Jeanne ne pouvait jouir des dons et privilèges qui, dans la créance des gens d’alors, étaient l’apanage de la virginité.
Jeanne échappée au supplice ! C’est le comble. Ainsi poètes et historiens d’Angleterre, depuis Shakespeare jusqu’à David Hume, auraient chargé leur pays d’un crime imaginaire ? Il faudrait prendre au sérieux, grâce à une ingénieuse sélection des documents dont on ne donne qu’une partie, cette aventurière qui, après avoir exploité la crédulité de bonnes âmes, fut publiquement démasquée, conspuée, réduite à confesser son imposture et ses turpitudes ? Mais que faites-vous de l’aveu catégorique des bourreaux eux-mêmes dans les Informations et Apologies posthumes du procès ? Que faites-vous des attestations de ces trente-quatre témoins de la captivité, du jugement, du supplice de Jeanne, relatant les phases de son martyre, la montrant constamment héroïque, sans aucune affectation d’insensibilité ?
Ici l’histoire, en même temps qu’elle est plus belle que toute poésie, est plus prouvée que toute histoire.
- [5]
Tous ces détails pourraient paraître imaginaires. Ils sont exactement conformes à la vérité historique. Mêmes cérémonies, mêmes réjouissances, mêmes hommages des mêmes hommes, mêmes Noëls pour Henri VI, et puis pour Charles VII. Le dais, les tentures, les ornements qui avaient servi pour l’un servirent pour l’autre.
- [6]
Sur ce point spécial et sur le coup d’œil militaire de Jeanne, attesté par Dunois, d’Alençon, Gaucourt, Thibaut d’Armagnac et autres, lisez leurs dépositions dans le Procès de réhabilitation.
- [7]
Cette scène est imitée de Shakespeare (Henri VI, partie I, scène 19).
- [8]
Il est historique que Talbot, général en chef, ayant été fait prisonnier, la liberté lui fut rendue sans rançon.
- [9]
Les vieilles chroniques nous montrent ce favori, ce premier ministre, rapinant sur tout et ravitaillant les Anglais dès l’époque du siège d’Orléans. Il fit d’ailleurs lui-même le cynique aveu de ses méfaits ; et sa confession est consignée dans les lettres de rémission que le roi voulut bien lui délivrer en 1431, date du supplice de Jeanne. Dans les Chroniques de Lorraine, le doyen de Saint-Thibault de Metz dit de ce triste sire :
Il avoit envie (était jaloux) de la Pucelle, et fut cause de sa prise.
On sait qu’il était, à titre honoraire, capitaine de Compiègne. - [10]
L’éloge réel de Jeanne qu’a fait Alain Chartier en langue latine est bien autrement pompeux et enthousiaste. Je l’ai traduit ailleurs. (Voir Jeanne et le peuple de France, chapitre IV : La légende du secret du roi.)
- [11]
Dans l’Allemagne, divers contemporains firent écho à Alain Chartier et célébrèrent, avec Henri de Gorckeim, les miracles de la
Sibylle de France
. À remarquer une lettre écrite en allemand par Jean d’Ersch, secrétaire de la ville de Metz en 1429. Il y est parlé du grand nombre de chevaliers qui partent des pays allemands pour aller au sacre de Reims. - [12]
À Reims, la mère de Jeanne fut logée et défrayée aux frais de la ville, dans l’hôtellerie de l’Âne rayé, qui était située devant la cathédrale, là où se trouve aujourd’hui l’hôtel de la Maison rouge, place du Parvis-Notre-Dame.
- [13]
La tour du haut de laquelle Jeanne sauta, dans l’espoir d’échapper aux Anglais et de porter secours à ses amis en détresse, avait, d’après divers indices, une hauteur d’environ 21 mètres. Dans le Procès, les ennemis de Jeanne ne précisent pas la hauteur. Ils disent simplement que Jeanne se précipita du haut d’une tour élevée (a summitate unius altæ turris), mue par l’instigation du diable, par sa crainte des Anglais et par les mauvaises nouvelles qu’on lui avait données, lui disant que
ceulx de Compiègne, tous, jusques à l’aage de sept ans, devoient estre mis à feu et à sanc
. - [14]
Le célèbre historien anglais David Hume, tout en louant les rares qualités de l’illustre Bedford, flétrit son œuvre de politique et de vengeance à l’endroit de Jeanne, et le représente couvrant du voile de la religion la violation la plus criante de la justice et de l’humanité.
- [15]
L’auteur de l’Imitation, le livre de vie qui commençait à être populaire du temps de Jeanne, demande que les docteurs, que les prophètes se taisent, et dit à Dieu :
Parlez-moi vous seul !
Rien de plus conforme aux sentiments de François d’Assise, dit le Séraphique, et de Bernardin de Sienne, dont frère Richard fut le disciple. Vallet de Viriville, M. Anatole France et M. Siméon Luce ont bien parlé de frère Richard, le prédicateur patriote qui devint l’ami et le confesseur de Jeanne, et des caractères de l’esprit franciscain en opposition avec l’esprit dominicain. - [16]
Le dominicain Isambard, qui assista et plaignit si sincèrement Jeanne à ses derniers moments, fut néanmoins un des auteurs de sa mort. On sait que, le 29 mai, une assemblée de quarante-deux assesseurs sanctionna à l’unanimité, par une condamnation définitive de l’accusée, les conclusions de cette centaine de clercs qui, acquis au parti anglais et consultés sur les douze articles, avaient les premiers porté à Jeanne le coup de mort. Isambard était un de ces assesseurs. Il prononça, avec Lefèvre, le futur évêque de Démétriade, qu’il y avait lieu de livrer Jeanne au bras séculier, ajoutant, avec Courcelles, qu’il fallait lui dire qu’elle n’avait plus rien à espérer quant à sa vie temporelle.
- [17]
Il faut lire le récit authentique de cette scène sinistre fait par les juges, attestant eux-mêmes leur propre infamie et l’héroïsme de Jeanne.
Johannæ fuit dictum quod nisi fateretur veritatem super his, poneretur in tormentis, quæ sibi tunc in eadem turri parata ostendebantur. Ubi etiam præsentes aderant officiarii qui, jussu nostro, parati erant ipsam in hujusmodi tormentis ponere, etc.
Pour cette fois, on estima que, vu l’endurcissement de Jeanne, il y avait lieu de surseoir à l’application de supplices qui ne lui profiteraient pas. Mais, trois jours après, Cauchon remit en délibération la torture. Il s’agissait de donner à Jeanne la question spécialement sur le point de la soumission au jugement de l’Église (utrum se submittere velit judicio Ecclesiæ), Sur treize opinants, il ne s’en trouva que trois qui eurent le courage de se prononcer pour la torture. Courcelles, le théologien renommé qui, avec le monstrueux d’Estivet, requit contre Jeanne, fut un des trois. Lui aussi Loiseleur, le confesseur et l’espion de Jeanne, estima qu’il serait bon de la torturer, pour la médecine de son âme.
- [18]
L’abjuration à laquelle, pressée par Loiseleur et autres, Jeanne se résigna, était toute différente de celle que lui attribuèrent des juges perfides, dont le plan était de tromper la pauvre fille et puis de tromper l’histoire. Cela ressort des dépositions.
- [19]
On ignore généralement que, quand elle rétracta son abjuration, Jeanne dit à ses juges :
Si c’est votre vouloir, je reprendrai encore l’habit de femme.
Mais elle ne consentait à céder une seconde fois que pour cette question de l’habit. Au sujet de sa mission et de ses voix elle se montra intraitable. (Voir Procès de condamnation, partie V, chapitre I : Jeanne reniant ses défaillances.) - [20]
On l’entend à plusieurs reprises appeler saint Michel d’une voix éclatante. La forme sous laquelle sa vocation lui a été révélée reparaît à la dernière heure.
(Henri Martin.) — En effet, divers témoins, dont le curé Bouchier, déposent que Jeanne appela et implora spécialement saint Michel. Bouchier ajoute :Pluresque assistentes, usque ad decem millia, flentes et lacrimantes…
Il existe un monument national où il faudrait que se dressât une gigantesque statue de Jeanne d’Arc et qui, enrichi de souvenirs et d’images de ses faits et gestes, devrait devenir en quelque sorte son temple. C’est l’abbaye-château du Mont-Saint-Michel-au-Péril-de-la Mer, comme on disait au quinzième siècle. Saint-Michel, le saint préféré de Jeanne, constamment invoqué par elle ! saint Michel, l’archange à l’épée flamboyante, si populaire alors parmi les chrétiens de France, qui lui donnaient, dans leur culte, la place qu’avaient tenue tour à tour saint Martin et saint Denis, antiques patrons du royaume ! Pourquoi ne pas consacrer à Jeanne cette
merveille
bâtie au milieu des flots, sur la crête d’un roc escarpé qui regarde et défie l’Angleterre, fort avancé qui sut tenir quand tout cédait, grand centre de pèlerinages où l’on allait, de tous les points, demander remède aux maux des individus et aux maux de la patrie ? Cela n’empêcherait pas un monument à Domrémy et à Vaucouleurs, ni surtout un monument national au cœur de la France, à Paris. - [21]
La réconciliation du duc de Bourgogne avec Charles VII, si énergiquement et si constamment poursuivie par Jeanne, — comme en témoignent ses lettres au duc (voir Jeanne et le peuple de France, chapitre V, 5. lettre au duc de Bourgogne et 12. lettres non retrouvées, et Procès de condamnation, partie III, chapitre IV), — fut en effet la catastrophe décisive pour les Anglais, qui durent abandonner Paris, puis petit à petit toute la France, et le coup de mort pour Bedford, qui, foudroyé par la défection de son beau-frère, expira à Rouen au moment où allait être signé à Arras le traité libérateur.