Étude
La famille de Jeanne d’Arc Son séjour dans l’Orléanais d’après des titres authentiques récemment découverts
par
(1878)
Éditions Ars&litteræ © 2017
I Avant-Propos
Les savants travaux consacrés de nos jours à la vierge de Domrémy ont couronné sa noble et sainte figure de la seule auréole qui désormais soit digne d’elle, la pure auréole de la vérité historique.
À de moindres hauteurs assurément, mais dans un rang honorable encore, la patriarcale famille au sein de laquelle Jeanne reçut le jour a droit aussi à de sérieuses études.
Pieux gardiens de la chaste enfance de la Pucelle, ces simples cultivateurs déposèrent dans son cœur le germe de ses héroïques vertus. Ils l’accompagnèrent en ses expéditions militaires, puis délaissés, comme elle-même l’avait été durant son cruel martyre, ils consacrèrent leur vie à réhabiliter son souvenir.
Une légitime curiosité invite donc à suivre, dans le lointain des temps, les héritiers d’un si beau nom, et à puiser des notions certaines à leur égard dans des documents dignes de foi.
Cette tâche semble particulièrement incomber à la province en laquelle les plus proches parents de Jeanne d’Arc vinrent, peu d’années après sa mort, chercher une nouvelle patrie.
Si Orléans a mérité l’honneur de voir son nom inséparablement uni au nom béni de la libératrice de la France, ce n’est pas seulement, en effet, pour avoir été le but spécial de sa mission et le théâtre de ses premiers triomphes ; la noble cité a mieux encore et plus complètement rempli sa tâche ; tandis que, par de publics hommages, elle témoignait de sa religieuse gratitude envers l’héroïque jeune fille, elle donnait en même temps asile à sa famille et lui assurait une douce aisance au sein d’une filiale hospitalité.
Peut-être, au cours de cette étude, éprouverai-je plus d’une fois le regret de voir les documents et les faits que je soumets à l’appréciation du lecteur en désaccord avec des traditions depuis longtemps acceptées. Si des textes authentiques, heureusement retrouvés, m’imposent certaines modifications aux opinions émises par mes savants devanciers, ma respectueuse déférence pour leurs consciencieux travaux n’en subira du moins aucune atteinte. L’inévitable condition des recherches historiques est de s’épurer incessamment par des rectifications successives ; de recueillir avec soin les faits déjà mis en lumière, et de chercher par de nouveaux efforts à s’approcher de plus en plus de la vérité.
II Notions générales
Jacques d’Arc1, pauvre laboureur de Domrémy, eut d’Isabelle Romée, son épouse2, trois fils et deux filles : Jacquemin, l’aîné des enfants ; Jean, qui fut prévôt de Vaucouleurs ; Pierre, honoré du titre de chevalier ; Jeanne, l’immortelle héroïne ; une autre fille enfin, nommée Catherine, jusqu’à présent peu connue, et sur laquelle nos nouveaux documents révèlent d’intéressants détails3.
Au mois de février 1429, Jeanne, à peine âgée de dix-sept ans, obéissant aux voix qui lui commandaient de quitter son village pour aller délivrer Orléans et faire sacrer le roi à Reims, après avoir versé bien des larmes, partait enfin de Vaucouleurs. À la pensée que la pieuse enfant allait se trouver seule au milieu de ces hommes d’armes dont l’indiscipline était la terreur des campagnes, ses parents désolés abandonnèrent, à leur tour, leur chaumière et leurs champs, pour la suivre. Ils voulaient la protéger contre les dangers qu’elle allait courir, ou du moins les partager avec elle.
Jacquemin paraît être resté à Domrémy4.
Quelques chroniques affirment, sans beaucoup de preuves, il faut l’avouer, que le père et la mère de Jeanne assistaient à la première audience que lui accorda Charles VII5. Du moins semble-t-il certain qu’ils étaient près d’elle dans plusieurs de ses expéditions militaires.
Ses deux frères, Jean et Pierre, l’accompagnaient certainement : — à Chinon lorsqu’elle s’y rendit près de Charles VII6 ; — à Tours, quand, armée et équipée, par ordre du roi, elle y fit peindre sa bannière7 ; — à Blois, lorsqu’on y préparait, pour secourir Orléans, un convoi de munitions et de vivres ; — à Orléans enfin, le 29 avril 1429, quand le soir, à huit heures, à cheval, armée de toutes pièces, entourée des bourgeois et capitaines, elle y entrait saluée de tous, comme un ange envoyé du ciel8.
Les noms de Pierre et de Jean d’Arc sont plusieurs fois inscrits dans les vieux comptes de ville d’Orléans9.
L’un et l’autre combattaient à côté de leur sœur, dans sa glorieuse campagne de la Loire.
À Reims, Jeanne victorieuse associait son père, sa mère, ses frères et son oncle Laxart aux honneurs de son triomphe10.
Cinq mois après, dans un élan, trop peu durable, de reconnaissance, Charles VII conférait la noblesse à la famille de sa libératrice et lui concédait, avec le beau nom de du Lis, le droit de porter sur son écu les lis de France et la couronne royale soutenue par l’épée de la Pucelle11.
Enfin, à la fatale sortie de Compiègne, Pierre fut fait prisonnier avec sa sœur et demeura longtemps captif du bâtard de Vergy12.
On ignore ce que devinrent les parents de Jeanne d’Arc pendant les longs mois de son inique procès et durant les années qui le suivirent. L’oubli qui s’était fait autour d’elle s’étendit aussi sur les siens. Le cœur brisé de douleur, ils allèrent vraisemblablement cacher leurs larmes dans leur chaumière de Domrémy, et y reprendre leurs rustiques travaux.
Si sainte qu’eût été la mort de l’héroïque victime, l’inconsciente réprobation qui s’attachait alors aux condamnations en matière de foi pesait sur sa mémoire comme un funèbre linceul. Orléans, fidèle à sa foi première, protestait seul, chaque année, contre l’odieuse sentence par un culte religieux de gratitude et de respect.
Ces solennels hommages déterminèrent, sans doute, plusieurs des proches parents de la Pucelle à quitter leur pays natal pour fixer leur séjour dans la province hospitalière où le souvenir de la noble fille était si hautement honoré.
C’est ainsi que, vers les premiers jours de juillet 1440, Isabelle Romée, devenue veuve, arriva à Orléans, et reçut des procureurs de la ville un affectueux accueil. Elle amenait avec elle une de ses petites-filles, Marguerite, fille de Jean, prévôt de Vaucouleurs.
Pierre, rendu à la liberté, après avoir acquitté sa rançon, accompagné de sa femme et de son jeune fils, suivit de près sa mère, si même il ne l’avait précédée13.
Jean, nommé bailli de Vermandois, puis prévôt de Vaucouleurs, dut nécessairement demeurer où l’appelaient ces honorables fonctions14.
Jacquemin, l’aîné des trois frères, resta, cette fois encore, à Domrémy.
Quelles furent, après cette séparation, les alliances et la postérité de la famille de Jacques d’Arc scindée, pourrait-on dire, en deux branches ?
Quelles ont été tout spécialement, en notre province, la position sociale, la fortune, la résidence habituelle, la descendance enfin des parents de la Pucelle qui vinrent y constituer la tige orléanaise de cette illustre race ?
L’examen successif de ces diverses questions sera l’objet de ce travail.
Une grande obscurité a, jusqu’ici, régné sur ces souvenirs, dignes pourtant d’un véritable intérêt.
La rareté des documents, le sens inexactement apprécié de quelques formules de langage, des traditions erronées, passées à l’état légendaire, ont donné lieu, dans plusieurs écrits modernes, à des affirmations peu fondées.
Je m’estimerais heureux si les titres depuis longtemps oubliés, que de patientes recherches ont fait tomber sous mes yeux, rapprochés de ceux que nous possédions déjà, aidaient à rectifier de regrettables erreurs, et éclairaient de quelques utiles indications un champ d’étude où il y a beaucoup encore à recueillir.
III Principaux historiens de la famille de Jeanne d’Arc
Étienne Pasquier, dans ses Recherches de la France15, après un chaleureux hommage à la vierge de Domrémy, a, le premier, consacré quelques pages à la mémoire de ses frères.
Presque en même temps, Charles du Lis, avocat général à la Cour des aides, ami et commensal de Pasquier, publiait très-brièvement, d’abord en 1610 et 1612, puis avec plus de développements en 1628, sous le titre de : Traité sommaire, tant du nom et des armes que de la naissance et parenté de la Pucelle d’Orléans et de ses frères, des détails intéressants et peu connus sur la famille de Jeanne d’Arc.
Ce précieux travail est le point de départ de tout ce qui depuis a été écrit à ce sujet.
Charles du Lis descendait au cinquième degré d’un des frères de la Pucelle. Il avait épousé, vers l’année 1595, Catherine de Cailly, dont un des aïeux, Guy de Cailly, le 29 avril 1429, reçut Jeanne d’Arc en son manoir de Reuilly, paroisse de Chécy. Cette famille orléanaise avait, paraît-il, conservé d’affectueux rapports avec messire Pierre d’Arc et Jean son fils, qui, l’un et l’autre, durant soixante ans, possédèrent d’importants domaines en ces localités 16.
Les alliances de Charles du Lis, les hautes fonctions qu’il occupait, ses relations habituelles avec les savants de son temps, lui permettaient, mieux qu’à tout autre, de puiser aux meilleures sources des renseignements aussi certains qu’il était possible de l’espérer alors17.
Ce premier essai, quel qu’en soit le mérite, n’est toutefois exempt ni de lacunes, ni d’obscurités, ni même d’erreurs considérables, bien qu’excusables assurément en l’état des documents et des faits connus, lors de sa publication18.
Le Traité sommaire, devenu fort rare, a été réédité en 1856 par M. Vallet de Viriville et enrichi d’intéressantes notices.
Deux ans auparavant (1854), M. Vallet avait personnellement publié, sous le titre de : Nouvelles recherches sur la famille et sur le nom de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, un écrit de peu d’étendue, mais dans lequel de curieux détails sont mis en relief, avec la profonde érudition qui caractérise les travaux de cet auteur.
La plupart des inexactitudes échappées à Charles du Lis y sont malheureusement reproduites19.
De La Roque, en son Traité de la noblesse, consacre un chapitre spécial à Jeanne d’Arc et à quelques membres de sa famille, sous ce titre : La noblesse de Jeanne Day ou Darc, Pucelle d’Orléans, dite du Lis, etc.20.
Il s’est surtout appliqué, en ce chapitre, à indiquer les lettres-patentes et arrêts obtenus dans la seconde moitié du XVIe siècle et au commencement du XVIIe par diverses familles, et principalement par les Le Fournier (de Normandie), pour être maintenus, comme descendants collatéraux de la Pucelle, dans la jouissance des privilèges et immunités nobiliaires.
À ces documents officiels, par lui soigneusement recueillis, l’auteur ajoute, trop facilement peut-être, quelques traditions beaucoup moins justifiées.
Il mentionne également les lettres-patentes obtenues de Louis XIII par Charles du Lis, le 25 octobre 1612, ainsi que le Traité sommaire, auquel il emprunte plusieurs détails, tout en restant fort sobre d’éloges à son égard21.
Nos vieux historiens Orléanais : Lemaire, Symphorien Guyon, le doyen Charles de la Saussaye, chaleureux admirateurs de notre sainte libératrice, gardent, et l’on a quelque droit de s’en étonner, un silence absolu sur la venue et le long séjour de ses proches parents au sein de notre province.
Nos modernes annalistes en parlent plus au long, mais pour mêler à de véridiques récits des affirmations toutes gratuites et de nombreuses erreurs22.
Quant aux ouvrages spécialement consacrés à l’histoire de la Pucelle, s’ils disent quelques mots de sa famille, c’est toujours d’une manière sommaire et sans se préoccuper des détails23.
Une heureuse émulation appelle en ce moment, sur ce sujet trop longtemps négligé, de sérieux et patriotiques efforts.
Avec un zèle digne d’éloges, l’érudit archiviste du Loiret, M. J. Doinel, explore courageusement les vieilles minutes de nos études de notaires, pour rechercher, dans la poussière de ces dépôts oubliés, quelques documents sur Jeanne d’Arc et sa famille.
De précieuses découvertes ont récompensé ses laborieuses investigations ; plusieurs titres d’un véritable intérêt ont été par lui publiés ; quelques autres qu’il a bien voulu me communiquer m’ont utilement servi pour ce travail.
Il me sera permis d’ajouter que deux graves historiens : M. de Bouteiller, ancien député de Metz, et M. le baron de Braux, arrière-petit-neveu de Jeanne d’Arc, préparent, avec une consciencieuse persévérance, un ouvrage spécial sur la descendance de la Pucelle. Bien qu’ayant particulièrement pour objet la généalogie, continuée jusqu’à nos jours, des branches lorraines et normandes, cette œuvre, impatiemment attendue, jettera de précieuses lumières sur d’importantes questions que je m’estime heureux d’étudier avec ces savants auteurs.
IV Arrivée d’Isabelle Romée à Orléans ; la ville lui sert une pension jusqu’à sa mort
Orléans, quand la mère de Jeanne vint, vers 1440, lui demander asile, ne se borna pas envers elle à un affectueux, mais stérile accueil. La ville pourvut à ses besoins avec une régularité qui ne se démentit pas, depuis son arrivée jusqu’à sa mort. Cette sollicitude toute filiale est constatée, dès les premiers jours, sur le registre de 1440, en termes naïfs et touchants que j’aime à reproduire ici :
À Henriet Anquetil et Guillemin Bouchier, pour avoir gardé et gouverné Isabeau, mère de Jehanne la Pucelle, tant en sa maladie comme depuis, et y a esté depuis le vije jour de juillet jusques au derrenier jour d’aoust, c’est assavoir audit Henriet ix liv. xij s. parisis, et audit Guillemin Bouchier lvij s. ij d. p., pour pain et vin. — Pour ce xij liv. ix s. ij d. p.
À la chambrière, qui estoit à feu messire Bertran, phizicien, qui avoit gardé ladite malade, pour ce iiij s. p.
À Henriet Anquetil, pour la despence de ladicte Ysabeau, et de marchié fait à lui de quarante-huit solz parisis par mois ; pour ce, pour demi-mois de septembre, xxiiij s. p.
À lui, le xxixe jour de septembre, pour l’autre demi-mois, pour ce xxiiij s. p.
À lui, le xiije jour d’octobre, pour demi-mois, pour ladite cause, pour ce xxiiij s. p.
À lui, le xxvije jour d’octobre, pour l’autre demi-mois, pour ce xxiiij s. p.
À ladite Ysabeau, mère de Jehanne, pour le mois de novembre, pour ce xlviij s. p.24.
Et plus loin :
A Ysabeau, mère de Jehanne, pour sa nourriture, pour le mois de décembre [1440], et par l’ordonnance de la chambre, pour ce xlviij s. p.25.
Isabelle Romée paraît avoir quitté la maison d’Henriet Anquetil vers la fin d’octobre 1440, car on voit que la pension mensuelle de novembre et des mois suivants est inscrite à son nom personnel.
Peut-être son fils Pierre, arrivé avec sa famille à Orléans, l’avait-il déjà recueillie chez lui.
Depuis lors, et durant plus de dix-huit années, jusqu’au 28 novembre 1458, jour de sa mort, ces paiements de 48 sols parisis26 par mois, soit 28 livres 8 sols parisis ou 36 livres tournois par an, sont régulièrement inscrits, tantôt isolément, tantôt pour plusieurs mois à la fois, dans les comptes de commune. Ils sont habituellement suivis de quelqu’une des phrases suivantes :
À Ysabeau, mère de Jehanne la Pucelle, pour don que la ville lui fait ;
À Ysabeau, mère de la Pucelle, pour lui aidier à vivre et quérir ses nécessités ;
À Ysabeau, mère, de la Pucelle, en charité, pour lui aidier à vivre.
Le chiffre peu élevé de cette allocation, et les formules qui l’accompagnent d’ordinaire sur les registres, ont fait penser à quelques personnes que, durant son séjour à Orléans ou aux environs, la mère de Jeanne d’Arc y vivait dans un état précaire, presque voisin de l’indigence.
D’incontestables documents permettent d’établir que cette appréciation est mal fondée. Il suffit d’abord de voir, dans nos vieux comptes de ville, quelle était à cette époque, au sein de nos provinces, l’extrême simplicité des mœurs et le modique prit des choses nécessaires à la vie.
Dans ces siècles si différents de nos habitudes actuelles, les présents offerts par la cité aux plus éminents personnages consistaient en quelques mesures de blé ou d’avoine, en quelques pintes de vin présentées dans des vases d’étain, en quelques poissons, lapins ou levrauts, en quelques chapons de haulte gresse.
Quand les procureurs de la ville se réunissaient pour les plus importantes affaires, alors qu’ils payaient généreusement, soit des deniers communs, soit de leurs propres épargnes, de la poudre, du salpêtre, des canons, des milliers de traits pour aider à reconquérir la France, ils inscrivaient avec une touchante simplicité, au compte des dépenses, un ou deux sols de pain, de cerises ou de cerneaux, achetés pour leur déjeuner, après la séance.
Un prédicateur recevait alors xvj sols d’honoraires pour un sermon solennel27.
Le receveur des deniers communs, trente-deux livres parisis par an à Orléans28 ; et trente livres à Blois.
Le traitement annuel du doyen de l’église collégiale de Saint-Pierre-le-Puellier était de trente livres29.
Un haut fonctionnaire du duché, Hue de Saint-Marc, gouverneur de Blois, avait pour gages, comme on disait alors, soixante-six livres tournois chaque demi-année30.
Un homme de peine gagnait de un à deux sols par jour ; quatre sols payaient la journée d’un bon cheval.
Une mine de froment (un tiers d’hectolitre) valait en moyenne dix à douze sols, une mine d’avoine cinq à six sols, une pinte de vin six à huit deniers.
Le loyer des maisons bourgeoises, de celles par exemple habitées par les chanoines de la cathédrale, variait de dix à quatorze livres par an et s’élevait rarement à quinze livres, bien qu’elles se louassent à l’enchère31.
En de telles conditions, l’allocation mensuelle de 48 sols parisis, soit 36 livres tournois par an, était réellement plus que suffisante pour subvenir aux besoins de la mère de la Pucelle.
Henriet Anquetil, dans son marché avec la ville, n’avait pas d’ailleurs demandé davantage pour la recevoir et la nourrir en son hôtel.
Les formules souvent ajoutées aux mentions de paiement : En charité, pour lui aidier à vivre et quérir ses nécessités, etc., doivent également s’interpréter d’après les habitudes de langage usitées alors.
Les mots : en charité, n’avaient pas le sens d’aumône que nous lui donnons habituellement aujourd’hui, mais celui du latin caritas, amitié, bienveillance, etc. Caritas, dit Ducange, don volontaire et gratuit
, quod gratis conceditur, non ex debito, vel consuetudine32.
La locution : pour lui aidier à vivre, fréquemment employée dans les écrits du temps, signifie d’ordinaire : accroître l’aisance du donataire, plutôt que subvenir à ses besoins essentiels.
Nous lisons ainsi dans nos comptes de commune et de forteresse :
Payé à M. Pierre Paris, avocat et conseiller de la ville d’Orléans, pour don à luy fait pour luy aidier à vivre et soustenir son estat, xl liv. p.
À maître Jean, le canonnier (qui commandait l’artillerie des assiégés), pour don à lui fait le 3 juin, pour lui aidier à vivre, viij liv. p.33.
Dans un compte du receveur général des finances du Languedoc, maistre Jehan Brehal, docteur en théologie, inquisiteur de la foi au royaume de France, reçoit du roi, au mois de décembre 1452, trente-sept livres dix sols pour soy aidier à vivre, au fait de l’examen du procès de feu Jehanne la Pucelle34.
Philippe de Commines, enfin, racontant comment Louis XI, alors dauphin, se réfugia auprès du duc de Bourgogne, pour éviter le ressentiment de son père, s’exprime en ces termes :
Durant qu’il estoit fugitif de son père, le roi Charles VII, il fut receu et nourri six ans (par le duc de Bourgogne), ayant deniers de luy pour son vivre35.
Ces exemples, qu’il serait facile de multiplier, suffisent à faire apprécier le vrai sens de ces formules, inexactement interprétées par quelques auteurs, et la valeur réelle de la subvention annuelle donnée à Isabelle Romée. Ce n’était donc pas une aumône que la ville faisait à la mère de la Pucelle, mais une pension suffisant à une honnête aisance, égale aux traitements de fonctionnaires d’un rang honorable et considéré.
V Pierre du Lis prend à bail emphytéotique la ferme de Bagneux, appartenant au chapitre de l’église d’Orléans
À son arrivée dans l’Orléanais, la famille de Jeanne d’Arc était, paraît-il, dans une très-grande gêne :
Avons reçu, [disent les lettres du duc d’Orléans, du 28 juillet 1443, dont il sera parlé ci-après], l’humble supplication de notre bien-amé messire Pierre du Lis, chevalier, contenant […] que par fortune des guerres […] a perdu tous ses biens, tellement que à peine a de quoi vivre et avoir la vie de sa femme et de ses enfants…
Il n’en pouvait être autrement. La fortune de la famille d’Arc, à Domrémy, était des plus modestes. Les dons peu considérables de Charles VII aux frères de la Pucelle avaient été absorbés par leurs dépenses de guerre, et le petit patrimoine de Pierre était devenu insuffisant pour acquitter personnellement sa rançon36.
Isabelle Romée et son fils durent donc, jusqu’à ce qu’ils eussent trouvé quelque honorable moyen de subvenir à leurs besoins, se fixer tout d’abord dans la ville même où de vives et utiles sympathies leur étaient acquises. Mais le séjour de notre vieille cité, telle qu’elle était alors, entourée de ses faubourgs en ruines37, avec sa population commerçante et universitaire, tumultueuse, agitée, serrée en d’étroites maisons ouvrant sur des rues plus étroites encore, devait offrir peu de ressources et surtout peu d’attrait à cette famille de pauvres cultivateurs accoutumés dès l’enfance aux travaux des champs, au soin des troupeaux, à l’air calme et pur des vallées de la Meuse.
Ils devaient désirer, semble-t-il, loin du bruit et de l’oisiveté de la ville, quelque paisible culture mieux appropriée à leurs laborieuses habitudes.
Un précieux document, oublié dans les vieux registres du chapitre de Sainte-Croix d’Orléans, où j’eus l’heureuse fortune de le rencontrer il y a quelques années, vint justifier ces prévisions, et jeter une lumière inattendue sur le problème historique dont je cherchais la solution.
L’église de Sainte-Croix possédait en la paroisse Saint-Aignan de Sandillon, à deux lieues à l’est d’Orléans, sur la rive gauche de la Loire, la ferme de Baigneaux, comprenant, outre ses bâtiments d’exploitation, en assez mauvais état, paraît-il, 170 à 180 arpents de terres labourables baignées par les eaux du fleuve38.
Pierre du Lis eut la pensée de prendre à bail cette métairie ; mais la régularité de la gestion ecclésiastique exigeait qu’une personne d’une solvabilité connue se portât caution des engagements par lui contractés envers le chapitre. Un ami dévoué, que Pierre du Lis avait en la paroisse de Chécy, lui apporta ce précieux concours.
Jean Bourdon, écuyer, chef d’une famille considérable à cette époque, avait à Chécy d’importantes propriétés, et de plus y tenait en fief, du domaine, la plupart des vastes îles existant alors dans le lit de la Loire, entre cette commune et celle de Sandillon39.
C’était de lui ou de l’un de ses proches qu’avait pris nom l’île aux Bourdons en la paroisse de Chécy où, le 28 avril 1429, Jeanne, arrivant de Blois par la rive gauche pour ravitailler Orléans, arrêta son convoi de munitions et de vivres, pour le transborder dans les chalands envoyés de la ville40.
Il n’est pas invraisemblable que ce fait militaire, accompli sur les terres dont jouissait Jean Bourdon, eût créé entre lui et Pierre d’Arc, qui accompagnait sa sœur, des liens d’amitié que quelques années de séparation n’avaient pu rompre. Toujours est-il que le dernier jour de février 1441 (1442 nouv. st.) Pierre du Lis, sous la caution de Jean Bourdon, prenait la métairie de Baigneaux à bail emphytéotique pour lui, sa femme et son fils, et, par devant Denis de la Salle, notaire au Châtelet d’Orléans, passait l’acte dont suit la teneur41 :
Mestaierie de Baigneaux.
Le mercredi derrenier jour de janvier 1441 (1442 n. st.), Messire Pierre du Lis, chevalier, chambellan du roy nostre sire, et dame Jehanne sa femme, du pays de Bar, à présens demourant à Orléans, o l’auctorité, etc., confessèrent avoir prins à la vie d’eulx deux et de Jehan du Lis leur filz, et au survivant d’eulx trois, de chappitre de l’Église d’Orléans, en la présence de messire Philippe Scheust, leur bourcier, et à commencer du jour de Toussaint qui sera en l’an mil CCCC quarante et trois, la mestaierie, terres et appartenances de Baigneaux, assise au vau de Laire (sic), et d’icelle mestaierie, terres et appartenances ferons [faire] les prouffis leurs lesdites vies durant, pour la quantité de sept muids de grains, c’est assavoir : quatre muids de blé seigle et trois muids avene, mesure d’Orléans et rendus chacun an [à Orléans, ès greniers du dit chappitre, de rente ferme ou pension] lesdites vies durant, et à rendre et paier desdits preneurs et de chacun d’eux pour le tout, sans division, auxdits bailleurs, à leurs successeurs bourcier et procureur, ou au porteur de ces lettres, chacun an et par la manière [ancienne] que dit est au terme de Saint-Remy, dont le premier terme et payement commencera au terme de Saint-Remy qui sera en l’an mil CCCC quarante et quatre, auquel terme ne et autres trois termes de Saint-Remy après ensuyvant ne sera tenu paier chacun an, durant lesdits quatre ans, que quatre muids de blé seigle, et les autres années après enssuivant, seront tenus de payer par chascun an toute la dite moison, les dites vies durant, et seront tenus les dits preneurs de repparer et mectre en estat deu ledict hostel et closture d’icelui hostel, et icelui mis, tenir, soustenir et maintenir en bon estat les dites vies durant, et en la fin d’icelles vies laisser en bon et suffisant estat.
Et de paier et faire ce que dit est s’est constitué et établi pleige principal, faiseur et paieur, pour les dits preneurs et à leur requeste, et des couls et intérests, Jehan Bourdon, escuier, demourant en la paroisse de Chécy.
Et se le dit fils seurvit ses père et mère, sera tenu de soy venir [obliger envers les dits de chappitre] dedans la fin de l’an après ensuivant les morts de ses dits père et mère ; et en deffaut de ce faire, pourront iceux bailleurs reprendre leur dit héritage en leur main et en faire ce qui leur plaira, etc… promettant non venir contre, etc… obligeant, etc…
La minute de l’acte porte au bas la mention suivante :
Jehan Bourdon.
Les dits chevalier et dame ont promis au dict escuier de l’acquicter, garantir, délivrer et deffendre envers lesdiz sieurs de ce qu’il a plaigé envers iceulx de la prise et choses dessus dictes, et sur ce le garder de tous intérest et dommaige, obligent, etc…
Quelques détails inscrits dans cet acte doivent être particulièrement signalés.
La longue durée du bail révèle tout d’abord l’intention arrêtée de Pierre du Lis et de sa famille de se fixer définitivement dans l’Orléanais.
Pierre y déclare : demourer à présent à Orléans ; dans tous les actes ultérieurs il est dit constamment avoir sa résidence en quelqu’une de ses propriétés rurales : soit les Isles de Chécy, soit Luminard, paroisse de Saint-Denis-en-Val ; le plus souvent Bagneaux, paroisse de Saint-Aignan de Sandillon.
Sa femme est inscrite, en ce bail, sous le nom de Jehanne du pays de Bar, appellation conforme à l’usage du XVe siècle, qui d’ordinaire désignait les femmes, celles surtout de moyenne condition, par leur nom de baptême, joint à celui du lieu de leur naissance. Charles du Lis, dans son Traité sommaire, et divers actes publics faits en Normandie à la fin du XVIe siècle et reproduits par de La Roque42, la nomment : Damoiselle Jehanne de Prouville43. L’enquête de 1502 nous révélera que son vrai nom était Jehanne Baudot.
Obligation est imposée au fils des preneurs de venir, dans l’année du décès de ses père et mère, s’engager de nouveau, envers les bailleurs, à remplir les conditions souscrites.
J’ai eu la satisfaction de retrouver, dans les vieux registres du chapitre, ce nouvel acte de reprise de bail, qui fera connaître, très-approximativement, la date, jusqu’à présent ignorée, de la mort de Pierre du Lis.
Je le publierai textuellement ci-après.
Les titres de messire, de chevalier et de chambellan du roi, inscrits par le notaire, témoignent du rang qu’occupait ce frère puîné de la Pucelle.
On verra reparaître, dans l’acte de reprise fait après la mort de Pierre du Lis, la qualification de chambellan du roi qui lui est ici donnée.
Quant au titre de chevalier, qui lui fut constamment attribué, les lettres-patentes octroyées par Louis XIII à Charles du Lis, le 25 octobre 1612, et plusieurs auteurs, d’après cet acte officiel, n’en font remonter la concession en faveur de Pierre d’Arc qu’aux lettres du duc d’Orléans, du 28 juillet 1443, relatives à la jouissance emphytéotique de l’Île-aux-Bœufs44.
Les lettres-patentes de 1612 commettent sur ce point une évidente inexactitude.
La donation du 28 juillet 1443 désigne formellement le frère de la Pucelle sous le titre de messire et de chevalier45. Dès lors, loin de lui octroyer cette qualification, elle constate implicitement qu’il en avait déjà la possession. Si le jour précis où ce titre lui fut accordé nous est encore inconnu, du moins est-il certain que ce jour est antérieur au 28 juillet 1443, et même au 31 janvier 1442, puisqu’à cette date il lui était déjà attribué, par le notaire, dans le bail du chapitre.
VI Pierre du Lis obtient du duc d’Orléans la jouissance gratuite de l’Île-aux-Bœufs, paroisse de Chécy
L’exploitation de la ferme de Bagneaux assurait à la famille de Jeanne d’Arc une position modeste, mais paisible, conforme à ses habitudes et suffisant à ses besoins. L’affectueuse sollicitude de Jean Bourdon ne tarda pas à l’accroître encore, dans des conditions plus avantageuses et plus honorables à la fois.
La paroisse de Chécy qu’habitait Jean Bourdon, et celle de Sandillon, où se trouve la métairie de Bagneaux, sont assises vis-à-vis l’une de l’autre, sur les rives opposées de la Loire ; mais l’aspect du fleuve aux XIVe et XVe siècles différait notablement de ce qu’il est aujourd’hui.
Les eaux qui, peu à peu, se sont rejetées vers le nord avaient alors, au midi, leur principal cours. Un vaste réseau d’îles, les unes soudées maintenant au val de gauche, les autres amoindries ou même complètement entraînées par le courant, existait entre les deux bords et subdivisait la masse des eaux en plusieurs bras de faible largeur. On pouvait ainsi communiquer facilement d’une rive à l’autre par des passerelles construites à cet effet, et dont quelques vestiges ont été récemment retrouvés.
J’ai essayé dans une précédente publication, à l’aide de titres publics et privés, d’aveux féodaux et d’enquêtes administratives et judiciaires, conservés dans nos archives départementales, de restituer approximativement, pour ces localités, l’ancienne physionomie de la Loire, telle à peu près qu’on peut se la figurer à cette époque46.
L’Île-aux-Bœufs, sise en la paroisse de Chécy, à proximité des terres de Bagneaux, et d’une contenance de plus de deux cents arpents de terres labourables, bois et pâtures, faisait partie de ce groupe d’atterrissements submersibles, dont l’étendue totale dépassait huit cents arpents47.
Jean Bourdon tenait cette île en fief du domaine, moyennant une modique redevance de six livres parisis par an. Par lettres de renonciation, du 26 juillet 1443, ce généreux gentilhomme consentit à s’en dessaisir en faveur de son ami, et le surlendemain, des lettres-patentes du duc Charles, datées d’Orléans, le 28 juillet 1443, faisaient donation à Pierre du Lis, dans les termes les plus flatteurs, et à titre en quelque sorte de récompense nationale, de l’usufruit de cette île, pour la même date d’entrée en jouissance, et la même durée emphytéotique que le bail de la ferme de Bagneaux, c’est-à-dire pour sa vie et celles de sa femme et de Jean son fils.
Cette charte, d’un si haut intérêt pour la famille dont je recueille ici les souvenirs, paraît ne plus exister en original. Les principaux passages en ont été primitivement publiés par Étienne Pasquier, dans ses Recherches de la France (livre VI, chap. V), et par Charles du Lis en son Traité sommaire.
Un vidimus, daté du 29 juillet 1443, a été retrouvé, il y a peu d’années, aux archives du Loiret, et publié par la Société archéologique et historique de l’Orléanais48. À raison de son importance, et de quelques modifications de lecture, je le reproduis ici textuellement49 :
Lettres de donation
de l’Île-aux-Bœufs
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, le bailli de Blois, salut. Savoir faisons que par Jehan des Estangs, tabellion juré du scel aux contraux de la chastellenie de Blois, ont esté teneues, veues, leues et diligemment regardées de mot à mot unes lectres saines et entières en seel et escripture, scellées en cire vermeille, sus double queue, du grant seel de Monseigneur le duc d’Orléans, desquelles la teneur s’ensuit :
Charles, duc d’Orléans et de Valoys, conte de Blois et de Beaumont et seigneur d’Ast et de Coucy, à noz amez et feaulx gens de nos comptes, général trésorier sur le fait et gouvernement de noz finances, gouverneur, procureur et receveur de nostre duchié d’Orléans, ou à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Receue avons l’umble supplicacion de nostre bien amé messire Pierre du Lis, chevalier, contenant que pour acquicter sa loyauté envers Monseigneur le roy et nous, il s’en feust depparti de son pais et venu ou service de mondit seigneur le roy et de nous, en la compaignie de Jehanne la Pucelle sa seur, avecques laquelle jusques à son abstentement et depuis ce jusques à présent il a exposé son corps et ses biens oudit service et ou fait des guerres de mondit seigneur le roy, tant à la résistance des annemis de ce royaume qui tindrent le siège devant ceste nostre ville d’Orléans, comme en plusieurs voyages faiz et entreprins par mondit seigneur le roy et ses chefs de guerre et autrement, en plusieurs et divers lieux, et par fortune desdictes guerres a esté prisonnier desdiz ennemis, et à ceste cause vendu les héritages de sa femme et perdu tous ses biens, tellement que à paine a de quoy vivre ne avoir la vie de sa femme et de ses enfants, nous requérant très humblement que pour luy aider à ce, il nous plaise luy donner sa vie, la vie durant de luy et de Jehan du Liz, son filz naturel et légitime, les uffruiz, prouffiz, revenues et émolumens d’une ysle appelée l’Ysle aux Beufs à nous appartenant, assise en la rivière de Loire près de la Salle, au droit de Chécy, ainsi comme elle se poursuit et comporte, en comprenant environ demy arpent de ladite ysle qui est au droit de lostel de la Cour-Dieu, appelle Givrou, laquelle ysle Jehan Bourdon et autres tenoient naguières de nous à la somme de six livres parisis valant marc d’argent sept livres tournois, payant chascun an, par moitié, à deux termes, cest assavoir à Toussains et Ascension Nostre-Seigneur, et à laquelle ysle et choses dessus dictes, de nostre consentement, ilz ont naguières renoncié à nostre prouffit et pour en disposer à nostre voulenté, ainsi que plus à plain peut apparoir par lectres de renonciacion données le xxvje jour de ce présent moys de juillet, lan mil CCCC quarante et trois.
Pour quoy nous, en considéracion aux choses dessusdictes, voulans, en faveur et contemplacion de la dicte Jehanne la Pucelle, sa seur germaine, et des grands, hauls et notables services qu’elle et ledit messire Pierre, son frère, ont faiz à mondit seigneur le roy et à nous, à la compulsion et résistance desdiz ennemis et autrement, avons donné et donnons, de nostre certaine science et grâce espécial, par ces présentes, audit messire Pierre, lesdiz uffruiz, prouffiz, revenues et émolumens de ladicte ysle et choses dessusdictes, pour yceulx prandre et parcevoir doresenavant par luy et sondit filz, la vie durant d’eulz deux et de chascun d’eulx, tant comme le seurvivant d’eulx deux vivra et aura la vie ou corps.
Si vous mandons, commandons et expressément enjoingnons par ces dictes présentes et à chascun de vous, si comme à luy appartendra et aussi à tous noz autres justiciers, officiers et subgiez de nostre dit duchié, présens et avenir, que de nostre présent don, facent, seuffrent et laissent lesdiz messire Pierre et Jehan du Liz, son filz, joir et user plainement et paisiblement, ledit temps durant, de ladite ysle et choses dessus dictes, plainement et paisiblement et ycelles exploictez, avoir, prandre et percevoir les prouffiz, uffruiz, revenues et appartenances ledit temps durant, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement, au contraire. Et, par rapportant ces présentes ou vidimus d’icelles, collacionné en la chambre de noz comptes pour une foiz seulement, avecques recongnoissance dudit chevalier du joyssement desdictes choses, nous voulons vous, nostre receveur et tous autres qu’il appartendra, estre et demourer quictes et deschargez, le temps dessusdit durant desdictes vies dudit chevalier et de sondit filz, de la recepte des revenues dessusdictes par vous, gens de nosdiz comptes et par tous autres à qui il appartendra sans aucun contredit ou difficulté ; car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant quelconques autres dons ou biens faiz par nous audit chevalier, non exprimez en ces présentes et quelconques ordonnances par nous faictes et à faire, de non donner ou aliéner aucune chose de nostre domaine, restraincions, mandements ou deffensements ad ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel à ces présentes. Donné à Orléans le xxviije jour de juillet l’an de grâce mil CCCC quarante et trois. Ainsi signé par monseigneur le duc, Mgr le bastart de Vertuz, vous garde des seaulx et autres présens, D. Berthelin.
Ausquelles lectres cy-dessus transcriptes estoit atachée la vérification de honorable homme et saige maistre Jehan le Fuzelier, général conseiller de Monseigneur le duc d’Orléans, sur son signet placqué en cire vermeille, contenant ce qui s’ensuit : Jehan le Fuzelier, général conseiller, ordonné par monseigneur le duc d’Orléans, sur le fait et gouvernement de toutes ses finances comme mondit seigneur le duc, par ses lectres pattentes, données en sa ville d’Orléans, le xxviije jour de juillet derrenier passé ausquelles ces présentes sont atachées soubs mon signet, et pour les causes plus a plain contenues et déclairées en icelles, ait donné et ottroyé à messire Pierre du Liz, chevalier, frère de Jehanne la Pucelle, et à Jehan du Liz son filz, et au seurvivant d’eulx deux les uffruiz, prouffiz, revenues et émolumens d’une isle appellée l’Isle aux Beufs, appartenant à mondit seigneur le duc, assise en la rivière de Loire, près de la Salle, au droit de Chécy, ainsi comme elle se poursuit et comporte ; en ce compris environ demy arpent de ladicte isle qui est assis au droit de l’ostel de la Court-Dieu, appellée Givrou, laquelle ysle naguières souloient tenir dudit seigneur, Jehan Bourdon et autres, à six livres parisis par an, lesquelz y ont renoncié du consentement dudit seigneur : lesquelz uffruiz, prouffiz, revenues et émoluments dessusditz d’icelle ysle, ledit messire Pierre tendrait et pourrait avoir, tenir, prandre, avoir et parcevoir durant la vie d’eulx deux et de chascun d’eulx, et tant et si longuement comme le seurvivant d’eulx deux vivra et aura la vie naturelle ou corps seulement. Me consens, entant que en moy est, et qu’il me touche et appartient, à l’entérinement et accomplissement du contenu esdictes lectres tout selon pour les causes et par la fourme et manière que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles. Donné soubs mes saing manuel et signet, le xxixe jour dudit mois de juillet, l’an mil CCCC quarante et trois, et signée J. le Fuzelier. En tesmoing de laquelle chose nous, bailli de Blois dessusdit, à la relation dudit juré, avons fait seeller ces présentes lectres et vidimus du seel de ladicte chastellenie de Blois, le second jour d’aoust, l’an de grâce mil quatre cens quarante et trois.
Signé : Des Estangs.
Collacionné aux originaux50.
Au dos, sont inscrites les mentions suivantes :
Collatio hujus transcripti, cum litteris originalibus, datis et signatis prout ad album cavetur, facta fuit in camera compotorum Domini Ducis Aurelianensis, ij die mensis augusti, anno M.CCCC.XLIII, per me Filleul et me Tuillies.
Et plus bas :
L’an mil CCCC quarante et six, le vendredy XXVIIe jour du mois de janvier, messire Pierre du Lis, chevalier, confessa que, par vertu de ces présentes, les gens et officiers de Monseigneur le duc d’Orléans le ont lessé et lessent paisiblement joir et user de l’Isle et appartenances, contenance en usaige, et en prendre et percevoir les fruiz et revenues, pour les causes contenues en ces présentes, sans aucune chose en paier et bailler.
Signé : Maubaudet.
La donation octroyée par cet acte eut sa pleine exécution. La mention ci-dessus, inscrite au dos de l’acte, et les comptes du domaine constatent que Pierre du Lis et, après lui, Jean son fils conservèrent, leur vie durant, la jouissance gratuite de l’Île-aux-Bœufs51.
La série de documents qui vient d’être mise sous les yeux du lecteur permet donc aujourd’hui d’apprécier, sur des données à peu près certaines, la fortune dont jouissaient, en notre province, la mère et le frère de Jeanne d’Arc.
Leur revenu se composait principalement du produit, déduction faite des fermages dus au chapitre, des quatre cents arpents de terres labourables, pacages et oseraies formant les dépendances de la ferme de Bagneaux et de l’Île-aux-Bœufs, puis de la rente de 48 sols parisis, par mois, régulièrement payée par la ville d’Orléans, à Ysabeau, mère de la Pucelle.
Il s’accrut, quelques années après, d’une pension de cent vingt et une livres tournois sur le Trésor, accordée à Pierre du Lis et continuée, après sa mort, à Jean son fils.
L’époque précise où cette pension lui fut constituée ne nous est pas, jusqu’à présent, connue ; nous trouvons seulement le paiement des arrérages inscrit à la Cour des comptes à partir de 145452.
Les regrettables inexactitudes commises par plusieurs auteurs se trouvent ainsi rectifiées. On peut, dès à présent, affirmer avec assurance que, loin de n’avoir rencontré en notre province qu’une position pénible et précaire, les parents de la Pucelle, grâce à la constante sollicitude des procureurs de la ville, aux bienfaits du duc Charles et à l’affectueux appui d’amis sincères et dévoués, avaient repris, à peu de distance de la ville, là même où s’était accompli le premier acte de la délivrance d’Orléans, leurs paisibles habitudes de culture, au sein d’une laborieuse aisance et d’une honorable hospitalité.
VII Marguerite du Lis, fille de Jean, prévôt de Vaucouleurs, second frère de la Pucelle, épouse Antoine de Brunet, écuyer ; sa postérité ; sa mort
Une honorable alliance vint, à une date qu’on ne saurait en ce moment préciser, resserrer les liens qui rattachaient la famille de Jeanne d’Arc à ces rives de la Loire, devenues sa nouvelle patrie.
Marguerite, fille de Jean, prévôt de Vaucouleurs, qu’Isabelle Romée avait amenée de Domrémy avec elle, épousait un gentilhomme Orléanais nommé Antoine de Brunet, et son oncle, messire Pierre, lui constituait en dot53 la jouissance du petit fief du Mont, sis en la paroisse de Saint-Denis-en-Val, limitrophe de Saint-Aignan de Sandillon54.
C’est à tort qu’Antoine de Brunet est désigné sous le nom d’Antoine de Bonnet par Charles du Lis et d’autres auteurs. Le domaine du Mont existe encore aujourd’hui, et j’ai pu en consulter les titres. Les noms d’Antoine de Brunet (ou quelquefois du Brunet) et de Marguerite du Lis, sa femme, y sont tant de fois inscrits dans les aveux féodaux, les paiements de cens annuels à la fabrique de Saint-Donatien d’Orléans, et autres actes publics et privés, qu’aucun doute ne peut s’élever à cet égard55.
Les documents qui ont passé sous mes yeux mentionnent peu de faits importants relatifs à cette branche de la famille de la Pucelle.
Antoine de Brunet et Marguerite du Lis habitèrent constamment le domaine du Mont. Ils en eurent d’abord la jouissance, puis en devinrent propriétaires à la mort de Messire Pierre et en accrurent notablement l’étendue.
Ils prirent une part considérable aux graves incidents de la succession de leur cousin germain, Jean du Lis, seigneur de Villiers. Les intéressants détails en seront exposés au chapitre XI de cette étude.
Le 3 octobre 1501, le Prévôt d’Orléans rendait une sentence favorable aux prétentions de Marguerite du Lis ; le 5 septembre 1502, son mari, Antoine de Brunet, terminait l’affaire, en la seigneurie du Mont, par une transaction signée de lui :À cause de feu Marguerite du Lis, sa femme.
La mort de cette nièce de Jeanne d’Arc est donc comprise entre ces deux époques.
Du mariage de Marguerite et d’Antoine de Brunet naquirent trois enfants56 : Antoine et Anne, morts avant 1519, sans avoir contracté d’alliance57, et Jean de Brunet, écuyer, qui, suivant acte du 17 novembre 1519, devant Guy Pescheloche, notaire à Cloyes, épousa damoiselle Catherine de Thiville, fille de noble homme Guillaume de Thiville, seigneur de la Roche-Verd, et de damoiselle Marie de la Forêt.
Devenu veuf de Marguerite du Lis, Antoine de Brunet contracta un nouveau mariage avec Marguerite Potin, dont il eut deux enfants : Claudine, qui depuis épousa Luc de Sourches (ou Des Ouches), et un fils nommé François.
Des dissentiments paraissent s’être élevés entre Antoine et Jean son fils, né du premier mariage, et donnèrent lieu à divers actes, dont l’un nous apprend qu’Antoine, après le décès, de son cousin Jean du Lis, seigneur de Villiers, reprit personnellement le bail de la ferme de Bagneaux, car, dans, une transaction, du 25 août 1525, devant Michel Dubois, notaire, au Châtelet d’Orléans, Antoine abandonne à son fils les lieu et métairie de Bagneaux, paroisse Saint-Aignan de Sandillon, et Jean, lui rétrocède, en compensation, la métairie, de Lussault, paroisse,de Viglain, en Sologne.
Au cours de ces débats intérieurs, Jacques Groslot, chevalier, conseiller du roy en son grand conseil, bailli d’Orléans, etc., voulut acquérir, de la famille de Brunet, le fief du Mont, enclavé dans les vastes dépendances de son domaine de l’Île, au centre duquel il construisait le château aujourd’hui à demi-détruit, qui, durant les discordes religieuses du XVIe siècle, devint le foyer du protestantisme en notre Orléanais.
Marguerite Potin, par suite de partages, en était devenue propriétaire. À sa mort, ses deux enfants, Claudine, épouse de Luc de Sourches, et François de Brunet, avaient recueilli ce bien dans sa succession. Jehan de Brunet et Catherine de Thiville, sa femme, y avaient aussi conservé des droits.
Après de longs incidents, Jehan de Brunet et Catherine de Thiville, Luc de Sourches et Claudine de Brunet vendirent, par acte du 29 avril 1532, devant Nicolas Sevin, notaire, ce domaine du Mont à messire Jacques Groslot et à dame Jehanne Garrault, sa femme, administrant, dit l’acte, le négoce de son dit mari, par les occupations considérables qu’il a à l’œuvre de ses estats officiels58.
Le Mont, depuis cette vente, a fait partie des dépendances du château de l’Île.
Antoine de Brunet, époux de Marguerite du Lis, mourut de 1530 à 1531 ; son nom disparaît, à cette date, des registres censiers de la terre du Mont qui m’ont été communiqués.
Les descendants de cette nièce de Jeanne d’Arc, s’il en existe encore, ont, depuis lors, échappé à mes recherches.
VIII Le procès en réhabilitation
Si douce que fût la vieillesse d’Isabelle Romée près de ses enfants et dans la paix de ses travaux champêtres, aucun bonheur ne pouvait exister pour elle tant que ne serait pas réalisée l’unique pensée de sa vie, tant que la tache imprimée par une odieuse sentence au nom de sa noble fille ne serait pas solennellement effacée.
En 1452 se leva enfin l’aurore de cette révision depuis si longtemps attendue.
Après vingt ans de délaissement et d’oubli, contre lesquels Orléans, par ses publics hommages, protestait en vain chaque année, un prélat français, le cardinal Guillaume d’Estouteville59, indigné de l’iniquité judiciaire qui déshonorait l’histoire de sa province, conçut la généreuse pensée d’en poursuivre d’office, en sa qualité de légat du Saint-Siège près de la Cour de France, la légitime réparation.
Accompagné de l’inquisiteur de la foi, Jean Bréhal, il se rendit de sa personne à Orléans, près de la mère et du frère de l’héroïque victime. Cette première information faite à Orléans pour la réhabilitation de Jeanne d’Arc a laissé une trace précieuse en nos vieux registres de commune. On lit dans le compte de Jehan de Troyes, année 1452 :
Payé audit Pichon, le xxvje de may ensuivant (1452), pour six pintes et choppine de vin présentées à maistre Guillaume Baille et à l’Inquisiteur de la foy, lesquelz avoient mandez les procureurs pour le procès de feue Jehanne la Pucelle, à viij d. p. la pinte, vallent iiij s. iiij d. p.60
Comme si la cause qu’il prenait noblement en main eût déjà triomphé, le cardinal, en vertu de ses pouvoirs, et par lettres apostoliques données à Orléans le 9 juin 145261, accorda un an et cent jours d’indulgences à tous ceux qui, le 8 mai de chaque année, s’associeraient pieusement à la fête de la délivrance et assisteraient le lendemain au service funèbre célébré pour les victimes du siège62.
Puis, s’étant fait remettre par Isabelle Romée, et aussi par Pierre d’Arc, en son nom et en celui de Jean, son frère, une requête formelle en révision du procès, il voulut aller lui-même la déposer aux pieds du Souverain-Pontife et l’appuyer de son crédit personnel.
Ce fut ainsi d’Orléans ou de sa banlieue, ce fut des rives de ce fleuve tant de fois témoin des merveilleux exploits de la Pucelle que, sous la patriotique impulsion du cardinal d’Estouteville, se fit entendre pour la première fois la solennelle revendication de la réhabilitation de Jeanne d’Arc.
Durant trois longues années d’hésitations, cette pieuse requête dut attendra encore, près de la cour romaine, l’heure d’une tardive justice. Enfin, le 11 juin 1455, Calixte III, récemment élu, ordonna, par un rescrit pontifical, que le procès de condamnation fût publiquement révisé, et nomma, pour procéder au jugement réparateur, trois membres éminents du clergé de France : Jean Jouvenel des Ursins, archevêque de Reims, Guillaume Charger, évêque de Paris, et Richard de Longueil, évêque de Coutances, assistés de l’Inquisiteur de la foi, Jean Bréhal.
Isabelle Romée et ses deux fils, Jean et Pierre, prirent une part considérable à ces imposants débats, provoqués et poursuivis en leur nom63.
Le 17 novembre 1455, la mère de Jeanne vint d’Orléans avec messire Pierre et plusieurs notables de la ville assister, en la cathédrale de Paris, à leur solennelle ouverture, puis bientôt après, à raison de son grand âge, jam fere ætate decrepita, dit le procès-verbal64, elle obtint de retourner en sa province et de se faire représenter au procès par un fondé de pouvoirs.
En mars 1456, elle fut de nouveau interrogée à Orléans par l’archevêque de Reims65.
Enfin, après douze mois d’informations et d’enquêtes, à Rouen, à Domrémy, à Orléans, à Paris, etc., un arrêt définitif, prononcé le 7 juin 1456, mit à néant l’odieuse condamnation du 30 mai 1431 et ordonna que cette sentence de réhabilitation fût publiée à Rouen d’abord, à la suite d’une procession générale d’expiation, puis dans toutes les villes du royaume66.
Le 20 juillet suivant, deux des juges du procès, l’évêque de Coutances et l’Inquisiteur de la foi, Jean Bréhal, se rendirent eux-mêmes à Orléans, et le lendemain mercredi 21, dans l’imposant appareil des solennités religieuses, y proclamèrent publiquement l’acte réparateur67.
L’œuvre de justice était enfin accomplie ; l’humble requête de la mère de Jeanne avait triomphé d’une trop longue indifférence. Isabelle Romée pouvait désormais mourir ; elle venait de voir, comme autrefois à Reims, le nom de sa pieuse fille salué des acclamations et des bénédictions de la France.
Quelques personnes voyant les paiements, mois par mois, de la pension d’Isabelle Romée si exactement inscrits dans nos comptes de commune, se sont étonnées qu’aucune mention n’y fût faite des actes de la réhabilitation accomplis parmi nous et auxquels elle prit, ainsi que son fils, une si grande part.
Ce silence de nos vieux registres s’expliquerait en effet difficilement, si la famille de la Pucelle eût habité la ville. Il semble dès lors permis d’en induire qu’elle n’avait pas à Orléans sa principale résidence.
Nos comptes de commune et de forteresse, très-régulièrement tenus, n’avaient à mentionner que les faits relatifs à la cité même, en tant surtout qu’ils se rattachaient à l’emploi de nos finances municipales.
Si les parents de la Pucelle avaient leur demeure habituelle en une commune rurale, les frais du procès de réhabilitation ne retombant à la charge de la ville que pour les présents ou les solennités qu’ils occasionnaient, il n’y avait nul motif pour que les actes d’informations, auxquels participaient les membres de la famille, figurassent aux comptes de gestion de nos procureurs.
IX Dernières années d’Isabelle Romée, de Messire Pierre du Lis et de sa femme Jeanne (du pays de Bar)
La vénérable mère de la Pucelle, accablée d’années et courbée si longtemps sous le poids de la douleur, allait bientôt descendre dans la tombe. Un dernier jour de joie devait toutefois luire encore pour elle ; un dernier témoignage d’honneur devait être donné à elle-même et aux siens.
Un an après les solennités de la réhabilitation, son petit-fils Jean, fils de messire Pierre, s’unissait en mariage à une noble héritière, damoiselle Macée de Vézines, fille de Jean de Vézines, écuyer, seigneur du domaine de Villiers, en la paroisse d’Ardon.
Pour donner plus d’éclat à ces noces, le 18 juillet 1467, disent nos vieux registres, la famille quitta son village et vint les célébrer à Orléans.
Les procureurs de la ville saisirent cette occasion d’offrir aux parents de leur sainte libératrice une marque publique de déférence et d’affection.
Cette touchante manifestation est inscrite aux comptes de 1457, en termes d’une simplicité si naïve, que, bien que déjà publiés, j’aime à les reproduire ici :
À Symon le Mazier, demourant à l’Enge, le lundi xviije jour du mois de juillet [M CCCC LVII], pour lj pintes de vin, tant blanc que vermeil, pris ledit jour en son hostel, et présenté par la ville au disner et soupper des nopces du filz de messire Pierre du Lis, chevalier, frère de feu Jehanne la Pucelle ; pour ce qu’il estoit venu faire sa feste du village en ceste ville et n’avoit point de bon vin vieil de provision pour povoir festoier et faire plaisir à messeigneurs de la justice et autres notables gens de ladicte ville et de dehors, qui estoient venus aucdictes nopces, lij s. p, ; c’est assavoir, pour xv pintes de vin blanc, x s. p., et en xxxvj pintes de vin vermeil, à xiv d. la pinte, xlij s. Pour ce, payé audit Simonnet, par l’ordonnance desdiz procureurs, lij s. p.
À Michelet Filleul, l’un des procureurs, la somme de vint livres tournois qui, par l’ordonnance desdiz procureurs, a esté par lui présentée ou nom de la ville au filz dudit messire Pierre du Lis, chevalier, le mardi xixe jour dudit mois, en aulmentacion de son mariage, pour considération des grans biens, bons et agréables services que fist durant le siège feu Jehanne la Pucelle, seur dudit messire Pierre du Lis, à ceste cité d’Orliens. Pour ce, audit Michelet, le dit jour, xvj l. p.
Audit Michelet, ledit jour, pour une bource par lui achaptée, en quoy il a présenté la somme dessus dicte en monnoie, ij s. iv d.68.
Quinze mois après, le 28 ou 29 novembre 1458, Isabelle Romée, presque octogénaire69, achevait sa longue et douloureuse carrière.
Sa mort est mentionnée en ces termes sur le registre de compte, de 1458 :
À Messire Pierre Dulis, chevalier, frère de feu Jehanne la Pucelle, la somme de xlviij s. p., qui par les procureurs a esté ordonné lui estre baillée, pour le don que la ville faisoit chascun mois à feu Ysabeau, leur mère, pour lui aider à vivre, et pour le mois de novembre derrenier passé (M CCCC LVIII), ouquel mois elle trespassa le xxviij ou xxixe jour ; pour laquelle cause ladicte somme a esté ordonné estre baillée audit messire Pierre, son filz, pour faire du bien pour l’âme d’elle et accomplir son testament. Pour ce, xlviij s.70.
Ce texte mérite d’être attentivement étudié. Il semble en ressortir qu’Isabelle Romée n’est pas décédée en la ville même, mais près de ses enfants, aux lieux où les retenaient habituellement leurs occupations agricoles, et que c’est là, vraisemblablement, que ses cendres reposent.
Si la mère de Jeanne eût rendu à Orléans son dernier soupir, on aurait droit de s’étonner que la cité reconnaissante qui, dès son arrivée, en 1440, l’avait accueillie avec tant de sollicitude, qui depuis dix-neuf ans pourvoyait finalement à ses besoins, et tout récemment encore s’était si affectueusement associée à ses joies de famille, n’eût rien fait, rien absolument, pour honorer ses obsèques. Cette indifférence n’était pas dans les habitudes de nos pères. Le profond attachement qu’en toutes circonstances ils aimaient à manifester, non seulement envers leur vénérée libératrice, mais aussi envers les parents qui perpétuaient son souvenir, est un élément certain d’appréciation qu’on ne doit jamais oublier.
La simple mention consignée dans le compte de Hervé Paris et, pour n’omettre aucun détail, l’incertitude sur le jour même de la mort, constatée au registre par la double date du 28 ou du 29, tout semble révéler, en ce texte, qu’Isabelle Romée ne mourut pas à la ville, et que cette déclaration, postérieure de quelque temps à son décès, n’avait pour objet qu’un dernier règlement de la pension qui s’éteignait avec elle.
Messire Pierre survécut de quelques années à sa mère. Divers détails, recueillis à son égard, doivent être, sommairement au moins, indiqués ici, pour compléter ces souvenirs.
Un acte fort curieux, retrouvé aux archives départementales par le zèle intelligent de M. J. Doinel, nous a fait connaître que le 8 mai 1452, Pierre du Lis avait pris à bail, de l’abbé et du couvent de Saint-Euverte, pour cinquante-neuf ans, à compter de la Nativité Saint-Jean-Baptiste (1452), une maison en ruines qu’ils avaient à Orléans en la paroisse Saint-Pierre-Pullier (sic), laquelle faisait le coin de la rue qui va de Saint-Flou à l’église dudit Saint-Pierre-Pullier71. Le prix très-minime de cette location était de 32 sols parisis de rente (monnoye vallant sept livres tournois, marc d’argent
, dit l’acte) ; de plus les deux premières années devaient être gratuites, et les quatre ensuivant chargées seulement de douze sols parisis de rente par an.
Pierre du Lis était, en outre, tenu par ce contrat :
… de mectre ladicte maison en bon estat et convenable, en six ans prochains venans, tant de couvertures comme de murailles, planchers et autres choses, et icelle mise, la maintenir et la laisser en bon estat et couverte toute en thuille.
Elle fut, à la mort de Pierre du Lis, conservée aux mêmes conditions par Jean son fils, après le décès duquel elle fit retour, en 1505, au couvent de Saint-Euverte72. Fut-elle complètement rebâtie, comme le prescrivait le bail ? Peut-être serait-il permis d’avoir quelques doutes à cet égard, car dans un autre acte du 23 mai 1509, relatif à la même propriété, et dont la découverte est également due à M. J. Doinel, il est dit :
Dans laquelle masure y a deux pans de mur et ung sur le derrière, fandus, qui ont été condampnés à abattre par les charpentiers jurés d’Orléans73.
Ce qui pourrait donner à croire qu’il n’y fut fait que des travaux partiels ou d’importance secondaire.
Dans ce bail authentique du 8 mai 1452, Pierre du Lis déclare :
… demourer à présent en la paroisse Saint-Aignan de Sandillon.
J’aurai à examiner plus tard le sens probable des mots : demourer à présent
.
Mais vers la fin de sa vie, messire Pierre semblerait avoir habité la propriété de Luminard, en la paroisse de Saint-Denis-en-Val, limitrophe de Sandillon. Dans l’enquête de l’année 1502, un de ses petits-neveux, noble homme Claude du Lis, alors âgé d’environ cinquante ans, déclare :
… avoir demouré, en son jeune âge, avec feu Pierre du Lis, oncle à sa mère, et avec dame Jehanne sa femme, au lieu de Luminart, près Orléans, environ le temps et espace de cinq ans74.
Le 11 juin 1463, Pierre du Lis reçut du duc d’Orléans une nouvelle marque de bienveillance. Par lettres-patentes données en son chastel de Blois,
… en souvenance des bons et notables services que feue Jehanne la Pucelle a faits à tout ce royaulme, au recouvrement d’iceluy, et mesmement durant le siège mis par les Anglois devant la ville d’Orléans,…
le duc Charles lui fait don d’une somme de dix livres tournois par an, à prendre sur le prix de vente des bois de la forêt75.
Pierre du Lis existait donc encore en juin 1463. Il avait cessé de vivre le 8 janvier 1467.
Cette limite extrême de sa vie nous est donnée par l’acte de reprise du bail de Bagneaux, pour lequel Jean, son fils, devait obligatoirement, dans l’année du décès de ses père et mère, s’engager personnellement envers le chapitre, aux termes du contrat primitif de 1442.
J’ai déjà dit avoir retrouvé cet acte de continuation de bail, ainsi que l’avait été le titre originaire de location, dans les registres de l’église de Sainte-Croix. Il est daté du 8 janvier 1467, passé devant Tassin Berthelin, notaire juré au Châtelet d’Orléans, et conçu ainsi qu’il suit :
Baignaux
Le huitième jour de janvier LXVI76.
Comme feux messire Pierre du Liz, jadiz chevalier, chambellan du Roy notre sire, et dame Jehanne, sa femme, du pays de Bar, o l’auctorité de son dit feux mary, eussent ou vivans dudit feux messire Pierre, le mercredi derrenier jour de février 1441, pris à la vie d’eulx deux et de Jehan du Lis leur filz, et au survivant d’eulx trois, à commancer du jour de Toussains qui seroit en l’an 1443, de vénérables et discrètes personnes les doyen et chappitre de l’église d’Orléans, la mestairie, terres et appartenances de Baignaulx, assis au vau de Loire, et d’icelle mestairie, terres et appartenances, faire les prouffis leurs lesdictes vies durant, pour la quantité de sept muys de grains, c’est assavoir quatre muys de blé-seigle et trois muys aveine, mesure d’Orléans, et rendus chascun an à Orléans es greniers dudit chappitre ; de rente ferme ou penssion, chascun an, lesdictes vies durant ; que lesdits preneurs en promisdrent rendre et paier, chascun pour le tout, sans division, ausdiz seigneurs, à leur bourcier et procureur ou au porteur de leurs lettres, au terme de Saint-Remy, soubz telle condition que lesdiz preneurs seroient tenuz de réparer et mectre en estat deu ledit hostel et closture d’icelluy, et icelluy mis, tenir, soustenir et maintenir en bon estat, lesdites vies durant, et en la fin d’icelles vies, lesser en bon et suffisant estat.
Et aussi fut dit que se ledict filz seurvivoit à ses père et mère, qu’il seroit tenu de soy venir obliger devers lesdiz de chappitre à ce présent contrault dedans la fin de l’an après ensuivant les mors desdiz père et mère, et en deffault de ce fère pourroient iceulx bailleurs reprandre ledict héritaige en leur main et, en fere ce qu’il leur plairoit, comme ces choses sont plus à plain contenues et déchirées es lettres de prise sur ce faictes et passées par feu Denis de la Salle, jadis notaire de Chastellet d’Orliens, lesdis an et jour.
Savoir faisons que ledict Jehan du Lis, autrement dit de la Pucelle, filz desdiz feus messire Pierre du Lis et de ladite dame Jehanne, establi aujourd’huy, date de ces présentes, par devant Tassin-Berthelin, clerc, notaire juré de Chastellet d’Orléans, lequel de son bon gré et voulanté, en accomplissant la promesse faicte par sesdiz feux père et mère, promet, et s’oblige, et encore par ces présentes promet et s’oblige par sa foy baillée et mise corporellement en la main d’icelluy juré, ausdiz doyen et chappitre, à leur procureur ou bourcier ou au porteur de ces lettres, rendre et paier chacun an lesdiz sept muys de grains de rente telz et mesure que dessus, au lieu et terme dessusdiz, et faire et accomplir en ladicte mestairie toutes et chacunes les choses dessusdites, et quant ad ces choses, et à rendre et paier tous coustements, mises, dommaiges, intérestz et despens qui faiz seront par deffauls de paie ou d’accomplissement d’avances de choses contenues et déclairées esdictes lettres de prise, icelluy Jehan du Liz en a obligé et oblige loyalement et par sa dite foy ausdiz doyen et chappitre, et soubzmest, à ce, soy, etc.77.
On aura remarqué, dans ces lettres de reprise de bail, que, pour la seconde fois, Pierre du Lis y est dit : chambellan du roi.
Nulle part ailleurs, hormis dans ces deux contrats du chapitre, je n’ai rencontré cette qualification ajoutée à celles de messire et de chevalier qui lui sont constamment données.
Et pourtant, il semble bien difficile d’admettre qu’en un acte public auquel concourait un corps aussi considérable que le chapitre de l’église d’Orléans, Pierre du Lis eût osé s’attribuer une distinction honorifique très-recherchée par la noblesse, qui ne lui aurait pas légitimement appartenu.
Il serait plus inexplicable encore qu’à vingt-quatre ans de distance, alors que Pierre du Lis avait cessé d’exister, ce titre de chambellan du roi lui eût été, sans droit, itérativement maintenu dans un second contrat authentique, devant un notaire du chapitre, autre que celui de 1442.
Les lettres-patentes de juin 1463, la déclaration de Claude du Lis dans l’enquête de 1502, et l’acte du 8 janvier 1467, circonscrivent en des limites assez restreintes, c’est-à-dire vers 1465 ou 1466, l’époque de la mort de messire Pierre du Lis.
S’il était, comme on le pense généralement, un peu plus âgé que la Pucelle, il devait avoir environ soixante ans.
La mort de Jeanne sa femme (du pays de Bar, ou de Prouville, dans le Barrois), eut lieu vraisemblablement peu de temps après la sienne. Les lettres de reprise du bail de Bagneaux constatent d’une manière incontestable que l’un et l’autre avaient cessé de vivre le 8 janvier 1467. Mais le dernier acte public auquel Jeanne ait pris part étant le mariage de son fils Jean avec Macée de Vézines, en 1457, un intervalle de dix années resterait indéterminé pour la date de sa mort, si la déposition de noble homme Claude du Lis, en l’enquête de 1502, n’eût fait connaître que, selon toute apparence, son décès avait eu lieu, comme celui de son mari, de 1465 à 1467.
X Jean du Lis, dit de la Pucelle, Seigneur de Villiers, fils de messire Pierre du Lis et de Jeanne (du pays de Bar)
Du mariage de messire Pierre du Lis, chevalier, et de Jeanne, son épouse, naquit un fils, Jean, dont le nom est inscrit au bail de Bagneaux (janvier 1442), ainsi qu’aux lettres patentes du 29 juillet 1443. Charles du Lis, en son Traité sommaire, nous a transmis à son égard plusieurs détails, que de nouveaux documents permettent de compléter.
Jean du Lis dut au nom qu’il portait l’honorable alliance qu’il contracta à l’âge d’environ vingt-cinq ans avec damoiselle Macée de Vézines, et les témoignages d’affection que lui donnèrent les procureurs de la ville, à l’occasion de ce mariage.
La famille de Vézines était, depuis le commencement du XIVe siècle, en possession du manoir fortifié de Villiers-Charbonneau, relevant de la Ferté-Nabert et sis en la paroisse d’Ardon, près Orléans.
Plusieurs aveux féodaux rendus, à partir de 1431, par Hervé de Vézines, Naudon son fils, et Jean, fils de Naudon, père de damoiselle Macée, sont conservés dans les titres de ce domaine78, moins considérable alors qu’il ne l’est aujourd’hui. Quelques-uns ont été cités par Charles du Lis79.
Dans son contrat de mariage passé devant Jean Bureau le jeune, notaire au Châtelet d’Orléans, le 26 mars 1456 (1457, nouv. st.), Jean du Lis prend le titre d’écuyer, fils de messire Pierre du Lis, chevalier, et de dame Jehanne sa femme.
Et Macée de Vézines y est dite fille de Jehan de Vézines, escuier, et de damoiselle Jehanne Gouynette.
Les parents de damoiselle Macée assurèrent aux jeunes conjoints dix livres parisis de rente, et le futur époux constitua en doë (douaire) à sa femme cent escus d’or, à prendre sur les biens qui, lors de son décès, adviendraient à ses héritiers80.
Peu de temps après son mariage, Jean du Lis vint habiter le château de Villiers dont il était devenu possesseur. On l’y voit recevoir des aveux de foi et hommage, et y exercer des droits de propriétaire dont les titres existent encore dans le chartrier de ce domaine.
Il s’y qualifie d’ordinaire noble homme Jehan du Lis, dit de la Pucelle, escuier, seigneur de Villiers-Charbonneau ;
mais, depuis la mort de son père, il déclare presque toujours demeurer à Saint-Aignan de Sandillon et prend, lui aussi, le titre de seigneur de Bagneaux, encore bien qu’il ne fût réellement, comme l’avait été Pierre du Lis, que tenancier, à prix d’argent, du chapitre.
Jean du Lis, en effet, était entré en possession de la métairie de Bagneaux et des terres de l’Île-aux-Bœufs, au décès de ses père et mère, dont le bail de 1442 et les lettres-patentes de 1443 lui avaient assuré la survivance.
La pension annuelle de cent vingt-cinq livres tournois (alias 121 livres) dont avait joui messire Pierre, depuis 1454, lui fut également continuée81.
Il conserva, au même titre, et moyennant la même rente de 32 sols parisis par an, la petite maison que son père avait prise à loyer, en 1452, de l’abbé de Saint-Euverte.
Dès que Jean du Lis et damoiselle Macée de Vézines furent en possession de leur fortune héréditaire, ils complétèrent leurs conventions matrimoniales par un acte authentique de donation mutuelle qu’ils se firent l’un à l’autre, le 28 mai 1468, à la bonne amour, foy, familiarité et compaignie de mariage qu’ils avoient ensemble82
.
C’est en ce titre de 1468 que pour la première fois Jean du Lis dit avoir sa demeure en la paroisse Saint-Aignan de Sandillon, affirmation qu’il réitère ensuite dans plusieurs contrats ultérieurs83. Il semble, peu après le décès de son père, avoir voulu quitter Villiers pour retourner à ces bords de la Loire où l’appelait la gestion des importants domaines venus en ses mains, où s’était écoulée sa jeunesse au sein des glorieux souvenirs de sa famille, où ses parents avaient vécu et étaient morts.
Dès l’année suivante, nous apprend Charles du Lis84, il chercha à rentrer en possession du petit fief du Mont, dont son père avait donné la jouissance à Marguerite, sa nièce, lors de son mariage avec Antoine de Brunet ; il paraît avoir réussi dans cette revendication, car le 11 janvier 1469, il baillait tout ou partie de ce domaine à Pierre Chauvet, laboureur85, et plus tard il le vendait à Antoine de Brunet lui-même.
Le 15 octobre 1482 il afferma à Étienne, à Jacques et à Berchier Mignon, marchands bouchers au grand Bourg-Neuf d’Orléans, moyennant dix escus d’or, de bail ou pension annuelle, une portion des dépendances de l’Île-aux-Bœufs ; mais il s’en réserva expressément les prés et terres en labour, comme s’il eût eu l’intention de les exploiter lui-même86.
Enfin, le 9 mars 1496 (1497 n. s.), par un acte authentique devant Benoît Martin, notaire au Châtelet d’Orléans87 :
Noble homme Jehan du Lis, alias de la Pucelle, escuier, sieur de Villiers, à présent demourant au lieu de Baignaux, paroisse Saint-Aignan de Sandillon, déclare faire don entre-vifs, dès maintenant et à toujours, à Nicolas Le Berruyer, marchand, demourant en la paroisse Saint-Sulpice d’Orléans, du lieu, terres et appartenances de Villiers-Charbonneau, vassaux, arrière-fiefs, étangs, bois, terres, etc., relevant en fief de la Ferté-Nabert, et ce par récompense de plusieurs bons et agréables services que Nicolas le Berruyer, et Pierre son père, lui ont fait par cy devant88. […] Il se réserva toutefois l’usufruit et entière jouissance de ladite terre et de ses dépendances durant le plein cours de sa vie et de damoiselle Macée, son épouse…
J’aurai plus tard à appeler sur cet acte important l’attention du lecteur.
En conséquence de sa réserve d’usufruit, Jean du Lis, le 29 juin 1499, reçut encore, en personne, au château de Villiers, l’aveu féodal que venait lui faire Aignan de Saint-Mesmin, pour des terres de Marcilly qui relevaient de ce domaine89.
Macée de Vézines paraît avoir peu survécu à la donation de Villiers.
Le 8 mai 1501, Jean du Lis prit part, à Orléans, à la fête de la délivrance. Sa présence y est constatée par la mention suivante, inscrite dans le compte de commune d’Antoine Descontes, l’un des procureurs.
Payé à Regnault Pasté (serviteur de la ville), pour dépense faite le jour de la feste, huictième jour de may mil cinq cents et unq, ausdit hostel de la communité, tant en pain, vin que autre despense faicte audict disner, auquel estoient : mons. le bailly de Dunois, maistre Fleurens Bourgoing, maistre Jehan, noble Jehan du Lis, dit la Pucelle ; maistre Antoine Dufour, prédicateur, et lesdits eschevins de ladite ville, la somme de lvj sols viij deniers tournois90.
Jean du Lis mourut peu de temps après cette solennité. Si la date de sa mort ne nous est pas connue d’une manière précise, elle est nécessairement comprise entre le 8 mai 1501 et le 3 octobre de la même année, jour où sa succession fut déclarée ouverte par sentence du prévôt d’Orléans.
Il ne laissa pas d’héritiers directs ; mais avait-il des frères, des sœurs ou des neveux ?
Cette grave question, qui touche aux points essentiels de la descendance collatérale de Jeanne d’Arc, est demeurée jusqu’ici fort obscure, en présence de traditions et même de titres officiels complètement contradictoires.
Les nouveaux documents produits et étudiés dans les chapitres qui vont suivre pourront, j’ose l’espérer, préparer une solution régulière et motivée.
XI Succession de Jean du Lis, seigneur de Villiers : incidents révélés par les nouveaux documents
§1. Ouverture de la succession ; absence d’enfants, de frères et de sœurs du défunt.
À la mort de Jean du Lis, les biens dont il avait la jouissance firent retour à leurs propriétaires respectifs : la métairie de Bagneaux, au chapitre de l’église d’Orléans ; l’Île-aux-Bœufs, au domaine91 ; la petite maison de la rue des Africains, au couvent de Saint-Euverte92.
Quant au château de Villiers, dont Jean du Lis, sous réserve d’usufruit, avait fait don à son ami, Nicolas le Berruyer, ce dernier, au décès du donateur, en acquit la complète propriété, et depuis lors, son nom figure seul dans les registres de cens et dans les titres.
La succession se trouvait ainsi moins considérable que n’avaient pu le faire supposer les domaines importants dont le fils de messire Pierre avait eu la possession, à titre viager et précaire.
Quelle qu’elle fût, des frères, sœurs ou neveux, s’il en eût existé, se fussent certainement fait un devoir de la recueillir.
Aucun ne se présenta.
En cet état de déshérence, conformément à la législation d’alors, le procureur du roi au bailliage d’Orléans fit saisir et mettre sous la main de justice tout ce qui constituait cette succession vacante.
§2. Revendication de la succession de Jean du Lis par Marguerite du Lis, sa cousine germaine du côté paternel, à titre de plus proche héritière.
À la nouvelle de cette saisie, Marguerite du Lis, femme d’Antoine de Brunet, cousine germaine du défunt du côté paternel, présenta requête au prévôt d’Orléans, à titre de plus proche héritière, pour obtenir main-levée du séquestre et envoi en possession de la succession.
Sa requête fut accueillie, et, le 3 octobre 1501, le prévôt d’Orléans, après information judiciaire, rendit, sous le scel de la prévôté, la sentence suivante :
À tous ceux qui ces présentes lettres verront […] Louis Roillard, garde de la prévosté, etc. Comme puis naguères, après le trépas de feu Jehan du Lis, dit de la Pucelle, escuyer, au vivant de luy seigneur de Baignaux, de Villiers et de l’Isle-aux-Bœufs, près d’Orléans, le procureur du roy notre sire au bailliage et duché d’Orléans, eut fait prendre saisie et mettre sous la main du roy les héritages, terres, revenus, biens desquels ledit défunt, Jehan du Lis, était mort saisi et vestu, supposant ledit procureur, et voulant maintenir iceux héritaiges appartenir au roy notre sire en deffault d’hoirs et héritiers apparents d’icelui deffunt Jehan du Lis. — Et depuis fut venu par devers nous et les advocats et procureurs dudit seigneur, et par requête, Damoiselle Marguerite du Lis, femme de Anthoine de Brunet, escuier, à présent demeurant en la paroisse Saint-Denis-en-Vaulx, et nous eut exposé et donné à entendre qu’elle estoit cousine germaine dudit deffunt Jehan du Lys, et sa plus prochaine parente et lignagère, habile à lui succéder par la coutume gardée au royaume ;
Information à ce faite et communiquée auxdits avocats et procureur du roy ;
Savoir faisons que aujourd’hui comparant devant nous en jugement ladite Damoiselle Marguerite du Lis ;
Vue par nous la requête faite et baillée par icelle, requérant les informations ;
Disons que ladite Damoiselle a bien et suffisamment informé du contenu de sa dite requête, et qu’elle est cousine germaine et prochaine parente et lignagére dudit défunt Jehan du Lis, et par ce habile à jouir de sa succession ;
Et lui donnons main-levée et délivrance des héritages audit défunt. Ainsi arrêté à la requête du procureur du roy ;
Si donnons en mandement, etc…
Donné sous le seel aux contraulls de ladite Prévosté, le troisième octobre 1501.
Collationné à l’original par moi, notaire et secrétaire du roy.
Signé : Le Boullanger.
En marge est écrit de la main de Charles du Lis : J’ai l’original93.
Cet acte judiciaire, dont l’authenticité ne peut être contestée, est, pour la question de la descendance de Pierre du Lis, frère de Jeanne d’Arc, d’une importance capitale.
Il n’a pas seulement l’autorité de la chose jugée, mais la valeur d’un acte officiel de notoriété, émané de personnes compétentes, constatant juridiquement un fait dont elles ont connaissance publique et personnelle.
La position sociale des du Lis les tenait, peut-on dire, à la vue de tous.
Que leur demeure habituelle fut à la ville ou dans la banlieue, toujours est-il qu’en relations affectueuses avec nos plus honorables familles, ils avaient de fréquents rapports : avec le domaine, pour la jouissance de l’Île-aux-Bœufs ; avec les procureurs de la ville, pour la pension mensuelle d’Isabelle Romée ; avec le trésor public, pour la rente de 121 livres ; avec le chapitre de la cathédrale, pour la métairie de Bagneaux ; avec l’abbé et le couvent de Saint-Euverte, pour la petite maison de la rue des Africains.
Marguerite, de son côté, amenée à Orléans par Isabelle Romée, mariée et dotée par messire Pierre, avait passé sa vie entière dans l’intimité de son aïeule et de son oncle : en leur propre maison jusqu’à son mariage, et dans leur plus prochain voisinage depuis son union avec Anthoine de Brunet94.
En un tel état de notoriété, Marguerite du Lis peut-elle être sérieusement soupçonnée de déclaration mensongère, alors que, par requête présentée à la justice locale, elle affirme être cousine germaine de feu Jean, seigneur de Villiers, et à ce titre sa plus proche parente et légitime héritière, et qu’elle demande elle-même que sa réclamation soit régulièrement examinée ?
Et lorsqu’après information judiciaire et communication aux avocats et procureur du roi, le prévôt d’Orléans prononce que ladite damoiselle a bien et suffisamment justifié de sa demande, et qu’il lui donne, en conséquence, à titre de cousine germaine et plus proche parente du défunt, main-levée et délivrance de la succession, n’est-ce pas, jusqu’à preuve contraire, démonstration suffisante que Jean, seigneur de Villiers, était fils unique de messire Pierre, et ne laissait à sa mort ni enfants, ni frères, ni sœurs, ni descendants d’eux, pour recueillir son héritage ?
On verra, dans le chapitre suivant, que les faits et documents ultérieurs, loin d’infirmer la déclaration de Marguerite du Lis et la sentence de 1501, leur donnent au contraire une éclatante confirmation.
§3. Les parents de Domrémy, cousins germains, du coté maternel, revendiquent, contre Marguerite de Brunet, leur part de l’héritage de Jean du Lis.
Aucun parent d’un degré plus proche n’ayant contesté la sentence du prévôt d’Orléans, la nouvelle parvint bientôt à Domrémy de la mort du seigneur de Villiers, du délaissement de sa succession tombée en déshérence, et de l’envoi en possession de Marguerite, femme d’Antoine de Brunet, à titre de cousine germaine et plus proche héritière. Ces faits, naturellement grossis par la distance, y éveillèrent l’attention des cousins germains du côté maternel.
Une sœur de Jeanne Baudot, femme de messire Pierre, Catherine Baudot, avait épousé Joffroy Tallevart, de Domrémy, et en avait eu deux fils : Jean Tallevart, mort sans postérité en janvier 1498, et Poiresson ou Pierresson (Pierre) Tallevart, survivant.
Poiresson Tallevart, cousin germain de Jean du Lis, avait, sur sa succession, des droits égaux à ceux de Marguerite de Brunet ; il voulut les faire valoir.
Mais préalablement à toute revendication, il dut faire constater, par un acte authentique de notoriété, le degré de parenté qui constituait son titre à l’héritage.
En conséquence, le 16 août 1502, par devant deux notaires en la prévosté de Vaucouleurs, à la requête de Poiresson Tallevart, demeurant au village limitrophe de Marcey-sous-Brixey, s’ouvrit, à Domrémy, une enquête en laquelle huit honorables habitants, soit de Domrémy même, soit des paroisses voisines, parents ou amis de la famille de la Pucelle, vinrent, avec une remarquable unanimité, affirmer des faits dont ils déclaraient avoir connaissance précise et personnelle.
Cette information, d’un haut intérêt, par son incontestable authenticité, la gravité des témoignages et les faits nouveaux qu’elle révèle, est parvenue jusqu’à nous. Elle était restée inconnue à Charles du Lis et aux savants historiens venus après lui.
J’eus l’heureuse fortune de la retrouver dans le riche dépôt de nos archives nationales95, et peu après je m’empressai d’en donner connaissance à MM. les délégués des sociétés savantes réunis à la Sorbonne, en leur séance publique du vendredi 6 avril 1877.
Ce titre, d’un si grand intérêt, parut être vivement apprécié96.
Quelle que soit son étendue, on me saura gré, certainement, de le reproduire en son entier.
XII Information faite à Domrémy le 16 août 1502, à la requête des cousins maternels de Jean du Lis
§1. Texte de l’enquête.
L’acte de notoriété du 16 août 1502 est, je le répète, l’un des plus précieux documents parvenus jusqu’à nous, sur la famille de la Pucelle.
Il est en forme complètement régulière, reçu par deux officiers publics, sous l’autorité du prévôt en exercice. Les huit témoins entendus, proches parents ou amis des frères de Jeanne d’Arc, ont eu avec eux des relations affectueuses et fréquentes, quelques-uns une longue et permanente intimité. Notables et d’âge mur, habitant le pays natal, les faits dont ils témoignent avec une naïve simplicité, ils les ont vus de leurs yeux, ou recueillis de la bouche de leurs pères ; ils n’ont nul intérêt à les altérer, et si, sur ces détails présents à leurs communs souvenirs, quelque erreur eût échappée à l’un d’eux, elle eût été, à l’instant, rectifiée par tous les autres.
Acte de notoriété
16 août 1502.
A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront :
Thomas de Sinzelle, escuyer, garde, de par le roy notre sire, du scel de la prévosté de Vaucouleurs, salut :
Savoir faisons que Pierre Mongeot et Cugny Rouyer, notaires jurés au roy nostre dit sire, en la prévosté et ressort dudit Vaucouleurs, nous ont tesmoignés et relactés pour vray que eulx, estant au villaige de Dompremy-sur-Meuse, le mardi seizième jour du mois d’août l’an mil cinq cens et deux, par Poiresson Taillevart, demeurant à Marcey-soubs-Brixey97.
Leur fut requis de oyr aucuns d’icelles personnes qu’il entend d’estre enquis et avoir attestacions d’eulx sur ce que ung nommé Henri Baideot (sic), à son vivant demorant audit Dompremy, fut joint par mariaige à une nommée Katherine.
Duquel mariaige sont descendus deux filles, l’une nommée Jehanne, qui fut mariée à feu messire Pierre du Lys, seigneur de Bagneau, près d’Orléans, et l’autre nommée Katherine, qui fut mariée à feu Joffroy Tallevart, desquels sire Pierre du Lys et dame Jehanne, sa femme, est venu et descendu ung nommé Jehan du Lis.
Et du mariaige dudit Joffroy et Katherine sont venus et descendus ledit Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, lequel Jehan Tallevart est allé de vie à trépas, sont environ quatre ans.
Pour et affin de se apparoir et monstrer en temps et lieux où mestier luy sera, que ledit Poiresson et ledit feu Jehan du Lis estoient venus et descendus desdites deux sœurs, dame Jehanne et Katherine, et à ce moyen, cousins germains.
A cette cause a fait venir par devant les dits notaires, pour dudit cas attester la vérité, ceulx cy après nommés, et premier :
Noble homme Claude du Lys, demourant audit Domrémy-sur-Meuse, aagé d’environ cinquante ans, a dit, affermé, et attesté, sous sa loyaulté et conscience, que en son jeusne aaige, peut avoir environ vingt-quatre ans, il demoura avec ledit feu Pierre du Lis, oncle à sa mère, fille de Jacquemin du Lys, grand-père dudit attestant, au lieu de Luminart, près d’Orléans, environ le temps et espace de cinq ans.
Pendant lequel temps il a oy dire, par plusieurs et diverses fois, audit feu sieur Pierre du Lis et à la dite dame Jehanne, sa femme :
Que Katherine, femme Joffroy Tallevart, étoit seur germaine d’icelle dame Jehanne, sa femme, et que si icelle sa femme alloit de vie à trépas sans hoirs de son corps, la femme dudit Joffroy Tallevart ou ses enfans seroient ses héritiers.
Oultre dit qu’il a bien veu et cougneu feux Joffroy Tallevart et ladite Katherine, sa femme, demeurant à Marcey-soubs-Brixey, lesquels, à leur trépas, ont délaissé Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, leurs enfants et héritiers seuls et pour le tout, lequel Jehan Tallevart alla de vie à trépas, ou mois de janvier l’an mil quatre cent quatre-vingt-dix-huit, dernier passé ;
Et a toujours oy dire à ses ancesseurs et à aultres ses voisins, congnoissans la généalogie, que icelles dames Jehanne et Katherine, femme dudit Joffroy, estoient sœurs germaines.
Honorable homme Jehan Thieriet, marchand bourgeois, demourant audit Marcey-soubs-Brixey, aagé d’environ soixante-dix ans, a dit, attesté et affermé, en sa loyaulté et conscience, qu’il a veu et cougneu feu Henri Baudot, à son vivant demorant à Gondrecourt, qui est à trois lieues dudit Dompremy, assis ou bailliage de Chaumont ;
Lequel, à son trépas, délaissa deux filles ses héritières ;
L’une nommée Jehanne, qui fut mariée à feu messire Pierre du Lys, à son vivant chevallier, qui depuis alla demorer à Orléans, duquel mariage est venu et descendu feu Jehan du Lis ;
Et l’autre fille, nommée Katherine, fut mariée à Joffroy Tallevart, lors demorant audit Marcey ;
Duquel mariage sont venus et descendus Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, cousins germains dudit feu Jehan du Lys et enffans des deux sœurs, lequel Jehan Tallevart, au mois de janvier dernier passé, y a eu trois ans, est allé de vie à trépas.
Dit savoir les choses dessus dittes, parce qu’il est natif dudit Marcey, et il a demeuré tout son temps jusques à présent, et a veu et congneu lesdits sire Pierre et dame Jehanne, sa femme, demorans audit lieu de Dompremy, dont il est prochain, et pareillement lesdits Joffroy Tallevart et Katherine, sa femme, et leurs enfans demeurés audit Marcey.
Claude Gérart, laboureur, demorant à Dompremy-sur-Meuse, natif dudit lieu, aagé d’environ soixante ans, a dit, affirmé, attesté et certifié qu’il a veu :
Une nommée Katherine, fille de feu Henri Baudot, qui depuis fut femme de Joffroy Tallevart, demorant à Marcey-soubs-Brixey ;
Et aussi a veu et congneu feux messire Pierre du Lis et Jehan du Lys, son fils, parens à la Pucelle, parce que les a veu audit Dompremy, traverser, venir et aller en leur maison, pour ce que la mère dudit attestant estait prochaine de lignaige de la femme dudit Joffroy Tallevart et de dame Jehanne, femme dudit messire Pierre du Lys, et mère dudit Jean du Lys, mais il n’est pas recors qu’il ait veu ladicte dame Jehanne ;
Mais en a oy dire à sesdiz père et mère, et ausdiz messire Pierre du Lys et Jehan du Lys, son fils, que ladicte dame Jehanne estoit seur germaine à laditte Katherine, et que icelles dames Jehanne et Katherine, seurs, estaient prochaines parentes de sesdiz père et mère.
Dit aussi qu’il a congneu ung nommé Jehan du Lys, à son vivant frère de ladicte Jehanne la Pucelle, et dudit sire Pierre du Lys, prévôt dudit Vaucouleurs, lequel venoit aucunes fois dudit Vaucouleurs audit Dompremy, et hantait à cause de parentaige en leur maison ;
Et a oy dire audit Jehan du Lys que ladicte Catherine et dame Jehanne estaient seurs ;
Et que ledit sire Pierre et dame Jehanne n’avoient, synon ung fils, nommé petit Jehan du Lys, qui estoit peu de chose ;
Et que s’il alloit de vie à trépas, la femme dudit Joffroy Tallevart seroit héritière de ladicte dame Jehanne, sa seur.
Dit outre que du mariaige desdiz Joffroy Tallevart et Katherine sont venus et descendus deux enffans, c’est assavoir Jehan Tallevart et Poiresson Tallevart, lequel Jehan Tallevart morust environ le mois de janvier l’an mil quatre cent quatre-vingt-dix-huit.
Didier de Monts, laboureur, maire de Greux98, aaigé d’environ soixante-cinq ans, a dit, attesté et certiffié qu’il est natif de Dompremy, où il a toujours demeuré, synon depuis six ou sept ans qu’il est allé demeurer audit Greux ;
Et que luy, estant en son jeune aaige de vingt ans, il a plusieurs fois conversé avec ung nommé Esselin, fils Le Maire Mongetz, dudit Domrémy, qui demandoit à avoir en mariage une fille nommée Katherine, fille de Poiresson Tallevart, fils dudit Joffroy, et que, en devisant entre autres choses, luy dit :
Que Catherine, sa femme, estoit sœur de dame Jehanne, femme de feu messire Pierre du Lys, et que leur lignaige estaient quasi tous gentils gens, à cause de feu Jehanne la Pucelle, par quoy ils en estaient favorisés en beaucoup de lieux.
Oultre dit que ledit Joffroy Tallevart et Catherine, sa femme, avoient deux enfans, c’est assavoir Jehan Tallevart et ledit Poiresson Tallevart, et qu’il y peut avoir environ trois ou quatre ans que ledit Jehan Tallevart alla de vie à trépas.
Apparu Jacquart, laboureur, demeurant à Greux, près de Dompremy, aaigé d’environ soixante ans, a dit, attesté et certiffié sur sa conscience :
Qu’il a veu et congneu Catherine et dame Jehanne, seurs germaines, et a oy dire à son père et à sa mère qu’elles estaient filles de Henri Baudot, lequel Henri a aucunes fois demoré audit Dompremy et ou lieu de Gondrecourt ;
Et dit qu’icelles filles furent mariées, c’est assavoir ladicte Catherine à ung nommé Joffroy Tallevart, à son vivant demeurant à Marcey-soubs-Brixey, et de leur mariaige sont issus et descendus Jehan Tallevart et Poiresson Tallevart, lequel Jehan Tallevart alla de vie à trépas audit Marcey, a eu au mois de janvier environ trois ou quatre ans ;
Et l’autre fille, nommée Jehanne, fut mariée à feu messire Pierre du Lys, à son vivant chevallier, demeurant à Orléans, ou là environ. Du mariaige est issu feu Jehan du Lys, leur fils, et cousin auxdiz Poiresson Tallevart et Jehan Tallevart, et ledit sçavoit par ce qu’il a congneu les parties et, veu passer et repasser lesdiz feux messire Pierre du Lys, ladicte dame Jehanne, sa femme, et ledit feu Jehan du Lys, leur fils ;
Et disoient les gens pardevant qui ils passoient que ledit feu messire Pierre du Lys estoit frère à la Pucelle.
Vaulterin Cousturier, demorant audit Marcey-soubs-Brixey, aaigé d’environ cinquante-cinq ans, a dit, affermé et attesté en sa loyaulté et conscience :
Qu’il a bien veu et conneu feux Joffroy Tallevart et Katherine, sa femme, père et mère de Poiresson et Jehan Tallevart dudit Marcey ;
Dit que l’année après la journée de Nancey, où le duc Charles de Bourgogne fut mort99, il vit feu Jehan du Lys, seigneur de Bagneaux, près d’Orléans, venir en la maison feu Joffroy Tallevart, père dudit Poiresson Tallevart, audit lieu de Marcey, pour avoir ung cheval, et pour ce qu’il ne trouva pas son cas, il s’en vint à la maison de feu Jehan Thiesselin, audit Dompremy, où il en trouva ung ;
Auquel Jehan du Lys, luy estant en la maison dudit Joffroy Tallevart, il oyt dire et recongnoistre que dame Jehanne, sa mère, et Katherine, femme dudit Joffroy Tallevart, estoient seurs germaines, et luy fit, ledit Joffroy, grant recueil pour ce qu’il estoit nepveu de sa femme.
Jacob Brenet, laboureur, demorant audit Dompremy, aaigé d’environ soixante-dix ans, a dit, affermé et attesté qu’il a veu et cogneu feu Henri Baudot et Katherine, sa femme, qui demorèrent longtemps audit lieu de Dompremy ;
Et pour les guerres s’en alèrent demorer à Gondrecourt ;
Du mariaige desquels sont descendus Katherine et Jehanne, leurs filles, l’une desquelles, c’est assavoir ladite Jehanne, fut mariée à feu messire Pierre du Lys, à son vivant chevallier, demorant à Orléans, lesquels eurent, en leur mariaige, ung fils nommé Jehan du Lys ;
Et iceulx messire Pierre, dame Jehanne, sa femme, et ledit Jehan du Lys a veu hanter, en son jeune aige, audit Dompremy ;
Et l’autre, nommée Katherine, fut mariée à Marcey-soubs-Brixey, à Joffroy Tallevart, lesquels eurent en leur mariaige deux fils qui leur ont survécus, l’un nommé Poiresson Tallevart, et l’autre Jehan Tallevart, lequel Jehan alla de vie à trépas au mois de janvier l’an mil quatre cent quatre-vingt-dix-huit dernier passé ;
Le seoit, parce qu’il a toujours hanté, demeuré et conversé audit heu de Dompremy et de Marcey.
Mongeot Rendelz, laboureur, demorant à Greux, aaigé d’environ soixante ans, a dit, attesté, certifié et affermé qu’il a veu feu Joffroy Tallevart et Katherine, sa femme, demorant à Marcey-soubs-Brixey ;
Dont sont venus Poiresson Tallevart et feu Jehan Tallevart, frères ;
Et dit qu’il a veu Colin Le Maire, fils de Jehan Colin, à son vivant maïeur dudit Greux, frère de sa mère, lequel avoit en espousée la seur de la Pucelle, comme il a oy dire à son dit oncle.
Dit oultre qu’il a oy dire à icelluy son oncle, souventes fois, que dame Jehanne, femme de feu messire Pierre du Lys, et Catherine, femme de Joffroy Tallevart, estaient seurs germaines.
Et toutes ces choses ont lesdiz attestans, chacun pour soy, certiffiées et affirmées, en leur loyaulté et conscience, estre vrayes ; de toutes lesquelles choses dessus dictes et d’une chacune d’icelles, ledit Poiresson Tallevart a quis et demandé auxdiz notaires royaulx avoir lectres d’attestations, ou instruments, ung ou plusieurs, pour luy valloir et servir ce que raison devra, ce que lesdiz notaires luy ont octroie en ceste forme, en tant que faire le povoient et devoient.
En tesmoing de vérité, nous, garde du seel dessus nommé, à la relation desdiz jurés et de leur seel et seings manuels, mis à ces présentes lectres d’attestations ou instrument, avons seellé icelles du seel de ladicte prévosté et de notre seel en contre-seel, saulfs tous droits.
Ce fut fait l’an, jour et lieux que dessus. Signé : Mongeot et Rouyer (avec paraphes).
Extrait et collationné par les notaires au Chastellet d’Orléans, soussignés, sur l’original en parchemin, estant ès-titres de la terre de l’isle Groslot, cejourd’hui vingt-un janvier mil sept cent cinquante-deux.
Signé (en autographes) : Prévost et Lion (avec paraphes).
Controllé à Orléans, gratis, le premier janvier 1752. Signé : Robin.
En marge est écrit de la main de M. Le Clerc de Douy :
Soit controllé gratis pour le domaine. Signé : Le Clerc de Douy100.
§2. Faits historiques révélés par l’enquête du 16 août 1502.
L’enquête avait pour but d’établir que Poiresson Tallevart était, dans la ligne maternelle, cousin germain de Jean du Lys. Ce fait y est mis en pleine lumière.
Les huit déposants s’accordent à déclarer :
- Que Henri Baudot, habitant de Domrémy, et qui, durant les guerres, se réfugiait quelquefois à Gondrecourt101, eut de Catherine, son épouse, deux filles : Jeanne, mariée à messire Pierre du Lis, chevalier, seigneur de Bagneaux, près Orléans, et Catherine, mariée à Joffroy Tallevart, de Marcey-sous-Brixey102, près Domrémy ;
- Que Joffroy Tallevart eût, de Catherine Baudot, deux fils : Poiresson Tallevart, vivant et requérant, et Jean, son frère, décédé en janvier 1498.
D’où la conséquence que Jean du Lis, fils de Jeanne Baudot, et Poiresson Tallevart, fils de Catherine, enfants des deux sœurs, étaient cousins germains l’un de l’autre.
Ces unanimes déclarations révèlent incidemment le nom, jusqu’à présent ignoré, de la femme de Pierre du Lis. On l’a vue désignée, dans les deux baux du chapitre, sous la dénomination de son pays d’origine : Jehanne, du pays de Bar ; dans les écrits de Charles du Lis et de La Roque, sous la forme plus moderne de : damoiselle Jehanne de Prouville103.
Elle se nommait réellement Jehanne Baudot, fille de Henri Baudot et de Catherine, son épouse.
D’autres faits, dignes d’intérêt, ressortent de l’acte de notoriété de 1502.
Il était de tradition, généralement acceptée jusqu’à ce jour, que Jacquemin, frère aîné de la Pucelle, anobli avec ses deux frères en décembre 1429, était mort à Domrémy, sans alliance et sans postérité, du chagrin causé par l’inique supplice de sa sœur.
Or, le premier déposant, noble homme Claude du Lis, âgé d’environ cinquante ans, et demeurant à Domrémy, affirme sur sa loyaulté et conscience, et sans être en rien désavoué par aucun de ceux qui l’entendent :
… que sa mère estoit fille de Jacquemin du Lis, grand-père de lui, attestant ; que feu Pierre du Lis [frère dudit Jacquemin] estoit oncle de sa mère, et que lui-même, Claude, en son jeune aaige, peut avoir environ vingt-quatre ans, avoit demouré, le temps d’environ cinq ans, avec ledit sieur Pierre du Lis et dame Jehanne, sa femme, au lieu de Luminard, près d’Orléans 104.
Des affirmations si précises, complètement désintéressées, puisqu’elles ne donnaient à Claude du Lis aucun droit sur la succession qu’il s’agissait de recueillir ; confirmées d’ailleurs par le tacite assentiment des sept autres témoins, peuvent difficilement être révoquées en doute.
Il semble donc permis d’en conclure que, contrairement aux traditions acceptées, Jacquemin, frère aîné de la Pucelle, avait contracté mariage, et que de ce mariage était née, tout au moins, une fille, laquelle ayant un fils, âgé en 1502 d’environ cinquante ans, et nommé noble homme Claude du Lis, avait dû, vers 1450, épouser un de ses parents honoré de ce glorieux nom.
C’était encore une tradition, accréditée sans conteste, qu’une jeune sœur de la Pucelle, habituellement désignée sous le nom de Catherine, était, elle aussi, décédée sans alliance.
Or, le huitième déposant, Mongeot-Rendelz, laboureur à Greux :
… aaigé d’environ soixante ans, certifie et affirme que Colin Le Maire, fils de Jehan Colin, en son vivant maïeur (maire) dudit Greux, et frère de la mère dudit déposant, avoit en espousée la seur de la Pucelle, et que son dit oncle le lui a dit à lui-même.
Ainsi, c’est de la bouche même de son oncle, Colin Le Maire, que Mongeot-Rendelz a recueilli cette déclaration si nette et si formelle. Il est difficile d’admettre que Colin Le Maire ait altéré la vérité quand il disait à son neveu que sa tante était sœur de la Pucelle. Mongeot-Rendelz a-t-il pu se tromper à son tour sur l’affirmation faite par son oncle d’une alliance si honorable pour leur famille ? Et si, contrairement à toute vraisemblance, ce récit d’un fait si notoire eût été inexact, les sept autres témoins n’eussent-ils pas immédiatement réclamé ?
Cette fois encore, il semble donc permis de dire que la tradition acceptée sur la sœur de Jeanne d’Arc est rectifiée par l’enquête, et que Catherine avait réellement contracté mariage avec un habitant du pays, Colin, fils de Jean Colin, maire de Greux, oncle de Mongeot-Rendelz.
Peut-être ne serait-il pas impossible de retrouver trace, en un autre document officiel, de ce beau-frère de Jeanne d’Arc, époux de sa sœur Catherine.
Aux solennelles informations, pour le procès de réhabilitation, faites à Domrémy le 30 janvier 1456, le vingt-et-unième témoin entendu déclara se nommer Colin, fils de Jean Colin, laboureur à Greux, âgé d’environ cinquante ans. Sa naissance remontait donc approximativement à 1405105.
Or, dans l’enquête de 1502, Mongeot-Rendelz se dit âgé d’environ soixante ans, dès lors né vers 1442. Admettant que son oncle, Colin (Le Maire), fils de Jean Colin, maire de Greux, et mari de la sœur de la Pucelle, eût trente à trente-cinq ans de plus que son neveu, la naissance de cet oncle remonterait également à environ 1405.
Cette remarquable similitude de nom, d’âge, de profession et de résidence, entre les deux Colin, fils de Jean Colin, mentionnés l’un à l’enquête de 1456, l’autre à celle de 1502, peut donc permettre, sans invraisemblance, de ne voir en eux qu’une seule et même personne, et de conjecturer que le vingt-et-unième témoin de l’information, pour le procès de réhabilitation, a pu être l’époux de la sœur de la Pucelle106.
Une curieuse déposition, remarquée par MM. de Bouteiller et de Braux, dans une autre enquête du 8 octobre 1555, vient compléter, d’une manière inattendue, les révélations de l’acte de notoriété de 1502, sur cette sœur de Jeanne d’Arc, à l’égard de laquelle l’histoire avait gardé un silence absolu jusqu’à ce jour.
Ce naïf récit sera lu, je l’espère, avec quelque intérêt.
Hallouy Robert, femme de Parisot-Lengres, demourant à Badouville, aagée d’environ soixante-seize ans, dit et dépose qu’elle a eu bonne cognoissance de feu Demange le Vauseul et de Jehanne le Vauseul, à cause qu’ils estaient frère et seur de Catherine le Vauseul, mère de ladicte déposante ; tous lesquels estoient enfans de feu Jehan le Vauseul et d’une nommée Aveline, sœur de Isabeau, mère de Jehanne la Pucelle107, et ainsi l’a oy dire et réciter à ladicte Catherine, sa mère, laquelle lui disoit que ladicte Aveline, sa mère, et mère-grand de ladicte déposante, lui auroit dict et récité que lorsque ladicte Pucelle se départit de son pays de Vaucouleurs pour aller sacrer le roy, ladicte Pucelle auroit requis ladicte Aveline que, puisque elle estoit enceinte d’enfant, la prioit que si elle escouchoit d’une fille, elle luy fit mectre en nom Catherine, pour la soubvenance de feu Catherine, sa sœur, niepce de ladicte Aveline. Tellement que la mère d’elle déposante fut appelée et nommée Catherine.
Et disoit la mère d’elle déposante que ladicte Pucelle appeloit communément ladicte Aveline, sa tante, et lui portoit bonne affection, pour ce qu’elle avoit esté souvent nourrie à la maison de ladicte Aveline et de Jehan le Vauseul, son mari, etc.108.
Cette déposition, qui porte en elle tous les caractères de la sincérité, nous fait ainsi connaître que la sœur de Jeanne se nommait réellement Catherine ; qu’elle était l’aînée de la Pucelle, et qu’une tendre amitié les unissait l’une à l’autre. Elles allaient souvent ensemble, avaient dit les témoins de la réhabilitation, prier à la chapelle de Bermont109. Mariée, jeune, à Jean Colin, Catherine n’existait déjà plus quand, en 1429, Jeanne quitta Domrémy pour accomplir sa glorieuse mission.
Peut-être, pour le dire en passant, le religieux souvenir de sa sœur se mêlait-il, dans le cœur de la Pucelle, à sa pieuse confiance en sainte Catherine, l’une de ses deux vénérées protectrices.
En résumé, les faits, depuis si longtemps oubliés, que l’enquête de 1502 révèle aujourd’hui à l’histoire, peuvent s’énumérer ainsi qu’il suit :
- Jacquemin, frère aîné de la Pucelle, a contracté mariage ;
- Une fille de Jacquemin a contracté mariage à son tour, soit avec son oncle Jean, prévôt de Vaucouleurs, soit plutôt avec son cousin germain, fils dudit prévôt ;
- Un fils est né de cette union : noble homme Claude du Lis, premier témoin de l’enquête de 1502 ;
- Catherine, sœur aînée de la Pucelle, morte avant 1429, avait épousé un notable habitant de Greux : Colin Le Maire, fils de Jean Colin, le même, selon toute apparence, que le vingt-et-unième témoin des informations de 1452 ;
- L’épouse de messire Pierre du Lis, jusqu’ici désignée sous la dénomination de Jeanne, du pays de Bar, ou de Jeanne de Prouville, se nommait réellement Jeanne Baudot, fille de Henri Baudot et de Catherine, sa femme ;
- L’enquête nous fait connaître, en outre, que, dans les dernières années de leur vie, messire Pierre et Jeanne Baudot habitaient Luminard, petit domaine situé à deux lieues à l’est d’Orléans, près de Bagneaux et de l’Île-aux-Bœufs.
- Elle nous apprend encore qu’après avoir quitté Domrémy pour se fixer dans l’Orléanais, ils retournaient de temps à autre, avec Jean, leur fils, au pays natal ; qu’ils y étaient amicalement reçus par leurs proches ; que leurs parents venaient, à Orléans, les visiter à leur tour ; en un mot, que des relations affectueuses, entretenues par de fréquentes communications, s’étaient conservées entre les deux branches de la famille, tout éloignées qu’elles fussent l’une de l’autre110.
- Il n’aura échappé enfin à aucun lecteur que les témoignages consignés en cet acte de notoriété, les déclarations formelles de plusieurs déposants, et le silence non moins significatif des autres, tendent unanimement à constater que Jean du Lis, seigneur de Villiers, marié à damoiselle Macée de Vézines, fut l’unique enfant de messire Pierre et de Jeanne Baudot, et qu’à sa mort, en 1501, il ne laissa ni descendants, ni frères, ni sœurs pour recueillir son héritage.
§3. Transaction entre les cousins germains des lignes paternelle et maternelle sur la succession de Jean du Lis, seigneur de Villiers. — Extinction de la branche orléanaise des du Lis.
L’enquête du 16 août 1502 ne fut pas une vaine manifestation. Des actes réguliers la suivirent pour continuer, en faveur de Poiresson Tallevart, la revendication de sa part héréditaire dans la succession de Jean du Lis.
Dès le lendemain (17 août 1502), en vertu de cet acte de notoriété homologué par Thomas de Sinzelles, garde du scel de la prévôté de Vaucouleurs, Poiresson Tallevart donna, par devant les mêmes notaires, à Colas Tallevart, son fils, laboureur à Marcey-sous-Brixey ; à Pierre Tallevart, son neveu ; à Jean Mocelot, à Garin Thomassin, enfin à noble homme Claude du Lis, demeurant à Domrémy-sur-Meuse, procuration générale d’aller :
… partout où besoin seroit, faire valoir les droits successifs à lui échus par le trépas de feu Jehan du Lis, son cousin germain, requérir et pourchasser ses possessions et seigneuries quelque part qu’elles furent situées111.
Munis de ces pleins pouvoirs, Colas et Pierre Tallevart se transportèrent immédiatement à Orléans, mais y trouvèrent une succession beaucoup moins opulente, qu’ils ne l’avaient supposé. Ainsi déçus de leurs brillantes espérances, le 5 septembre, 1502, par acte passé au lieu et seigneurie du Mont, paroisse de Saint-Denis-en-Val, devant Estienne Rousseau, notaire au Chastellet d’Orléans
, en présence de témoins, ils cédèrent, dès maintenant et à toujours, à leur cohéritier Antoine de Brunet, écuyer, seigneur du Mont, à cause de feue Marguerite du Lis, sa femme, la totalité des droits successifs de Poiresson Tallevart, leur père et oncle, sur les biens et héritages, de son cousin, Jean du Lis, pour la modique somme de douze écus d’or à la couronne, valant vingt-huit sols parisis pièce, payés et baillés auxdits vendeurs112.
La transaction du 5 septembre 1502, qui complète l’acte de notoriété du 16 août, et la mort de Marguerite du Lis, nièce de Jeanne d’Arc, incidemment constatée dans cet acte d’abandon, furent les dernières phases du séjour, en notre Orléanais, de la mère, des frères et des neveux de la Pucelle. À partir de ce jour, et pour de longues années, le silence se fit parmi nous sur ce nom cher et historique des du Lis qui, pendant trois quarts de siècle, avait reçu de nos pères tant de témoignages d’attachement et de respect.
§4. Noble homme Claude du Lis.
L’acte de notoriété du 16 août 1502, dans ses précieuses révélations sur les proches parents de Jeanne d’Arc, a mis en lumière un personnage, jusqu’à présent peu connu, qui semble avoir eu, à la fin du XVe siècle, un rang considérable dans la famille.
Noble homme Claude du Lis nous apprend lui-même qu’il était né vers 1452113 ; que sa mère (nommée Jeanne en l’enquête de 1551)114 était fille de Jacquemin, frère, aîné de la Pucelle, et que messire Pierre, chez qui il avait passé cinq années de sa jeunesse115, était son oncle.
Claude était dès lors fils ou petit-fils du troisième frère, Jean, prévôt de Vaucouleurs ; car, à une époque si rapprochée de l’anoblissement accordé par Charles VII, nul autre qu’un neveu de l’héroïne n’eût osé porter, à Domrémy, ce nom glorieusement significatif de noble homme Claude du Lis.
Dans la procuration authentique du 17 août 1502, il est dit demourer à Domrémy116. Charles du Lis ajoute, qu’il y remplissait les fonctions de procureur fiscal, et qu’il avait pour frère Étienne ou Thévenin, qui contracta mariage, et pour sœur Marguerite, femme d’Antoine de Brunet117.
Il serait difficile de préciser aujourd’hui si Claude était fils ou petit-fils de Jean, frère de la Pucelle ; son âge, de cinquante ans environ, en 1502, peut s’accorder avec l’une ou l’autre hypothèse ; notre ignorance absolue de la date du mariage du prévôt de Vaucouleurs laisse également sur la question quelque incertitude.
Jean, né vraisemblablement de 1400 à 1412, puisqu’il était, paraît-il, l’aîné de la Pucelle, et décédé de 1470 à 1476118, a pu, dans un âge avancé, épouser la fille de son frère Jacquemin, bien que ces sortes d’alliances fussent peu d’usage au XVe siècle, surtout dans les familles de condition moyenne.
Il a pu, tout au contraire, se marier jeune encore, à Domrémy, soit avant le départ de Jeanne, soit après le martyre de Rouen, et vingt-deux ou vingt-trois ans après, vers 1452, avoir eu un petit-fils, Claude du Lis.
Plusieurs témoins de l’enquête de 1551, dont les dépositions ont un caractère incontestable de gravité119, et, d’après eux, Charles du Lis, en son Traité sommaire, disent qu’il était fils de Jean ; mais une objection considérable s’élève contre ce système.
Si Claude du Lis était fils de Jean, prévôt de Vaucouleurs, il était dès lors frère de Marguerite du Lis, épouse d’Antoine de Brunet, et conséquemment héritier, comme elle, de leur cousin germain paternel, Jean, seigneur de Villiers. Comment s’expliquer alors qu’il soit intervenu, dans l’information du 16 août 1502 et dans la procuration du 17 août suivant, pour soutenir les prétentions des parents de la ligne maternelle, au lieu de se joindre à sa sœur Marguerite pour revendiquer, conjointement avec elle, leurs droits paternels, opposés à ceux des Tallevart ?
La difficulté disparaît, si Claude du Lis, au lieu d’être fils du prévôt, n’est que son petit-fils. Plus éloigné, d’un degré de parenté, que les deux concurrents à l’héritage, il était naturellement exclu par l’un comme par l’autre, et n’avait plus droit à la succession.
Si grave que soit cette observation, le mieux, semble-t-il, est de laisser à l’avenir la solution de ce problème historique.
Claude du Lis a, dans l’information de 1502, une place de déférence et d’honneur.
Il est le premier témoin entendu ; seul il y prend le titre de noble homme. Dans la procuration du 17 août 1502, il est l’un des mandataires chargés d’aller maintenir les droits de la famille maternelle de Jean du Lis, seigneur de Villiers, contre les prétentions exclusives de Marguerite de Brunet. Ce mandat, à lui conféré, était d’ailleurs purement honorifique, car son nom ne figure pas dans les actes signés en la seigneurie du Mont par les fondés de pouvoir120.
L’information faite en avril 1551, à Vaucouleurs, et le Traité sommaire, sont peu d’accord en ce qu’ils racontent de Claude du Lis.
On reconnaît, de part et d’autre, qu’il eut pour épouse Nicolle Thiesselin, fille de Jean Thiesselin ; mais Charles du Lis ajoute qu’il mourut vers 1502 sans enfants, et il attribue à son frère Étienne la descendance de cette branche de la famille121.
Tout au contraire, en l’acte de notoriété du 13 avril 1551, deux témoins, Didon du Lis, veuve de Thévenin Thibert, âgée de cinquante ans, et Anne du Lis, veuve de Hautrevault, âgée de soixante ans, déclarent être filles de Claude du Lis et de Nicolle Thiesselin, sa femme. Deux autres, François de Boissy, praticien, et François Hurlet, prêtre à Domrémy, du même âge à peu près que Didon et Anne du Lis, affirment, à leur tour, être petits-fils de Claude et de Nicolle122.
Un autre témoin, Didier Vaultrin, dit que Claude eut, de son mariage avec Nicolle, six filles ; et François de Boissy, petit-fils de Claude, lui en attribue huit (peut-être huit enfants, dont six filles ?).
Bien que la plupart des dépositions consignées en l’enquête d’avril 1551 contiennent de nombreuses et évidentes inexactitudes, on ne peut méconnaître que de telles affirmations, sur des faits personnels aux déposants, ne soient d’une haute gravité.
Mêmes dissentiments sur l’époque de la mort. Tandis que le Traité sommaire prétend que Claude mourut vers 1502, François de Boissy dépose à l’enquête qu’il vivait encore en 1507, et Didier Vaultrin qu’il décéda vers 1525.
La loi que je me suis imposée de ne rien affirmer, en cette étude, qui ne s’appuie sur des textes ou des faits incontestés, m’interdit de m’aventurer, à travers ces divergences, sur le mobile terrain des conjectures. Il semble toutefois permis de croire que noble homme Claude du Lis, petit-fils de deux frères de la Pucelle : par son père, de Jean, prévôt de Vaucouleurs ; par sa mère, de Jacquemin, l’aîné des trois frères ; petit-neveu et, pour ainsi dire, fils adoptif de messire Pierre ; de plus, père de plusieurs enfants, dont le nombre et le sexe ne sont pas encore parfaitement connus, ait été à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe, l’un des chefs de nom et d’armes de la famille de la Pucelle.
Il ne serait donc pas invraisemblable que ce neveu de Jeanne d’Arc fût l’une des principales tiges dont les rameaux ont continué jusqu’à nous la noble lignée de la libératrice de la France.
Il ne serait pas non plus impossible qu’un fils, jusqu’à présent inconnu, de Jacquemin, l’aîné de la famille, ou d’Étienne, fils de Jean, prévôt de Vaucouleurs, partageât avec lui cet honneur.
N’ayant rien à préciser à cet égard, je me borne à signaler ces solutions comme parfaitement admissibles, en l’état actuel de la question généalogique.
XIII Affirmations, non justifiées, sur la descendance de Messire Pierre du Lis, émises au XVIe et XVIIe siècles
§1. Origine de ces inexactitudes.
Les documents contemporains publiés au cours de cette étude semblent avoir suffisamment établi, par leurs textes précis et leur parfaite concordance, que Jean du Lis, seigneur de Villiers, fut l’unique fils de messire Pierre et de Jeanne Baudot, son épouse, et que, lorsqu’il mourut sans enfants, en 1501, ce rameau de la lignée de la Pucelle s’éteignit à toujours.
Je ne dois pas toutefois laisser ignorer que des affirmations contraires émises vers le milieu du XVIe siècle, puis accréditées au cours du XVIIe, se sont perpétuées jusqu’à nous.
D’après ces affirmations, reproduites par bien des auteurs, Pierre du Lis, réellement père de Jean, seigneur de Villiers, aurait eu trois autres enfants :
- Un fils puîné, nommé Jean, comme l’aîné et, depuis, échevin d’Arras ;
- Une fille, Catherine, mariée à François de Villebresme, receveur du domaine à Orléans, mère de Marie de Villebresme, laquelle aurait épousé Jacques Le Fournier, receveur des tailles à Caen ;
- Une seconde fille, Hauvy, Halouys ou Helvide, mariée, en Lorraine, à Étienne Hordal.
Voici de quelle manière ces légendes généalogiques, que les documents nouvellement découverts ne permettent plus aujourd’hui d’admettre, paraissent avoir pris naissance au XVIe siècle et s’être propagées depuis lors.
Les lettres d’anoblissement concédées par Charles VII, en 1429, accordaient aux femmes de la famille de Jeanne d’Arc le privilège, jusque-là sans exemple, de transmettre à leurs maris, de quelque condition qu’ils fussent, et aux enfants nés de leur légitime union, le titre nobiliaire et les exemptions pécuniaires qui en étaient la conséquence123.
Ces immunités, multipliées par de nombreuses alliances, ne tardèrent pas à porter au trésor public un dommage que les préposés aux finances voulurent atténuer. Dès le milieu du XVIe siècle, l’édit d’Amboise, du 25 mars 1556, et l’arrêt conforme de la Cour des aides de Normandie, en date du 25 avril suivant, exigèrent, pour première restriction, que les maris et descendants eussent vécu noblement et justifiassent de leur extraction par des lettres-patentes ou des décisions judiciaires spécialement obtenues à leur égard124.
Il n’était pas toujours facile de produire exactement ces justifications.
Personne n’ignore que les actes de naissance ne furent régulièrement inscrits sur des registres qu’à partir de la célèbre ordonnance de Villers-Cotterêts, d’août 1539, et trente ans s’écoulèrent encore avant que l’édit de Blois prescrivît aux curés des diverses localités de constater également, par écrit, les mariages et les décès survenus en leurs paroisses. Jusque-là, hormis pour les personnes de haut rang, dont les noms étaient conservés dans des obituaires ou des actes privés et publics, le souvenir des naissances, des mariages et des décès, dans la plupart des familles, ne reposait que sur des traditions orales transmises de générations en générations.
Ce mode de constatation, après de longs intervalles, était inévitablement sujet à d’involontaires inexactitudes.
Le nombre restreint des noms de baptême usités au XVe siècle devenait une nouvelle cause de confusion et d’erreurs.
Or, les père et mère, les oncles et les frères de la Pucelle avaient vécu et étaient morts dans le cours du XVe siècle. Lorsqu’après de longues années écoulées, on voulut préciser leurs alliances et leurs filiations déjà si lointaines, on ne put donc s’appuyer que sur des enquêtes locales, toujours exposées, quand il s’agit de faits anciens, aux imperfections inhérentes à cette sorte d’informations.
§2. Les Le Fournier (de Normandie).
La famille normande des Le Fournier paraît être entrée l’une des premières dans cette voie de justifications légales125. Au mois d’octobre 1550, Robert Le Fournier, baron de Tournebut, obtint d’Henri II des lettres-patentes déclarant qu’il était, ainsi que Luc du Chemyn, son neveu, de la lignée de la Pucelle.
Peu après, la Chambre des comptes de Paris donna commission aux prévôts de Chaumont en Bassigny, d’Orléans, de Blois et de Caen, d’informer de ceux qui prétendaient appartenir à l’illustre race de Jeanne d’Arc, et avaient vécu noblement depuis lors. Des enquêtes furent ouvertes, en conséquence, dans ces diverses prévôtés. Quelques-uns de ces actes de notoriété, entre autres ceux de Chaumont ou de Vaucouleurs et de Caen, faits, les uns et les autres, à la requête de Luc du Chemyn, de Robert Le Fournier et de leurs proches, ; sont parvenus jusqu’à nous 126.
Les lettres-patentes d’Henri II, en faveur de Robert Le Fournier, avaient été publiées très-incomplètement par Denys Godefroy, en son Histoire de Charles VII, et par de La Roque, en son Traité de la noblesse. M. J. Quicherat, après les avoir corrigées et complétées sur le registre 260 du Trésor des chartes, les a fait connaître en leur entier127.
Ce texte complet a révélé, contrairement aux traditions acceptées, qu’avec une sage réserve, ces lettres-patentes s’étaient abstenues de tout détail de filiation, se bornant à déclarer, en termes généraux, que Robert Le Fournier et Luc du Chemyn, son neveu, étoient issuz et descenduz de la lignée de la Pucelle128.
Moins discrets en leurs déclarations, les témoins de l’information faite en avril 1551, à Vaucouleurs, à la requête de Luc du Chemyn et de ses proches, sans être plus affirmatifs en ce qui touchait l’existence d’une fille de Pierre du Lis, nommée Catherine, se sont laissé entraîner, sur la foi de souvenirs fort altérés, à un regrettable mélange de vérités et d’erreurs. Ainsi, sur douze déposants entendus, huit affirment formellement qu’un frère de la Pucelle, appelé Pierre par les uns, Jacques ou Jean par les autres, alla, peu de temps après que Jeanne d’Arc eut quitté Domrémy, se fixer à Orléans, qu’il y acquit de grandes richesses et y exerça les fonctions de prévôt, etc., assertions dont les deux dernières, au moins, sont de la plus complète inexactitude.
D’autres ont ouï dire que ce frère de la Pucelle, prévôt d’Orléans, s’y était allié à une famille considérable du nom de Villebresme.
D’autres enfin que Jean du Lis, prévôt d’Orléans129, s’étant marié avec une Orléanaise de bonne maison et bonne apparence
, en avait eu deux filles, dont l’une avait pris un époux dans la maison opulente et noble de Villebresme, et que le requérant, Luc du Chemin, était probablement son descendant130
.
L’enquête ouverte à Caen, quelques mois auparavant (janvier 1551), par devant le lieutenant-général au bailliage, aux termes du même mandement de la Chambre des Comptes et à la même requête de Luc du Chemyn et de la famille Le Fournier, soulève une objection presque péremptoire, soit contre l’existence de Catherine du Lis, soit au moins contre l’affirmation, accréditée, qu’elle était fille de messire Pierre et mère de Marie de Villebresme, femme de Jacques Le Fournier.
C’est aux lieux mêmes où, depuis de longues années, les Le Fournier avaient leur résidence, c’est sous les yeux des membres de la famille qu’est faite cette information. Vingt notables habitants du pays, appelés comme témoins, y sont entendus, et tous déclarent avoir connu et fréquenté Jacques Le Fournier, receveur des tailles à Caen, père et aïeul des requérants, et Marie de Villebresme, son épouse. Tous ajoutent que Marie de Villebresme était généralement réputée descendre de la lignée de la Pucelle.
Or, de ces vingt témoins presque oculaires, amis, pour la plupart, des Le Fournier et très au courant de ce qui les concerne, pas un seul ne dépose que Marie de Villebresme fût fille de Catherine du Lis et petite-fille de messire Pierre. Tout au contraire, les uns déclarent qu’elle était fille de Jeanne Brachet, épouse de François de Villebresme, et les autres, d’accord sur ce point avec l’enquête de Vaucouleurs, qu’elle descendait de Jean, prévôt et frère de la Pucelle, de telle manière qu’en ce long procès-verbal d’enquête, fait aux lieux où la naissance de Marie de Villebresme devait être mieux connue qu’ailleurs, et où les déposants ne sont pas, assurément, sobres de détails, les noms de messire Pierre du Lis et de Catherine, sa prétendue fille, ne sont pas une seule fois prononcés.
Ce silence absolu sur un fait considérable, qui n’eût pu être ignoré des vingt témoins entendus, est gravement significatif131.
Les vagues propos de quelques témoins de l’enquête de Vaucouleurs paraissent donc être l’unique origine de la légende d’une fille de messire Pierre du Lis, nommée Catherine, laquelle aurait épousé François de Villebresme, receveur du domaine à Orléans132. Acceptée sans preuves, accréditée sans contrôle, inconciliable avec les documents contemporains aujourd’hui connus, elle n’en a pas moins acquis une sorte de possession d’état, du XVIe siècle jusqu’à nous.
L’attribution à messire Pierre du Lis d’une seconde fille nommée tantôt Hauvy, tantôt Halouys ou Helvide, mariée à un gentilhomme lorrain, Étienne Hordal, ne repose pas sur des bases plus solides.
§3. La famille lorraine des Hordal.
Dans les dernières années du XVIe siècle, Jean Hordal, docteur en droit, l’un des quatre professeurs en l’Université de Pont-à-Mousson, voulant asseoir sur un titre officiel la tradition, depuis longtemps conservée dans sa famille, qu’il était de la lignée de la Pucelle, obtint qu’à sa requête une information fût ouverte à Toul, le 7 juin 1596, en vertu d’une commission du comte de Salm, gouverneur de Nancy.
Les témoins entendus en cette enquête s’accordèrent à déclarer que les Hordal avaient toujours été regardés comme, parents de Jeanne d’Arc, et que vers le milieu du XVe siècle, Étienne Hordal, bisaïeul du requérant, avait pris pour épouse une nommée Hauvy (de Burey). Quelques-uns ajoutèrent avoir entendu dire que cette demoiselle Hauvy était fille d’un frère de la Pucelle, appelé Pierre.
À la suite de cette enquête, le 10 juillet 1596, Charles III, duc de Lorraine, octroya à Jean Hordal des lettres de noblesse dont est extrait textuellement ce qui suit :
Charles, par la grâce de Dieu… Considérant que par les preuves et thémoins administrés par nostre bien amé et féal maître Jehan Hordal pour vérification de sa généalogie avec les enquêtes sur ce receues… il y a apparence vraysemblable qu’il est issu de la parenté de la dite Pucelle… luy permettons et à ses enfans de porter les armoiries qu’on dit avoir esté de la dite Pucelle et le déclarons noble, luy et ses descendans, etc., etc.133
On voit qu’à l’exemple de la déclaration d’Henri II, en 1550, les lettres du duc de Lorraine s’abstiennent, avec une prudente réserve, de tout détail de descendance et de filiation, et se bornent à dire que les Hordal sont vraisemblablement issus de la parenté de la Pucelle.
La légende d’une seconde fille, Hauvy ou Halouys, attribuée à messire Pierre du Lis, semble donc, elle aussi, reposer uniquement sur les vagues récits de quelques témoins de l’enquête de Toul en 1596.
Quelques recherches que j’aie dû faire sur l’attribution, à Messire Pierre, de ces deux filles, Catherine et Hauvy, je n’ai pu, je dois le redire encore, trouver d’autre origine à l’une et à l’autre que les on-dit non justifiés de quelques témoins des enquêtes.
§4. Filiation personnelle de l’avocat général Charles du Lis. — Les lettres-patentes du 25 octobre 1612.
Quand, pour établir sa propre filiation, l’avocat général Charles du Lis voulut, au commencement du XVIIe siècle, projeter quelque lumière sur les premiers degrés, si obscurs alors, de la parenté de la Pucelle, sans contester en quoi que ce fût ni la sincérité, ni la noblesse des Hordal et des Le Fournier, ni les liens qui les rattachaient aux frères de Jeanne d’Arc, ni l’existence d’une demoiselle Hauvy, épouse d’Étienne Hordal, il fut frappé, paraît-il, du peu de solidité des affirmations relatives à l’attribution de deux filles à messire Pierre du Lis.
Sa correspondance avec Jean Hordal témoigne de ses longues hésitations à accueillir une filiation assise sur des bases réellement si fragiles134.
Toutefois, après avoir résisté pendant plus de deux années aux affectueuses et pressantes obsessions des familles intéressées, ce grave magistrat, avec une condescendance peut-être excessive, finit par céder à ces vives instances, appuyées, il faut le reconnaître, sur de récentes décisions de juridictions financières, en lesquelles ces affirmations généalogiques avaient été trop facilement acceptées.
Il consentit donc, selon le vœu des Hordal, à insérer, au chapitre VII de son Traité sommaire de la parenté de la Pucelle, qu’ils se rattachaient à la famille de Jeanne d’Arc par l’alliance d’Étienne Hordal, leur bisaïeul, avec une fille de Pierre du Lis, nommée Hauvy ou Halouys135, puis à inscrire au chapitre IX que les Le Fournier s’y rattachaient également par le mariage de Jacques Le Fournier, leur auteur, avec une petite-fille de messire Pierre, née de sa seconde fille, Catherine, épouse de François de Villebresme, receveur du domaine à Orléans.
Ce pas une fois franchi, Charles du Lis s’était, en quelque sorte, imposé à lui-même la voie que désormais il devait suivre dans la fixation, assurément difficile alors, de ces premières générations si confuses et si lointaines.
Aussi, lorsqu’il voulut, à son tour, faire consacrer, par un titre officiel, sa légitime prétention et celle de Luc du Lis, son frère, d’être issus du noble sang de la libératrice de la France, enchaîné par le système qu’il avait cru devoir accepter, il fît insérer, dans les lettres patentes du 25 octobre 1612, la série généalogique dont suit textuellement la teneur136 :
Louis, etc… nos amez et feaulx MM. Charles du Lis, notre conseiller… et Luc du Lis, escuyer, sieur de Reinemoulin… frères, nous ont fait humblement remonstrer que comme durant les guerres… qui furent en ce royaume… cette magnanime et vertueuse fille nommée Jeanne d’Arc… fist miraculeusement lever le siège que les Anglois tenoient devant nostre ville d’Orléans… en recognoissance desquels grands et signalés services elle fut annoblie, avec ses père, mère, frères, et toute leur postérité… desquels frères de ladite Pucelle l’aisné137, Jehan d’Arc, dit du Lis, prévost de Vaucouleurs, et les descendans d’iceluy auroient continué de porter les dits noms et armes du Lys… et le puisné, Pierre d’Arc, aussi dès lors surnommé du Lys, suivant la profession des armes, après être parvenu à l’ordre et degré de chevalerie par lettres-patentes du duc d’Orléans, données à Orléans le 28 juillet 1443138, auroit été récompensé… des signalez services par luy rendus, en faict d’armes, avec sa dicte sœur… Mesme que dudit Pierre du Lis, chevalier, frère puisné de ladite Pucelle, seroient issus et descendus, en droite ligne, lesdits exposans, frères, enfans de Michel du Lis, leur père, fils de Jehan du Lis, leur ayeul, qui fut fils d’autre Jehan du Lis le jeune, lequel estoit aussi fils puisné dudit Pierre du Lis, chevalier, frère encore puisné de ladite Pucelle : lequel Jehan du Lis le jeune, bisayeul desdits exposans, fut nommé et envoyé pour estre l’un des eschevins de la ville d’Arras, par le roy Louis XI, fils et successeur du roy Charles VII139… et d’autant que lesdits exposans sont recognuz aujourd’huy seuls représentans ledit Pierre du Lis, leur trisayeul, frère germain de ladite Pucelle, au moyen de ce que Jehan du Lis le vieil fils aisné dudit Pierre du Lys, chevalier, frère de ladite Pucelle, seroit décédé sans hoirs… À ces causes, etc…140.
Ainsi, Charles du Lis, après avoir consenti à greffer la filiation des Le Fournier (de Normandie) et celle des Hordal (de Lorraine) sur la branche orléanaise de la lignée de la Pucelle, par l’attribution, toute gratuite, à messire Pierre, de deux filles, Catherine et Hauvy, venait, à son tour, dans ces lettres de 1612, confirmées par ses écrits, enter sur cette même branche orléanaise sa propre descendance, en attribuant, gratuitement encore, à ce frère de Jeanne d’Arc, un second fils nommé Jean, comme l’était déjà son aîné141.
L’esprit si éclairé de l’honorable avocat général dut certainement lui faire entrevoir que les titres contemporains par lui laborieusement recueillis, tout incomplets qu’ils fussent à cette époque, soulevaient déjà de graves objections contre ce système généalogique. Sa longue résistance à l’admettre en rendent suffisamment témoignage142. Nos textes nouveaux, s’ils eussent été connus de lui, auraient, on n’en saurait douter, apporté quelques changements à ses appréciations.
La respectueuse déférence due à ce savant magistrat impose donc le devoir de résumer sommairement, ici, les impérieuses déductions qui, forcément, doivent modifier aujourd’hui les thèses généalogiques par lui acceptées, puis accréditées.
§5. Examen spécial du système généalogique accepté par l’avocat général Charles du Lis.
Si messire Pierre du Lis, déjà père d’un fils nommé Jean, dont l’existence ne peut être mise en doute, en eût eu réellement un second, comme l’affirment les lettres-patentes de 1612, ne devrait-on pas s’étonner, tout d’abord, qu’au XVe siècle, où le prénom reçu par l’enfant au baptême était, d’ordinaire, le signe caractéristique de son individualité personnelle, Pierre eût donné à ce second fils le même et unique prénom de Jean, déjà porté par son premier né, sans nulle indication qui les distinguât l’un de l’autre ?
Ne devrait-on pas s’étonner encore que ce fils aîné, Jean, seigneur de Villiers, se voyant privé d’héritiers directs, mais ayant, affirme-t-on, un frère cadet, deux sœurs, Catherine et Hauvy, et des neveux nés de leurs mariages, eût, le 9 mars 1496, par la donation de sa terre de Villiers, la plus belle part de sa fortune, complètement dépouillé, en faveur d’un étranger, ce frère, ces sœurs et leurs enfants, sans inscrire dans l’acte, à l’égard d’aucun d’eux, un seul mot, soit d’exhérédation, soit de souvenir ?
Les incidents survenus à l’ouverture de la succession de ce Jean du Lis, fils de messire Pierre, la déclaration de déshérence et le séquestre des biens, faute d’héritiers connus, la revendication de la succession par une cousine germaine, Marguerite de Brunet, à titre de plus proche parente, la sentence prononcée en sa faveur par le prévôt d’Orléans, après information judiciaire, tous ces faits d’ordre public semblent, on l’a vu143, absolument incompatibles avec l’existence des trois autres enfants attribués à Pierre du Lis144.
L’information faite à Domrémy, le 16 août 1502, imprime à ces déductions, déjà si concluantes, la rigueur d’une démonstration péremptoire.
Le caractère et la personnalité des témoins entendus, la concordance des récits, la simplicité du langage, font jaillir, de leurs témoignages, une clarté qui ne laisse subsister aucune incertitude.
Les huit déposants, parents ou amis ont tous connu messire Pierre, sa femme et son fils.
Trois d’entre eux, Apparu Jacquart, Vaulterin Cousturier et Jacob Brenet, avaient d’affectueux rapports avec les du Lis, lorsqu’ils venaient d’Orléans à Domrémy.
Claude Gérart, allié par sa mère à messire Pierre, l’a reçu maintes fois dans sa maison ; il se rappelle avoir entendu dire à Jean, prévôt de Vaucouleurs, que son frère Pierre et Jeanne, son épouse, n’avaient qu’un seul fils ; que ce fils, nommé petit Jean, était de faible santé et que, s’il venait à mourir, ils auraient pour héritiers leurs neveux.
Enfin, noble homme Claude du Lis, petit-fils du frère aîné de la Pucelle, a, dans son jeune âge, demeuré cinq ans chez son oncle, messire Pierre, en son habitation de Luminard, près Orléans : bien des fois il a conversé avec lui et avec dame Jeanne, sa tante, de leur famille et de leurs affaires, et de ce que deviendrait leur héritage, s’ils allaient de vie à trépas sans laisser d’hoirs de leur corps.
Est-il admissible que ces parents et ces amis de Pierre du Lis, après avoir vécu si familièrement avec lui, aient pu ignorer qu’il eût quatre enfants, et soient venus, dans une enquête publique, déposer en leur loyaulté et conscience qu’il n’en avait qu’un seul ? Est-il possible de croire qu’ils aient voulu, d’un commun accord, dissimuler, dans un acte officiel, des vérités notoires dont l’inévitable révélation eût mis immédiatement à néant leur coupable supercherie ?
Devant un tel ensemble de faits, de titres et de témoignages auxquels nul document contemporain ne peut être opposé, des doutes raisonnés et sérieux peuvent-ils subsister encore ?
§6. Hypothèse d’un double mariage contracté par messire Pierre du Lis.
Pour mettre d’accord, s’il se pouvait, deux systèmes généalogiques, fort difficiles assurément à concilier, quelques personnes ont imaginé de supposer que messire Pierre du Lis aurait pu successivement contracter deux mariages : le premier avec Jeanne Baudot, dont serait issu Jean, seigneur de Villiers ; le second avec Jeanne de Prouville, duquel seraient nés Jean, échevin d’Arras, Hauvy ou Hallouys, épouse d’Étienne Hordal, et Catherine, mariée à François de Villebresme.
Cette hypothèse, tout à fait gratuite, avait été, dès l’origine, suggérée à Charles du Lis par Jean Hordal, dans ses lettres des 25 mars 1610 et 2 avril 1611145. Le grave avocat général n’avait pas cru devoir l’accueillir. Fût-elle admissible, elle ne résolvait aucune des difficultés dont il était évidemment préoccupé. Que Jean, échevin d’Arras, que Catherine et Hauvy fussent frère et sœurs consanguins ou frère et sœurs germains de Jean du Lis, seigneur de Villiers, leurs droits à sa succession eussent toujours été de même nature. Le silence absolu gardé partout à leur égard, leur absence persistante et à toujours n’en devenaient pas, logiquement, plus explicables.
La supposition d’un double mariage contracté par messire Pierre est d’ailleurs complètement inconciliable avec les documents que nous possédons aujourd’hui. Nous y voyons Pierre du Lis et Jeanne Baudot simultanément inscrits près l’un de l’autre, depuis leur départ de Domrémy jusqu’à leur mort.
Ils étaient mariés, dit l’enquête de 1502, quand [vers 1440] ils quittèrent leur village pour aller demeurer à Orléans.
En janvier 1442, Pierre et Jeanne du pays de Bar, sa femme, s’obligent envers le chapitre dans le bail de la métairie de Bagneaux.
En juillet 1443, ils sont mentionnés l’un et l’autre dans les lettres de concession de l’Île-aux-Bœufs, paroisse de Chécy.
Le 26 mars 1457, ils comparaissent tous deux au contrat de mariage de Jean, leur fils, avec Macée de Vézines.
Vers 1460 ou 1465, leur petit-neveu, Claude du Lis, demeure, durant cinq années, avec son oncle Pierre et Jeanne Baudot, sa tante, en leur habitation près d’Orléans.
Et le 8 janvier 1467, l’acte de reprise du bail de Bagneaux constate que Pierre du Lys et Jeanne, son épouse, ont cessé d’exister.
Entre ces dates qui se succèdent sans lacune, où trouver place pour un second mariage et pour la naissance de trois enfants ?
§7. Observations générales sur ce chapitre.
Si des titres incontestés permettent désormais de maintenir, comme un fait acquis à l’histoire, que messire Pierre n’eut qu’une seule épouse, Jeanne Baudot ; de cette épouse qu’un seul fils, Jean, dit de la Pucelle, seigneur de Villiers, et qu’à la mort de ce fils, en 1501, la branche orléanaise des du Lis prit fin en sa personne, ces graves modifications au système généalogique accepté par Charles du Lis ne sauraient, on l’a déjà compris, porter aucune atteinte à la juste renommée de lumières et de droiture acquise à cet honorable magistrat.
L’erreur essentielle commise par Charles du Lis est d’avoir attribué à messire Pierre un fils puîné et deux filles qui évidemment ne peuvent lui appartenir, et qui, selon toute vraisemblance, se rattachent à la descendance de l’un ou l’autre de ses deux frères.
Cette erreur, malheureusement accréditée par ses écrits, et plus encore par une insertion quasi-officielle dans les lettres-patentes du 25 octobre 1612, était véritablement excusable en l’état des documents connus alors.
La rectification de cette inexactitude, devenue facile aujourd’hui, grâce aux textes récemment mis au jour, ne dissipe pas complètement, il faut le reconnaître, l’obscurité dont sont encore enveloppées les premières générations de la parenté de la Pucelle ; mais elle permet au moins, d’entrevoir la vérité à cet égard.
Rien ne paraît s’opposer, en effet, à ce que Jean, échevin d’Arras, regardé à tort, par Charles du Lis et par les lettres d’octobre 1612, comme fils de messire Pierre, ne soit réellement fils, soit de Jacquemin, frère aîné de Jeanne d’Arc, soit de Jean, prévôt de Vaucouleurs146.
Si c’est de Jean qu’il était fils, il peut, vers 1450, avoir épousé Jeanne, fille de Jacquemin, sa cousine germaine, et en avoir eu deux fils : noble homme Claude du Lis, et Jean, surnommé le Picard ; puis, devenu veuf, il peut, vers 1460, avoir quitté Domrémy, emmenant avec lui Jean, l’un de ses deux fils, et laissant l’autre, Claude, aux soins de son oncle, messire Pierre.
On pourrait admettre mieux encore, peut-être, que ce même Jean, échevin d’Arras, au lieu d’être père de noble homme Claude du Lis, ait été son frère ; petit-fils comme lui, de Jean, prévôt de Vaucouleurs, leur aïeul paternel ; petit-fils de Jacquemin, par leur mère Jeanne, et petit-neveu de messire Pierre147.
Hauvy, épouse d’Étienne Hordal, et Catherine, mariée, dit-on, à un François de Villebresme, pourraient aussi être filles ou petites-filles, soit de Jacquemin, soit de Jean, frères de la Pucelle.
Ces solutions, indiquées ici à titre de simples hypothèses, sont complètement subordonnées, il est inutile de le redire, aux découvertes possibles de l’avenir.
Le temps, en nous révélant des textes et des faits nouveaux, et en rendant ainsi moins difficile et plus sûre la tâche de la critique historique, ne nous donne pas le droit de nous montrer ingrats envers nos laborieux initiateurs.
Charles du Lis, au prix de longues et consciencieuses recherches, a, le premier, déblayé la voie où nous marchons à sa suite ; il a, le premier, porté le flambeau en un dédale obscurci, jusqu’à lui, d’un nuage épais d’incertitudes et de récits légendaires. Il serait trop injuste de reprocher soit à lui-même, soit à ceux qui, sur la foi de son savoir, ont accepté ses solutions, quelques involontaires, ou pour mieux dire quelques inévitables inexactitudes.
S’il nous est loisible aujourd’hui, à l’aide d’éléments que Charles du Lis ne connut pas, de rectifier et de compléter son œuvre, en apportant notre humble pierre à l’édifice historique dont il posa les premières assises, nulle autre ambition ne nous est donc permise que d’être ses respectueux disciples et ses dévoués continuateurs.
Encore moins avons-nous à craindre de découronner de leur légitime honneur les nobles familles qui, en diverses provinces, mettent à si haut prix de rattacher leur filiation à l’arbre généalogique de notre sainte libératrice. Leur droit incontesté de se dire issus et descendus de la lignée de la Pucelle, inscrit à toujours dans des actes émanés de l’autorité souveraine148, consacré par une possession plusieurs fois séculaire, leur est irrévocablement acquis, et demeure intact, en dehors de la question qui s’agite.
Ce qui constitue leur suprême prérogative c’est de tenir par un point, quel qu’il soit, à cette tige incomparable. Que le rameau par lequel elles y sont greffées, encore à demi-voilé dans les horizons lointains du passé, ait nom Pierre, ou Jacques, ou Jean, que leur importe ? Que le premier jet de cette sève héroïque soit noble homme Claude du Lis, ou son père, ou quelqu’un de ses frères, ou quelque fils de Jacquemin, encore inconnu jusqu’à ce jour, que leur importe encore ? Elles n’en possèdent pas moins le glorieux privilège de continuer parmi nous une lignée chère à la France, et de sentir couler en leurs veines quelques gouttes d’un sang béni de la terre et du ciel.
Charles du Lis l’avait su comprendre, quand aux lettres patentes de 1612, concédées à sa requête, et rédigées vraisemblablement sous ses auspices, il obtenait de faire inscrire :
Que Charles du Lis et Luc du Lis, sieur de Reinemoulin, son frère, porteraient, dans leurs armoiries, leur heaume timbré d’une figure de la Pucelle, vestue de blanc, ayant en sa main droite une couronne d’or soustenue sur la pointe de son espée, et en la gauche sa bannière représentée comme de son vivant elle la portait, et que le cri de lui, de son frère et des siens serait : La Pucelle et les lys149…
Rien, en effet, ne saurait mieux retracer l’éminent caractère de cette noble race que ce gracieux et touchant symbole. Jeanne y domine tous les siens de ses insignes et de son nom ; toutes notabilités intermédiaires s’absorbent en son incomparable souvenir ; mais elle ne se les approprie, en quelque sorte, que pour les illuminer d’un éclat plus durable et plus pur, et les couronner, les unes comme les autres, du rayonnement de son immortelle auréole.
XIV Quelle fut, dans l’Orléanais, la résidence habituelle d’Isabelle Romée, de Messire Pierre du Lis et de sa famille ?
La série de faits placée sous les yeux du lecteur a pu déjà permettre d’apprécier en quels lieux vécurent habituellement les parents de Jeanne d’Arc, depuis leur venue en notre province jusqu’au jour où la branche orléanaise de cette glorieuse tige s’éteignit parmi nous.
Peut-être n’est-il pas toutefois inutile de grouper en un chapitre spécial les déductions successivement émises, et, sur ce point encore, de reconstituer, aussi exactement que possible, ces lointains et intéressants souvenirs.
À partir de leur arrivée à Orléans, jusqu’à ce qu’ils eussent trouvé un emploi fructueux et convenable, la mère et le frère de la Pucelle habitèrent provisoirement la ville. Les mentions inscrites aux comptes de commune et les énonciations du bail de 1442 ne laissent aucun doute à cet égard.
Mais dès que, cautionnés par Jean Bourdon, ils eurent pris à bail les cent soixante-dix arpents de la ferme de Bagneaux, et que, grâce à son généreux désistement, ils purent joindre à cette exploitation, déjà considérable, les deux cents arpents de l’Île-aux-Bœufs, ils durent naturellement fixer leur séjour là où les appelaient, à la fois, leurs goûts champêtres et les exigences de leur position nouvelle.
Placés à la tête d’une gestion importante, la surveillance de la culture et du bétail, le soin de leurs graves intérêts et de ceux de l’ami dévoué qui s’était porté caution de leurs engagements envers le chapitre, tout réclamait leur présence en ces propriétés qu’ils faisaient valoir.
Il ne faut pas oublier d’ailleurs qu’au XVe siècle la vie des champs était l’existence habituelle de la noblesse d’épée, en nos provinces.
Nos cités du moyen âge, resserrées dans leur enceinte de murailles, à peine pavées en leurs voies principales, presque entièrement dépourvues des agréments que la civilisation moderne prend à tâche d’y réunir, n’ayant guère d’autres distractions à offrir, comme nous l’apprennent nos comptes de commune, que le passage des personnages en renom et les religieuses solennités des processions générales, n’étaient généralement habitées que par les familles vouées au négoce et aux industries usuelles, et par les magistrats, les étudiants, les corporations religieuses ou enseignantes et les fonctionnaires publics.
Les gentilshommes vivaient dans leurs terres. Lorsqu’ils n’étaient pas riches, et telle était la position des du Lis, ils les faisaient valoir eux-mêmes, plantant, comme on disait alors, leur épée au bout de leur sillon.
Le titre de chevalier, conféré à Pierre du Lis, lui donnait rang dans la noblesse. Tout révèle qu’il appréciait vivement cet honneur. La vie champêtre n’eût-elle pas été sa condition originaire, il l’eût certainement préférée à toute autre, pour mieux s’assimiler à ceux auxquels il se trouvait désormais agrégé.
Ces appréciations ressortent de la nature des choses ; elles sont pleinement confirmées, d’ailleurs, par l’ensemble des documents parvenus jusqu’à nous.
Dans le bail de Bagneaux, du 31 janvier 1442, Pierre du Lis, récemment arrivé de Domrémy, déclare demourer à Orléans ; mais tous les textes ultérieurs, sans exception, indiquent qu’il avait, en ses exploitations agricoles, sa principale résidence.
Ainsi, dans l’enquête de 1476, ouverte en la prévôté de Vitry150, l’un des témoins, Thomas Senlis, demeurant à Sermaize, près Bar-le-Duc, dépose, on ne l’a pas oublié, qu’ayant été vers 1451 ou 1452 à Orléans pour ses affaires, il y fit rencontre d’un nommé Collesson Coutant, cordonnier, natif dudit Sermaize :
… lequel le mena veoir dame Isabellot, mère de Jehanne la Pucelle, demourant lors audit Orléans, et qu’en allant en son hostel, ils rencontrèrent messire Pierre du Lis, fils d’icelle dame Isabellot, qui, comme il disoit, venoit d’un village nommé les Ysles-lez-Orléans, que ledit feu roy Charles lui avoit baillé151.
Un autre témoin de cette enquête, Henri (de Vouthon), dit Perrinet, charpentier, petit-neveu d’Isabelle, dit, à son tour :
… avoir été, avec feu son cousin Jehan (de Perthes), veoir à Orléans Isabellot, mère de la Pucelle, demourant audit lieu, et son fils messire Pierre, demourant au grand hostel de Baigneaux.
Ces mêmes affirmations se retrouvent dans les actes de notoriété de 1502 et de 1551. — Dans l’acte de 1502, Pierre du Lis est dit demeurer à Orléans, ou là environ152. — Dans celui de 1551, Nicole Boulland, chanoine de Vaucouleurs, dépose qu’un frère de la Pucelle était allé à Orléans, ou au pays à l’environ ; et Didon d’Alis (du Lis) dit que ce frère de Jeanne d’Arc avait, près d’Orléans, une seigneurie nommée Baiguenault (sic), où souvent il se tenait.
Messire Pierre lui-même, dans le bail de la petite maison rue des Africains (8 mai 1852), déclare qu’il demoure à présens en la paroisse Saint-Aignan de Sandillon.
Ces mots, qu’il demoure à présens, pourraient donner à croire qu’il n’y demeurait que depuis peu de temps. Il ne serait pas invraisemblable, en effet, que jusqu’à ce que les bâtiments de la ferme de Bagneaux eussent été mis, comme le lui imposait le bail, en état de le recevoir, Pierre eût habité Chécy, où l’appelaient à la fois les amis dévoués qu’il avait en cette prévôté et la gestion des deux cents arpents de l’Île-aux-Bœufs153.
Le témoignage ci-dessus, de Thomas Senlis, tendrait à confirmer cette induction.
Le compte de commune de 1457 constate à son tour que Pierre du Lis était venu de son villaige faire les noces de son fils à la ville.
Enfin, dans l’enquête du 16 août 1502, Claude du Lis affirme avoir passé près de son oncle, messire Pierre, et de Jeanne Baudot, sa tante, au lieu de Luminard (près de Bagneaux et de l’Île-aux-Bœufs), les dernières années de leur vie.
Ainsi, que Pierre du Lis ait habité à diverses époques, soit Chécy, soit Bagneaux, soit Luminard, toujours est-il que les inductions, d’accord avec les textes, révèlent unanimement qu’à l’exemple des gentilshommes de son temps, il avait sa demeure habituelle dans les propriétés rurales qu’il faisait valoir.
Quant à Isabelle Romée, si nous manquons d’indications précises, de graves inductions autorisent à penser qu’elle vécut près de ses enfants, et rendit entre leurs bras son dernier soupir.
Tout cependant porte à croire que, vers 1452, alors que sous la religieuse impulsion du cardinal d’Estouteville commencèrent de sérieux efforts pour la réhabilitation de Jehanne d’Arc, sa vieille mère vint habiter la ville. Elle dut vouloir suivre de plus près cette grave affaire, intentée à sa requête, continuée en son nom, et qui réalisait le vœu de son cœur et toute la pensée de sa vie.
C’est à cette époque, en effet, que, dans l’enquête de 1476, Thomas Senlis et Henri (de Vouthon) déposent avoir été reçus à Orléans par la dame Ysabellot, demourant lors en la ville.
C’est à cette date encore que, pour la seule fois durant dix-huit ans, se lit, à trois reprises consécutives, dans les comptes de commune, cette mention inusitée, ajoutée à l’indication du paiement de sa pension mensuelle :
>
À Ysabeau, mère de Jehanne la Pucelle, à qui ladicte ville donne, par chascun moys, quarante-huit solz parisis, pour lui aider à vivre et avoir ses nécessités en ladicte ville154.
C’est enfin le 8 mai 1452, au moment même où Guillaume d’Estouteville se faisait remettre par Isabelle la requête au Souverain-Pontife en révision du procès, que Pierre du Lis prenait à bail, de l’abbaye de Saint-Euverte, la petite maison en ruines, rue des Africains, à charge de la reconstruire et de la mettre en état habitable. L’enquête de Vitry, en 1476, nous apprend que, vers 1455, messire Pierre, ayant, dans un voyage en Lorraine, rencontré, à Favresse, un de ses cousins, Perrinet (de Vouthon), charpentier, l’emmena avec lui à Orléans, en intention d’avoir son avis sur une maison qu’il prétendait y faire construire155.
Combien de temps dura le séjour d’Isabelle à la ville ? Rien, jusqu’ici, ne le fait précisément connaître ; mais il n’est pas invraisemblable qu’après la solennelle proclamation de la réhabilitation de sa fille, elle soit revenue près de ses enfants, passer à leur foyer les dernières années de sa vie. Plusieurs textes, on l’a vu, autorisent à le croire.
Jean du Lis, fils de messire Pierre, continua jusqu’à sa mort le bail de la petite maison, rue des Africains ; mais il n’est mention, dans aucun titre parvenu jusqu’à nous, qu’il y ait eu sa résidence. Les actes antérieurs à la mort de son père portent qu’il habitait le château de Villiers, et dans tous les autres il dit avoir son domicile à Saint-Aignan de Sandillon.
Quant à Marguerite du Lis, elle paraît avoir constamment demeuré avec son mari dans la petite seigneurie du Mont, près de l’Île-aux-Bœufs.
La découverte faite par M. J. Doinel, du bail à long terme de la maison rue des Africains, n’en conserve pas moins toute sa valeur. Elle précise, d’une manière certaine, la notion, jusqu’ici vaguement répandue, que les parents de la Pucelle eurent à Orléans une petite habitation qu’Isabelle Romée occupa vraisemblablement durant quelques années. Elle rattache par un lien de plus cette illustre famille à notre ville156 ; mais elle ne paraît pas devoir notablement modifier les appréciations rigoureusement déduites des faits et documents en ce moment connus.
Il reste toujours acquis qu’en leurs domaines ruraux, sis aux bords de la Loire, les parents de Jeanne d’Arc trouvaient ce qui fait le charme et constitue les préoccupations de la vie : les liens affectueux, les graves intérêts, les souvenirs.
À Bagneaux étaient les principaux bâtiments de leur exploitation et les meilleures terres de leur culture. Pierre du Lis aimait à s’en dire le seigneur. Tout près de là, en la petite seigneurie du Mont, habitaient Marguerite du Lis, Antoine de Brunet, son mari, et leurs trois enfants.
À Chécy demeuraient leurs plus chaleureux amis et leurs plus dévoués protecteurs : les Bourdon, les Cailly, d’autres encore. Possesseur, en cette paroisse, d’une terre domaniale à lui donnée par le duc apanagiste, comme une sorte de récompense nationale, messire Pierre y avait, à ce titre, un rang égal aux meilleurs gentilshommes de la prévôté.
La vieille mère de la Pucelle y vivait parmi les témoins des premiers exploits de sa noble fille, du passage de la Loire, du ravitaillement d’Orléans, de l’accueil enthousiaste des capitaines et des bourgeois de la ville.
Elle pouvait s’agenouiller, chaque jour, aux pieds du premier autel Orléanais où Jeanne avait prié pour le Dauphin et pour la France.
Les Orléanais, nos pères, si injustement accusés d’avoir laissé vivre près d’eux, dans une situation précaire, la mère vénérée de leur libératrice, n’avaient donc pas seulement pourvu à ses besoins de chaque jour ; grâce à l’affectueux concours d’amitiés presque filiales et de la reconnaissance publique, Isabelle Romée, à quelques pas de la ville, aux rives du fleuve dont les échos redisaient le nom béni de la Pucelle, retrouvait, en sa vieillesse, le souvenir de ses jeunes années et de sa patrie absente, le calme des champs, les paisibles soins du labour et du bétail, les eaux, les prairies, les coteaux boisés, les riants aspects du pays natal.
XV Les du Lys, au XVIIe siècle dans l’Orléanais ; l’avocat général Charles du Lis et Catherine de Cailly, son épouse
Le nom des du Lis semblait, en 1502, par la mort de Jean, fils de messire Pierre, et par celle de Marguerite, femme d’Antoine de Brunet, éteint pour toujours en notre Orléanais, lorsqu’un siècle après on l’y vit de nouveau refleurir, dans le brillant épanouissement d’un patriotisme héréditaire.
Charles du Lis, né vers 1559, substitut du procureur général au parlement, puis, en 1602, avocat général près la Cour des aides de Paris, descendait, au cinquième degré, d’un frère de la Pucelle157.
Comme s’il eût voulu retremper son nom aux sources de son illustration originaire, il vint, vers 1594 ou 1595, se choisir une épouse en la famille orléanaise des Cailly, dont le nom se rattachait aux premiers souvenirs de la Vierge de Domrémy.
Catherine de Cailly158 descendait, elle aussi, au cinquième degré, de Guy de Cailly, qui reçut Jeanne d’Arc en son manoir, lorsqu’au début de sa mission elle amena de Blois à Orléans un convoi de munitions et de vivres, et qui, depuis, paraît s’être attaché fidèlement à sa fortune159.
Des lettres d’anoblissement, accordées par Charles VII en 1429, consacrèrent l’antique honorabilité des Cailly, alliés aux meilleurs noms de la province160.
Ainsi devenue Madame, ou, comme on disait alors, Mademoiselle du Lis161, Catherine de Cailly, par la délicatesse de son esprit, et mieux encore par l’élévation de ses sentiments, se montra digne de l’alliance qu’elle venait de contracter.
Son frère, Jacques de Cailly, gentilhomme ordinaire de la maison du roy162, père du gracieux auteur des Petites poésies du chevalier d’Aceilly, aimait aussi les lettres163 ; mais, dans cette vieille famille, le culte religieux de la libératrice de la France se perpétuait, plus que tout autre, comme une partie de l’héritage paternel.
Une généreuse réaction se manifestait, à cette époque, au sein d’un groupe de nobles cœurs et de hautes intelligences, en faveur de l’héroïque jeune fille dont la sainte mémoire avait été indignement outragée par quelques écrivains du XVIe siècle.
L’illustre Étienne Pasquier, avocat général à la Cour des comptes, marchait à la tête ; près de lui s’étaient rangés, pour défendre la même cause, Charles du Lis, les Cailly, les Hordal (de Lorraine), d’autres encore.
Par son nom, ses fonctions, son grand caractère, Charles du Lis, sous les auspices d’Étienne Pasquier, son commensal et son ami, devint bientôt l’un des centres d’action de cette généreuse croisade, où la science historique luttait avec la poésie, de patriotisme et d’efforts.
Uni d’une vive affection à Jacques de Cailly, son beau-frère, Charles du Lis le venait voir souvent en son manoir de Reuilly, et les registres paroissiaux de Chécy conservent de précieux témoignages de ses fréquentes visites et de celles de Luc du Lis, sieur de Reinemoulin, son frère.
C’est en ces lieux, tout imprégnés des souvenirs de la Pucelle, que paraissent s’être élaborés plusieurs des écrits voués à la légitime glorification de ses services et de ses vertus.
… Ne laissons pas oublier, m’écrivait, il y a quelques années, un éminent historien, dont le nom est aujourd’hui une des gloires de notre province164, ne laissons pas oublier que les rives de la Loire furent, pour la France, aux XVIe et XVIIe siècles, ce que Florence était pour l’Italie, le berceau de la patrie et des arts…
Sous la chaleureuse inspiration des Pasquier, des Cailly, des du Lis, elles furent quelque chose de plus encore : elles furent le foyer d’un pur et ardent patriotisme165.
Tandis qu’une commune pensée de réparation et de gratitude inspirait, presque à la fois, les éloquentes protestations de l’auteur des Recherches de la France, les laborieuses investigations du Traité sommaire, les religieuses pages de Jean Hordal166, de François Le Maire167, de Symphorien Guyon168 et du doyen Charles de la Saussaye169, la restauration du monument élevé sur le pont d’Orléans, à la mémoire de l’immortelle héroïne, offrait aux du Lis et aux Cailly l’occasion d’une brillante manifestation poétique. Une sorte de concours épigraphique, pour les inscriptions qui devaient orner le piédestal, s’ouvrait sur leur initiative, et la plupart des beaux esprits du temps tinrent à honneur d’y apporter le tribut de leur admiration et de leurs vers.
Un recueil, aujourd’hui fort rare, publié en 1613 par Charles du Lis, nous a conservé ce faisceau d’hommages enthousiastes offerts à la Pucelle, en prose, et surtout en vers, dans une féconde variété de styles et de langues mortes ou vivantes170.
Si l’élégance et la simplicité littéraire laissent parfois à désirer, en ces cent cinquante petites pièces de prose ou de vers signées des illustres noms de Malherbe, de Dorat, de Gournay, de Sainte-Marthe, et des noms plus modestes de notre pléiade orléanaise : des la Saussaye, des Louis d’Orléans, des Durant, des Jacques et Catherine de Cailly, des du Lis, et même du bon curé de Chécy, auteur d’un des plus jolis quatrains du recueil, personne ne saurait nier, du moins, que les sentiments qu’elles expriment ne soient constamment dignes d’éloges.
Cette couronne poétique, déposée aux pieds de la Pucelle, fit beaucoup d’honneur aux du Lis et aux Cailly, principaux inspirateurs de cette œuvre collective.
Mais la mort ne tarda pas à décimer, sans pourtant l’éteindre, l’illustre race qui venait de refleurir parmi nous.
Luc du Lis, sieur de Reinemoulin, frère de l’avocat général, avait épousé demoiselle Louise Collier. Il vivait encore en 1628, mais ne paraît pas avoir laissé d’héritiers, non plus que sa sœur Jacqueline, veuve de M. Chanterel171.
Charles du Lis mourut vers 1634.
De son mariage avec Catherine de Cailly étaient nés quatre enfants ; ses deux fils, dont l’un fut principal du collège de Boissy, décédèrent sans postérité.
Une de ses filles, Catherine, devenue femme de M. Richard de Pichon, trésorier de Guyenne, eut aussi deux fils qui, l’un et l’autre, entrèrent dans les ordres.
Sa seconde fille, damoiselle Françoise, épousa M. Louis de Quatrehommes, membre de la Cour des aides et du Conseil privé des finances. Sa descendance s’est seule continuée jusqu’à nos jours.
C’est par elle que se perpétue, en notre vieil Orléanais, le sang des du Lis, si sympathique à notre province ; par elle que se rattache à Charles du Lis, et par Charles du Lis à l’un des frères de Jeanne d’Arc, la noble famille, fidèle et bienveillante gardienne des précieuses archives de cette race historique, digne héritière de ses belles traditions de patriotisme et d’honneur172.
XVI Enquêtes, en forme authentique, faites au XVe et XVIe siècle, sur Jeanne d’Arc et sa famille
Un certain nombre d’informations, soit officielles, soit d’intérêt privé, mais toujours reçues par des officiers publics, furent faites aux XVe et XVIe siècles, pour constater des faits relatifs à Jeanne d’Arc et aux siens, et suppléer à l’absence d’actes réguliers de l’état civil.
Les procès-verbaux de ces actes de notoriété donnent de précieux renseignements sur les origines de la parenté de la Pucelle. Bien que, d’ordinaire, leur but spécial soit de rattacher à la vierge de Domrémy la filiation particulière de quelques familles, et que dès lors une notable partie des dépositions soit sans intérêt pour l’histoire, il est rare qu’une étude attentive ne parvienne pas à y recueillir d’utiles éclaircissements, ou quelques curieux détails.
C’est là qu’ont été puisés bien des faits consignés en cette étude. Il ne semble donc pas inutile de donner quelques notions sommaires sur ces sources fécondes, insuffisamment explorées jusqu’ici.
Pour plusieurs de ces enquêtes, j’aurai peu de chose à ajouter à ce que j’ai déjà dit à leur égard ; je parlerai des autres avec un peu plus d’étendue, me bornant d’ailleurs à ce qui peut avoir quelque valeur historique.
Je les analyserai successivement dans l’ordre chronologique de leur ouverture, en observant que leur autorité est d’autant plus grande qu’étant plus rapprochées des faits qu’elles ont pour objet de constater, les souvenirs des témoins sont moins altérés par le temps.
§1. Enquêtes officielles de 1456, pour le procès de réhabilitation.
Dès l’année 1452, sous les auspices du cardinal d’Estouteville, légat du Saint-Siège près la cour de France, des enquêtes avaient été faites à Rouen, pour préparer la réformation de l’odieuse sentence du 30 mai 1431173. Quand Calixte III, par son rescrit pontifical du 11 juin 1455, eut enfin ordonné la révision de cet inique procès, les juges, par lui institués, prescrivirent, sur la demande du promoteur, que ces informations fussent reprises et continuées, partout où besoin serait, par des commissaires spécialement désignés. Des notaires ecclésiastiques furent chargés de recueillir les dépositions.
Du 28 janvier au 28 mai 1456, des enquêtes furent ouvertes, en conséquence, à Domrémy et Vaucouleurs, à Orléans, à Paris, à Rouen et à Lyon. Cent douze témoins y furent entendus174.
Leurs dépositions, inscrites aux procès-verbaux de la réhabilitation, sont parvenues jusqu’à nous. Si l’on regrette, en les lisant, que bien des détails d’un haut prix pour l’histoire aient été trop sommairement indiqués par les notaires rédacteurs, ou même parfois passés sous silence, les déclarations de ces témoins oculaires, émises sous la foi du serment et consignées par des officiers publics en un acte authentique, sont d’une incomparable valeur. Nous leur devons, ainsi qu’aux réponses de Jeanne d’Arc elle-même, en ses interrogatoires, ce que nous savons de plus digne d’intérêt sur la famille et sur la vie publique et privée de la vierge de Domrémy.
§2. Enquête faites en octobre et novembre 1476, dans les prévôtés de Vaucouleurs et de Vitry, à la requête de Collot (de Perthes), petit-fils de Jean (de Vouthon), frère d’Isabelle Romée. — Détails historiques. — La fausse Jeanne d’Arc de Sermaize (en Barrois), etc.175
Vingt ans après ces solennelles informations, Collot (de Perthes), petit-neveu d’Isabelle Romée, mère de la Pucelle, obtint qu’une double enquête fût ouverte à sa requête, pour constater régulièrement sa parenté.
Dans la première, reçue le 28 octobre 1476 par deux tabellions jurés en la prévôté de Vaucouleurs, six notables habitants du pays, parmi lesquels se remarquent les noms de Geoffroy Tallevart, beau-frère de messire Pierre du Lis, et de Michel Lebuin, l’un des témoins entendus pour la réhabilitation176, déclarèrent
qu’ils avoient bien connu ung nommé Jehan (de Vouthon, ou Voulton), recouvreur de son état, demeurant audit Voulton, et une nommée Ysabelot, femme de feu Jacques d’Arc, à leur vivant demeurant à Domrémy-sur-Meuse, lesquels Jehan (de Vouthon) et Ysabelot estoient frère et sœur germains… et au regard dudit Jehan (de Vouthon), s’absenta dudit lieu et s’en alla demourer en Champagne, comme la commune renommée estoit par le pays177…
Les 2 et 3 novembre suivant, à la même requête de Collot (de Perthes), une seconde information fut ouverte à Sermaize et à Faveresse178, par devant deux notaires jurés au tabellionnage de Vitry, sous l’autorité de Jehan Le Couat, garde du scel en cette prévôté.
Treize habitants de Sermaizes et de Faveresse, presque tous parents ou amis de la famille de la Pucelle, donnèrent, en cet acte de notoriété, sur la descendance de ce Jehan de Vouthon, oncle de Jehanne d’Arc, des détails complets et précis.
Il résulte de l’ensemble de leurs dépositions que, vers l’année 1416, Jehan, frère d’Isabelle, né comme elle au village de Vouthon, en Barrois, vint se fixer à Sermaize avec sa femme Marguerite, ses trois fils et une fille nommée Mengotte179, encore en bas âge ; qu’il y vécut trente ans et y mourut vers l’année 1446.
De ses trois fils, l’aîné, Poiresson (ou Perresson), sur lequel les déposants donnent peu de détails, paraît avoir, lui aussi, vécu à Sermaize. — Le second, Perrinet, charpentier de son état, se serait établi au village voisin de Faveresse. L’un de ses enfants, Henri Perrinet, né vers 1424, charpentier comme son père et l’un des déposants en cette enquête de 1476, fut rencontré à Faveresse, de 1450 à 1455, par messire Pierre du Lis, et emmené par lui à Orléans pour l’aider dans la construction d’une maison qu’il y voulait bâtir. — Nicolas, le troisième fils, religieux au couvent de Cheminon (ordre de Cîteaux), diocèse de Châlons, aurait quitté son monastère, dit Henri Perrinet en sa déposition, sur la demande de Jeanne d’Arc et de Charles VII, et sur l’ordre de son abbé, pour accompagner Jeanne, à titre de chapelain, en ses expéditions militaires.
Mengotte, la plus jeune de la famille, après avoir épousé, en premières noces, Collot Turlant (de Sermaize), s’unit en second mariage à Pierre (de Perthes) dont elle eut cinq enfants : Jean, mort en 1468, au service du roi ; Didier, religieux à Châlons ; Collot (de Perthes), promoteur de l’enquête, et deux filles : Marguerite et Agnès. — Pierre de Perthes mourut vers 1474 ; Mengotte était décédée avant 1476180.
§2.1 Détails historiques recueillis dans l’enquête de 1476.
Ces notions si complètes sur cette branche collatérale de la famille de Jeanne d’Arc ne sont pas les seules qui nous aient été transmises par l’enquête de 1476. Nous lui devons, sur d’autres points encore, d’intéressants détails.
Ainsi, la déclaration de plusieurs témoins que Jean, prévôt de Vaucouleurs, était venu, en 1470, visiter ses parents à Faveresse et à Sermaize, et qu’il n’existait plus en 1476, circonscrit entre les années 1470 et 1476 la date, jusqu’à ce jour ignorée, du décès de ce frère de la Pucelle.
Les voyages de Henri Perrinet et de Thomas Senlis à Orléans, vers 1452, et les naïfs récits de leurs visites à Isabelle Romée et à son fils messire Pierre, montrent, en termes simples et touchants, quels rapports affectueux s’étaient conservés entre les divers membres de la famille181. Tous les témoignages sont d’ailleurs unanimes à cet égard.
Un proche parent, jusqu’à présent inconnu, de Jeanne d’Arc nous est, de plus, révélé par cette information.
D’anciens habitants de Sermaize déposent que, lorsque Jean (de Vouthon) vint, avec sa famille, s’établir en cette petite ville, elle avait pour curé un messire Henri (de Vouthon) qu’ils ont longtemps connu, et qui l’administra jusqu’à sa mort. Ce messire Henri était, lui aussi, natif de Vouthon en Barrois ; les trois enfants de Jean : Perrinet, Perresson et Mengotte, furent constamment traités par lui comme ses plus prochains linagers et amis charnels, tellement qu’après son trépas, ils prirent et emportèrent, par portions égales, toute sa succession mobiliaire et immobiliaire, sans qu’aucun empêchement leur en fust fait puis lors182.
Ce messire Henri (de Vouthon), de même nom, de même âge et de même pays que Jean, frère d’Isabelle ; qui semble l’avoir fait venir près de lui par affection ; qui traite ses enfants comme ses plus proches parents et les a pour seuls héritiers à son décès, lui tenait évidemment par des liens très-étroits de parenté.
Ne pourrait-on entrevoir en lui un second frère d’Isabelle, et cette pieuse famille, qui comptait déjà deux religieux parmi ses membres, y compterait-elle, de plus, un ministre des autels ?
§2.2 La fausse Jeanne d’Arc de Sermaize (en Barrois). — Son acceptation par les notables du pays et les membres, de la famille. — Lettre de rémission découverte par M. Lecoy de la Marche.
D’autres témoins, dont la sincérité ne peut être révoquée en doute, nous révèlent un fait plus étrange encore et complètement ignoré jusqu’ici.
Je cite textuellement leurs récits :
Jehan le Montigneux, demourant à Sermaize, aagé d’environ soixante-dix ans, dict et deppose par devant lesdiz jurés qu’il est natif dudict Sermaize, auquel lieu il a tout son temps demouré et fait sa continuelle résidence, et est bien recordz que depuis environ vingt-sept ans en ça [vers 1450 ou environ], une nommée Jehanne, soi disant être la Pucelle, natifve, comme elle disoit, de la ville de Dompremy, sur la rivière de Meuze, au pays de Barrois, vint audit Sermaize en un jour dont il n’est recordz, laquelle il vit accompagnée d’un nommé Collesson Coutant et plusieurs autres, desquels ne sçait les noms, but, mangea et fit bonne chère en la maison dudit Perrinet, son cousin, fils dudit Jehan de Voulton, et, en pourparlant de plusieurs choses, icelle Jehanne dit tout publiquement qu’elle estoit venue audit Sermaize pour veoir et visiter Henry Perrinet, dit de Voulton, lequel elle disoit estre son cousin et linager bien prochain, à cause de ce qu’il étoit né et descendu dudict Perrinet de Voulton, filz dudict Jehan de Voulton. Ne sait, lui depposant, sur ce requis, en quel degré elle le tenoit et reputoit son cousin, ni aussi si ladicte Jehanne estoit celle qui accompagna le dit feu Charles à son sacre à Reims…
Un autre témoin, Jehan Guillaume l’aisné, aagé d’environ soixante-seize ans, natif aussi dudit Sermaize, où il a demeuré trente ans, dit et dépose en sa loyauté et conscience :
Qu’il a veu audit Sermaize une nommée Jehanne, soi disant estre Jehanne la Pucelle, faire bonne chère ès hostels et maisons desdicts de Voulton, Perrinet et Peresson frères, enfans de Jehan de Voulton, lesquels elle disoit estre de son linage en bien prochain degré ; ne sçait, lui depposant, auquel degré, ne aussi si ladicte Jehanne estoit la Pucelle qui accompagna le feu roy Charles, à son sacre à Reims, et plus n’en a dit ni depposé.
Ces témoignages déjà si précis et si formels sont confirmés, par la déposition suivante, dont la gravité ne saurait être méconnue :
Vénérable personne, messire Simon Fauchart, prestre, curé de Sermaize, notaire et juré du roy, nostre sire, en la prévosté dudict Vitry, demourant audit lieu de Sermaize, aagé d’environ cinquante-trois ans, dict et deppose, in verbo sacerdotis, qu’il est bien recordz et mémorant que vingt-quatre ans ou environ [vers 1452], une jeune femme, soi disant estre Jehanne la Pucelle, vint audit Sermaize, habillée en habit d’homme, avec laquelle il fit bonne chère et joua à la paulme contre elle, en la halle dudit Sermaize ; et est vrai qu’il lui ouyt dire telz motz : Dictes hardiment que vous avez joué à la paulme contre la Pucelle ;
dont le dit depposant fust fort joyeulx ; et si lui oyt dire, en oultre, que les nommés Perrinet et Poiresson (de Voulton) frères, demourant audit Sermaize, enfans de feu Jehan de Voulton, estoient ses prochains parents et linagers, et luy veit faire avecques eulx, durant qu’elle fust audit Sermaize, une très-grande et joyeuse chère…
Il ressort de ces textes que, vers 1452, vingt ans après le martyre de Rouen, une nouvelle aventurière osa, dans la contrée même où avait vécu Jeanne d’Arc, et où ses proches parents résidaient encore, usurper son nom et ses glorieux souvenirs, et parvint, chose réellement étrange, à se faire accepter par les notables du pays et les membres mêmes de la famille.
Cette acceptation fut si sincère, que, plus de vingt ans après, en 1476, malgré les enquêtes publiques faites, en 1456, à Domrémy et à Vaucouleurs, et la sentence solennelle de réhabilitation, ces témoins, requis par les deux notaires jurés de parler en leur loyauté et conscience, se bornent à déclarer timidement qu’ils ne savent pas si ladite Pucelle étoit celle qui accompagna le feu roy Charles VII à son sacre à Reims.
La fausse Jeanne d’Arc de Sermaize ne saurait évidemment être confondue avec la fourbe audacieuse, épousée par le chevalier Robert des Armoises, et dont la coupable et mystérieuse intrigue, protégée par de hauts personnages, débuta, en 1436, aux environs de Metz, séduisit des populations nombreuses, trompa les échevins d’Orléans et jusqu’aux frères de Jeanne d’Arc, et quatre ans après, vers 1440, fut publiquement démasquée et flétrie. Il serait peu vraisemblable qu’après avoir, à Chinon, demandé grâce à Charles VII, dont une simple question avait déconcerté son impudente effronterie183, puis, amenée de force à Paris, avoir été exposée et prêchée, à la vue du peuple, sur la table de marbre de la cour du Parlement184, elle eût, douze ans après, sans nul espoir de succès, conçu la folle pensée de recommencer sa criminelle imposture, au risque de graves démêlés avec la justice, en des pays où son humiliant échec ne pouvait être ignoré.
Mais quel était alors le nom véritable et le lieu d’origine de la fausse Pucelle de Sermaize ? Quelles furent les phases et l’exacte durée de sa misérable aventure ? Nous l’ignorons complètement, et serions réduits à savoir, d’après les dépositions de l’enquête de 1476, qu’elle était jeune et se disait native de Domrémy, qu’elle portait des habits d’homme, jouait son rôle avec une grande hardiesse, et faisait bonne et joyeuse chère avec ses crédules adeptes, si un curieux document, trouvé il y a quelques années par M. Lecoy de la Marche, dans le recueil du Trésor des Chartes185, et publié par lui, in extenso, dans une intéressante étude historique186, ne nous eût révélé, sur ce singulier épisode, quelques détails inattendus.
Les intelligentes recherches de M. Lecoy de La Marche, au riche dépôt de nos archives nationales, lui ont fait découvrir une lettre de rémission accordée par René, duc d’Anjou et de Bar, en février 1457, à Jehanne de Sermaize. J’en reproduis ici, d’après son texte, les passages essentiels :
René, par la grâce de Dieu, roy de Jérusalem et de Sicile, duc d’Anjou et de Bar… Humble supplication de Jehanne de Sermaize, à présent femme de Jehan Douillet, avons receue, contenant que par hayne que ont conçue contre elle aucuns des parens de la dame de Saumoussay… elle a esté mise en une prison de Saumur, et ilec détenue par l’espace de troys mois, ou environ, et luy a esté imposé par aucuns nos officiers, audit lieu de Saumur, qu’elle s’estoit fait appeler par longtemps Jehanne la Pucelle, en abusant et faisant abuser plusieurs personnes qui autrefois avaient veu la Pucelle qui fust à lever le siège d’Orléans contre les anciens ennemis de ce royaulme…
Et à celle occasion, jassoit à ce qu’il n’y ait eu autre charge contre elle, a esté par nos officiers dudit lieu de Saumur bannie de nostre dit pays d’Anjou, et deffendu de n’y entrer ne converser en aucune manière ; par le moyen duquel bannissement la dite suppliante ne ouse aller ne venir en nostre dite ville de Saumur… requérant humblement que, actendu qu’elle ne fust onques actainte d’aucun autre vilain cas, blâme ou reprouche, nous lui voulussions donner et octroyer congé et licence d’aller, venir et séjourner par tout nostre dit pays d’Anjou… et lui impartir nostre grâce et miséricorde sur ce…
Savoir faisons que nous, ayant considération aux choses dessus dites et mesmement à la requeste d’aucuns, qui de ce nous ont supplyé et requis, avons voulu et consenti… que la dite Jehanne de Sermaize puisse aller et venir partout nostre dit pays d’Anjou et où bon lui semblera… jusques à cinq ans… toutesvoyes que doresenavant elle se portera honnestement, tant en abiz que autrement, ainsi qu’il appartient à une femme de faire…
Donné en notre chastel d’Angiers, le… jour de février mil CCCC cinquante-six [1457 n. s.].
Lorsqu’en 1871 M. Lecoy de la Marche publia ce curieux document qu’il venait de recueillir, l’enquête de 1476 était à peu près inédite, et rien n’avait encore révélé la fausse Jeanne d’Arc de 1452. Il dut donc naturellement rattacher cette lettre de rémission à la dame des Armoises, et crut voir dans les mots, deux fois répétés, Jehanne de Sermaize une double altération du mot des Armoises, due à une inexactitude de lecture.
En présence aujourd’hui des révélations si formelles de l’enquête de 1476, j’ose espérer que M. Lecoy de la Marche et l’éminent auteur de l’Histoire de Jeanne d’Arc, qui a mentionné la découverte et reproduit l’interprétation de ce savant archiviste187, voudront bien modifier leurs premières appréciations. Ils reconnaîtront, j’en ai la confiance, que ce n’est pas à la dame des Armoises, mais réellement à notre Jeanne de Sermaize que s’applique la lettre de rémission de février 1457.
Tout l’indique, en effet, de manière à ne laisser aucun doute :
Jeanne de Sermaize, dit la lettre de rémission, s’était fait appeler par longtemps Jeanne la Pucelle. Or, près de quatre années semblent s’être écoulées entre ses agissements de 1452 et la répression judiciaire de 1456.
René, duc d’Anjou, était aussi duc de Bar ; c’était donc en ses États que la coupable imposture avait eu cours, et malgré les puissants appuis que paraît avoir eus cette jeune intrigante, c’était à lui, fidèle et respectueux compagnon d’armes de la Pucelle, qu’il appartenait, à tous les titres, de punir l’audacieuse usurpation de son souvenir et de son nom.
À quelle époque et pour quels motifs Jehanne de Sermaize, devenue femme de Jehan Douillet, quitta-t-elle le duché de Bar pour venir en Anjou ? Rien jusqu’ici ne nous le fait connaître ; mais il n’est pas invraisemblable qu’au moment où s’ouvraient, en 1456, dans les pays voisins, les enquêtes judiciaires pour la réhabilitation, elle ait compris que sa présence, en ces contrées, devenait un scandale public, et qu’elle ait jugé prudent de s’éloigner.
Peut-être, comme la dame des Armoises l’avait fait près de Charles VII, allait-elle à Angers demander grâce et merci à son prince, et peut-être les officiers de la justice de Saumur l’ont-ils arrêtée au passage, avant qu’elle n’ait pu parvenir jusqu’à lui.
La sentence de réhabilitation solennellement prononcée le 7 juin 1456, ayant mis fin désormais à toutes ces impostures, le duc René put céder, quelques mois après, à de vives sollicitations, et user de clémence envers la dernière usurpatrice du nom vénéré de la Pucelle d’Orléans. Il ne le fit toutefois qu’avec une prudente réserve, imposa à la coupable cinq années d’épreuve, lui défendit de porter des habits d’homme à l’avenir, et lui prescrivit de se porter honnestement, ainsi qu’il appartient à une femme de faire.
J’ai cru pouvoir arrêter quelque temps l’attention du lecteur sur un épisode oublié, où de proches parents de Jeanne d’Arc firent preuve d’une crédulité plus que naïve, et qui, d’après nos textes, paraît avoir eu, au cours du XVe siècle, un certain retentissement et une assez longue durée188.
Comme le dit avec raison M. Lecoy de la Marche, si répréhensibles que soient ces publiques impostures, elles ne sauraient être complètement dédaignées par l’histoire : la docilité des populations à les accueillir est encore un tacite hommage au souvenir du personnage illustre dont le nom est faussement usurpé.
En ce qui regarde particulièrement la vierge de Domrémy ; sa vie avait été si pure, sa mission si pleine de merveilles, le peuple l’avait tant de fois bénie, comme un ange envoyé du ciel, qu’il ne pouvait se faire a la pensée que cette pieuse et noble enfant eût achevé sa vie dans un horrible supplice. Il croyait facilement à un prodige que tant de bienfaits lui semblaient mériter.
§3. Information faite à Domrémy, le 16 août 1602, à la requête de Poiresson Tallevart, neveu de messire Pierre du Lis, pour établir ses droits successifs à l’héritage de Jean du Lis, seigneur de Villiers189.
J’ai textuellement publié190 ce grave document, inconnu à Charles du Lis, et récemment retrouvé au dépôt de nos archives nationales. J’ai essayé de faire ressortir l’importance des faits qu’il révèle sur la famille de la Pucelle. Je ne saurais rien ajouter à ce que j’ai dit à son égard.
§4. Informations faites en 1551, à la requête de la famille Le Fournier (de Normandie), pour établir ses liens de parenté avec la Pucelle.
§4.1 Enquête ouverte à Caen, le 13 janvier 1551. — Détails historiques recueillis en cette enquête191.
Aux termes de lettres-patentes octroyées à Rouen, en octobre 1550, en faveur de Robert Le Fournier, baron de Tournebut, de Lucas du Chemyn, son neveu, et de plusieurs de leurs parents et alliés, les baillis d’Orléans, de Blois, de Chaumont en Bassigny et de Caen, par ordre des gens des comptes du roi, ouvrirent, en l’année 1551, des enquêtes à l’effet de savoir si les membres de cette famille étaient réellement issus de la lignée de la Pucelle, et s’ils avaient droit aux privilèges et immunités nobiliaires concédés par Charles VII à Jeanne d’Arc et aux siens.
Le but de ces actes de notoriété est donc essentiellement privé, et une notable partie des dépositions, relative à la filiation des requérants, est sans intérêt historique. J’ai pu toutefois y recueillir quelques utiles renseignements sur la parenté de Jeanne d’Arc.
Le premier article du questionnaire, inscrit en tête du procès-verbal de Caen, indique à la fois l’objet de l’information et quelques-unes des inexactitudes qui déjà s’étaient accréditées.
… li sera demandé aux déposants : S’ils cognoissent ou ont pas ouysdire que de Jean d’Ay, prévôt d’Orléans (sic), frère de Jeanne d’Ay, [est issue une fille] qui, depuis, fut mariée à Jean de Villebresme, notaire et secrétaire du, roy, et dudit Jean sorty autre Jean, semblablement notaire et secrétaire du roy, et conseiller de Loys, duc d’Orléans, du depuis roy, et, dudit Jean, M. François de Villebresme, recepveur et conseiller de Loys, duc d’Orléans, du depuis Loys, roy, douzième de ce nom192, et si dudit François de Villebresme et de damoiselle Jehanne Brach et est pas issue damoiselle Marie de Villebresme, mariée avec Jacques Le Fournier, escuyer, sieur de Villambray…
Les autres articles du questionnaire ont trait à la filiation des membres de la famille Le Fournier et à la condition, depuis quelque temps exigée, d’avoir toujours vécu noblement.
L’enquête de Caen fut, le 13 janvier 1551, ouverte en cette ville, où demeuraient la plupart des membres de la famille. Pierre André, écuyer, licencié en droit, lieutenant général au bailliage, recevait les dépositions.
Vingt témoins furent entendus ; tous s’accordèrent à déposer qu’ils avaient personnellement connu Jacques Le Fournier, receveur des tailles à Caen, père et aïeul des requérants, et damoiselle Marie de Villebresme, son épouse. Marie de Villebresme, ajoutèrent-ils, née à Orléans, appartenait à une noble famille de cette ville, et, selon l’opinion générale, elle était de la lignée de Jehanne d’Ay, Pucelle d’Orléans, anoblie par Charles VII.
La plupart se firent toutefois un devoir de dire qu’ils ignoraient personnellement de quelle manière et à quel degré s’établissait cette parenté.
Aucune justification, en effet, n’est par eux produite, à l’appui de leur affirmation.
Mais, des vingt témoins entendus, pas un, je l’ai déjà remarqué193, ne dépose que Marie de Villebresme ait eu pour mère une Catherine du Lis, fille de messire Pierre, dont il n’est pas même question dans l’enquête.
Les uns, conformément au questionnaire présenté par la famille Le Fournier, déclarent que Marie de Villebresme était fille de François de Villebresme, receveur du domaine, et de damoiselle Jehanne Brachet ; d’autres, en termes moins précis, qu’elle était réputée avoir pour aïeul un Jean ou Louis de Villebresme, attaché à la maison d’Orléans, lequel aurait épousé une Jehanne d’Ay, fille de Jehan d’Ay, frère de la Pucelle… etc.
Tous, d’ailleurs, racontent que les requérants ont toujours vécu noblement, qu’ils possèdent de grands biens, ont chiens, chevaux et oiseaux de chasse, et vivent en relations habituelles avec la noblesse du pays, déclarations que, par suite des nouvelles exigences, nous retrouverons constamment dans les informations ultérieures.
Détails historiques recueillis en l’enquête de Caen.
Trois faits relatifs à la famille de Jeanne d’Arc ressortent donc des dépositions inscrites au procès-verbal de Caen :
En premier lieu, l’affirmation unanime, bien que dénuée de preuves, d’une alliance de la famille de Villebresme, attachée à la maison d’Orléans, avec une nièce de la Pucelle, généralement désignée par les témoins comme fille de Jean, prévôt de Vaucouleurs.
En second lieu, la tacite, mais formelle rectification de la tradition, accréditée par Charles du Lis194, qu’une fille de messire Pierre, nommée Catherine, aurait épousé un François de Villebresme, receveur du domaine à Orléans, et serait mère de Marie de Villebresme, femme de Jacques Le Fournier. Les vingt déposants à l’enquête faite sous les yeux de la famille Le Fournier, et les Le Fournier eux-mêmes dans leur questionnaire, gardent un silence absolu sur cette Catherine du Lis, et attribuent à Marie de Villebresme une autre origine.
En troisième lieu, l’altération dans les dépositions des témoins, et jusque dans le questionnaire, du nom de du Lis, constamment écrit sous la forme Day, même quand il s’agit de la Pucelle. Cette altération n’est pas spéciale au pays normand ; nous la retrouverons dans des enquêtes ultérieures, faites en des contrées différentes.
§4.2 Enquête ouverte à Vaucouleurs, bailliage de Chaumont en Bassigny, le 13 avril 1551. — Détails historiques recueillis en cette enquête195.
Peu de temps après, au mois d’avril 1551, à la requête encore des Le Fournier, en exécution des mêmes lettres-patentes et des mêmes prescriptions de la chambre des comptes, une nouvelle information s’ouvrait à Vaucouleurs et formait, en quelque sorte, le complément de la précédente.
À Caen, les déposants avaient affirmé que, par son mariage avec une Orléanaise, damoiselle Marie de Villebresme, issue, selon la commune renommée, d’une fille de Jean, frère de la Pucelle, Jacques Le Fournier, père et aïeul des requérants, avait acquis pour lui et ses descendants les immunités accordées à la postérité masculine et féminine de Jeanne d’Arc.
À Vaucouleurs, les témoins déposent, à leur tour, qu’après que Jeanne eut quitté Domrémy, ses frères abandonnèrent aussi leur pays pour la suivre, puis fixèrent leur résidence, soit temporairement en diverses provinces, soit définitivement dans l’Orléanais.
Ces faits, connus d’ailleurs, sont, dans les déclarations des témoins, accompagnés de détails tellement confus et inexacts, qu’on a peine à s’expliquer qu’aux lieux où la mémoire de Jeanne d’Arc et des siens semblait devoir être plus fidèlement conservée, un siècle seulement d’intervalle ait pu si profondément en altérer le souvenir.
La plupart des témoins confondent, en effet, dans leurs dépositions, les lieux, les personnes et les choses. Ils font, voyager en France Jacquemin, qui paraît n’avoir pas quitté son village. Ils ont presque tous oublié que Jean fut prévôt de Vaucouleurs, et s’accordent à raconter qu’un des trois frères, nommé Jean par les uns, et dont les autres ne savent plus le nom, fut prévôt d’Orléans, y acquit de grandes richesses et y contracta un brillant mariage. Deux ou trois ont entendu dire que de ce mariage étaient issues deux filles, alliées, plus tard, à de nobles et opulentes maisons, etc., etc.196.
Mais lorsque, échappant à ces faits d’ordre général, où leurs récits s’égarent, les déposants viennent à parler de choses qui leur sont personnelles, leurs témoignages, devenus ainsi quasi-oculaires, acquièrent une tout autre valeur et donnent, sur la famille de Jeanne d’Arc, quelques intéressants détails.
Détails historiques recueillis dans l’enquête de 1551, à Vaucouleurs.
Quatre témoins : Didon Daly et Anne Daly, sa sœur, François de Boissy, praticien, et François Hurlet, prêtre, y déclarent, sous la foi du serment, être enfants ou petits-enfants de noble homme Claude du Lis et de Nicolle Thiesselin, sa femme. Ces quatre dépositions si formelles semblent rectifier péremptoirement l’assertion, jusqu’à ce jour constamment reproduite, que ce neveu de la Pucelle était mort sans postérité197.
Didon et Anne Daly nous apprennent encore que la fille de Jacquemin, mère de Claude, se nommait Jeanne.
Elles confirment la déclaration faite par Claude lui-même, dans l’enquête de 1502, qu’en sa jeunesse il avait passé plusieurs années chez son oncle messire Pierre, à quelques lieues d’Orléans. Elles témoignent, enfin, des bons rapports existant entre les membres des diverses branches ; des visites qu’ils se rendaient mutuellement, tant à Orléans qu’à Domrémy, malgré la longueur du voyage, et du bon vin Orléanais dont messire Pierre aimait à faire présent à ses parents.
L’altération, dans le langage vulgaire, du nom de du Lis, déjà signalée en l’enquête de Caen, se remarque également en celle de Vaucouleurs ; mais elle y est moins uniforme et moins constante, et l’on voit le même personnage désigné tantôt sous le nom altéré de Day ou Daly, tantôt sous le vrai nom de du Lis.
§4.3 Enquêtes d’Orléans et de Blois (à la même requête et en la même année 1551).
Deux autres informations, en cette même année 1551, furent faites à Orléans et à Blois, toujours à la requête de la famille Le Fournier, et dans des conditions semblables à celles de Caen et de Vaucouleurs.
Les procès-verbaux de ces deux enquêtes ont échappé à mes recherches. Celui de Blois paraît avoir complètement disparu. Celui d’Orléans fut connu de Charles du Lis, qui le cite en son Traité sommaire ; mais il n’existe plus en nos archives départementales, et M. de Maleissye, malgré ses bienveillantes investigations, n’a pu le retrouver encore parmi les titres qu’il possède.
La perte de l’enquête de Blois semble médiocrement regrettable, les du Lis ayant peu séjourné en cette ville ; mais, bien qu’en 1551 la branche orléanaise de cette noble famille eût, depuis près d’un demi-siècle, presque entièrement disparu de notre province, et n’eût plus de représentants que les descendants peu connus de Marguerite du Lis et d’Antoine de Brunet, il ne serait pas impossible que des faits intéressants et maintenant oubliés eussent été consignés en cette information. Espérons donc que quelque expédition égarée pourra se retrouver un jour198.
§5. Information faite à Vaucouleurs, le 8 octobre 1555, à la requête de Jean Royer, descendant d’Aveline, sœur d’Isabelle Romée. — Détails historiques recueillis en cette enquête199.
En l’année 1555, Jean Royer, se disant arrière-petit-fils de Demange Le Vauseul200, fils lui-même d’Aveline le Vauseul, sœur d’Isabelle Romée, fut admis, sur requête, à prouver authentiquement qu’il était de la parenté de la Pucelle.
En conséquence, le 8 octobre 1555, par commission de messeigneurs des comptes à Paris, Jean de Gondrecourt, écuyer, lieutenant particulier au bailliage de Chaumont, en présence du procureur du roi, Guillaume de Rivière, ouvrit, en l’hôtel de Didier Gérardin, à Vaucouleurs, une information sur les faits affirmés en la demande.
Dix témoins y furent entendus. Leur âge, leur caractère, la concordance de leurs récits, donnent à cette enquête une incontestable autorité. Charles du Lis eut l’heureuse pensée d’en lever une expédition régulière, dont il publia seulement quelques extraits201. Nous lui devons ainsi de posséder aujourd’hui des notions précises sur cette branche collatérale de la famille de Jeanne d’Arc.
J’emprunte à la déposition du premier témoin, confirmée de tous points et complétée par les neuf autres, les données essentielles de cette filiation :
Martin Gilbert, lieutenant du maïeur pour le roy notre sire au lieu de Chalaines202, dit qu’il a connoissance qu’une nommée Aveline, que l’on disoit sœur de la mère de Jehanne ; la Pucelle, épousa un nommé Jehan Le Vauseul, duquel mariage seroit né un fils nommé Demange Le Vauseul, demeurant à Burey en Vaulx203, cousin germain de ladite Pucelle.
Lequel Demange Le Vauseul auroit été conjoint par mariage avec une nommée Ydotte Voynand, duquel mariage seroit issu un nommé Jehan Le Vauseul… lequel se disoit cousin remué de germain de la Pucelle et étoit réputé tel.
Lequel Jehan Le Vauseul fut conjoint par mariage avec une nommée Mongeotte, duquel mariage seroit issue une fille nommée Mongeotte Le Vauseul, mère du suppliant…
Dit aussi avoir connoissance de Jehanne Le Vauseul, sœur de Demange Le Vauseul, laquelle étoit de son vivant, comme ledit Demange Vauseul, cousine germaine de la Pucelle, comme étant fille de ladite Aveline, sa tante. Laquelle Jehanne fut mariée avec un nommée Durand Lassois204, demeurant audit Burey, duquel mariage seroit issu un nommé Thibault Lassois, dit le Noble, demeurant à Sauvoy, lequel le déposant a connu et fréquenté. Et est recors que, y a trente ans, ledit déposant étant collecteur de certaines tailles, ledit Thibault, comme l’un des habitants dudit Sauvoy, y fut imposé, d’où procès devant le bailli de Chaumont entre Thibault et les habitants.
Lequel Thibault gagna son procès, et fut exempt, depuis lors, comme parent de la Pucelle, ainsi que Nicolle Lassois, surnommée la Noble, sa fille.
Dit que ledit Jehan Royer, suppliant, est fils de Médard Royer, maire de Chalaines pour le roy, et de Mongeotte Vauseul, lesquels eurent six enfants, desquels l’un, Jehan Royer, après avoir suivi les armes, est aujourd’hui praticien au Châtelet du roy, non marié, et demeurant en la maison d’un procureur au Châtelet de Paris205.
Le tableau synoptique ci-annexé206, dans lequel j’ai tâché de réunir les renseignements généalogiques recueillis sur cette branche collatérale, me dispense de plus longs détails.
L’enquête de 1555 en a fourni la meilleure part. Elle nous révèle, en outre, quelques faits particuliers qu’il n’est pas sans intérêt de signaler ici.
§5.1 Détails historiques recueillis dans l’enquête de 1555, à Vaucouleurs.
Il ressort tout d’abord, de l’ensemble des témoignages, que cette famille de cultivateurs vivait groupée, à peu de distance de Domrémy, dans le petit village de Burey-en-Vaux (Burey-le-Petit, comme on l’appelait alors). Ceci fait mieux comprendre comment Jeanne d’Arc, peu avant son départ, pressée par ses voix d’accomplir sa glorieuse mission, mais profondément affligée du mécontentement de son père, alla passer quelques semaines à Burey, près de sa tante Aveline et de sa cousine germaine, Jeanne Le Vauseul, femme de Durand Laxart, qui l’aimaient tendrement. Par une singulière coïncidence, elles étaient alors enceintes l’une et l’autre207.
Durand Lassois, mentionné dans l’enquête de 1555 comme cousin germain de la Pucelle, paraît, selon toute vraisemblance, n’être autre que le vingt-cinquième témoin de l’enquête pour la réhabilitation, Durand Laxart, qui, sous le titre d’oncle, conduisit Jeanne d’Arc au capitaine Baudricourt, assista à Reims au sacre de Charles VII, etc.
Durand Laxart, en sa déposition de 1456, déclare être laboureur à Burey-le-Petit, âgé, à cette époque, d’environ soixante ans (dès lors de trente à trente-deux ans en 1428) et, par sa femme Jeanne, être parent de la Pucelle ; il était allé, dit-il, chercher Jeanne d’Arc à Domrémy chez son père, l’avait amenée à Burey près de sa femme enceinte, et, après l’avoir affectueusement accueillie durant plusieurs semaines, l’avait accompagnée chez Baudricourt208.
Durand Lassois, de l’enquête de 1555, était également, en 1428, laboureur à Burey-le-Petit ; récemment marié à Jeanne, fille d’Aveline, il était, par sa femme, parent de Jeanne d’Arc ; lui aussi avait vécu quelque temps près d’elle, alors qu’au dire des témoins elle demeurait à Burey, chez sa tante, avant d’aller trouver le capitaine de Vaucouleurs.
Une telle similitude, à la même date, de prénoms, d’âge, d’alliance, de profession et de résidence, ne semble-t-elle pas révéler en Durand Laxart et Durand Lassois un seul et même personnage ?
La légère différence des noms Laxart en 1456, et Lassois en 1555, peut facilement s’expliquer, à plus d’un siècle d’intervalle, soit par une de ces altérations locales dont on a déjà vu plusieurs exemples, soit par une inexactitude des greffiers du procès ou de l’enquête.
Quant à la qualification d’oncle de la Pucelle, donnée à Durand Laxart par quatre témoins de l’information de 1456209 et par Jeanne d’Arc elle-même, en son interrogatoire du 22 juin 1431210, on voit ici qu’elle n’est pas parfaitement exacte, et que Durand Laxart (ou Lassois) n’était pas oncle de la Pucelle, dans le sens vrai du mot, mais seulement son cousin germain par alliance.
Cette dissemblance, sérieusement étudiée, n’est pas d’une haute gravité.
L’enquête du 2 novembre 1476, à Vitry, offre deux exemples de ce mot d’oncle ainsi entendu : Mengotte, fille de Jean (de Vouthon), dès lors nièce d’Isabelle Romée, y qualifie du nom d’oncle son cousin germain, Pierre du Lis ; et réciproquement, Pierre du Lis y donne le titre de neveu à son cousin issu de germain, Henri (de Vouthon), dit Perrinet, qu’il emmenait à Orléans pour l’aider dans la construction d’une maison qu’il y voulait bâtir211.
L’enquête du 13 avril 1551 à Vaucouleurs en fournit encore un exemple : Jacques Robert, époux de la seconde fille d’Aveline, et dès lors cousin germain de la Pucelle, comme l’était Durand Lassois, son beau-frère, est également appelé oncle de Jeanne d’Arc, par l’un des déposants, Blaize Barrois (de Burey-en-Vaux).
Cette affectueuse qualification d’oncle semble donc avoir été, à cette époque et dans ces contrées, un simple titre de courtoisie, donné par déférence à des cousins germains plus avancés en âge212.
Hallouy Robert, petite-fille d’Aveline, raconte, en déposition citée plus haut (chapitre XII), que lorsque Jeanne d’Arc se préparait à quitter Domrémy, elle vint demander à sa tante Aveline, alors enceinte, que, si elle accouchait d’une fille, elle lui donnât le nom de Catherine, en soubvenance de feue Catherine, sa sœur, niepce de ladite Aveline… tellement que la mère d’elle déposante fut appelée et nommée Catherine…
Un frère de Hallouy Robert, Jacob Robert, laboureur à Burey-en-Vaux, entendu dans les deux enquêtes de Vaucouleurs, en 1551 et 1555, est, sur ce point, en désaccord avec sa sœur. Il déclare, dans l’information de 1551, que leur mère Catherine accompagnait la Pucelle quand elle se présenta devant Baudricourt.
Une simple comparaison de dates suffit à faire reconnaître que les souvenirs de Jacob Robert étaient inexacts.
D’après le témoignage d’Hallouy Robert, Catherine Le Vauseul, sa mère, aurait vu le jour en 1428 ou 1429. Si l’on admet, au contraire, avec Jacob Robert, qu’elle ait accompagné Jeanne chez Baudricourt, elle ne pouvait avoir moins de douze à quinze ans alors, ce qui reporterait sa naissance vers 1412 ou 1415.
Or Jacob Robert, dans sa déposition de 1551, se dit âgé d’environ soixante-douze ans, d’où résulte qu’il serait né vers 1479. Si Catherine, sa mère, fût née en 1412 ou 1415, elle aurait eu soixante-quatre ans au moins quand, en 1479, ce fils Jacob serait venu au monde.
Une telle invraisemblance assure, au récit d’Hallouy Robert, une préférence qu’il paraît, au surplus, mériter à tous égards.
§6. Information faite à Toul, le 7 Juin 1596, à la requête de Me Jean Hordal, professeur à l’Université de Pont-à-Mousson, pour justifier de sa noblesse et de son extraction d’un frère de la Pucelle213.
J’ai peu de détails à ajouter à ce que j’ai déjà dit de cette enquête et des lettres-patentes octroyées à la suite214. Jean Hordal, conseiller d’État de Lorraine, docteur en droit et l’un des quatre professeurs en l’Université de Pont-à-Mousson215, avait affirmé, par requête, qu’il descendait d’un des frères de la Pucelle. Balthazar Crock, poursuivant d’armes de S. A. le duc Charles de Lorraine, en vertu de la commission du comte de Salm, gouverneur de Nancy, ouvrit donc, à Toul, le 7 juin 1596, une information pour recueillir les preuves qu’Hordal voudrait produire à l’appui de sa déclaration.
Les témoins, je l’ai déjà fait connaître, déposèrent presque unanimement que les Hordal avaient toujours été réputés tenir à la famille de Jeanne d’Arc, et même s’étaient habituellement servis de ses armoiries pour leurs cachets. Plusieurs déclarèrent, de plus, avoir ouï dire qu’Étienne Hordal, bisaïeul du requérant, avait épousé une nommée Hauvy ou Hallouy, qui descendait d’un frère de la Pucelle ; deux ou trois ajoutèrent, mais sans nulles preuves ni aucuns détails à l’appui, qu’Hauvy était fille de Pierre Day, fils lui-même de Jacques Day et d’Isabeau, son épouse.
J’ai rappelé qu’à la suite de cette enquête, le duc de Lorraine, par lettre du 10 juillet 1596, considérant qu’il y avait apparence vraisemblable que Me Jehan Hordal étoit issu de la parenté de la Pucelle, l’avait anobli, lui et ses descendants, avec autorisation de porter les armoiries de Jeanne d’Arc216.
Je n’ai nulle pensée, assurément, de mettre en doute l’illustre origine des Hordal, consacrée par une possession trois fois séculaire et un titre émané de l’autorité souveraine.
La seule question qu’il importait d’examiner était de savoir si Hauvy (Hallouis ou Helvide), bisaïeule du requérant, était réellement fille de Pierre du Lis.
J’aurais regardé comme une heureuse fortune de pouvoir rattacher à notre branche orléanaise cette honorable famille des Hordal, si chaleureusement dévouée à notre sainte héroïne ; mais l’inexorable logique des documents et des faits est venue, on ne l’a pas oublié, opposer à cette thèse généalogique des difficultés insurmontables. Après un long examen, j’ai dû m’incliner devant la vérité.
Il me reste donc seulement à signaler, en cette enquête, l’altération persistante du nom de du Lis sous une nouvelle forme, Dailly, mêlée, dans quelques dépositions, aux variantes déjà signalées de Day et de Dalix, et au nom régulier de du Lis.
§7. Enquêtes et revendications postérieures au XVIe siècle.
Le but que j’ai désiré atteindre, en ce travail, est, je ne saurais trop le redire, exclusivement historique. J’ai tenté, dans la mesure de mes forces, de projeter quelque nouvelle lumière sur les origines, mais sur les origines seulement de la parenté de la Pucelle, je veux dire sur les premières et lointaines générations de celle noble race.
La fin du XVIe siècle a donc semblé la limite naturelle imposée à mes recherches. — Cette limite, je n’ai pas dû la dépasser.
À partir du XVIe siècle, la solution des questions généalogiques change, en effet, de forme et d’aspect. La tenue régulière des registres de l’état-civil fournit aux investigations, quel qu’en soit l’objet, des éléments certains, dont l’appréciation appartient aux études administratives ou judiciaires, bien plus qu’à celles de l’histoire.
Plein de respect pour les droits des honorables familles qui prétendent rattacher leur filiation à notre incomparable Jeanne, j’applaudis à leurs légitimes efforts ; mais, à aucun titre et en quoi que ce soit, il ne me convient d’y intervenir.
J’ai donc pris à tâche de rester complètement étranger à toutes questions d’intérêt privé, naturellement en dehors de ma compétence.
C’est pour la critique historique un devoir et un bonheur de se maintenir en ces régions sereines, où des déductions complètement impersonnelles n’ont d’autre objectif que la recherche impartiale de la vérité.
XVII Altération, en quelques provinces, du nom de du Lis
Jeanne, dans ses interrogatoires, avait déclaré que le nom de son père était d’Arc et que ce nom était également le sien, bien que, suivant l’usage du pays, on l’appelât souvent Romée, comme sa mère217.
Ce nom, jusqu’alors inconnu, qu’elle avait, en quelques mois, couronné d’un éclat immortel, resta fidèlement conservé, dans les actes officiels, tels que les lettres d’anoblissement, les procès de condamnation et de réhabilitation, etc. ; mais bientôt, dans diverses provinces, il parut, durant quelque temps, disparaître peu à peu du langage habituel et presque des souvenirs.
Pour le peuple, et particulièrement pour nos populations des rives de la Loire, l’héroïque enfant de Domrémy fut toujours Jeanne la Pucelle. C’est sous ce nom simple et charmant que nous la trouvons habituellement désignée dans ses lettres missives, ses interrogatoires et nos vieux textes Orléanais.
Ses frères, peu après les lettres d’anoblissement, s’empressèrent, à leur tour, de substituer à leur nom patronymique celui de du Lis, qui devenait pour eux le vivant témoignage des glorieuses armoiries que leur avait octroyées Charles VII218.
Jean, désigné en 1430, dans les comptes communaux d’Orléans, sous le nom de frère de la Pucelle, y est, dès le 21 août 1436, appelé Jehan du Lis.
Pierre, peu après son arrivée à Orléans, en 1440, est inscrit dans le bail de Bagneaux et dans les lettres de concession de l’Île-aux-Bœufs sous le nom de messire Pierre du Lis, qui, depuis lors, lui fut continué, Sans altération, à lui et aux siens.
Cette nouvelle dénomination ne tarda pas à pénétrer en Lorraine, soit par Jean, qui paraît y avoir eu son principal séjour, soit par Jacquemin peut-être ; car, à défaut d’actes émanés de lui, nous ignorons réellement s’il la prit et la porta comme ses frères ; mais à peine cet honorable surnom y était-il connu que, sous l’influence des locutions vicieuses du patois lorrain, il se déforma, dans le langage usuel, en de nombreuses variantes.
Ainsi, dans une lettre de rémission donnée à Saint-Mihiel en Barrois, le 23 mai 1445, Pierre du Lis est déjà appelé Pierre Dalix, chevalier, frère de Jeanne la Pucelle219.
En janvier et février 1456, dans deux actes officiels des enquêtes pour la réhabilitation, auxquelles Jean dut participer, à titre de prévôt de Vaucouleurs, il est nommé Johannes Dalie præpositus, et ce même nom de Dalie lui est donné dans la déposition d’un témoin cité à sa requête, Nicolas Bailly, lieutenant du prévôt d’Andelot220.
Michel Montaigne, racontant un voyage fait par lui en 1580, écrit
qu’à Domrémy-sur-Meuse, à trois lieues de Vaucouleurs, d’où estoit native cette fameuse Pucelle d’Orléans qui se nommoit Jeanne d’Ay ou Dallis, ses descendants lui monstrèrent la maisonnette où elle naquit et les armes que le roy leur donna, qui sont : d’azur à une espée droite, couronnée et poignée d’or, et deux fleurs de lys d’or au costé de la dicte espée221…
Les enquêtes, de Caen et de Vaucouleurs, en 1551, et celle de Toul en 1596, nous ont enfin révélé les nombreuses variantes de ce nom historique si étrangement défiguré222.
Cette erreur, comme tant d’autres, se propageait donc de proche en proche, substituant au noble surnom de la famille d’Arc les formes bizarres et multiples, de Dalix, Dalie, Daily, Dailly, Day, etc.
Il est juste toutefois de remarquer que la véritable dénomination se maintint en son intégrité dans plusieurs autres provinces, en notre Orléanais par exemple, et dans divers actes publics, tels que l’enquête de 1502 à Vaucouleurs.
L’altération du nom de du Lis paraît avoir pénétré en Normandie à la suite d’alliances matrimoniales entre des branches de Lorraine et d’honorables familles normandes. Elle s’y enracina de telle sorte, que dans l’enquête de Caen, ainsi que je l’ai fait remarquer223, la locution Day est seule employée par tous les témoins sans exception, et même dans le questionnaire officiel.
Cette déformation, passée en habitude, a donné lieu à un grave incident dont je dois dire quelques mots.
Les lettres d’anoblissement, ce titre essentiel de la famille, ne furent longtemps connues, en l’absence de l’original, que par une expédition insérée, en 1550, au Trésor des chartes (registre 260, page 306). Elles furent plusieurs fois imprimées d’après cette source unique, d’abord par P. Grégoire, mort en 1597224, puis par Hordal, Godefroy, de La Roque, et quelques autres, et l’on s’étonnait, non sans raison, que le nom historique d’Arc y fût constamment écrit sous la forme altérée Day.
L’éminent éditeur des procès de condamnation et de réhabilitation, en reproduisant, à son tour, dans son savant recueil, cette pièce importante, d’après le seul texte connu alors, crut devoir exprimer sa surprise d’une telle altération dans un document si capital225.
La découverte faite en 1853, par M. Vallet de Viriville, dans ses laborieuses recherches aux archives nationales, d’une nouvelle expédition plus authentique et plus correcte que la première, a donné l’explication de cette anomalie.
Après l’incendie qui, en octobre 1737, détruisit une partie des archives de la chambre des comptes de Paris, une déclaration du roi, du 26 avril 1738, ordonna à tous les détenteurs de titres, ayant trait aux attributions de ce corps judiciaire, de les représenter, afin que des copies vérifiées et collationnées reconstituassent, autant que possible, ces précieuses archives.
L’original des lettres d’anoblissement se trouvait, en 1610, au témoignage de Charles du Lis, entre les mains d’un membre de la famille habitant la Normandie226. Cet original, conformément à la déclaration du roi, fut représenté, paraît-il, au conseiller-maître, commis à ces fonctions par la chambre des comptes. Copie collationnée en fut faite ; et, sous là cote K, 65, no 9, de la section historique des archives, M. Vallet de Viriville retrouva cette expédition officielle, où le nom d’Arc est constamment inscrit dans son exacte régularité.
La copie fautive, seule connue jusqu’en 1853, avait donc été insérée, en 1550, au Trésor des chartes, sur la requête de Robert Le Fournier, baron de Tournebut, habitant de Caen, dépositaire de l’original des lettres d’anoblissement, lorsque, pour se soustraire au paiement des droits de francs-fiefs et de nouveaux acquêts, il s’efforçait de justifier qu’il en devait être exempt, comme issu et descendu de la lignée de la Pucelle.
Le baron de Tournebut ; dit M. Vallet de Viriville, ne connaissait probablement pas le nom véritable de l’illustre race à laquelle il prétendait appartenir. Surpris de le trouver écrit d’Arc sur le diplôme, il y fit substituer, sur la copie par lui produite, celui de Day, attendu qu’en 1550 ce nom était, dans l’usage du pays normand qu’il habitait, le nom habituel de la famille à laquelle il lui importait de se rattacher227…
Ainsi, les Le Fournier, qui, dans leurs traditions un peu trop légendaires, avaient déjà gratifié messire Pierre du Lis d’une fille qui ne peut lui appartenir, eurent, durant un temps assez long, le singulier privilège d’avoir doté la famille elle-même d’un nom qui n’était pas le sien…
XVIII Tableaux généalogiques annexés à cette étude historique
Quelques personnes ont pensé que des tableaux synoptiques, groupant sous un seul aspect les faits généalogiques successivement appréciés au cours de cette étude, en rendraient l’intelligence plus facile.
J’ai fait droit à ces bienveillants conseils.
Un premier tableau retrace fidèlement le système accrédité, sur la parenté de la Pucelle, par l’avocat général Charles du Lis228, accepté depuis par M. Vallet de Viriville229, et qui, sur la foi de ces deux noms justement autorisés, a acquis une sorte de possession d’état, jusqu’à nos jours.
De précieux documents contemporains étaient restés inconnus à Charles du Lis. M. Vallet de Viriville, qui consacra à Jeanne d’Arc et à son époque une si haute érudition et de si consciencieuses recherches, n’eut pas l’heureuse fortune de les découvrir et n’apporta que peu d’éléments nouveaux à la thèse de l’honorable avocat général.
Une série de notes signale à l’attention du lecteur les points aujourd’hui contestés.
Un second tableau résume aussi exactement que possible, en ce qui concerne la descendance directe des père et mère de la Pucelle, l’ensemble des déductions émises au cours de ce travail, savoir :
1° La série des générations durant le XVe siècle et partie du XVIe ;
2° Les modifications proposées à plusieurs affirmations jusqu’à présent acceptées ;
3° Les documents anciens ou nouveaux sur lesquels s’appuient ces rectifications, et les divers chapitres en lesquels ces textes contemporains sont reproduits et étudiés.
Un troisième et dernier tableau, divisé en deux parties, est spécialement consacré à la descendance collatérale du frère et de la sœur d’Isabelle Romée : Jehan (de Vouthon) et Aveline Le Vauseul, oncle et tante de la Pucelle.
Les détails compris en ces deux filiations distinctes sont presque entièrement puisés dans les précieuses enquêtes de Vitry et de Vaucouleurs en 1476 et 1555. Charles du Lis, à qui nous en devons la conservation, en a publié dans son Traite sommaire (chap. II) les principaux résultats. J’ai cru devoir les compléter.
Bien que ces généalogies collatérales semblent, au premier abord, s’écarter un peu du but de mon travail, elles y touchent en tant de points, qu’elles m’ont paru n’y être pas réellement étrangères.
Aucun de ces tableaux ne dépasse la fin du XVIe siècle, limite assignée à mes recherches.
XIX Conclusion
Une doublé pensée m’a soutenu au cours de cette étude, qui n’a pas été sans labeur.
Des liens si étroits rattachent la mémoire de la vierge de Domrémy à celle dès protecteurs et des amis de Son enfance, que leurs mutuels souvenirs se complètent souvent l’un par l’autre.
En essayant, à l’aide de documents nouveaux, de reconstituer, en leurs principaux détails, les origines de la famille de Jeanne d’Arc, j’ai cru acquitter envers Jeanne elle-même mon humble tribut de reconnaissance et de respect.
Il m’a semblé d’ailleurs qu’une race historique, honorée par l’autorité royale de prérogatives nobiliaires sans exemple dans l’histoire, méritait, ne fût-ce qu’à ce titre, un examen approfondi.
Je ne me suis pas dissimulé les difficultés de ma tâche ; conduit, par l’impérieuse logique des textes et des faits, à combattre des opinions accréditées par des auteurs justement renommés, acceptées, de nos jours, par des savants pour lesquels je professe une respectueuse déférence, j’ai dû me faire un devoir de ne rien affirmer qui ne me parût s’appuyer sur des déductions rigoureuses et des titres clairs et certains.
Les solutions inattendues que ces textes authentiques ont imposées à ma conviction, je ne les avais assurément pas appelées de mes vœux.
Ce n’est pas sans regret que j’ai vu s’éteindre, en 1501, cette branche orléanaise des du Lis, dont le séjour en notre province y personnifiait de chers et glorieux souvenirs. J’eusse été heureux que la descendance de notre messire Pierre d’Arc eût perpétué jusqu’à nous le nom de notre admirable Jeanne, et j’ai du moins éprouvé quelque joie qu’un nouveau rameau de cette noble tige, uni à notre vieille famille des Cailly, vînt s’épanouir, un siècle après, sur notre sol. Uno avulso non deficit alter. Mais la sincérité de l’histoire ne saurait se plier à des vœux non plus qu’à des regrets personnels ; et, guidé par le seul amour de la vérité, j’ai dû suivre la voie que me traçaient des faits incontestables et des documents précis.
Je n’avais pu voir, non plus, sans douleur, d’honorables historiens incliner à croire que, tandis que nos Orléanais vouaient à leur immortelle libératrice un culte religieux et public, ils avaient, durant de longues années, laissé près d’eux la mère, le frère, les neveux de l’héroïque jeune fille dans une situation voisine de l’indigence, à peine adoucie par quelques charitables aumônes.
J’avais la ferme conviction qu’il n’en avait pas été ainsi ; que des textes mal interprétés, que des légendes sans autorité avaient altéré l’exactitude de l’histoire, et qu’il devait suffire d’interroger avec plus de soin les monuments contemporains, pour en faire jaillir des déductions plus dignes de la cité de Jeanne d’Arc.
Sur ce point, mon attente n’a pas été trompée.
Les textes formels, que de longues recherches et de bienveillantes communications m’ont permis de mettre en lumière, ont unanimement révélé que la famille de la Pucelle avait joui, à la fois, en notre province, d’une légitime considération et d’une douce aisance, fruit d’un paisible et honorable labeur.
Mes vœux à cet égard étaient dès lors accomplis ; je n’aurai donc pas à regretter quelques sérieuses études, s’il m’a été donné de rectifier de regrettables erreurs et de montrer, par d’incontestables témoignages, qu’Orléans a su remplir tous les devoirs de sa religieuse gratitude.
Ce travail était déjà sous presse, lorsqu’à paru récemment l’excellent ouvrage de MM. de Bouteiller et de Braux : La famille de Jeanne d’Arc, documents inédits, généalogies, etc. (Paris, 1878.)
Sous des titres presque semblables, le but que se sont proposé ces consciencieux historiens diffère sensiblement de celui que j’ai cherché à atteindre ; mais sur les questions essentielles qui font l’objet de nos communes recherches, j’ai vu, avec une vive satisfaction, leurs convictions motivées, bien qu’exprimées avec une délicate réserve, se rapprocher beaucoup des miennes.
Je ne dois donc pas seulement à MM. de Bouteiller et de Braux une sincère reconnaissance pour leurs communications si précieuses ; je tiens surtout à honneur d’appuyer mes modestes travaux sur leurs graves et savantes appréciations.
Tableaux généalogiques
- Premier tableau : descendance directe de Jacques d’Arc et d’Isabelle Romée d’après Charles du Lis
- Deuxième tableau : descendance directe d’après les titres authentiques et contemporains, récemment découverts
- Troisième tableau : branches collatérales de la famille de Jeanne d’Arc
Premier tableau
Descendance directe de Jacques d’Arc et d’Isabelle Romée, père et mère de la Pucelle, durant le XVe siècle et partie du XVIe.
Inexactement établie par l’avocat-général Charles du Lis, dans son Traité Sommaire, et dans les Lettres-patentes du 35 octobre 1612, d’après les documents incomplets, seuls connus alors, et toutefois reproduite par M. Vallet de Viriville dans ses Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d’Arc.
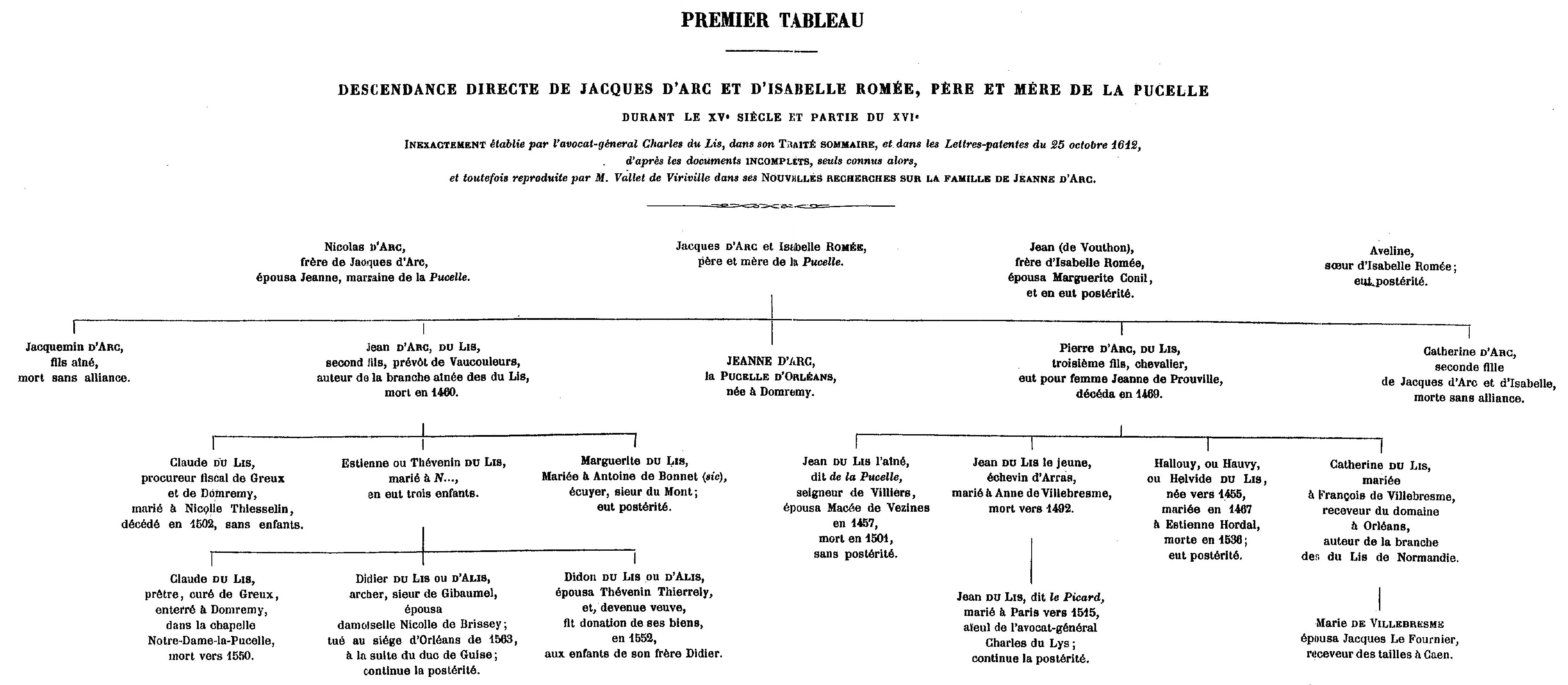
- Nicolas d’Arc
Frère de Jacques d’Arc, épousa Jeanne, marraine de la Pucelle.
- Jacques d’Arc et Isabelle Romée
Père et mère de la Pucelle.
- Jacquemin d’Arc230
Fils aîné, mort sans alliance.
- Jean d’Arc, du Lis231
Second fils, prévôt de Vaucouleurs, auteur de la branche aînée des du List, mort en 1460.
- Claude du Lis234
Procureur fiscal de Greux et de Domrémy, marié à Nicolle Thiesselin, décédé en 1502, sans enfants.
- Étienne ou Thévenin du Lis
Marié à N…, en eut trois enfants.
- Claude du Lis
Prêtre, curé de Greux, enterré à Domrémy, dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Pucelle, mort en 1550.
- Didier du Lis ou d’Alis
Archer, sieur de Gibaumel, épousa damoiselle Nicolle de Brissey ; tué au siège d’Orléans de 1563, à la suite du duc de Guise ; continua la postérité.
- Didon du Lis ou d’Alis
Épousa Thévenin Thierrely, et, devenue veuve, fit don de ses biens, en 1552, aux enfants de son frère Didier.
- Claude du Lis
- Marguerite du Lis
Marié à Antoine de Bonnet (sic), écuyer, sieur du Mont ; eut postérité.
- Claude du Lis234
- Jeanne d’Arc
La Pucelle d’Orléans, née à Domrémy.
- Pierre d’Arc, du Lis232
Troisième fils, chevalier, eut pour femme Jeanne de Prouville, décéda en 1469.
- Jean du Lis l’aîné, dit de la Pucelle
Seigneur de Villiers, épousa Macée de Vézines en 1457, mort en 1501, sans postérité.
- Jean du Lis le jeune235
Échevin d’Arras, marié à Anne de Villebresme, mort vers 1492.
- Jean du Lis, dit le Picard
Marié à Paris vers 1515, aïeul de l’avocat général Charles du Lys ; continue la postérité.
- Jean du Lis, dit le Picard
- Hallouy, ou Hauvy, ou Helvide du Lis236
Née vers 1455, mariée en 1467 à Estienne Hordal, morte en 1536 ; eut postérité.
- Catherine du Lis237
Mariée à François de Villebresme, receveur du domaine à Orléans, auteur de la branche des Lis de Normandie.
- Marie de Villebresme238
Épousa Jacques Le Fournier, receveur des tailles à Caen.
- Marie de Villebresme238
- Jean du Lis l’aîné, dit de la Pucelle
- Catherine d’Arc233
Seconde fille de Jacques d’Arc et Isabelle, morte sans alliance.
- Jacquemin d’Arc230
- Jean (de Vouthon)
Frère d’Isabelle Romée, épousa Marguerite Conil et en eut postérité.
- Aveline
Sœur d’Isabelle Romée, eut postérité.
Deuxième tableau
Descendance directe de Jacques d’Arc et d’Isabelle Romée, père et mère de la Pucelle, durant le XVe siècle et partie du XVIe.
D’après les titres authentiques et contemporains, récemment découverts. (En note les documents justificatifs).
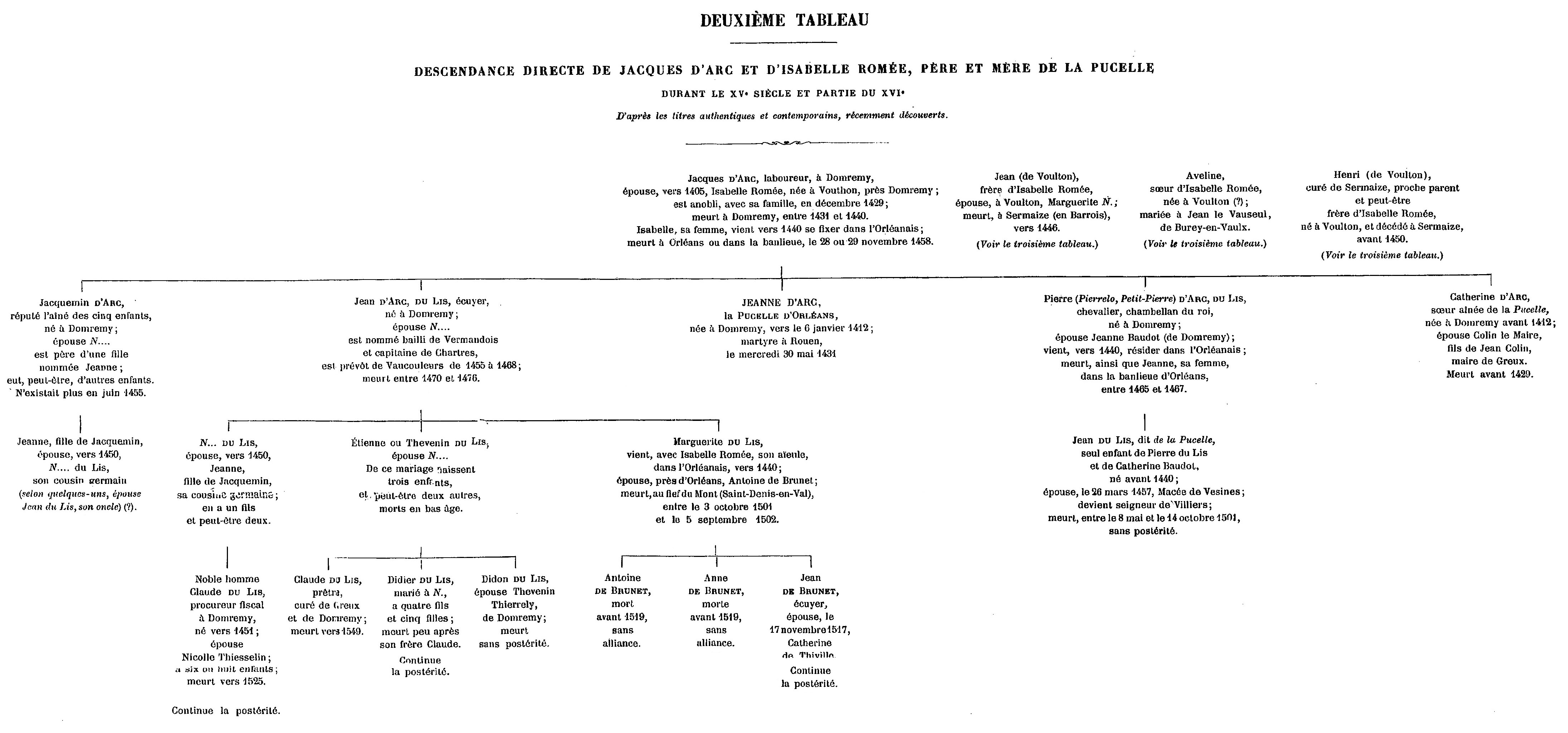
- Jacques d’Arc239
Laboureur, à Domrémy, épouse vers 1405 Isabelle Romée, née à Vouthon près Domrémy ; est anobli, avec sa famille, en décembre 1429 ; meurt à Domrémy, entre 1431 et 1440. — Isabelle, sa femme, vient vers 1440 se fixer dans l’Orléanais ; meurt à Orléans ou dans la banlieue, le 28 ou 29 novembre 1458.
- Jacquemin d’Arc241
Réputé l’aîné des cinq enfants, né à Domrémy ; épouse N… ; est père d’une fille nommée Jeanne ; eut, peut-être, d’autres enfants ; n’existait plus en juin 1455.
- Jeanne, fille de Jacquemin245
Épouse vers 1450 N… du Lis, son cousin germain (selon quelques-uns, épouse Jean du Lis, son oncle) (?)
- Jeanne, fille de Jacquemin245
- Jean d’Arc, du Lis242
Écuyer, né à Domrémy, épouse N… ; est nommé bailli de Vermandois et capitaine de Chartres, est prévôt de Vaucouleurs de 1455 à 1458 ; meurt entre 1470 et 1476.
- N… du Lis246
Épouse, vers 1450, Jeanne, fille de Jacquemin, sa cousine germaine ; en a un fils et peut-être deux.
- Étienne ou Thévenin du Lis247
Épouse N…. De ce mariage naissent trois enfants, et peut-être d’autres, morts en bas âge.
- Marguerite du Lis248
Vient, avec Isabelle Romée, son aïeule, dans l’Orléanais en 1440 ; épouse, près d’Orléans, Antoine de Brunet ; meurt, au fief du Mont (Saint-Denis-en-Val), entre le 3 octobre 1501 et le 5 septembre 1502.
- Antoine de Brunet253
Mort avant 1519, sans alliance.
- Anne de Brunet
Morte avant 1519, sans alliance.
- Jean de Brunet
Écuyer, épouse le 17 novembre 1517, Catherine de Thiville. Continue la postérité.
- Antoine de Brunet253
- N… du Lis246
- Jeanne d’Arc240
La Pucelle d’Orléans, née à Domrémy le 6 janvier 1412 ; martyre à Rouen le mercredi 30 mai 1431.
- Pierre (Pierrolo, Petit-Pierre) d’Arc, du Lis243
Chevalier, chambellan du roi, né à Domrémy ; épouse Jeanne Baudot (de Domrémy) ; vient, vers 1440, résider dans l’Orléanais ; meurt, ainsi que Jeanne, sa femme, dans la banlieue d’Orléans, entre 1465 et 1467.
- Jean du Lis, dit de la Pucelle249
Seul enfant de Pierre du Lis et Catherine Baudot, né avant 1440 ; épouse, le 26 mars, 1457, Macée de Vesines ; devient seigneur de Villiers ; meurt, entre le 8 mai et le 14 octobre 1504, sans postérité.
- Jean du Lis, dit de la Pucelle249
- Catherine d’Arc244
Sœur aînée de la Pucelle, née à Domrémy avant 1412 ; épouse Colin le Maire, fils de Jean Colin, maire de Greux. Meurt avant 1429.
- Jacquemin d’Arc241
- Jean (de Vouthon)
Frère d’Isabelle Romée, épouse à Vouthon, Marguerite N. ; meurt à Sermaize (en Barrois) vers 1446. (Voir le troisième tableau).
- Aveline
Sœur d’Isabelle Romée, né à Vouthon, mariée à Jean le Vauseul, de Burey-en-Vaulx. (Voir le troisième tableau).
- Henri (de Vouthon)
Curé de Sermaize, proche parent et peut-être frère d’Isabelle Romée, né à Vouthon, et décédé à Sermaize, avant 1450. (Voir le troisième tableau).
Troisième tableau
Branches collatérales de la famille de Jeanne d’Arc. Descendance de Jehan (de Vouthon)255, frère d’Isabelle Romée, et d’Aveline260, sa sœur, durant le XVe siècle et partie du XVIe.
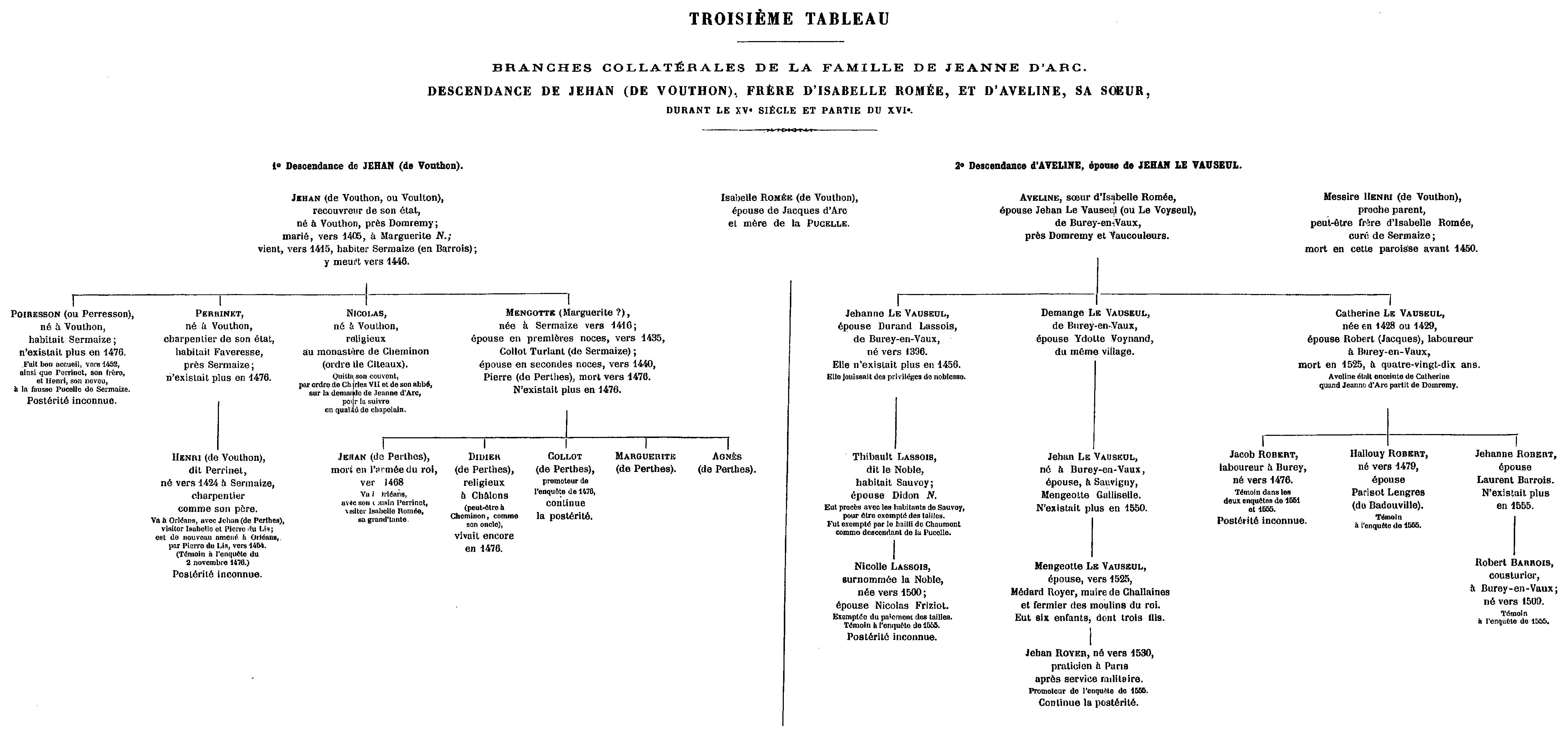
- Jehan (de Vouthon, ou Voulton)256,
Recouvreur de son état, né à Vouthon, près Domrémy ; marié, vers 1405, à Marguerite N. ; vient, vers 1415, habiter Sermaize (en Barrois) ; y meurt vers 1446.
- Poiresson (ou Perresson)257
Né à Vouthon, habitait Sermaize ; n’existait plus en 1476. — Fait bon accueil, vers 1452, ainsi que Perrinet, son frère, et Henri, son neveu, à la fausse pucelle de Sermaize. — Postérité inconnue.
- Perrinet258
Né à Vouthon, charpentier de son état, habitait Faveresse, près Sermaize ; n’existait plus en 1476.
- Henri (de Vouthon), dit Perrinet
Né vers 1424 à Sermaize, charpentier comme son père. — Va à Orléans avec Jehan (de Perthes), visiter Isabelle et Pierre du Lis ; est de nouveau amené à Orléans, par Pierre du Lis, vers 1464. (Témoin à l’enquête du 2 novembre 1476.) — Postérité inconnue.
- Henri (de Vouthon), dit Perrinet
- Nicolas259
Né à Vouthon, religieux au monastère de Cheminon (ordre de Cîteaux). — Quitte son couvent, par ordre de Charles VII et de son abbé, sur la demande de Jeanne d’Arc, pour le suivre en qualité de chapelain.
- Mengotte (Marguerite ?)
Née à Sermaize vers 1416, épouse en premières noces, vers 1435, Collot Turlant (de Sermaize) ; épouse en secondes noces, vers 1440, Pierre (de Perthes), mort vers 1476. N’existait plus en 1476.
- Jehan (de Perthes)
Mort en l’armée du roi, vers 1468. — Va à Orléans avec son cousin Perrinet, visiter Isabelle Romée, sa grand-tante.
- Didier (de Perthes)
Religieux à Châlons (peut-être à Cheminon, comme son oncle). Vivait encore en 1476.
- Collot (de Perthes)
Promoteur de l’enquête de 1476. — Continue la postérité.
- Marguerite (de Perthes)
- Agnès (de Perthes)
- Jehan (de Perthes)
- Poiresson (ou Perresson)257
- Isabelle Romée (de Vouthon)
Épouse de Jacques d’Arc et mère de la Pucelle.
- Aveline
Sœur d’Isabelle Romée, épouse de Jehan Le Vauseul (ou le Voyseul), de Burey-en-Vaux, près Domrémy et Vaucouleurs.
- Jehanne Le Vauseul261
Épouse Durand Lassois, de Burey-en-Vaux, né vers 1396. — Elle n’existait plus en 1456. — Elle jouissait des privilèges de noblesse.
- Thibault Lassois
Dit, le Noble, habitait Sauvoy ; épouse Didon N. — Eut procès avec les habitants de Sauvoy, pour être exempté des tailles. Fut exempté par le bailli de Chaumont comme descendant de la Pucelle.
- Nicolle Lassois
Surnomée la Noble, née vers 1500, épouse Nicolas Friziot. — Exempté du paiement des tailles. Témoins à l’enquête de 1555. — Postérité inconnue.
- Nicolle Lassois
- Thibault Lassois
- Demange Le Vauseul
De Burey-en-Vaux, épouse Ydotte, Voynand, du même village.
- Jehan Le Vauseul
Né à Burey-en-Vaux, épouse, à Sauvigny, Mengeotte Galliselle. N’existait plus en 1550.
- Mengeotte Le Vauseul
Épouse vers 1525, Médard Royer, maire de Challaines et fermier des moulins du roi. Eut six enfants, dont trois fils.
- Jean Royer
Né vers 1530, praticien à Paris après service militaire.
Promoteur de l’enquête de 1555.
Continue la postérité.
- Jean Royer
- Mengeotte Le Vauseul
- Jehan Le Vauseul
- Catherine Le Vauseul262
Née en 1428 ou 1429, épouse Robert (Jacques), laboureur à Burey-en-Vaux, mort en 1525, à quatre-vingt-dix ans. — Aveline était enceinte de Catherine quand Jeanne d’Arc partit de Domrémy.
- Jacob Robert
Laboureur à Burey, né en 1476. — Témoin dans les deux enquêtes de 1551 et 1555. — Postérité inconnue.
- Hallouy Robert263
Né vers 1479, épouse Parisot Lengres (de Badouville). — Témoin à l’enquête de 1555. — Postérité inconnue.
- Jehanne Robert
Épouse Laurent Barrois. N’existait plus en 1555.
- Robert Barrois
Couturier à Burey-en-Vaux ; né vers 1509. — Témoin à l’enquête de 1555.
- Robert Barrois
- Jacob Robert
- Jehanne Le Vauseul261
- Messire Henri (de Vouthon)264
Proche parent, peut-être frère d’Isabelle de Romée, curé de Sermaize ; mort dans cette paroisse avant 1450.
Notes
- [1]
Jacques d’Arc était né à Ceffonds, prés de Montier-en-Der (Haute-Marne). Plusieurs historiens pensent, avec beaucoup de vraisemblance, que la famille d’Arc tire son nom de quelque village ou hameau dont elle serait originaire : Arc-sur-Tille, Arc-en-Barrois, etc.
- [2]
Isabelle Romée, née à Vouthon, près de Domrémy, eut un frère nommé Jehan et une sœur du nom d’Aveline.
Jehan, né, comme Ysabelle, à Vouthon-en-Barrois, et recouvreur de son état, alla plus tard demeurer à Sermaize, près de Bar-le-Duc. Il eut de sa femme Marguerite quatre enfants : Perresson ; Perrinet, charpentier ; Nicolas, religieux au monastère de Cheminon (diocèse de Châlons), qui, selon quelques témoignages, aurait été, sur la demande de Jeanne d’Arc, attaché à sa suite, à titre de chapelain, par Charles VII ; une fille enfin nommée Mengotte, épouse de Pierre (de Perthes).
Aveline, mariée à Jehan le Vauseul, de Burey-en-Vaulx, eut trois enfants : un fils, Demange le Vauseul ; une fille, Jehanne, mariée à Durand Laxart, de Burey, qui conduisit Jeanne d’Arc au capitaine Baudricourt, désigné dans les actes des procès sous le titre d’oncle de la Pucelle, bien qu’il ne fût réellement que son cousin germain par alliance ; une seconde fille enfin nommée Catherine, mariée à Jacques Robert, laboureur à Burey. (Enquêtes de Vitry, les 2 et 3 novembre 1476, et de Vaucouleurs, le 8 octobre 1555, possédées par M. le comte de Maleissye, voir chapitre XVI, §2 et §5, et les tableaux généalogiques).
- [3]
Trois témoins de l’enquête faite à Domrémy et à Vaucouleurs, en janvier 1456, mentionnent l’existence d’une sœur de la Pucelle, à savoir : Perrin, drappier à Domrémy ; Colin, fils de Jean Colin, laboureur à Greux ; et Michel Lebuin, cultivateur à Domrémy. (Quicherat, Procès, t. II, pp. 413, 433, 439.)
- [4]
Jacquemin, que l’on croyait jusqu’ici être mort sans alliance, contracta réellement mariage et eut postérité. Ses devoirs de père de famille purent le retenir à Domrémy. (Voir chapitre XII, information à Domrémy en 1502, §1 et §5.)
- [5]
Le Miroir des femmes vertueuses. (Quicherat, Procès, t. IV, p. 268.) — Pierre Sala, Hardiesses des grands rois et empereurs (Ibid., p. 280.)
- [6]
Le greffier de l’hôtel-de-ville d’Alby. (Quicherat, Procès, t. IV, p. 300 ; Journal du siège, ibid., IV, p. 126.)
- [7]
Compte d’Hémon Raguier. (Quicherat, Procès, t. V, p. 257, 258.)
- [8]
Journal du siège. (Quicherat, Procès, t. IV, p. 153.)
- [9]
Archives municipales d’Orléans, comptes annuels de commune.
- [10]
Enquête de 1456, à Vaucouleurs, déposition de Durand Laxart. (Quicherat, Procès, t. II, p. 445.) Comptes de la ville de Reims, ibid., p. 266.
- [11]
Voir pour les armoiries et le nom de du Lis, concédés à la famille d’Arc, la note 221.
- [12]
Quicherat, Procès, t. V, p. 209.
- [13]
Charles du Lis, Traité sommaire, etc., chap. VII.
- [14]
Registres de la chambre des comptes. (Quicherat, Procès, t. V, pp. 279 et 280.)
- [15]
Étienne Pasquier, avocat général à la Cour des comptes, Recherches de la France, Paris, 1621, livre VI, chap. V, p. 459.
- [16]
Voir ci-après, chapitre XV, Pierre du Lis et Catherine de Cailly.
- [17]
Charles du Lis, pour remplir la tâche qu’il s’était imposée, se livra à de laborieuses recherches. Il se fit particulièrement délivrer des expéditions de la plupart des actes authentiques dont il voulait faire usage dans son travail. Ces copies de titres, dont plusieurs originaux ont maintenant disparu, conservées aujourd’hui par M. le comte de Maleissye, descendant direct de Charles du Lis et de Catherine de Cailly, sont d’une incomparable valeur. Trois lettres de Jeanne d’Arc, dont deux signées de sa main, existent en outre en ces précieuses archives. M. de Maleissye a bien voulu m’ouvrir ce trésor de famille avec une gracieuse bienveillance ; je ne saurais assez lui en exprimer ma profonde gratitude.
- [18]
Parmi les titres possédés par M. de Maleissye se trouvent des lettres très-curieuses adressées à Charles du Lys. Trois d’entre elles, datées des 19 juillet 1609, 25 mars 1610 et 2 avril 1611, émanent de Jean Hordal, professeur à l’Université de Pont-à-Mousson, auteur de l’ouvrage latin : Heroinæ nobilissimæ Ioannæ Darc Lotharingiæ vulgo Aurelianensis puellæ historia, etc., arrière-petit-fils d’une nièce de la Pucelle. Deux autres, en date des 12 août 1609 et 13 mars 1611, lui furent écrites par Claude du Lis, écuyer, résidant à Vaucouleurs, descendant au quatrième degré de Jean, second frère de l’héroïne.
Charles du Lis avait fait appel aux souvenirs généalogiques de ces deux parents collatéraux de Jeanne d’Arc, qui, de tous les membres de la famille, se croyaient les mieux instruits de ses origines.
Or, Claude du Lis déclare loyalement tout d’abord que, par la disgrâce des troubles, ses parents et lui-même ont perdu tous leurs titres ; puis, après avoir exprimé le regret que ses ancêtres n’ayent pas eu la curiosité de laisser quelque monument par écrit de l’entre-suytte de leur naissance… il raconte à Charles du Lis, ainsi que le fait de son côté Hordal, avec une évidente sincérité, ce que la tradition leur a transmis sur ce sujet dont ils sont vivement préoccupés.
Après avoir attentivement étudié, comme M. de Maleissye m’a permis de le faire, ces cinq curieuses lettres, et y avoir remarqué, à la fois, l’absence de toute indication précise et le caractère vague, souvent contradictoire, de la plupart des affirmations qui y sont contenues, j’ai compris les difficultés qu’a dû éprouver le savant avocat général à faire pénétrer quelque lumière dans cette masse d’informations confuses, qui de divers côtés lui étaient transmises. Loin de lui reprocher certaines condescendances auxquelles d’instantes sollicitations ont pu l’entraîner, et les erreurs involontaires que lui-même a pu commettre, on doit s’étonner, au contraire, de n’en pas trouver davantage.
Cet état incomplet de la question généalogique, au XVIIe siècle, nous justifiera peut-être, à notre tour, de proposer, d’après des documents inconnus à Charles du Lis, quelques rectifications aux affirmations inexactes qu’il a, plus que tout autre, accréditées.
- [19]
Une notable partie des Nouvelles recherches est consacrée par M. Vallet de Viriville à défendre l’opinion qu’il cherchait à faire prévaloir, que le nom de la Pucelle doit s’écrire en un seul mot, Darc, et non en deux, avec apostrophe, d’Arc, comme on le fait généralement.
M. Wallon, dans la 3e édition de sa Jeanne d’Arc, a combattu, avec une haute autorité, cette thèse, un peu paradoxale, acceptée toutefois par quelques auteurs. (Paris, Hachette, 1875, t. I, p. 356.)
- [20]
Traité de la Noblesse, par Gilles-André de La Roque, 1ère édition, en 1678, réimpression à Rouen en 1734, chapitre XLIII.
- [21]
Le roi Louis XIII accorda des lettres-patentes, données à Paris le 26 octobre 1612, à Charles du Lis, conseiller et avocat général… et à Lucas du Lis, son frère, qui se disaient de la race de la Pucelle… Ce qui fut suivi d’un factum qu’ils publièrent pour faire connaître leur origine au public.
(Traité de la noblesse, 1734, p. 151.) - [22]
Il serait peu utile de signaler ici les graves inexactitudes commises par M. Vergnaud-Romagnési dans son Histoire de la ville d’Orléans, pages 362 (note), 403, 628, etc., et surtout par M. Lottin dans ses Recherches historiques sur la ville d’Orléans, tome I, pages 178, 246, 249, 287, 310, 311, 312, etc. Ces erreurs seront implicitement rectifiées par les documents qui vont être ci-après reproduits.
- [23]
M. de Haldat, secrétaire perpétuel de l’Académie de Nancy, dans son louable ouvrage : Examen critique de l’histoire de Jeanne d’Arc… (Nancy, 1850), a inséré sur la famille de la Pucelle quelques pages presque entièrement empruntées au système généalogique de Charles du Lis.
- [24]
Archives municipales d’Orléans, compte de commune de Gilet-Morchoasne, pour deux ans, commençant le 23 mars 1438 (1439 n. st.) et finissant le 22 mars 1440 (1441), XXXe mandement.
- [25]
Ibid., xxxvje mandement.
- [26]
La livre parisis était d’un quart plus forte que la livre tournois. Ainsi la livre tournois valant 20 sols tournois, la livre parisis en valait 25.
- [27]
Comptes de commune. — Archives municipales d’Orléans.
- [28]
Comptes de commune. — Archives municipales d’Orléans.
- [29]
Symphorien Guyon, Histoire d’Orléans, p. 289.
- [30]
Quittance de Hue de Saint-Marc pour l’année 1434 (collection particulière de l’auteur).
- [31]
Titres du chapitre de Sainte-Croix d’Orléans. — Bibliothèque de l’Évêché.
- [32]
Ducange, Glossaire, au mot Caritas. — C’est en ce sens que, dans une charte du prieuré de Saint-Gondon (Loiret), inscrite au Cartulaire général de l’abbaye de Saint-Florent, près Saumur :
Un seigneur nommé Hugues de la Tour (Hugo de Turre) promet aux religieux de Saint-Gondon de les garantir de toute entreprise faite à leur préjudice contre un moulin qu’ils possédaient dans son fief, à la condition qu’ils lui feront en charité un don volontaire équivalent à 20 sols, monnaie de Sancerre, tali pacto ut monachi darent ei caritatem, scilicet xx solidos Sancerrensis monetæ… don que le prieur acquitta immédiatement en remettant au seigneur son propre palefroy, bien qu’il fût de plus grande valeur…
— (Communication de M. Marchegay, membre non résidant du Comité des travaux historiques.) - [33]
Comptes de forteresse de Jean Hillaire, années 1428, 1430 ; Archives municipales d’Orléans.
- [34]
Quicherat, Procès, t. V, p. 277.
- [35]
Mémoires de Philippe de Comines, Imprimerie royale, in-fol., 1649, p. 37, année 1465.
- [36]
Des lettres de rémission du 23 mai 1445, conservées au trésor des chartes (I, 177, no45), et publiées par Quicherat, Procès, t. V, p. 209, font connaître que Pierre du Lis eut besoin, pour payer sa rançon au bâtard de Vergy, qui le retenait prisonnier, de faire un emprunt à Philibert de Brécy, chevalier. Il lui assigna pour gage de remboursement
les proufits et revenus de haut passage au bailliage de Chaumont, et particulièrement en la ville de Serqueux, prevosté de Montigny, dont le roi lui avait fait don
. Le recouvrement tenté par Philibert de Brécy contre la ville de Serqueux, de ces profils de haut passage, pour se payer de son prêt que Pierre du Lis n’avait pu apparemment lui rembourser, donna lieu en 1439 à des voies de fait qui motivèrent ces lettres de rémission. - [37]
Incendiés et détruits par les habitants eux-mêmes, pour que les Anglais ne pussent s’y établir. (Journal du siège.)
- [38]
Cette métairie existe encore aujourd’hui, et conserve le nom de ferme des Chanoines. Elle dépend du château de Bagneaux, et appartient à M. de Noras, qui, avec une affectueuse bienveillance, a mis à ma disposition les titres de sa propriété.
- [39]
Voir sur la famille Bourdon : Le château de l’Isle et la famille Groslot, par M. l’abbé de Torquat (Mém. de la Soc. archéol. de l’Orléanais, t. II, p. 19 et suiv.) ; — La première expédition de Jeanne d’Arc (Ibid., t. XV, p. 1 et suiv.) ; — les archives départementales du Loiret, et les titres particuliers du château de l’Isle.
- [40]
Chronique de l’établissement de la fête du 8 mai. (Quicherat, Procès, t. V, p. 285.)
- [41]
Archives du Loiret, série G ; fonds du Chapitre de Sainte-Croix ; registres des copies de contrats pour le Chapitre de Sainte-Croix d’Orléans ; — volume des années 1418 à 1451. — J’ai mis entre crochets et en caractères italiques les variantes remarquées par M. Doinel dans l’original de cet acte qu’il a retrouvé parmi les vieilles minutes de Denis de la Salle (étude de Me Linget, titulaire actuel).
- [42]
Traité de la noblesse, chap. XLIII.
- [43]
Ce nom de Jehanne de Prouville, dont on s’est beaucoup préoccupé, semble pouvoir s’expliquer facilement. Le dictionnaire topographique du département de la Meuse, rédigé sous les auspices de la Société philomatique de Verdun, par M. Félix Liénard (Paris, 1871), indique en la commune de Doulcon, canton de Dun-sur-Meuse en Barrois, à vingt-cinq lieues, ou environ, de Domrémy, une ferme du nom de Proiville ou Prouville.
On verra dans l’enquête de 1502 (chapitre XI, ci-après) qu’Henri Baudot, père de Jeanne Baudot, habitait, de son vivant, avec Catherine sa femme, Domrémy et quelquefois Gondrecourt ; mais il n’est pas dit qu’il en fût originaire. II n’y a donc rien d’invraisemblable à ce qu’avant de venir se fixer à Domrémy il eût auparavant habité Prouville, et même à ce que sa fille Jeanne y fût née.
Le canton de Dun-sur-Meuse, où est situé Prouville, étant du pays de Bar, on pouvait, selon l’usage d’alors, nommer Jeanne Baudot soit Jehanne de Prouville, soit Jehanne du pays de Bar, de même qu’Isabelle Romée, sa belle-mère, née à Vouthon, était fréquemment nommée Isabelle de Vouthon.
- [44]
Pierre d’Arc, surnommé du Lis, [disent les lettres accordées à Charles du Lis, le 25 octobre 1612], après être parvenu à l’ordre et degré de chevalerie par lettres-patentes du duc d’Orléans, données à Orléans le 28 juillet 1443, etc.
Ainsi, d’après ces lettres de 1612, Pierre aurait été fait chevalier par l’acte de donation de 1443. - [45]
…Avons reçue l’humble supplication de nostre bien-amé Messire du Lis, chevalier…
(Lettre du duc d’Orléans, du 28 juillet 1443, chap. VI, ci-après.) — Pierre était donc déjà chevalier. - [46]
Première expédition de Jeanne d’Arc pour le ravitaillement d’Orléans, et plan topographique annexé. — Orléans, 1874.
- [47]
Première expédition de Jeanne-d’Arc, etc., note VIII, p. 90.
- [48]
Bulletin no 35. — 1er trimestre de 1860.
- [49]
Archives du Loiret, série A, 274, fonds de l’Apanage. — D’après les indications données par Étienne Pasquier et par Charles du Lis, ce vidimus paraît être celui qu’ils ont eu entre les mains, et dans lequel ils ont puisé leurs extraits.
Mlle de Villaret, ancienne élève de Saint-Denis, dont le talent paléographique m’a été d’un précieux secours, a bien voulu faire de ce vidimus une nouvelle et très-exacte lecture. Qu’il me soit permis de lui en exprimer ici ma respectueuse gratitude.
- [50]
Le sceau, sur double queue de parchemin, est enlevé.
- [51]
Étienne Pasquier, Recherches de la France, livre VI, chap. V.
- [52]
Quicherat, Procès, t. V, p. 279.
- [53]
Charles du Lis, Traité sommaire, chap. VI et VII.
- [54]
D’après plusieurs titres possédés par M. de Noras, le fief du Mont se composait alors de maison, verger, vignes et bois, et d’environ quatre arpents de terre, sis à quatre ou cinq kilomètres de Bagneaux, tout près de l’Île-aux-Bœufs.
- [55]
Titres particuliers du domaine du Mont.
- [56]
Les détails qui suivent sont puisés dans les registres de cens du Mont et de Luminard et dans les titres du château de l’Île, que l’obligeante bienveillance de MM. de Noras, de Brouville et de Terrouenne m’a permis de consulter. Ils sont confirmés et complétés, par un acte authentique du 29 avril 1532, devant Nicolas Sevin, notaire à Orléans, dont M. Doinel a retrouvé la minute en l’étude de Me Francheterre et qu’il a récemment publié.
- [57]
Anne de Brunet, petite-nièce de Jeanne d’Arc, est fréquemment nommée jusqu’en 1519 dans les papiers censiers du Mont et de Luminard, presque toujours sous la dénomination de damoiselle Anne, fille d’Antoine de Brunet, quelquefois sous celle de Madamoiselle du Mont. L’acte de Nicolas Sevin, du 29 avril 1532, dit qu’elle n’existait plus le 14 novembre 1519. Elle serait donc décédée dans le cours de cette année.
Ce même acte la nomme à deux reprises Jeanne au lieu de Anne ; c’est, je crois, une erreur du notaire, rien n’indiquant que Marguerite du Lis ait eu deux filles : Anne et Jeanne.
- [58]
Titres du château de l’Île.
- [59]
Guillaume d’Estouteville, d’une ancienne famille de Normandie, cardinal en 1439, devint archevêque de Rouen en 1454.
- [60]
Archives municipales d’Orléans : Commune, 1451-1452, mandement XVIIIe. — Ce curieux témoignage de la première manifestation officielle faite à Orléans, pour la réhabilitation de Jeanne d’Arc, avait jusqu’à présent échappé aux recherches. Il a été remarqué, dans nos comptes de commune, par Mlle de Villaret, qui a eu la bonté de me le communiquer.
- [61]
Ces lettres apostoliques, déjà publiées par Lenglet Dufresnoy, l’ont été de nouveau par M. J. Quicherat, t. V, p. 299 de son recueil.
L’original, un des titres les plus précieux des archives municipales d’Orléans, était autrefois à l’hôtel-de-Ville.
Lorsqu’en 1849 M. J. Quicherat en prit de nouveau copie pour en réviser la lecture, il était, ajoute-t-il, conservé au greffe de la Cour royale. — Il n’y est malheureusement plus aujourd’hui. - [62]
On lit dans les comptes de commune de Jehan de Troyes, 1451, 1452, et d’André Saichet, 1453, 1454, que ce pardon d’un an et cent jours fut impétré de M. le Cardinal légat par les Procureurs de la ville, et qu’en mai 1453, Jaquet Simon, crieur d’échelette, le cria et publia par les rues et carrefours, et reçut seize deniers parisis pour salaire.
- [63]
Jacquemin, frère aîné, n’est nommé dans aucun des actes du procès de réhabilitation. On en conclut, avec toute raison, qu’il n’existait plus en 1455.
- [64]
Quicherat, Procès, Procès de réhabilitation, t. II, p. 108.
- [65]
Quicherat, Procès, Procès de réhabilitation, t. II, p. 283.
- [66]
Quicherat, Procès, t. III, p. 355. — O’Reilly, Les deux procès de Jeanne d’Arc, t. II, p. 528.
- [67]
Voir, aux archives municipales d’Orléans, 16 compte de commune de Jehan Bureau, années 1555, 1456 (mandement XXIIe). Bien que des extraits de ce compte de commune aient été publiés par M. Quicherat, t. V, p. 277 et 278, j’ai pensé qu’il y aurait quelque intérêt à le reproduire complètement ici :
À Jehan Pichon, pour paier à six hommes qui, le xxj juillet, portèrent les six torches de lu ville à une procession qui fut faicte ledit jour en l’église Saint-Sanxon d’Orléans, par l’ordonnance de mesdiz seigneurs l’Évesque de Coutances et Inquisiteur de la foy, au prix chascun de viij d. p., et pour le fait de Jehanne la Pucelle, pour ce iiij s. p.
À maître François Berthaud, gardien des Cordeliers, qui, le cinquième jour d’aoust, fist le sermon à une procession faicte à Saint-Pol, à la requeste des procureurs, xvj s. p.
Audit Pichon, pour payer à quatre compaignons qui portèrent quatre des torches de la dicte ville à une procession que firent les religieux de Saint-Euvertre, le dymanche viije jour d’aoust, ij s. viij d. p.
À Berthault Fornier, poulailler, pour douze poussins, deux lappereaux, douze pigons et un levrat, achetez de lui le mardi xxe jour de juillet [M CCCC LVI] par Cosme de Comy et Martin de Maubodet, qui ledit jour furent présentez de par ladicte ville à Monseigneur l’Éesque de Cotences, pour ce, xxij s. viij d. t.
À Jehan Pichon, pour dix pintes et choppine de vin par lui présentées de par la dicte ville, au disner, à mondit seigneur l’Évesque de Cotences et à l’Inquisiteur de la foy, audit pris de dix deniers viij s. ix d. p.
Audit Pichon, pour dix pintes et choppine de vin par lui présentées ledit jour, au soupper, auxdits Monseigneur l’évesque de Cotances et l’Inquisiteur de la foy, audit prix, viij s. ix d. p.
Audit Pichon, pour dix pintes et choppine de vin pareillement présentées le mercredi xxje jour de juillet auxdits Monseigneur l’Évesque et l’Inquisiteur de la foy, audit prix, viij s. ix d. p.
Audit Jehan Pichon, pour dix pintes et choppine de vin par lui pareillement présentées, au soupper, auxditz mondit Seigneur l’Évesque et Inquisiteur de la foy, audit prix de dix deniers, viij s. ix d. p.
- [68]
Archives municipales d’Orléans. — Comptes de commune de Hervé Paris, 1557, 1558 (mandement VIII).
- [69]
Jeanne d’Arc, née en 1412, la quatrième peut-être, plus probablement la cinquième et dernière enfant d’Isabelle Bornée, reporte approximativement la naissance de sa mère de 1380 à 1385.
- [70]
Archives municipales d’Orléans. — Compte de commune de Hervé Paris, 1457, 1458. (Mandement XLIX.)
- [71]
Aujourd’hui rue des Africains, paroisse Saint-Pierre-le-Puellier.
- [72]
Voir, pour ces détails, l’intéressante notice ayant pour titre : La maison de la famille de Pierre d’Arc, frère de la Pucelle, à Orléans, par M. J. Doinel, archiviste du Loiret. (Mémoires de la Société archéologique et historique de l’Orléanais, t. XV.)
- [73]
Ibidem.
- [74]
Enquête de 1502, ci-après, chapitre XII.
- [75]
Titres de M. le comte de Maleissye. — Voir aussi M. J. Quicherat, t. V, p. 280, d’après un manuscrit du Vatican. — Quelques variantes existent dans les deux textes de ce document.
- [76]
1467, nouveau style.
- [77]
Archives du Loiret, série G. Fonds du chapitre Sainte-Croix d’Orléans. Registre des copies de contrats, année 1457.
- [78]
Le château de Villiers, vendu récemment, a longtemps appartenu à l’honorable famille de Laage de Meux. M. Joël de Meux a eu la bonté de m’en communiquer les titres.
- [79]
En 1457 et 1458, un Guillaume de Vézines était chanoine et pénitencier de l’Église d’Orléans. (Registres capitulaires, aux archives du Loiret. — Archives municipales d’Orléans, comptes de commune de Hervé Paris, XLVIIe mandement.)
- [80]
Une expédition authentique de ce contrat de mariage est en la possession de M. le comte de Maleissye. La minute originale a été retrouvée par M. J. Doinel dans les registres de Jehan Bureau le jeune, conservés en l’élude de Me Paillat, titulaire actuel, et a été publiée par lui dans son ouvrage ayant pour titre : La maison de la famille de Pierre d’Arc.
- [81]
Registre de la Chambre des comptes. — Quicherat, Procès, t. V, p. 286.
- [82]
J’ai retrouvé aux archives nationales (R4, 20287, Recueil de copies collationnées de titres, t. I, fo 35) une expédition authentique de cette donation, jusqu’à ce jour inconnue.
- [83]
Actes du 11 janvier 1469, du 9 mars 1497, etc.
- [84]
Traité sommaire, chap. VII.
- [85]
Registres de cens annexés aux titres de Bagneaux.
- [86]
Une expédition authentique de ce bail de l’Île-aux-Bœufs, cité par Charles du Lis (chap. VII), est possédée par M. de Maleissye.
- [87]
L’original de cet acte de donation, conservé dans les titres du château de Villiers, m’a été obligeamment communiqué par M. Joël de Meux. — Charles du Lis en a publié un extrait où l’on remarque quelques inexactitudes.
- [88]
Dans un acte du 14 décembre 1500, possédé par M. de Maleissye, il est dit que Pierre Le Berruyer était conseiller et advocat du roy. De 1522 à 1545, il fut lieutenant général au bailliage.
- [89]
Titres de M. le comte de Maleissye.
- [90]
Archives municipales d’Orléans, compte de commune d’Antoine Descontes. — Lottin (Recherches historiques sur la ville d’Orléans, t. I, p. 340) a reproduit ce passage d’une manière très-inexacte.
- [91]
L’Île-aux-Bœufs, après avoir, à la mort de Jean du Lis, passé en diverses mains, fut donnée en usufruit, par François Ier, à Raoul et François Burgensis, ses sommelliers, par lettres-patentes de 1527, dont une ampliation est conservée dans les titres du château de l’Île.
- [92]
Voir pour les actes judiciaires de retrait de cette maison, par l’abbé de Saint-Euverte, en 1505, les archives départementales du Loiret, et La Maison de la famille de Pierre d’Arc, par M. Doinel.
- [93]
Une expédition authentique de cette sentence a été levée par les soins de Charles du Lis et fait partie des précieuses archives de M. de Maleissye, qui a bien voulu m’en donner communication.
La note inscrite de la main de Charles du Lis : J’ai l’original, c’est-à-dire le registre de la prévôté où cette décision judiciaire était conservée, confirme, en tant que de besoin, l’exactitude du document.
Charles du Lis, en publiant dans son Traité sommaire (chap. VII) un long extrait de cette sentence, n’a fait connaître ni les actes qui l’ont suivie, ni les conséquences qui en ressortent pour la filiation de Messire Pierre. J’essaierai de combler cette lacune.
- [94]
Le petit fief du Mont, que Marguerite du Lis avait reçu de son oncle messire Pierre, et qu’elle habita avec son mari jusqu’à sa mort, est à huit kilomètres environ d’Orléans et à quatre ou cinq de Chécy, de Bagneaux et de Luminard : il touche aux terres de l’Île-aux-Bœufs, successivement possédées par son oncle et son cousin germain, Jean du Lis.
- [95]
Archives nationales R4 20287. — Recueil de copies de pièces, t. I, p. 42.
Le texte conservé aux archives est une expédition, en forme authentique, délivrée sur la demande de M. Leclerc de Douy, procureur du roi et du duc au siège présidial d’Orléans. Elle se trouve dans les nombreuses copies de pièces par lui recueillies, à l’occasion des longs procès qui eurent lieu au XVIIIe siècle entre le domaine et quelques seigneurs de la banlieue d’Orléans, relativement à la mouvance féodale de l’Île-aux-Bœufs et autres terres submersibles entre Chécy et Sandillon.
On lit en cette expédition que l’original, en parchemin, faisait partie des titres de la terre de l’Île Groslot. Il paraît ne plus s’y trouver aujourd’hui. Il y était vraisemblablement entré avec ceux du Mont, qui appartenait à la famille de Brunet, et fut vendu en 1532 à Jacques Groslot, propriétaire du domaine de l’Île.
- [96]
Il ne me sera pas refusé, j’ose l’espérer, de citer ici quelques lignes du rapport en lequel le savant et bienveillant secrétaire de la section d’histoire, M. Hippeau, a rendu compte, avec la haute autorité qui s’attache à ses appréciations, de cette communication faite en la séance publique du 6 avril 1877 :
Un acte authentique d’enquête et de notoriété du 16 août 1502, conservé aux archives nationales, retrouvé et produit en son mémoire par M. Boucher de Molandon, fournit sur les frères et les sœurs de Jeanne d’Arc des notions contraires à celles qui, jusqu’à présent, avaient été acceptées, savoir… (Suit l’exacte analyse de l’enquête.) De toutes ces recherches découlent, soit sur les membres de la famille de Jeanne d’Arc, qui, durant près de trois quarts de siècle, vinrent vivre et mourir dans la banlieue d’Orléans, soit sur ses frères et sœurs qui demeurèrent à Domrémy, des notions inattendues dont l’exposition a d’autant plus vivement intéressé l’auditoire, qu’elles s’appuient sur des actes authentiques, des contrats, des enquêtes dont l’auteur a su tirer partie de la manière la plus heureuse.
(Réunion annuelle des délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne en avril 1877. — Compte-rendu des lectures et communications à la section d’histoire et de philologie, par M. Hippeau, secrétaire. — Revue des Sociétés savantes, publiée sous les auspices du Ministère de l’instruction publique, 6e série, t. V, avril 1877, p. 495 et suivantes.) - [97]
Marcey-sous-Brixey (aujourd’hui Marcey ou Marcy-sur-Meuse), village à deux kilomètre environ et presque en face de Domrémy, sur la rive droite de la Meuse (Domrémy est sur la rive gauche).
Les deux villages de Marcey et de Brixey sont situés sur la même colline ; mais Brixey est plus près du sommet ; de là le nom de Marcey-sous-Brixey.
- [98]
Greux, village attenant à Domrémy, l’un et l’autre sur la rive gauche de la Meuse et sur la route de Vaucouleurs.
- [99]
5 janvier 1477.
- [100]
Archives nationales. — Recueil de copies de pièces, R4 20287, t. I, fo 42.
- [101]
Gondrecourt, village autrefois fortifié, aujourd’hui chef-lieu de canton de la Meuse, à trois lieues environ de Domrémy.
- [102]
Aujourd’hui Maxey (Meuse).
- [103]
Charles du Lis, Traité sommaire, 1628, chap. VII. — De La Roque, Traité de la noblesse, chap. XLIII, Rouen, 1678.
- [104]
Une petite inexactitude doit être signalée dans cette déposition, de quelque, part qu’elle provienne, soit du témoin, soit du notaire rédacteur. Claude du Lis dit avoir demeuré, avec son oncle messire Pierre et dame Jeanne sa tante, au lieu de Luminard, près d’Orléans, en sofa jeune âge, peut avoir environ vingt-quatre ans. — Si l’on se reporte de vingt-quatre ans en arrière du jour de l’enquête, on atteint à peu près l’année 1476. Or, Pierre du Lis et Jeanne sa femme n’existaient plus en 1476. Ils étaient morts, on l’a vu plus haut, avant le 8 janvier 1467. Au lieu de vingt-quatre ans, c’est donc vraisemblablement trente-quatre ans qu’il faut lire. Ce serait alors à l’âge d’environ quatorze à quinze ans que Claude aurait été passer près de son oncle et de sa tante les cinq dernières années de leur vie. Il serait revenu à Domrémy vers l’époque de leur mort.
Ces appréciations sont confirmées par plusieurs témoignages de l’enquête faite à Vaucouleurs, en 1551.
- [105]
Procès de réhabilitation : information à Domrémy. (Quicherat, Procès, t. II, p. 432 et suiv.)
- [106]
On pourrait toutefois s’étonner que Colin, fils de Jean Colin, après avoir, dans sa déposition de 1456, dit de la sœur de Jeanne d’Arc :
…Quolibet die sabbati, post meridiem, ipsa Johanna, cum quadam sorore sua, et aliis mulieribus, ibat ad heremum, seu ecclesiam beatæ Mariæ de Bermont… (Jeanne, les samedis, après midi, avec sa sœur et quelques femmes, allait à la chapelle de Sainte-Marie-de-Bermont)
n’eût pas ajouté que cette sœur était devenue son épouse. Mais on sait qu’en de nombreuses circonstances les greffiers de ces enquêtes n’ont consigné dans leurs procès-verbaux que les détails ayant trait direct au but spécial de l’information, et ont passé le reste sous silence. - [107]
On verra ci-après, dans les tableaux généalogiques (3e tableau), que Aveline, sœur d’Ysabeau, mère de la Pucelle, avait épousé Jehan le Vauseul, et que de leur mariage étaient nés : Demange le Vauseul, Jehanne le Vauseul, mariée à Durand Laxart, et Catherine le Vauseul, mariée à Jacques Robert et mère d’Hallouy Robert, femme de Parisot-Lengres. — Voir, sur le récit d’Hallouy Robert, le chapitre XVI, §5.
- [108]
Enquête des 8, 9 et 16 octobre 1555, faite à Vaucouleurs devant Jehan de Gondrecourt, escuyer, lieutenant particulier du roy au bailliage de Chaumont, à la requête de Jehan Royer, se disant de la lignée de la Pucelle. Une expédition de cette enquête est, je l’ai dit plus haut, possédée par M. de Maleissye. — Voir chapitre XVI, §5.
- [109]
Quicherat, Procès, t. II, p. 413, 433 et 439.
- [110]
Plusieurs dépositions, consignées en d’autres informations, témoignent de ces affectueux rapports.
Ainsi, dans l’enquête faite en 1476 devant le prévôt de Vitry, pour établir la descendance de Jehan de Voulton, frère d’Isabeau, mère de la Pucelle,
… Henri (de Voulton), dict Perrinet, charpentier, demourant à Sermaize, petit-neveu d’Isabelle Romée, dit avoir esté veoir ladicte feue Ysabelot à Orléans, et messire Pierre du Lys, frère germain de la Pucelle, au grand hostel de Baigneaux… Et ont receu lui comme leur prochain parent, accompagné de feu Jehan (de Perthes), son cousin que pareillement ils recepvèrent comme leur cousin et linager, les festoyèrent et firent grande chère à chascune fois qu’ilz ont esté audict pays…
Thomas Senlis, demourant aussi à Sermaize, dépose à son tour
qu’il s’en alla (vers 1453) à la ville et cité d’Orléans pour ses affaires, en laquelle ville il trouva un nommé Collesson Coutant, cordonnier, demourant illec, ouvrant de son mestier, natif dudict Sermaize, lequel… le mena et conduisit en plusieurs lieux d’icelle cité, et par espécial le mena veoir une nommée dame Ysabelot, demourant lors audit Orléans, qu’il disoit estre mère de ladite Jehanne la Pucelle. En allant en son quel hostel rencontrèrent et trouvèrent messire Pierre du Lys, filz d’icelle dame Ysabelot et frère de ladite Jehanne la Pucelle, qui, comme il disoit, venoit d’un village nommé les Ysles-les […] ledit Orléans, que ledit feu roy Charles luy avoit baillé, qui pareillement alloit veoir ladite Ysabelot, sa mère… S’en allèrent tous trois devers ladite dame Ysabelot, mère d’iceluy du Lys, à laquelle il dit qu’il luy amenoit l’un des voisins de leurs parens et linagers de Sermaize, c’est assavoir de Henri et Perrinet de Voulton, qui, plusieurs foys, l’avoient receu en leurs hostels audit Sermaizes et fait en iceulx grande et amiable chère. Pourquoy la dame Ysabelot reçut de bon et joyeux courage ledit depposant, l’embrassa de ses bras en luy demandant comment se portoient lesdiz ses cousins et linagers, et s’ils estaient tous en bon point. À laquelle il respondit qu’ilz estaient tous en bon point, dont elle et ledit messire Pierre, son filz, furent fort joyeulx. Et en iceluy hostel fust, auxdiz depposant et Coutant, faict par icelle Ysabelot et son filz une très grande, singulière et amyable chère…
Dans une autre information faite en 1551, à Vaucouleurs, plusieurs témoins déclarent avoir entendu dire à leurs pères qu’ils
avoient esté à Orléans rendre visite à la mère et au frère de Jeanne d’Arc ;
d’autres, quemessire Pierre envoyoit, en présent, du vin d’Orléans à ses parents de Domrémy.
(Informations de Vitry en novembre 1476, et de Vaucouleurs en avril 1551, possédées par M. de Maleissye.) - [111]
La forme solennelle de cette procuration, le nombre des fondés de pouvoir et le choix de noble homme Claude du Lis, vraisemblablement alors chef de la famille, semblent révéler à la fois la pensée d’un riche héritage, et une sorte de protestation contre la prétention de Marguerite du Lis de représenter seule les parents collatéraux d’un des frères de la Pucelle.
- [112]
Des expéditions authentiques de la procuration du 17 août et de l’acte de cession du 5 septembre 1502 sont conservées dans la collection des manuscrits de la Bibliothèque publique d’Orléans. Elles y ont été retrouvées en 1876 par M. J. Doinel, et publiées par lui dans son travail ayant pour titre : La maison de la famille de Pierre d’Arc, etc.
- [113]
Claude, dans l’information du 16 août 1502, déclare être âgé d’environ cinquante ans.
- [114]
Enquête du 13 avril 1551, à Vaucouleurs, — Dépositions de Didon du Lis, veuve de Thévenin Thibert, et de Anne du Lis, veuve de Hautrevault, se disant l’une et l’autre filles de Claude du Lis et de Nicole Thiesselin.
- [115]
Didon du Lis, en l’enquête de 1551, confirme cette déclaration et dépose que son père, Claude du Lis, étant jeune enfant, s’en alla près de son oncle, à Orléans, et demeura chez lui près de dix ans.
- [116]
Les parents de Claude du Lis, entendus dans l’information de 1551, déclarent également qu’il habitait Domrémy, et que ses enfants y étaient nés.
- [117]
Traité sommaire, chap. VI. — Plusieurs titres authentiques, relatifs aux descendants du prévôt, sont mentionnés par Charles du Lis.
- [118]
Voir chapitre XVI, §2.
- [119]
Déposition de Didon et de Anne du Lis.
- [120]
Bibliothèque d’Orléans (pièces manuscrites citées plus haut.)
- [121]
D’après Charles du Lis (Traité sommaire, chap. VI), Étienne ou Thévenin du Lis, second fils du prévôt, aurait eu trois enfants : Claude, curé de Greux et de Domrémy ; Didier, qui, père de quatre fils et de cinq filles, aurait continué la postérité, et Didon du Lis, épouse de Thévenin Thierrely, qui, restée veuve et sans enfants, fit don de tous ses biens à ses neveux et nièces, par un acte de donation du 26 février 1552. — Voyez, sur l’obscurité de ce détail généalogique, la note du chapitre XVI, §2, no 2.
- [122]
Il paraît assez bizarre que les déposants, qui dans cette enquête se disent les uns enfants, les autres petits-enfants de Claude et de Nicolle, soient à peu près du même âge. Ne seraient-ils pas tous des petits-enfants ?
- [123]
Præfatam puellam… patrem… matrem… fratres ipsius Puellæ… et totam suam parentelam et lignagium… etiam et eorum posteritatem masculinam et femininam in legitimo matrimonio natam et nascituram… nobilitavimus et per presentes… nobilitamus et nobiles facimus… concedentes… ut privilegiis, libertatibus, prærogativis… gaudeant pacifice et utantur… volentes ut iidem prænominati, dictaque parentela et lignagium sæpefatæ Puellæ et eorum posteritas masculina et fœminina… feoda et retrofeoda et res nobiles acquirant… et possidere perpetuo possint… nec aliquam financiam nobis vel successoribus nostris… solvere quovis modo teneantur… quam quidem financiam dictæ parentelæ et lignagio prædictæ Puellæ… donamus et quictamus per pressentes…
(Lettres d’anoblissement données à Mehun-sur-Yèvre, en décembre 1429.) - [124]
Ce privilège, créé en 1429, ainsi restreint successivement par les lettres et édits de 1556 et 1614, fut tout à fait supprimé en janvier 1634. Des exceptions furent, à diverses époques, accordées à quelques familles, par dérogation à cette suppression.
- [125]
La première information connue est celle de 1476, à la requête de Collot (de Perthes), petit-neveu d’Isabelle Romée. (Voir chapitre XVI, §2.)
- [126]
L’enquête d’Orléans pourrait offrir beaucoup d’intérêt. Elle a passé sous les yeux de Charles du Lis, qui la cite en son Traité sommaire (chap. VII). M. de Maleissye, avec son obligeance accoutumée, a bien voulu, sur ma demande, faire d’activés recherches en ses précieuses archives. Ces recherches ont été, jusqu’à présent, sans succès.
- [127]
Quicherat, Procès, t. V, p. 219.
- [128]
Charles du Lis, en citant, par extrait seulement, en son Traité sommaire (chap. IX), ces lettres-patentes d’octobre 1550, s’exprime en ces termes :
Robert Le Fournier obtint, en 1550, pour lui et Lucas du Chemyn, son neveu, des lettres-patentes par lesquelles ils sont tous deux déclarés nobles, comme descendus de Pierre du Lis, frère de ladite Pucelle, par Catherine du Lis, sa fille, leur aïeule.
Le savant avocat général, qui sans doute n’avait pas sous les yeux le texte officiel, publié depuis par M. Quicherat, s’est involontairement fait l’écho d’une grave inexactitude. — Les lettres de 1550 ne parlent, en quoi que ce soit, ni de Pierre du Lis, ni d’une fille de lui, nommée Catherine. Elles se bornent à dire que Robert Le Fournier et son neveu sont issuz et descenduz de la lignée de la Pucelle.
- [129]
La liste des prévôts d’Orléans est parfaitement connue ; aucun du Lis n’y figure.
- [130]
Voir chapitre XVI, §4.
- [131]
Cette enquête de Caen, jusqu’à présent inédite, est conservée dans les précieuses archives de M. de Maleissye, qui a bien voulu me la communiquer. De plus amples détails à son égard seront donnés ci-après, chapitre XVI, §4.
- [132]
La vieille famille orléanaise des Villebresme, aujourd’hui éteinte, si je ne me trompe, eut au XVe siècle plusieurs de ses membres attachés à la maison d’Orléans à titre de trésoriers ou de secrétaires des commandements. L’érudit chanoine Hubert, dans ses Généalogies orléanaises, donne en détail la filiation des Villebresme et la série de leurs alliances. Quelques membres y ont le prénom de François ; mais aucun n’y est indiqué comme receveur du domaine et comme époux d’une Catherine du Lis. (Manuscrit 457 bis de la Bibliothèque d’Orléans.)
- [133]
Je dois à MM. de Bouteiller et de Braux la connaissance des lettres du duc de Lorraine et de l’enquête du 7 juin 1596.
- [134]
Le 19 juillet 1609, Jean Hordal écrivait à Charles du Lis :
… Quant au doubte que faictes de la fille de Pierre, nommée Hauvy, qui espousa Estienne Hordal, que Dieu absolve, duquel suis descendu, c’est chose vérifiée par le témoignage de ceux qui l’ont veu il y a proche quatre-vingts ans…
Charles du Lis ne trouvait pas apparemment ces témoignages suffisants, et persistait dans ses doutes. — Le 25 mars 1610, Hordal réitéra plus instamment sa demande :
… Touchant le doubte que faictes de la dicte Hauvy, ma bisayeulle, je vous supplie de croire qu’il est très-bien vérifié qu’elle est fille de Pierre d’Arc, troisième frère de ladite Pucelle, et non de Jean d’Arc, prevost de Vaucouleurs, et de ce vous en jure en homme d’honneur. Pour preuve de ce, M. le grand doyen de Toul, mon cousin… m’a dit et asseuré qu’il mettroit, si besoing estoit, sa teste sur un bloc pour estre coupée, desquels termes il a usé, et pour sa grande preudhommie, fais autant d’estat d’un tel tesmoing que si plusieurs autres en déposoient…
Ces affirmations, certainement très-sincères, ne paraissaient pas, semble-t-il, suffisamment probatives à Charles du Lis, car le 2 avril 1611 Jean Hordal revenait une troisième fois à la charge avec une insistance plus pressante encore :
… M. le grand doyen… et trois autres miens cousins sommes grandement étonnés et extrêmement marris que révoquiez en doute que soyons sortis de Hauvy, fille de Pierre d’Arc, troisième frère de ladite Pucelle… comme je prétends l’avoir vérifié par l’enquête (de 1596).
(Correspondance de Charles du Lis et de Jean Hordal, conservée par M. de Maleissye.) - [135]
Le docteur Jean Hordal, si vivement préoccupé de ce qui pouvait relier sa famille à Jeanne d’Arc, ne s’était toutefois appuyé, après l’enquête de 1596, et les lettres-patentes du duc de Lorraine, en ce qui touchait le mariage d’Étienne Hordal, son bisaïeul, avec Hauvy, fille de Pierre du Lis, que sur des traditions pieusement conservées parmi les siens. — Dans sa correspondance avec Charles du Lis, tout en déclarant qu’il n’y avait personne, en Lorraine, qui en sceut plus que lui sur cette généalogie, il avait loyalement reconnu ne posséder aucun titre justificatif de cette filiation. — Ce nonobstant, un de ses arrière-neveux, M. Claude de Gratas, voulant, en 1676, se faire maintenir en son état de noblesse et de parenté, imagina de produire
le contrat de mariage, en parchemin, de noble Estienne Hordal avec Hauvy du Lys, fille de messire du Lys, chevalier, frère de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle d’Orléans, daté du 4 juillet 1467…
et d’en conclure qu’il était descendant direct de messire Pierre du Lis.C’était par trop dépasser le but. — L’acte produit en 1676 ne nomme même pas messire Pierre, mais seulement un messire du Lys, chevalier, frère de Jeanne d’Arc. — M. de Gratas, n’ayant d’ailleurs fait connaître ni l’origine, ni la justification, ni les moyens de contrôle de ce contrat si tardivement mis au jour, en opposition, d’ailleurs, pour ce qui concerne messire Pierre, avec tous les documents authentiques, il est inutile de rechercher ici si cet acte est apocryphe ou seulement interpolé. (Je dois à MM. de Bouteiller et de Braux connaissance de cette production de titres de M. de Gratas.)
- [136]
Charles du Lis, en adoptant cette thèse généalogique, put éprouver quelque satisfaction personnelle à greffer sa filiation sur la branche orléanaise, dont les souvenirs se rattachaient à ceux de Jacques de Cailly, son beau-frère, et de Catherine de Cailly, son épouse.
- [137]
On s’étonne qu’en cette énumération des frères de la Pucelle, le rédacteur des lettres-patentes de 1612 ait omis Jacquemin, généralement regardé comme l’aîné de la famille, et nommément inscrit dans les lettres d’anoblissement de décembre 1429.
- [138]
On a déjà remarqué (voir chapitre V), que messire Pierre du Lis n’a pas été créé chevalier par les lettres-patentes du 28 juillet 1443, et qu’il portait publiquement ce titre dès avant le 31 janvier 1442.
- [139]
Le brevet original de cette nomination, daté de juillet 1481, est conservé dans les archives de M. de Maleissye.
- [140]
Lettres-patentes de Louis XIII, en date du 25 octobre 1612 accordées à MM. Charles et Luc du Lis, sur leur requête. (Texte vérifié d’après la minute authentique des archives nationales.)
- [141]
Dans les lettres de concession de l’Île-aux-Bœufs (28 juillet 1443), Charles du Lis avait cru lire :
En considéracion des choses dessus dites, avons donné et donnons audit messire Pierre du Lis les revenus d’une isle appelée… etc., pour en jouyr sa vie durant, et de Jehan du Lis son aisné fils…
(Traité sommaire, chap. VII.)Les mots, son aisné fils, s’ils étaient réellement inscrits dans ce texte officiel, induiraient, en effet, à penser que messire Pierre pouvait avoir un second fils. Mais une lecture plus attentive permet facilement de reconnaître que Charles du Lis a fait erreur. Le texte ne porte pas : son aisné fils ; on y lit seulement : son dit fils (voir chapitre VI, et l’original aux archives du Loiret.)
- [142]
Les hésitations de Charles du Lis à accepter ces hypothèses non justifiées ne se révèlent pas seulement dans sa correspondance avec les familles intéressées, mais dans plusieurs passages de ses propres écrits. — Ainsi, dans la deuxième édition (1610) de son Traité sommaire, il donne Jeanne de Prouville pour femme à Jean, seigneur de Villiers, fils de messire Pierre du Lis. Dans l’édition suivante (1628), il l’attribue pour épouse à messire Pierre lui-même. — Dans l’édition de 1610, il donne à messire Pierre trois enfants : un fils aîné, Jean, seigneur de Villiers ; un second fils, Jean, échevin d’Arras, et une fille, Marie, épouse de François de Villebresme. — Dans la troisième édition (1628), il lui en donne quatre, ajoutant aux trois premiers Halouys ou Hauvy, épouse de Étienne Hordal. (Œuvres de Charles du Lis, rééditées par Vallet de Viriville, 1856, pp. 11, 13, 64 et 76.)
- [143]
Voir chapitre XI.
- [144]
La gravité de ces incidents avait été remarquée, dès le commencement de ce siècle, par l’un des plus savants explorateurs de notre histoire orléanaise au temps de la Pucelle, le vénérable et consciencieux abbé Dubois, théologal de l’Église d’Orléans, mort en 1823.
L’abbé Dubois ne connaissait ni les baux du chapitre, ni l’enquête de 1502, ni le texte des lettres-patentes de 1550 publié par M. Quicherat, et toutefois, dans un passage consacré à l’examen du Traité sommaire de Charles du Lis, il s’exprime en ces termes que je suis heureux de citer à l’appui de mes propres apréciations :
…Ce qui jette beaucoup d’incertitude sur ce qui est dit, dans le Traité sommaire, de la famille des du Lis, c’est qu’en 1501, à la mort de Jean du Lis, fils de Pierre du Lis, le procureur du roi fit saisir, faute d’héritiers, les biens qui lui appartenaient.
… Pierre du Lis, ajoute l’abbé Dubois, ayant toujours vécu auprès d’Orléans, y jouissait d’une grande considération ; pouvait-il se faire qu’on ne sût pas qu’il eût une fille mariée à Vaucouleurs, et une autre mariée à François de Villebresme, receveur du domaine à Orléans ? Peut-on supposer qu’elles ne se fussent pas présentées pour recueillir la succession de leur frère, ou leurs enfants pour recueillir celle de leur oncle ?
…Comment, après l’information faite par ordre du prévôt d’Orléans, sur la requête par laquelle Marguerite, épouse d’Antoine de Bonnet (sic), exposait qu’elle était cousine germaine du défunt Jean du Lys, et sa plus prochaine parente, a-t-il pu intervenir une sentence qui la déclare, comme cousine germaine, habile à lui succéder ? Cette sentence ne démontre-t-elle pas que Jean du Lis n’avait ni frères, ni sœurs, ni neveux, ni nièces, tandis qu’on suppose qu’il avait deux sœurs, ou vivantes ou ayant des enfants, et un frère ?… Jusqu’à ce qu’on ait répondu à mes questions, il me sera permis de douter de la généalogie de Charles du Lis…
(Bibliothèque publique d’Orléans. — Manuscrits de M. l’abbé Dubois, t. II, p. 55 et suiv.) - [145]
M. le grand doyen de Toul, mon cousin, et autres, m’ont assuré ledict Pierre d’Arc avoir esté marié en Lorraine… dont est sorti ladicte Hauvy… mariée audict feu Estienne Hordal… et la mère de ladicte Hauvy étant morte, ledict Pierre auroit convolé en France à de secondes noces, dont MM. du Lis, vos prédécesseurs, sont extraicts…
(Lettre de Jean Hordal à Charles du Lis, en date du 25 mars 1610. — Archives de M. de Maleissye.)La même hypothèse, toujours sans indication de preuves, est reproduite, en termes presque identiques, dans la lettre de Jean Hordal à Charles du Lis, du 2 avril 1611. (Ibid.)
- [146]
Jean du Lis, second fils de Jacques d’Arc et d’Isabelle Romée, tient, lui aussi, dans l’histoire, un rang honorable auprès de sa noble sœur. — Il était avec elle à Neufchâteau, quand elle s’y réfugia, dans son enfance, avec sa famille. (Quicherat, Procès, t. II, p. 423.) — Il l’accompagna de Vaucouleurs à Chinon, puis à Blois. à Orléans et dans ses glorieuses campagnes. (Ibid., t. IV, p. 126 et 153.) — Anobli avec sa famille en 1429, il eut le titre d’écuyer. (Ibid., t. V, p. 151 et 279.) — Des dons affectueux lui furent faits par les Orléanais. (Comptes de commune, 1429, 1436, etc.) — Nommé bailli de Vermandois et capitaine de Chartres (Registres de la Chambre des comptes), il en exerça peu les fonctions ; mais prévôt de Vaucouleurs, il occupa cette charge jusqu’en 1468 (Ibid., t. V, p. 280), et en cette qualité il prit part, en 1456, aux enquêtes faites dans le pays de Jeanne, pour la réhabilitation. — Puis il suivit personnellement le procès à Paris et à Rouen, avec Guillaume Prévosteau, fondé de pouvoirs de sa mire Isabelle. (Ibid., t. III, p. 255 à 362.) — Jean recevait du Trésor une pension de 121 livres tournois. — Il se maria, eut deux fils et une fille, Marguerite, épouse d’Antoine de Brunet, et vivait [encore en 1470, au dire d’un des témoins de l’enquête de 1476.
- [147]
Voir chapitre XII §4, et chapitre XVI, §§3 et 4.
On estime généralement que la descendance masculine des frères de la Pucelle s’est complètement éteinte au cours du XVIIe siècle.
- [148]
Lettres-patentes d’Henri II, en 1550 et 1555 ; du duc Charles de Lorraine, en 1596 ; de Louis XIII, en 1612 ; de Charles X, en 1827, etc.
- [149]
Lettres pour augmentation d’armoiries, accordées le 25 octobre 1612 à MM. du Lis, de la lignée de la Pucelle d’Orléans.
- [150]
Aujourd’hui département de la Marne.
- [151]
Thomas Senlis confond le roi Charles VII et le duc Charles d’Orléans. Mais on ne peut douter qu’il ne s’agisse ici de l’Île-aux-Bœufs, en la paroisse de Chécy.
- [152]
Déposition d’Apparu Jacquart, en l’enquête de Domrémy du 16 août 1502.
- [153]
Il est à remarquer qu’hormis ce bail du 8 mai 1452, aucun acte émané de Pierre du Lis, du vivant de sa mère, n’indique spécialement en quelle paroisse rurale il avait son séjour.
- [154]
Archives municipales d’Orléans, compte de commune Me Jean Bureau, 1455, 1456. Cette indication inusitée : pour avoir ses nécessités en ladite ville, est reproduite trois fois de suite dans le compte de Jehan Bureau :
1° Au VIIe mandement, pour les mois cumulés d’avril, mai, juin, juillet et août 1455 ;
2° Au XIe mandement, pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre ;
3° Au XIXe mandement, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 1456.
La mention du paiement mensuel de la rente revient à plusieurs reprises, dans ce même compte, savoir : deux fois au XXIVe mandement, pour juillet et août, et quatre fois au XXVe, pour septembre, octobre, novembre et décembre 1456. Or, dans ces six dernières mentions, l’indication : pour avoir ses nécessités en ladite ville, a disparu.
On pourrait presque en induire qu’Isabelle n’a habité la ville que durant vingt-un mois : d’avril 1455 à décembre 1456, c’est-à-dire durant le cours du procès de réhabilitation.
- [155]
Enquête de 1476, en la prévôté de Vitry. Déposition de François Collesson, manouvrier à Faveresse, près Bar-le-Duc, de Thomas Senlis et autres. (Voir chapitre XVI, §2.)
- [156]
Une inscription, placée par les soins de M. Doinel et du propriétaire, M. Desseaux, à la façade extérieure de la maison construite sur l’emplacement de celle de 1452, conserve cet intéressant souvenir. Elle est conçue en ces termes, peut-être un peu trop explicites :
1452-1509
Sur l’emplacement de cette maison
s’élevait la demeure de Pierre du Lys
frère et compagnon d’armes
de Jeanne d’Arc. - [157]
Voir chapitre III. — Une notice d’un grand intérêt sur Charles du Lis a été publiée par M. Vallet (de Viriville), en sa réédition du Traité sommaire (Paris, Aubry, 1856).
- [158]
Mlle de Villaret, dans ses savantes recherches aux archives municipales d’Orléans, a retrouvé l’acte de baptême de Catherine de Cailly, et a eu la bonté de me le communiquer. Cet acte est ainsi conçu :
Le vingt-cinquième jour du moys de novembre mil cinq cent soixante-quatorze.
Katherine, fille de noble homme Jacques Cailly, seigneur de Rouilly, et de dame Bernarde Moreau, sa femme, a esté baptisée par moy, soubzsigné, curé de ladite église Bonnes Nouvelles ; laquelle a esté levée sur les sainctz fons de baptesme par honorable homme Guillaume Tranchot, marchant-bourgoys d’Orléans, parain, et par Jehanne Moreau, femme de honorable homme Jacques Picard, et par Jehanne Moreau (sic), femme de honorable homme Mathurin Brébard, marchant bourgoys d’Orléans.
Signé :De Dinant.
(Archives municipales d’Orléans. — Registres paroissiaux de l’église de Bonnes-Nouvelles.)M. Vallet de Viriville, qui ne connaissait pas l’acte de naissance de Catherine de Cailly, dit donc à tort, dans sa notice sur Charles du Lis (Aubry, 1856, p. XX), qu’il épousa Mlle de Cailly vers 1580. — Il ajoute, à tort également, que leur fils aîné, Charles du Lis, principal du collège de Boissy, naquit en 1585 ; c’est vraisemblablement vers 1595 qu’il faut lire.
- [159]
Première expédition de Jeanne d’Arc pour le ravitaillement d’Orléans. (Orléans, 1874, chap. VI, §2.)
- [160]
Quicherat, Procès, t. V, p. 342. — Lettres d’anoblissement des Cailly.
- [161]
On appelait souvent à cette époque Mademoiselle les femmes des gens de qualité, et particulièrement des magistrats de haut rang.
- [162]
Ce titre est donné à Jacques de Cailly dans une curieuse inscription funéraire placée par lui au transept nord de l’église de Chécy, en souvenir de sa femme et de plusieurs de ses enfants. Je l’ai publiée dans la Première expédition de Jeanne d’Arc, note XVe.
- [163]
Étienne Pasquier, en ses Recherches de la France, nous a conservé quelques lettres et poésies de Catherine du Lis (t. II, p. 667 et suiv.). — Plusieurs autres pièces de vers en diverses langues, tant de Jacques de Cailly que de Catherine du Lis, sa sœur, se lisent dans le Recueil d’inscriptions de Charles du Lis et dans divers écrits du temps.
- [164]
M. Amédée Thierry, sénateur, membre de l’Institut, né à Blois. Lettre écrite à l’auteur à l’occasion du premier concours quinquennal ouvert en 1869 par la Société archéologique et historique de l’Orléanais.
- [165]
Les œuvres d’Étienne Pasquier, et diverses collections publiques et privées, témoignent de l’active correspondance de ces dévoués champions de la Pucelle.
- [166]
Jean Hordal, conseiller d’État du duc de Lorraine, professeur à l’Université du Pont-à-Mousson, auteur de l’ouvrage latin : Nobilissimæ heroinæ Johannæ d’Arc historia…, dans ses lettres à Charles du Lis, parle souvent de M. de Reuilly (Jacques de Cailly).
- [167]
François Le Maire, Histoire et antiquités de la ville et duché d’Orléans, Orléans, 1645, 1ère partie, chap. XL.
- [168]
Symphorien Guyon, Histoire de l’Église, diocèse, ville et université d’Orléans, Orléans, 1650, 2e partie, chap. LXXXVII et suiv.
- [169]
Charles de la Saussaye, doyen de l’Église d’Orléans, Annales Ecclesiæ Aurelianensis,1615, livre XIV.
- [170]
Recueil de plusieurs inscriptions proposées pour remplir les tables d’attentes, estans sous les statues du roy Charles VII et de la Pucelle d’Orléans… sur le pont de la ville d’Orléans… et de diverses poésies faites à la louange de la mesme Pucelle. (1ère édit., Orléans, 1613 ; 2e édit. in-4., Paris, Édit. Martin, 1628.)
- [171]
Jean Chanterel, seigneur de Rezons, auditeur à la Chambre des Comptes.
- [172]
Marie de Quatrehommes, fille de Louis de Quatrehommes et de Françoise du Lis, épousa en 1654 Achille de Barentin, conseiller au Parlement de Paris, frère de Jacques de Barentin, premier président de la Cour des aides. (Un des membres de cette honorable famille, Charles-Amable-Honoré de Barentin, conseiller d’État, mort en 1762, fut intendant d’Orléans.)
Des onze enfants nés du mariage de Marie de Quatrehommes et d’Achille de Barentin, une fille, Anne de Barentin, eut seule postérité. Elle s’unit en 1684 à Jacques de Tardieu, marquis de Maleissye et de Melleville, capitaine aux gardes françaises.
Les Tardieu de Maleissye, qui comptent dans leur famille des conseillers d’État, des lieutenants-généraux, gouverneurs de ville, des dames d’honneur de la reine, etc., devenus ainsi aujourd’hui seuls héritiers de Charles du Lis et de Catherine de Cailly, ont, en notre Orléanais, leur principale résidence au château d’Houville, près Chartres (Eure-et-Loir).
Charles-Étienne de Tardieu, marquis de Maleissye, arrière-petit-fils de Jacques de Maleissye et d’Anne de Barentin, est mort à Houville le 1er novembre 1872, laissant, après lui, le souvenir vénéré des plus éminentes qualités. Son dévouement, dans la guerre néfaste de 1870, fut au-dessus de tout éloge. Ancien officier et presque septuagénaire, il fit, comme volontaire, les campagnes de la Loire et du Mans. Son fils aîné était chef de bataillon des mobiles d’Eure-et-Loir, un autre de ses fils capitaine.
- [173]
Enquêtes de 1452, faites par les soins du cardinal d’Estouteville, antérieurement au procès de réhabilitation. (Quicherat, Procès, t. II, p. 291, et t. V, p. 215.)
- [174]
Enquête à Domrémy et Vaucouleurs, janvier 1456 (Quicherat, Procès, t. II, p. 378) ; — à Orléans, février et mars 1456 (ibid., III, p. 1 et suiv.) ; — à Paris et à Rouen, janvier et mai 1456 (ibid., III ; p. 35) ; à Lyon, 28 mai 1456 (ibid., III, p. 206).
- [175]
Une expédition de cette intéressante information, levée par Charles du Lis, est, je l’ai déjà dit, conservée par M. de Maleissye.
- [176]
Quicherat, Procès, t. II, p. 439.
- [177]
Copie de cet acte fut délivrée à Collot (de Perthes), par Hugues d’Orges, écuyer, prévôt de Vaucouleurs, revêtue du scel de cire verte de la prévôté.
- [178]
Sermaize en Barrois (Marne), petite ville sur les confins des départements de la Marne et de la Meuse, entre Vitry et Bar-le-Duc, à peu de distance de Vaucouleurs. Environ 2,000 habitants ; restes d’anciennes fortifications, etc.
Faveresse, village près de Sermaize.
- [179]
Marguerite (?). D’après plusieurs autres témoins, elle était née à Sermaize.
- [180]
Voir, pour la descendance de Jehan (de Vouthon), le troisième tableau généalogique ci-annexé (2e partie).
La noblesse de cette branche collatérale a été reconnue et confirmée par sentence du siège présidial de Vitry, le 16 août 1585. (Charles du Lys, Traité sommaire, chap. II.)
- [181]
Voir ces récits, chapitre XII, §2.
- [182]
Enquête de 1476. — Dépositions de Jehan Collin l’aisné et de Jehanne, veuve de Jehan Remy.
- [183]
Récit de Pierre Sala. (Quicherat, Procès, t. IV, p. 281.)
- [184]
Journal de Paris sous Charles VI et Charles VII. (Quicherat, Procès, t. V, p. 335.)
- [185]
Archives nationales, P 13343, cote 10, fo 199.
- [186]
Lecoy de la Marche, archiviste aux archives nationales : Une fausse Jeanne d’Arc. (Revue des questions historiques, 1er octobre 1871, p. 562.)
- [187]
M. Wallon, dans sa belle histoire de Jeanne d’Arc, cite avec de justes éloges, bien qu’avec quelques réserves, l’étude, très-remarquable d’ailleurs, de M. Lecoy de la Marche. (Jeanne d’Arc, par M. H. Wallon, XXIIIe appendice, tome II, pp. 416 à 420. — 3e édition, in-12, 1875.)
- [188]
Je dois, à cette occasion, remercier, une fois encore, MM. de Maleissye et de Bouteiller d’avoir bien voulu me permettre de publier ces détails dans la précieuse enquête de 1476, qu’ils ont le louable projet de publier en son entier. À eux appartient tout l’honneur de ces révélations historiques.
- [189]
Archives nationales, R4 20287. — Recueil de copies de pièces.
- [190]
Voir ci-dessus, chapitre XII.
- [191]
Cette enquête, je l’ai déjà remarqué, est complètement inédite. Une expédition authentique, aujourd’hui possédée par M. de Maleissye, fut levée par Charles du Lis, qui ne crut pas devoir en faire usage en son Traité sommaire.
- [192]
Il ne serait pas impossible que, par erreur de copiste, le nom de Jean de Villebresme, notaire et secrétaire du roi, fût ici, et à tort, répété deux fois. S’il en était ainsi, Jean de Villebresme serait aïeul de Marie de Villebresme, épouse de Jacques Le Fournier, au lieu d’être son bisaïeul, comme il semblerait l’être, d’après ce texte littéralement accepté.
- [193]
- [194]
Traité sommaire, chap. IX.
- [195]
Archives de M. de Maleissye.
- [196]
J’ai fait connaître ailleurs que ces affirmations étaient complètement inexactes. (Voir chapitre XIII, §2.)
- [197]
Ce n’est pas sur ce fait seulement que les affirmations de Charles du Lis et celles de l’enquête d’avril 1551 présentent des divergences difficiles à concilier. Le Traité sommaire, par exemple, donne pour fille à Étienne, fils de Jean, prévôt, et dès lors pour nièce à Claude, frère d’Étienne, une Didon du Lis, de Domrémy, qui, devenue veuve de Thévenin Thierriel ou Thierrely, aurait fait, par acte du 26 février 1552, donation de ses biens aux enfants de son frère, Didier du Lis.
Or, dans l’enquête d’avril 1551, Didon du Lis, de Domrémy, veuve Thévenin Thibert, déclare être fille de noble homme Claude du Lis et de Nicolle Thiesselin, son épouse. — Si ces deux Didon du Lis sont des personnes distinctes, elles ont d’étranges similitudes de nom, d’âge, de domicile et de veuvage. — Si elles ne sont qu’un seul et même personnage, comment concilier la diversité de leur origine ?
Bien que la filiation d’Étienne du Lis ne se rattache pas directement à l’objet principal de mes recherches, j’ai dû signaler, en passant, ce point obscur, que l’absence de titres précis ne m’a pas permis d’éclaircir.
- [198]
Les informations faites à la requête des Le Fournier furent couronnées de succès. Plusieurs arrêts de juridictions financières, conformément aux lettres-patentes de 1550, reconnurent et consacrèrent les prérogatives nobiliaires de cette famille et l’autorisèrent à jouir des immunités qui en résultaient en sa faveur.
- [199]
Archives de M. de Maleissye.
- [200]
Ou Voyseul.
- [201]
Traité sommaire, chap. II.
- [202]
Chalaines, village attenant à Vaucouleurs.
- [203]
Burey-en-Vaux, quelquefois Burey-le-Petit, village près de Domrémy, à quatre kilomètres de Vaucouleurs.
- [204]
Ou Laxart. (Voir ci-après.)
- [205]
Conformément à sa requête, Jean Royer, rapporte Charles du Lis, obtint en 1555 des titres de confirmation de noblesse pour lui et ses descendants.
- [206]
Voir le troisième tableau généalogique, 2e partie.
- [207]
Dépositions, en 1456, d’Isabelle, femme de Gérardin ; de Mengete, femme de Jean Soyart ; de Colin, fils de Jean Colin. (Quicherat, Procès, t. II, pp. 428, 430, 434) ; déposition d’Hallouy Robert, en 1555.
- [208]
Jeanne, femme de Durand Laxart (ou Lassois), n’existait probablement plus en 1456, puisqu’elle ne figure pas parmi les témoins de l’enquête pour la réhabilitation.
- [209]
Dépositions de Jeannette, femme de Thévenin Le Roy, et de Perrin Drapier (de Domrémy), de Gérard Guillemette (de Greux), de Bertrand de Poulengy. (Quicherat, Procès, t. II, pp. 399, 414, 416, 456.)
- [210]
Dixit ultro (Johanna) quod ivit ad avunculum suum… dixitque suo præfato avunculo, quod opportebat eam ire ad oppidum de Vallicoloris, et ipse avunculus ejus illo duxit eam…
(Procès de condamnation, Quicherat, Procès, t. I, p. 53.) - [211]
Le déposant dit, en sa loyaulté et conscience, être bien recordz que ung nommé messire Pierre du Lis, chevalier, étoit accompagné d’ung nommé Perrinet (de Voulton), charpentier, demourant lors à Sermaize, lequel il disoit être son nepveu… ; est aussi bien recordz que feue Mengotte, femme de Pierre (de Perthes)… appeloit messire du Lis son oncle…
— Enquête de 1476. — Déposition de François Collesson, 13e témoin. (Voir le troisième tableau généalogique.) - [212]
Une locution analogue est encore usitée dans plusieurs de nos provinces : oncle à la mode de Bretagne.
M. Vallet de Viriville aurait donc fait erreur quand il dit, avec quelque hésitation d’ailleurs, et sans aucune preuve, que Durand Laxart était oncle de la Pucelle, parce qu’il aurait épousé une Jeanne, veuve d’un Nicolas d’Arc, frère du père de Jeanne d’Arc. (Nouvelles recherches, etc., p. 10.) Cette veuve est complètement inconnue.
- [213]
Archives de M. de Maleissye et de M. de Haldat (de Lorraine).
- [214]
- [215]
Auteur de l’ouvrage déjà cité : Nobilissimæ heroinæ Johannæ d’Arc, etc.
- [216]
Voir Charles du Lis, Traité sommaire, chapitre VI et VIII.
- [217]
Interrogata de nomine patris et matris, respondit quod pater vocabatur Jacobus d’Arc, mater vero Ysabellis. (Interrogatoire du 21 février 1431.) …Postea vero dixit, quod erat cognominata d’Arc seu Rommée, et quod, in partibus suis, filiæ portabant cognomen matris…
(Interrogatoire du 24 mars, Quicherat, Procès, t. I, p. 46 et 191.) - [218]
La déclaration formelle de Jeanne d’Arc, en son interrogatoire du 10 mars 1431, ne permet pas de douter que les nobles armoiries portées par ses frères ne leur aient été concédées par Charles VII.
Interroguée s’elle avoit point escu et armes : respond qu’elle n’en eust oncques point ; mais son roy donna à ses frères armes, c’est assavoir, ung escu d’asur, deux fleurs de liz d’or et une espée par my… Item, dit que ce fut donné par son roy à ses frères, à la plaisance d’eulx, sans la requeste d’elle et sans révélacion…
(Quicherat, Procès, t. I, pp. 117 et 300.)Quant au diplôme officiel de cette concession d’armoiries, ainsi que du nom de du Lis, il était dès le temps de Charles du Lis oublié ou perdu. Les lettres d’anoblissement de 1429 sont muettes sur ce point, et les lettres confirmatives du 25 octobre 1612 ne mentionnent nommément aucun titre.
Nous ignorons donc aujourd’hui si l’addition du nom de du Lis au nom patronymique d’Arc fut accordée par un diplôme spécial, ou fut seulement la conséquence de l’octroi des armoiries.
- [219]
Pièce inédite trouvée et publiée par M. Quicherat, Procès, t. V, p. 209.
- [220]
Quicherat, Procès, t. II, p. 387, 451, 464.
- [221]
Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie, en 1580, édition de 1774, in-4°.
- [222]
Les deux lettres citées plus haut (p. 89), adressées à l’avocat général Charles du Lis, les 12 août 1609 et 13 mars 1611, par M. Claude du Lis, de Vaucouleurs, sont signées C. Daily.
- [223]
Chapitre XVI, §4, no 1.
- [224]
P. Grégoire, professeur de droit à Pont-à-Mousson, Republica, livre VII.
- [225]
Quicherat, Procès, t. V, note de la page 150.
- [226]
Charles du Lis, De l’extraction et parenté de la Pucelle d’Orléans, 1610, réimpression de 1856, p. 4.
M. Claude du Lis (de Vaucouleurs), dans sa lettre du 12 août 1609, à Charles du Lis, conservée par M. de Maleissye, déclare formellement que le diplôme d’anoblissement de 1429 était entre les mains du baron de Tournebut.
- [227]
Vallet de Viriville, Bibliothèque de l’école des chartes, 1854, 3e série, t. V, p. 271 et suiv., et Nouvelles recherches, p. 27 a 30.
- [228]
Traité sommaire et lettres-patentes du 25 octobre 1612.
- [229]
Nouvelles recherches sur la famille et sur le nom de la Pucelle, etc.