La Guerre de Cent ans (G. Minois, 2016)
La Guerre de Cent ans (Georges Minois, 2016)
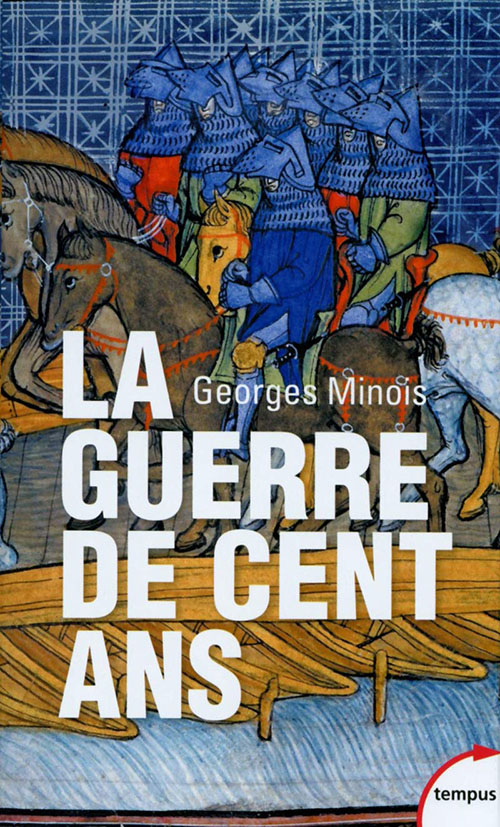
Commentaire
Avis général
Cette vision caricaturale de l’épopée de Jeanne d’Arc aurait pu être écrite par un encyclopédiste de la première génération : mépris d’un Moyen Âge dépeint comme ignare et superstitieux, minimisation grossière, voire effacement de Jeanne.
La disparition de Jeanne d’Arc
Voici comment Minois raconte la levé du siège d’Orléans :
Dunois préfère attendre l’arrivée des renforts, et avec eux il prend la bastide Saint-Loup, à l’est de la ville, le 4 mai. Le 6, une sortie est effectuée ; on traverse la Loire à l’amont d’Orléans, et on s’empare des Tourelles, à l’extrémité du pont, sur la rive sud, le 7 mai, Le 8, on se prépare à une bataille rangée sous les murs de la ville, lorsque les Anglais décident de lever le siège.
C’est probablement la seule narration de la libération d’Orléans où le nom de Jeanne d’Arc n’apparaît pas. Où était-elle et que faisait-elle, se demande-t-on ? On l’apprend plus loin :
Jeanne n’a fait qu’assister aux combats.
Mieux, son nom n’est pas même évoqué lors de toute la campagne de la Loire et les batailles de Jargeau, Beaugency et Patay. L’héroïne n’aurait donc prit part à aucune action militaire ? Si. Minois nous rapporte un fait d’arme. Nous sommes après le sacre, Charles VII a dissous l’armée et a regagné ses pays de Loire :
[Jeanne] commence à agacer sérieusement l’entourage royal. On lui trouve un petit emploi pour l’hiver : à cinquante kilomètres de Bourges, il y a un chef de bande qui travaille pour les Anglo-Bourguignons, Perrinet Gressart. Puisqu’elle tient tant à se battre, qu’elle aille le déloger. C’est un échec complet, qui en fait ricaner plus d’un.
Résumons. Jeanne n’a rien fait, et heureusement ; car le jour où l’idée lui est venue de se mêler de guerre, l’affaire a tourné à la farce.
De bout en bout, qu’il parle de Jeanne, de Charles VII (et de son sacre à la sauvette
) ou des mœurs du temps, l’auteur ne se départ jamais de son ton goguenard :
Les illuminés courent les rues en cette époque.
Le sacre est bâclé. [Les instruments royaux sont entre les mains des Anglais à Saint-Denis.] On va donc utiliser des copies. Par contre, il reste du saint chrême, dans la sainte ampoule apportée par un ange pour le baptême de Clovis et qui depuis reste miraculeusement à un niveau constant. On est en plein merveilleux. Jeanne d’Arc est aux anges.
On pense qu’elle peut déclencher des orages. […] [Elle a] l’aplomb de ceux qui se croient inspirés. […] [Devant Paris] Jeanne d’Arc est la curiosité du jour. […] Etc., etc.
Georges Minois, cette énigme…
Texte
Extrait de la Guerre de Cent ans de Georges Minois, édition Tempus Perrin (mars 2016), format poche (816 pages), p. 432-442.
432En avril 1429, on organise à Blois un convoi de vivres qui doit remonter la Loire pour ravitailler les assiégés. Il est escorté par La Hire, Ambroise de Loré, Louis de Granville, amiral de France, Gilles de Rais, et une jeune fille récemment arrivée de Lorraine, Jeanne d’Arc, au sujet de laquelle Dunois et les habitants d’Orléans s’interrogent. Le bâtard d’Orléans s’est renseigné sur la demoiselle en envoyant le sire de Villars et Jamet du Tillet auprès du roi. Ils reviennent avec les nouvelles, suivantes : Jeanne vient du pays de Bar, des environs de Vaucouleurs ; elle se présente comme inspirée, saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, particulièrement vénérés dans cette région, lui ayant confié la mission d’aller trouver le dauphin
Charles, pour le faire couronner à Reims après avoir délivré Orléans. Le 4 mars, elle est arrivée à Chinon, où se trouvait Charles VII, qui est extrêmement méfiant et ne la reçoit que le 6. Il n’est pas surpris outre mesure, car les illuminés courent les rues en cette époque de tensions exacerbées. Ce qui se passe lors de l’entretien a malheureusement été déformé par la légende hagiographique, colportée par la propagande royale, relayée plus tard par celle du patriotisme républicain, et orchestrée par l’Église catholique avec une telle constance que la légende a fini par acquérir un quasi-statut de vérité historique. Seul fait avéré, par Raoul de Gaucourt notamment, un esprit sobre, qui était présent : la fille, pour une bergère, fait preuve d’une belle assurance, qui ébranle un peu le roi. Ce dernier se laisse persuader par le duc d’Alençon, un jeune homme plutôt exalté, arrivé quelques jours plus tard à Chinon et tout de suite convaincu de la mission divine de Jeanne, de la faire examiner à Poitiers. Examens gynécologique et théologique, les deux étant liés : la demoiselle se prétend pucelle, condition indispensable comme garantie de vertu et de consécration à Dieu, et prouvant également qu’elle n’a pas eu commerce avec 433le diable. La virginité étant prouvée, les docteurs en théologie vérifient ensuite le caractère orthodoxe de ses croyances. Examen concluant, à l’issue duquel l’avocat du parlement Jean Barbin conclut : Étant donné la nécessité où se trouvaient le roi et le royaume, puisque le roi et les habitants qui lui étaient fidèles étaient à ce moment-là au désespoir et ne savaient quel espoir d’aide avoir s’il ne lui venait de Dieu, que le roi pouvait s’aider d’elle.
Même conclusion du dominicain Seguin : Nous avons rapporté tout cela au conseil du roi et nous fûmes d’opinion que, étant donné la nécessité pressante et le péril dans lequel était la ville d’Orléans, le roi pouvait s’aider d’elle et l’envoyer à Orléans.
Traduisons : au point où nous en sommes, nous ne risquons pas grand-chose à l’envoyer à Orléans. C’est bien ce que pense Charles VII. Le souverain, introverti, hésitant, et aimant les belles femmes, n’a aucune affinité pour cette fille aux allures de garçon, qui tape sur l’épaule des soldats et affiche une assurance insolente. À aucun moment on ne relève chez le roi le moindre signe de sympathie pour Jeanne, qui est aux antipodes de son tempérament et dont le comportement l’agace. La Trémoille, Regnault de Chartres sont tout aussi choqués par son aplomb, l’aplomb de ceux qui se croient inspirés et qui pensent donc que cela leur donne le droit de mépriser les avis contraires.
Yolande d’Anjou va financer la petite expédition. Charles VII lui envoie le duc d’Alençon, qui organise le convoi à Blois, où Jeanne arrive après s’être fait faire une armure et un étendard à Tours. Vers la fin avril, on se met donc en route vers Orléans, où on entre le 29, après un long détour pour traverser la Loire en amont. Les capitaines sont assez réticents devant la tactique rudimentaire préconisée par Jeanne : foncer directement sur l’ennemi et le battre avec l’aide de Dieu. 434Dunois préfère attendre l’arrivée des renforts, et avec eux il prend la bastide Saint-Loup, à l’est de la ville, le 4 mai. Le 6, une sortie est effectuée ; on traverse la Loire à l’amont d’Orléans, et on s’empare des Tourelles, à l’extrémité du pont, sur la rive sud, le 7 mai, Le 8, on se prépare à une bataille rangée sous les murs de la ville, lorsque les Anglais décident de lever le siège.
Le sacre de Charles VIII (1429)
La soudaineté de l’événement frappe les esprits et lui donne les allures d’un miracle. Jeanne n’a fait qu’assister aux combats. Sa présence a peut-être stimulé les soldats, mais le départ des Anglais n’a évidemment rien de miraculeux. Cela fait sept mois qu’ils sont devant Orléans, et ils viennent de subir deux échecs. Le bon sens leur fait comprendre qu’il est inutile de s’obstiner. À Paris, c’est la consternation. Le Bourgeois est déconcerté ; il ne peut pas croire à cette histoire de pucelle armée
. Les capitaines anglais sont furieux. Talbot ne décolère pas devant la couardise des hommes qui ont été impressionnés par cette putain de vachère
. Bedford est plus poli, mais il écrit à Henry VI que le motif du désastre se trouve, selon moi, en grande partie, dans les folles idées et la peur déraisonnable inspirées à vos gens par un disciple et limier du diable, appelé la Pucelle, qui a usé de faux enchantements et de sorcellerie
.
La nouvelle se répand rapidement par la correspondance des grandes maisons de commerce et des banques : en Italie, en Allemagne, l’événement est commenté, et le mythe apparaît : la naissance de Jeanne a été entourée de phénomènes merveilleux ; elle n’a jamais perdu une seule brebis ; elle peut rester six jours et six nuits armée… Le plus sobre est encore Charles VII, 435qui dans une lettre circulaire qu’il envoie aux villes du royaume pour annoncer la délivrance d’Orléans, ne mentionne la présence de Jeanne qu’au détour d’une phrase, de façon très anecdotique : La Pucelle … a toujours été en personne à l’exécution de toutes ces choses.
À Londres, on s’émeut. L’échec d’Orléans est ressenti comme un affront à la nation : Jeanne d’Arc a autant contribué au développement du patriotisme anglais qu’à celui des Français. Bedford demande des renforts. C’est justement l’époque où le cardinal Beaufort rassemble des troupes dans le Kent en vue de conduire une croisade contre les Hussites, à la demande du pape. Ce n’est pas le moment de détourner des soldats vers l’Europe centrale. L’expédition est annulée. Bedford demande également que Henry VI soit sacré, afin d’augmenter sa légitimité. En novembre 1429, cela est fait à Westminster, comme roi d’Angleterre ; mais il faudrait aussi qu’il soit sacré roi de France.
Dans l’immédiat, il faut d’abord rétablir la situation militaire, car cela va de mal en pis. Sur la lancée d’Orléans, les Français ont pris Jargeau, le 12 juin ; le comte de Suffolk a été fait prisonnier ; puis c’est Beaugency qui tombe. Et le 18 juin, désastre. L’armée anglaise, pourtant commandée par ses meilleurs capitaines, Talbot, Fastolf, Scales, est complètement battue entre Orléans et Chartres, à Patay, par des Français dirigés par Richemont, qu’on a enfin autorisé à revenir, La Hire, Xaintrailles, Gaucourt, Dunois, Alençon, La Fayette, le comte de Laval, Gilles de Rais, ce qui fait beaucoup de chefs. Bataille extrêmement confuse, où une mésentente entre Talbot et Fastolf provoque une panique et finalement la déroute. Les Anglais laissent 2.000 morts et 200 prisonniers, dont Talbot et Scales. John Talbot, absolument furieux, accuse Fastolf d’être responsable de la déroute et d’avoir fui comme un lâche. La rivalité 436entre les deux hommes est déjà ancienne. Fastolf, qui avait capturé le duc d’Alençon à Verneuil, s’était plaint qu’on ne lui avait pas versé toute sa part de la rançon. En 1426, il avait reçu l’ordre de la Jarretière à la suite de ses succès dans le Maine, mais Talbot l’avait remplacé comme gouverneur d’Anjou et du Maine. Sa victoire à la bataille des harengs avait provoqué la jalousie de Talbot, qui se venge maintenant en l’accusant de couardise. Accusation reprise par Monstrelet et qui semble être à l’origine de la caricature tout à fait injuste que Shakespeare fera du personnage, sous le nom de Falstaff, dans Henry IV.
Les Français ont alors le choix entre deux options : la reconquête de la Normandie, option stratégique qui a les faveurs de La Trémoille et de Regnault de Chartres, et le sacre de Charles VII à Reims, option symbolique énergiquement défendue par Jeanne d’Arc, qui l’emporte. Problème : Reims est en territoire ennemi, il va falloir se frayer un chemin à coups d’épée. L’entreprise est risquée, et le roi n’est pas très enthousiaste. Il réunit malgré tout une armée à Gien, et se met en route le 29 juin. Il faut profiter du désarroi des Anglais. Il y a des obstacles sur la route, et il faudra dix-sept jours pour franchir les 250 kilomètres de Gien à Reims. On est en territoire bourguignon, et les garnisons des villes qui se trouvent sur le trajet sont assez embarrassées, car l’attitude de Philippe le Bon est hésitante. À Auxerre, il faut parlementer trois jours avant que les bourgeois acceptent finalement de fournir des vivres à l’armée. Troyes est un obstacle plus redoutable. Lieu de la signature du traité qui est à l’origine de tous les problèmes, la ville est bien défendue, par une garnison de 600 Anglais et Bourguignons, et se prépare à un siège. Mais la guerre de Troyes n’aura pas lieu : l’évêque et les bourgeois, impressionnés par les préparatifs français, cèdent. La marche continue. Châlons-sur-Marne ouvre ses 437portes le 12 juillet, et le 16 on est devant Reims, dont le capitaine, le seigneur de Châtillon, ne s’estime pas en mesure de résister. Charles entre à Reims le samedi 16 juillet au soir. Il est sacré le lendemain matin, 17, dans la cathédrale.
C’est dire que le sacre est bâclé. On ne peut s’attarder en territoire hostile. On doit réunir à la hâte tout l’attirail symbolique nécessaire à la cérémonie, les regalia : sceptre, main de justice, oriflamme, couronne. Mais tous ces objets sont à Saint-Denis, aux mains des Anglais. On va donc utiliser des copies. Par contre, il reste du saint chrême, dans la sainte ampoule apportée par un ange pour le baptême de Clovis et qui depuis reste miraculeusement à un niveau constant. On est en plein merveilleux. Jeanne d’Arc est aux anges.
Qu’il s’agisse d’un sacre à la sauvette, c’est une évidence. Il manque d’ailleurs des personnages de marque : la reine, le connétable, le premier pair du royaume (le duc de Bourgogne), le duc de Bretagne, autre pair laïc, l’évêque de Beauvais, pair ecclésiastique. Il n’existe aucun récit de la cérémonie, alors qu’habituellement les chroniqueurs sont intarissables sur les fastes du rituel. On espère cependant que l’effet sera le même. Car le sacre est supposé donner au roi un prestige symbolique essentiel pour son autorité, lui conférer une légitimité d’origine divine. Le premier souverain à avoir été oint et consacré est Louis le Pieux, fils de Charlemagne, en 816, et depuis Henri Ier, en 1026, un seul roi n’a pas été sacré à Reims, Louis VI. Le sacre fait du roi un personnage exceptionnel, participant à la nature divine, et cet aspect se renforce considérablement depuis le milieu du XIVe siècle. Sous le règne de Charles V, grand-père de Charles VII, le carme Jean Golein, dans son Traité du sacre, compare ce dernier à l’entrée en religion et au baptême : il donne un statut nouveau au personnage, et efface tous ses péchés.
438Le sacre de 1429, effectué dans des conditions particulièrement difficiles, accentue aux yeux des contemporains l’élément surnaturel : l’intervention divine, pour beaucoup, semble manifeste : le roi s’est frayé miraculeusement un chemin par la force, en territoire hostile, jusqu’à Reims ; il est guidé par la Pucelle, dont la renommée atteint son zénith. Dans beaucoup de lieux, on commence à honorer cette dernière comme une sainte ; on lui apporte des objets et des malades à toucher ; on lui demande même à Lagny de ressusciter un enfant ; on en fait des statuettes ; on fait sur elle des chansons ; on pense qu’elle peut déclencher des orages ; en Allemagne et en Italie on disserte sur son cas. Certains dirigeants lui demandent son aide, comme Bonne Visconti pour récupérer le duché de Milan. Les intellectuels sont eux-mêmes gagnés par l’enthousiasme : Jean Gerson, qui est réfugié à Lyon, a rédigé en juin une défense de la Pucelle, juste avant de mourir, le 12 juillet. Christine de Pisan célèbre en 448 vers l’événement du sacre, qu’elle attribue elle aussi à une intervention divine.
D’un sacre à l’autre (1429-1431)
Et le sacre crée une dynamique, dont Jeanne d’Arc voudrait profiter. Des villes du Soissonnais, du Valois, de Picardie, des pays de Senlis et de Beauvais envoient spontanément des messagers, qui apportent leurs clés au souverain. Le duc de Bourgogne lui-même semble hésiter. En tout cas, il est courtisé par les deux côtés. Dès le 30 juin, La Trémoille avait ouvert des négociations ; le 16 août, Regnault de Chartres arrive à Arras et fait des offres intéressantes. De son côté, Bedford l’invite à passer quelques jours à Paris, du 10 au 15 juillet, donne des fêtes en son honneur, et le comble 439de cadeaux. Puis il lui envoie Hugues de Lannoy. Philippe est plus que jamais en position d’arbitre.
Bedford s’attend maintenant à une attaque sur Paris, dont il renforce les défenses. Le 25 juillet, il reçoit enfin en renfort les soldats que son oncle Henry Beaufort avait équipés pour la croisade hussite, et plutôt que d’attendre Charles VII, il va à sa rencontre, le 4 août. Le 14, les deux armées sont face à face près de Senlis. Toute les journée du 15 août, elles s’observent, immobiles, sous un soleil de plomb et dans une poussière aveuglante : il y avait si grande poudre, qu’on ne reconnaissait ni Français, ni Anglais
, dit Perceval de Cagny. Finalement, personne n’ose entamer le combat. Le roi reprend son curieux périple, qui témoigne de son hésitation. Le 18 août, il entre à Compiègne ; le 7 septembre, il est à Saint-Denis. Il n’a aucune intention d’assiéger sérieusement Paris, où les fortifications de Charles V, défendues par 2.000 soldats anglo-bourguignons, présentent un formidable obstacle. Pour tester les défenses, il laisse les enthousiastes, le duc d’Alençon, Raoul de Gaucourt, Gilles de Rais, Jeanne d’Arc, tenter un assaut le 8 contre la porte Saint-Honoré. Jeanne d’Arc est la curiosité du jour, créature en forme de femme, qu’on nommait la Pucelle
, écrit le Bourgeois. Copieusement traitée de paillarde
, ribaude
, putain du dauphin
, elle est blessée d’un trait d’arbalète à la jambe.
L’assaut est repoussé, la magie est rompue. Le 13 septembre, le roi ordonne le départ. Il rentre dans ses châteaux berrichons. Que faire de Jeanne d’Arc maintenant ? Elle ne manifeste aucune intention de retourner garder ses moutons, et commence à agacer sérieusement l’entourage royal. On lui trouve un petit emploi pour l’hiver : à cinquante kilomètres de Bourges, il y a un chef de bande qui travaille pour les Anglo-Bourguignons, Perrinet Gressart. Puisqu’elle tient tant à 440se battre, qu’elle aille le déloger. C’est un échec complet, qui en fait ricaner plus d’un. À la fin décembre, Charles VII anoblit la Pucelle et toute sa famille, pour les services louables, gracieux et utiles déjà rendus de toute façon par ladite Jeanne la Pucelle
. En avril 1430, il l’envoie avec quelques troupes en Île-de-France, pour aider la garnison de Compiègne menacée par les Bourguignons.
La situation est en effet confuse. À la fin août 1429, le roi et le duc de Bourgogne avaient conclu une trêve s’achevant au 1er janvier 1430. Elle prévoyait l’organisation d’une conférence de paix, et Charles VII avait promis oralement de restituer Compiègne, Creil, Pont-Sainte-Maxence et Senlis. Mais les habitants avaient refusé le transfert. S’estimant trompé, Philippe repousse la conférence et décide de reprendre les villes par la force. Le roi accuse le duc de duplicité, et envoie donc des soldats contre les Bourguignons. Jeanne d’Arc arrive à Compiègne le 13 mai. Le 23, elle fait une sortie et, lorsqu’elle veut rentrer, le capitaine de la ville, Guillaume de Flavy, fait fermer la porte, de peur que les Bourguignons ne s’engouffrent à la suite des Français, avec lesquels ils sont au corps à corps. Entourée, désarçonnée, Jeanne se rend au bâtard de Wandonne, un homme de Jean de Luxembourg, évêque de Thérouanne et un des principaux lieutenants du duc de Bourgogne.
On a parlé de trahison, ce qui est tout à fait vraisemblable. De nombreuses chroniques en font état, à commencer par la Chronique de la Pucelle : Aucuns veulent dire que quelqu’un des François fut cause de l’empeschement qu’elle ne se pût retirer ; qui est chose facile à croire
; pour la Chronique de Heintich Token, Jeanne est victime de la jalousie des capitaines qui supportaient avec peine qu’une jeune fille les menât
. Pour la Chronique de Flandre, il y aurait eu un véritable complot : Depuis dirent et affirmèrent plusieurs que, par 441l’envie des capitaines de France, avec la faveur que aulcuns du conseil du roy avaient à Philippe de Bourgogne, et messire Jehan de Luxembourg, on trouva couleur de faire mourir ladite Pucelle par feu.
Ce aulcuns du conseil du roy
pourrait désigner La Trémoille, dont les plans tortueux étaient contrariés par les victoires de la Pucelle, et Regnault de Chartres, l’archevêque de Reims, qui justement est à Compiègne au mois de mai 1430, où il rencontre son ancien pupille Guillaume de Flavy. Ce qui est sûr, c’est que Jeanne gênait beaucoup de monde dans les deux camps, et que sa prise en a soulagé plus d’un parmi les partisans de Charles VII. Écrivant à ses diocésains de Reims, l’archevêque ne dissimule pas sa satisfaction. Elle était trop sûre d’elle-même, dit-il, elle ne vouloit croire conseil, ains [mais] faisoit tout à son plaisir
.
Jeanne est aux mains de Jean de Luxembourg. Les Anglais font pression pour l’acquérir, mais il n’est pas question de rançon. On ne rançonne pas un symbole. L’idée est de la juger pour hérésie, afin de renverser les rôles : montrer que sa mission divine
n’est en fait qu’une mission diabolique, et donc que Dieu est en réalité du côté des Anglais. Des deux côtés, c’est une pure affaire de propagande. Au début décembre, Jeanne est vendue aux Anglais pour 10.000 livres. Bedford décide que le procès aura lieu à Rouen, sous la présidence de Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, puisque c’est dans son diocèse qu’a eu lieu la prise. Jeanne est condamnée en mai 1431 comme hérétique, relapse, idolâtre
, et brûlée à Rouen le 30 mai. La propagande anglaise donne un maximum de publicité à l’événement, par l’intermédiaire de prédicateurs, et Henry VI demande au duc de Bourgogne d’afficher partout la sentence, afin que dorénavant fussent plus sûrs et mieux avertis de ne pas croire en semblables erreurs, qui avaient régné à l’occasion de ladite Pucelle
. En Angleterre, l’épisode 442contribue à développer la xénophobie. La tension monte contre les sujets français du roi. À Londres, les quartiers malfamés du sud de la Tamise ont la réputation d’être fréquentés par des espions et des criminels picards, flamands, gascons, français. L’entourage français de la reine mère Catherine de Valois est très mal vu, et les Bourguignons ne sont guère plus estimés : les sujets de Philippe le Bon en Flandre sont des rivaux. La prise de conscience de l’identité insulaire se bâtit par opposition au continent, et la xénophobie éclate dans un traité comme le Libelle of Englysche Polycye, de 1436.
L’encombrante Jeanne d’Arc éliminée, on peut reprendre la guerre sur les bases habituelles. En fait, elle n’a pas cessé pendant la captivité et le procès de la Pucelle. Les années 1430 et 1431 sont particulièrement confuses. Le duc de Bedford est confronté à de multiples difficultés, en dehors de Jeanne d’Arc. La Normandie reste un foyer d’agitation permanent, qui immobilise de nombreuses troupes. Calais lui donne des soucis, c’est un gouffre financier, et périodiquement les troupes, mal payées, se saisissent des cargaisons de laine. L’Aquitaine, un peu oubliée depuis que les combats se concentrent au nord de la Loire, est à la merci d’une attaque française : le sénéchal John Rascliffe [Radcliffe] n’a que 200 ou 300 hommes, dans des fortifications délabrées. Il faut surveiller l’Écosse, d’où le roi Jacques continue à envoyer des secours à Charles VII. Et en Angleterre même, Gloucester reste turbulent ; des émeutes ont éclaté dans le Kent en 1428, en raison des exactions commises par les troupes mal payées qui attendaient leur transfert en France.