Texte intégral
Le culte de Jeanne d’Arc au XVe siècle
par
(1887)

Éditions Ars&litteræ © 2024

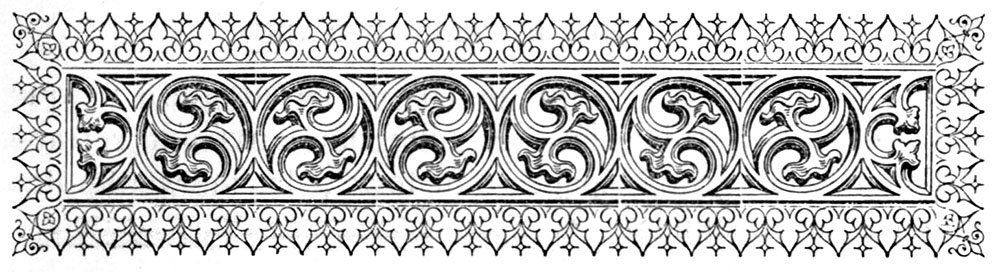
5 Le culte de Jeanne d’Arc au XVe siècle
S’il est un nom souvent prononcé en France, une histoire souvent redite, c’est bien le nom et l’histoire de Jeanne d’Arc. Jamais, depuis le XVe siècle, on ne s’est tant occupé de celle dont le souvenir radieux brille d’un si vif éclat dans les fastes de notre vieille France chevaleresque. Les arts1 et la 6poésie s’emparent plus que jamais de ce caractère unique entre tous, et les historiens les plus éminents ont retracé à l’envi cette grande page d’histoire, la merveille des annales européennes.
Il est assurément peu de figures qui aient inspiré un plus grand nombre d’écrivains2, un plus grand nombre de panégyristes ; car, chose à remarquer, sauf quelques bien rares dissonances, ceux qui ont pris la plume sur ce sujet, l’ont prise pour donner libre cours à leur admiration. Ce culte de la France moderne pour sa libératrice est une manifestation des plus touchantes et honore autant les cœurs qui le professent que celle qui en est l’objet. Il ne faudrait pas croire pourtant que ce culte soit une manifestation toute moderne.
Si au lieu de naître en 1410, Jeanne d’Arc était venue au monde en 1853, — dit M. l’abbé Mourot à propos de la canonisation de l’héroïne, — et si, au lieu de chasser le duc de Bedford de Paris, elle avait dispersé les légions allemandes et délivré la France de la présence des Prussiens, si en un mot, le miracle accompli au XVe siècle, s’était produit, en 1870, quels cris de reconnaissance, ne se seraient-ils pas élevés de toutes parts ?
Quelle admiration, quel enthousiasme et quel délire s’empareraient des cités et des hameaux ! On baiserait la trace de ses pas, et son nom, répété par les échos, serait béni de génération en génération. Chaque ville aurait sa place publique, son monument consacré à Jeanne ; son image planerait sous toutes ses formes : médailles, statues, fontaines, écoles, chapelles expiatoires. Ce serait justice ; ce qui est justice en un temps, peut-il ne pas l’être en un autre3 ?
Eh bien, cet enthousiasme, cette vénération que notre 7France du XIXe siècle saurait vouer aujourd’hui au héros qui la sauverait du désastre, serait-il croyable que la France du XVe siècle ne les eût pas éprouvés pour sa libératrice ?
Assurément non. À cette époque, les mœurs pouvaient être moins policées qu’aujourd’hui, mais l’âme humaine est-elle ainsi faite, que ses sentiments puissent changer du tout au tout dans un espace de quatre siècles, et le sang français, si enthousiaste de ce qui est grand, noble, pur, héroïque, a-t-il jamais pu rester froid devant ces mêmes manifestations !
Ces médailles, ces statues, ces monuments, ces preuves de reconnaissance et de gratitude, Jeanne les a eus ; ce délire, elle l’a fait éprouver ; cet enthousiasme, elle l’a excité, et celui-ci a été d’autant plus grand, que le peuple au XVe siècle était plus inflammable et peut-être même, hélas ! plus accessible que nous à l’idée religieuse, par le fait même que la crise qu’il traversait était plus terrible et plus douloureuse.
Rien n’est plus curieux, en effet, que d’étudier dans les historiens, dans les poètes de cette époque, quelle admiration sans bornes les contemporains de Jeanne professaient pour elle.
Ce sont d’abord ses compagnons d’armes, Gui de Laval, Perceval de Boulainvilliers et tant d’autres qui exaltent sa vaillance et son humanité, son génie militaire et sa modestie.
Ce sont ensuite les chroniqueurs et les historiens, dont plusieurs ont suivi les armées, qui racontent soit ses prouesses et ses faits d’armes, auxquels ils ont eux-mêmes assisté, soit ceux qu’ils ont recueillis de la bouche des chevaliers qui en furent témoins. Alain Chartier, Perceval de Cagny, Jacques le Bouvier, Jean Chartier, Cousinot de Montreuil, P. Cochon, Pierre Sala, Guillaume Girault, Jean Rogier, Thomassin, Gruel, Chatelain de la Porte, doyen de Saint-Thibaut de Metz, Lefèvre de Saint-Rémi, le recteur Jean Chuffart, Monstrelet, les auteurs du Journal du siège d’Orléans, de la Chronique de Lorraine, l’abréviateur du procès, — avec des nuances toutefois, car plusieurs sont bourguignons, c’est-à-dire dévoués aux intérêts anglais, — ne peuvent 8s’empêcher de rendre hommage au caractère de la Pucelle.
Les religieux et les docteurs témoignent en sa faveur par de solennels écrits. Thomas Basin, évêque de Lisieux, Gerson, Jacques Gelu, archevêque d’Embrun, Henri de Gorkum, le docteur allemand de Spire, les docteurs de Poitiers, ceux qui étudièrent comme juges le procès de réhabilitation et qui recueillirent les dépositions de cent vingt témoins, toutes à la louange de la Pucelle, se montrent véritablement enthousiastes à son égard, et un volume ne suffirait pas à reproduire ceux de leurs témoignages d’admiration qui nous sont parvenus4.
Les poètes, Christine de Pisan, Martin Franc, Antoine, Astésan, Martial d’Auvergne, Valéran Varan, Chastelain, Villon, Saint-Gelais, célèbrent dans leurs vers les merveilles qu’ils ont entendu raconter.
Le bruit de ces exploits, porté par les voix de la renommée, se répand rapidement dans les Pays-Bas, en Italie où le Pape Pie II, alors Æneas Sylvius Piccolimini, où Guerneri Berni, Philippe Forest de Bergame, l’auteur du Breviarium historiale, leur rendent leur tribut d’hommages, ainsi qu’au caractère de celle qui les a accomplis. En Espagne, se publiait la Cronica de la Poncella d’Orliens ;en Grèce, Laonic Chalcondyle racontait cette histoire extraordinaire jusqu’aux confins de la chrétienté, tandis qu’en Allemagne, non seulement les docteurs faisaient des dissertations sur Jeanne, mais encore, en 1429, on montrait à Ratisbonne son portrait, à l’exhibition publique et officielle duquel l’empereur Sigismond assista5. Un fragment de tapisserie allemande, découvert à Lucerne en 1858, et donné l’année suivante par M. d’Azeglio au Musée Jeanne d’Arc à Orléans6, où il figure 9encore aujourd’hui sous le n° 8, paraît aussi avoir fait partie d’une série de tableaux analogues7.
Si Jeanne recevait à l’étranger les plus grands honneurs, que ne devait-elle pas attendre de son peuple ! Jusqu’en 1793, le pont d’Orléans conserva le monument que les femmes de cette ville avaient élevé en 1458 à leur libératrice8. Montaigne, dans ses récits de voyage, dit avoir vu la façade de la maison d’Arc à Domrémy, recouverte de vieilles peintures du XVe siècle, représentant les gestes de l’héroïne.
Le 8 mai 1436, à la fête de la ville d’Orléans en l’honneur de sa libératrice (fête qui n’a jamais cessé de s’y célébrer dans la plus grande pompe et toujours sous le nom de Fêtes de Jeanne d’Arc), était joué un mistère dans lequel étaient représentés les haut faits de la Pucelle ; mystère qui fut rejoué en 1439 et en 1456, à l’occasion de la même solennité9.
10Un des côtés les plus extraordinaires de la vie de la Pucelle, c’est le culte religieux que ses contemporains eurent pour elle.
On sait, qu’au XVe siècle, le miracle exerçait un attrait universel sur les esprits et qu’il se retrouve dans presque tous les témoignages parvenus jusqu’à nous, des historiens que nous venons de citer, c’est-à-dire des personnages les plus graves et les plus éclairés de cette époque.
Jeanne, avec la puissance de sa riche nature, s’abandonnait à ce besoin impérieux de l’âme humaine, au sentiment religieux ; c’était une femme profondément croyante, d’une piété large et sincère qui contrastait singulièrement avec celle des imposteurs et des aventurières, soi-disant faiseuses de petits miracles, adonnés à de trompeuses pratiques, qui tentèrent de se faire passer pour elle, et qui essayèrent de jouer après elle, son rôle politique et religieux. Comme le disait Vallet,
sans que l’on mette sur le même rang ces diverses rivales, la Pucelle n’eût qu’à écarter du pied les moins nobles, pour que la confusion soit demeurée impossible.
Jeanne ne prophétisait pas en vue de faire signes
, elle ne macérait point ses sens dans une idée de perfection solitaire, ni d’édification mystique, c’était une piété agissante ; ses signes consistaient dans la levée du siège d’Orléans, dans le sacre du roi à Reims et dans le fait de
bouter les Angloys hors de France.
Quand elle les eut montrés,
sa gloire était parvenue au-dessus de toutes les gloires, était surtout d’une autre nature que toute autre gloire, de même que sa sainteté était, aux yeux du peuple, autre que la sainteté ordinaire ; c’était la sainteté d’un être descendu du Ciel, plutôt que 11d’un être qui lutte pour le gagner. Le peuple se crut gouverné directement par ce Ciel ; par elle transporté dans un autre monde, il vécut dans le surhumain comme dans son atmosphère naturelle10.
Après la délivrance d’Orléans, les sentiments impérissables d’admiration que Jeanne avait fait naître au cœur des masses prirent aisément la forme religieuse, comme ils se manifestèrent bien souvent sous la couleur du merveilleux, propre au temps où elle vivait.
Perceval de Boulainvilliers écrivait au duc de Milan, Philippe de Visconti, que, le jour où la Pucelle était née, tous les habitants en avaient été avertis par les coqs, qui, comme ries hérauts de bonne nouvelle, s’étaient mis à chanter avec une allégresse inaccoutumée11. Et il ajoutait en latin d’autres épisodes merveilleux que le recteur Jean Chuffart rendait ainsi dans son Journal d’un bourgeois de Paris :
Quand elle estoit bien petite, et qu’elle gardoit les brebis, oncque de ses bestes ne périt ; les oiseaulx des bois et des champs, quand les appeloit, venoient mangier son pain dans son giron, comme privés12.
Après la bataille de Patay,
hom voit venir en Poictou, de pardecza des plus merveilleuses choses que hom vit oncques, come des homes armés de toutes pièces chevaucher en l’aer sur un grant cheval blanc, et audessus les armeures une grant bende blanche, venent devers la mer d’Espaigne, et passer par-dessus deux ou trois forterasses près de Talamont et tirer vers Bretaigne : dont tout le pays de Bretaigne fut espaventé, et mon dict seigneur le duc, dont il a fait le serement aux Angloys, disent qu’ils connaissent leur destruccion par luy. Le roy a envoyé devers l’evesque de Luezon pour savoir la vérité de ceste besoigne13…
Une chronique bourguignonne disait :
et l’apelloient ly 12aucun du comun de France : l’angelicque et en faisoient et en cantoient pluisieurs canchons, fables et bourdes moult merveilleuses14.
Nous ne parlerons pas du sentiment que ses soldats et ses compagnons d’armes éprouvaient pour elle. Elle leur avait rendu la confiance, elle avait relevé leurs esprits démoralisés, de vaincus elle en avait fait des vainqueurs, et la terreur qu’elle inspirait à l’ennemi était si grande, que, non seulement les soldats anglais fuyaient à son approche, mais encore beaucoup d’entre eux désertaient pour repasser la mer15, et qu’en Angleterre capitaines et soldats refusaient de s’embarquer pour la France par crainte de la Pucelle16.
Mais, même dans le peuple, c’était comme une adoration pour elle. On se jetait aux pieds de son cheval, on baisait ses mains et ses vêtements ; les objets dont elle s’était servie étaient conservés avec soin, et la tradition indique encore avec respect les maisons où elle logea, de même que les villes où l’héroïne séjourna se firent et se font encore gloire de l’avoir reçue dans leurs murs17.
Que de fois ne vint-on pas la consulter, comme une véritable 13prophétesse, tant la confiance religieuse qu’elle inspirait était forte. Le comte d’Armagnac, ayant eu des démêlés avec le pape Martin V, consulta Jeanne sur le point de savoir lequel des trois papes Martin, Clément ou Benoît était le véritable, celui auquel on devait obéissance ; il fut éconduit poliment18, car Jeanne ne répondait guère aux demandes étrangères à l’objet de sa mission.
Son bon sens la mettait en garde contre l’enivrement de ces honneurs, elle accueillait ces démonstrations avec sa modestie habituelle, à chaque pas elle repoussait ces superstitions populaires et ces naïves idolâtries, quelquefois même elle s’en fâchait, le plus souvent elle se défendait avec douceur. Quand on lui reprocha de les avoir souffertes, lui disant qu’elle avait entraîné les peuples à l’idolâtrie, elle répondit avec simplicité : En vérité, je ne ne m’en aurais su garder, si Dieu ne m’en avait gardé lui-même.
Lorsqu’elle entra à Troyes, les habitants ne s’approchèrent d’elle qu’avec une crainte superstitieuse, tant les prodiges accomplis par elle leur paraissaient n’avoir pu être l’œuvre que d’un être surnaturel :
— Approchez hardiment, je ne m’envouleray point19.
À Poitiers les femmes lui apportèrent des patenôtres et d’autres objets à toucher : Touchez-les vous-mêmes, ils en vaudront tout autant
, leur répondit-elle.
On comprend facilement la consternation qui se répandit dans les populations à la nouvelle de la prise de la Pucelle. Dans beaucoup de villes, à Blois, à Orléans, il y eut deuil public20. À Tours notamment, on ordonna des prières générales, on fit. une procession à laquelle assistèrent tous les prêtres et tous les habitants de la ville, pieds nus21.
14Cet ardent désir qu’avait le peuple de voir Jeanne délivrée, explique sans doute la crédulité première avec laquelle on accueillit les fausses Jeanne d’Arc, qui essayaient, comme nous le disions tout à l’heure, de se faire passer pour elle. À ce sujet, le Manuscrit 812 à la Bibliothèque Méjanes d’Aix, (liasse Bouquier, qui date du commencement du XVIIIe siècle), renferme une mention curieuse :
Du 27e iour de iuing 1436, notaire Jean Seguin à Arles. Gageure entre Jean Romieu et Pons Veyrier, sur ce que le dict Veyrier disoit que la Pucelle (d’Orléans) de France bruslée par les Angloys à Rouen estoit encor en vie, ce que le dict Romieu nioit, avec la transaction sur ce passée22.
15M. Fassin, conseiller à la Cour d’appel d’Aix, un arlésien dont l’érudition ne le cède qu’à la bienveillance, nous a dit se souvenir d’avoir vu autrefois quelque chose d’identique dans un manuscrit du fond Bonnemant à la Bibliothèque d’Arles, sans pouvoir se rappeler toutefois si la mention de cet acte notarié était plus détaillée que celle que nous donnons ici.
Après de nombreuses recherches à Arles, nous n’avons pu retrouver l’original de cet acte. Les écritures du notaire dont s’agit, Jean Seguin le vieux (1432-1480), sont réparties entre les études Long et Rigaud. Nous avons trouvé chez ce dernier tous les protocoles de Jean Seguin, sauf celui de l’année 1436. Enfin nous n’avons pas été plus heureux à la bibliothèque et aux archives municipales.
Ce qu’il y a de certain, toutefois, c’est que cet acte a dû exister, puisque deux personnes l’ont relaté dans leurs notes. Or c’est en mai 1436 que l’aventurière Claude des Armoises s’était présentée aux Orléanais, se disant la Pucelle ressuscitée du bûcher ; sa ressemblance avec Jeanne était si frappante, qu’elle en avait imposé à tous. Ne la voyait-on pas par les yeux de la foi ? Le pouvoir surnaturel attribué par la population à Jeanne avait été si grand, que l’on n’hésitait 16pas à voir dans cette aventurière la vraie Jeanne sortie vivante des cendres de son bûcher.
Dans beaucoup de villes des religieux prêchèrent au peuple la mission divine de Jeanne d’Arc et racontèrent les miracles qu’elle avait opérés. M. Michel Hardy a découvert récemment dans les livres de comptes de l’Hôtel de Ville de Périgueux, année 1428-1429, le curieux document que voici :
Item, nous avons payé, le treizième jour de décembre, où nous fîmes dire une messe chantée, par ce que messire Hélie Bodant était venu dans cette ville et prêchait à tout le peuple, les grands miracles accomplis en France par l’intervention d’une pucelle qui était venu trouver le roi, notre sire, de part Dieu ; à ladite messe, nous avons fait mettre deux cierges du poids de un quart et demi, et donné deux sols à l’officiant M. Jehan de Lascoutz. Monta le tout à la somme de trois sols, quatre deniers et une maille23.
Ce qui indique encore dans quelle estime de sainteté les contemporains tenaient la vierge de Domrémy, c’est, comme l’a fait remarquer M. Charles de Beaurepaire, le savant archiviste de la Seine-Inférieure, que jamais on ne fonda pour le repos de son âme, ni messes, ni services, soit après sa mort, soit après sa réhabilitation, dans un temps où cependant les fondations de ce genre étaient fréquentes.
Pourquoi cette abstention exceptionnelle pour Jeanne d’Arc, — se demande avec raison M. l’abbé Julien Loth, — si ce n’est qu’on la tenait pour sainte et martyre24 ?
Non seulement on ne sentait pas le besoin de prier Dieu pour elle, mais le peuple au contraire implorait Jeanne d’intercéder 17pour lui auprès du Père éternel, et fit, à cet effet, des processions en son honneur.
À partir de la prise de Jeanne, les processions publiques se continuent à Orléans, à Bourges, à Rouen, par reconnaissance pour elle.
Aussi plusieurs villes en font solemnité, car si Orléans fust cheu entre les mains des dits Angloys le demourant du royaulme eust esté fort blacié.
Le Cardinal d’Estouteville accorda en 1452 cent jours d’indulgence aux personnes qui suivraient cette procession du 8 mai ; l’année suivante, l’évêque d’Orléans Thibaud d’Aussigny accorda quarante jours ; en 1474, François de Brillac, son successeur, ajouta quarante jours, et en 1482 le cardinal Jean Rolin, évêque d’Autun, accorda cent autres jours25.
En 1431 la voix populaire réclama même la béatification de son héroïne. Regnault de Chartres, archevêque de Reims, chancelier de France, qui, par lâche jalousie, avait été cause, avec La Trémouille, le mauvais génie de Charles VII et avec Guillaume de Flavy, de la perte de la Pucelle, enraya l’enthousiasme des Français qui voulaient la béatifier26.
Mais la popularité de Jeanne d’Arc alla encore plus loin, car il est certain aujourd’hui, que, sans avoir été l’objet 18d’un culte liturgique, elle fut celui d’un culte privé des plus étendus.
L’article 52, en effet, de l’acte d’accusation qui fut dressé par les docteurs de Rouen contre leur innocente victime, disait :
Item, la dite Jeanne par ses inventions a séduit le peuple catholique, beaucoup en sa présence l’ont adorée comme sainte et l’adorent encore en son absence ; commandant en son honneur messes et collectes dans les églises ; bien plus, ils la déclarent la plus grande parmi les saintes après la sainte Vierge ; ils élèvent des images et représentations d’elle dans les basiliques des saints et aussi portent sur eux ces représentations en plomb et en autre métal, ainsi qu’il est accoutumé de faire pour les mémoires et représentations des saints canonisés par l’Église ; ils disent partout que c’est l’envoyée de Dieu et qu’elle est plutôt ange que femme27.
Or, les faits que mentionne cet article ne sont pas œuvre d’imagination. Nous possédons aujourd’hui encore quelques monuments qui semblent se rapporter exactement à ces griefs, et qui, étant donné leur nombre, leur variété, leurs origines diverses, viennent établir de la façon la plus formelle et la plus authentique ce culte privé dont la Pucelle fut l’objet de la part de ses contemporains.
On sait qu’il était d’usage au XVe siècle de porter sur soi des figurines ou médailles, le plus souvent en plomb, à l’effigie des saints dont on espérait aide et protection. Les 19historiens nous montrent Louis XI au château de Plessis-lèz-Tours, terrorisé par la crainte de la mort, enlevant à tout moment son chaperon qui portait des figurines de ce genre, et leur faisant ses dévotions dans l’espoir de prolonger sa vie.
Or, deux de ces médailles à l’effigie, aux armes de Jeanne d’Arc, sont arrivées jusqu’à nous. L’une, qui appartenait à M. Rolin, de Guise, a été décrite et reproduite par son propriétaire28. Elle présentait au droit le buste de la Pucelle, au revers ses armoiries et datait de 1430. Il est vrai que Vallet de Viriville mettait en doute que ce fussent là et le buste et les armes de la Pucelle, mais cette opinion tout à fait isolée n’étonne pas de la part de l’esprit contradictoire de M. Vallet, car celui-ci, bien qu’ayant été un de ceux qui ont le plus et le mieux contribué à nous faire connaître Jeanne d’Arc, a bien souvent, par amour de la discussion, adopté les solutions les plus extraordinaires. Il n’y a d’ailleurs, pour se convaincre de la chose, qu’à se reporter à la production donnée par M. Vallet lui-même29, et on sera assuré au premier coup d’œil que cette médaille ne saurait s’appliquer qu’à la Pucelle. Cette opinion est celle, non seulement de Quicherat30, mais encore de tous les auteurs qui se sont occupés de cette question. Aussi en 1861, M. Vallet revint-il sur sa première idée, et convint-il de son erreur en donnant un nouvel article sur cette médaille qu’il avouait ne pouvoir être relative qu’à Jeanne d’Arc31.
Une seconde médaille du même genre, quoique d’un autre modèle, qui se trouve aujourd’hui au Musée Cluny, a été aussi décrite par M. Forgeais ; son droit représente une personne en pied, peut-être le Père éternel, mais sur le revers très bien conservé se trouvent encore les armes de la Pucelle32.
20Mais il y a plus, les images de Jeanne d’Arc ont figuré dans les églises.
En 1754 l’abbé Lebeuf écrivait :
Dans la nef de l’église Saint-Paul, à l’un des vitrages du côté méridional, sont quatre pans ou panneaux : au premier est Moyse… au second David… au troisième Godefroy de Bouillon… au quatrième on voit une femme dont la coeffure est en bleu, les habits en verd. Elle a la main droite appuyée sur un tapis orné d’une fleur de lys, et de cette main elle tient une épée. De la main gauche posée sur sa poitrine elle tient quelque chose qu’il n’est pas facile de distinguer. Au dessus de sa tête est écrit :
Et moy j’ai défendu le Roy.J’ai pensé que ce devait être la Pucelle d’Orléans, et un savant historiographe d’Orléans, M. Daniel Polluche, m’a confirmé dans ce sentiment. C’est peut-être le seul endroit public où soit représentée dans Paris Jeanne d’Arc qui rendit de si grands services au roi Charles VII contre les Anglais33.
L’église ayant été démolie en 1797, ce vitrail, qui était d’Henri Mellin peintre verrier de Charles VII34, disparut. Quoique Vallet de Viriville ait encore mis en doute que ce fût là une représentation de la Pucelle35, disant que cette figure pouvait personnifier la noblesse ( ?), il nous paraît difficile de nier la chose et de ne pas se conformer à l’opinion unanime des quatre auteurs qui, ayant vu le vitrail, l’ont reconnu pour représenter Jeanne d’Arc.
Non seulement des vitraux, mais encore des tableaux et des statues avaient été placés au XVe siècle dans les églises.
M. Auvray a découvert récemment un tableau religieux peint au blanc d’œuf et exécuté du temps même de la Pucelle, 21lequel a dû être fait assurément pour quelque chapelle. Il représente la Vierge avec l’Enfant-Jésus, à sa droite se trouve saint Michel portant la balance avec laquelle il pèse les âmes, à sa gauche se tient Jeanne d’Arc son étendard d’une main, de l’autre son écu armorié. Comme la Vierge, l’Enfant-Jésus et saint Michel, Jeanne porte le nimbe attribut de la, sainteté36.
En 1481 n’érigeait-on pas dans l’église de Notre-Dame de Domrémy une statue de la Pucelle en prière, faite en 1456 par un artiste lorrain, et cette statue ne resta-t-elle pas pendant plusieurs siècles dans cette même chapelle, aux pieds d’une image en bois polychrome de la Vierge37 ?
La cathédrale de Toul ne conserva-t-elle pas jusqu’à la Révolution une effigie de Jeanne d’Arc qui y avait été élevée entre les chapelles de la Visitation et de Saint-Nicolas38 ? M. Carrand possédait une statuette (faisant partie aujourd’hui de la collection de M. Odiot), qui par son style, sa forme et ses dimensions répond au modèle des saints que l’on plaçait sur les autels. En bronze, de 40 centimètres sur 30 de hauteur, elle représente la Pucelle à cheval et porte sur le socle la mention :
La Pucelle d’Orliens.
Ce socle est percé de deux trous qui devaient servir à le fixer sur une base. L’expression de ce groupe est toute pacifique, 22Jeanne ne porte pas d’armes, et devait tenir à la main son étendard.
Cette effigie, — dit M. Vallet de Viriville, — se rapporte d’une manière frappante, et comme nécessaire, à l idée qu’on peut se faire des images de piété mentionnées dans l’article 52 de l’acte d’accusation. Cependant l’aspect archéologique du groupe, et surtout la forme de la chaussure dite en bec de canard, semble ramener l’époque de l’exécution vers 1490. Ou la statuette de M. Carrand est l’original même de l’une des images offertes dans les églises en 1430 aux hommages des fidèles, ou elle est une copie postérieure de l’une de ces images. Tels sont les deux seuls termes entre lesquels il y ait lieu d’opter, si je ne me trompe, quant à l’attribution de cette figure. La tête, d’une expression naïve et intéressante, coiffée quant aux cheveux avec une fidélité tout à fait historique, accuse néanmoins un modelé trop rond, trop vague, trop imparfait pour que l’on puisse y voir des traits individuels exactement rendus d’après nature. L’impuissance du procédé technique se joint à l’impuissance de l’artiste employé39.
Mais ce n est pas là, la seule statuette de ce genre que nous possédions.
Le Musée Cluny s’est enrichi en 1876 d’une statue en bois, de Jeanne d ‘Arc, dont la provenance et l’antiquité sont authentiques.
C’est une statue équestre du XVe siècle de 1m50 de hauteur sur 0m85 de longueur. Elle provient, d’après M. Du Sommerard, directeur du Musée de Cluny, de l’église de Montargis où elle était conservée de temps immémorial. Dans toutes les processions solennelles elle était portée sur un brancard dont on distingue encore les attaches. A-t-on jamais eu l’habitude de porter aux processions des statues 23de personnes auxquelles on n’attribue pas quelque chose de religieux ? Celle-ci avait donc incontestablement ce caractère qui lui avait été conservé depuis le XVe siècle jusqu’à la Révolution et même au-delà, car elle fut encore portée aux processions sous la Restauration, et toujours invariablement connue sous le nom de Jeanne d’Arc.
La jambe gauche de la statue est coupée obliquement au-dessous du genou et se déploie, au moyen d’une charnière, sous le ventre du cheval, pour donner ouverture à une cavité qui y est pratiquée. Cette cavité contenait vraisemblablement des reliques, à moins qu’elle ne renfermât un objet provenant de la Pucelle elle-même, et à ce titre entouré de la vénération publique. Cet objet, quel qu’il fût, a disparu sans que la tradition en ait conservé la mémoire.
L’authenticité de cette statue est hors de doute, elle constitue, avec celle de la collection Odiot qui date du XVe siècle, la plus ancienne reproduction modelée des traits de la Pucelle que l’on possède aujourd’hui40.
Nous donnons ci-joint la reproduction inédite d’une petite figurine en marbre de 35 centimètres de haut sur 9 de large et 4 d’épaisseur. D’après sa forme et selon l’avis des connaisseurs auxquels nous l’avons montrée, cette statuette remonte au XVe siècle et a dû figurer dans un oratoire. Nous n’en connaissons malheureusement pas l’origine. Elle est depuis fort longtemps, ainsi que plusieurs autres objets et chartes concernant Jeanne d’Arc, dans la famille, mais nous n’avons rien trouvé dans nos papiers qui pût nous renseigner à ce sujet.
Quoi qu’il en soit, comme on en peut juger par la présente reproduction, c’est là une œuvre peu fine et qui ne saurait assurément prétendre à la ressemblance ; le temps ou l’usage ont en quelque sorte poli et légèrement usé les saillies du visage ; on voit aussi que les mains sont disproportionnées au corps. L’étendard ne porte aucun dessin, mais, dans une sorte de petit écu que Jeanne tient à la main 24gauche, on voit une fleur de lis et une épée supportant une couronne, le tout grossièrement figuré, mais très reconnaissable bien que le bras en cache une partie. La taille est serrée par une large ceinture ; l’épée est supportée par un baudrier qui disparaît sous un manteau. Jeanne porte le costume féminin, ses cheveux dénoués tombent jusqu’à ses épaules, et sa tète supporte une couronne, la couronne de sainte ou de martyre.
Cette figurine ne viendrait-elle pas, avec celles des collections Carrand-Odiot et du Musée Cluny, à l’appui de cette thèse que Jeanne a figuré sur les autels ?
N’est-il pas probable que c’est devant ces tableaux, devant ces statues, que se sont dites les prières adressées à Jeanne d’Arc, auxquelles faisait allusion l’article 52 de l’acte d’accusation ?
Nous possédons encore le texte d’une collecte ou prière finale de l’office, dans laquelle le nom de la Pucelle figure avec les honneurs qu’on rendait aux saints :
Antiphona.
Congregati sunt inimici nostri, et gloriantur in virtute sua.
Contere fortitudinem eorum, Domine, et disperge illos, ut cognoscant quia non est alius qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster.
V. Da illis formidinem et tabefac audaciam illorum.
R. Commoveantur a conditione sua. | Domine exaudi orationem, etc… | Dominus vobiscum, etc…
Oremus.
Deus auctor pacis, qui sine arca et sagitta inimicos in te sperantes elidis, subveni, quæsumus, Domine, ut nostram propitius tuearis adversitatem, ut, sicut populum tuum, per manum fæminæ liberasti, sic Carolo, regenostro, brachium victoriæ erige ut hostes qui in sua confidunt multitudine ac sagittis et suis lanceis gloriantur queat in præsenti superare, 25et tandem ad te, qui via, veritas et vita es, una cum sibi commissa plebe, gloriose valeat pervenire.
Per dominum nostrum Jesum Christum.
(Explicit oratio Puellæ per regnum Franciæ41.)
Il y a quelques années, M. E. Magnien découvrait trois oraisons qui se disaient en Dauphiné pour la délivrance de la Pucelle pendant sa captivité. Ces oraisons se disaient à la messe, la première après le Gloria, la seconde après l’Offertoire et la troisième après l’Ablution :
Prima oratio pro liberatione Johanne Puelle.
Omnipotens sempiterne Deus qui tua sancta et ineffabili clemencia virtute que mirabili ad exaltationem et conservationem, confusionem ac destructionem inimicorum ejus, puellam venire jubsisti et eam in sacris precepti tui operibus vacantem per manus eorumdem incarcerari permisisti, da nobis, quesumus, intercedente beata semper virgine Maria, cum omnibus sanctis, illam ab eorum potestate illesam liberari et que per te ei in eodem actu jussa sunt formaliter ad implere, per Dominum nostrum, etc.
Secunda oratio.
In hac oblatione pater virtutum et Deus omnipotens, sacro sancta benedictio tua descendat que et in potestate miraculorum tuorum, intercedente beata semper virgine Maria cum omnibus sanctis, pnpllam in carceribus inimicorum nostrorum detentam sine lesura liberet, et sue negociacionis det, secundum ea que sibi jusseras, operis sui effectum sortiri, per Dominum nostrum, etc.
Tertia oratio.
Exaudi, Deus omnipotens, preces populi tui et per sacramenta que sumpsimus, intercedente beata semper virgine 26Maria cum omnibus sanctis, Puelle agentis secundum opera que sibi dixeras, nunc ab inimicis nostris incarcerate vincula prosterne quod super est negociacionis sue ad implendo sanctissima pietate et misericordia tua illesam abire concede, per Dominum nostrum, etc.42
Ces oraisons sont une preuve des sentiments qui agitaient tous les cœurs français au moment où la Pucelle était torturée par les Anglais ; elles montrent bien aussi le caractère de divin que le peuple prêtait à la mission de Jeanne. Ne disent-elles pas en effet : Laisse ton envoyée accomplir jusqu’au bout les ordres que tu lui a donnés.
Est-il possible de traduire autrement negociatio que par mission ?
Et même, en affirmant que, non seulement Jeanne d’Arc avait été prophétisée43, mais encore qu’elle avait prophétisé elle-même44, ses contemporains n’ont-ils pas poussé plus loin que la vénération, les croyances, la foi qu’ils avaient en elle ?
Voici ce que rapporte la Chronique de la Pucelle, en résumant le sixième interrogatoire, séance du 3 mars :
Interroguée 27quel aaige avoit l’enfant à Laigny qu’ele ala visiter : respond, l’enfant, avoit trois jours ; et fut apporté à Laigny à Nostre-Dame, et luy fut dit que les pucelles de la ville estoient devant Nostre-Dame et qu’elle y voulsist aler prier Dieu et Nostre-Dame qu’ilz lui voulsist donner vie ; et elle y ala et pria avec les autres. Et finablement il y apparut vie, et bailla trois fois ; et puis fut baptizé, et tantoust mourut, et fut enterré en terre sainte. Et il y avoit trois jours, comme l’on disoit, que en l’enfant n’y estoit apparu vie, et estoit noir comme sa coste ; mais quand ii baisla, la couleur lui recommença à revenir. Et estoit avec les pucelles à genoulz devant Nostre-Dame à faire sa prière45.
À sa mort, ne racontait-on pas que son cœur, ce cœur qui avait tant aimé la France, respecté des flammes avait été retrouvé intact au milieu des cendres du bûcher de Rouen46, et le bourreau lui-même, n’avait-il pas vu s’exhaler de la bouche de Jeanne d’Arc, avec son souffle suprême Jésus !
, une colombe ?
Alors même que ces faits ne seraient que l’œuvre de 28l’imagination populaire, ne montrent-ils pas jusqu’à l’évidence la foi religieuse dont Jeanne était l’objet, en tant qu’envoyée de Dieu ?
Mais les miracles dans l’ordre naturel47 ne suffiraient-ils pas à justifier ce culte que les cœurs français vouaient à leur glorieuse héroïne. De son enfance jusqu’à sa mort, à Domrémy, à la Cour, à l’armée, sur le bûcher, Jeanne ne fut-elle pas la personnification continue et manifeste de la sainteté ?
Sa vie n’avait été qu’un miracle permanent. Un guerrier de dix-sept ans, possédant toutes les qualités du parfait soldat et du général accompli, l’histoire en connaît-elle ? Et si ce guerrier, si jeune maître sans avoir été élève, est une jeune fille, une villageoise, qui ne sera forcé de reconnaître en elle l’envoyée de Dieu ?
Quand en quelques jours, à la tête d’une petite armée jusque-là découragée, on la voit délivrer Orléans, s’emparer de vingt places fortes, infliger à l’armée anglaise, réputée invincible et dix fois supérieure en nombre, la défaite de Patay, lui faire prisonnier ses généraux et cinq mille hommes, traverser trente lieues de pays ennemi hérissé de forteresses et conduire Charles se faire sacrer dans la basilique de Reims, n’est-ce pas là le miracle dans tout son éclat ?
Notre siècle a eu l’honneur de rétablir dans toute sa splendeur la douce mémoire de la Vierge lorraine48. À l’époque 29de ses triomphes, et même durant sa captivité, Jeanne fut invoquée comme sainte par le peuple qui racontait les prodiges 30obtenus par son intercession. Puis l’oubli49, la haine vinrent voiler sa figure, l’impiété antipatriotique et impudente essaya de la déshonorer. Peu à peu la vaillante guerrière a triomphé une seconde fois de ses ennemis, peu à peu elle est sortie resplendissante des chartes du Moyen Âge, comme cette statue d’un ciseau royal est sortie vivante du marbre inerte et froid, sous l’inspiration de l’art le plus élevé.
Aujourd’hui, plus que jamais, les esprits et les cœurs se tournent vers la libératrice de la France pour lui demander aide et protection. À l’étranger même, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, jusqu’en Chine, historiens, poètes, théologiens, la célèbrent à l’envi, et des prélats de tous pays prennent en mains la cause de cette canonisation.
31En France, chaque jour amène une pierre de plus dans ce monument de gratitude élevé par nos cœurs à la grande Française. Non seulement les écrits, les discours deviennent chaque jour plus nombreux, mais encore, des fêtes en son honneur sont rétablies dans plusieurs villes50, et des pèlerinages s’organisent, aux lieux qui sont siens par le souvenir.
Parmi les plusieurs milliers de visiteurs venus chaque 32année à la maison de la Pucelle, s’il y a eu des touristes poussés par la seule curiosité, ne faut-il pas croire que bon nombre aussi, y sont venus guidés par un autre sentiment, y sont venus en pèlerins pour prier à l’endroit où la sainte s’est agenouillée, pour se prosterner à leur tour et pour baiser avec respect cette terre sanctifiée par ce qu’on peut appeler la veillée des armes de Jeanne d’Arc. Les pèlerinages organisés par plusieurs de nos évêques, n’ont-ils pas été guidés par quelque sentiment spécial de vénération pour la Vierge de Domrémy ?
En un mot, la France du XIXe siècle n’éprouve-t-elle pas le même amour, le même besoin de culte religieux pour Jeanne que la France du XVe siècle ? Les sentiments d’aujourd’hui, ne sont-ils pas les mêmes que ceux qui l’agitaient il y a quatre siècles ? Ne demande-t-elle pas à l’Église, comme le demandaient nos ancêtres, au grand déplaisir de Regnault de Chartres, d’accorder à celle qui est la personnification vivante du dévouement pour la Patrie, à celle qui est le plus pur symbole de l’union du sentiment religieux avec le sentiment patriotique, le dernier témoignage de sa tendresse ?
Le 8 mai de cette année-ci, à Orléans, au milieu d’un concours immense de peuple se pressant dans l’antique basilique de Sainte-Croix, trop étroite pour la circonstance, Mgr Perraud terminait son magnifique panégyrique de la Pucelle par ces paroles51 :
Vingt-quatre ans après la mort de Jeanne d’Arc, les Parisiens pouvaient être témoins d’un spectacle émouvant.
Le 7 novembre 1455 à Notre-Dame, une femme courbée sous le poids de la vieillesse, se présentait devant les membres d’un tribunal ecclésiastique formé par les ordres du pape Calixte III.
C’était Isabelle Romée, accompagnée de son fils Pierre d’Arc, qui suppliait l’archevêque de Reims et l’évêque de 33Paris de réhabiliter la mémoire de sa fille indignement flétrie par les juges de Rouen ; elle appelait de leur sentence au siège apostolique, comme à la source de la justice et au refuge de tous les opprimés.
Il me semble à cette heure voir se renouveler, mais sur un plus vaste théâtre, cette scène pathétique.
La France, mère de Jeanne, se tourne vers l’Église de Rome, elle se présente aux pieds du Pontife magnanime qui porte le nom de Léon, et qui semble devenir de plus en plus, dans notre époque troublée, un arbitre de justice et de paix.
Très Saint Père, lui dit-elle par notre bouche, voici les actes authentiques de la vie, de la mission, de la mort de Jeanne la Pucelle. Pesez dans votre sagesse ces témoignages qui ont subi l’épreuve et reçu la sanction d’un premier procès apostolique dont les conclusions ont été solennellement confirmées par un de vos prédécesseurs. Puis, dans l’exercice de votre magistère infaillible, déclarez que les vertus, les prophéties, les miracles de cette Messagère de Dieu décident l’Église à l’inscrire sur le livre d’or des élus du Ciel, et à placer sur sa tête la couronne d’or de la sainteté.Quant à nous, nous ne cesserons d’appeler de nos vœux les plus ardents le jour où il nous sera permis d’offrir à notre héroïque sœur l’hommage d’un culte public.
Puissent alors, tous les enfants de cette France qu’elle a miraculeusement sauvée, avoir mis un terme à leurs douloureux et funestes dissentiments ! Puissent-ils, réunis dans une même foi religieuse et dans un même dévouement à la Patrie, faire monter vers le Ciel une prière d’action de grâce qui retentira de l’Océan à la Méditerranée, des Pyrénées aux Vosges… plus loin encore !
Fidèle écho de la gratitude et de la piété nationales, et s’inspirant des paroles par lesquelles Ozias exprimait à Judith la reconnaissance des habitants de Béthulie, cette prière saluera en ces termes, dictés par l’Esprit de Dieu, la Vierge de Domrémy, la libératrice de la cité orléanaise, la martyre de Rouen :
Fille de notre peuple ! Béni soit le Seigneur qui a daigné 34armer votre bras ! Il a mis sur votre nom une gloire impérissable, et, jusqu’à la fin des siècles, vos concitoyens garderont le souvenir de votre vertu et du dévouement avec lequel vous avez eu compassion de leurs angoisses, et vous vous êtes sacrifiée pour arracher votre pays à une ruine certaine.Et maintenant vous qui êtes sainte, priez pour nous !

Notes
- [1]
Voici dans quels termes Albert Wolff, pontifiant dans le Figaro, à l’occasion de l’ouverture du Salon de 1887, se réjouissait de ce mouvement artistique :
Une des particularités de ce Salon est que Jeanne d’Arc y relève la tête dans des proportions inquiétantes. En voici tout de suite une qui rentre dans Orléans. Cette peinture apprise, mélancolique et terne, appartient à l’ordre de l’art inutile.
(Cela n’a pas empêché le jury d’accorder à ce tableau de M. Scherrer une médaille, et pour un peu plus le grand prix du salon.)
Et plus loin, en parlant de deux autres toiles sur le même sujet, il les traite, pour cela uniquement je suppose, de vieilles rengaines, salades japonaises dignes du dépotoir, et fait d’autres mots d’un esprit aussi facile que délicat. (Figaro du 30 avril 1887.) Cette boutade n’a pas empêché non plus M. Lucas, un des peintres qu’elle visait d’obtenir aussi une médaille. Jeanne d’Arc n’a donc pas mal inspiré ceux qui l’ont prise pour sujet de leurs travaux. elle leur a même porté bonheur à ce salon, mais que MM. les artistes sachent que ce motif a le don d’agacer les nerfs de ce prince de la critique ; qu’on se le dise !
- [2]
Dans notre Bibliographie des ouvrages relatifs à Jeanne d’Arc (Paris, Techener, 52 rue de l’Arbre-Sec, 1887, in-8° de 960 p., nous avons mentionné plus de dix-sept cents ouvrages consacrés à la Vierge lorraine, et encore avons-nous laissé de côté les volumes qui ne parlaient qu’accidentellement de la Pucelle.
Voir aussi nos articles dans le Bulletin du bibliophile, de Techener : 1886, p. 161-192 ; 241-267 ; 383-434 ; 505-536 ; — 1887 : p. 1-23 : 49-60 ; 145-161 ; 193-215 ; 338-355, etc.
- [3]
V. Mourot, Jeanne d’Arc en face de l’Église romaine et de la Révolution, Palmé, 1886, p. 68.
- [4]
Voir les œuvres détachées de ces divers auteurs, ainsi que les collections de Roucher, 1785, t. VII ; Petitot, 1819, t. VIII ; Buchon, 1817 ; Michaud et Poujoulat, 1837, t. III ; Quicherat. Procès, 1841-1849 5 vol. ; de L’Averdy, Mss. de la Bibl. du Roi, 1790, t. III ; et la majeure partie des historiens modernes qui en rapportent des extraits.
- [5]
Quicherat, V, p. 270 ; Magasin pittoresque, 1834. n. 119.
- [6]
Le musée, créé par le vénérable M. Desnoyers, vicaire général d’Orléans, dépendant de la Société historique et archéologique de l’Orléanais, est, comme l’indique son nom, uniquement consacré aux œuvres littéraires et artistiques relatives à la Pucelle. Grâce au zèle infatigable et aux libéralités de son directeur-fondateur, c’est là une collection unique, qui renferme plusieurs milliers de numéros. Le catalogue en a été publié par par M. Mantellier, chez Herluison, 1880, in-8° de 129 p. (1 fr.) Mais, depuis cette époque, la collection ayant doublé, ce catalogue est devenu notoirement insuffisant.
- [7]
En voir des reproductions dans le Wallon illustré, 1876, p. 148, chromolithographié, et gravé dans le Joseph Fabre, Delagrave, 1885, in-4°, p. 232 ; dans l’Illustration, 1858, p. 103 avec un article de Vallet de Viriville.
- [8]
Ce monument détruit toutefois par les huguenots en 1562, avait été reconstruit.
Voici ce que nous écrivait naguère, au sujet de cette statue, le vénérable abbé Rouette, curé de Saint-Germain-des-Prés (Loiret) :
… Dans ma jeunesse, vers 1828, il me fut donné de converser avec des vieillards dont plusieurs avaient 90 et 98 ans et qui avaient vu l’ancien monument de la Pucelle, de même qu’ils avaient vu planter l’avenue du nouveau pont (rue Dauphine). Ces vieillards qui avaient la foi auraient regardé comme un sacrilège d’ajouter un mot à ce qu’ils tenaient de leurs pères, grands-pères et arrières-grands-pères, lesquels se faisaient eux-mêmes un devoir de conscience de ne rien changer au dire de leurs ancêtres. À l’occasion de la fête du 8 mai et de l’inauguration de la statue de Gois, élevée sur le Martroi, ils m’expliquèrent la conformation de l’ancien monument et me dirent que lorsqu’on passait devant lui, on se signait et on priait. Ces mots m’avaient fait une grande impression.
- [9]
Le Mistère du siège d’Orléans avait été écrit sur les ordres et aux frais du maréchal Gilles de Rais, compagnon d’armes de Jeanne, par Jacques Millet. Il comptait plus de 20.500 vers et fut représenté avec le plus grand luxe, par cent quarante acteurs, sans compter les figurants, aux frais du maréchal, dépense qui s’éleva à près de cent mille écus d’or. Découvert à la Bibliothèque vaticane, sous le n° 122 du fonds de la Reine de Suède, le manuscrit en a été publié dans les Documents inédits de l’Histoire de France, par MM. Guessard et de Certain, Paris, Imprim. impér., 1862, in-4° de LXVI et 814 p.
- [10]
Henri Martin Jeanne Darc, Furne, 1857, p. 103.
- [11]
Quicherat, V, 116.
- [12]
Buchon, Panthéon littéraire, Desrez, 1838, p. 679.
- [13]
Quicherat, V, p. 142 ; Buchon loc. citat. ; ms. 7301, anno 1429, Bibl. nationale.
- [14]
Manuscrit de Lille n° 26 ; Bulletin de la Société de l’Histoire de France, 1857-1858, p. 102.
- [15]
On fut obligé de prendre contre eux un édit qui est donné par Rymer Pacta. fœdera… t. X, p. 472, sous le titre de : De fugitivis ab exercitu, quos terriculamenta Puellæ exanimaverant, arestandis. Rapporté par Quicherat, V, 192.
- [16]
On prit aussi un édit. Rymer, X, p. 459 : De proclamationibus contra capitaneos et soldarios tergiversantes incantationibus, Puellæ terrificatos. Quicherat, v, p. 162.
- [17]
Nous n’énumérerons pas les plaques commémoratives nombreuses, placées en souvenir de Jeanne dans plusieurs villes du centre, ni les objets conservés pour la même cause dans plusieurs de nos musées. Le musée de Poitiers conserve une borne qui avait servi de montoir à Jeanne ; de même, un de nos archéologues les plus distingués, M. G. d’Espinay, garde religieusement dans une de ses propriétés une margelle de puits, qui, d’après la tradition, aurait rempli le même office.
La maison de la Bouvillerie, au village du Petit-Poisay, n’a rien de remarquable, mais on y voit une relique précieuse : c’est une large margelle de puits, monolithe, de forme octogonale et fort usée par le frottement des cordes. Elle provient du puits du Carroy à Chinon, et a été vendue par l’administration de cette ville, lors de l’établissement d’une pompe au Carroy. Suivant la tradition, Jeanne d’Arc aurait posé le pied sur cette margelle en descendant de cheval à son arrivée à Chinon.
G. d’Espinay, Notice sur Marcay, Tours 1882, p. 8, extrait du Bullet. d’Archéologie ; de Cougny, Charles VII et Jeanne d’Arc à Chinon, 1879, p. 21.
- [18]
Quicherat, I, 82.
- [19]
Quicherat, I, 100 ; id., V, 253 ; Maan, Turonensis ecclesia, p. 164.
- [20]
Carreau, Histoire de Touraine, ms. 28 de la collection de D. Housseau à la Bibliothèque nationale ; Quicherat, V, 253.
- [21]
Henri Martin, Histoire de France, VI, 233.
- [22]
Ce nom de Romieu qui est commun aujourd’hui dans le Midi, ne l’était pas autant au XVe siècle. Le terme de Romée, dans le Nord, de Romieu ou Roumieu dans le Midi, de Romei en Italie, désignait bien il est vrai, à l’origine c’est-à-dire avant le XVe siècle, le pèlerin qui avait visité la capitale des papes italiens. Mais, cette acceptation étroite au début, s’étendit peu à peu à ceux qui étaient allés à des pèlerinages autres que celui de Rome. Ainsi Romée de Villeneuve est ainsi nommé parce qu’il avait fait le pèlerinage de Saint-Jacques.
Isabelle Vouthon, la mère de Jeanne d’Arc, est appelée par presque tous les auteurs Isabelle Romée ; c’est là une erreur. Ce second nom n’est qu’un surnom et n’est pas un nom patronymique. Romée n’est qu’un qualificatif qui lui est absolument personnel et que n’ont jamais adopté les autres membres de sa famille.
MM. Michelet (Jeanne d’Arc, 1853, p. 7), E. de Bouteiller et de Braux (Nouvelles recherches sur la famille de Jeanne d’Arc, Claudin, 1879, p. XII), Siméon Luce (Jeanne d’Arc à Domrémy, 1886, p. XLXII) et d’autres auteurs ont attribué ce surnom d’Isabelle Vouthon à un pèlerinage à Rome, accompli à une époque et dans des conditions qu’ils conviennent eux-mêmes d’ignorer. Vallet de Viriville (Histoire de Charles VII, t. II, p. 43) prétend que Romée était le nom héréditaire de la mère de Jeanne. Cette opinion est inadmissible, parce que nulle part le nom de Romée n’est donné à son frère, ni à sa sœur ; elle-même est fréquemment appelée Vouthon, comme l’un et l’autre le sont invariablement. Il faut d’une manière absolue, renoncer à l’idée d’une famille Romée, c’était là un surnom personnel.
Notre savant ami M. Charles de Ribbe possède un acte notarié de 1432, dans lequel un nommé Duranti est dit Romieu,
parce qu’il avait été au grand jubilé du Puy en Velay de 1429
.Or nous savons qu’Isabelle Vouthon fut envoyée par Jeanne à ce fameux pèlerinage du Puy de 1429. Les papes, dès une époque fort reculée, avaient accordé à Notre-Dame du Puy en Velay un grand jubilé, chaque fois que le vendredi saint tomberait le 25 mars, jour de l’Annonciation, qui est la fête patronale de la cathédrale et du diocèse du Puy ; institution qui subsiste encore aujourd’hui, ainsi que le prouve le jubilé de 1864. Jeanne, comme nous le raconte M. Siméon Luce, envoya donc à ce pèlerinage, au moment même où elle commençait sa mission, sa mère et plusieurs de ses amies ou compatriotes.
Cette coïncidence entre la charte possédée par M. de Ribbe et le voyage d’Isabelle Vouthon, n’est-elle pas curieuse ? Qui sait même si la mère de la Pucelle n’aurait pas été appelée Romée (comme le fut Duranti), seulement en raison de son pèlerinage au Puy, c’est-à-dire postérieurement à 1429 ? C’est là notre avis ; nulle part avant cette date, nous ne voyons Isabelot nommée Romée.
Ce n’est qu’un peu plus tard que ce nom devint nom patronymique et que la descendance d’un pèlerin fut appelée Romieu, comme son ancêtre.
L’extension graduelle de ce Romieu, n’est-elle pas démontrée par le mot provençal romevage (d’où l’on a fait l’expression actuelle de romérage), qui s’applique aux fêtes des villages avoisinants, auxquelles la coutume est de rendre en bandes, en quelque sorte en pèlerinage ; la racine du mot est toujours la même.
Quoi qu’il en soit, le Romieu dont s’agit a été peut-être un des ancêtres du de Romieu, natif d’Arles, qui fut grand ministre d’État en Provence.
- [23]
Michel Hardy, La Mission de Jeanne d’Arc prêchée à Périgueux en 1429, Périgueux 1887, in-8°.
Voici le texte de ce document :
Item beylem lo xiij jorn de dezembre, que fezern dire una messa am nota, per so que Me Hel. Bodant era vengut en esta vila e prediquet a tot lo poble los grans miratgles que eran estat fact en Fransa per la venguda d’una pioucela qui era venguda a nostre sier lo rey de part Diou ; e nos fezem metre à la dicha messa dos siris qui pesavan j quart et demi quart, e donem a Mosser Joh. de Lascout qui dizia la dichia messa dos S., monta tot iij s. iiij d. ma.
- [24]
Semaine religieuse de Rouen, 29 mai 1886, p. 527.
- [25]
Manuscrits au greffe de la Cour d’Orléans, et à la Vaticane, n° 891, fonds de la reine Christine ; Lenglet Dufresnoy, Histoire de Jeanne d’Arc, 1753, t. III, p 267-277 ; Quicherat, V, 299 à 308.
- [26]
Vallet, Procès de Jeanne d’Arc, Didot, 1867, p. CIV, introduction.
On sait que Cauchon étant un des suffragants de Regnault de Chartres, celui-ci aurait pu évoquer le procès. Mais allait-il sauver Jeanne après s’être toujours montré son ennemi acharné, allait-il la sauver après avoir contribué à sa prise par les Anglais ? Cauchon savait si bien son sentiment à ce sujet, qu’il proposa à Jeanne de s’en rapporter, sur plusieurs questions, à la décision de Regnault de Chartres, tant il savait celui-ci dévoué aux intérêts anglais ! Regnault s’opposa même au spirituel, comme La Trémouille s’opposa au temporel, à ce qu’un effort fut tenté pour soustraire Jeanne à la juridiction de Rouen.
(Cf. Quicherat, I, 72, 73, 471 ; 184, 396, 401, 445 ; Quicherat, Aperçus nouveaux, p. 125. Ripoll, Bullarium dominicanum, 1729, t. III, p. 7 et 8 ; Vallet, Charles VII, t. II, p. 221.)
- [27]
Voici le texte de cet article :
LII. Item ipsa Johanna in tantum suis adinventionibus catholicum populum seduxit, quod multi in præsentia, ejus ram adoraverunt ut sanctam, et adhuc adorant in absentia, ordinando in reverentiam ejus missas et collectas in erclesiis ; imo cam dicunt majorem esse omnibus, Sanctis Dei, post Beatam Virginem elevant imagines et repræsentationes ejus in basilicis Sanctorum, ac etiam in plumbo et alio metallo repræsentationes ipsius super se deferunt, prout de memoriis et repræsentationibus Sanctorum per Ecclesiam canonizatorum solet fieri ; et prædicant publice ipsam esse nuntiam Dei et potius esse angelum quam mulierem… — (Quicherat, I, 290.)
Il est inutile d’insister sur l’authenticité des expéditions des deux procès dont plusieurs nous sont parvenues signées à chaque page par les greffiers mêmes des commissions. Un grand nombre de ces manuscrits sont conformes, les témoignages, dépositions, actes qu’ils renferment, ne sauraient donc être révoqués en doute.
- [28]
Revue numismatique, I, p. 413.
- [29]
Vallet, Recherches iconographiques, Dumoulin, 1855, p. 8 et pl. 1 (extrait de la Revue archéologique, 1855, avec fig.).
- [30]
Quicherat, I, 291 ; Michaud et Poujoulat, Mémoires, III, 1866, p. 188, fig ; de Bouteiller et de Braux, Notes iconographiques, 1879, etc…
- [31]
Dans le Magasin pittoresque, 1862, p. 176 avec une reproduction.
- [32]
Forgeais, Notice sur les plombs historiés trouvés dans la Seine, 1860 ; le Wallon illustré, Didot, 1876, p. 145 ; la Vie de Jeanne d’Arc, d’Abel Desjardins, Didot, 1885, p. 128, en donnent la reproduction.
Les deux médailles ont fait l’objet d’une étude nouvelle de Vallet de Viriville dans la Revue archéologique de juin 1861 : Notes sur deux médailles de plomb, Didier, in-8° de 30 p.
- [33]
Abbé Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, 1754, I, p. 523.
Cette assertion a été répétée par Levieil, L’art dans la peinture sur verre, 1774, I, ch. XI, p. 32 ; par Alex. Lenoir, Histoire des arts en France prouvée par les monuments, 1810, p. 123.
- [34]
Henri Martin, loc. citat., p. 308.
- [35]
Vallet, Recherches iconographiques, 1855, p. 9.
- [36]
La reproduction chromolithographiée a été donnée dans le Wallon illustré, 1876, p. 258.
Bien des gravures anciennes représentent la Pucelle avec les attributs de la sainteté. La plus ancienne des xylographies que l’on connaisse à ce sujet, datant de 1538, représente Jeanne avec la couronne du martyre. Cette gravure se trouve dans le Regalium Franciæ libri duo… de Charles de Grassailles, Lyon, 1538.
Nous n’énumérerons pas tous les artistes anciens et modernes qui ont entouré la tête de Jeanne de cette auréole. Citons toutefois l’hommage rendu à l’héroïne française par un peintre polonais, M. Jean Matejko, dans son beau tableau du salon de 1887 : Entrée de J. d’Arc et de Charles VII à Reims.
- [37]
Charles du Lis, Opuscules relatifs à Jeanne d’Arc, édit. de Vallet, Aubry, 1856 ; abbé Bourgaut, Guide et souvenirs du pèlerin à Domrémy, Nancy, 1878, p. 38.
- [38]
Jollois, Histoire de Jeanne d’Arc, Kilian, Didot, 1821, p. 179, note a ; de Bouteiller et de Braux, Notes iconographiques, Claudin, 1879, p. 20.
- [39]
Vallet, Recherches iconographiques, p. 10 et pl. 2 et aussi dans la Revue archéologique de 1855, p. 75 et suiv.
Vallet en avait déjà donné une reproduction dans l’Illustration du 15 juillet 1854, p. 48. MM. de Bouteiller et de Braux en ont donné une autre dans leurs Notes iconographiques, p. 19, ainsi que la Gazette des beaux-arts, 1878 ; Abel Desjardins, Vie de J. d’Arc, Didot, 1885, p. 121 ; Joseph Fabre, Jeanne d’Arc, Delagrave (1885), p. 144.
- [40]
De Bouteiller et de Braux, Notes iconographiques, Claudin, 1879, p. 8 avec une reproduction de ce groupe.
- [41]
Manuscrit 7301 à la Bibl. Nationale ; Buchon, Panthéon littéraire, p. 544 ; Quicherat, V, 101.
- [42]
E. Magnien, Nécrologe de la ville de Grenoble dans le Bulletin de l’Académie Delphinale, 1867-68.
M. G. de Braux a reproduit ces trois oraisons dans le Journal de la Société d’archéologie lorraine, juin 1887 (avec tirage à part in-8° de 3 p.)
- [43]
La France perdue par une femme sera relevée par une vierge des marches de Lorraine
avait dit Merlin.Cf. la déposition du premier témoin de l’enquête de Rouen dans de L’Averdy, Notice des manuscrits de la Bibl. du Roi, ms. 1790, p. 347 ; Michelet, loc. citat., p. 12.
Voir aussi le dire de Savigny dans Siméon Luce, Jeanne d’Arc à Domrémy, Champion, 1886 p. CCXCVII ; les dépositions de Durand Laxart et de Catherine Royer dans Quicherat, II, 444 et 447.
- [44]
Un clerc anonyme de Spire, contemporain de Jeanne, n’a-t-il pas intitulé son ouvrage : la prophétesse de France, De Sybilla francica ? (Ce ms. trouvé par Goldast fut publié par lui en 1606 à Ursel, dans le duché de Nassau, joint avec quelques autres dissertations sur la Pucelle).
Le docteur Jean Nieder, prieur des Dominicains de Bâle au XVIe siècle, n’a-t-il pas dans son Formicarium et dans son Tractatus de visionibus, attribué le même pouvoir à la Pucelle ?
Dépositions de Paquerel (Quicherat, III, 102, de L’Averdy, loc. citat., p. 348), etc…
Lire le développement de cette thèse dans P. Ayroles, Jeanne d’Arc sur les autels, Gaume. 1885, p. 88 à 97.
- [45]
Manuscrit d’Urfé à la Bibl. nationale, fol. 20. Rapporté dans la Chronique et Procès de la Pucelle, édit Buchon, 1827, et aussi dans le Panthéon littéraire, vol. Mathieu de Coussy, p. 480, d’après le manuscrit de la Bibl. d’Orléans. Michaud et Poujoulat, t. III de leurs Mémoires, Quicherat, dans ses Procès, l’ont reproduit.
Voici le texte latin lui-même :
Interrogata qualem ætatem habebat puer quem ipsa suscitavit apud Latigniacum respondit quod puer ille erat trium dierum et fuit apportatus coram imagine Beatæ Mariæ in Latigniaco, fuitque dictum ipsi Johannæ quod puellæ de villa erant coram dicta imagine, et quod ipsa vellet ire ad orandum Deum et Beatam Virginem, quod daretur vita infanti. Et tunc ipsa cum aliis puellis ivit et oravit, et finaliter apparuit vite in illo puero, qui fecit tres hiatus et fuit baptizatus postea ; statim que fuit mortuus et inhumatus in terra benedicta. Et fuerant tres dies elapsi, ut dicebatur, quibus non apparuerat vita in puero ; eratque niger velut tunica ejusdem Johannæ. Sed puellis, orans genibus flexis, coram Nostra-Domina. — (Quicherat, V, 105.)
Cf. Marius Sepet, Jeanne d’Arc, Tours, 1885, p. 290 ; Wallon, 1876, p. 258 ; J. A. Le Paire, Jeanne d’Arc en Seine et Marne, Lagny, Aureau, 1882, p. 12.
Cette scène est reproduite dans l’église Saint-Pierre de Lagny sur un vitrail de la chapelle de la sainte Vierge.
- [46]
Déposition d’Isambart de la Pierre rapportée dans Quicherat, III, 7. Cf. P. Ayroles, loc. citat., p. 144.
- [47]
Cf. P. Ayroles, loc. citat., p. 99 à 117.
- [48]
On sait que la question de nationalité de la Pucelle a été vivement discutée.
Voici ce que nous écrivions naguère encore dans la Bibliographie catholique (décembre 1886, p. 456 459) :
Jeanne d’Arc était champenoise. En effet le village de Greux, dont dépendait la partie de Domrémy située au nord du ruisseau des Trois-Fontaines, partie sur laquelle se trouve la maison où est née notre héroïne, était champenois, puisqu’on 1335 la seigneurie de Vaucouleurs avait été achetée à Jean de Joinville par Philippe VI et unie de nouveau à la couronne, attachée au gouvernement de la Champagne par Charles V en 1365.
Le nom même de Domrémy n’indique-t-il pas que ce village était dédié à saint Rémy, le patron de Reims et de la Champagne ?
Domrémy était bien français puisque, en récompense des services rendus par sa glorieuse citoyenne, il fut exempté d’impôts par Charles VII. Or, il perdit ce privilège en 1571, époque où, à la suite d’un nouveau règlement de limites entre le roi de France et le duc de Lorraine, il devint sujet de celui-ci, et il le recouvra en 1766 lorsque, avec la Lorraine, il redevint français.
La Lorraine était alors une souveraineté distincte, indépendante de la France et probablement même ouvertement alliée à ses ennemis ; elle ne devait devenir française que trois siècles après. Quand Jeanne est mandée par le vieux duc de Lorraine, Charles II, elle reçoit de lui un sauf-conduit ; en aurait-elle eu besoin si elle avait été sa sujette ? Serait-il admissible d’ailleurs de faire naître notre héroïne en pays étranger, de la faire naître l’ennemie de cette France qu’elle sauva au prix de son sang et de sa vie ? Une Française seule pouvait entendre dans son cœur le cri de la France expirante.
Les paroles de Jeanne, les actes de la chancellerie de Charles VII, et ceux des deux procès ne sont-ils pas précis ? Nous savons bien que quelques chroniques emploient, en parlant de la Pucelle, le mot de lorraine, mais que l’on veuille bien remarquer que ce mot au XVIe siècle, grâce à la vogue persistante des chansons de geste, avait conservé dans l’usage populaire son acception primitive et carolingienne. C’est ainsi que Jean de Montéclère, natif d’Andelot, est traité de lorrain dans le Journal du siège, quoique, en réalité, il fût, comme Jeanne, également surnommée la lorraine, natif du Bassigny champenois.
Toutefois, ajoutions-nous, si Jeanne est étrangère par sa naissance à l’ancienne Lorraine, à la Lorraine non encore française, il est juste de reconnaître que cette Lorraine est devenue depuis française, et bonne française. Elle a couvert alors de son égide Domrémy, la patrie de notre guerrière, fière, et à juste titre, de devenir ainsi, par une sorte d’effet rétroactif, la patrie adoptive de Jeanne d’Arc, ce symbole si pur de notre gloire militaire.
On pardonne volontiers au poète plein de flamme qui nous est né de nos désastres de 1870, Paul Déroulède, d’avoir salué Jeanne :
la lorraine, la patronne des envahis !
car en France un sentiment peut souvent être une raison. C’est ce sentiment patriotique qui lui a sans doute fait voir en la Pucelle la fille adoptive de cette contrée si française de cœur, qui lui a permis de l’appeler, comme autrefois la saluaient Christine de Pisan et Villon :Jeanne la bonne lorraine !
Malgré ces arguments agréables à soutenir, nous sommes forcés aujourd’hui de nous rallier à l’opinion adverse et d’admettre avec M. Chapellier que Jeanne n’était pas champenoise, mais barrisienne, c’est-à-dire lorraine. Les textes anciens nous disent bien que le ruisseau des Trois-Fontaines formait la limite entre le Barrois et la Champagne, que la rive gauche était champenoise, la rive droite étant du duché de Bar. Or, aujourd’hui la maison de Jeanne d’Arc était située à gauche du ruisseau, nous soutenions qu’elle était champenoise. Mais de récentes recherches ont fait découvrir que le ruisseau des Trois-Fontaines avait changé de lit, qu’on l’avait détourné au milieu du XVIIIe siècle, lors de la construction de la route de Vaucouleurs à Neufchâteau, et qu’aujourd’hui il coule à la droite de la maison de Jeanne d’Arc, tandis qu’autrefois il coulait à gauche.
Les preuves matérielles et les témoignages paraissent formels. Donc Jeanne d’Arc étant née sur la rive droite du ruisseau et non pas sur la gauche, comme nous l’avions cru jusqu’ici, est bien barroise et non champenoise.
(Voir J. Chapellier, Étude sur la véritable nationalité de Jeanne d’Arc, Nancy Crépin Leblond, 1886, extrait du Journal de la Société archéologique lorraine, décembre 1885.)
(Cf. pour la première opinion J. Chapellier, Étude sur la nationalité de Jeanne d’Arc, Épinal, Vve Gley 1870, extrait des Annales de la soc. d’émulation des Vosges ; Henri Lepage, Jeanne d’Arc est-elle lorraine ? Nancy, Grimblot et Vve Raybois, 1852 ; seconde dissertation sur la même question, même lieu, 1855, extraite aussi des mémoires de l’Académie Stanislas ; Un dernier mot sur cette question, Nancy, Lepage, 1856, extrait du Journal de la Société d’archéologique lorraine ; abbé Riant, De la nationalité de Jeanne d’Arc, Épinal, Vve Gley, 1870, Annales de la Société d’émulation des Vosges.
Pour l’origine champenoise : Athanase Renard, trois mémoires intitulés : Jeanne d’Arc était elle française ? Paris, Claye 1852, 1855, 1857 ; Jeanne d’Arc examen d’une question de lieu, Orléans Jacob 1862 ; L’état civil de Jeanne d’Arc, Langres 1879 ; La patrie de Jeanne d’Arc, Langres 1880 ; A. Assier, Une cité champenoise au XVe siècle, Paris Claudia 1875 ; Harmand, Mémoires de la société des belles-lettres de l’Aube, 1855, p. 47 ; abbé Étienne Georges, Jeanne d’Arc est-elle champenoise ou lorraine ? Troyes, Dufour-Bouquot 1882, extrait de l’Annuaire de l’Aube, etc…)
- [49]
Croirait-on qu’au commencement du XVIIIe siècle, il s’est trouvé un historien français, le comte de Boulainvilliers, qui, dans les cent pages qu’il a consacrées au règne de Charles VII, trouve le moyen de ne pas mème citer le nom de la Pucelle, ni de faire aucune allusion à un seul de ses actes ? (Réflexions sur l’histoire de France.) Voici tout ce qu’il dit des secours qui vinrent à Charles :
Il s’attacha à la belle Agnès Sorel aux sentiments de laquelle l’histoire rend de si glorieux témoignages de courage et d’élévation, qu’elle nous persuade qu’on lui doit en partie le recouvrement de la France.
- [50]
L’année dernière, S. G. Mgr l’archevêque de Rouen, répondant aux vœux de la population, a rétabli la fête du 30 mai, anniversaire du supplice de Jeanne, fête qui avait été fondée en 1456 par la ville de Rouen lors du procès de réhabilitation, en expiation du supplice dont elle avait été le théâtre.
Voir Fête solennelle en l’honneur de Jeanne d’Arc, Rouen, Cagniard, 1886, in-8° de 66 p. contenant : 1° le récit de la fête par M. l’abbé Julien Loth ; 2° le panégyrique prononcé par Mgr Thomas ; 3° le poème de M. Allard.
Un superbe oratorio de M. Charles Lenepveu fut exécuté à cette occasion, dans la cathédrale de Rouen, par 400 musiciens. (Jeanne d’Arc, drame lyrique en trois parties, poème de M. Paul Allard, musique de M. Charles Lenepveu. Paris, O’Kelly, 1886, in-4° de 142 p.) La seconde édition du poème seul, est de Rouen, Paul Leprêtre, 1886, in-8° de 24 p.
On a lu aussi dans les journaux le récit de la belle fête qui a eu lieu le 24 juillet dernier dans la cathédrale de Reims. Mgr Langénieux y a fait exécuter une magnifique messe en musique de Gounod, composée pour la circonstance et intitulée : À la mémoire de Jeanne d’Arc, vierge et martyre. (Paris, Lemoine, 1887).
Signalons encore parmi les expressions du plus vif enthousiasme patriotique pour la Pucelle, l’hommage qui lui a été rendu récemment par M. Henri Jadart, secrétaire de l’Académie de Reims, dans son intéressant volume Jeanne d’Arc à Reims (Reims, Michaud, 1887, in-8° de X et 133 p. avec grav.).
La France moderne, — dit M. Jadart, — étudie, connaît et aime Jeanne d’Arc, comme ne l’a jamais fait l’ancienne France. Avec quel profit ce culte serait entretenu dans toutes les classes sociales ! Quelle leçon n’en tireraient point tous les âges ? Cette fille du peuple, qui fut de son vivant l’objet de tant de contradictions et d’envie, la victime de tant de haines d’une part, d’indifférence et de lâcheté de l’autre, n’est-elle pas restée, en somme, à travers les variations des siècles comme le plus admirable idéal de réconciliation et de concorde ? Il ne pouvait en être autrement, car on retrouve en elle toutes les qualités de la nation : la droiture et le bons sens, le dévouement chevaleresque, la foi fervente et efficace. Mieux que les légendes antiques, mieux que les chansons de geste, sa vie reste pour nous une leçon élevée autant que populaire, un encouragement aux jours d’épreuves, une consolation et une espérance au lendemain des revers. Nobles sentiments de gratitude et d’élan patriotique qu’il faut partout susciter, partout encourager, partout servir ! C’est la cause française par excellence.
- [51]
Mgr Perraud, Jeanne d’Arc, message de Dieu, discours prononcé pour le 458e anniversaire de la levée du siège d’Orléans, Herluison, 1887, in-8° de 40 p.