Vie de Jeanne d’Arc
Vie de Jeanne d’Arc
par
(1818)
Éditions Ars&litteræ © 2023

5Préface
Longtemps la vie de l’Héroïne qui a sauvé la France en 1429 a été, pour la négligence de son style et de son impression, reléguée parmi les contes de la Bibliothèque bleue. Il y a un an environ que M. Le Brun de Charmettes l’a tirée de cette humiliante proscription, en publiant sur ce sujet, cher à tout bon Français, quatre forts volumes remplis de recherches et de dissertations du plus grand intérêt. Ce livre, dont nous sentons tout le prix, nous a donné l’idée d’une composition moins étendue, moins savante, et conséquemment sous tous 6les rapports, bien plus à la portée du commun des lecteurs : c’est ce que nous offrons en ce moment au public.
Nous avons puisé nos matériaux à la Bibliothèque du Roi ; nous garantissons donc leur authenticité, dont chacun d’ailleurs est maître de s’assurer par lui-même. Un récit animé et rapide, quoique renfermant tous les détails nécessaires, nous a paru convenir à ce livre, et nous l’y avons employé quand il s’agit de raconter des événements tels que ceux qu’il renferme, nous pensons que les digressions sont dangereuses, eussent-elles pour but d’éclaircir, par la discussion, des points d’histoire ; elles fatiguent le lecteur, le détournent de l’objet principal, 7et finissent par l’en dégoûter. C’est avec lui-même que l’auteur doit, en pareil cas, discuter les choses douteuses, pour présenter ensuite au lecteur le résultat de ses observations.
La vie soignée de Jeanne d’Arc, ainsi rendue d’un achat facile pour tout le monde, ne saurait être présentée dans un moment plus favorable. Par un mouvement aussi beau et aussi juste que celui qui a fait reparaître au milieu de nous la statue du grand Henri, on parle d’élever au sein de la capitale, un monument à la jeune vierge qui fut plus anciennement la libératrice de la France : avant que ce monument si intéressant pour la gloire nationale pare une de nos places 8publiques, n’est-il pas convenable que chacun de nous apprenne véritablement à connaître la généreuse Française dont il rappellera les hauts faits et le noble dévouement.
9Vie de Jeanne d’Arc
Livre Ier
- État déplorable de la France pendant les premières années du règne de Charles VII.
- À quels titres les princes anglais prétendaient en être rois.
- Régence du duc de Bedford, pour cause de la minorité de Henri VI d’Angleterre.
- Succès importants des Anglais en France.
- Siège d’Orléans entrepris par eux.
- Commencements de Jeanne d’Arc.
- Quelles sont les premières révélations qu’elle croit avoir.
- Quand elle se croit appelée à sauver la France.
- Ses hésitations.
- Elle se rend auprès 10du seigneur de Baudricourt, gouverneur de Vaucouleurs.
- Difficultés qu’elle éprouve à le persuader de sa mission.
- Elle part enfin pour la cour.
- Elle y subit de rigoureux examens avant d’être admise devant le roi.
- Elle est admise ; circonstances particulières de cette entrevue.
- Nouveaux examens.
- Elle est investie d’une grande autorité.
- Ses préparatifs singuliers avant de partir à la tête d’une armée pour secourir Orléans.
- Sa lettre aux Anglais.
Ensuite du meurtre commis à Montereau, le 10 septembre 1419, sur la personne du duc de Bourgogne, par les officiers de la suite du dauphin, la France, depuis longtemps attaquée et entamée par les Anglais, était en quelque sorte devenue une province de l’Angleterre.
Le dauphin, cité à la Table de Marbre 11du Parlement pour ce meurtre, avait été condamné par contumace et banni du royaume à perpétuité. Un traité avait été signé à Troyes, portant pour articles principaux : que Madame Catherine de France, fille de Charles VI, roi de France, épouserait Henri V, roi d’Angleterre ; qu’à cette condition, après la mort de Charles VI, Henri lui succéderait à la couronne de France, comme son héritier, et transmettrait cette couronne à ses descendants ; que, bien que le roi Charles, tant qu’il vivrait, dût être possesseur du royaume, néanmoins le soin de le gouverner et de le régler en serait confié à Henri, et que les sujets, vassaux et états lui feraient dès lors hommage et serment de fidélité et obéissance ; que tous les actes publics seraient expédiés sous le nom et sous le sceau de Charles, ce qui n’empêcherait pas qu’en quelques cas Henri ne pût donner des ordres ou faire des défenses, tant de par le roi Charles, que de par lui, comme régent ; que Charles, en lui écrivant, userait de cette formule : À notre très cher Fils, Henri, roi d’Angleterre, héritier 12de France
; qu’après que Henri serait parvenu à la couronne de France, les deux couronnes de France et d’Angleterre seraient unies en une même personne, tant de lui que de ses héritiers, en conservant cependant à chacun des deux royaumes, ses coutumes, libertés, privilèges, lois, et sans soumettre l’une à l’autre.
Ce traité avait reçu son exécution en tout ce qui dépendait des parties contractantes. Le roi d’Angleterre avait pris dans les actes publics le titre de régent et héritier de France ; les baillis, avant d’être reçus au parlement, juraient de le reconnaître en cette qualité, et ce prince avait même, par une extension abusive de ses droits prétendus, rendu une ordonnance pour faire battre en Normandie une monnaie sur la quelle cette inscription devait être mise : Henricus Francorum Rex (Henri, roi des Français).
Henri V étant mort, son fils Henri VI, à peine âgé d’un an, avait été proclamé héritier de la couronne de France, sous la régence du duc de Bedford ; et Charles VI 13ayant lui-même cessé de vivre au moment où il fut enterré, un héraut avait fait retentir l’église Saint-Denis, sépulture ordinaire de nos rois, de ce cri funeste : Vive Henri de Lancastre, roi de France et d’Angleterre !
et pour rendre cette prise de possession encore plus solennelle, le duc de Bedford, en rentrant ce jour-là dans Paris, avait fait porter devant lui l’épée royale, comme régent du royaume.
Mais, ce qui plus que toutes ces formalités, fruit d’un traité surpris à un prince dans un état complet de démence, mettait le royaume en péril, c’est la puissance que, par la force des armes, les Anglais y avaient acquise. Quand le dauphin, sous le nom de Charles VII, se trouva saisi de la couronne par la mort de son père qui ne pouvait, en aucun cas, la transmettre à d’autres héritiers que les princes de sa maison, presque toute la France était effectivement envahie. Les trahisons et les malheurs continuant à paralyser les efforts de ceux de ses guerriers qui demeuraient fidèles, bientôt même elle fut réduite à cette détresse, 14que son sort parut dépendre entièrement de celui d’Orléans attaqué avec succès sur toutes ses faces par une armée composée de l’élite des troupes ennemies, et commandée par leurs généraux les plus célèbres. Cette ville n’avait cependant, pour se défendre, qu’une faible garnison qu’il paraissait impossible de renforcer convenablement ; et après avoir vu prendre toutes ses approches malgré le courage désespéré de ses habitants, elle avait déjà demandé à capituler sous certaines conditions. La France semblait à jamais perdue, et l’on s’attendait à voir tomber d’un moment à l’autre entre les mains des Anglais, la place que l’on regardait comme le dernier boulevard qu’elle pût leur opposer. Le duc de Bedford avait renvoyé les députés d’Orléans avec mépris, en s’écriant qu’il aurait leur ville à volonté, et que les habitants lui paieraient ce que lui avait coûté son siège
.
En Bassigny, dans le hameau de Domrémy, vivait une jeune paysanne de l’âge de dix-sept à dix-huit ans, aimée et respectée de tout le monde à cause de la pureté de 15ses mœurs et de la douceur de son caractère : ce fut de là que partit le coup inattendu qui devait écraser l’orgueil des ennemis de la France.
La paysanne de Domrémy se nommait Jeanne, et était fille de Jacques d’Arc, cultivateur, vivant honnêtement d’un peu de labourage et du produit de quelque bétail ; pieux, simple, hospitalier, et d’une probité sévère.
Jeanne portait la piété encore plus loin que l’auteur de ses jours. À l’âge de treize ans, elle invoquait Dieu sans cesse et partout, craignant de ne le point honorer assez dignement, et lui demandant de lui faire connaître par des inspirations comment il voulait qu’elle le servît. Un jour d’été, vers l’heure de midi, comme elle s’abandonnait ainsi à une espèce de méditation dans le jardin de son père, il lui sembla tout à coup voir éclater à sa droite, et du côté de l’église du hameau, une grande clarté, et entendre en même temps retentir une voix inconnue qui la rassurait sur l’état de son âme, en l’invitant à persévérer dans sa piété et dans 16sa bonne conduite3. Les historiens de sa vie font remonter cette première révélation de Jeanne d’Arc au 8 mai 1423 ou 1424.
La jeune paysanne aimait sa patrie ; elle ne l’oubliait pas dans ses prières, et demandait encore avec ferveur à Dieu, qu’il tirât la France de l’état d’humiliation et d’opprobre toujours croissant où la tenaient ses divisions intestines, et les séductions et le fer de l’étranger : bientôt ses visions se portèrent sur ce point. Un jour elle crut se trouver en présence de l’archange saint Michel, qui lui dit que Dieu avait pitié de la France ; qu’il fallait qu’elle, Jeanne, allât au secours du Roi ; qu’elle ferait lever le siège d’Orléans, et qu’elle rétablirait Charles VII, malgré ses ennemis, dans le royaume de ses pères
. Jeanne avait trop de modestie pour croire facilement à une telle révélation, que les événements 17humains eux-mêmes ne pouvaient que peu accréditer dans son esprit, puisque Orléans, qu’elle regardait principalement, ne fut assiégé que quatre ou cinq ans plus tard. Sortie de cette espèce de moment d’extase, elle s’excusa devant Dieu, comme d’une faute, d’avoir eu l’orgueil de s’y abandonner. Cependant la révélation se renouvela plusieurs fois. Jeanne crut entendre l’archange lui annoncer sainte Catherine et sainte Marguerite, auxquelles elle avait beaucoup de confiance, comme les êtres supérieurs choisis pour la guider et l’assister de leurs conseils ; et effectivement elle ne tarda pas à se persuader qu’elle voyait et qu’elle entendait ces deux saintes, qui tantôt lui parlaient en se montrant à elle, et tantôt, en restant invisibles, se faisaient seulement entendre.
Plus elle avançait en âge, plus ces injonctions des envoyés célestes lui semblaient devenir pressantes. Les voix (ainsi les désignait-elle) lui disaient deux ou trois fois par semaine, qu’elle partît, et vînt en France, c’est-à-dire, suivant le langage 18du temps, dans la portion du royaume qui formait le domaine immédiat de la couronne ; la Picardie, l’Île-de-France, l’Orléanais, le Berry et la Touraine.
Jeanne n’osait s’ouvrir à personne de ces révélations : qui que ce soit n’y eût pris confiance, et elle n’y voyait que le danger de se faire passer inutilement pour folle. Peut-être, après quelque espace de temps, se sentait-elle portée à s’accuser elle-même d’exaltation et de délire ; mais le même phénomène se répétait bientôt pour la replonger dans le même état d’agitation et d’inquiétude. Plusieurs années s’écoulèrent ainsi ; elle en vint peu à peu à laisser échapper, par intervalles, quelques mots qui appartenaient à ce secret, pour lequel elle eût voulu trouver ses parents et leurs compatriotes d’une piété aussi absolue, aussi confiante que la sienne. Mon compère, dit-elle un jour à un laboureur de son voisinage, si vous n’étiez pas Bourguignon, je vous dirais quelque chose.
(Le duc de Bourgogne, c’est-à-dire le fils du prince tué sur le pont de Montereau, était, comme on a pu en juger par le commencement 19de ce livre, uni aux Anglais contre le Roi de France, et l’on appelait généralement Bourguignons, les ennemis de ce dernier.) Un autre laboureur, nommé Michel Lebuin, l’entendit s’écrier, dans une autre occasion, qu’il y avait, entre Compey et Vaucouleurs, une fille qui, avant un an, ferait sacrer le roi de France
; prédiction qui s’accomplit effectivement dans l’année. Devant un troisième, elle répéta différentes fois ces paroles bien plus positives : qu’elle délivrerait la France et le sang royal
.
Cependant toutes ces choses étaient parvenues aux oreilles de ses parents, qui, les attribuant sa haine pour les ennemis de sa patrie, veillaient avec soin sur elle, de peur, disaient-ils, comme ils l’avaient songé, que leur fille ne s’en allât avec les gens d’armes
.
Des troupes bourguignonnes vinrent dans le pays, forcèrent les habitants à en fuir, et le pillèrent. Quand Jeanne y rentra avec sa famille, après le départ de ces brigands, le spectacle du ravage qu’ils y 20avaient fait, lui rappela encore, d’une manière plus vive que jamais, la noble mission à laquelle elle croyait se sentir appelée, et l’ordre que ses voix lui avaient déjà donné antérieurement : de se rendre à Vaucouleurs, où elle trouverait dans la protection de Robert de Baudricourt, gouverneur de cette ville, les moyens de faire le voyage de Chinon, qu’habitait alors le roi Charles VII
. Enfin, quelques persécutions qu’on lui fît éprouver, vers le même temps, relativement à un mariage que les auteurs de ses jours eussent bien voulu lui voir contracter, pour se débarrasser des inquiétudes qu’elle leur donnait, lui fournirent l’occasion de tenter d’obéir à ce qu’elle regardait comme la volonté du Très-haut.
Ayant, à la suite de ces persécutions, demandé avec succès à son oncle maternel, nommé Durand Laxart, qui demeurait au Petit-Burey, village situé entre Domrémy et Vaucouleurs, la permission de se retirer chez lui ; elle n’y eut pas plutôt demeuré huit jours, qu’elle lui dit qu’il fallait 21qu’elle allât à Vaucouleurs, parce qu’elle voulait de là se rendre en France, vers le dauphin, pour le faire couronner
; soit qu’elle n’eût témoigné à son oncle le désir de résider chez lui que dans ce dessein, soit que dans ce nouveau domicile ses inspirations et ses révélations fussent devenues plus pressantes qu’elles ne l’avaient encore été.
Son oncle l’aimait beaucoup : il finit par se laisser gagner, et exigea seulement de Jeanne qu’elle permît qu’il allât d’abord, seul, trouver le seigneur de Baudricourt, pour lui faire connaître dans quelle situation extraordinaire se trouvait sa nièce. Cette nièce ne sembla au seigneur de Baudricourt qu’une insensée, qu’il recommanda à la sévérité de Durand Laxart. Le premier pas était fait, et les voix de Jeanne lui avaient prédit qu’elle serait repoussée jusqu’à trois fois : elle ne se rebuta donc pas de ce premier contre-temps, et voulut aller trouver elle-même le gouverneur de Vaucouleurs ; son oncle l’accompagna, quelles que fussent ses dispositions particulières au sujet de ce voyage.
22Elle arriva à Vaucouleurs dans les premiers jours de mai 1428, vêtue simplement de ses habits de paysanne. Le seigneur de Baudricourt, prévenu de son arrivée, refusa de l’envoyer au roi, mais voulut cependant bien la voir. Jeanne quoiqu’il lui eût toujours été absolument inconnu, courut droit à lui parmi ceux qui l’environnaient, ayant prétendu dans un des interrogatoires que lui firent subir les Anglais en 1430, qu’il lui avait été indiqué par ses voix. Elle lui dit qu’elle venait vers lui de la part de son Seigneur ; pour qu’il mandât au dauphin de se bien maintenir, et qu’il n’assignât point de bataille à ses ennemis, parce que son Seigneur lui donnerait secours dans la mi-carême ; que le royaume n’appartenait pas au dauphin, mais à son Seigneur ; que toutefois son Seigneur voulait que ledit dauphin devint roi, et qu’il eût ce royaume en dépôt ; ajoutant que, malgré ses ennemis, il serait fait roi, et qu’elle le mènerait sacrer
.
— Qui est votre Seigneur, lui demanda le gouverneur ?
— Le roi du ciel, 23lui répondit-elle avec assurance.
Cette entrevue ne suffit pas pour persuader le gouverneur, et le voyage de Jeanne fut inutile. Après avoir, dans plusieurs entretiens avec différents habitants de Vaucouleurs, protesté en quelque sorte de cette négligence, et défendu sa mission contre des ministres même des autels, elle retourna à son village, où elle reprit ses exercices de piété avec autant d’abandon et d’humilité qu’auparavant.
Au commencement du carême de 1429, Jeanne revint à Vaucouleurs avec son fidèle conducteur, Durand Laxart. Elle y logea, comme la première fois, chez un charron nommé Henri, dont la femme, appelée Catherine, avait conçu pour elle la plus vive amitié. Jean de Novelompont, surnommé de Metz, gentilhomme considéré dans le pays, vint par hasard chez son hôte. Ayant appris quel rôle singulier elle y jouait :
— Que faites-vous ici, mon amie, lui dit-il : ne faut-il pas bien que le roi soit chassé du royaume, et que nous devenions Anglais ?
— Je suis venue, répondit Jeanne, demander à Robert de Baudricourt, 24qu’il me conduisit ou me fit conduire au roi, lequel n’a cure (ne s’occupe) de moi ni de mes paroles. Et cependant, avant qu’il soit la mi-carême, il faut que je sois devers le roi, dussé-je, pour m’y rendre user mes jambes jusqu’aux genoux : car personne au monde, ni rois, ni ducs, ni fille du Roi d’Écosse4, ou tous autres ne peuvent reprendre le royaume de France, et il n’y a pour lui de secours que moi-même, quoique j’aimasse mieux rester à filer près de ma pauvre mère ; car ce n’est pas là mon ouvrage : mais il faut que j’aille et que je le fasse, parce que mon Seigneur le veut.
— Et quel est votre Seigneur ? lui demanda Jean de Metz, comme l’avait fait précédemment le seigneur de Baudricourt.
— C’est Dieu, répondit encore Jeanne.
Il paraît que le ton qu’elle mit à prononcer ce peu de paroles frappa Jean de Metz, qui avait peut-être beaucoup entendu parler d’elle, car il lui promit, 25par sa foi, sa main dans la sienne, que sous la conduite de Dieu, il la mènerait au roi, et lui demanda quand elle désirait partir :
— Plutôt aujourd’hui que demain, répondit-elle.
Le départ fut néanmoins différé, le seigneur de Baudricourt attendant une réponse du roi, auquel il avait écrit, et Jeanne croyant d’ailleurs fermement, d’après ses révélations, qu’elle finirait par partir avec l’assentiment de ce seigneur, dont la recommandation ne pouvait qu’infiniment faciliter à la cour le succès de sa mission.
Orléans était alors assiégé depuis quatre mois, et cette circonstance devait augmenter encore la confiance de Jeanne d’Arc dans ses révélations.
Cependant elle commençait à acquérir de la célébrité dans le pays. Chacun raisonnait d’elle à sa manière, et l’on commençait en général à la regarder comme une fille suscitée par le ciel pour sauver la France et lui rendre sa gloire. Le duc, Charles de Lorraine, depuis longtemps malade, se la fit amener, espérant en tirer 26quelque remède capable de lui rendre la santé ; mais Jeanne ne se reconnaissait pas la prescience, et au nom de Dieu, elle invita seulement ce prince, avec dignité, à mériter, par une meilleure conduite envers son épouse, que les gens de bien fissent des vœux pour sa guérison. Quoiqu’elle n’eût pu donner au duc le secours qu’il en attendait, il eut pour elle les plus grands égards, et ne la congédia qu’après lui avoir fait un présent.
Enfin arriva à Vaucouleurs un envoyé du roi, porteur d’une lettre qui autorisait le seigneur de Baudricourt à faire partir la jeune inspirée pour la cour, afin qu’elle y fût au moins interrogée et examinée.
On ne songea donc plus qu’à la mettre en route. Si l’on s’en rapporte à une chronique du temps, quelques jours plus tôt, alors que le gouverneur hésitait encore, en attendant les réponses du roi, Jeanne lui prouva sa mission en lui apprenant l’issue du funeste combat de Rouvray Saint-Denis, si célèbre sous le nom de journée des harengs, le jour même où 27il fut livré5 : En mon Dieu, lui dit-elle, vous mettez trop à m’envoyer ; car aujourd’hui le gentil dauphin a eu, assez près d’Orléans, un bien grand dommage, et sera-t-il encore taillé de l’avoir plus grand, si ne m’envoyez bientôt vers lui.
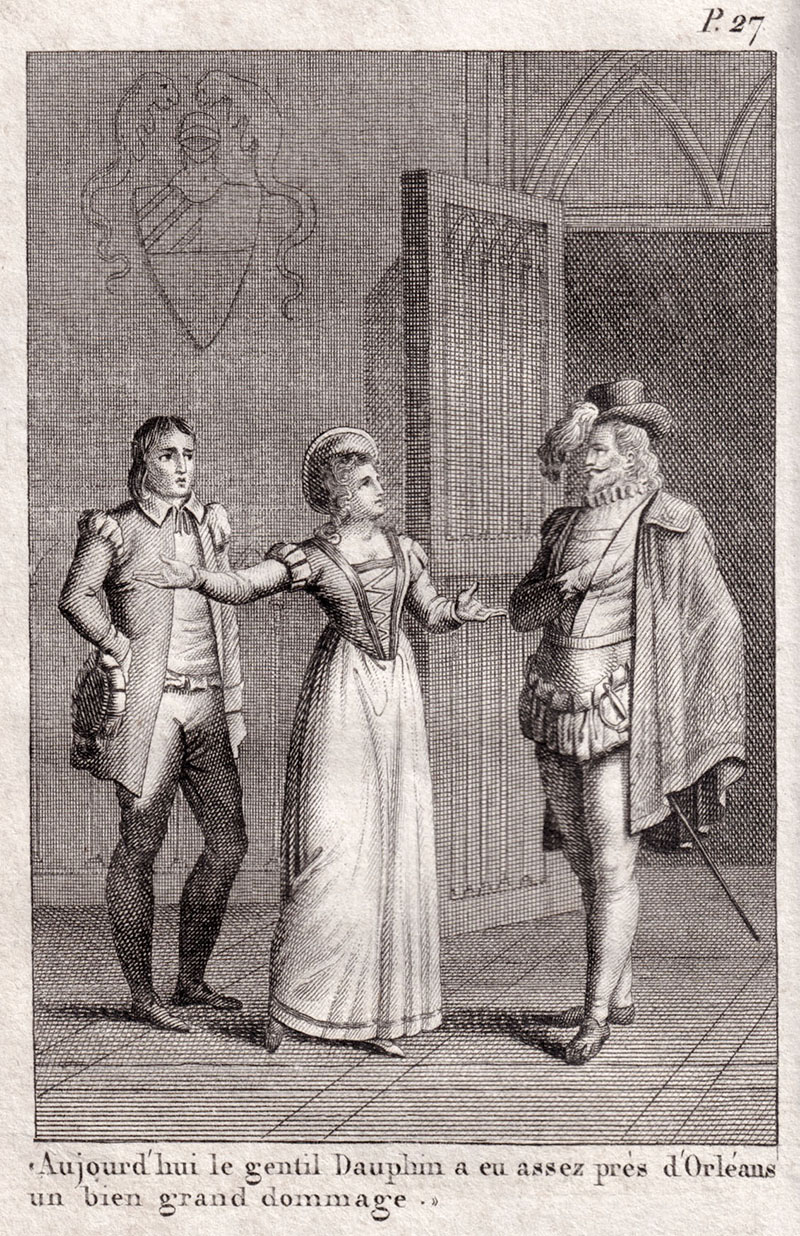
Sur le choix qu’elle fit d’habits d’homme pour son voyage, les habitants de Vaucouleurs s’empressèrent de lui procurer, à leurs frais, tout ce qui était nécessaire pour son équipement. Ils lui firent faire une robe d’homme, des bottines, etc., etc.
Durand Laxart, et un nommé Jacques Alain, qui était devenu un de ses plus déterminés partisans, se réunirent pour lui acheter un cheval. Quant au seigneur de Baudricourt, il se contenta de lui donner une épée, et n’entra à son sujet dans aucune autre dépense. Il ne pouvait se résoudre à croire assez en elle pour l’aider 28plus puissamment. Son incrédulité parut jusque dans ses adieux : Va, lui dit-il, au moment où elle partit, va, et advienne ce qu’il pourra.
La petite escorte de Jeanne d’Arc consistait en six personnes, savoir :
Jean de Novelonpont, dit de Metz, auquel Jeanne paraît donner le titre de chevalier ;
Bertrand de Poulengy, ou de Poulengey, écuyer ;
Pierre d’Arc, troisième frère de Jeanne ;
Colet de Vienne, messager ou envoyé du Roi ;
Richard, archer ;
Julien, valet de Poulengy ; et Jean de Honnecourt, ou Bonnecourt, serviteur de Jean de Metz.
Ces six personnes avaient juré, entre les mains du seigneur de Baudricourt, qu’ils la mèneraient saine et sauve au roi.
On était alors au dimanche, 13 février, 1429.
Jeanne paraissait pleine de confiance. Quelques personnes lui ayant demandé 29comment il était possible qu’elle entreprît de partir, vu le grand nombre d’hommes d’armes ennemis qui battaient le pays aux environs de Vaucouleurs : Je ne crains pas les hommes d’armes, répondit-elle, et je trouverai le chemin libre ; car, s’il y a des hommes d’armes sur la route, j’ai Dieu, mon Seigneur, qui me fera mon chemin jusqu’à monseigneur le dauphin.
— C’est pour cela que je suis née
, disait-elle encore à la foule, étonnée de la voir s’exposer à de si grands périls. Au reste, elle assurait que les esprits célestes avec lesquels elle croyait être en communication, lui avaient donné bonne espérance : Va hardiment, lui avaient-ils dit ; quand tu seras devers le roi, il aura bon signe de te recevoir et croire.
Pour joindre Chinon, où résidait alors Charles VII, il ne fallait pas parcourir moins de cent-cinquante lieues, et une bonne partie de cette longue route était infestée par l’ennemi : on prit des chemins détournés, et l’on traversa à gué plusieurs rivières, bien que la saison fût peu favorable 30à cette manière de voyager. Si l’on eût cru Jeanne d’Arc, on n’aurait pas pris toutes ces précautions. Se prétendant, dans cette grande circonstance, continuellement inspirée et avisée par ses saints protecteurs, elle répétait sans cesse qu’il ne pouvait y avoir rien à redouter, ni pour elle, ni pour ceux de sa suite. Quelques-uns d’entre eux voulant éprouver jusqu’à quel point on pouvait compter sur le courage et la tranquillité quelle faisait paraître, imaginèrent de s’écarter de la troupe, et de revenir ensuite l’attaquer comme s’ils eussent été un parti ennemi : Ne fuyez pas, dit Jeanne avec calme à ceux qui, étant restés auprès d’elle, feignaient de vouloir prendre la fuite ; en mon Dieu, ils ne vous feront aucun mal.
Ses compagnons de voyage remarquaient que sa première pensée, chaque matin en s’éveillant, était de prier Dieu, et elle témoignait un grand désir d’assister à l’office divin, bien que, par prudence, eux, qui répondaient d’elle lui permissent rarement de se montrer ainsi en public dans les lieux qu’ils traversaient.
31Arrivée à Fierbois, village de Touraine, situé à cinq ou six lieues de Chinon, elle envoya au roi une lettre, portant en substance qu’elle désirait savoir si elle devait entrer dans la ville où il était ; qu’elle avait bien cheminé l’espace de cent cinquante lieues venir vers lui à son pour secours, et qu’elle savait beaucoup de choses qui lui seraient agréables.
La réponse fut favorable, et ne se fit pas longtemps attendre, car Jeanne partit bientôt pour Chinon. Elle n’avait mis que onze jours dans tout son voyage.
Elle ne pouvait arriver à la cour dans un moment plus opportun. Le roi se trouvait sans moyens réels de secourir Orléans, qu’il regardait cependant comme sa dernière espérance. Il était presque sans troupes et sans argent. La dame de Bouligny, qui était alors dans la ville de Bourges, auprès de la reine, rapporte qu’en ce temps-là, il y avait dans ce royaume, spécialement dans les parties obéissantes au roi, tant de calamités et si grande pénurie d’argent, que c’était pitié ; si bien que 32les sujets fidèles au roi étaient, près de s’abandonner au désespoir ; et le sait celle qui parle, ajoute en cet endroit la dame de Bouligny, parce que son mari était alors receveur général, lequel tant de la pécune (de l’argent) du roi, que de la sienne propre, n’avait en tout chez lui que quatre écus. Tout était désespéré, et l’on ne se flattait de recevoir aucun secours, à moins qu’il ne fût envoyé de Dieu.
La mission divine que prétendait accomplir Jeanne d’Arc, semblait d’ailleurs justifiée par des prédictions, des prophéties, sortes de choses qui, à cette époque avaient, même à la cour, un fort grand crédit. Jeanne ne fut cependant point admise sur-le-champ, devant le roi : on décida qu’elle serait d’abord examinée et interrogée par des prélats. Ce fut Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, qui la leur présentèrent. Les commissaires du roi lui firent beaucoup de questions, et lui demandèrent, entre autres choses, dans quel dessein elle était venue à Chinon, et ce qu’elle prétendait : mais elle refusa d’abord de leur rien 33répondre, sinon qu’elle avait à parler au roi. Cependant, pressée au nom de ce prince de faire connaître l’objet de sa mission, elle dit enfin, qu’elle avait deux choses à accomplir de la part du Roi des cieux : la première, de faire lever le siège d’Orléans ; la seconde, de conduire le roi à Reims, pour l’y faire sacrer et couronner.
Après cette première entrevue, les prélats ne se trouvèrent pas d’un avis unanime : les uns voulaient que le roi n’ajoutât aucune foi aux paroles de cette jeune fille ; et les autres, qu’il l’entendit, puisqu’elle se disait envoyée de Dieu, et prétendait avoir quelque chose à dire au prince. Charles VII, de lui-même naturellement irrésolu, s’arrêta au parti de la faire examiner de nouveau. On la tira donc de son hôtellerie pour la loger dans une tour du château du Coudray, où l’on pourrait l’observer à loisir tandis qu’on enverrait dans son pays natal, s’informer de sa vie, de son caractère et de ses mœurs.
Les personnes de distinction qui eurent 34permission ou commission de venir converser avec elle, ne rapportèrent de ses entretiens, rien qui ne fût à sa louange ; elles la trouvèrent en parfaite raison, et d’une pureté de pensées peu commune ; mais se croyant fermement réservée la par volonté d’en haut à sauver la France, et assistée à ce sujet de conseils divins. Ceux que le soin de la servir fixait continuellement auprès d’elle, racontèrent de leur côté qu’elle passait une grande partie de la journée en prières, montrant alors la plus grande ferveur.
Enfin, l’urgence du danger l’emportant sur toute autre considération, et imposant silence aux plus incrédules et aux plus en vieux, il fut décidé, le troisième jour de son arrivée, qu’elle serait entendue.
Le roi, pour l’éprouver encore dans cette occasion, et peut-être pour vérifier ce qui s’était passé lors de sa présentation au seigneur de Baudricourt, se cacha, modestement vêtu, dans la foule de ses courtisans. Il était curieux de voir si ne connaissant pas sa personne, elle serait, de prime 35abord, poussée vers lui par ses inspirations ; ce qui parut arriver effectivement. Quoique plusieurs seigneurs magnifiquement parés, et plus de trois-cents chevaliers de haute naissance, fussent réunis à dessein dans la salle où on l’introduisit, elle alla, sans hésiter, au prince, ses voix, dit-elle, le lui ayant fait connaître
, le salua humblement, et lui dit en s’agenouillant, selon l’usage, et en l’embrassant par les jambes :
— Dieu vous doint (donne) bonne vie, gentil roi !
— Ce ne suis-je pas qui suis roi, Jehanne, répondit Charles VII continuant son épreuve, et lui montrant un des seigneurs de sa suite ; voici le roi.
Mais Jeanne, sans se déconcerter, lui répliqua :
— En mon Dieu, gentil prince, c’estes vous, et non aultre ! Très-noble seigneur daulphin, poursuivit-elle, je viens et suis envoyée de la part de Dieu, pour prêter secours à vous et au royaume.
Elle ajouta qu’elle voulait aller faire la guerre aux Anglais. Selon d’autres, le roi lui demanda d’abord son nom, et elle lui répondit en ces termes :
— Gentil daulphin, j’ai nom 36Jehanne la Pucelle ; et vous mande le Roi des cieux, par moi, que vous serez sacré et couronné en la ville de Reims, et serez lieutenant du Roi des cieux, qui est Roi de France.
Le roi la tira à part, et s’entretint fort longtemps avec elle. Pendant cet entretien, les spectateurs virent la satisfaction se peindre sur la figure du prince. On a prétendu que Jeanne, en témoignage de l’esprit divin qui l’animait, rapporta à Charles VII, une chose qui ne pouvait être connue que de Dieu et de lui. Dans le temps de ses plus grands malheurs, ce prince, auquel ses ennemis contestaient jusqu’à sa naissance, avait, seul en son oratoire, prié Dieu que, si ainsi était qu’il fût vrai roi, descendu de la noble maison de France, et que justement le royaume lui dût appartenir, il lui plût le lui garder et défendre ; ou, au pis, lui donner grâce d’échapper, sans mort ou prison, et qu’il se pût sauver en Espagne ou en Écosse, qui étaient de toute ancienneté frères d’armes, amis et alliés des rois de France ; et pour ce, avait-il 37là choisi son refuge.
Or, on assure que ce fut cette prière que Jeanne d’Arc répéta au roi, pour lui prouver la réalité de sa mission divine. On rapporte encore que le roi, ayant cessé de s’entretenir à part avec elle, se rapprocha des courtisans qui étaient demeurés dans la chambre, et leur dit lui-même que cette jeune fille venait de lui raconter certaines choses secrètes que nul ne savait ni ne pouvait savoir, Dieu seul excepté ; et que, pour cette raison, il avait pris grande confiance en elle.
Il restait, d’après la superstition du temps, à décider si Jeanne devait sa prescience à Dieu ou à la magie, car, dans le second cas, on aurait cru ne pas pouvoir se servir d’elle. Charles VII, que d’ailleurs nous avons déjà signalé comme un prince naturellement lent et irrésolu, se détermina donc à la soumettre à de nouveaux examens, et à prendre à son sujet les avis des docteurs les plus célèbres. Pendant ce temps, la garde de sa personne fut remise à Guillaume Bellier, maître de la maison du roi.
38Jeanne fut d’abord interrogée à Chinon, et ensuite à Poitiers, où était alors transféré le parlement. On dit qu’elle refusa d’entrer dans beaucoup des détails qui lui furent demandés, se contentant de répondre qu’elle avait donné au roi des signes clairs et évidents de sa mission. Les questions furent poussées très loin, et faites sans ménagements. On y mit même de l’aigreur et de la dureté, ce qui, de la part de Jeanne, attira des réponses vives à quelques-uns des questionneurs ; mais dans toutes, elle fit admirer sa confiance, son bon sens et sa présence d’esprit. Parmi les membres du conseil du roi et les docteurs qui l’examinèrent à Poitiers, se trouvait un frère Séguin, bien aigre homme, disent les mémoires du temps. Né dans la province du Limousin, et parlant un français corrompu ; il s’avisa de demander à Jeanne, déjà fatiguée d’un long interrogatoire, quel idiome parlait la voix dont elle était assistée :
— Meilleur que le vôtre, lui répondit Jeanne avec vivacité.
— Croyez-vous en Dieu, ajouta-t-il ?
— Mieux que vous, répondit-elle.
39Effectivement, interroger de cette manière une personne qui, demandant à sauver son pays, se prétendait et paraissait être inspirée de Dieu, n’était pas prouver qu’on le respectât beaucoup.
— Dieu, continua le même frère Séguin, ne veut point qu’on croie à vos paroles, à moins que vous ne fassiez voir un signe par lequel il demeure évident qu’il vous faut croire. Nous ne conseillerons donc point au roi, sur votre simple assertion, de vous confier des gens d’armes, pour que vous les mettiez en péril, si vous ne nous dites pas autre chose.
— En mon Dieu, dit Jeanne avec dignité, je ne suis pas venue à Poitiers pour faire signes (miracles) ; mais conduisez-moi à Orléans ; je vous y montrerai des signes, pourquoi je suis envoyée… Le signe qui m’a été donné, dit-elle dans un autre moment, pour montrer que je suis envoyée de Dieu, c’est de faire lever le siège d’Orléans. Qu’on me donne des gens d’armes, en telle et si petite quantité qu’on voudra, et j’irai.
Maître Guillaume Aymeri lui adressa un 40jour l’objection suivante :
— Tu prétends que la voix t’a dit que Dieu veut délivrer le peuple de France de la calamité où il est : or, s’il veut en effet le délivrer, il n’est pas besoin de gens d’armes.
Jeanne répondit aussitôt, et sans se déconcerter :
— En mon Dieu, les gens d’armes batailleront, et Dieu donnera la victoire.
Quelques personnes lui ayant demandé pourquoi elle appelait le roi dauphin et non pas roi :
— Je ne le nommerai roi, répondit-elle, que lorsqu’il aura été sacré et couronné à Reims, où je prétends le conduire.
On lui attribue encore dans cet examen quatre prédictions, qui se sont toutes réalisées.
La première : que les Anglais seraient vaincus ; qu’ils lèveraient le siège qu’ils avaient mis devant Orléans, et que cette ville serait délivrée desdits Anglais : que toutefois elle les sommerait d’abord de se retirer.
La seconde : que le roi serait sacré à Reims.
41La troisième :que la ville de Paris serait rendue à l’obéissance du roi.
La quatrième : que le duc d’Orléans, alors prisonnier en Angleterre, reviendrait en France.
Quand les docteurs commis pour l’interroger lui faisaient de savantes citations, et appelaient à leur secours tous les auteurs sacrés pour prouver qu’on ne la devait pas croire, Jeanne les écoutait tranquillement, et se contentait de répondre, lorsqu’ils avaient fini : Il y a ès livres (dans les livres) de Messire (de Dieu) plus que ès vostres (dans les vôtres).
Elle témoignait au reste du mécontentement de ce qu’on perdait ainsi le temps en examens et en interrogatoires. Elle répétait souvent : qu’il était temps et besoin d’agir
.
Les informations faites à Domrémy et dans les environs vinrent bientôt ajouter à la bonne opinion que Jeanne donnait d’elle à tous ceux qui l’approchaient et qui l’entendaient.
Les commissaires prononcèrent enfin. Ils 42déclarèrent qu’ils ne trouvaient en elle, ni en ses paroles, rien de mal ni de contraire à la foi catholique ; qu’ils ne voyaient rien que de bon dans son fait ; et qu’attendu son état, ses réponses si prudentes, qu’elles leur, semblaient inspirées ; ses manières, sa simplicité, sa conversation, sa sainte vie et sa louable réputation ; attendu aussi le péril imminent et besoin d’être immédiatement secourue où se trouvait la ville d’Orléans, ainsi que la nécessité pressante où étaient le roi et le royaume, dont les habitants soumis à l’obéissance du roi étaient réduits au désespoir, et n’attendaient aucun secours que de Dieu ; ils étaient d’avis que le roi pouvait accepter les services de cette jeune fille et l’envoyer au secours d’Orléans
.
Le roi, toujours irrésolu, et craignant peut-être le ridicule que jetterait sur lui une telle aventure si elle n’était point couronnée du succès, fit encore plusieurs autres consultations particulières, et ordonna enfin que Jeanne serait remise à des femmes chargées de constater l’état de pureté où elle avait vécu jusque là.
43Cette dernière épreuve, si propre à égayer certains de nos contemporains, avait une très grande importance dans cette affaire, pour le temps où elle se fit. On croyait qu’une vierge ne pouvait participer aux enchantements de la magie ; et, comme nous l’avons déjà dit plus haut, l’on ne voulait, par conscience, se servir de Jeanne qu’autant qu’il serait bien constaté qu’elle n’était pas magicienne. La confiance que l’on pensait pouvoir prendre dans la jeune paysanne de Domrémy, venait d’ailleurs en grande partie d’une vieille prédiction qui disait : que la France serait perdue par une femme, et rétablie par une vierge des marches (des frontières) de la Lorraine
. La femme qui avait perdu la France était la reine Isabeau de Bavière, qui, par haine pour Charles VII, avait contribué plus que personne à faire appeler l’Anglais à la succession de la couronne : il s’agissait de s’assurer, par tous les moyens que l’on pourrait employer, si la paysanne des marches de la Lorraine, qui demandait qu’on lui remît le sort de la France, était 44bien la vierge que l’on croyait prédestinée pour la sauver. Le coup qu’on allait porter devait être décisif. Demeuré sans succès, non seulement il déconsidérerait totalement le roi, mais il achèverait de décourager le reste de ses sujets fidèles, et leur ferait tomber les armes de la main.
Aussitôt que Charles VII eut décidé qu’il emploierait Jeanne d’Arc, on revint à Chinon. Trois semaines s’étaient écoulées depuis que Jeanne y était arrivée de son pays. De là le roi envoya le duc d’Alençon à Blois, pour préparer le convoi qu’on voulait introduire dans Orléans. Le prince accepta d’autant plus volontiers cette commission, qu’il prenait le plus vif intérêt à Jeanne. Elle-même, mise sous la conduite du chevalier d’Aulon, l’un des plus respectés à la cour, obtint la permission d’aller jusqu’à Tours, attendre que tout fût prêt pour l’expédition. Elle se montrait toujours impatiente et sans inquiétude.
— Jeanne, lui avait dit à Poitiers un maître des requêtes de l’hôtel du roi, on veut que vous essayez à mettre les vivres dans Orléans, mais il me semble 45que ce sera forte chose, vu les bastilles (les forts) qui sont devant, et que les Anglais sont très puissants.
— En mon Dieu, avait elle répondu, nous les mettrons dedans Orléans à notre aise, et si, il n’y aura Anglais qui saille (sorte) ne qui fasse semblant de l’empêcher.
Jeanne, à Tours, ne tarda point à avoir une maison montée, c’est-à-dire qu’on lui donna par ordre du roi, des gens pour sa garde et pour son service, et tout l’équipage d’un général d’armée, ou, comme on parlait alors, d’un chef de guerre. Jean d’Aulon remplit constamment auprès d’elle les fonctions d’écuyer ; Louis de Contes, sur nommé Imerguet ou Imigot, jeune homme de treize à quatorze ans, fut désigné pour l’accompagner en qualité de page, conjointement avec un autre gentilhomme qui avait pour prénom celui de Raymond, mais dont le nom de famille est inconnu. Le roi attacha encore à son service deux hérauts d’armes, dont l’un s’appelait Guyenne, et l’autre Ambleville. Un historien ajoute à ce nombre un maître-d’hôtel et deux valets. 46Son aumônier lui fut donné par son père ou sa mère, qui, pour la voir, étaient venu habiter un village voisin de Chinon. Ce prêtre se nommait Jean Pasquerel, et dès ce moment il ne la quitta plus.
Le roi fit faire pour elle, soit à Chinon, soit à Tours, une armure complète entièrement semblable à celles que portaient les chevaliers. Son cheval, du moins celui qu’elle monta dans ces premiers moments, lui avait été donné en cadeau par le duc d’Alençon, un certain jour qu’à Chinon elle avait couru la lance avec tant d’adresse et de bonne grâce qu’elle avait excité une admiration générale. Ce fait porterait assez naturellement à croire, comme le dit un auteur, qu’après avoir passé ses premières années à mener les troupeaux de son père aux pâturages, elle s’était exercée ensuite à monter ses chevaux, et avait pris part aux jeux dans lesquels ses compagnes s’exerçaient à disputer le prix de la course, et à combattre avec des espèces de lances à la manière des chevaliers.
Quant à son épée, voici comment elle-même 47déclara dans un des interrogatoires que les Anglais lui firent subir en 1430, se l’être procurée.
Pendant qu’elle était à Chinon ou à Tours, elle sut, dit-elle, par la révélation des voix célestes qui l’assistaient, qu’il y avait une épée marquée de cinq croix, enfouie près de l’autel de l’église de Sainte-Catherine de Fierbois, et que c’était de celle-là qu’elle devait s’armer. Elle écrivit en conséquence aux prêtres qui desservaient cette église, pour qu’il leur plût qu’elle pût avoir cette épée. Elle leur désignait exactement la place, sa mémoire ne lui permettant cependant pas d’assurer si c’était devant ou derrière l’autel, quoiqu’elle crût plutôt que c’était derrière. On fouilla la terre à l’endroit désigné, et l’on ne tarda pas à découvrir l’arme en question. Elle était rouillée. Les prêtres qui avaient présidé à cette recherche la dérouillèrent eux-mêmes. Ils la renfermèrent ensuite dans un fourreau de velours vermeil tout parsemé de fleurs de lis, et l’envoyèrent à Jeanne d’Arc. Les habitants de Tours, renchérissant sur eux, 48voulurent substituer au fourreau de velours une gaîne de drap d’or ; mais Jeanne, que sa modestie n’abandonna jamais, ne se servit que d’un fourreau de cuir qu’elle fit faire exprès.
Toujours par l’avis de ses voix, à ce qu’elle nous dit encore elle-même dans un de ses interrogatoires de 1430, la guerrière inspirée voulut avoir un étendard, et désigna la manière dont il devait être peint. Sur un champ blanc, semé de fleurs de lis, y fut figuré le Sauveur des hommes, assis sur son tribunal dans les nuées, et tenant un globe dans ses mains. À droite et à gauche furent représentés deux anges en adoration : l’un d’eux tenait une fleur de lis en ses mains, sur laquelle Dieu semblait répandre ses bénédictions. Ces mots : Jhesus Maria
étaient écrits à côté. L’étendard était d’une toile blanche appelée alors boucassin, et frangé de soie. On remarqua dans la suite, qu’autant que cela lui était possible, elle portait elle-même cet étendard, et on l’entendit répondre à ceux qui lui en demandaient la raison : C’est parce que je 49ne veux pas me servir de mon épée, ni en percer personne.
Dans les combats, Jeanne d’Arc ne se servait effectivement de son épée qu’à la dernière extrémité, et pour parer les coups qu’on lui portait, plutôt que pour en porter elle-même ; elle se contentait ordinairement de repousser ses adversaires à coups de lance, ou de les écarter avec une petite hache qu’elle portait suspendue à son côté.
Quand tout fut prêt à Blois pour le secours que l’on destinait aux habitants d’Orléans, Jeanne s’y rendit, accompagnée de l’archevêque de Reims, chancelier de France, et du seigneur de Gaucourt, grand-maître de l’hôtel du roi, et suivie de sa propre maison. Elle séjourna à Blois deux ou trois jours, parce qu’il fallut attendre que les vivres qu’on y amenait dans des bateaux fussent arrivés. C’est dans cette ville qu’elle se revêtit pour la première fois de ses armes. Les soldats qui devaient faire partie de l’expédition n’avaient à cette époque, disent les vieilles chroniques, aucune confiance en elle. Cependant le roi pensait, malgré 50l’obscurité de son origine, raison très puissante dans ces temps reculés, avoir de si grands motifs de lui accorder toute créance, que bien qu’à la tête des troupes qui se rassemblaient à Blois, il ne manquât pas de bons et de suffisants capitaines pour délibérer du fait de la guerre, si commanda-t-il qu’on ne fît rien sans appeler Jeanne d’Arc
.
Tout dans les actions de celle qui allait fixer les regards de l’Europe entière portait un caractère extraordinaire. Elle voulut qu’un certain nombre de prêtres accompagnassent l’expédition. Elle leur donna une bannière qui représentait le Sauveur sur la croix. Tant qu’on fut à Blois, les prêtres de la ville, réunis autour de cette bannière deux fois le jour par l’aumônier Jean Pasquerel, chantèrent en l’honneur de la reine du ciel, des antiennes et des hymnes consacrées.
Jeanne, au reste, recommandait à toute l’armée la sagesse et les pratiques de la religion ; c’était comme à une croisade qu’elle se préparait à mener les guerriers français au secours d’Orléans.
51Rien n’arrêtant plus, les vivres ayant été chargés sur des chars, et les troupes réunies sous les bannières de leurs chefs, Jeanne d’Arc, les maréchaux de Saint-Sévère et de Rais, l’amiral de Culant, le seigneur de Gaucourt, Ambroise de Loré, La Hire et plusieurs autres chevaliers et officiers moins célèbres, quittèrent la ville de Blois le 27 avril 1429, et se dirigèrent sur Orléans. Cette petite armée formait un total de cinq à six-mille hommes environ. Les prêtres qui devaient faire partie de l’expédition marchaient à la tête des troupes à la suite de la bannière dont nous avons parlé un peu plus haut. Ils faisaient retentir les airs de chants religieux, et semblaient invoquer la vengeance du ciel contre ceux que l’on allait combattre.
Le dé était jeté, bien des gens en attendaient l’effet pour asseoir leur opinion sur ces voix prétendues qui avaient dit à Jeanne que Dieu donnerait secours au roi dans la mi-carême : car c’était dans la mi-carême que Jeanne avait paru à la 52cour ; et comme on lui appliquait la prédiction à elle-même, l’événement allait décider si c’était un véritable secours que, dans sa personne, Dieu avait envoyé à Charles VII.
Avant de partir, Jeanne avait expédié aux Anglais, devant Orléans, un héraut, chargé de leur remettre la lettre suivante, disant, qu’entre les instructions qu’elle avait reçues de ses deux saintes, il lui était surtout prescrit de sommer les Anglais d’abandonner le siège d’Orléans, avant de rien entreprendre contre eux.
✠ Jhesus Maria ✠
Roi d’Angleterre, et vous, duc de Bedford, qui vous dictes régent le royaume de France ; vous Guillaume de la Poule (Pole) comte de Sulford (Suffolk) Jehan sire de Talebot (Talbot) et vous, Thomas, sire de Scales, qui vous dictes lieutenant dudit duc de Bedford, faites raison au Roy du ciel, rendez à la Pucelle, qui est cy envoyée de par Dieu le Roy du 53ciel, les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est cy venue de par Dieu, pour réclamer le sanc royal. Elle est toute prête de faire paix, si vous lui voulez faire raison, par ainsi que France vous mettres sus et paierés ce que vous l’avez tenu. Et entre vous, archiers, compagnons de guerre, gentilz et autres, qui etes devant la ville d’Orléans, alez vous en vostre païs de par Dieu ; et se ainsi ne le faictes, attendés les nouvelles de la Pucelle, qui vous ira veoir briesvement à voz bien grans dommaiges ! Roi d’Angletterre, se ainsi ne le faictes, je suis chief de guerre, et en quelque lieu que je attaindrai voz gens en France, je les en ferai aler, veuillent ou non veuillent, et si ne veuillent obeir, je les ferai tous occire. Je suis cy envoiée de par Dieu, le roy du ciel, pour vous bouter hors de toute France. Et si veuillent obéir, je les prendray à mercy. Et n’ayés point en vostre oppinion, quar vous ne tendrez (tiendrez) point le royaume de Dieu, le roy du ciel, fils de 54saincte Marie : ains (mais) le tendra (tiendra) le roy Charles, vray heritier ; car Dieu, le roy du ciel, le veult, et lui est revelé par la Pucelle : lequel entrera à Paris à bonne compagnie. Se ne le voulez croire les nouvelles de par Dieu, et la Pucelle, en quelque lieu que vous trouverons, nous ferirons dedens, et y ferons un si grant hahay que encore a il mil ans que en France ne fu si grant, si vous ne faictes raison. Et croiez fermement que le roy du ciel envoiera plus de force à la Pucelle, que vous ne lui sariez mener de tous assaulz, à elle et à ses bonnes gens d’armes ; et aux horions, verra on qui ora meilleur droit de Dieu du ciel. Vous duc de Bedford, la Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous faictes mie destruire. Se vous lui faictes raison, encore pourrés vous venir en sa compaignie, l’où que les Franchois feront le plus bel faict que oncques fut fait pour la Xhrestpienté. Et faictes reponse se vous voulez faire paix, en la cité d’Orléans. Et se ainsi ne le faictes, de vos bien grans dommages vous 55souviegne briesvement. Escrit ce samedi sepmaine sainte (26 mars 1429).
Jeanne d’Arc ne put écrire cette lettre elle-même, puisqu’elle ne savait ni lire, ni écrire ; elle la dicta seulement. Lors de son procès à Rouen, elle ne la reconnut pas dans son entier : elle soutint qu’elle avait dicté : rendez au roi
, et non pas : rendez à la Pucelle
, et contesta aussi les mots : je suis chef de guerre
.
56Livre II
- L’armée arrive aux environs d’Orléans.
- Embarras où l’on se trouve pour n’avoir pas suivi l’avis de Jeanne d’Arc.
- Elle entre avec peu de monde dans Orléans.
- Effet qu’elle y produit.
- Ses tentatives auprès des Anglais pour les engager à se retirer.
- Elle facilite l’entrée des troupes qu’elle avait amenées de Blois.
- Les Anglais sont vaincus par elle dans plusieurs combats, et obligés de lever le siège.
Jeanne d’Arc et sa petite armée arrivèrent le troisième jour aux environs d’Orléans, sur la rive gauche de la Loire, c’est-à-dire ayant ce fleuve entre eux et la ville. Pour éviter ce désavantage, Jeanne voulait qu’on passât la Loire sur 57le pont de Blois, afin d’aborder ainsi Orléans par la rive droite, sur laquelle il est situé. Les généraux s’étaient montrés opposés à cet avis, parce qu’ils savaient que les assiégeants avaient placé leurs principales forces de ce côté : en vain la jeune inspirée avait-elle insisté, comptant sur ses révélations, qui ne lui laissaient rien à redouter des Anglais dans cette entreprise ; on l’avait trompée sur ce point, profitant pour cela de l’ignorance entière où elle était du pays. Quand elle s’aperçut de cette tromperie, que l’événement rendit inutile, il n’était plus temps d’y remédier ; on avait déjà Orléans en vue, du haut d’un coteau qui domine le cours du Loiret.
Après avoir, de là traversé l’espace appelé Val de Loire, qui sépare ce fleuve du Loiret, on parvint sur le rivage de la Loire, un peu au-dessus de la bastille (du fort) que les Anglais avaient construite à la place d’une église, nommée Saint-Jean-le-Blanc. Les prêtres de l’expédition marchaient toujours à la tête des troupes. Il 58fallait que des barques vinssent d’Orléans prendre dans cet endroit, les troupes et les provisions de toute espèce qu’elles escortaient ; ce qui était aussi très difficile, cause du voisinage du fort. La petite armée s’en trouvait si proche, que les guerriers des deux nations pouvaient mutuellement distinguer leurs traits. Un nouvel obstacle résultait d’ailleurs de l’état présent du ciel : ces barques ne pouvaient remonter contre le cours de la Loire qu’à la voile, et le vent se trouvait absolument contraire. C’était avoir bien malheureusement suivi un avis opposé à celui de Jeanne d’Arc. Et d’aucunes fois advenoit que l’opinion d’elle estoit tout au contraire des capitaines, remarque N. Sala ; mais quoi qu’il en fust, s’ilz la créoient, tousjours leur prenait bien ; et, le contraire, quant ilz voulaient exécuter leur opinion sans elle, mal leur venoit.
Instruit de la situation des guerriers qui venaient au secours d’Orléans, le chevalier Dunois, qui y commandait, passa la Loire dans un léger bateau à rames, avec Théobald 59d’Armagnac, dit de Termes, et plusieurs autres officiers, et vint mettre pied à terre à l’endroit où se tenait le convoi.
— Êtes-vous le bastard d’Orléans ? lui demanda Jeanne d’Arc en le voyant approcher.
— Oui, je le suis, répondit le chevalier ; et je me réjouis de votre arrivée.
— Est-ce vous, poursuivit-elle qui avez donné l’avis de me faire venir de ce côté de la rivière, et non pas directement du côté où sont Talbot et ses Anglais ? Les vivres eussent entré sans les faire passer par la rivière.
Dunois répliqua que lui et d’autres capitaines plus habiles que lui, en avaient ainsi décidé, croyant ce parti meilleur et plus sûr.
— En mon Dieu, reprit Jeanne d’Arc, le conseil de Dieu notre Seigneur est plus sûr et plus habile que le vostre. Vous avez cru me décevoir et vous vous êtes vous-même plus déçu que moi ; car je vous amène le meilleur secours qui ait jamais été envoyé à qui que ce soit, soit à chevalier, soit à ville, car c’est le secours du roi des cieux : non mie, par amour de moi, mais procède de Dieu 60même, qui, à la prière de saint Louis et de saint Charlemagne, a eu pitié de la ville d’Orléans, et ne veut point souffrir que les ennemis aient ensemble le corps du duc d’Orléans et sa ville.
Dans le conseil que l’on tint, on se fut bientôt convaincu que le voisinage de la bastille anglaise mettait dans une impossibilité réelle d’embarquer les vivres et les troupes dans ce lieu, et l’on décida que l’on remonterait le long des bords de la Loire jusque vis-à-vis le village de Chécy, à environ deux lieux à l’est d’Orléans. Il y avait un port commode, en cet endroit, et Dunois en était maître, par la petite garnison qu’il entretenait dans le village. L’obstacle du vent restait toujours ; mais il changea bientôt. Cependant Jeanne d’Arc encourageait les généraux, au lieu de profiter pour les humilier, de la faute où ils étaient tombés en refusant de suivre son avis.
Le chevalier Dunois s’était hâté de redescendre à Orléans aussitôt qu’il avait vu le vent changer. Il arriva avec les barques 61à Chécy, à peu près en même temps que la petite armée française. Allait-on faire traverser le fleuve à ces troupes, et les mettre sur-le-champ aux mains avec les Anglais ? La plus grande partie des officiers qui les commandaient ne le voulurent pas : ils les trouvèrent trop peu nombreuses, et furent d’avis de les reconduire à Blois, afin que, suivant l’opinion qu’avait d’abord émise Jeanne d’Arc, on leur fit passer le fleuve sur le pont, pour les ramener ensuite par la rive droite chercher, avec moins de précipitation et de danger, une occasion de pénétrer dans Orléans. Jeanne s’opposa encore à ce délai : les soldats, d’après son ordre, avaient rempli leurs devoirs de religion en pleine campagne ; et elle les prétendait dès lors invincibles. Quand elle eut cédé sur ce point, Dunois lui demanda d’entrer avec lui dans la ville, sa présence ne pouvant que rendre le courage aux habitants, et leur faire prendre patience jusqu’à l’arrivée des troupes. Jeanne y montra encore plus de répugnance, disant qu’elle ne voulait point 62laisser là ses soldats
; elle craignait peut être, qu’une fois partie pour Blois, les troupes ne reparussent plus. Elle finit cependant par se rendre aux prières du chevalier, ayant seulement soin d’ordonner à son chapelain, de rester avec l’armée, et de continuer de marcher devant elle, ainsi que les autres prêtres, avec leur bannière déployée.
Elle entra ensuite dans la barque de Dunois, avec lui, la Hire, le chevalier d’Aulon, Louis de Contes et plusieurs autres, et tenant son étendard à la main. Deux-cents lances seulement l’accompagnaient dans d’autres barques. On descendit sans difficulté à Chécy, dont, encore une fois, Dunois était maître ; tandis que l’armée, qui était restée en bataille sur la rive gauche du fleuve tout le temps que l’embarquement des munitions destinées aux Orléanais avait duré, reprenait la route de Blois, sous le commandement du maréchal de Rais et d’Ambroise de Loré.
En redescendant la Loire, pour regagner la ville, il fallait que les barques 63qui portaient les munitions passassent devant le port et l’église du nom de Saint-Loup, où les assiégeants avaient un poste fortifié. Dans l’intention de faciliter ce passage, auquel s’attendaient les Anglais, puisqu’ils avaient vu la petite flotte remonter, quelques instants plus tôt, le fleuve à vide, on fit de la ville une forte sortie. Cette sortie réussit parfaitement, et occupa l’ennemi aussi longtemps qu’il le fallait pour que le convoi arrivât sans malencontre à sa destination.
Cependant Jeanne d’Arc s’était arrêtée quelques heures à Chécy : car il avait été convenu qu’elle n’entrerait dans Orléans qu’à la nuit ; soit qu’on craignit de l’exposer en la faisant de jour traverser les quartiers ennemis avec une aussi faible escorte que celle qui l’accompagnait ; soit qu’on voulût éviter autant que possible, le tumulte que causerait son arrivée parmi les habitants. Un grand concours de monde se trouva néanmoins sur son passage lorsqu’elle entra par la porte orientale de la ville, armée de toutes pièces. Elle était 64montée sur un cheval blanc. Le chevalier Dunois marchait à sa gauche, et elle faisait porter devant elle son étendard, qui, par sa singularité, pouvait aussi exciter la curiosité, et fixer l’attention. À son escorte s’étaient joints plusieurs guerriers de la garnison et bourgeois de la ville, qui étaient sortis, par honneur, au-devant d’elle. Elle fut reçue du peuple avec des cris de joie et de grandes marques de reconnaissance : c’était un ange consolateur qui paraissait au milieu de lui ; il lui devait dans ce moment l’existence, et croyait que bientôt il lui devrait la victoire.
En effet, il y avait déjà plus d’un jour qu’on s’occupait de Jeanne à Orléans, et de la mission glorieuse dont elle se disait investie par le ciel. On y avait entendu parler d’elle dès le temps où elle était partie de son pays, pour se rendre auprès du roi. Le bruit y avait couru alors, qu’une jeune bergerette, qu’on ne désignait déjà plus que sous le nom de la Pucelle, avait passé par Gien, accompagnée de quelques gentilshommes des marches de la Lorraine, 65dont elle était originaire : laquelle avait annoncé qu’elle se rendait vers le noble dauphin, et qu’elle venait de la part et par ordre de Dieu, faire lever le siège d’Orléans, et conduire ensuite le roi à Reims, pour y être sacré
. Le chevalier Dunois, gouverneur de la ville, avait même, à cette époque, envoyé à la cour le seigneur de Villars, alors Sénéchal de Beaucaire, et Jamet de Tillay, ou de Tilloy, qui fut depuis bailli de Vermandois, pour savoir ce qu’il pouvait y avoir de vrai dans une nouvelle aussi surprenante ; et ces députés étant revenus à Orléans, pleins de l’enthousiasme que Jeanne d’Arc inspirait à tout le monde avaient fait partager aux habitants leur confiance en elle.
Quelque fatiguée que fût Jeanne, car, armée depuis le matin, elle était restée presque toute la journée à cheval, sans prendre aucune nourriture ; une fois qu’elle fut entrée dans la ville, elle voulut avant tout aller à la principale église, rendre grâces à Dieu. On l’y suivit, en faisant 66retentir les airs des acclamations les plus flatteuses pour elle. Sa modestie n’en fut point diminuée : elle exhortait le peuple à espérer en Dieu seul, dont elle n’était que l’humble servante, assurant que s’il avait véritablement foi et confiance, il échapperait aux fureurs de ses ennemis.
On la conduisit ensuite, en faisant éclater les mêmes transports, jusqu’auprès de la porte Regnart, à la maison de Jacques Boucher alors trésorier du duc d’Orléans, où son logement avait été marqué. Un souper splendide l’y attendait ; mais elle ne voulut manger que cinq ou six menues tranches de pain détrempées dans un peu de vin mêlé d’eau. Après ce repas frugal, elle se coucha, ayant soin, pour ne laisser aucune prise à la calomnie, de s’enfermer dans une même chambre, avec la maîtresse de la maison et sa fille. Pierre d’Arc, son frère, le chevalier d’Aulon, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, logèrent aussi chez le trésorier. Pour le maréchal de Boussac, qui faisait partie de ceux qui l’accompagnaient, aussitôt qu’il 67la vit en sûreté dans la ville, il en sortit, et chemina toute la nuit, sur la rive droite du fleuve, pour aller rejoindre l’armée au pont de Blois. On était alors au dernier jour du mois d’avril 1429.
Mais le moment est venu de faire connaître à nos lecteurs quelles étaient les positions des assiégeants autour de la ville. Arrivés à sa vue le 12 octobre 1428, ils s’étaient peu à peu, et après des combats opiniâtres où avaient brillé la valeur et le dévouement des Orléanais, emparés de toutes ses approches. Suivant la coutume du temps ils l’avaient entourée, sur tous les points, de bastilles ou forts. Les historiens varient sur le nombre. Selon Villaret, six grandes bastilles, élevées vis-à-vis des principales avenues d’Orléans, se communiquaient par soixante redoutes moins considérables, construites dans les intervalles.
Voici les noms et la position de ceux de ces forts et de ces redoutes dont parlent les chroniques.
68À l’occident.
La bastille de Saint-Laurent-des-Orgerils, commencée le 30 décembre 1428, au bord de la Loire, à l’endroit où se trouve encore aujourd’hui l’église de ce nom.
Le boulevard ou la redoute de la Croix-Boissée, existant dès le 17 janvier suivant, situé entre la ville et la bastille Saint-Laurent, à l’endroit vraisemblablement où se trouve aujourd’hui le carrefour formé par les rues Rose, Saint-Laurent, du Four-à-chaux et de la Croix-de-bois.
La bastille de Londres, à l’endroit appelé alors des Douze Pairs.
La bastille ou le boulevard du Colombier, ainsi nommé probablement parce qu’elle avait été élevée à l’endroit où était le Colombier-Turpin, qui a donné son nom à une rue aujourd’hui renfermée dans l’enceinte de la ville.
Le boulevard de la Croix-Morin, situé apparemment à l’endroit qu’on appelle encore aujourd’hui la Croix, presque au bout de la rue du Colombier.
69Au nord.
La bastille Aro ou de Rouen, vraisemblablement située vis-à-vis l’ancienne porte Bannier, à peu de distance de celle actuellement existante.
La bastille de Paris, achevée le 15 avril, entre Saint-Pouair et Saint-Ladre, aujourd’hui Saint-Paterne et Saint-Lazarre, sur l’ancien chemin de Paris, et vis-à-vis la porte Parisie.
À l’orient.
La bastille de Saint-Loup ou Saint-Laud, construite le 10 mars sur les débris de l’église de Saint-Loup, renfermée aujourd’hui dans l’enceinte de la ville, au coin des rues des Juifs, des Noyers et Saint-Euverte, à peu de distance de l’évêché. Cette forteresse se trouvait ainsi au nord-est de l’ancienne porte de Bourgogne, à portée de canon de la tour de la Fauconnerie, située à l’angle des remparts, à l’endroit où se voit aujourd’hui le carrefour formé par les rues Sainte-Euverte, des Hurpois, de l’Évêché et du Bourdon-Blanc. 70Il ne faut pas la confondre avec le port Saint-Loup, dont nous avons déjà parlé, et qui était distant de plus d’une demi-lieue de l’ancienne porte de Bourgogne.
Au sud.
La bastille de Saint-Jean-le-Blanc, élevée le 20 avril sur la rive gauche du fleuve, à l’orient des Tournelles, et à l’endroit où se trouve encore aujourd’hui l’église de ce nom.
La bastille des Tournelles. Cette bastille n’était point de la façon des Anglais. Située sur l’ancien pont d’Orléans, près de la rive gauche de la Loire, à l’endroit où ce pont formait un coude et biaisait un peu à l’est, elle faisait partie des fortifications de la ville ; elle ne tenait à la rive gauche de la Loire que par une seule arche de pierre et un pont-levis. À l’approche des Anglais, les habitants avaient couvert le pont-levis d’un boulevard élevé à même la rive gauche du fleuve. Ce boulevard, qu’on peut comparer, pour en donner une idée, 71à ces ouvrages que l’on nomme de nos jours têtes de pont, était, comme toutes les autres fortifications de même espèce dans ces temps reculés, formé de fagots, fortement liés les uns aux autres, et soutenus par de gros pieux profondément en foncés dans le sol, les intervalles se remplissant de terre et de décombres entassés. Destiné dans l’origine à défendre du côté de la terre l’approche du pont-levis qui donnait entrée dans la bastille des Tournelles, il était lui-même défendu par des fossés profonds où coulait l’eau de la Loire. Ce boulevard et la bastille des Tournelles ayant été pris par les Anglais le 24 octobre 1428, ils avaient, en conservant ce premier boulevard dans son entier, couvert la bastille d’un second boulevard placé sur le pont en regard de la ville. Les Orléanais avaient opposé à ce second boulevard pour la défense du reste du pont, un troisième boulevard solidement construit sur le pont même, dans un endroit où il s’appuyait, à peu près au milieu de la rivière, sur une espèce d’île disparue depuis. Deux ou trois 72arches étaient coupées entre ces deux ouvrages en opposition l’un à l’autre.
La bastille des Augustins, formée par les Anglais, du 17 au 20 octobre, sur la rive gauche de la Loire et sur les débris de la maison des augustins, à peu près à l’endroit où la maison de ce nom existe encore aujourd’hui, couvrait pour eux, au point où nous prenons le siège, la bastille des Tournelles et son boulevard méridional du côté de la Sologne.
À l’ouest de ces deux bastilles, au bord de la rivière, et presque vis-à-vis Saint-Laurent, les Anglais avaient construit, dans les premiers jours de janvier, un boulevard appelé de Saint-Privé, pour avoir été élevé dans un champ dépendant de l’église de Saint-Privé située encore plus à l’ouest.
Un autre boulevard, placé dans une petite île, nommée de Charlemagne, qui a depuis disparu, concourait avec celui de Saint-Privé à assurer en cet endroit, pour les assiégeants, le passage du fleuve.
Enfin nous apprenons avec quelque incertitude, d’un auteur moderne, qu’un 73fort anglais s’élevait à l’endroit où est aujourd’hui la petite église de Notre-Dame de Recouvrance, qui a, dit-il, été bâtie sur ses débris. Il ajoute que les Anglais avaient donné à ce fort le nom de Windsor.
Pour aller à couvert de l’une à l’autre de leurs bastilles, les Anglais avaient creusé en plusieurs endroits des espèces de tranchées qui achevaient d’enfermer la ville.
Les généraux anglais avaient divisé leur armée en deux parties destinées à agir, l’une sur la rive droite, et l’autre sur la rive gauche du fleuve ; celles des troupes qui n’étaient pas placées dans les bastilles et les boulevards, bivouaquaient dans trois camps ou parcs, sous des baraques ou loges construites avec de jeunes troncs d’arbres, et couvertes en chaume. L’un de ces camps était établi près de la bastille des Augustins ; le second près de celle de Saint-Laurent, et le troisième près de la bastille de Paris.
Il paraît que ceux des généraux anglais qui commandaient au nord de la place, 74étaient Suffolk, Talbot, Pole et le seigneur de Scales ; que Suffolk avait en particulier sous son gouvernement la bastille de Saint-Laurent, le boulevard de la Croix-Boissée et le boulevard de l’île Charlemagne ; que Pole et Scales s’étaient partagé les bastilles de Londres et de Rouen, desquelles dépendaient les boulevards du Colombier et de la Croix-Morin, et que Talbot avait le commandement de la bastille de Paris. Un certain Thomas Guerrart était capitaine de la bastille de Saint-Loup. Glasdale, homme d’une naissance obscure, mais d’un mérite consommé et d’une valeur brillante, gouvernant toute la partie du siège au sud de la ville, commandait particulièrement dans le fort des Tournelles. Les sires de Moulins et de Pommus s’étaient partagé les Augustins et Saint-Jean-le-Blanc.
Le lendemain de son entrée dans Orléans, Jeanne d’Arc se rendit dès le matin chez Dunois, pour conférer avec lui et les autres généraux sur ce qu’il y avait à faire. Le conseil fut orageux. Jeanne voulait que, 75pour mettre à profit la confiance et l’ardeur que montraient les Orléanais, on attaquât sur-le-champ les assiégeants. La Hire et Florent d’Illiers, gouverneur de Châteaudun, l’appuyaient fortement ; mais d’autres insistaient pour qu’on attendit l’arrivée de l’armée. Jeanne ayant voulu user de l’autorité qui lui avait été remise par le roi pour bannir des opérations une timidité qui y avait déjà nui, et qui était surtout contraire à l’abandon total qu’elle voulait qu’on fît des événements à la Providence, fut particulièrement combattue par Jean de Gamaches, frère de Guillaume II, comte de Gamaches. Ce seigneur, qui paraît avoir poussé très loin la vanité, voyant que celle qu’il regardait avec mépris comme une simple paysanne, allait triompher de sa résistance, s’emporta au-delà de toute mesure, et l’injuriant avec indignité, ploya sa bannière et la remit à Dunois, disant que puisque son avis était dédaigné en une telle occasion, il renonçait à toutes les prérogatives qu’il tenait de son rang et de ses services, et ne se considérait plus que 76comme un pauvre écuyer, résolu qu’il était de se soumettre à tout, plutôt que d’obéir à une femme quelle qu’elle fût. Dunois et plusieurs autres officiers qui s’entremirent de cette querelle, dont les suites pouvaient en effet devenir funestes, obtinrent avec beaucoup de peine que Jeanne et Gamaches se baiseraient à la joue en signe de réconciliation. On décida du reste, pour satisfaire autant que possible les deux partis, qu’on attendrait le retour de l’armée avant de rien entreprendre ; mais que plusieurs des généraux iraient au-devant d’elle jusqu’à Blois, pour lui témoigner le désir ardent que l’on avait de la voir bientôt paraître.
Cette décision mécontenta Jeanne, qui vit qu’elle allait répondre de l’issue d’une entreprise dont on ne lui laissait pas la conduite et elle se retira tristement à son logement ; tandis que La Hire et Florent d’Illiers, moins maîtres d’eux-mêmes, sortirent de la ville à la tête d’un certain nombre de chevaliers et d’hommes d’armes, et prouvèrent dans une escarmouche 77où ils eurent pleinement l’avantage, qu’en votant pour l’attaque des bastilles anglaises comme l’héroïne de Domrémy, ils n’avaient conseillé qu’un fait d’armes, dont, humainement même, le succès n’était pas impossible.
Jeanne l’ayant appris, voulut essayer au moins si cet échec partiel n’aurait point avisé les Anglais. Elle envoya donc ses deux hérauts d’armes, Ambleville et Guyenne, à la bastille Saint-Laurent, porter à Talbot, au comte de Suffolk et au seigneur de Scales une lettre qui n’était, suivant toute apparence, qu’un duplicata de la sommation qu’elle leur avait adressée de Blois. Les généraux anglais ne montrèrent qu’un grand courroux de cette démarche : ils retinrent Guyenne et renvoyèrent Ambleville à Jeanne pour lui annoncer que celui de ses deux hérauts d’armes qui leur avait personnellement remis ses lettres, allait être impitoyablement brûlé.
— Que dit Talbot, demanda la jeune guerrière à Ambleville aussitôt qu’elle l’aperçut ?
Celui-ci lui répondit, que luy et tous les aultres 78angloys disaient d’elle tous les maux qu’ilz povoient, et que s’ilz la tenoient, ils la feroient ardoir (brûler).
— Or, t’en retourne, répliqua Jeanne, et ne fais aulcun doubte que tu rameneras ton compagnon. Et dis à Talbot que s’il arme, je m’armeray aussi et qu’il se trouve en place devant la ville, et s’il me peut prendre qu’il me fasse ardoir ; et si je le desconfis, qu’il fasse lever les sièges et s’en aille en son pays.
Cependant Ambleville, effrayé du sort de son camarade, différa de remplir cette seconde commission, qu’il jugeait encore plus périlleuse que la première, jusqu’au moment où Dunois, qui partait en ce moment pour Blois avec d’autres officiers, serait de retour à Orléans.
Pour Jeanne, elle ne montrait pas la moindre inquiétude au sujet de Guyenne : En mon Dieu, répondait-elle aux personnes qui paraissaient trembler pour lui, ilz ne luy feront point de mal.
Dans le compte que j’ai rendu un peu plus haut des positions des Anglais autour de la place, j’ai dit que les Orléanais, après 79avoir perdu les Tournelles, avaient élevé sur leur pont un boulevard en regard d’un autre dont les Anglais avaient couvert le fort du côté de la ville. Cette redoute, appelée le boulevard de la Belle-Croix, du nom d’un monument de la piété des Orléanais qui se voyait en ce lieu, était si près de la redoute anglaise, que l’on pouvait facilement s’entendre de l’une à l’autre. Jeanne d’Arc s’y rendit vers le soir, pour sommer elle-même, de vive voix, les Anglais qui occupaient ce poste. La curiosité les fit accourir en foule sur leurs fortifications. Comme dans la sommation elle leur commanda au nom de Dieu de se retirer dans leur pays, que sinon mal leur en adviendrait, et honte à tretous
; Glasdale et les siens lui répondirent par des injures grossières, la menaçant de nouveau de la faire brûler s’ils parvenaient à s’emparer d’elle. Jeanne répondit à Glasdale, qui attaquait son honneur par les plus sales imprécations, qu’il mentoit ; que maulgré eulx tous ilz partiroient bien bref ; mais il ne le verroit jà, lui ; et si seroient grant 80partie de sa gent tuez
. Elle s’éloigna ensuite avec indignation, et rentra précipitamment dans la ville.
Par cette menace de la faire brûler, il est facile de juger que si les Anglais ne considéraient pas Jeanne d’Arc comme un personnage favorisé par le ciel d’une protection particulière, ils la regardaient au moins comme une magicienne. Quelque opinion qu’ils eussent d’elle, il est certain qu’elle commençait à inspirer une véritable terreur, sinon aux chefs, du moins aux soldats. On ne tarda point à en avoir la preuve. Le lendemain, d’Aulon et les autres officiers qui devaient aller au-devant de l’armée, du côté de Blois, se disposant à partir, Jeanne monta à cheval, et alla avec quelques troupes, se placer en observation hors de la ville, pour protéger leur passage. Les Anglais n’osèrent y mettre aucun obstacle, quelque grand que fût leur nombre de ce côté. Ils se tinrent avec soin enfermés dans leurs retranchements. Avant de rentrer, Jeanne s’approcha même des fortifications élevées par eux à la Croix-Morin :
81— Retournez de par Dieu en Angleterre, cria-t-elle de fort près à ceux qui gardaient ces fortifications, ou je vous ferai courroucez.
Ils ne songèrent point à sortir pour venger cette espèce d’affront ; ils se contentèrent de lui répondre par un torrent d’injures, non moins propres que celles de la veille à exciter son mépris.
De retour dans la ville, on la pria de s’y promener pendant quelques instants, pour satisfaire au vœu des habitants, si empressés de la voir, que dans certains moments ils forçaient presque la porte de l’hôtel où elle était logée. Chacun se répandit alors dans les rues ; et la foule était si grande, qu’à peine y pouvait-on passer. Jeanne était accompagnée de plusieurs chevaliers et écuyers parmi lesquels elle se faisait encore remarquer par son adresse et sa grâce à manier son cheval. Ce n’était pas le seul avantage par lequel elle pût de prime abord plaire au peuple, qu’un extérieur agréable dispose toujours favorablement. À la juger d’après un tableau qui paraît authentique, la nature l’avait, sous tous 82les rapports, bien traitée. Elle était très forte, mais parfaitement faite, et avait les membres très bien proportionnés, le sein et le visage très beaux, le regard mélancolique et d’une douceur inexprimable, le teint uni et d’une extrême blancheur ; ses cheveux, d’un beau châtain, et en grande quantité, rejetés en arrière au-dessus de ses tempes, faisaient ressortir la blancheur de son cou, sur lequel ils retombaient avec grâce. La candeur, l’innocence virginale, une pureté angélique, quelque chose de rêveur qui n’était pas sans attraits, formaient le caractère général de sa physionomie. Ceux qui lui adressaient quelques questions n’entendaient sortir de sa bouche que des paroles pleines d’aménité et de consolation.
Les révélations dont elle se prétendait favorisée lui eussent, de notre temps, donné un ridicule qui eût apprêté à rire ; à cette époque elles l’environnaient au contraire d’un respect et d’un intérêt infinis. Les Anglais, pour la rendre odieuse et amortir ainsi le coup qu’elle pouvait leur 83porter, affectaient de la proscrire comme une sorcière qui devait à d’indignes pratiques la prescience qu’elle paraissait quelquefois posséder ; mais le peuple d’Orléans, séduit par la promesse qu’elle lui faisait de le soustraire au joug étranger, pour lequel il avait une juste horreur ; convaincu par les marques de piété qu’elle donnait sans cesse au milieu de lui, voyait réellement en elle une libératrice que le ciel lui envoyait. En cela il se sentait d’autant plus porté à la juger favorablement, qu’elle était de son sang ; c’est-à-dire née comme lui loin des grandeurs, ou, pour parler plus juste, dans l’humiliation et l’avilissement. En sa personne il trouvait à triompher de tous ses ennemis à la fois, et des étrangers qui voulaient lui ravir sa patrie, et des grands, ses compatriotes, qui jusque-là avaient semblé croire qu’il ne pouvait sortir de lui rien que d’ignoble et de bas.
On croyait d’ailleurs aux prophéties dans ces temps ainsi que nous l’avons déjà remarqué, et à Orléans, comme on avait fait à la cour, on en répétait mille qui 84s’appliquaient volontiers à la paysanne inspirée des marches de Lorraine, et la présentaient comme un être privilégié prédestiné à sauver la France. Les Orléanais, depuis qu’ils étaient assiégés, prétendaient même avoir reconnu à des événements extraordinaires du siège, que leur sort n’était point de succomber aux efforts de l’ennemi, pourvu qu’ils le méritassent par leur dévouement ; et ces événements leur paraissaient une preuve de plus en faveur de Jeanne d’Arc.
Le lendemain, lundi 2 mai, comme elle alla, suivie de quelques guerriers, reconnaître les forts et les camps des Anglais, il fut impossible de retenir le peuple, qui se précipita en foule à sa suite, sans armes et sans nulle précaution. Il n’en arriva cependant aucun malheur ; les assiégeants, comme la veille, se tinrent dans leurs retranchements, quelque facilité que leur offrit ce désordre pour en sortir avec avantage. De jour en jour ils paraissaient d’autant plus redouter leur nouvelle ennemie, que celle-ci semblait elle-même moins les craindre.
85Ce n’était pas sans raison que Jeanne d’Arc s’était opposée à ce que la petite armée qu’elle avait amenée si près d’Orléans retournât du côté de Blois, pour revenir ensuite, par un autre chemin, secourir avec plus de facilité la ville assiégée : à peine les troupes furent-elles rentrées à Blois, qu’au mépris de leur parole formelle, les généraux et autres personnages de marque délibérèrent si elles en ressortiraient. Le chancelier avait vu Jeanne d’un œil défavorable, et il était un des principaux opposants. Il ne fallut pas moins que l’arrivée inattendue et les sollicitations réitérées du chevalier Dunois, pour rappeler les généraux à leur devoir le plus sacré. Cependant ils montrèrent ensuite la meilleure volonté, et s’avancèrent à grands pas, résolus à tenter le secours du côté de la Beauce, comme le désirait Jeanne d’Arc en partant de Blois. Il était probable qu’il faudrait au moins livrer un combat terrible ; cependant il n’en fut rien : la présence de l’héroïne, sortie à dessein à la tête d’un détachement de la garnison, 86suffit pour contenir les Anglais. L’armée française, pour entrer dans Orléans, défila lentement entre les bastilles ennemies de Londres et de Saint-Laurent, traînant au milieu d’elle un convoi de vivres fournis par les habitants de Bourges, d’Angers, de Tours et de Blois, et ayant à sa tête les prêtres de l’expédition qui marchaient solennellement à la suite de leur bannière, en chantant des hymnes et des cantiques. Les assiégeants couvraient leurs fortifications d’une multitude innombrable ; ils n’osèrent néanmoins encore en sortir, quelque important qu’il eût été pour eux d’empêcher la garnison d’Orléans de recevoir un renfort aussi considérable que celui qui se présentait. Ils paraissaient immobiles de surprise et d’épouvante. Ce n’était plus effectivement des ennemis ordinaires qu’ils avaient à combattre ; on s’armait contre eux de la religion qu’eux-mêmes professaient. Au milieu des acclamations du peuple, Jeanne d’Arc prédit, en ce moment décisif, que dans cinq jours il ne resterait pas un Anglais devant les murs de la ville ; 87et elle prédit juste. On était alors au mercredi 4 mai.
Le comte de Suffolk, dit David Hume, l’historien anglais le plus estimé, se trouvait dans une situation fort extraordinaire, et de nature à confondre l’homme le plus habile et le plus courageux. Il voyait ses troupes effrayées, et fortement frappées de l’idée qu’une influence divine accompagnait la Pucelle. Au lieu d’appeler à son secours, pour bannir ces vaines terreurs, l’agitation et le mouvement de la guerre, il crut devoir attendre que ses soldats fussent revenus de leur premier effroi, et il donna par là à ces dangereuses préventions le temps de se graver plus profondément dans leurs esprits. Les préceptes militaires, bons à suivre dans les cas ordinaires, le trompèrent dans des circonstances qui sortaient des règles communes. Les Anglais sentirent leur courage dompté et abattu, et en inférèrent que la vengeance divine pesait sur eux. Les Français tirèrent la même conséquence d’une inaction si nouvelle et si inattendue. Tout changea à la 88fois dans l’opinion des hommes, véritable arbitre des événements ; et l’audace, résultat naturel d’une longue suite de succès, passa subitement des vainqueurs aux vaincus.
Mais le premier exploit militaire de Jeanne n’était pas loin ; il suivit de près un exemple de fermeté par lequel elle fit voir qu’en la destinant à paraître à la tête des armées, Dieu l’avait douée des qualités nécessaires pour s’y faire obéir.
Dans l’après-dîner, le bâtard d’Orléans (ainsi appelait-on alors le chevalier Dunois) lui ayant dit, entre autres choses, qu’il était instruit, qu’un capitaine ennemi, nommé Fastolf, devait bientôt venir renforcer et ravitailler les assiégeants ; Jeanne d’Arc crut que cette occasion, qui pouvait avoir de si grandes conséquences, était celle qu’il fallait choisir pour inspirer aux généraux la déférence et le respect qu’ils lui devaient :
— Bastard, Bastard, s’écria-t-elle, au nom de Dieu, je te commande, que tantost que tu sçauras la venue dudit Falstof, que tu le me faces sçavoir ; car, 89s’il passe sans que je le sache, je te prometz que je te feray oster la teste !
Menace qu’elle était à même d’exécuter, par l’autorité véritable que le roi lui avait donnée sur son armée, autorité que Dunois reconnut par la réponse soumise qu’il fit.
Après cet entretien, Jeanne d’Arc, accablée de fatigue, s’était couchée sur un lit avec la fille de son hôtesse, à quelque distance de d’Aulon, chef de sa maison, qui prenait aussi du repos dans la même chambre : elle éveilla soudain ce chevalier par le grand bruit qu’elle fit en se jetant précipitamment en bas du meuble sur lequel elle s’était placée.
— Au nom de Dieu, s’écriait-elle, mon conseil m’a dit que je voise (que j’aille) contre les Angloys ! mais je ne scay si je doys aller à leurs bastilles, ou contre Falstof qui les doibt advitailler.
Son aumônier et quelques autres prêtres qui venaient en ce moment la voir, l’entendirent encore s’écrier :
— Où sont ceux qui me doivent armer ? le sang de nos gens coule par terre ! En mon Dieu, c’est mal 90fait ajouta-t-elle. Pourquoi ne m’a t’on pas plus tôt éveillée ? Nos gens ont bien à besoigner devant une bastille, et y en a de blécez… Mes armes ! apportez moi mes armes et amenez moi mon cheval !
D’Aulon lui présentait son armure ; mais cherchant son page, elle descendit précipitamment l’escalier. Louis de Contes était en ce moment à causer tranquillement sur la porte de la maison avec l’hôtesse ; car tout était calme dans ce quartier de la ville, et rien n’annonçait qu’on se battît au-dehors.
— Ha ! sanglant garçon ! s’écria Jeanne à son page aussitôt qu’elle l’aperçut ; vous ne me dyriez pas que le sang de France feust répandu : et elle lui commanda d’aller seller son cheval, et de le lui amener aussitôt.
Elle n’avait pas achevé de donner cet ordre, qu’elle était de retour dans sa chambre, ou d’Aulon se hâta de la revêtir de ses armes. Effectivement, pendant qu’il s’occupait de ce soin, on entendit de grands cris ; c’étaient ceux des habitants qui déploraient la perte qu’essuyaient en cet instant leurs guerriers de 91la part de l’ennemi. D’Aulon n’eut pas plutôt fini d’armer Jeanne d’Arc, qu’il se mit à s’armer lui-même pour l’accompagner. Mais il n’en eut pas le temps : il n’avait pas ajusté sa cuirasse que la jeune inspirée était déjà dans la rue sautant à cheval, et ordonnant à Louis de Contes, de monter lui jeter par la fenêtre son étendard, qu’elle avait oublié dans sa chambre. Cela fait, elle piqua vivement son coursier, se dirigeant en toute hâte vers la porte de Bourgogne, où son page et d’Aulon purent seulement la rejoindre. La foule y abondait, car c’était de ce côté qu’on avait combattu. Quelques chefs étant allés, avec un assez grand nombre de soldats, attaquer inopinément la bastille de Saint-Laud, avaient été vigoureusement repoussés, et rentraient en ville dans la plus triste confusion. On rapportait aussi des blessés ; cette vue parut affliger beaucoup Jeanne d’Arc :
— Jamais, s’écria-t-elle, je n’ai veu sang de Françoys, que les cheveux ne me levassent en sur !
Elle pressa cependant son cheval, et continua à avancer pour porter secours 92aux vaincus. Ceux des Français qui se retiraient les derniers, poussèrent un grand cri à sa vue, et firent volte face, encouragés d’ailleurs par Dunois, qui arrivait à la tête d’un de corps de troupes plein de bonne volonté et marchant en bon ordre.
Arrivée devant les retranchements de la bastille, Jeanne d’Arc, par une de ces précautions heureuses qui assurent quelquefois la victoire en la présentant comme certaine, et qui devaient avoir un prix tout particulier chez elle, rendit le courage à tout le monde : pendant que les Anglais, fiers de l’inutilité d’un premier assaut, défiaient les Français d’en essayer un second, elle fit proclamer à son de trompe, qu’aucun homme d’armes des troupes de France ne fût si hardi que de rien enlever de l’église de Saint-Loup que les Anglais avaient renfermée dans l’enceinte de la forteresse. À ces mots, que l’on regarda comme une prédiction, gage de la victoire, chacun, sur son ordre, courut ou retourna à l’assaut avec autant d’ardeur 93que s’il n’avait pas encore été tenté. Cet assaut fut cependant long et meurtrier : il dura trois heures, pendant lesquelles Jeanne, qui se trouvait en un combat pour la première fois de sa vie, montra autant d’intrépidité que de présence d’esprit. Soldat à la fois et capitaine, on la vit commander et exécuter comme aurait pu le faire un guerrier habile, blanchi sous le harnois militaire. Les Anglais des bastilles voisines voulurent tenter une diversion en faveur de leurs camarades ; mais ils furent contenus par une nouvelle troupe sortie d’Orléans, sous les ordres du maréchal de Sainte-Sévère, du seigneur de Graville, et du baron de Coulonces, et par Jeanne d’Arc elle-même, qui avait l’œil à tout, et qui couvrait l’assaut en même temps qu’elle le dirigeait.
La victoire remportée, elle prit les vaincus sous sa protection, et ne fut plus pour eux qu’un ange tutélaire. Tout ce qu’elle put atteindre ou qui chercha un asile auprès d’elle, eut la vie sauve. Pour être plus certaine qu’il n’arriverait aucun mal 94aux prisonniers, elles les fit même conduire à sa demeure, sans permettre, pendant le trajet, qu’on les éloignât, un seul instant, de sa vue. Ainsi se comporta avec les Anglais, dans la première action où elles les combattit, l’héroïne qu’un peu plus tard, ils devaient, sous de vains prétextes, faire périr dans les tourments les plus horribles. En rentrant dans la ville, elle versa encore des larmes sur ceux de leurs morts qu’elle vit couchés sur le champ de bataille, demandant au ciel que, pour soutenir une mauvaise cause, les assiégeants ne la réduisissent plus à de telles extrémités : mais de nouvelles défaites pouvaient seules les faire renoncer à leur entreprise ; car il semble irrévocablement décidé qu’une fois armés, les hommes ne céderont qu’à la force des armes.
Jeanne avait déclaré que le lendemain, fête de l’Ascension, il ne se tenterait rien contre les Anglais. Les chefs de l’armée française employèrent une partie du jour à délibérer sur ce qu’ils feraient ensuite. Ils décidèrent entre eux, à l’insu de Jeanne, 95qu’on ferait une fausse attaque sur les bastilles du côté de la Beauce, et qu’aussitôt que la plus grande partie des Anglais qui étaient postés de l’autre côté de la rivière l’auraient traversée pour venir au secours de leurs compagnons d’armes, un corps de troupes françaises la passerait lui-même pour tâcher de s’emparer des forts que les assiégeants occupaient sur la rive gauche de la Loire, et établir au moins par la prise de quelqu’un d’eux la communication entre Orléans et la Sologne. Il fut de plus convenu qu’on ne communiquerait que la première partie du projet à Jeanne, sous le prétexte ridicule de la crainte d’une indiscrétion.
Le journal du siège dit qu’après que Jeanne d’Arc eut reçu la communication qu’on devait lui faire, elle répondit avec colère, comme si elle devinait qu’on lui cachait quelque chose :
— Dictes ce que vous avez conclu et appoincté : je célerois bien plus grant chose que cestecy.
Que Dunois, pour la calmer, lui découvrit tout le plan d’opération, en ayant l’air de la consulter ; 96et que Jeanne répondit alors : qu’elle était contente, et qu’il semblait que cette conclusion était bonne ; mais qu’elle fût ainsi exécutée : et que toutes fois d’icelle conclusion ne fut rien fait ny exécuté
: récit qui, dans son entier, donne à penser que la jalousie inspirée par Jeanne d’Arc était dès lors poussée à un tel point, que, pour la satisfaire, des personnages importants s’oubliaient jusqu’à compromettre le salut de l’État.
En sortant du conseil, Jeanne d’Arc, qui croyait toujours que la pureté de ses soldats était ce qui devait les rendre invincibles, commanda que, par l’accomplissement de leurs devoirs religieux, ceux qui voudraient combattre méritassent que le lendemain Dieu fit prospérer leurs armes.
Elle voulut ensuite tenter un dernier effort pour persuader les Anglais avant de leur porter ce nouveau coup. Elle sortit donc encore de la ville vers la fin de la journée, s’approcha des bastilles anglaises, et y fit lancer un triplicata de sa lettre de sommation attaché au bout d’une flèche : les 97chefs anglais, plus furieux que consternés de leur première défaite, répondirent à cette sommation par des moqueries et des injures. Jeanne avait fait ajouter au bas de sa lettre les paroles suivantes : C’est pour la troisième et dernière fois que je vous écris, et ne vous écrirai plus désormais. Jhesus Maria. Jehanne la Pucelle.
Et un peu plus bas : Je vous enverrais mes lettres plus honnêtement, mais vous retenés mes héraults ; car vous retenés mon hérault nommé Guienne. Renvoiés le moi, et je vous enverrai quelques uns de vos gens pris à la bastille de Saint Laud ; car tous ne sont pas morts.
Dunois voyant cependant que cette prière ne produisait pas l’effet convenable, fit signifier formellement aux Anglais qu’ils eussent à renvoyer le héraut qu’ils retenaient prisonnier contre le droit des gens, ou qu’il ferait mourir lui-même tous les Anglais qui étaient en son pouvoir, et notamment les hérauts que plusieurs seigneurs d’Angleterre avaient envoyés dans la place pour traiter de la rançon de leurs amis. Personne n’osait se charger 98de ce message, qui ne paraissait pas effectivement sans danger après ce qui était arrivé à Guyenne. Ambleville finit néanmoins par consentir à le faire, sur l’assurance prophétique que lui renouvela Jeanne d’Arc : que les Anglais ne lui feraient aucun mal, et qu’il ramènerait son compagnon sain et sauf
; ce qui arriva effectivement. Les assiégeants, en cédant ainsi aux circonstances, le chargèrent seulement, dans le langage grossier qu’ils avaient affecté jusque-là, de dire à celle qui l’avait envoyé : qu’ils la brûleraient ; qu’elle n’était qu’une ribaude, et comme telle, s’en retournât garder les vaches
. Il fallait prouver le lendemain, 6 mai, que Jeanne d’Arc n’était effectivement bonne qu’à cela, et ce n’est pas ce que firent les Anglais, à leur grand détriment.
La jeune guerrière sortit d’Orléans de très bonne heure. Elle était accompagnée de Dunois, des maréchaux de Rais et de Sainte-Sévère, de Graville, de La Hire, de Florent d’Illiers, de Gaucourt, de Villars, de plusieurs autres chevaliers, écuyers et 99capitaines, et suivie d’environ quatre-mille combattants. La fausse attaque qui devait avoir lieu de l’autre côté de la ville comme on en était convenu avec l’héroïne, ne se faisait cependant pas.
On était sorti par la porte de Bourgogne. On s’embarqua entre la Tour-Neuve et le port Saint-Loup, et l’on vint aborder à une petite île voisine du poste anglais de Saint-Jean-le-Blanc. On fit faire ensuite le tour de l’île à deux barques, afin qu’elles servissent de pont dans le canal qui la séparait de la terre ferme : c’était le moyen d’arriver tous ensemble et en bon ordre au rivage.
Glasdale, qui, comme nous l’avons déjà dit plus haut, commandait toutes les forces ennemies du côté de la Sologne, n’eût pas plutôt vu les Français traverser la Loire, qu’il fit évacuer le fort de Saint-Jean-le-Blanc à ses troupes, après y avoir mis le feu, et les concentra toutes dans la bastille des Augustins, dans le fort des Tournelles et dans ses boulevards. Le but de la diversion arrêté la veille pour l’autre côté de la rivière, aurait été d’affaiblir ces postes, afin d’en faciliter la prise ; 100leur force venait au contraire d’être ainsi augmentée. Les généraux français crurent donc ne pas devoir les attaquer. Ils n’estimaient pas non plus qu’on pût raisonnablement chercher à s’établir dans la bastille de Saint-Jean-le-Blanc, à cause de l’état où l’avait laissée Glasdale. Quel que fût le motif qui eût empêché la diversion de s’exécuter, ils décidèrent que, vu les circonstances, il fallait rentrer dans la ville. Jeanne regardant cette résolution, qui rendait la sortie inutile, comme une perfidie, ou tout au moins comme l’effet d’une timidité préjudiciable, s’y opposa vivement, et marcha droit avec l’infanterie à la bastille des Augustins, espérant entraîner le reste des guerriers dans son mouvement. Elle avait déjà planté son étendard sur le boulevard de cette bastille, lorsqu’une terreur panique, produite par une infâme trahison, mit le désordre parmi les soldats qu’elle conduisait : on entendit crier tout d’un coup, au milieu des troupes, que les Anglais de la rive droite passaient le fleuve et venaient en force du côté de Saint-Privé ; 101chacun fuit alors en désordre vers l’endroit où l’on avait débarqué.
Les Anglais, faisant un horrible massacre de ceux qui marchaient les derniers, vinrent bientôt insulter, du rivage, Jeanne d’Arc, que, dès les premiers moments de la déroute, on avait en quelque sorte forcée de se retirer dans l’île ; mais cette bravade leur coûta cher. La jeune guerrière ne pouvant repasser sur le pont flottant qui était alors encombré par les fuyards, s’élança, tirant son cheval par la bride, dans une barque qui se trouvait près d’elle, et ordonna impérieusement aux rameurs de la porter sur le rivage. La Hire, qui veillait sur tous ses mouvements parce qu’il espérait leur devoir sous peu le signal d’un nouveau combat, se jeta à sa suite dans la même barque, tirant également son coursier après lui. En un moment, ils furent l’un et l’autre arrivés, et à cheval.
— Au nom du Seigneur, s’écria la jeune amazone en chargeant aussitôt les vainqueurs, la lance couchée, courons hardiment aux Anglais !
La Hire l’ayant imitée avec empressement, 102l’ennemi fut si déconcerté de cette brusque attaque, à laquelle il n’avait aucun sujet de s’attendre, qu’il prit la fuite à son tour, poursuivi par les Français rappelés à eux-mêmes par ce trait d’intrépidité. La suite de ce nouveau mouvement, que les Anglais avaient provoqué par leurs railleries et leur jactance, fut la prise de la bastille même des Augustins.
Quelques heures s’étaient à peine écoulées, et, grâce à Jeanne d’Arc, assez mal secondée, comme on l’a vu, il ne restait déjà plus aux Anglais, sur la rive gauche de la Loire, que le fort des Tournelles et ses boulevards. Il semble qu’il eût été convenable que, profitant de l’ardeur des Français et de la terreur de leurs ennemis, on attaquât sur-le-champ ces positions fortifiées : on ne le voulut pas cependant, et il fut décidé que, laissant devant une troupe suffisante pour contenir la garnison, on remettrait l’expédition au lendemain. On eut beaucoup de peine à déterminer Jeanne d’Arc à rentrer dans la ville avec les généraux. Laisserons-nous là nos gens en péril !
103dit-elle longtemps à ceux qui l’y engageaient.
Quand elle fut rentrée dans Orléans, un chevalier vint lui annoncer, comme elle finissait de souper, que les généraux et les chefs de guerre de l’armée du roi ayant tenu conseil, avaient été unanimement d’avis, qu’étant si peu de monde en comparaison des forces anglaises, les victoires qu’on venait d’obtenir étaient une grande grâce de Dieu ; qu’en conséquence, la ville étant maintenant pleine de vivres, on se contenterait de la garder en attendant un nouveau secours du roi, et qu’on ne sortirait pas le lendemain pour achever de conquérir le fort des Tournelles
. Une partie des difficultés étant levée, qu’était donc devenu ce moyen de diversion si sagement conçu il y avait deux jours, et dont on n’avait fait aucun usage ?
— Vous avés été en votre conseil, répondit Jeanne d’Arc au chevalier, et j’ai été au mien ; mais croiés que le conseil de mon Seigneur tiendra et s’accomplira, et que celui des hommes périra.
Se tournant alors vers son aumônier :
104— Levés-vous demain, lui dit-elle, dès la pointe du jour, et de meilleure heure encore qu’aujourd’hui, et faites du mieux que vous pourrés. Tenés-vous surtout toujours auprès de moi, car j’aurai demain beaucoup à faire, et plus que je n’ai eu jusqu’à-présent : il sortira demain du sang de mon corps au-dessus du sein ; je serai blessée devant la bastille du bout du pont.
Doit-on penser, d’après ce discours, que l’aumônier de Jeanne d’Arc et les prêtres qu’il avait réunis à Blois sous une bannière consacrée, la suivaient dans les combats d’aussi près qu’ils le pouvaient ? C’est un point sur lequel je n’ose prononcer.
Le lendemain, l’héroïne sacrée ayant dès la pointe du jour rempli ses devoirs religieux, se revêtit de ses armes, sans s’inquiéter de la résolution des généraux, et se disposa à conduire une partie des troupes à l’attaque des Tournelles. On fit de vains efforts pour la retenir à son logement. On aime certains poissons à Orléans : le trésorier du duc d’Orléans, qui, à ce qu’il paraît, sentait le prix d’un bon repas, 105voulut l’arrêter par l’appât de quelque chose de semblable.
— Jehanne, lui dit-il, mangeons ceste alose avant que partiez.
— Gardés-la jusqu’à ce soir, répondit Jeanne d’Arc ; car je vous amenerai ce soir ung Godon6 qui en mangera sa part, et repasserai par-dessus le pont, après avoir pris les Tournelles : promesse que tout le monde jugea impossible, ou du moins bien difficile à accomplir.
Jeanne sauta alors sur son cheval, quoi qu’on pût lui dire, et se dirigea vers la porte de Bourgogne. Une grande partie des troupes restées à la garde d’Orléans accourut sur ses pas, pêle-mêle avec des habitants de la ville qui demandaient le combat à grands cris. Le conseil des généraux, voulant faire respecter sa décision, avait confié, dès la veille, le soin de garder cette porte au seigneur de Gaucourt, comme nous l’avons dit plus haut, grand-maître 106de la maison du roi, et renommé pour sa fermeté. Il se présenta fièrement à la tête de ses hommes d’armes, et déclara que personne ne passerait. Le peuple et les soldats qui précédaient Jeanne d’Arc lui répondirent par des cris d’indignation et des menaces. Jeanne d’Arc s’ouvrit un passage à travers la multitude, et imposant silence à tout le monde :
— Vous êtes un méchant homme, dit-elle à Gaucourt ; mais, veuillez ou non, les gens d’armes viendront, et obtiendront aujourd’hui comme ils ont déjà obtenu ; et elle commanda en même temps d’ouvrir la porte.
La foule, sans attendre les gens d’armes dont parlait Jeanne d’Arc, se mit en devoir de l’enfoncer. La garde du seigneur de Gaucourt murmurait et faisait mauvaise contenance ; il fallut céder : non content de se faire ouvrir la porte de Bourgogne, le peuple força encore une petite porte voisine d’une grosse tour (probablement la Tour-Neuve), et sortit de la ville comme un torrent, en invoquant Dieu et répondant de la victoire. Le soleil se levait en ce moment.
107La Loire fut, comme la veille, traversée sans obstacles. Quand la barque qui portait Jeanne d’Arc se trouva à portée du rivage, la guerrière sauta légèrement à terre ; et, usant de l’autorité légitime qu’elle avait sur l’armée, envoya chercher les chefs de guerre restés devant les Tournelles, pour tenir à son tour conseil avec eux. Grâce au délai qu’on avait mis à attaquer les Tournelles, et aux nouveaux préparatifs de défense qu’y avaient faits des Anglais pendant la nuit, ce fort semblait désormais imprenable. On rangea cependant en bataille les troupes et les habitants armés qui avaient suivi la Pucelle, on sonna la charge, et l’on attaqua : il n’était pas alors moins de dix heures.
On avait de part et d’autre une artillerie formidable : pendant qu’elle faisait des deux côtés un grand ravage, les chevaliers français, qui croyaient dès lors que leur plus beau privilège était de combattre à la tête des guerriers de leur nation, s’élançaient dans les fossés, essayaient de gravir les retranchements, et attaquaient corps à corps 108les guerriers ennemis, obligés de rejeter de temps en temps derrière eux les simples soldats et les bourgeois armés qui leur disputaient la victoire et la mort. Parmi les plus audacieux, quelque part qu’ils eussent pu prendre aux délibérations du conseil des généraux, brillaient dans ce moment Dunois, le maréchal de Rais, les sires de Graville, de Guitry, de Coaraze et de Villars ; messires Denis de Chailly, Florent d’Illiers, Thibaut de Termes, l’amiral Louis de Culant, Lebourg de Mascaran, La Hire, Poton, de Xaintrailles et Richard de Gontaud. De leur côté, Glasdale, Pommus, Moulins et le bailli de Mantes donnaient l’exemple aux guerriers anglais… La victoire semblait incertaine : on avait commencé à combattre à dix heures, et le soleil avait déjà fourni la moitié de sa course… Les assaillants se lassaient de tuer inutilement, et le découragement s’emparait d’eux… Jeanne d’Arc, qui, comme à la bastille de Saint-Laud, n’avait cessé depuis le commencement du combat de se montrer dans les endroits les plus périlleux, 109en répétant que chacun eût bon cœur et bonne espérance en Dieu ; que l’heure approchait où les Anglais seraient desconfits, et que toutes choses viendraient à bonne fin
, s’élance dans le fossé en criant à l’assaut ! saisit une échelle, l’appuie au boulevard, et y monte… Suivant ce qu’elle avait annoncé, une flèche vient la frapper au-dessus du sein, entre le cou et l’épaule… Elle tombe presque sans connaissance… Vingt guerriers anglais se précipitent à sa suite dans le fossé, se disputant l’honneur de la faire prisonnière… Il croient déjà la tenir, quelques coups terribles qu’elle leur porte avec son épée, lorsque le seigneur de Gamaches, le même qui avait parlé à l’héroïne avec tant de mépris le lendemain de son entrée dans Orléans, tombe au milieu d’eux comme la foudre, les massacre ou les écarte avec sa hache d’armes ; et, montrant son cheval à l’héroïne, en même temps qu’il lui présente la main :
— Acceptés ce don, lui dit-il, brave chevalière ; plus de rancueur (plus de rancune) : j’advoue mon tort quand j’ai mal, 110présumé de vous.
— J’aurais grand tort, répond Jeanne d’Arc, de garder rancueur, car oncques ne vis chevalier si bien appris.
Et elle veut monter à cheval, mais sa force n’y suffit pas, et elle retombe sur la terre. Il faut l’emporter pour lui donner des soins, quoique d’une voix défaillante elle demande à rester sur le champ de bataille. Dunois plusieurs autres officiers, son aumônier et son page s’empressent de la secourir. Des hommes d’armes, suivant la croyance superstitieuse du temps, veulent charmer sa blessure ; elle les repousse, en disant qu’elle aimerait mieux mourir que de faire quelque chose qu’elle saurait être un péché, ou contre la volonté de Dieu
. On la panse ; des larmes abondantes coulent de ses yeux et de ceux de tous les Français témoins de cette scène désespérante… On est prêt à fuir ; la vue de son étendard, qu’un homme d’armes tient debout devant le boulevard ennemi, arrête seule les assaillants… On parle de se retirer… Tout à coup elle se ranime en regardant le ciel, s’écrie : C’est de la gloire, et non du sang 111qui coule de ma blessure
; s’agenouille, se relève,saute à cheval comme si elle était soudainement guérie, et s’élance vers le boulevard, en criant de nouveau : À l’assaut !
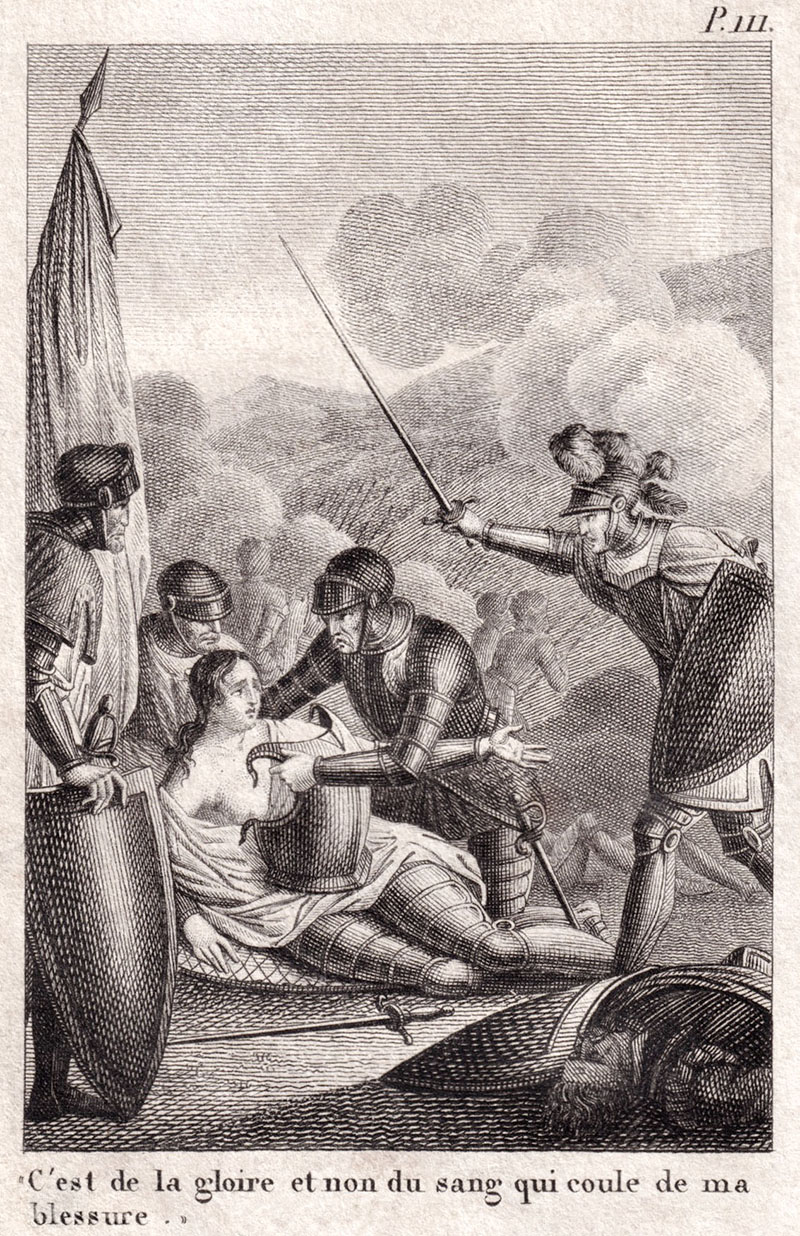
Les guerriers français se précipitent sur ses pas, en poussant des cris tumultueux. Arrivée près du boulevard, elle se jette en bas de son cheval, saisit son étendard, et essaie une seconde fois de gravir la redoute ennemie… Chacun se dispute la gloire de la suivre de plus près… Le combat recommence ; il est terrible… Les soldats anglais, sur la parole de leurs chefs, la croyaient morte ; c’est un fantôme qui se présente devant eux… C’est une divinité tutélaire que les Français ont à leur tête… La figure de Jeanne paraît effectivement animée, mais d’une expression divine ; le désir de la vengeance ni la colère, ne la décomposent : le sentiment de la victoire y règne seul. Les ennemis s’acharnent sur elle ; aucuns glaives ne peuvent l’atteindre : Dieu égare les uns, et les Français qui combattent autour d’elle, écartent les autres. Les coups mortels portés et parés 112forment au-dessus de sa tête une voûte mouvante de fer sous laquelle elle s’avance tranquillement… Un essaim de héros est entré avec elle dans la redoute. Jean de Gamaches, devenu son plus fidèle ami, la couvre de son épée ; Dunois, qui n’a qu’à demi confiance en sa mission, la garantit cependant avec soin, parce qu’il est chevalier et qu’elle est femme ; Florent d’Illiers, qui a toujours cru en elle, qui l’a même annoncée dans Orléans avant qu’elle vînt de Blois, rit dédaigneusement des efforts par lesquels l’ennemi cherche à l’accabler, laisse faire le ciel, et conserve à peine assez de sérieux pour se garantir lui-même. Quant à La Hire, dans cette incursion terrible, il n’a ni poste ni dessein fixe ; en avant de la guerrière inspirée, partout où un ennemi redoutable paraît, il y court. Il pourrait parfois le surprendre ; il lui donne le temps de se mettre en défense, l’attaque ensuite, et le perce de sa redoutable épée, en s’écriant, selon sa piété singulière : Grand Dieu ! fais pour La Hire ce que La Hire ferait pour toi s’il 113était Dieu et que tu fusses La Hire !
Jeanne renverse ce qui s’oppose à son passage, mais ne donne point la mort : son épée est pure de sang ; il semble que ce soit un pouvoir surnaturel séparé de sa personne, qui terrasse soudain les guerriers qui essaient d’arrêter ses pas. Tel Héliodore dut voir l’ange qui punit dans Jérusalem sa perfidie sacrilège, et le chassa ignominieusement du temple du Seigneur.
Cependant ce fantôme redoutable continue de gagner du terrain. Une partie des Anglais fuit devant lui sans combattre. En vain Glasdale cherche-t-il à rendre le courage à ses soldats saisis d’horreur. Pour leur prouver que Jeanne n’est pas invulnérable, il leur montre le sang qui de sa blessure a coulé sur sa cuirasse : les malheureux voient en même temps l’image auguste peinte sur l’étendard de l’inspirée, et cette image se confondant à leurs yeux troublés avec l’inspirée elle-même, il leur semble que c’est le sang du Sauveur du monde qui a coulé une seconde fois dans un combat impie, et ils fuient avec plus de précipitation 114encore… Glasdale et le reste de ses guerriers d’élite, après avoir fait inutilement des prodiges de valeur, reculent en rugissant… Ils n’ont déjà plus qu’un pied dans la redoute qui paraissait devoir être, devant le fort des Tournelles, un rempart inexpugnable.
— Glacidas ! Glacidas ! (Glasdale) crie au chef anglais l’héroïne française, rends-toi ! rends-toi ! Tu m’as cruellement injuriée ; mais j’ai pitié de ton âme et de celles des tiens !
L’Anglais sent qu’il est vaincu sans retour ; mais son orgueil humilié refuse toute composition : il va par le pont levis se retirer dans le fort des Tournelles même. Pour toute réponse, il montre fièrement ce fort à Jeanne d’Arc ; et son geste et ses regards désespérés, mais intrépides, semblent lui dire : Si nos frères d’armes de l’autre côté de la Loire ne viennent pas enfin à notre secours, c’est là que nous mourrons en soldats malheureux, mais dignes d’un meilleur sort !
Lui et les siens s’élancent en même temps sur le pont levis : ce pont, qui a été frappé d’une bombarde tirée de la ville pendant le combat, s’écroule 115sous eux, et les entraîne dans sa chute avec ses débris. En tombant, ils poussent un cri douloureux qui retentit jusqu’au fond du cœur de Jeanne. Hélas ! par cette retraite téméraire, c’était peut-être la mort aussi qu’ils cherchaient, mais la mort que donnent noblement les armes, et non celle qu’on trouve tristement au sein des flots. La sainte guerrière s’écrie aussi à ce moment, mais c’est pour ordonner qu’on vole à leur secours. Les flots les étouffent malgré les vains efforts que l’on fait pour les sauver. Par les soins de Jeanne d’Arc, le corps de sera du moins rendu à ses compatriotes, et l’héroïne assure une sépulture honorable à qui voulut entacher sa vie par d’infâmes injures.
Tandis ce que boulevard était ainsi conquis par Jeanne d’Arc et par les guerriers qu’elle conduisait, celui que les Anglais avaient opposé à la ville de l’autre côté du fort des Tournelles, sur le pont, subissait un même sort. La garnison et les habitants d’Orléans, comprimés peut-être, étaient restés immobiles pendant le premier assaut 116livré sur l’autre rive ; mais ils n’avaient pu tenir au second. Arrivés au boulevard de Belle-Croix, après être sortis tumultueusement de la ville par la porte du sud, ils y avaient trouvé à leurs desseins un obstacle jugé d’abord insurmontable (on doit se rappeler que plusieurs arches du pont avaient été rompues en cet endroit) ; mais que ne peuvent des Français pour s’ouvrir un chemin jusqu’à l’ennemi qu’ils brûlent de vaincre ! Les Orléanais et leurs défenseurs s’en furent bientôt fait un, du boulevard de Belle-Croix à celui qui couvrait sur ce point le fort des Tournelles, avec des solives et des planches amenées de la ville à force de bras. Les solives se trouvant trop courtes, à peine avaient-ils laissé à un ouvrier intrépide le temps d’en ajuster et d’en assurer deux ensemble. Ils s’étaient ensuite précipités dessus en foule, ayant à leur tête le seigneur de Giresme, commandeur de l’ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, guerrier déjà renommé pour ses faits d’armes dans la Palestine. En quelques minutes le boulevard anglais avait été conquis 117par eux ; et au même moment le fort des Tournelles se trouva, des deux côtés du pont, réduit à ses seules forces.
Dans cet état, ce poste ne pouvait résister longtemps ; on l’eut bientôt emporté. La plus grande partie de ceux qui le défendaient furent passés au fil de l’épée. Jeanne d’Arc parvint cependant encore à en sauver un petit nombre. On rapporte que de cinq-cents chevaliers et écuyers, réputés les plus preux et hardis du royaume d’Angleterre, qui étaient là sous les ordres de Glasdale, il n’en échappa, comme prisonniers, que deux-cents, et la perte des Anglais dans toute la journée a été évaluée, par leurs historiens mêmes, à sept ou huit-mille hommes, tant tués que pris.
Jeanne rentra dans la ville par le pont, comme elle l’avait annoncé le matin. Ce pont, quand elle le passa ainsi, était couvert d’une multitude ivre de joie et de reconnaissance qui jonchait son chemin de fleurs cueillies à la hâte dans tous les endroits où l’on avait pu en trouver ; chacun la comblait de bénédictions : les hommes 118la remerciaient de les avoir replacés dans le chemin de la victoire ; les vieillards lui faisaient hautement hommage de l’asile qu’elle leur avait conservé ; les jeunes filles chantaient des cantiques en dansant au-devant de celle qui venait de leur sauver l’honneur ; et les mères de famille, à genoux, élevaient leurs enfants vers la libératrice de leur patrie, comme pour les lui dévouer solennellement. Jeanne était partagée entre le soin d’empêcher ces transports de reconnaissance de dégénérer en une véritable idolâtrie, et celui de sauver une seconde fois les malheureux qu’elle avait dérobés à la fureur des vainqueurs : d’une main elle montrait le ciel aux Orléanais, pour leur rappeler que c’était là qu’ils devaient adresser leurs actions de grâces ; de l’autre elle leur donnait à entendre que les vaincus étaient sous sa protection, et qu’il fallait respecter leur malheur. Ceux-ci se pressant autour de son cheval, la contemplaient avec attendrissement et fierté : leurs regards semblaient dire qu’elle avait anobli leur défaite, et qu’ils ne craignaient 119rien, tant qu’elle ne les abandonnerait pas.
Bientôt le bruit des cloches, sonnant par son ordre, tandis qu’on chantait un Te Deum dans toutes les églises de la ville, eut fait connaître aux assiégeants de la rive droite de la Loire qu’il n’y avait plus de siège sur la rive gauche ; car, de ce côté là, personnes des leurs n’avait pu venir leur en donner la nouvelle officielle. Le triste gage qu’ils en eurent un peu plus tard fut la vue du corps inanimé de Glasdale, que des soldats français leur apportèrent de la part de Jeanne d’Arc, afin qu’ils pussent lui rendre les honneurs funéraires.
Leurs généraux, qui avaient craint ou jugé inutile d’essayer pendant cette journée terrible de faire passer la rivière à des renforts, employèrent la nuit à faire tous les préparatifs d’un décampement. L’investissement de la ville n’étant plus complet, la prolongation du siège d’un seul côté devenait en effet dangereuse. Le lendemain, dès la pointe du jour, les bastilles de la rive droite de la Loire furent évacuées, les tentes pliées, et les troupes formées en 120deux corps d’armée qui devaient se retirer sur deux points différents, commandés l’un par Talbot et Scales, l’autre par le comte de Suffolk.
On crut d’abord dans Orléans qu’il s’agissait d’une nouvelle attaque, et Jeanne d’Arc fit sortir les troupes françaises de la ville, et les rangea elle-même, offrant ainsi la bataille en plaine aux restes de l’armée anglaise, qui eux-mêmes formaient encore une armée considérable. Ce jour était le dimanche 8 mai 1429. Quand elle vit que les généraux ennemis ne voulaient que lever le siège, elle ordonna que, pour l’amour et honneur du dimanche, on les laissât aller tranquillement : car, dit-elle, c’est le plaisir et la volonté de Dieu ; s’ils veulent, partir, qu’on leur permette de s’en aller ; mais s’ils vous assaillent, ajouta t-elle, défendés-vous fort et hardiment.
Les Anglais se retirèrent, ceux qui étaient sous les ordres de Talbot, vers Meung et Beaugency, et les autres, qui avaient le comte de Suffolk à leur tête, vers la ville de Jargeau, tandis que, par ordre de l’héroïne, 121on célébrait au milieu de l’armée française le saint sacrifice de la messe.
Les assiégeants avaient laissé beaucoup de leurs munitions et de leur artillerie dans les bastilles en les abandonnant. Malgré la défense de Jeanne, les guerriers chargés de les suivre pour les observer dans leur retraite leur enlevèrent encore une grande partie de ce qu’ils traînaient à leur suite.
C’était le 4 mai que Jeanne d’Arc avait promis aux Orléanais que, dans cinq jours, il ne resterait pas un Anglais devant leurs murs.
122Livre III
- Jeanne d’Arc se rend auprès de Charles VII à Blois, et le sollicite vivement d’entreprendre le voyage de Reims.
- Difficulté qu’elle éprouve à le persuader.
- Expédition de Jargeau.
- Jeanne d’Arc est chargée de tous les préparatifs.
- Le roi se met en marche avec son armée.
- Détails de cette expédition.
- Services de différents genres qu’y rend Jeanne d’Arc.
- Capitulation de Troyes.
- Jeanne d’Arc voit plusieurs personnes de Domrémy à Châlons.
- Mot remarquable qu’elle leur adresse.
- Entrée du roi dans Reims.
- Son sacre et son couronnement.
- Quelle part y prend Jeanne d’Arc.
- Sa lettre au duc de Bourgogne.
Dès le lendemain de la levée du siège, Jeanne d’Arc quitta Orléans pour se rendre 123à Blois auprès de Charles VII. Elle croyait, comme je l’ai dit plus haut, que le second objet de sa mission était de conduire ce prince à Reims, à travers ses ennemis, afin qu’il y fût sacré, et elle saisit avec empressement l’occasion de ce devoir pour se dérober aux hommages de toute espèce que voulaient lui rendre les Orléanais.
Jeanne fut reçue à la cour avec de grands applaudissements, et le roi la combla de caresses et de marques de reconnaissance ; mais, dominé par un caractère indolent, il ne se montrait pas disposé à profiter de tout ce qu’elle venait de faire pour lui, en prenant, à la tête de son armée, la route de Reims. Cependant nul moment ne pouvait être plus favorables : les succès inouïs obtenus devant Orléans avaient ranimé le courage de ses sujets fidèles, et ils venaient de toutes parts lui offrir en foule leurs services ; il semblait qu’il ne fallût plus qu’un mouvement décisif de lui pour que la France entière se levât en sa faveur. Notre héroïne supportait ces retardements avec impatience. On prétend qu’elle était prise de l’idée 124qu’il lui restait peu de temps à vivre, et qu’on l’entendit, plus d’une fois, dire à Charles, en parlant de sa mission en général : Je ne durerai qu’un an, et guère au delà ; il faut tâcher de bien employer cette année.
Un jour qu’il s’était enfermé dans son cabinet avec l’évêque de Castres, Christophe de Harcourt, son confesseur, et le seigneur de Trèves qui avait été autrefois chancelier de France, elle vint frapper à la porte. Le roi ayant commandé qu’on la fit entrer, elle s’avança modestement, s’agenouilla devant lui ; et l’embrassant par les jambes :
— Noble daulphin, lui dit-elle, ne tenés plus tant et de si longs conseils mais venés au plus tost à Reims prendre votre digne couronne.
L’évêque lui demanda alors si c’était son conseil (ainsi appelait-elle elle-même les esprits célestes dont elle se croyait assistée) qui lui avait inspiré ce qu’elle venait de dire. Jeanne répondit que oui, et qu’elle était fréquemment incitée à cela.
— Ne voulez-vous pas, continua le prélat, nous dire ici, en présence 125du roi, la manière de votre conseil quand il vous parle ?
— Je conçois assez bien, répondit-elle, ce que vous voulés savoir, et je vous le dirai volontiers.
— Jeanne, dit alors Charles VII, vous plaist il bien de déclarer ce qu’il demande en présence des personnes qui sont ici ?
Jeanne répliqua que oui, et continua à peu près en ces termes :
— Quand il me déplaît en quelque manière de ce que je ne suis pas facilement crue des choses que je dis de la part de Dieu, je me retire à part, et je prie Dieu, me plaignant à lui, et lui demandant pourquoi on ne croit pas facilement ce que je dis ; et, ma prière faite, j’entends alors une voix qui me dit : Fille de Dieu, va, va, je serai à ton aide ; va ! Et quand j’entends cette voix, j’éprouve une grande joie, et voudrais toujours être en cet état.
Un grand nombre de ceux qui entouraient le roi voulaient qu’on profitât d’abord des circonstances pour essayer de conquérir la Normandie. On présentait cette conquête comme facile, les Normands ne demandant pas mieux que de secouer le 126joug des Anglais. C’était d’ailleurs, disait-on, un pays d’où l’on serait toujours maître de faire retraite ; au lieu que, pour aller à Reims, il fallait traverser la Bourgogne et une partie de la Champagne, deux provinces dévouées aux Anglais, s’isoler ainsi de tout secours, et se priver en cas de malheur de tout moyen de reculer avec sûreté. On ne pouvait néanmoins se décider à renoncer tout-à-fait au bénéfice des promesses de Jeanne d’Arc ; car on sentait tout l’avantage que l’on pouvait retirer du couronnement de Charles VII opposé à celui de Henri VI. On flottait dans une indécision cruelle entre les partis ordinaires et celui qu’une héroïne prétendue inspirée conseillait au nom du ciel. On eût voulu, ainsi qu’on a pu en juger par l’entretien que j’ai fait connaître plus haut, s’assurer, pour ne plus hésiter, de la réalité de cette mission, de laquelle tout dépendait. On avait bien déjà vu quelques événements qui en pouvaient paraître la preuve ; mais la chose en elle-même était si extraordinaire, qu’on n’osait se donner 127la consolation d’y croire aveuglément. C’est un grand malheur, en pareille circonstance, de n’avoir ni assez de philosophie pour s’en rapporter entièrement aux lumières de l’esprit humain, ni assez de religion pour s’en remettre absolument à Dieu. On décida que, pour nouvelle épreuve, on tenterait de chasser les Anglais des places qu’ils occupaient encore sur la Loire, au-dessus et au-dessous d’Orléans, le roi devant en personne marcher à cette expédition, et mandant de toutes parts tous ses nobles pour l’y suivre
.
Cependant Jeanne était devenue un véritable objet d’adoration pour le peuple. On baisait ses pieds, ses mains et ses vêtements quand on pouvait y atteindre. Son cheval même n’était pas à l’abri de telles superstitions. Jeanne souffrait beaucoup de ces marques excessives de confiance et de respect, qu’elle regardait comme de véritables impiétés ; mais sa douceur naturelle lui laissait peu de moyens de s’en garantir. Maître Pierre de Versailles lui disant un jour, à Loches, qu’elle faisait mal de 128souffrir de tels honneurs qui ne lui appartenaient pas, et qu’il fallait qu’elle s’en gardât, parce que ces choses rendaient les hommes idolâtres
.
— En vérité, lui répondit-elle avec sa candeur accoutumée, en vérité, je ne saurais m’en garder, à moins que Dieu ne veuille bien m’en garder lui-même.
Le roi voulait donner le commandement de la nouvelle expédition à Jean II, duc d’Alençon, avec le titre de son lieutenant-général. Le duc lui-même ambitionnait cet honneur ; et, récemment racheté des Anglais, pour avoir droit d’y prétendre, il venait d’acquitter entièrement sa rançon. Mais la duchesse, son épouse, Marie d’Armagnac, craignait pour lui de nouveaux dangers qui pouvaient lui être encore plus funestes que ceux qu’il avait déjà courus, et elle s’opposait de toutes ses forces à son départ. Jeanne d’Arc put seule la gagner, et ce fut en prenant ce ton prophétique qui acquérait de plus en plus du crédit chez elle :
— Ne craignez rien, madame, dit-elle à la duchesse en lui parlant de son mari, je 129vous le ramenerai sain et sauf, et aussi bien portant, voire même en meilleur état qu’il n’est maintenant.
Quant au duc, en entrant en campagne, il reçut du roi l’ordre de prendre en tout conseil de Jeanne.
On se dirigea d’abord vers Jargeau ville fortifiée, située à environ 4 lieues S. E. d’Orléans, et que les Anglais occupaient alors. Revue faite, l’armée française se trouva composée de trois-mille-six-cents combattants environ. La garnison anglaise de Jargeau était nombreuse, et commandée par Guillaume Pole, comte de Suffolk, l’un de meilleurs généraux de l’Angleterre. On tint conseil de guerre parmi les Français plusieurs voulaient que, pour attaquer, on attendit des renforts. Jeanne d’Arc prit la parole, et ce fut, suivant son usage, pour conseiller de braver les obstacles qui paraissaient se présenter.
— Ne craignés, dit-elle, aucune multitude, et ne faites point difficulté de donner assaut à ces Anglais ; car Dieu conduit votre œuvre. Croyés, ajouta-t-elle pour déterminer ceux qui l’entendaient, que, si je n’étais pas 130sûre que Dieu même conduit ce grand ouvrage, je préférerais garder les brebis à m’exposer à tant de contradictions et de périls.
On se remit en marche, suivant la route d’Orléans. Là on fut joint par quelques renforts, qui portèrent l’armée à quatre ou cinq-mille hommes. On partit le lendemain d’Orléans, et l’on tourna vers Jargeau par le Val de Loire. Au nombre des chefs des troupes se faisaient remarquer, après le duc d’Alençon et le chevalier Dunois, le maréchal de Sainte-Sévère, l’amiral de Culant, le seigneur de Graville, grand-maître des arbalétriers, Ambroise de Loré, Gautier de Brussac, Florent d’Illiers, La Hire, Jamet de Tillay, et Tugdual de Kermoysan, guerrier breton, très renommé. Jeanne d’Arc avait avec elle deux de ses frères, Pierre et Jean d’Arc. Le premier ne l’avait pas quittée depuis sa présentation au seigneur de Baudricourt, à Vaucouleurs ; le second venait seulement d’arriver auprès d’elle. L’armée française traînait à sa suite une artillerie assez considérable.
131On avait espéré surprendre les faubourgs de Jargeau ; mais on rencontra en chemin le comte de Suffolk, qui venait lui-même au-devant des Français, à la tête d’une partie de sa garnison. L’armée française, déconcertée par cette rencontre et l’attaque brusque qui la suivit, se vit sur le point d’être entièrement mise en déroute. Les soldats quittaient déjà leurs rangs et commençaient à fuir, lorsque Jeanne d’Arc, arrachant son étendard à celui qui le portait, se jeta au milieu d’eux, en leur rappelant leurs victoires récentes devant Orléans, et leur commandant au nom du ciel, de poursuivre d’aussi glorieux succès. À son aspect, à sa voix, chacun reprit courage et courut à l’ennemi. Chargés à leur tour avec impétuosité, les Anglais ne tardèrent pas à prendre eux-mêmes la fuite. Ils rentrèrent en désordre dans la ville, abandonnant ses faubourgs à l’armée française.
Le lendemain, dès la pointe du jour, la ville était battue par les bombardes et autres machines de guerre particulièrement 132soumises à Jeanne d’Arc, qui, disent les historiens du temps, avait un talent extraordinaire pour disposer l’artillerie. Grâce à ses soins, tout allait bien et promettait une prompte réussite, lorsqu’une alarme, comme celle qui avait failli faire échouer l’héroïne à Orléans devant la bastille des Augustins, vint encore en ce lieu retarder sa victoire : tout d’un coup le bruit se répandit dans l’armée, que Fastolf et quelques autres capitaines anglais arrivaient de Paris, avec des vivres, de l’artillerie et deux mille combattants. Cette fausse nouvelle sema l’inquiétude parmi les troupes, et ralentit leur ardeur ; plusieurs chefs parlèrent même de se retirer. Jeanne d’Arc parvint cependant à remettre les esprits, et à obtenir que l’on continuât le siège mais le premier moment était passé pour les assiégeants comme pour les assiégés ; les uns ne s’abandonnaient plus autant à l’attaque, et les autres y étaient mieux préparés. Les Anglais tinrent bon pendant trois jours ; et à ce terme encore, quoiqu’ils eussent fait plusieurs sorties 133inutiles, et vu la plus grande et la plus forte tour de la place s’écrouler sous le feu d’une bombarde française ; ils demandèrent seulement une suspension d’armes de quinze jours, au bout desquels ils s’engageaient à rendre Jargeau, s’ils n’étaient pas secourus.
Une telle proposition n’était point acceptable ; on y répondit par l’offre de laisser les Anglais se retirer avec leurs chevaux, s’ils voulaient abandonner sur-le-champ la ville. Tel fut le conseil de Jeanne d’Arc : Que les Angloys, dit-elle, aient la vie sauve, et partent, s’ils veulent, en leurs robes et gippons ; autrement ils seront pris d’assaut.
Effectivement cette offre ayant été refusée, on disposa tout pour emporter la place ce jour-là même, qui était le 14 juin. Bientôt les trompettes sonnèrent :
— Avant, gentil duc, à l’assaut ! cria Jeanne d’Arc au duc d’Alençon, en se coiffant de son casque ; et sur ce que ce prince se plaignait qu’on brusquait trop les choses : N’ayez doubte, continua-t-elle ; l’heure est prête quand il plais 134à Dieu. Il est temps d’agir quand Dieu veut qu’on agisse, et quand il agit lui-même.
Et voyant qu’il hésitait :
— Ah ! gentil duc, as tu peur ? lui dit l’héroïne ; ne sais tu pas que j’ai promis à ton épouse, de te ramener sain et sauf !
Lui donnant l’exemple, elle courut se joindre aux guerriers qui marchaient déjà vers la place. On déploya dans la défense autant de vigueur que dans l’attaque. En un moment, les fossés furent comblés d’échelles brisées, de débris de murailles, d’armures et de cadavres, et les remparts de morts et de mourants. Cependant l’assaut continue. Le comte de Suffolk, effrayé, demande à parler au duc d’Alençon ; on ne l’écoute pas. Les Anglais animés par le désespoir, redoublent d’efforts pour repousser les assaillants. L’assaut dure depuis quatre heures : s’il se prolonge encore, la fatigue fera tomber les armes des mains des Français ; il est temps de frapper un coup décisif ! Jeanne d’Arc, comme à Orléans, se précipite dans le fossé, son étendard à la main, court à l’endroit où les Anglais paraissent les plus 135forts, y plante une échelle, et monte elle même. Les Anglais font pleuvoir sur elle une grêle de traits et de pierres. Une de ces pierres l’atteint à la tête : la guerrière tombe agenouillée au pied du rempart ; les assiégés poussent un cri de victoire, et les assiégeants un cri d’épouvante. Mais Jeanne d’Arc se relève soudain, et reparaît bien tôt au haut de son échelle, en s’écriant :
— Amys ! amys ! sus ! sus ! ayez bon courage ! notre sire a condamné les Angloys ! à cette heure ils sont tous nostres !
Ce retour et ces mots, après une chute si terrible qu’elle semblait devoir être mortelle, encouragent les Français et glacent leurs ennemis. En quelques instants les premiers sont dans la place, poursuivant les Anglais de rue en rue, de place en place, de maison en maison. Tous les chefs furent tués ou pris. On ne put, en général, sauver qu’un très petit nombre des vaincus : le désordre d’une telle victoire laissa peu de place à la générosité et à la clémence. Ce fut Jeanne d’Arc et le duc d’Alençon qui sauvèrent le comte de Suffolk, en le 136faisant embarquer, avec son frère et plusieurs autres seigneurs anglais, dans une barque, qui les conduisit sans danger à Orléans. Eux-mêmes reprirent le soir-même le chemin de cette ville, où ils entrèrent pendant la nuit au bruit des acclamations de tout le peuple accouru sur leur passage.
Quel effet dut produire sur les Anglais ce nouvel exploit de la guerrière inspirée ! Qu’on juge en général de l’opinion qu’ils avaient d’elle à cette époque, par le fragment suivant d’une lettre du duc de Bedford au gouvernement d’Angleterre :
Et toute chose, y dit-il, prospérait ici pour nous jusqu’au temps du siège d’Orléans, entrepris, Dieu sait par l’avis de qui.
Auquel temps est tombé de la main de Dieu comme il semble, un grand coup sur vos gens, qui étaient assemblés là en grand nombre, causé en grande partie, comme je crois, par l’effet de la funeste croyance et vaine crainte qu’ils avaient d’un disciple et limier de l’ennemi 137des hommes, appelé la Pucelle, qui usait de faux enchantements et sorcellerie.
Lesquels coup et déconfiture non seulement diminuèrent beaucoup le nombre de vos gens ici, mais encore abattirent merveilleusement le courage du reste, et enhardirent votre adverse partie et vos ennemis à s’assembler aussitôt en grand nombre.
Il eût été à souhaiter que les événements inspirassent autant de confiance et de hardiesse au Roi de France, qu’ils imprimaient de terreur au gouvernement Anglais. Charles VII n’en témoigna cependant rien, et ne parut pas à la tête des troupes. Il s’en rapprocha seulement, en venant se loger à Sully, petite ville située près de Jargeau, tandis que l’armée victorieuse filait vers Beaugency, où elle savait avoir d’autres ennemis à combattre. Elle s’élevait alors à six ou sept-mille hommes.
Beaugency fut enlevé en un coup de main. Un secours considérable, qui, cette fois, arrivait effectivement, ayant pour un de ses chefs principaux le capitaine Fastolf, 138n’eut pas le temps de parvenir jusqu’à la place ; mais ce secours, qui, pour le temps, composait à lui seul, une véritable armée, donna ensuite lieu à une bataille célèbre sous le nom de Patay. Le connétable de Richemont, alors en disgrâce, avait depuis deux jours, joint l’armée française avec un petit corps de troupes levé à ses propres frais. Beau connétable, lui cria Jeanne d’Arc en apprenant l’approche des Anglais, vous n’êtes pas venu de par moi : mais puisque vous êtes venu vous serez le bien venu.
Il paraît que ce seigneur, qui, quels que fussent ses torts, demandait qu’on lui laissât saisir une occasion de les réparer, s’était mis la veille, sous sa protection, et que tout ce qu’il avait pu obtenir jusque-là avait été qu’on le laissât prendre part au siège de Beaugency, ayant cependant ses troupes séparées de celles du roi.
Les Anglais étaient environ au nombre de quatre-mille ; ils avaient pour chefs, outre Fastolf, Talbot et Scales. Le duc d’Alençon demanda à Jeanne d’Arc ce 139qu’il y avait à faire dans cette circonstance :
— Avés vous tous de bons éperons ? répondit Jeanne d’une voix haute.
— Que dites-vous ? s’écrièrent les témoins de cette conversation ; nous devons donc tourner le dos à l’ennemi ?
— Non, répondit l’inspirée, ce seront les Anglais qui ne se défendront point, et seront vaincus, et des éperons vous seront nécessaires pour courir après eux.
Elle ajouta que ce triomphe ne coûterait presque pas de sang à l’armée du roi, qu’il n’y aurait que très peu de monde de tué du côté des Français. On vint lui dire, quelques moments plus tard, que les Anglais semblaient disposés à combattre, et s’avançaient en bon ordre :
— Frappez hardiment sur eux, s’écria-t-elle alors ; ils ne demeureront pas longtemps sans prendre la fuite.
On se prépara effectivement à les attaquer aussitôt qu’ils paraîtraient, mais on sut bientôt qu’instruits que la ville était prise, ils se retiraient en toute hâte : on se mit à leur poursuite.
On craignait cependant de combattre 140les Anglais en rase campagne. Ils y avaient été victorieux à Azincourt, à Crevant, à Verneuil, à Rouvray-Saint-Denis ; et ces souvenirs encore récents semblaient en faire hésiter plusieurs.
— Chevaulchez hardiment, criait Jeanne d’Arc aux Français pour les faire revenir de cette indigne terreur ; chevaulchez hardiment, on aura bon conduict… En mon Dieu, il les faut combattre, ajouta-t-elle un moment après répondant à quelques uns, qui disaient que plutôt que de réduire les Anglais à un désespoir aussi dangereux que celui qui les avait rendus victorieux à la bataille d’Azincourt, il fallait les laisser se retirer ; il les faut combattre. S’ilz estoient pendus aux nues nous les arons ; car Dieu nous a envoyés pour les punir. Le gentil roy ara aujourd’huy la plus grant victoire qu’il eut pieça ; et m’a dit mon conseil qu’ilz sont tous nostres.
Effectivement l’armée ayant atteint les ennemis auprès du village de Patay, les défit si complètement qu’il n’en échappa presque aucun. Tous les généraux Anglais, 141à l’exception de Fastolf furent faits prisonniers. On amena Talbot devant la Pucelle, le connétable et le duc d’Alençon. Le duc ne put s’empêcher de dire à ce guerrier célèbre :
— Eh bien, sire de Talbot, vous ne vous attendiez pas ce matin qu’il vous en arriverait ainsi !
— C’est la fortune de la guerre, répondit froidement le chevalier anglais.
Il fut conduit à Beaugency, où il s’était promis d’entrer avec une toute autre gloire que celle seulement d’avoir combattu en héros pour retarder la défaite des siens.
Comme l’avait annoncé Jeanne d’Arc, peu de Français périrent dans la bataille. Cette héroïne donna l’exemple à tous : on la vit charger elle-même l’ennemi, et renverser ses guerriers les plus vaillants.
Après la victoire, elle fut, suivant sa coutume, la protectrice des vaincus. Un Français qui conduisait plusieurs prisonniers, en ayant frappé un à la tête avec tant de rudesse qu’il tomba expirant à ses pieds, l’héroïne, témoin de cette action indigne, se jeta en bas de son cheval, 142arracha l’Anglais à son féroce vainqueur, et lui prodigua les secours les plus touchants.
L’armée victorieuse après avoir conquis facilement les petites places de la Beauce que tenaient encore les Anglais, rentra dans Orléans. C’était là que se faisaient les préparatifs nécessaires au voyage de Reims. Jeanne voulait que le roi lui-même vînt les activer par sa présence ; mais elle ne put l’obtenir ; il s’avança seulement jusqu’à Châteauneuf-sur-Loire. Plusieurs historiens ont attribué cette conduite singulière de Charles VII, au soin qu’il prenait d’éviter la rencontre du connétable, pour ne pas être obligé de lui pardonner. Effectivement ce seigneur, que haïssait personnellement le ministre et favori du prince, La Trémoille, reçut bientôt l’ordre formel de quitter l’armée, quelques représentations que pussent faire à ce sujet, et Jeanne d’Arc elle-même, et les autres généraux.
C’était sur la libératrice d’Orléans que roulaient tous les préparatifs de la grande 143expédition dont elle était l’âme. À mesure qu’il se présentait de nouvelles troupes, elle les passait en revue, et les faisait partir pour Gien, qui était le rendez-vous général de l’armée. On la voyait sans cesse partagée entre ce soin, et celui d’aller entretenir Charles VII, dans l’idée du voyage qui devait, dans sa personne, opposer aux Anglais un véritable roi de France. Ce prince semblait toujours prêt à retomber dans ses irrésolutions, et, pour cette raison, Jeanne se tenait le moins possible éloignée de lui. Animé de temps en temps par l’exemple de la jeune guerrière, Charles sortait pour un moment de son inertie. Il vint un jour avec elle jusqu’à Saint-Benoît-sur-Loire, bourg situé alors sur la Loire, à une lieue au nord-ouest de Sully, pour voir passer des troupes et de l’artillerie qui se rendaient d’Orléans à Gien. Témoin des peines que Jeanne se donnait, il en conçut des inquiétudes pour sa santé, et lui témoigna le désir qu’elle se ménageât davantage. Jeanne, effrayée de le voir occupé de pareilles remarques dans une 144aussi grande circonstance, lui répondit en pleurant : qu’il n’eût aucun doute ; qu’il obtiendrait tout son royaume, et qu’il serait bientôt couronné
. Les inquiétudes que manifestait dans ce moment Charles VII annonçaient d’ailleurs qu’il avait peu de confiance dans la réalité de la mission de l’héroïne ; et, avec cette incertitude, quels obstacles ne devait pas craindre celle ci de son caractère irrésolu !
Quand tous les préparatifs furent faits, on mit effectivement en délibération si, avant d’entreprendre ce voyage, que l’on regardait encore comme infiniment aventureux, il ne serait pas convenable de soumettre d’abord Cône et La Charité, afin de nettoyer entièrement les pays de Berry, d’Orléans et du fleuve de Loire
; et Jeanne d’Arc eut beaucoup de peine à obtenir qu’on remettrait à attaquer ces places après le retour du roi. Elle ne cessait cependant de lui répéter, ainsi qu’aux guerriers qui devaient commander les troupes qu’ils allassent hardiment, et que toutes choses leur prospéreraient
. 145Ne craignez rien, leur disait-elle, car vous ne trouverez personne qui puisse vous nuire, ni presque aucune résistance.
Chez ceux qui n’avaient pas une pleine foi dans la jeune inspirée, l’hésitation pouvait sembler très raisonnable. Reims lui-même, but du voyage, et toutes les villes et forteresses de la Brie, du Gâtinais, de la Champagne, de l’Auxerrois et de la Bourgogne étaient au pouvoir des Anglais.
L’exécution d’un projet si hardi, écrit Villaret dans son Histoire de France, exigeait qu’on traversât près de quatre-vingt lieues de pays, avec une armée peu nombreuse, sans fonds pour la paye des troupes, sans vivres, sans espoir de s’en procurer que les armes à la main ; on devait nécessairement rencontrer sur la route plusieurs villes considérables, dont une seule suffisait pour arrêter la marche du roi pendant le reste de la campagne : nulle ressource en cas d’accident ; le moindre revers devenait irrémédiable. Pour affronter tant d’obstacles, on n’avait d’autre assurance 146qu’une prospérité constante jusqu’alors, mais qui pouvait se démentir, et les promesses d’une villageoise de dix-sept ans. C’était sur la parole de cette fille singulière qu’on formait une entreprise contraire à toutes les règles de la prudence humaine. On peut affirmer qu’en ce moment Jeanne d’Arc décida de la fortune de Charles ; il était perdu sans ressources s’il eût échoué. C’est ainsi qu’une providence incompréhensible se plaît quelquefois à manifester le néant de nos spéculations politiques, par la simplicité des moyens qu’elle emploie pour les renverser.
Ce fut le 28 juin 1429 que Jeanne partit de Gien, toujours accompagnée de ses deux frères. Le roi la suivit le lendemain.
Le duc d’Alençon, le comte de Clermont, fils du duc de Bourbon, le comte de Vendôme, le chevalier Dunois, le comte de Boulogne, Regnault de Chartres, archevêque de Reims, chancelier de France, le seigneur de Trèves, ancien chancelier, 147les maréchaux de Rais et de Sainte-Sévère, l’amiral de Culant, le sire de Laval, les seigneurs de Lohéac, de Thouars, de Sully, de Chaumont-sur-Loire, de Prie, de Chauvigny et de La Trémoille ; messires Jamet de Tillay, La Hire, Poton de Xaintrailles, Thibaut d’Armagnac, dit de Termes, le seigneur d’Albret et Jean d’Aulon, étaient les principaux de ceux qui accompagnaient Charles VII.
Les maréchaux de Rais et de Sainte-Sévère commandaient l’avant-garde, ayant sous leurs ordres, entre autres vaillants capitaines, La Hire et Poton de Xaintrailles.
L’armée montait à environ douze-mille combattants, tous gens de cœur et d’élite.
La première ville qui arrêta l’armée, fut Auxerre. Cette ville était alors très forte, et pouvait opposer une longue résistance. On accepta la proposition que firent les Auxerrois, de rester neutres pour le moment, à la condition singulière, cependant, 148 qu’on y ajouta, que par la suite ils feraient au roi telle obeyssance que feraient ceux des villes de Troyes, Chaslons et Reims
.
Les Auxerrois ne voulaient se déclarer entièrement pour leur souverain légitime, que lorsqu’ils seraient sûrs de pouvoir le faire avec sûreté.
L’armée allait toujours croissant : partout où paraissait Jeanne d’Arc, le peuple prenait spontanément les armes.
D’Auxerre on marcha sur Saint-Florentin, qui se soumit sans résistance ; mais on crut un moment qu’on serait obligé d’en venir aux armes pour se faire ouvrir les portes de Troyes.
En arrivant devant cette ville, où, huit ans auparavant, on avait, par le traité infâme que nous avons rapporté au commencement de cette histoire, conjuré la ruine de Charles VII, ce prince envoya ses hérauts d’armes, sommer les habitants de le reconnaître ; ce qu’ils refusèrent. Ils firent même une sortie sur l’avant-garde française, au moment où elle se présenta.
149L’armée prit position autour de la ville. Il paraît que, manquant d’artillerie pour l’attaquer, on se contenta d’en former le blocus. On ignorait encore à cette époque l’art d’approvisionner les armées : bientôt le camp du roi se trouva dans la disette la plus affreuse. Le peu de vivres qui y arrivaient se vendant au poids de l’or, il n’y eut en quelques jours que les seigneurs et les capitaines qui y pussent atteindre. Cinq à six-mille hommes des troupes restèrent plus de huit jours sans manger de pain. Il fallut vivre d’épis encore verts, que l’on froissait entre ses mains, et de fèves nouvelles dont on découvrit de vastes plantations à quelque distance de la place.
Le roi assembla les princes de sa maison, les ministres et les principaux officiers de l’armée, pour prendre leur avis sur ce qu’il y avait à faire en cette extrémité. Dans une longue délibération, beaucoup opinèrent, sans aucun ménagement, pour qu’on abandonnât entièrement le projet qui avait amené en Champagne : quelques-uns cependant, 150sentant les conséquences d’une telle retraite, voulaient qu’on essayât de gagner Reims, en laissant Troyes sur ses derrières comme on avait déjà fait d’Auxerre.
Quand ce fut venu au tour de Jean ou Robert le Maçon, ou le Masson, seigneur de Trèves et ancien chancelier, d’émettre son opinion ; ce vieillard, que toute l’armée considérait, à cause de ses longs services et de la marque de dévouement qu’il donnait alors, dit avec raison : qu’il pensait qu’on devait parler expressément à la Pucelle, par le conseil de laquelle avait été entrepris le voyage, et que probablement elle fournirait quelque moyen de sortir d’embarras
.
— Quant le roy est party, ajouta-t-il, et qu’il a entreprins ce véage, il ne l’a pas faict pour la grant puissance de gens d’armes qu’il eust lors, ne pour le grant argent de quoy il fust garny pour payer son ost (son camp), ne parce que le dit véage luy fust et semblast estre bien possible ; mais a seulement entreprins le dit véage par l’admonstrement de 151la dicte Jehanne, laquelle luy disoit tous jours qu’il tirast avant, pour aller à son couronnement à Reims, et qu’il y trouveroit bien peu de résistance, car c’estoit le plaisir et volonté de Dieu. Que si la dicte Jehanne ne conseille aulcune chose qui n’ayt esté dicte en icelluy conseil, je seray alors de la grant et commune opinion, c’est à savoir que le roy et son ost s’en retournent.
Comme sur ce discours la discussion se rallumait avec une nouvelle chaleur, Jeanne d’Arc se présenta à l’entrée du lieu où se tenait le conseil ; on l’introduisit.
— Jehanne, lui dit le chancelier, le roy et son conseil ont eu de grans perplexités, pour savoir ce qu’il a à faire.
Puis, lui ayant donné connaissance de tout ce qui avait été dit avant son arrivée, il la requit de dire à son tour, son opinion au roi.
— Serai-je creue de ce que je diray, demanda alors Jeanne d’Arc au roi ?
— Je ne sçais, répondit Charles VII : si vous dictes choses qui soient raisonnables et proffitables, je vous croiray voulentiers.
— Serai-je creue 152répéta Jeanne.
— Ouy, reprit le roi, selon ce que vous direz.
— Noble daulphin, dit-elle alors, ordonnés à votre gent de venir et d’assiéger la ville de Troyes, et ne tenés pas plus longs conseils ; car, en nom de Dieu, avant trois jours je vous introduirai en la ville de Troyes par amour ou par puissance ; et sera la fausse Bourgogne bien stupéfaite.
— Jehanne, dit alors le chancelier, qui seroit certain dedans six jours, on attendroit bien ; mais je ne sçay s’il est vray ce que vous dictes.
— Ne doutez de rien dit Jeanne au roi ; vous serés demain maître de la cité.
Jeanne se renfermant dans un terme aussi court, on résolut d’attendre l’effet de sa promesse.
Elle prit aussitôt son étendard, monta à cheval, rapprocha les troupes de la ville, et fit toutes les dispositions nécessaires à un assaut. Elle passa toute la nuit dans ces préparatifs, auxquels chacun se prêta avec beaucoup d’ardeur : chevaliers, écuyers, simples soldats, chacun voulut y concourir. Aussi encourageait-elle tout le monde 153par l’habileté et l’activité qu’elle montrait : et fit si merveilleuses diligences, dit Dunois, que tant n’en auroient pu faire, deux ou trois hommes de guerre des plus expérimentés et des plus fameux.
Aussitôt que le jour parut, elle fit sonner les trompettes, cria à l’assaut, et s’avança au bord des fossés, son étendard à la main, ordonnant qu’on les comblât avec les fascines qui avaient été préparées pendant la nuit. Mais ces démonstrations suffirent : la terreur s’empara des troupes anglaises et bourguignonnes qui couvraient les remparts de la ville ; et, menacées par le peuple, elles consentirent à capituler. Les principales conditions, furent, que les gens de guerre, tant Anglais que Bourguignons, s’en iraient librement, eulx et leurs biens, et que ceulx de la ville auroient abolicion généralle
.
Une de ces conditions fournit aux Anglais et aux Bourguignons de la garnison l’idée d’une prétention bien singulière : de ce qu’il était dit dans la capitulation, qu’il s’en iroient librement, eulx et leurs biens
, ils 154 ils conclurent qu’ils pouvaient emmener les prisonniers qu’ils avaient en leur puissance, et se mirent conséquemment en devoir de les faire sortir avec eux de la ville. Jeanne d’Arc se trouvait heureusement à la porte à laquelle ils se présentèrent. Elle prit hautement la défense des malheureux captifs qui allaient être victimes d’un aussi indigne abus des mots :
— En mon Dieu, ilz ne les emmeneront pas ! dit elle avec fermeté aux personnes qui lui faisaient des représentations à ce sujet, et elle commanda impérieusement aux Anglais et aux Bourguignons, de s’arrêter.
Ceux-ci récriminèrent vivement, tandis que les captifs imploraient l’héroïne à genoux. Elle tint bon jusqu’à ce que le roi eût envoyé ses ordres : qui furent que l’on compterait une certaine somme aux Anglais et aux Bourguignons, pour la rançon des prisonniers, qu’on les força de rendre sur-le-champ. C’était encore beaucoup donner où l’on ne devait rien.
Le lendemain, jour de l’entrée du roi dans Troyes, Jeanne d’Arc l’y devança, 155voulant ranger elle-même les gens de trait qui devaient former à pied la haie depuis la porte de la ville jusqu’à la cathédrale. Les habitants, prévenus par les guerriers qui venaient de les quitter, ne savaient s’ils devaient la considérer comme une magicienne ou comme une sainte. Ils envoyèrent au-devant d’elle un prêtre nommé le frère Richard, qui, aussitôt qu’il l’aperçut, se mit, par forme d’exorcisme, à faire des signes de croix et à lui jeter de l’eau bénite.
— Approuchez hardiment, lui dit Jeanne d’Arc en souriant ; je ne m’en voulleray pas.
Quand, par ses soins, tout fut prêt pour la réception du roi, elle retourna auprès de lui. Charles VII entra dans Troyes en grand appareil. Il était à cheval, ayant à son côté Jeanne d’Arc portant son étendard. Autour d’eux entrèrent, aussi à cheval, les princes du sang, les maréchaux et les autres chefs principaux de l’armée.
Le lendemain, toute l’armée traversa la ville aux acclamations des habitants.
Châlons, n’attendit même pas qu’on se 156présentât devant ses murs pour se soumettre. Charles en était encore à quelque distance, lorsqu’il vit venir au-devant de lui une grande partie des habitants, ayant leur évêque à leur tête. Cette marque de prévenance dut flatter infiniment ce prince, et il put l’attribuer jusqu’à un certain point à Jeanne d’Arc, qui précédait l’armée, exhortant chacun à faire son devoir et à venir saluer le véritable roi de France.
Elle était attendue à Châlons par plusieurs habitants de Domrémy, qui brûlaient de la voir. Elle les reçut avec la bonté la plus touchante, causant avec eux aussi familièrement qu’elle le faisait avant de quitter son village pour devenir l’ange tutélaire de sa patrie. Ils lui témoignèrent prendre le plus vif intérêt à son sort, lui demandant, entre autres choses, comment elle pouvait s’exposer à tant de périls, et si elle ne craignait pas de trouver la mort dans les combats :
— Je ne crains que la trahison, répondit Jeanne d’Arc, comme si elle crût avoir déja éprouvé quelque chose de semblable, et qu’elle prévît, à la contenance 157de ceux qui l’entouraient, que des périls de même nature étaient encore à re douter pour elle.
Charles VII, toujours indécis et inquiet, craignait de son côté que la ville de Reims à laquelle il allait bientôt atteindre, ne refusât d’ouvrir ses portes à ceux qui venaient consommer dans son sein le plus auguste et le plus imposant des actes. Jeanne cherchait cependant à le rassurer : N’ayez aucun doute, lui disait-elle, car les bourgeois de la ville viendront au-devant de vous. Avant que vous approchiez de la ville, les habitants se rendront. Avancés hardiment, et soyés sans inquiétude car si vous voulés agir virilement vous obtiendrez tout votre royaume.
Il s’arrêta avec son armée à quatre lieues de la ville, et prit son logement dans un château du domaine des archevêques, appelé Sept-Saulx.
Ceux qui commandaient dans Reims pour les Anglais et pour le duc de Bourgogne virent avec effroi que le peuple ne se montrait nullement disposé à les seconder. Ils 158se hâtèrent donc de se retirer, disant pour la forme aux habitants qu’ils tinssent bon, pendant qu’eux allaient solliciter un secours considérable tant du duc de Bedford que du duc de Bourgogne.
Cependant à peine furent-ils hors de la ville, que le peuple demanda à grands cris qu’on s’empressât de faire savoir au roi qu’il était attendu avec la plus vive impatience. Les notables allèrent donc déposer les clefs de Reims aux pieds de Charles. Ce prince fit solennellement son entrée le soir même. Jeanne d’Arc marchait à son côté, regardée et admirée de tous.
Que ce moment était beau pour elle ! Son roi entrait dans la cité où il devait recevoir l’onction sainte, et c’était sous ses auspices et par ses soins que, contre toutes les probabilités humaines, il était parvenu jusque là à travers mille obstacles de toute espèce. Déjà libératrice d’une ville à laquelle semblait attaché le salut de la France, et le front ceint de lauriers cueillis dans vingt combats, le résultat de ses conseils et de ses faits d’armes était d’assurer en cet 159instant la couronne de France sur la tête d’un prince français auquel, depuis si longtemps, des étrangers et des traîtres la disputaient avec succès. Elle amenait en quelque sorte ce prince par la main au milieu de la fleur des chevaliers de son temps, qui cependant n’étaient redevenus invincibles que depuis qu’ils l’avaient à leur tête. Quelle leçon pour les rois accoutumés à se laisser égarer dans le choix des dépositaires de leur confiance par les menées de l’intrigue et les prestiges de la fausse grandeur ! Que de motifs d’orgueil pour la jeune villageoise, si l’orgueil pouvait jamais accompagner la véritable vertu, et si Jeanne d’Arc ne se fût en particulier regardée comme un humble instrument de la volonté divine !
On décida que Charles VII serait sacré et couronné dès le lendemain 17 juillet. La nuit fut consacrée aux préparatifs. Une couronne fort riche venait à la suite du prince : on résolut, puisqu’elle n’était point arrivée, de se servir d’une autre beaucoup plus simple, que l’on trouva dans le trésor de la cathédrale. Il ne s’agissait pas de 160couronner magnifiquement le roi de France ; mais de le couronner seulement suivant toutes les formes usitées jusqu’alors, afin que son injuste compétiteur cessât de se prévaloir aux yeux des peuples, de l’absence de ce grand acte de religion et de politique.
Jeanne, toujours aussi désireuse du bonheur que de la gloire de son pays, employa le temps qui s’écoula entre le lever du soleil et la cérémonie du couronnement, à tenter par la lettre suivante, adressée au duc de Bourgogne, de faire cesser la dissension intestine qui déchirait le sein de la France et le tenait ouvert à l’étranger.
Lettre de Jehanne la Pucelle au duc de Bourgogne.
✠ Jhesus maria
Haut et redoubté prince, duc de Bourgongne, Jehanne la Pucelle vous requiert 161de par le Roy du ciel, mon droicturier souverain Seigneur, que le roy de France et vous faciez bonne paix, ferme, qui dure longuement ; pardonnés l’un à l’autre de bon cuer entièrement, ainsi que doibvent faire loyaux xhrestpiens, et s’il vous plaist aguerroyer, si allez sur le Sarrazin. Prince de Bourgogne, je vous prie, supplie et requiers, tant humblement que requierir vous puis, que ne guerroyés plus au saint royaulme deFrance ; et faictes retraire incontinent et briesvement vos gens qui sont en aucunes places et forte resses dudit saint royaume de France ; et de la part du gentil roy de France, il est prest de faire paix à vous, sauve son honneur, s’il ne tient en vous ; et vous fais assçavoir, de par le Roy du ciel, mon droicturier et souverain Seigneur, pour votre bien et pour votre honneur, et sur voz vie, que vous n’y gaignerés point bataille à l’encontre des loyaulx Françoys, et que touts ceulx qui guerroyent au dict saint royaulme de France, guerroyent contre le Roi Jhesus, Roy du ciel et de tout le 162monde, mon droicturier et souverain Seigneur, et vous prie et requiers joinctes mains que ne faictes nulle bataille et ne guerroyés contre nous, vous vos gens et subgiez ; et croyez surement quelque nombre de gens que vous amenez contre nous, qu’ilz n’y gaigneront mie, et sera grant pitié à la grant bataille et du sanc qui sera répandu de ceux qui y vendront contre nous. Et a trois semaines que je vous envoyé escript et envoyé bonnes leetres par ung hérault, que vous fussiez au sacre du roy, qui aujourd’huy dimanche, dix-septième jour de ce présent mois de juillet, se fait en la cité de Reims, dont je n’ay eu point de réponse, ne n’ouy oncques puis nouvelles dudit hérault. A Dieu vous command, et soit garde de vous, s’il lui plaist ; et prie Dieu qu’il y mette bonne paix. Escript au dict lieu de Reims, le dix-septième jour de juillet7.
Le sacre et le couronnement du roi se 163firent dans la plus grande rigueur. Ce furent les premières fonctions de son ministère, que remplit dans son diocèse Regnault de Chartres, chancelier de France, archevêque de Reims.
Au moment convenable, le roi d’armes de France, se plaçant devant le maître-autel, appela par leur nom les anciens pairs laïcs, savoir, les ducs de Bourgogne, de Normandie et d’Aquitaine, les comtes de Flandres, de Toulouse et de Champagne ; formalité qui, fondée sur les antiques éléments de la monarchie française, servait à maintenir le droit réel de souveraineté des rois de France sur les rois d’Angleterre, en leur qualité de grands vassaux de la couronne.
Les pairs appelés n’ayant point comparu, ils furent remplacés pour la cérémonie, par :
Le duc d’Alençon, représentant le duc de Bourgogne ;
Le comte de Clermont, fils aîné du duc de Bourbon, prisonnier en Angleterre, représentant le duc de Normandie ;
164Le comte de Vendôme, représentant le duc d’Aquitaine,
Le sire de La Trémoille, représentant le comte de Flandres ;
Le sire de Laval, représentant le comte de Toulouse ;
Et le seigneur de Gaucourt, ou de Beaumanoir, ou de Mailly (car l’histoire varie à ce sujet), représentant le comte de Champagne.
Les fonctions des pairs ecclésiastiques furent remplies par l’archevêque de Reims, les évêques de Châlons, d’Orléans, de Séez, et deux autres évêques que les historiens ne désignent point.
À un certain moment de l’auguste cérémonie, Jeanne d’Arc fut vue auprès de l’autel, son étendard à la main.
165Livre IV et dernier
- Jeanne d’Arc veut se retirer ; elle en est empêchée par les sollicitations des principaux seigneurs et les ordres formels du roi.
- Époque à laquelle on lui donna des lettres de noblesse.
- Continuation de ses exploits.
- Ses services et ses dangers au siège de Paris.
- Elle pressent sa perte prochaine.
- Elle défait un parti ennemi aux environs de Lagny.
- Elle marche au secours de Compiègne.
- Elle est prise dans une sortie.
- Les Anglais l’achètent de Jean de Luxembourg.
- Elle tente inutilement de s’évader.
- Rigueurs et cruautés exercées envers elle.
- Elle est mise en jugement à Rouen comme magicienne.
- Sa première condamnation.
- Elle est brûlée.
- Détails sur 166ses derniers moments.
- Sa réhabilitation.
Jeanne d’Arc avait vu son père à Reims, et y avait témoigné pour lui le plus tendre empressement et le plus profond respect. Comment aurait-elle manqué à ces deux devoirs de la piété filiale, la jeune héroïne qui prenait la vertu la plus sévère pour base de toutes ses actions, et qui se montrait même persuadée, qu’à l’exemple de ce qui se passait chez les anciens Israélites, la pureté des combattants pouvait seule, dans une action de guerre, assurer la victoire à leur courage et leur habileté ! Cet oubli coupable aurait-il pu devenir chez elle l’effet de cet éblouissement que causent quelquefois les grandeurs à ceux qui ont passé leurs premières années loin d’elles et de leurs vains prestiges ? Jeanne d’Arc se croyant, dès son enfance, destinée à jouer le rôle brillant qu’elle soutenait avec tant de noblesse, ne s’était introduite auprès du roi que par soumission aux décrets du 167souverain Auteur de toutes choses, qu’elle consultait sans cesse, pour lui donner sans cesse aussi des marques de l’obéissance la plus absolue. Les honneurs ne parurent jamais la flatter, et il semblerait même qu’elle en portait le poids avec impatience. Du moins la vit-on, après le sacre et le couronnement du roi, solliciter comme un bienfait la permission de se retirer au sein de sa famille, prétendant au reste que sa mission était terminée, et que les plus grands malheurs fondraient sur elle si elle prolongeait au-delà sa présence à l’armée.
Il ne fallut rien moins que les sollicitations de tous les guerriers illustres qui avaient été ses compagnons d’armes, et même les ordres du roi pour la retenir. L’histoire nous apprend que, dans l’idée sans doute de l’enchaîner par l’intérêt, lien que les hommes croient généralement tout puissant, parce que la plupart d’entre eux en peuvent être invinciblement attachés ; l’histoire nous apprend, dis-je, que ce ne fut que dans le mois de décembre, c’est-à-dire à un terme déjà éloigné du sacre de Charles VII, 168qui s’était fait le 17 juillet, et après de nouveaux services, que Jeanne d’Arc reçut du roi des lettres de noblesse, récompense qu’on lui rendait commune avec toute sa famille, pour laquelle on connaissait sa tendre affection. Dès le mois de juillet, on avait ce pendant élevé à la dignité de bailli de Vermandois le chevalier La Hire, qui n’avait fait que lui prêter dans les combats le secours de son épée, qu’il sortait volontiers du fourreau.
Forcée de céder aux volontés de son souverain, dit Villaret dans son Histoire de France, on la vit, depuis ce moment, s’abstenir d’opposer son avis à celui des ministres ou des généraux, liberté qu’elle s’était presque toujours donnée jusqu’alors. Elle se contenta dans la suite de partager les travaux des plus dangereuses expéditions, et de s’exposer la première.
Ainsi se montra-t-elle, par exemple (en août) ; à la bataille de Montépilloy, dont l’événement fut indécis. Accompagnée du chevalier Dunois, du comte d’Albret et de La Hire, elle se jeta plusieurs fois dans la 169mêlée pour essayer pour de fixer la victoire du côté de ses compatriotes ; tantôt ralliant les guerriers français, et les ramenant au combat, tantôt croisant sa lance avec celles des chefs ennemis, et les faisant reculer ou rouler sur la poussière.
Ainsi se montra-t-elle encore un peu plus tard, c’est-à-dire le 8 septembre, au siège de Paris. Ce jour-là, cette ville, que tenaient toujours les Anglais, étant attaquée avec succès par les guerriers fidèles à Charles VII, dans l’espace de terrain qui s’étendait entre la butte Saint-Roch ou des Moulins et la porte Saint-Honoré, placée alors où la rue Traversière vient aujourd’hui se joindre à la rue Saint-Honoré, Jeanne d’Arc fit particulièrement preuve de valeur, et l’on put croire un moment que la réduction de la capitale de la France allait devenir le prix de son courage et de son génie militaire.
Les Anglais, qui occupaient d’abord quelques ouvrages avancés, venaient d’être repoussés jusque dans la place, après avoir vu l’épée d’un de leurs chevaliers devenir la conquête de la libératrice d’Orléans, 170lorsque celle-ci, jugeant avec raison que cet avantage, si l’on savait en profiter, pouvait se pousser jusqu’à la prise même de Paris, s’écria qu’il fallait monter à l’assaut. Ce coup de vigueur devait, à l’entendre, achever la défaite d’un ennemi déjà découragé et consterné, et pouvait aussi faire déclarer les partisans nombreux que le roi avait dans la ville. Il était, disent les chroniques du temps, environ deux heures après midi. Jeanne parut bientôt au bord du premier fossé8, l’épée d’une main, et la fascine de l’autre un grand nombre de guerriers de tous rangs la suivaient, armés comme elle. En un moment ce premier fossé eût été comblé, Jeanne d’Arc se précipita ensuite vers le second : mais les assiégés avaient eu la précaution de le tenir plein d’eau ; ce qu’elle ignorait. Elle ne se découragea cependant pas, et debout sur l’espace étroit qui séparait les deux fossés, 171elle se mit à diriger dans leur travail les soldats français, qui comblaient le second fossé comme ils avaient fait du premier. Un guerrier tenait son étendard déployé auprès d’elle. Aux injures, aux menaces que lui adressaient les assiégés de leurs remparts, elle ne répondait que ces mots : Rendez la ville au roi de France.
Tous les traits des soldats ennemis se dirigeaient sur elle et sur son porte-étendard ; car les assiégés croyaient, non sans quelque fondement, que s’ils parvenaient à les abattre l’un et l’autre, le courage et la constance des Français employés à cette attaque, tomberaient avec eux. Un trait atteignit Jeanne à la cuisse, et la renversa ; un autre blessa en même temps au pied son porte-étendard ; et comme ce guerrier se baissait pour arracher le fer de sa plaie, un troisième trait le frappa entre les deux yeux, et le tua raide.
Cependant Jeanne d’Arc, malgré ce qu’elle souffrait, continuait à exhorter les Français à poursuivre leur travail ; mais l’attitude où ils la voyaient réduite par sa 172blessure, et ce qui venait d’arriver au même moment à son porte-étendard, les rendaient défiants et incertains : ils n’avaient plus cette ardeur qui fait seule réussir les entreprises difficiles. Une décharge terrible d’artillerie s’étant bientôt faite des remparts, ils prirent tout à fait l’épouvante, et s’enfuirent à toutes jambes, abandonnant sur le champ de bataille les chariots qui avaient apporté leurs fascines, et ne songeant même point à en enlever la noble guerrière, qui, sans sa blessure, leur aurait peut-être donné la victoire. Jeanne, dans le désespoir de ce moment, montrait au reste peu d’amour pour la vie, et ce ne fut que sur les instances réitérées des principaux chefs de l’armée du roi, qu’un peu plus tard elle consentit à se faire transporter au camp. Elle voulait d’abord qu’on la laissât mourir à la place où elle avait été renversée du moment de vaincre. Elle eût ainsi pu être faite prisonnière ; mais les assiégeants inspiraient encore assez de terreur aux assiégés pour que ceux-ci n’aient point osé sortir de la ville à leur poursuite.
173Jeanne voulait encore se retirer de l’armée, attribuant la fâcheuse issue de sa dernière entreprise à la mauvaise volonté d’une partie de ceux qui auraient dû être les premiers à la seconder, et elle en demanda la permission au roi ; mais sur les justifications et les instances qui lui furent faites, elle consentit de nouveau à demeurer. Elle partit donc le 12 septembre, avec Charles VII, pour les provinces de la Loire, où l’on jugeait convenable de ramener les troupes. Avant de se mettre en route, elle consacra dans l’église de Saint-Denis, et fit attacher à une des colonnes de cette basilique, l’armure du chevalier anglais qu’elle avait vaincu sous les murs de Paris9. Il paraît que sa blessure n’était ni dangereuse ni grave, puisqu’elle lui permit d’entreprendre aussi vite ce voyage.
Jeanne d’Arc, au milieu des guerriers, continua d’être leur exemple. On lui dût encore, 174entre autres faits d’armes éclatants, la prise de Saint-Pierre-le-Moûtier, dont elle risqua l’assaut contre l’avis des autres chefs de l’armée. Elle concourut aussi à une défaite sanglante que les Anglais essuyèrent devant Melun. Ce fut sur les fossés de cette dernière ville qu’elle prétendit avoir eu une vision dans laquelle les saintes ses protectrices lui annoncèrent qu’elle tomberait, avant la Saint-Jean, au pouvoir de ses ennemis. Ce malheur, dont les suites ont compromis l’honneur de deux nations, ou plutôt de leurs chefs, arriva en effet à Compiègne dans ce terme. Il fut préparé et accompagné par les circonstances les plus honorables pour Jeanne d’Arc ; telles ont, au reste, été toutes les grandes époques de la vie de cette héroïne.
Vers le mois de mai 1430, la guerre se ranimait avec une nouvelle fureur. On promenait en France le jeune roi d’Angleterre Henri VI ; le régent anglais et le duc de Bourgogne redoublaient d’efforts pour faire triompher sa cause, et ils attendaient de la Grande-Bretagne des renforts considérable. 175C’était aussi pour tous les bons Français, le moment de se mettre en campagne, afin de soutenir les avantages qu’ils avaient obtenus depuis un an sur les ennemis, et d’empêcher ceux-ci de réduire le royaume aux fâcheuses extrémités où il s’était trouvé avant les premiers exploits de la Pucelle d’Orléans. Aussi voyait-on les guerriers déjà célèbres par des services rendus dans cette guerre à Charles VII, courir partout où ils espéraient pouvoir se rendre utiles. Chaque jour était marqué par quelqu’une de leurs tentatives, le plus souvent couronnées d’un heureux succès.
Jeanne d’Arc s’avançait en ce moment vers l’Île-de-France à la tête d’un petit corps d’armée. On l’avait entendue répondre à quelqu’un qui parlait d’entrer en négociation avec le duc de Bourgogne : Il me semble qu’on n’y trouvera point de paix, si ce n’est au bout de la lance.
Elle arriva à Lagny-sur-Marne, dans les premiers jours de mai, c’est-à-dire environ à la même époque où, un an auparavant elle était venue secourir Orléans. On ne 176tarda pas à lui annoncer dans cette ville qu’un corps de trois à quatre-cents Anglais ou Bourguignons, commandé par un nommé Franquet d’Arras, homme d’armes aussi odieux pour ses cruautés que renommé pour sa vaillance, allait passer non loin de Lagny, chargé des dépouilles de tous les habitants de l’Île-de-France. Jeanne d’Arc déclara qu’elle allait sortir pour charger ce brigand, et invita les chevaliers qui l’entouraient à l’imiter. Quelques-uns la suivirent. Quatre-cents hommes d’armes composaient toute la troupe qu’elle prit avec elle. On ne tarda point à rencontrer l’ennemi. Le combat fut sanglant : deux fois mis en déroute, deux fois les Français furent ralliés par l’héroïne ; enfin ils remportèrent une victoire complète, et eurent Franquet d’Arras lui-même au nombre de leurs prisonniers. Jeanne d’Arc demandait qu’il fût, comme un prisonnier ordinaire, échangé contre un nommé de Lours, du parti du roi, qui était tombé entre les mains des Anglais, et auquel elle prenait intérêt ; mais les juges de Lagny et le bailli de Senlis, 177qui regardaient Franquet comme un scélérat, à cause de la manière indigne dont il faisait la guerre, voulaient qu’il fût jugé conformément aux lois, pour les vols et meurtres qu’il avait commis dans ses incursions. On en était à contester sur ce point, lorsque l’on apprit la mort de ce de Lours, contre lequel Jeanne d’Arc désirait qu’on l’échangeât. Cette nouvelle fit tout d’un coup cesser la contestation. Puisque mon homme est mort, que je vouloye avoir, dit Jeanne, faictes de icelluy ce que, debvroyez faire par justice.
Franquet d’Arras fut donc mis en jugement. Il fit différents aveux ensuite desquels il fut condamné à mort et exécuté comme meurdrier, larron et traictre
. Cette exécution, injuste ou légitime, mais dont il est démontré que Jeanne était innocente, fut un des chefs d’accusation que les Anglais produisirent contre elle dans son procès.
Cependant, Compiègne ne tarda pas à être menacée. Jeanne d’Arc y courut aussi tôt, faisant un appel à tous les Français qui se trouvaient à portée de secourir cette 178ville. Jacques de Chabannes, Théaulde de Valpergue, Regnault de Fontaines, Poton de Xaintrailles, et plusieurs autres chevaliers célèbres vinrent se ranger sous la bannière de la jeune amazone, amenant avec eux environ deux-mille combattants. Le duc de Bourgogne assiégeait alors la forteresse de Choisy, qui, située dans la péninsule formée par les rivières de l’Aisne et de l’Oise, était un point de communication entre Compiègne et les autres villes françaises. On décida, dans un conseil de guerre qui fut tenu à Compiègne, que l’on essaierait de faire lever ce siège, en allant attaquer les faubourgs de Noyon, où le duc avait laissé une partie de son armée et ses bagages. Cette expédition, à laquelle Jeanne d’Arc prit part, ne fut point heureuse. La trop grande supériorité numérique de l’ennemi força d’y renoncer. On fit, avec aussi peu de succès, différentes autres attaques sur le camp même du duc de Bourgogne. Cependant la forteresse de Choisy, battue par une artillerie formidable, et ne conservant bientôt plus aucun espoir 179d’être secourue, se rendit au duc qui, ayant fait rétablir à la hâte son pont sur l’Oise, s’en servit pour venir, avec toute son armée, assiéger Compiègne du côté du nord.
La garnison, secondée par les habitants, ne laissa pas les Anglais et les Bourguignons s’établir tranquillement autour de la ville ; et quand ils y eurent réussi, grâce à leur grand nombre, elle les fatigua tous les jours par des sorties meurtrières. Jeanne d’Arc n’était pas encore rentrée de l’expédition de Choisy. On ne tarda cependant point à la voir paraître à la tête d’une nouvelle troupe de guerriers qu’elle amenait de Crépy-en-Valois. On était alors au 23 mai 1430. Un renfort anglais venait aussi d’arriver dans le camp du duc de Bourgogne, conduit par les comtes de Huntington, d’Arundel et de Suffolk.
À la vue de Jeanne d’Arc rentrant dans Compiègne, le peuple fit éclater de grands transports de joie. Il paraissait désormais se croire invincible : la présence de l’héroïne avait été le gage de la délivrance d’Orléans ; on s’écriait qu’elle serait aussi celui de la délivrance de Compiègne. On montrait 180la plus grande ardeur ; tout le monde demandait à combattre. Il semblait qu’il n’y eût plus qu’à se montrer hors des murs pour forcer les Anglais à lever le siège. Les chefs de la garnison résolurent de profiter de ces bonnes dispositions pour aller détruire les fortifications que le général ennemi Baudouin de Noyelles faisait élever à Marigny, au bout de la chaussée. Jeanne d’Arc, Poton le Bourguignon, et plusieurs autres seigneurs ou chevaliers, sortirent en conséquence de Compiègne par la porte du pont, suivis de six-cents hommes d’armes environ, tant à pied qu’à cheval, traversèrent le pont, et débouchèrent par le boulevard qui en défendait l’issue du côté de la campagne, dans une prairie qui se trouvait au-delà. Jeanne d’Arc était facile à remarquer parmi tous les guerriers qui l’environnaient ; ce jour là, une tunique de soie couleur de pourpre, brodée en or et en argent, recouvrait son armure.
Il était cinq heures après midi. Jean de Luxembourg, lieutenant du duc de Bourgogne, était sorti de son quartier, peu éloigné 181de celui de Baudouin de Noyelles, avec quelques autres officiers de distinction, pour examiner les dehors de la place, et tâcher d’en découvrir les côtés faibles. À la vue des Français débouchant dans la plaine, ils crièrent à l’arme, et se replièrent sur le quartier de Marigny ; en quelques minutes, dans ce quartier et dans tous les autres, on se fut mis en état de combattre. On marcha ensuite à la rencontre des Français. Ils renversaient à mesure tout ce qui se présentait devant eux. L’accroissement progressif des forces qu’on leur opposa ne sembla un moment que devoir rendre leur triomphe plus glorieux. Deux fois Jeanne d’Arc, avec ses six-cents hommes d’armes, enfonça et culbuta les Anglais et les Bourguignons jusque sur le quartier de Marigny ; mais leur nombre, augmentant sans cesse, elle ne pût, dans troisième charge, les ramener qu’à moitié chemin. Les Français, remarquant alors que toute l’armée ennemie s’avançait pour les écraser, se mirent en devoir de rentrer dans la ville. Suivant sa coutume en pareil cas, Jeanne d’Arc marchait 182la dernière, tournant tête de temps en temps avec quelques braves pour ralentir la poursuite de l’ennemi. Les Anglais prirent cette petite troupe en flanc, tandis que les Bourguignons la chargèrent vigoureusement en queue. Elle fut en quelques instants rompue et dispersée, et presque tous ceux qui en faisaient partie tombèrent sous le fer du vainqueur, ou devinrent ses prisonniers. De tous, il ne resta bientôt plus, en quelque sorte, que Jeanne d’Arc. Reconnue par les Anglais et les Bourguignons, à cause de son habillement, et surtout à son étendard, qu’elle tenait d’une main, tandis que de l’autre elle se faisait jour à coups d’épée, elle vit tous les efforts se diriger contre elle ; c’était à qui aurait l’honneur de s’emparer de sa personne. Elle vint cependant à bout de gagner, en combattant, le pied du boulevard du pont ; mais elle n’y put entrer, soit qu’elle fût suivie de trop près, soit qu’elle en trouvât l’ouverture encombrée par les fuyards, soit enfin, comme l’ont dit quelques-uns sans en avoir donné aucune preuve, que la barrière en eût été 183fermée par la perfidie de Guillaume de Flavy, gouverneur de Compiègne, jaloux de l’héroïne, et craignant qu’elle ne recueillit toute la gloire de la défense de la ville, si cette défense était couronnée du succès. Elle chercha alors à gagner les champs du côté de la Picardie, comptant encore sur la vitesse de son cheval pour échapper : mais un cavalier bourguignon, d’autres disent un archer picard, la saisit par son vêtement, et la fit tomber de son cheval. Elle fut ensuite désarmée de vive force, puis amenée à Marigny, où l’on établit autour d’elle une garde nombreuse.
On sent quelle dut être la joie des Anglais et de leurs alliés quand ils tinrent ainsi Jeanne d’Arc prisonnière. Ils se hâtèrent d’annoncer cette nouvelle à toutes les villes de leur parti. Elle fut connue à Paris le lendemain 25 mai. En réjouissance, on y chanta un Te Deum dans la métropole, et l’on y alluma ensuite, de tous côtés, des feux de joie. Il est à remarquer, pour la suite des événements, que dès ce premier moment, les Anglais et les Bourguignons, 184en célébrant son malheur, l’accusèrent, dans leurs déclamations, d’impiété et de magie.
Elle avait cependant été vendue, par celui qui l’avait prise, à Jean de Luxembourg. Celui-ci la fit conduire, par une escorte nombreuse, au château de Beaulieu. Jeanne d’Arc, déjà fatiguée de sa captivité, chercha bientôt à s’évader, et elle faillit y réussir. Étant parvenue, un jour, à sortir de la chambre où on la tenait renfermée, par une ouverture qu’elle avait pratiquée entre deux pièces de bois, elle allait gagner la campagne, lorsqu’elle fut rencontrée par le portier du château, qui mit aussitôt tout le monde sur pied par ses cris d’alarme. Il fallut alors que Jeanne d’Arc rentrât dans sa prison. De Beaulieu, Jean de Luxembourg l’envoya à son château de Beaurevoir, en Picardie, à quatre lieues environ de Cambrai. Elle y trouva l’épouse et la sœur de ce seigneur, qui toutes deux parurent prendre le plus vif intérêt à son sort. Ces dames, instruites qu’on cherchait dans le parti anglais matière à lui faire son procès, 185et qu’un des principaux griefs dont on prétendait s’armer contre elle était son changement d’habits, voulurent lui faire reprendre les vêtements ordinaires à son sexe, et lui en offrirent même des leurs. Mais Jeanne d’Arc, qui croyait avoir reçu d’en haut l’ordre de se conduire en tout comme elle le faisait depuis un an, refusa avec une fermeté inébranlable : Je ne quitterai point, dit-elle, les vêtements que je porte, sans la permission de Dieu… Je n’en ai pas le congié de messire ; et il n’est pas encore temps.
Elle habita le château de Beaurevoir pendant quatre mois environ. Elle y était, comme nous venons de le dire, traité avec beaucoup d’égards, mais cependant gardée comme une prisonnière dans le donjon.
On s’agitait de tous côtés pour la perdre. Dès les premiers moments, un frère Martin, prenant les titres de maître en théologie et de vicaire-général de l’inquisiteur de la foi au royaume de France, demanda au duc de Bourgogne qu’elle fût remise entre ses mains :
Nous, dit-il dans la lettre qu’il 186écrivit à ce sujet en usant des droits de notre office, de l’auctorité à nous commise du saint siège de Rome, requérons instamment, et enjoignons, en faveur de la foi catholique, et sur les peines de droit, d’envoyer et amener toute prisonnière par devers nous, ladite Jeanne, soupçonnée véhémentement de plusieurs crimes sentant hérésie, pour estre à droit par devers nous, procédé contre elle par le promoteur de la sainte inquisition.
Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, qui faisait profession de détester le parti français et tout ce qui s’y rapportait, prétendit de son côté, que Jeanne d’Arc avait été prise sur le territoire de son diocèse, et que c’était conséquemment devant son tribunal qu’elle devait être traduite.
Enfin on vit l’Université de Paris, bassement dévouée aux Anglais, demander aussi, et à plusieurs reprises, qu’elle fût livrée à un tribunal ecclésiastique quelconque, comme suspecte de magie et de sortilèges.
Sur cette réquisition de l’Université de Paris, qui n’était sans doute, ainsi les que 187sollicitations du frère Martin et de l’évêque Cauchon, qu’un effet des manœuvres secrètes des Anglais, Pierre Cauchon se déclara médiateur entre Jean de Luxembourg, le duc de Bourgogne et le roi d’Angleterre, afin que Jeanne d’Arc fût livrée à ce dernier, moyennant rançon. L’évêque de Beauvais, pour lever toute autre difficulté, se soumettait au reste à agir, dans cette affaire, de concert avec l’inquisiteur de la foi. Voici un fragment de la missive qu’il adressa à ce sujet aux parties intéressées :
C’est ce que requiert l’évêque de Beauvais à monseigneur le duc de Bourgogne et à messire Jean de Luxembourg, et au bastard de Vendôme, de par le Roy notre Sire, et de par lui comme évesque de Beauvais, que cette femme que l’on appelle Jehanne la Pucelle, prisonnière, soit envoyée au roi, pour la délivrer à l’Église, pour lui faire son procès, pour ce qu’elle est suspectionnée et diffamée d’avoir commis plusieurs crimes, comme sortilège, idolastrie, invocation d’ennemys (de démons) et autres plusieurs cas touchans nostre saincte foy et contre icelle.
188Et combien qu’elle ne doit point estre prinse de guerre, comme il semble, considéré ce que dit est, néanmoins, pour la rémunéracion de ceulx qui l’ont prinse et détenue, le roi veult libéralement leur bailler jusqu’à la somme de six mille fr. ; et pour le dict bastard qui l’a prinse, luy donner et assigner rente, pour soubstenir son état, jusques à deux ou trois cents livres… etc., etc.
Il paraît néanmoins que le roi d’Angleterre fut obligé de donner pour cet infâme marché, jusqu’à dix-mille francs (environ soixante-six-mille livres de notre monnaie). À ce prix, Jean de Luxembourg convint de lui livrer son intéressante prisonnière, malgré les sollicitations de son épouse, la dame de Beaurevoir, qui, dit Villaret, embrassa plusieurs fois ses genoux, en le conjurant, par les motifs les plus pressants de l’honneur et de l’humanité, de ne pas livrer à une mort certaine une captive intéressante par son courage et son innocence, que d’ailleurs les lois de la guerre commandaient de respecter.
189Jeanne, au château de Beaurevoir, s’occupait beaucoup plus du salut de sa patrie que de son propre sort, et c’était avant la sienne, la délivrance des habitants de Compiègne qu’elle demandait à Dieu. Elle eût bien voulu, par une tentative plus heureuse que celle qu’elle avait faite au château de Beaulieu, se mettre en puissance d’aller, de nouveau, combattre à leur tête. Ce qui se préparait ne pouvait l’y conduire. Aussitôt donc qu’elle sut qu’elle était vendue aux Anglais, elle essaya encore de s’évader. Quelque moyen qu’elle eût pris, elle tomba, cette fois, du sommet du donjon où on la gardait prisonnière, et se blessa. On la trouva évanouie au pied de la tour.
Quand elle fut tout-à-fait rétablie, on la conduisit à Arras, où des personnes respectables, qui prévoyaient ce qui allait lui arriver lorsqu’elle aurait été remise aux Anglais, voulurent encore vainement lui faire reprendre les habits de son sexe. D’Arras on la mena au château du Crotoy, forteresse située en Picardie, à l’embouchure de la Somme, et de ce château à Rouen. Là, prisonnière 190des Anglais, elle fut renfermée dans la grosse tour du château, la seule qui existe encore aujourd’hui. On l’y traita avec la dernière rigueur. Quelques auteurs prétendent même qu’elle y fut, pendant un certain espace de temps, renfermée dans une cage de fer. Ce dont on ne peut douter, c’est qu’elle avait les pieds retenus par des ceps de fer, qui tenaient eux-mêmes par une forte chaîne et au moyen d’une serrure fermant à clef, à une grosse pièce de bois. La garde de sa personne était, de plus, confiée à cinq soldats anglais, qui, pris dans les derniers rangs de l’armée anglaise, se faisaient un mérite d’insulter et de tourmenter de mille façons leur prisonnière. Ils poussaient la cruauté jusqu’à l’éveiller de temps en temps, pendant la nuit, pour lui dire faussement que l’heure de sa mort était venue, et qu’on allait la faire périr du dernier supplice.
Il paraît enfin que ces hommes abominables, indignes de coiffer le casque sous aucune bannière européenne, essayèrent, plus d’une fois de porter atteinte à son honneur, nouveau genre de tourment inventé 191pour elle. L’évêque de Beauvais et le comte de Warwick lui demandant une fois pourquoi elle ne revêtait pas des habits de femme, et lui faisant observer qu’il n’était pas décent à une femme d’avoir une robe d’homme, et des chausses attachées avec beaucoup d’aiguillettes fortement nouées, elle leur répondit qu’elle n’osait quitter lesdites chausses, ni les tenir moins fortement attachées, car ils savaient bien (ledit comte et ledit évêque en convenaient) que ses gardes avaient plusieurs fois tenté de la violer ; et qu’une fois qu’elle appelait à son aide, ledit comte, entendant ses cris, vint au secours, si bien que, s’il ne fût survenu, lesdits gardes l’eussent violée.
Le 3 janvier 1431, parurent les lettres patentes par lesquelles le roi d’Angleterre, prétendu roi de France, ordonnait qu’elle serait mise en jugement.
Une femme, disait-il dans ses lettres, qui se fait appeler la Pucelle, laissant l’habit et vestière du sexe féminin, contre la loi divine, comme chose abhominable à Dieu, réprouvée et deffendue de toute loi, vestue et habillée 192et armée en habit et estat d’homme, a fait et exercé cruel faict d’hommicide, et, comme l’on dict, a donné à entendre au simple peuple, pour le séduire et abuser, qu’elle estait envoyée de par Dieu, et avait cognoissance de ses divins secrets, ensemble plusieurs autres dogmatisations très périlleuses à nostre saincte foy catholique moult préjudiciables et scandaleuses ; en poursuivant par elle lesquelles abusions, et exerçant hostilité à l’encontre de nous et de nostre peuple, a été prinse armée devant Compiègne par aulcuns de nos loyaulz subjectz, et deppuis ammenée prisonnière par devers nous. Et pour ce que de susperstitions, faulses dogmatisations, et austres crimes de lèze-majesté divine, elle a esté, de plusieurs, réputée suspecte, nottée et diffamée, avons esté requis très instamment par révérend père en Dieu notre amé et féal conseiller l’évesque de Beauvais, juge ecclésiastique et ordinaire de la dite Jehanne, de ce qu’elle a été prinse et apprehendée es termes et limites de son dioceze, et pareillement exhorté de par nostre très chière et très 193saincte fille, l’université de Paris, que icelle Jehanne veuillons faire rendre, bailler et délivrer au dict reverend père en Dieu, pour la interroger et examiner sur les dits cas, et procéder contre elle selon les ordonnances et dispositions des droits divins et canoniques, appelés ceulx qui sont à appeler,… etc., etc.
Composition du tribunal ecclésiastique chargé de juger Jeanne d’Arc.
Seuls juges ayant voix délibérative.
Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, licencié en droit, nommé en 1420 à son évêché par la faction bourguignonne, l’un des conseillers du roi d’Angleterre en France.
Jean Lemaître, frère prêcheur, bachelier en théologie, prenant la qualité d’Inquisiteur-général de la Foi en France.
Conseiller-Commissaire-Examinateur.
Jean de la Fontaine, licencié en droit canonique.
194Promoteur.
Jean, ou Joseph, ou Guillaume d’Estivet, chanoine de Beauvais et de Bayeux, promoteur du diocèse de Beauvais. (Les fonctions de promoteur dans les tribunaux ecclésiastiques répondaient à celles de procureur du roi dans les juridictions séculières.)
Notaires-Greffiers.
Guillaume Manchon, prêtre, notaire public et de la cour de l’archevêché de Rouen.
Guillaume Colles ou Coles, prêtre, dit Bosguillaume ou Boys-Guillaume, notaire public et de la cour de l’archevêché de Rouen.
Nicolas Tasquel, notaire public et de la cour de l’archevêché de Rouen.
Appariteur ou huissier ecclésiastique.
Jean Massieu, prêtre, et en 1455, l’un des curés de l’église paroissiale de Saint-Candide de Rouen. Ses fonctions dans le procès furent de donner les exploits, de 195faire les citations, d’amener Jeanne au tribunal, de la reconduire en prison, et de prévenir ceux des assesseurs qui étaient mandés aux séances.
Juges-assesseurs ou Conseillers, c’est-à dire ayant voix consultative seulement.
Le nombre en fut très grand et indéterminé : tel assista à la première séance qui ne vint point à la seconde, et tel se montra à celle-ci qu’on, n’avait pas vu à la première. Il paraît que cette partie du tribunal se composa, chaque jour d’instance, de tout ce que l’on avait pu rassembler de docteurs contraints même par force à prêter leur ministère à cet odieux procès.
Par l’espèce du tribunal qui fut appelé à juger Jeanne d’Arc, il est facile de pressentir sur quoi porta principalement la procédure : on s’efforça de prouver qu’elle était sorcière ; et pour atteindre ce but, on s’aida le mieux qu’on pût des conseils divins que Jeanne prétendait elle-même recevoir journellement. Ses déclarations furent, à cet égard, positives, et elle parut y croire 196sa conscience intéressée. Au reste, de tels aveux ne constituaient pas ce qu’on appelait, dans ces temps d’ignorance et de superstition, une sorcière, mais seulement une personne qui se figurait être pour la Divinité un objet particulier de protection.
Jeanne, tant que dura le procès, montra le plus grand calme, et ses réponses furent quelquefois pleines de grandeur et de fierté.
— Disiés vous point, lui demanda-t-on, que les pennonceaulx (les étendards) qui étaient semblables au vostre, seraient heureux ?
— Je disais : Entrez hardiment au milieu des Anglais, et j’y entrais moi mesme.
Ce mot, vraiment héroïque, rappelle celui que Jeanne, blessée, fit entendre à l’attaque du pont d’Orléans : Ce n’est pas du sang, c’est de la gloire qui coule de ma blessure.
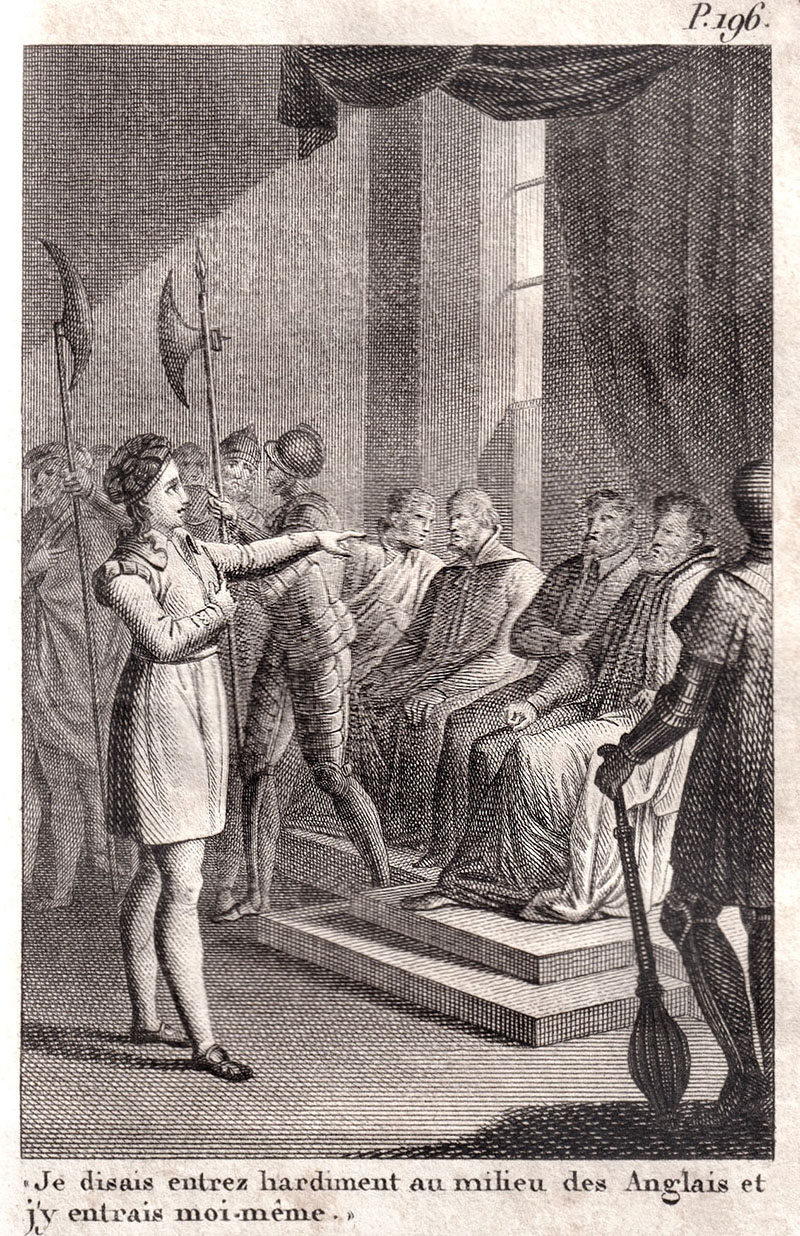
On pense bien qu’elle fut aussi interrogée au sujet de l’épée trouvée, sur ses renseignements, dans l’église de Sainte-Catherine. On désirait beaucoup savoir si c’était cette même épée qui était tombée avec elle au pouvoir des Anglais et des Bourguignons. Mais il paraît que depuis longtemps elle 197n’avait plus cette arme, qui s’était brisée entre ses mains, un jour qu’emportée par son indignation elle en frappait des soldats qu’elle avait surpris dans une action contraire à leur devoir.
— Depuis Lagny, dit l’héroïne, je portais une espée prise sur un Bourguignon, et qui était une bonne espée de guerre, propre à donner de bonnes buffes et de bons torchons (vieux mots français qui signifiaient propres à porter de bons coups).
Elle fut traitée aussi durement pendant le procès, qu’elle l’avait été depuis qu’on la tenait captive. On lui refusait jusqu’à la consolation de remplir ses devoirs de religion. L’appariteur Jean Massieu, qui se distinguait par son humanité de tous ceux qui disposaient de son sort, lui ayant permis, un jour qu’il la conduisait au tribunal, de s’agenouiller et de faire sa prière devant la chapelle du château, en fut vivement réprimandé parle promoteur d’Estivet.
La perte de Jeanne d’Arc était au reste ce qu’on attendait de tous ses juges, et l’on ne souffrait pas qu’ils montrassent pour 198elle le moindre intérêt. Ils avaient été réellement appelés, non à donner leur avis sur elle suivant leur conscience, mais à la condamner sans aucun examen sérieux de sa cause.
— Que te semble de ses réponses ? sera-t-elle arse (brûlée), dit un jour au même Jean Massieu, un prêtre anglais nommé Eustache Turquetil.
— Jusqu’ici, répondit Massieu, je n’ai vu que bien et honneur en elle, et elle me semble une bonne femme : mais je ne sais quelle sera sa fin : Dieu le sait.
Turquetil alla sur-le-champ rapporter cette réponse au comte de Warwick, disant que Massieu n’était pas bon pour le roi Henri VI
. L’appariteur fut mandé dans l’après-dînée chez l’évêque de Beauvais, qui lui reprocha aigrement son discours, et finit par lui dire qu’il se gardast de mesprendre, ou on lui ferait boire une fois plus que de raison
; et il paraît qu’effectivement, pour de simples paroles en faveur de la libératrice d’Orléans, plusieurs personnes furent, pendant qu’on instruisait son procès, cousues dans des sacs et jetées à la rivière.
199Le moment vint enfin de prononcer. Jeanne d’Arc, quoique aucune de ses réponses n’y pût donner lieu, fut déclarée schismatique, hérétique, et abandonnée à d’infâmes pratiques envers le démon ; et il fut décidé, en conséquence, que si elle n’abjurait solennellement, elle serait livrée au bras séculier, et brûlée. Le tribunal ecclésiastique ne pouvait faire davantage pour les Anglais, qui eux-mêmes n’avaient cependant pas trouvé d’autre moyen pour tenter de faire périr leur ennemie, que de la livrer au clergé comme sorcière et hérétique. Au reste, on pouvait penser, d’après le caractère connu de Jeanne d’Arc, qu’elle refuserait d’abjurer.
Effectivement elle résista plusieurs jours, et ce ne fut qu’au dernier moment qu’elle céda. Ce jour-là, qui était le 24 mai 1431, tout était prêt pour le dénouement de cette affreuse tragédie : la sentence de condamnation avait été dressée à l’avance dans la supposition vraisemblable que Jeanne d’Arc persisterait dans son refus ; le bourreau se tenait à peu de distance, avec le charriot 200consacré aux exécutions, et le bûcher était dressé dans le lieu ordinaire.
C’était dans le cimetière de l’abbaye de Saint-Ouen de Rouen, que Jeanne devait être prêchée publiquement et pour la dernière fois. Au milieu avait été élevés, l’un vis-à-vis de l’autre, deux théâtres ou échafauds ; sur l’un se placèrent l’évêque de Beauvais, le vice-inquisiteur, le cardinal d’Angleterre, l’évêque de Noyon, l’évêque de Boulogne, trente-trois assesseurs, et quelques personnes de marque, étrangères au procès. On fit monter Jeanne d’Arc sur le second échafaud. Guillaume Érard ou Evrard, docteur en théologie, chargé de la prêcher, y parut auprès d’elle. Les appariteurs Jean Massieu et Mauger le Parmentier y prirent aussi place à peu de distance de la prisonnière. Celle-ci était revêtue de ses habits d’homme.
Une foule immense remplissait la place, et se pressait autour des échafauds.
Érard fit un discours qui avait en apparence pour objet le salut éternel de la prisonnière et l’instruction du peuple ; mais il 201paraît qu’il s’emporta plusieurs fois dans le courant de ce discours, jusqu’à adresser des injures à Jeanne d’Arc et au roi Charles VII. Jeanne souffrit sans répliquer celles de ces injures qui lui étaient personnelles ; mais l’héroïne repoussa avec indignation les outrages faits à son souverain, qui dans ce moment cependant semblait l’avoir entièrement oubliée et abandonnée. Après un passage dans lequel il accusait le roi de France d’hérésie, pour avoir cru aux paroles de Jeanne d’Arc et avoir accepté son secours, passage qu’il répéta trois fois avec affectation, le prédicateur ayant par une espèce de dépit, adressé les paroles suivantes à Jeanne elle-même : C’est à toi, Jehanne, à qui je parle, et te dis que ton roi est hérétique, scismatique.
Jeanne lui répondit : Parlez de moi, mais ne parlez pas du roi ; il est bon chrétien.
- Et comme il continuait : Par ma foy, sire, révérence gardée ! s’écria-t-elle, car je vous ose bien dire et jurer, sur peine de ma vie, que c’est le plus noble crestien de tous les crestiens, et qui mieulx ayme la Foy et 202l’Église, et n’est point tel que vous dictes.
Par l’ordre du prédicateur et de l’évêque de Beauvais, l’appariteur Massieu lui imposa alors silence.
Cet appariteur eut encore commission de lire à Jeanne, après le discours du docteur Érard, une cédule contenant une formule d’abjuration de la doctrine et des actes contraires à la religion, attribuée à l’infortunée. Érard avait fait précéder la lecture, de ces mots prononcés avec dureté : Tu abjureras, et signeras cette cédule !
La cédule contenait, entre autres choses, l’engagement de ne plus porter, à l’avenir, les armes ni l’habit viril, et de tailler ses cheveux à la manière des femmes, et non pas à celle des hommes. Jeanne répondit, après la lecture :
qu’elle n’entendait point ce que c’était qu’abjurer, et que sur ce elle demandait conseil
. Érard dit alors à l’appariteur Massieu : qu’il la conseillast sur cela
. Massieu, qui, comme je l’ai fait remarquer plus haut à mes lecteurs, voyait Jeanne d’un tout autre œil que ses juges, lui dit, sans s’engager dans des explications inutiles, et voulant 203lui faire comprendre en peu de mots tout le danger de sa situation : que c’était à dire que s’elle alloit à l’encontre d’aucun des ditz articles, elle serait arse (brulée). Mais luy conseilloit qu’elle se rapportast à l’Église universelle se elle devait abjurer les ditz articles, ou non.
Jeanne, conformément à ce conseil, s’écria :
— Je me rapporte à l’Église universelle, si je les dois abjurer, ou non.
— Tu les abjureras présentement, ou tu seras arse ! lui dit Érard.
— J’ai déjà répondu à ce qui concerne la soumission à l’Église, par rapport à mes actions et mes paroles, répliqua Jeanne d’Arc je consens qu’on envoie mes réponses à Rome, et je m’y soumets ; mais j’affirme en mesme temps que je n’ai rien fait que par les ordres de Dieu. Au surplus, j’ajoute qu’aucun de mes faits ni de mes discours ne peut être à la charge de mon Roi, ni d’aucun autre s’il y a quelques reproches à me faire à ce sujet, ils viennent de moi seule, et non d’autre.
Quelle fidélité, quelle grandeur d’âme dans cet instant terrible !
Après cette réponse on ne lui demanda 204plus si elle voulait se soumettre à l’Église, on ne le pouvait pas ; mais si elle voulait révoquer ceux de ses faits et de ses discours qui avaient été condamnés par les ecclésiastiques présents.
— Je m’en rapporte à Dieu et ànotre saint père le pape, répondit Jeanne.
Les deux juges, sans prendre conseil d’aucun assesseur, lui dirent : que cela ne suffisait pas, et que le pape habitait des lieux trop éloignés pour qu’on pust recourir à lui. Les ordinaires, ajoutèrent-ils, sont juges dans leurs diocèses ; ainsi il est nécessaire de vous en rapporter à notre mère la saincte Église, et de tenir tout ce que des clercs et des gens habiles ont dit et décidé de vos discours et de vos actions.
Jeanne d’Arc, beaucoup plus orthodoxe que ses juges, ayant cru ne devoir rien répondre aux trois sommations qui lui furent ensuite faites de se soumettre à cet étrange principe, l’évêque de Beauvais commença à lire sa sentence de condamnation, dans laquelle on dut remarquer avec bien de l’étonnement les mots suivants : De plus, vous avés, d’un esprit obstiné, et avec persévérance, 205refusé expressément, plusieurs fois de vous soumettre à notre saint père le pape et au concile général.
C’était bien là le comble de l’audace et de l’impudence.
Cependant, pendant la lecture même du jugement, on cherchait à obtenir d’elle l’abjuration exigée. Les uns y employaient les menaces, et les autres les prières ; car tous ceux qui entouraient dans ce moment Jeanne d’Arc n’étaient pas ses ennemis, et il paraît qu’il y en avait plus d’un qui désiraient la sauver. Les menaces ne faisaient qu’irriter l’héroïne :
— Tout ce que j’ai fait, s’écria-t-elle en répondant à l’une d’elles, tout ce que je fais, j’ai bien fait et fais bien de le faire.
Mais les prières l’attendrissaient, et ce furent elles qui finirent par l’engager à céder. Loiseleur, l’un des assesseurs, l’exhortait de la manière la plus pressante, à se soumettre, et à consentir surtout à jurer de reprendre pour jamais les habits de son sexe, obligation sur laquelle on appuyait alors principalement, l’intérêt des Anglais, qui conduisaient tout ce procès, étant qu’elle 206renonçât éternellement à porter les armes. Érard, changeant de ton, lui parlait aussi de temps en temps avec une feinte bienveillance : Jehanne, lui disait-il, nous avons tous pitié de toi ! il faut que tu révoques ce que tu as dit, ou que nous t’abandonnions à la justice séculière.
Jehanne, lui criaient à la fois plusieurs personnes mues par un véritable intérêt pour elle, faites ce qu’on vous conseille ; voulez-vous vous faire mourir ?
Jeanne d’Arc commençait à être ébranlée. On la vit bientôt songer à se justifier en quelque sorte d’un des principaux chefs d’accusation, en disant au prédicateur qu’elle avait pris l’habit d’homme, parce qu’ayant à paraître au milieu des hommes d’armes, il était plus sûr et plus convenable qu’elle fût revêtue de cet habit que d’un habit de femme. Elle dit qu’elle n’avait rien fait de mal ; qu’elle croyait les douze articles de foi et les dix préceptes du Décalogue, et elle répéta encore qu’elle s’en référait à la cour de Rome, et voulait croire tout ce que croyait la sainte Église. Érard, 207qui par ce qui se passait en ce moment, se trouvait, ainsi que les juges ecclésiastiques, commis avec le chef suprême de la religion, en étant venu jusqu’à lui promettre que si elle faisait ce qu’on lui conseillait, elle serait délivrée de sa prison, on l’entendit, à demi gagnée, s’écrier d’un accent moins ferme :
— Ah ! vous aurez bien de la peine à me séduire !
À ces mots l’évêque de Beauvais interrompit soudain la lecture de la sentence de condamnation, déjà fort avancée, ce qui excita les murmures d’une partie des Anglais qui assistaient à cette scène terrible. Un docteur anglais, chapelain du cardinal d’Angleterre, poussa même la chose jusqu’à traiter l’évêque de traître et de fauteur de la prisonnière. Pierre Cauchon, naturellement violent, repoussa cette sortie avec beaucoup de hauteur, et plutôt même en guerrier qu’en prélat :
— Vous en avez menti ! cria-t-il au chapelain du cardinal d’Angleterre, car dans une telle cause je ne veux favoriser personne, mais c’est le devoir de ma profession de chercher le 208salut de l’âme et du corps de ladite Jehanne. Vous m’avez injurié, et je ne passerai pas outre que vous ne m’en aiés fait réparation.
Le cardinal d’Angleterre fit cesser cette contestation en réprimandant le chapelain et lui ordonnant de se taire ; mais le coup était porté, et l’évêque de Beauvais, par contradiction, ne désirait plus désormais que des paroles de la prisonnière, seulement assez équivoques pour que, dans le désordre d’un tel moment, il pût feindre de les regarder comme une abjuration. Aussi Jeanne d’Arc ayant répondu aux sollicitations que l’on continuait de lui faire : que cette cédule soit vue par les clercs et l’Église dans les mains desquels je dois être mise ; et s’ils me donnent conseil de la signer et de faire les choses qui me sont dites, je le ferai volontiers
. On se mit à agir, comme si elle consentait purement et simplement à ce qui était exigé d’elle. Érard s’écria :
— Signe maintenaut, autrement tu finiras aujourd’hui tes jours par le feu.
Et Jeanne ayant répliqué à cela, sans y mettre beaucoup d’importance, 209 qu’elle aimait mieux signer qu’être brûlée
, l’évêque de Beauvais demanda au cardinal d’Angleterre ce qu’il devait faire, attendu la soumission de la prisonnière. Le cardinal répondit, ce qu’il ne pouvait se défendre de répondre d’après le cours qu’avait pris l’affaire : que le prélat devait admettre Jeanne à la pénitence
.
Aussitôt Laurent Callot, secrétaire du roi d’Angleterre, tira de sa manche une cédule qu’il présenta à la signature de Jeanne d’Arc. Jeanne dit à Laurent Callot qu’elle ne savait ni lire ni écrire. Callot insista. Jean Massieu, qui veillait sur tous les mouvements de la prisonnière, pour ne pas laisser échapper l’occasion de la sauver, lui donna une plume, en l’engageant à s’en servir comme elle s’en servait ordinairement. On se mit en même temps à lui faire répéter mot à mot les termes de l’abjuration. Jeanne se prêta à cette formalité, mais en souriant, comme si elle n’y attachait aucune importance. Enfin, et continuant toujours à avoir l’air de se moquer, de la plume que lui avait donnée Jean Massieu, 210elle traça un rond en forme de zéro au bas de la cédule. Laurent Callot lui saisit la main, et lui fit faire au bas de cet acte une marque en forme de croix. Jeanne d’Arc ainsi sauvée, on remarqua un mouvement de joie parmi le peuple, ce qui contint les Anglais présents ; quelques-uns cependant lancèrent, dit-on, des pierres aux juges.
L’évêque de Beauvais et le vice-inquisiteur prononcèrent alors une sentence toute différente de la première. Après y avoir fait quelques réflexions générales sur le devoir imposé aux ministres de la religion, de combattre les erreurs et de confondre les faux prophètes, ils y annonçaient à Jeanne : qu’attendu qu’elle revenait enfin, par la grâce de Dieu, au sein de l’Église, avec un cœur contrit et une foi non feinte, ainsi qu’on le croyait ; qu’elle avait révoqué hautement ses erreurs, et publiquement abjuré son hérésie d’une manière conforme aux ordonnances ecclésiastiques, ils la relevaient de l’excommunication qu’elle avait encourue, à la condition qu’elle observerait 211ce qu’on lui prescrirait, et la condamnant modération au surplus, par grâce et par modération, à passer le reste de ses jours en prison, au pain de douleur et à l’eau d’angoisse.
Loiseleur s’approcha de Jeanne d’Arc, et lui dit :
— Jehanne, vous avés fait une bonne journée, si Dieu plaist, et avez saulvé vostre asme.
Jeanne demanda où on allait la conduire, et si elle ne serait pas remise au pouvoir de l’Église, puisque c’était elle qui la condamnait. Comme personne ne prenait la parole pour lui répondre :
— Or çà, entre vous, dit-elle, gens d’Église, menez moy en vos prisons, et que je ne soye plus en la main des Anglais.
Plusieurs docteurs ayant requis l’évêque de Beauvais de faire droit à cette réclamation, qui était d’une justice évidente, il ne jugea cependant pas à propos d’y déférer, et se contenta de dire aux appariteurs, qui attendaient un ordre :
— Menez la où vous l’avés prinse ; et la question étant décidée de cette manière, Jeanne d’Arc fut reconduite au château de Rouen.
Le vice-inquisiteur ne tarda point à l’y 212suivre. Après une courte exhortation de ne point retomber dans les erreurs que l’Église venait de lui pardonner, il lui enjoignit de reprendre les vêtements de son sexe, ainsi qu’on le lui avait ordonné, et qu’elle avait consenti à le faire. Jeanne s’y soumit sans difficulté, ainsi qu’à ne plus porter ses cheveux coupés à la manière des hommes. On lui avait apporté des habits de femme et elle les revêtit en effet. On n’emporta pas ses habits d’homme, mais on les renferma dans un sac qu’on laissa près d’elle. Cette observation est importante, parce qu’elle jette un jour bien grand et bien affreux sur ce qui ne tarda point à arriver, et devint le complément de l’atrocité la plus révoltante qui ait jamais été commise par des hommes.
Jeanne d’Arc avait été, ensuite de cette opération, laissée à la garde de cinq soldats anglais, ainsi qu’il avait été pratiqué dès le moment de son arrivée à Rouen. Trois, pendant la nuit, devaient rester en dedans de la chambre, et deux dehors. Elle estait, dit un peu plus tard un témoin oculaire, 213couchée, ferrée par les jambes de deux paires de fers à chaisne, et attachée moult (très) estroitement d’une chaisne traver sante par les piedz de son lict, tenant à une grosse pièce de boys de longueur de cinq à six piedz, et fermant à clef, par quoy ne pouvoit mouvoir de la place.
Tout cela n’était rien moins que conforme aux promesses que lui avait faites Érard sur l’échafaud, pour obtenir son abjuration. On voit qu’après avoir signé la cédule, elle était traitée comme avant de paraître devant ses juges.
Tout à coup, le dimanche 27 mai, il fut publié que Jeanne d’Arc avait, au mépris de ses promesses expresses et des termes de la cédule qu’elle avait signée repris ses habits d’homme10.
214Il paraît, en rapprochant les différents récits les uns des autres, et en établissant 215entre eux une juste correspondance, que Jeanne d’Arc avait été contrainte à cette 216violation de ses engagements par la perfidie de ses gardiens.
Ceux-ci renouvelèrent d’abord sur elle les tortures infâmes qu’on lui avait fait éprouver dès les premiers instants de sa captivité, et introduisirent même dans sa prison un personnage considérable qui tenta d’aller jusqu’aux dernières violences. Une idée singulière, mais qui naît naturellement du fait, se présente à l’esprit quand on réfléchit à cette circonstance de la vie de Jeanne d’Arc, on se rappelle la prophétie qui, ayant pris créance dans ces temps, disait que la France serait rétablie par une vierge des marches de la Lorraine. Les tentatives de viol dont nous parlons 217en ce moment n’auraient-elles pas eu pour but, de la part des Anglais, de prévenir l’entier accomplissement de cette prophétie, qui était déjà en si bon train ? La superstition est capable de tout, et il n’est rien d’indigne et de bizarre qu’on ne doive attendre d’elle. Envisagées ainsi, ces tentatives de viol recommencées plusieurs fois ont un motif, autrement elles se trouvent transformées en persécutions insignifiantes, et tout-à-fait contraires aux mœurs du temps.
Ce qu’il y a de certain, c’est que d’aussi horribles entreprises ayant échoué par la résistance de Jeanne d’Arc, à laquelle un témoin vit ensuite le visage contusionné et déchiré, on ne songea plus qu’à la faire périr, en se servant pour cela de l’état même où l’avait placée le jugement ecclésiastique qui lui avait conservé la vie.
L’heure à laquelle elle avait coutume de se lever étant venue, le dimanche 27 mai, elle demanda aux Anglais qui la gardaient, de la déferrer. Ceux-ci, avant d’y consentir, s’emparèrent de ses habillements de femme, 218qui étaient sur son lit, et mirent à la place ses habits d’homme, qu’on avait, ainsi que nous l’avons dit plus haut, renfermés dans un sac et laissés dans la chambre. L’ayant ensuite déferrée, ils lui dirent qu’elle était la maîtresse de se lever. Jeanne leur fit observer qu’elle ne pouvait se vêtir des vêtements qu’ils avaient placés sur son lit. Là dessus il s’éleva entre elle et ces misérables une contestation qui dura jusqu’à midi, heure à laquelle Jeanne d’Arc fut obligée de se vêtir des habits d’homme pour aller satisfaire à un besoin pressant ; ce qui se renouvela encore le lendemain, les soldats anglais ne voulant pas lui rendre ses habits de femme.
Ce fut ce lendemain, lundi 28 mai, que l’évêque de Beauvais et le vice-inquisiteur, accompagnés de huit assesseurs, se rendirent à la prison. Ils constatèrent cette infraction à la cédule d’abjuration, comme un acte de la volonté libre de Jeanne d’Arc, quelles que fussent ses protestations à cet égard, et cherchèrent à la rendre encore plus coupable dans ce sens, en lui adressant 219de nouveau, sur les voix célestes dont elle avait prétendu anciennement être assistée, des questions captieuses propres à la faire tomber en contradiction avec la cédule. Ils y réussirent facilement. Jeanne, que dans ce moment personne ne sollicitait plus en faveur de sa propre vie, et qui peut-être avait aussi été trompée sur le contenu de la cédule, s’écria avec force, quand on lui reprocha malignement qu’elle avait, sur l’échafaud, déclaré que c’était faussement qu’elle s’était prétendue assistée d’apparitions et voix divines :
— C’est ce que je ne croiais ni dire ni faire ; je n’ai point entendu révoquer ces apparitions, ni dire que ce n’étaient point les voix de sainte Marguerite qui me parlaient, et tout ce que j’ai fait, ce n’a été que par la crainte du feu : c’est contre la vérité que j’ai révoqué tout ce que j’ai pu révoquer. J’aime mieux faire ma pénitence tout d’un coup, que de souffrir plus longtemps tout ce que je souffre en prison. Au surplus, je n’ai jamais rien dit ni rien fait contre Dieu et contre la foi, quelque chose qu’on m’ait ordonné de révoquer. 220 Je ne comprends pas ce qu’il y avait dans la cédule d’abjuration, et je n’ai rien révoqué que dans la supposition que cette révocation plairait à Dieu. Enfin, si les juges le veulent, je reprendrai l’habit de femme ; mais je ne ferai rien autre chose.
Là-dessus les juges se retirèrent en fermant leur procès-verbal par ces paroles : Ce qu’ayant entendu, nous nous sommes retirés pour procéder ultérieurement.
Le résultat de la délibération qui suivit ce procès-verbal fut que, le surlendemain mercredi 30 mai, dès le matin, le frère Martin Ladvenu eut commission de se rendre auprès de Jeanne d’Arc, pour lui annoncer sa prochaine mort, et l’y disposer.
L’évêque de Beauvais et le vice-inquisiteur ne furent, dans ces derniers moments, comme on le voit, que les agents passifs des Anglais, tandis qu’il auraient dû, pour défendre les droits de l’Église même, constater de quelle part était provenue véritablement l’infraction à la cédule, et exiger le redressement de ce tort. Pierre Cauchon, en particulier, 221n’avait pas longtemps soutenu sa conduite du jour de la prédication ; et, effrayé par les menaces du comte de Warwick et de sa suite, on avait entendu dans ce jour même, qui pouvait encore devenir si glorieux pour lui, un des docteurs qui possédaient toute sa confiance et n’étaient, pour ainsi dire, que ses interprètes, dire aux Anglais :
— N’aiés cure (soyez tranquilles), nous la retrouverons bien.
En sortant de la prison, le lundi 28 mai, l’évêque lui-même dit aux Anglais : Farewell ! farewell !
mot de leur langue qui signifie, tenez-vous en joie. De telles observations expliquent encore l’action étrange d’avoir laissé dans la prison de Jeanne d’Arc ses habits d’homme, après l’en avoir dépouillée, soit que l’on voie dans cette action le dessein de soumettre la prisonnière à une tentation que l’on croyait irrésistible, ou un acte de lâche complaisance pour ceux qui voulaient, un peu plus tard, achever de la perdre.
Quoi qu’il en soit, voici le déplorable récit de l’événement par lequel, ensuite du nouveau reproche fait à Jeanne d’Arc, des 222Anglais compromirent l’honneur de leur pays, et Pierre Cauchon celui du clergé de France.
L’infortunée, en apprenant le motif de la visite du frère Martin Ladvenu, commença par déplorer amèrement son sort. Rappelée bientôt à elle-même par ce ministre du Seigneur, elle ne sembla plus songer qu’à se préparer à paraître devant Dieu. Elle se confessa dévotement, et reçut l’Eucharistie, qu’on lui apporta, après quelques difficultés. L’évêque de Beauvais parut alors devant elle, avec quelques autres personnes.
— Évêque, lui dit Jeanne, je meurs par vous.
— Ha Jehanne ! répondit le coupable prélat, prenez-en patience, vous mourés parce que vous n’avés tenu ce que vous nous aviés promis, et que vous este retournée à vostre premier maléfice.
— Hélas ! répliqua la prisonnière, se vous m’eussiez mise aux prisons de court d’Église, et rendue entre les mains de concierges ecclésiastiques compétens et convenables, cecy ne fust pas advenu : pour quoy je appelle de vous devant Dieu.
Ayant alors aperçu Pierre Morice, qui lui avait 223témoigné de l’intérêt, le jour de la monition :
— Ah, maître Pierre ! s’écria-t-elle ; où serai-je aujourd’hui ?
— N’avez-vous pas bonne espérance au seigneur ? dit Pierre Morice.
Jeanne d’Arc répondit que oui, et que, Dieu aidant, elle serait en paradis.
Le moment fatal arrivé, on la revêtit d’habits de femme, et on la fit monter dans un chariot. Il était alors neuf heures du matin. Le frère Martin Ladvenu, un autre prêtre, nommé le frère Isambard, et l’appariteur Jean Massieu s’y placèrent avec elle. Plus de huit-cents hommes de guerre, armés de haches, de glaives et de lances composaient l’escorte.
Nicolas Loiseleur, dont j’ai déjà parlé, fut saisi d’un tel remords en la voyant dans cet état, qu’il monta sur le chariot, et lui demanda pardon à la vue de tout le monde. Les Anglais le forcèrent de descendre, et ils l’eussent tué sans le comte de Warwick qui ordonna seulement qu’il serait sur-le-champ chassé de la ville.
Elle fut ainsi conduite au vieux marché de Rouen, qui était alors le lieu consacré 224aux exécutions. Elle s’écriait par intervalles, avec douleur : Rouen ! Rouen ! mourray-je cy ?
Trois échafauds avaient été dressés dans la place : sur l’un on voyait les juges ; sur un autre plusieurs prélats, et sur le troisième, le bois destiné au supplice de Jeanne d’Arc. Ce dernier avait été construit en plâtre, ou plutôt en moellons. Les juges séculiers, c’est-à-dire ceux qui avaient seuls droit de prononcer la sentence de mort, le bailli de Rouen et son lieutenant, étaient assis sur l’un des échafauds. Au nombre des prélats spectateurs, on remarquait le cardinal d’Angleterre.
Comme au jour de la monition, une grande multitude remplissait la place.
Ce fut Nicolas Midi, docteur en théologie, qui prêcha la sainte victime. Son sermon fini, il lui adressa ces paroles :
— Jehanne, allés en paix : l’Église ne peut plus vous défendre, et vous laisse en la main séculière.
L’évêque de Beauvais lui répéta à peu près les mêmes mots, rédigés en forme de jugement.
225Ainsi abandonnée par l’Église à la vengeance des ennemis de sa patrie, Jeanne d’Arc demanda qu’on lui donnât une croix. Un Anglais en fit une de bois au bout d’un bâton, et la lui tendit. Jeanne la baisa à plusieurs reprises, et la mit dans son sein, entre sa chair et ses vêtements. Cependant on lui apporta bientôt celle de la paroisse Saint-Sauveur, qu’elle tint embrassée jusqu’au moment de son supplice.
La majorité des spectateurs paraissait attendrie. Quelques-uns des assesseurs même s’enfuirent en donnant publiquement des marques de repentir et d’horreur. Des Anglais crièrent à Jean Massieu, qui l’exhortait en ce moment :
— Comment, prêtre ! nous ferés vous ici diner !
Et ils appelèrent le bourreau, en lui disant de faire son devoir. Deux sergents accoururent pour contraindre Jeanne d’Arc à descendre de l’échafaud sur lequel elle avait d’abord été placée. Elle baisa la croix qu’elle tenait dans ses bras, salua les assistants, et descendit d’elle-même, suivie de frère Martin Ladvenu. Une troupe d’hommes d’armes anglais s’empara alors d’elle, 226tumultuairement, et l’entraîna au supplice avec une sorte de furie : comme nous l’avons vu, au siège d’Orléans et dans tous les autres combats, son premier soin, à elle, était de sauver les Anglais vaincus. Le bailli de Rouen et son lieutenant n’eurent le temps de prononcer aucune sentence contre elle. Ils ne furent pas même consultés. Ainsi traînée à la mort, Jeanne d’Arc invoquait le nom du Tout-puissant, et on l’entendit s’écrier : Ah ! Rouen ! Rouen ! seras-tu ma
dernière demeure ?
Au pied du bûcher, on ceignit sa tête d’une mitre de l’inquisition, sur laquelle étaient écrits les mots suivants : Herétique, relapse, apostate, ydolastre.
Ceux-ci se lisaient sur un long tableau placé devant l’échafaud : Jehanne, qui s’est fait nommer la Pucelle, menteresse, pernicieuse, abuseresse de peuple, divineresse, supersticieuse, blasphemeresse de Dieu, mal créant de la foy de Jhesucrist, vanteresse, ydolastre, cruelle, dissolue, invocateresse de déables, scismatique et hérétique.
227Montée sur l’échafaud qui devait servir au plus épouvantable attentat, on la lia à une attache, et le bourreau mit le feu au bas du bûcher.
Le frère Martin Ladvenu, qui ne l’avait pas encore quittée, était si absorbé par le soin de la préparer à la mort, qu’il ne s’apercevait pas que la flamme le gagnait. Jeanne l’en avertit, le priant en même temps de se placer au bas de l’échafaud, de tenir la croix élevée devant elle, afin qu’elle pût la voir jusqu’au dernier moment, et de continuer son exhortation assez haut pour qu’elle l’entendit. Tandis qu’il s’acquittait avec zèle de ce devoir, l’évêque de Beauvais s’approcha. Jeanne lui adressa les mêmes reproches que dans la prison, lui répétant qu’elle avait été abusée le jour de la monition, et qu’elle croyait n’avoir rien fait à la tête des guerriers français, que par l’ordre de Dieu. Ha, Rouen ! s’écria-t-elle, j’ai grand peur que tu ne ayes à souffrir de ma mort !
Quelques Anglais riaient ; d’autre paraissaient ne voir ce spectacle qu’avec chagrin : Nous sommes perdus, dit, après ce grand 228acte d’iniquité, Jean Tressart, secrétaire du roi d’Angleterre, car une sainte personne a été brûlée.
Le supplice de Jeanne d’Arc fut très long, quelques efforts que fit le bourreau pour l’abréger vu la hauteur de l’échafaud, il ne pouvait facilement atteindre à elle… Elle expira en invoquant avec résignation le nom de Dieu…
Quand elle fut morte, les Anglais firent un moment écarter le feu, afin que chacun pût la voir et la reconnaître. On augmenta ensuite le bûcher, pour qu’il consumât promptement son corps. Après un certain laps de temps accordé à cette opération, qui ne se fit qu’imparfaitement, on jeta, par l’ordre du cardinal d’Angleterre, ses cendres et tout ce qui restait de ses os dans la Seine.
Ainsi périt cruellement et impunément, après une année de la plus dure captivité, une héroïne française, dans un supplice qui fut un outrage à la religion, à la vertu, à l’humanité et au droit des gens, qui, dès ce temps-là, rendait sacrée la personne des guerriers pris les armes à la main. Que fit 229le roi de France pour s’y opposer ou le venger ? Rien sans doute, car l’histoire se tait à cet égard, et elle parlerait s’il y avait quelque chose à dire. Accusons-en l’indolence naturelle au prince, le peu de temps qui sépara la première condamnation de la seconde, et celle-ci de l’exécution. Accusons en encore la barbarie des temps : une imputation de sorcellerie était alors de la plus grande gravité, et personne n’avait assez de véritable religion, de philosophie, ou de courage pour la repousser ouvertement comme une œuvre indigne de la superstition ou de la méchanceté humaine. Redevenu possesseur de la presque totalité de son royaume en 1455, comme l’avait annoncé Jeanne d’Arc, Charles VII n’osa pas, de sa seule autorité, réhabiliter la mémoire de celle à qui il devait véritablement sa couronne. Il fallut qu’un jugement ecclésiastique, autorisé par le souverain pontife, prononçât cette réhabilitation, le 7 juillet 1456. La réhabilitation fut au reste complète, et le jugement ordonna qu’un monument expiatoire 230serait élevé à Rouen, sur le lieu même de l’exécution.
Les Anglais ne gagnèrent réellement rien à la mort de l’héroïne que leurs chefs firent périr aussi misérablement. Le coup décisif leur avait été porté par elle à Orléans et à Reims ; et il avait remis les Français dans le chemin de la victoire. Ils continuèrent d’y marcher glorieusement, quoique n’ayant plus Jeanne d’Arc à leur tête ; et il arriva à leurs ennemis, chargés inutilement d’un crime odieux, ce qui finira toujours par arriver à des étrangers chez une grande nation momentanément humiliée par des revers et des trahisons : ils furent chassés de France, et repoussés jusque sur leur sol, après avoir fait, en argent et en hommes, des pertes immenses.
Fin
Notes
- [1]
Titre original complet :
Vie de Jeanne d’Arc, surnommée la Pucelle d’Orléans ; écrite d’après les manuscrits les plus authentiques de la Bibliothèque du Roi, et dans laquelle on trouve des détails exacts sur la naissance, les premières années, les exploits, la prise, le procès et la fin terrible de cette héroïne ; sur les sièges d’Orléans et de Paris, et sur le couronnement de Charles VII. Ornée de quatre gravures en taille-douce. Par M. H. Lemaire. À Paris, chez Le Prieur, libraire, rue des Mathurins Saint-Jacques, hôtel Cluny, 1818.
- [2]
Équivalences des noms propres dans leur graphie actuelle :
- Baudon de Noielle / Baudouin de Noyelles
- Beaugenci / Beaugency
- Bedfort / Bedford
- Berri / Berry
- Cambray / Cambrai
- Carmoisen (Thudual de) / Kermoysan (Tugdual de)
- Chabanne / Chabannes
- Château-Neuf-sur-Loire / Châteauneuf-sur-Loire
- Checy / Chécy
- Choisi / Choisy
- Crespy en Valois / Crépy-en-Valois
- Culan / Culant
- Dom-Remy / Domrémy
- Falstof / Fastolf
- Gamache / Gamaches
- Gastinois / Gâtinais
- Glacidas / Glasdale
- Guienne / Guyenne
- Isle-de-France / Île-de-France
- Lemaistre / Lemaître
- L’Advenu / Ladvenu
- Lahire / La Hire
- La Trimouille / La Trémoille
- Lebrun des Charmettes / Le Brun de Charmettes
- Leheac / Lohéac
- Lore / Loré
- L’Oyseleur / Loiseleur
- Meun / Meung
- Midy / Midi
- Mont-Piloer / Montépilloy
- Novelonpont / Novelompont
- Rayz / Rais
- Regnaut / Regnault
- Rheims / Reims
- Saint-Laurent-des-Orgerilz / Saint-Laurent-des-Orgerils
- Sainte-Sevère / Sainte-Sévère
- Scalles / Scales
- Suffolck / Suffolk
- [3]
Jeanne d’Arc elle-même est l’historienne que nous suivons dans ce passage de notre livre, ainsi que dans tous ceux où il est question de choses semblables. Voyez, à la Bibliothèque royale, ses interrogatoires.
- [4]
Il était alors question de marier le dauphin Louis, fils de Charles VII, avec la fille du roi d’Écosse, qui alors aurait fait de plus puissants efforts en faveur de la France, qu’il soutenait déjà.
- [5]
Dans cet endroit, comme dans beaucoup d’autres, j’ai affecté de respecter le langage du temps et les propres paroles qui ont été dites dans l’action ; je crois que mes lecteurs ne m’en sauront pas mauvais gré.
- [6]
Sobriquet que l’on donnait alors aux Anglais, à cause d’un de leurs jurons qui est aujourd’hui goddem.
- [7]
L’original de cette lettre existe dans les archives de la chambre des comptes de Lille.
- [8]
Le fossé était double, c’est-à-dire que pour arriver aux remparts, il fallait nécessairement passer deux fossés séparés l’un de l’autre par une langue de terre.
- [9]
Cette armure en fut depuis enlevée par les Anglais. Il n’en resta, au trésor de l’abbaye, que l’épée, soustraite, on ne sait comment, par les moines.
- [10]
Cette cédule était ainsi conçue :
Toute personne qui a erré et mespris en la Foy xhrestienne, et depuis, par la grâce de Dieu, est retournée en lumière de vérité, et à l’union de notre mère saincte Église, se doibt moult bien garder que l’ennemi d’enfer ne le reboute et fasse rencheoir en erreur et en dampnation. Pour ceste cause, je, Jehanne, communément appelée la Pucelle, misérable pecheresse, après que j’ai congneu le las d’erreur auquel je estois tenue, et que, par la grace de Dieu, suis retournée à nostre mère saincte Église, affin que on voye que non pas faintement, mais de bon cueur et de bonne voulenté, suis retournée à icelle je confesse que j’ai tres griesvement pechié, en faigniant mensongeusement avoir eu revelations et apparitions de par Dieu par les anges et saincte Katherine et saincte Marguerite ; en séduisant les ames, en créant follement et legierement ; en faisant superstitieuses divinations ; en blasphemant Dieu, ses saincts et ses sainctes ; en trespassant la loi divine, la Saincte Escripture, les droits canons ; en portant habit dissolu, difforme et deshonneste, contre la décence de nature, et cheveux rongnez en ront en guise d’homme, contre toute honnestelé du sexe de femme ; en portant aussi armeures, par grant présomption, et desirant crueusement (cruellement) effusion de sang humain ; en disant que toutes ces choses j’ay faites par le commandement de Dieu, des anges, et des sainctes dessus dictes, et que en ces choses j’ay bien fait et n’ay point mespris ; en mesprisant Dieu et ses sacrements ; en faisant séditions ; en ydolastrant par adourer maulyais esprits et invocant iceulx. Confesse aussi que j’ai été scismatique, et par plusieurs manières ay erré en la Foy. Lesquelz crimes et erreurs de bon cueur et sans fiction, je, de la grace de Dieu nostre Seigneur, retournée à voie de vérité par la saincte doctrine et par le bon conseil de vous ; et des docteurs et maistres que m’avez envoyés, abjure, deteste, regnie, et du tout y renonce et m’en despars, et sur toutes ces choses devant dictes me soubmectz à la correction, disposition, amendement et totale détermination de nostre mère saincte Église et de vostre bonne justice. Aussi je jure, voue et prometz à monseigneur saint Pierre, prince des Apôtres à nostre saint père le pape de Rome, son vicaire, et à ses successeurs, et à vous messeigneurs, reverend père en Dieu monseigneur l’evesque de Beauvais, et religieuse personne maistre Jehan Lemaistre, vicaire de monseigneur l’inquisiteur de la Foi, comme à mes juges, que jamais, par quelque exhortement ou autre manière, ne retourneray aux erreurs devant dicts, desquelz il a pleu à nostre Seigneur moy oster et delivrer ; mais à tousjours demourray en l’union de nostre mère saincte Église, et à l’obéissance de nostre sainct père le pape de Rome. Et cecy je dis, afferme et jure par Dieu le Tout-Puissant et par ses saincts Evangiles. Et en signe de ce, j’ay signé ceste cédule de mon signe.
Jehanne ✠
Des témoins de l’abjuration de Jeanne d’Arc prétendirent que la cédule qui avait été lue plusieurs fois, avant qu’elle consentît à la signer, n’était que de six ou sept lignes, et que celle-ci fut frauduleusement substituée au moment de la signature.