Dans la presse d'époque
La Jeanne d’Arc de Duprez dans la presse d’époque
Chronologie
Représentation de 1859
Dimanche 30 janvier 1859, matinée musicale dans le théâtre de l’école spéciale de chant de Duprez, en son hôtel de la rue Turgot. Première représentation de son opéra Jeanne d’Arc, qui ne compte alors qu’un acte de trois tableaux, avec déjà Marie Brunet dans le rôle-titre (qui prendra par la suite le nom de Maria Brunetti). Sont présents dans le public les compositeurs et amis de Duprez : Rossini, Meyerbeer, Halévy, Auber, Vieuxtemps.
- Le Messager des théâtres et des arts (3 février 1859)
- Le Monde illustré (5 février 1859)
- Le Charivari (7 février 1859)
- Le Figaro (31 mars 1859)
Représentations de 1860
Dimanche 22 avril 1860, matinée musicale rue Turgot. Deuxième représentation de Jeanne d’Arc : Maria Brunetti, cent-trente exécutants dont Duprez interprétant quelques rôles secondaires (comme celui du bourreau) ainsi qu’une chanson à boire qui sera retirée dans la version définitive.
- La Patrie (23 avril 1860)
- Le Figaro (29 avril 1860)
- Le Ménestrel (6 mai 1860) :
Les retardataires se pressaient dans les salons et couloirs, et beaucoup d’entre eux ont dû se contenter d’assister au spectacle dans le jardin.
Lundi 14 mai 1860, représentation publique du 2e acte de Jeanne d’Arc (le Roi de Bourges) au Théâtre-Lyrique, lors d’un gala de bienfaisance.
- Le Ménestrel (13 mai 1860)
- Le Messager des théâtres et des arts (17 mai 1860)
- Le Ménestrel (20 mai 1860)
Encouragé par la bonne réception de ces représentations, Duprez proposa quelques années plus tard sa Jeanne d’Arc au directeur du Théâtre-Lyrique, qui lui préféra une œuvre de Berlioz ; puis au directeur de l’Opéra, qui venait de commander une Jeanne d’Arc à M. Mermet
. De dépit, il trouva dans les alentours de la gare de Lyon, un local fort laid et mal agencé, décoré du titre de théâtre
, et s’entendit avec le directeur (Souvenir d’un chanteur, chapitre XII).
Représentations de 1865
Début janvier, la presse annonce l’ouverture prochaine du Grand-Théâtre-Parisien fondé par M. Alfred Massue, ancien pensionnaire de l’Odéon
; une salle de 2000 spectateurs, aménagée à l’emplacement d’un hangar servant autrefois de magasin de ferrailles
. Inauguration le 29 mars, par la représentation de la Duchesse de Valbreuse, drame en cinq actes et un prologue de E. Ayasse, Julien Deschamps et Émile Prat, précédé d’un prologue d’ouverture, Entre Lyon et Paris, des mêmes auteurs.
- Le Messager des théâtres et des arts (7 juillet 1864)
- Le Messager des théâtres et des arts (5 janvier 1865)
- L’Opinion nationale (4 mars 1865)
- Le Messager des théâtres et des arts (19 mars 1865)
- Le Figaro (19 mars 1865)
- La Comédie (2 avril 1865) : description très désavantageuse des lieux et de la programmation.
Oh ! alors, il y eut un éclat de rire général, un éclat de rire stupéfiant de deux-mille personnes, suivi de sifflets, de cris, de huées, de vociférations qui firent un charivari indescriptible. C’est ainsi que furent accueillies les cinq filles du directeur ; celui-ci se promenait dans la salle en mordant sa longue moustache ; il était vert.
- Le Jockey (4 avril 1865) :
[Le Théâtre-Parisien] était il y a moins d’un an, une sorte de grand hangar dont M. Millaud était propriétaire. Qu’en ferait-il ? un dock, un hôtel ou un magasin de charbon ? Il était encore indécis quand M. Massue se présenta.
- Le Messager des théâtres et des arts (6 avril 1865) : compte-rendu très-positif du journaliste qui a assisté, dans un théâtre qu’il qualifie de cossu, à la première du mercredi (une grande cohue) ainsi qu’à la représentation de vendredi.
Jeudi 25 mai, première des Gardes forestiers d’Alexandre Dumas, après ses deux conférences des dimanches 7 et 14 mai. L’auteur a loué pour son compte la salle du Grand-Théâtre-Parisien. Succès croissant jusqu’à son retrait en juillet.
- Le Temps (6 mai 1865) :
Dimanche 7 mai, à deux heures, M. Alexandre Dumas inaugurera les Entretiens populaires.
- Le Messager des théâtres et des arts (28 mai 1865)
- Le Temps (12 juin 1865)
- Les Annales politiques et littéraires (28 octobre 1883) : l’écrivain Gabriel Ferry relate les dernières années de la vie de Dumas, et comment celui-ci, toujours à cours d’argent, eut l’idée de faire jouer son drame à Paris ainsi que l’étrange périple qui s’en suivit.
Premiers bruits d’un opéra de Duprez au Grand-Théâtre-Parisien : sont évoqués son Samson ou sa Jeanne d’Arc.
- La Presse théâtrale (22 juin 1865)
- La Semaine musicale (22 juin 1865)
La presse parle du Grand Opéra populaire ; premières annonces sérieuses de la prochaine représentation de Jeanne d’Arc.
Jeudi 20 juillet : dernière des Gardes forestiers. Samedi 22 juillet : représentation d’Hamlet d’Alexandre Dumas (puis le 26 juillet et le 3 août), en attendant la pièce Jean le Cocher.
Samedi 29 juillet : première représentation d’un opéra au Grand-Théâtre-Parisien : le Barbier de Séville ; réussite.
- Le Petit Journal (16 juillet 1865) : article de Méry (l’un des auteurs du livret de Jeanne d’Arc). Il loue le succès obtenu par son ami Dumas (le Théâtre-Parisien
devrait bien se nommer Théâtre-Dumas
) et détaille la genèse du grand-opéra populaire (Un heureux hasard a fait rencontrer chez M. Millaud, M. Massue et notre illustre Duprez
). - La Semaine musicale (20 juillet 1865)
- Le Ménestrel (23 juillet 1865) :
Le Grand Opéra populaire.
- Le Petit Journal (28 juillet 1865)
- Le Courrier artistique (6 août 1865)
Mardi 9 août : première de Jean le Cocher, de Joseph Bouchardy.
15 août : Duprez est fait chevalier de la Légion d’honneur, en même temps qu’Auguste Mermet.
- Le Petit Journal (8 août 1865)
- Le Petit Journal (18 août 1865)
- La Semaine musicale (24 août 1865) : Légion d’honneur.
- Le Petit Journal (26 août 1865)
Début septembre, la presse annonce les répétitions et la prochaine représentation de Jeanne d’Arc pour la fin du mois.
- Le Ménestrel (10 septembre 1865)
- Le Figaro (10 septembre 1865)
- Le Petit Journal (11 septembre 1865) :
Six décorations nouvelles, 150 costumes sont terminés.
- Le Petit Journal (12 septembre 1865) : Article
Les Trois Jeanne d’Arc
de Timothée Trimm, sur les œuvres dramatiques consacrées à l’héroïne (celle de Mermet, celle de Duprez, avec nombre détails, et celle d’une baraque de la foire de Saint-Cloud). - Le Petit Journal (15 septembre 1865)
Fin septembre, les choses se précisent, les dates de premières sont annoncées, Duprez présente lui-même le projet dans la presse.
- Le Figaro (17 septembre 1865) : Lettre de Duprez (datée du 15).
Restait donc le choix d’un grand sujet dramatique. Jeanne d’Arc nous a paru réunir les meilleures conditions. C’est, par excellence, l’héroïne populaire !
- Le Temps (17 septembre 1865)
- La Presse théâtrale (21 septembre 1865)
- Le Petit Journal (23 septembre 1865)
- Le Petit Journal (25 septembre 1865) : Lettre de Duprez (datée du 19) en réponse à l’article de Timothée Trimm ; il évoque le prix des places.
- La Semaine musicale (28 septembre 1865)
Samedi 30 septembre : répétition générale. Succès encourageant. Annonce de la grande première.
- Le Petit Journal (4 octobre 1865) : Article
Le suffrage universel en musique
de Timothée Trimm, qui a assisté à la répétition générale. - Le Ménestrel (8 octobre 1865)
- Le Moniteur universel (8 octobre 1865)
- Le Figaro (10 octobre 1865)
- Le Petit Journal (10 octobre 1865) : annonce de la première pour le mardi 10.
- Le Petit Journal (11 octobre 1865) : report pour le jeudi 12, pour cause d’indisposition du ténor Du Wast.
Jeudi 12 octobre : Première première de Jeanne d’Arc ; la représentation est interrompue au milieu du second acte suite à une extinction de voix de l’interprète principale Mlle Maria Brunetti.
- La Comédie (15 octobre 1865)
- Le Ménestrel (15 octobre 1865)
- Le Journal des débats (15 octobre 1865)
- Le Figaro (15 octobre 1865)
- Le Siècle (17 octobre 1865)
- Le Temps (18 octobre 1865)
- Le Foyer (19 octobre 1865)
- Le Figaro (19 octobre 1865) : billet humoristique d’Albert Wolff.
- Le Monde illustré (21 octobre 1865)
Le Figaro annonce la mort du père de Maria Brunetti ; elle se fera remplacer pour quelques représentations.
- Le Figaro (22 octobre 1865)
- Le Charivari (22 octobre 1865) : Caricatures montrant la lutte entre Duprez et Mermet, tout deux compositeurs d’un opéra Jeanne d’Arc.
Vendredi 20 octobre : premier procès entre Massue et Duprez ; le directeur du théâtre accuse le compositeur d’imprudence pour n’avoir pas prévu de remplaçante. Duprez l’emporte.
- Le Droit (23 octobre 1865)
Mardi 24 octobre : Seconde première de Jeanne d’Arc. Les critiques sont très variées et généralement positives. Si l’œuvre n’est pas considérée comme un chef d’œuvre, l’entreprise est louée.
- La Presse (24 octobre 1865)
- La Patrie (24 octobre 1865)
- Le Foyer (26 octobre 1865) : compte-rendu sommaire en attendant l’analyse complète (celle-ci, publiée le 2 novembre, sera beaucoup moins enthousiaste).
Les artistes, les hommes de lettres, les amateurs les plus éclairés semblaient s’être donné rendez-vous au Grand-Théâtre-Parisien, […] le populaire et aimé Timothée Trimm, le directeur de l’Académie impériale de musique et toute la presse parisienne se trouvaient là. […] Aussi le public, émerveillé, a-t-il applaudi à outrance, redemandé les acteurs et montré une émotion violente à la scène du bûcher.
- La Presse théâtrale (26 octobre 1865) : compte-rendu d’A. Hernette.
La pièce est assurée d’un succès durable à Paris, et nul doute que la province ne l’applaudisse sous peu.
- Le Petit Journal (26 octobre 1865)
Le succès de l’œuvre de MM. Méry et de Duprez a été complet.
- L’Indépendance belge (27 octobre 1865) : longue analyse critique ; avis mitigé.
- Le Journal des débats (27 octobre 1865)
- Le Temps (28 octobre 1865) :
La seconde représentation de Jeanne d’Arc a confirmé le succès de la première.
- La Comédie (29 octobre 1865) : analyse très fouillée de Paul Ferry.
Il y eut alors des acclamations, un enthousiasme, un beau soir. Quatre mille voix exclamèrent le nom célèbre… Et Arnold [le rôle de Duprez dans Guillaume Tell] revint s’incliner comme autrefois, le front radieux, le cœur gonflé, devant cet auditoire qu’il retrouvait, et qui retrouvait encore le maître en lui. Ce fut un beau soir. On aura pour l’œuvre du maestro tard venu des restrictions nécessaires, mais nous ne méconnaîtrons point que le compositeur a vaincu mardi.
- Le Ménestrel (29 octobre 1865) : long article de Gustave Bertrand.
Musique, livret, artistes ont été écoutés avec un intérêt sympathique et soutenu. La partie est donc presque gagnée pour Jeanne d’Arc et pour le compositeur.
- Le Figaro (29 octobre 1865)
- Le Moniteur universel (30 octobre 1865) : long article de Théophile Gautier fils.
Le succès qui s’était ébauché à la précédente tentative s’est affirmé de la façon la plus éclatante.
- Le Siècle (31 octobre 1865) : très longue analyse de Gustave Chadeuil.
Résumons-nous : avec ses chœurs énergiques, malgré ses cabalettes douteuses et ses romances d’amour sans chaleur, la partition de Jeanne d’Arc constitue néanmoins une œuvre estimable. Les qualités et les défauts y figurent en portions égales. Si le sentiment y manque, on y trouve la vigueur comme compensation.
- La Patrie (31 octobre 1865) : M. de Thémines expose sa vision de ce que devrait être un opéra populaire (et qui n’est pas ce qu’il a vu au Grand-Théâtre-Populaire) mais demande l’indulgence pour l’œuvre de Duprez.
Tel ouvrage, en effet, qui eût paru insuffisant s’il était signé d’un des musiciens connus par des opéras joués sur nos premiers théâtres de chant, peut être considéré comme un tour de force venant de l’heureux interprète des œuvres d’autrui et de l’habile professeur de chant.
Il critique le livret :
Le poème n’est qu’une succession de tableaux plus ou moins cousus entre eus — je devrais dire décousus. On eût pu l’intituler : Scènes de la vie de Jeanne d’Arc.
Note. — Or cette démarche est justement celle revendiquée par Duprez (Cf. son autobiographie Souvenirs d’un chanteur).
- Le Temps (31 octobre 1865) : avis négatif de Johannès Weber.
Pourquoi me fatiguer inutilement à chercher des atténuations ? Honneur au courage malheureux ! C’est le jugement le plus indulgent que je puisse porter sur Jeanne d’Arc.
- L’Opinion nationale (31 octobre 1865) : Alexis Azevedo loue des débuts encourageants.
On peut dire, sans exagérer les choses, qu’à dater de ce jour, le grand opéra populaire a été fondé chez nous. […] L’accueil fait à Jeanne d’Arc le soir de la première représentation a été très sympathique, et aux meilleurs endroits, très chaleureux.
- L’Avenir musical (1er novembre 1865) : analyse critique d’Armand Gouzien.
Duprez a été rappelé à la chute du rideau, et le public, qui avait envahi l’immense halle qu’on appelle Grand-Théâtre-Parisien, a consacré par ses applaudissements significatifs la fondation du grand opéra populaire par le plus populaire des chanteurs de Grand-Opéra.
- La Semaine musicale (2 novembre 1865) : compte-rendu de Robert Nuay.
Et maintenant, devons-nous, après le peu de succès de l’opéra de Jeanne d’Arc, désespérer de l’avenir de l’opéra populaire ? Non… Le public est de bon compte ; il a foi dans la réussite de cette entreprise ; il y poussera de toutes ses forces, et le jour où on lui présentera des pièces convenables, il envahira le Grand-Théâtre-Parisien.
- Le Foyer (2 novembre) : compte-rendu critique d’Alphonse Baralle ; très négatif, il ne reconnaît de mérite qu’aux décors.
Le poème est puéril, les situations mauvaises et quelquefois ridicules, la partie musicale est pour ainsi dire nulle.
- Le Grand Journal (5 novembre 1865) : analyse d’Albert Vizentini, l’une des plus dures.
À la soirée bouffonne du douze octobre a succédé la triste représentation du vingt-quatre et nous avons entendu tout au long (hélas !) l’œuvre dont nous avons à rendre compte.
- Le Hanneton (5 novembre 1865)
- Le Ménestrel (5 novembre 1865)
- La Liberté (7 novembre 1865) : analyse de Charles Colin :
S’il y a dans la musique de M. Duprez bien des défauts, il se trouve aussi des qualités réelles. […] Le théâtre d’opéra populaire a donc enfin fait son apparition ; nous ne pouvons lui souhaiter que succès et longévité.
- Le Journal des débats (8 novembre 1865) : compte-rendu de Joseph d’Ortigue.
La pièce a bien marché cette fois, et le compositeur n’a pas, eu à se plaindre de l’accueil fait aux principaux morceaux de son ouvrage. Il y a effectivement dans cette partition des chœurs animés, des endroits pleins de verve, des détails ingénieux, d’heureuses combinaisons de voix et d’instruments ; il y a quelquefois même des passages de récit bien sentis.
- Le Foyer (9 novembre). L’article constate l’
insuccès de Jeanne d’Arc
, mais l’attribue aux défauts de l’œuvre plutôt qu’à l’impossibilité d’un opéra populaire (dont il attribue la paternité du concept à Massue plutôt qu’à Duprez). - La Presse théâtrale (9 novembre 1865), sur les débuts de Félicia Lustani-Mendès, remplaçante de Maria Brunetti.
- Le Monde illustré (11 novembre 1865) : analyse d’Albert de Lasalle.
Ils faut louer [Méry et Édouard Duprez] de ne s’être point écartés de la vérité historique. Gilbert Duprez a été moins heureux dans la traduction musicale.
Lasalle relève les réminiscences des grands maîtres qu’il a chanté :
Il faudrait être un génie singulièrement puissant pour vider sa mémoire de tout ce qu’elle a gardé.
- La Gazette de France (15 novembre 1865) : avis mitigé d’Edmond Bach.
- Le Figaro (16 novembre 1865) : Duprez songerait à monter sa Jeanne d’Arc à Rouen.
- Le Petit Journal (16 novembre 1865)
- Le Monde illustré (18 novembre 1865)
Liste des représentations (les mardi, jeudi et samedi, en alternance avec une pièce de théâtre, le Fils au deux mères) :
- Mardi 24 octobre : (deuxième) première.
- Jeudi 26 octobre : l’Espagnole Félicia Lustani reprend le rôle de Jeanne.
- Samedi 28 octobre
- Mardi 31 octobre
- Jeudi 2 novembre
- Samedi 4 novembre : retour de Maria Brunetti.
- Mardi 7 novembre
- Jeudi 9 novembre
- Samedi 11 novembre
- Mardi 14 novembre
- Jeudi 16 novembre
- Samedi 18 novembre : représentation annulée.
Samedi 18 novembre : annulation de la douzième représentation. Duprez souhaitait retirer son opéra pour le remplacer par une autre pièce, le directeur souhaitait la maintenir. La représentation est annoncée dans les journaux mais le soir-même, ni le compositeur ni les interprètes ne se présentent.
- Le Ménestrel (19 novembre 1865) : retrait de l’opéra
malgré son succès
; en cause l’éloignement du théâtre. - La Presse théâtrale (23 novembre 1865)
- Le Foyer (23 novembre 1865). Alphonse Baralle rejette l’explication du Ménestrel :
Quoi, voilà un succès qui ne fait pas d’argent ? […] L’éloignement n’a été pour rien dans la non-réussite de l’œuvre de M. G. Duprez. Le poème était nul et la partition complètement ennuyeuse et insignifiante.
- La Comédie (26 novembre 1865) :
La douzième représentation était affichée samedi, et un public plus empressé que de coutume était accouru ; mais il se retira après que le commissaire de police eût constaté l’absence des interprètes.
- Le Temps (26 novembre 1865) :
Le directeur du Grand-Théâtre-Parisien se dispose à plaider contre Duprez et Méry. Le fond de la querelle, c’est que les grands et les petits confortables du théâtre se meublaient difficilement pendant les représentations de Jeanne d’Arc.
- Le Charivari (29 novembre 1865)
- Le Temps (1er décembre 1865) :
Malgré le prix relativement élevé des places, les représentations de Jeanne d’Arc n’ont jamais produit plus de cinq ou six cents francs de recettes.
- Le Siècle (4 décembre 1865)
- Le Tintamarre (10 décembre 1865)
Samedi 9 décembre : reprise de Jeanne d’Arc avec Félicia Lustani, après un accord entre Massue et Duprez (M. Duprez a consenti à faire représenter son opéra aux prix ordinaires du drame pour justifier le titre d’opéra populaire
précise le Moniteur universel).
- Le Temps (10 décembre 1865)
- Le Petit Journal (12 décembre 1865)
- La Semaine musicale (14 décembre 1865)
Liste des dernières représentations :
- Samedi 9 décembre : reprise.
- Mardi 12 décembre
- Jeudi 14 décembre
- Samedi 16 décembre
Note. — Dans son autobiographie, Duprez parle de 16 représentations. Compte-t-il la première première ? ou bien a-t-on joué le mardi 19 décembre ? (Nous n’avons pas retrouvé l’annonce de cette représentation.)
16 janvier 1866 : second procès Massue-Duprez. Duprez l’emporte à nouveau. Dans une audience précédente, le Grand-Théâtre-Parisien a été déclaré en faillite.
- Le Droit (20 janvier 1866)
Quelques mois plus tard, le Grand-Théâtre-Parisien est repris par le dramaturge Léon Pournin qui y jouera trois de ses drames : les Nuits de la place Royale, qu’il avait créé au théâtre Beaumarchais en 1862, les Rôdeurs de la Bastille (31 mai) et les Volontaires de Sambre-et-Meuse (15 juin). Son idée d’offrir des rafraîchissements pour attirer le public (bières pour les hommes, saucisses pour les femmes) fut largement raillée par la presse.
- La Comédie (27 mai 1866)
- L’Événement (16 juin 1866)
L’entreprise de Pournin ne passa pas l’été et dès le mois d’août Massue retrouvait son théâtre, munie d’une autorisation temporaire du préfet. Il monta la Jeanne d’Arc de Charles Desnoyer (1847), avec les décors créés pour Duprez et ses trois aînées dans les rôles principaux.
- Le Foyer (9 août 1866)
Octobre 1866 : Tout à fait consolé de l’échec de Jeanne d’Arc, Duprez s’est tourné depuis quelque temps du côté de la musique sacrée.
- Le Ménestrel (14 octobre 1866)
Articles de presse
Le Messager des théâtres et des arts 3 février 1859
Compte-rendu de E. Langlois.
Lien : Retronews
Concert. — Soirée de G. Duprez, — Exercices dramatiques. — Jeanne d’Arc, grand opéra inédit en un acte et trois tableaux.
Dimanche, nous avons assisté à une séance vocale et dramatique extrêmement intéressante. M. Duprez avait convoqué dans son hôtel de la rue Turgot une réunion d’artistes et d’amis pour faire entendre les élèves de l’École spéciale du chant qu’il a fondée ; la foule était grande, et les noms les plus illustres s’y faisaient remarquer. Rossini, Meyerbeer, Auber, Halévy, Vieuxtemps, et beaucoup d’autres, avaient tenu à honneur de répondre au gracieux appel du célèbre professeur. L’attente générale n’a pas été trompée.
Dans une première partie, modestement intitulée Exercice vocal, nous avons applaudi avec la salle toute entière, non pas des élèves, mais des artistes déjà d’une grande valeur. Mlles Battu, Monrose et Marimon ont chanté avec le plus grand succès les airs de la Sémiramide, de la Norma et des Diamants de la Couronne ; Mlle Raissac, avec une voix trop émue peut-être, mais avec un profond sentiment, a fait entendre l’air de la Magicienne : Je vais au cloître solitaire ; enfin M. Salviani, un transfuge du temple d’Esculape, à ce qu’on assure, a obtenu le plus légitime triomphe dans le fameux air d’Othello : Ah ! si per voi gia sento. La voix de M. Salviani est d’une grande étendue et d’une remarquable ampleur ; son articulation est nette ; sa prononciation est excellente, et nous ne doutons pas que nous n’ayons avant peu l’occasion de l’applaudir sur une de nos grandes scènes lyriques.
La seconde partie, Exercice dramatique, se composait de Jeanne d’Arc, grand-opéra inédit en un acte et en trois tableaux, dont M. G. Duprez a composé la musique. Il y a là deux finales, ceux des second et troisième tableaux, qui ne dépareraient aucun des grands ouvrages de nos maîtres. L’agitato, Je crois en toi, le Chant de guerre de Dunois, le duo entre Charles VII et Jeanne, sont aussi de très-heureuses inspirations, mais le cri de la malheureuse Jeanne : Charles, à mon secours ! est peut-être le passage qui a le plus vivement ému l’auditoire. C’est un véritable cri du cœur.
Mlle Marie Brunet, chargée du rôle difficile de l’héroïne, y a déployé des qualités vraiment exceptionnelles. Sentiment dramatique, grâce juvénile, énergie inspirée, simplicité d’enfant, elle a eu tour à tour tous les accents, et communiqué au public toutes les émotions. Lorsque, sous la direction du maître, Mlle Marie Brunet aura quelque peu adouci le mordant de sa voix ou modéré les élans qui l’entraînent parfois un peu loin, nous sommes convaincus que le plus bel avenir s’ouvrira pour elle.
Enfin, la séance s’est terminée par un concert dans lequel Mme Nantier-Didiée a dit avec une verve incomparable deux chansons espagnoles, la Perla de Aragon et Coricoco ; Mme Van-den-Heuvel a chanté la Sicilienne des Vêpres, et y a perlé un trille qui a soulevé l’enthousiasme général ; puis les deux grandes artistes auxquelles s’est jointe Mlle Battu, remplaçant Mme M. Carvalho absente, ont fait entendre le trio bouffe Del Matrimonio segreto avec un ensemble merveilleux. Mlle Battu s’y est fait très-justement applaudir auprès de ses célèbres émules ; c’est une si bonne chose que la complaisance réunie au talent !
Lorsque nous sommes sortis, il faisait un temps horrible ; mais que n’oublierait-on pas pour assister à de pareilles séances dont la grâce parfaite augmente encore le prix ?
Le Monde illustré 5 février 1859
Compte-rendu du critique Hippolyte Lucas (1807-1878).
Lien : Gallica
Le Conservatoire de Duprez.
On sait que Duprez habite un délicieux hôtel de la rue Turgot, et qu’il y a fait construire un élégant théâtre où il initie des élèves de choix à cette grande méthode de chant qui a déjà mis au premier rang de nos cantatrices Mme Duprez-Van-den-Heuvel, Mme Miolan-Carvalho, et qui a donné à la scène de Madrid Mlle Leheman, au Théâtre-Lyrique, Mlle Marimon, M. Ballanqué. Duprez, après avoir été l’empereur des ténors, occupe ainsi utilement les loisirs que lui a fait son abdication, en se livrant de plus, avec beaucoup de succès, à la composition musicale. Il ne s’est pas retiré, comme Dioclétien à Salone, pour faire croître des légumes, ni, comme Charles-Quint dans le couvent des moines de Saint-Just, pour s’abandonner à des instincts gourmands ; il ne se passe pas de jours que Duprez ne rende quelque service à l’art dont il a été un si éloquent et si savant interprète, qu’on prétendait, lors de ses débuts, qu’un moine italien l’avait gratifié de son fameux ut de poitrine à l’aide de la magie.
Il nous a été donné de pénétrer dans le sanctuaire, et d’assister à quelques-uns des exercices de Duprez, et nous avons été émerveillé, c’est le mot, des dispositions de plusieurs de ses élèves, destinées, sans contredit, aux plus beaux triomphes de l’Académie impériale de musique ou de l’Opéra-Comique.
Nous citerons tout d’abord Mlle Monrose, que l’on dit récemment engagée à ce dernier théâtre. Mlle Monrose, petite-fille du célèbre Monrose, l’ancien comique du Théâtre-Français, est une très-belle personne douée d’une voix étendue et bien accentuée, et dont les débuts feront, nous n’en doutons pas, une grande sensation. Elle portera dignement ce nom, que le théâtre a déjà illustré. Nous citerons aussi Mlle Battu, la fille du second chef d’orchestre de l’Opéra, et la sœur d’un auteur dramatique distingué, dont la perte a été bien regrettée. La voix facile et légère de Mlle Monrose est du timbre le plus agréable ; elle promet d’être et sera, tôt ou tard, la fortune d’un théâtre. Ces deux élèves seront à coup sûr, des artistes de premier ordre, ainsi que Mme Caroline Duprez et Mme Miolan.
Nous avons entendu Mlle Battu chanter le grand air de Jéliotte, opéra du maestro, véritable bijou. Mlle Battu a dit cet air de la façon la plus brillante, et provoqué les plus vifs applaudissements de la part des auditeurs et du maestro lui-même, enchanté d’une si excellente exécutrice. Ce petit opéra de Jéliotte est un tableau à la Watteau, une fête galante où le frère de Duprez, qui est poète, a fait passer un coin enrubanné et poudré du dix-huitième siècle. On en entendra certainement parler un jour.
Après cette scène d’opéra comique, nous avons vu passer sous nos yeux toute la cour de Charles VII. Un opéra de Jeanne d’Arc, composé aussi pour les paroles par M. Édouard Duprez, et pour la musique par le maestro, opéra d’un grand et beau caractère, nous a révélé un talent très-dramatique et très-puissant, chez Mlle Brunet, qui est restée quelque temps comme endormie au Théâtre-Lyrique, et qui s’est réveillée tout d’un coup comme si elle avait été touchée par le rameau de la Belle au bois dormant, ou comme si elle avait rencontré le fameux moine italien.
Enfin, pour terminer nos indiscrétions, car nous avons bien peur d’en commettre, une jeune et intelligente actrice du Théâtre Lyrique, et à qui le théâtre n’offre pas assez d’occasions de témoigner de ses études et de l’amour de son art, Mlle Marimon a paru sous le costume du Chérubin de Mozart, et chanté la romance à la comtesse avec une grâce parfaite. On dit que Mlle Marimon ira, pour se tenir en haleine, chanter à Bade un opéra de M. Gounod. M. Bénazet est un fin connaisseur, il aime à servir des talents nouveaux à ses habitués un peu blasés sur les grandes renommées. Tels sont les élèves de Duprez, y compris son fils, jeune ténor qui marche dignement sur les traces de son père, et qui chante : Il mio tesoro d’une façon ravissante, tels sont les élèves dont nous avons pu apprécier les qualités éminentes et qui nous permettent d’appeler l’école du maestro un véritable conservatoire.
Mais ce qui nous a surtout frappé, ce n’est pas que Duprez enseigne si bien un art qu’il a si bien possédé, c’est le mérite dont il fait preuve comme compositeur. On a des préjugés en France, et l’on ne veut pas en général qu’un homme qui a réussi dans un art se fasse une réputation dans un autre. Nous pouvons certifier que toutes ces préventions tomberont du jour où Duprez aura fait jouer ou son Samson, ou sa Jeanne d’Arc, ou le joli opéra de Jéliotte ; lequel Jéliotte, si je ne me trompe, excellent chanteur lui-même, a pris place parmi les compositeurs français. Nous faisons des vœux pour que le public soit admis à la connaissance de ces œuvres musicales, connues jusqu à ce jour seulement d’un petit nombre d’amateurs, et nous prions Duprez de nous pardonner d’avoir trahi le secret de son exercices. Les journalistes n’en font jamais d’autres, et quand on désire qu’un secret soit gardé il ne faut pus le leur confier.
Le Charivari 7 février 1859
Compte-rendu de Clément Caraguel.
Lien : Retronews
L’école de chant de Duprez
Première séance vocale et dramatique. — Dimanche dernier a eu lieu la première séance vocale et dramatique de l’école de chant fondée par Duprez. Retiré de la scène, l’illustre chanteur n’a pas pour cela renoncé à l’art qu’il aime d’une véritable passion, et l’école qu’il a ouverte chez lui, rue Turgot, est un conservatoire libre qui rivalise avec le conservatoire officiel.
La matinée de dimanche a été très brillante. On a applaudi dans la première partie Mlle Monrose et Mlle Battu qui ont chanté, l’une, le fameux Casta Diva, l’autre, un air de Sémiramide d’une manière tout à fait magistrale. Ce ne sont plus deux élèves mais déjà deux cantatrices tout à fait hors ligne. Mlle Marimon a chanté un air des Diamants de telle façon qu’il y avait des gens qui croyaient entendre Mme Cabel.
La seconde partie du programme se composait de Jeanne d’Arc, opéra en trois tableaux, musique du maître de la maison. Les chœurs sont les morceaux les plus saillants de cette partition, qui a du reste produit beaucoup d’effet et a été supérieurement exécutée. Le rôle de Jeanne d’Arc était chanté par Mlle Brunet, une toute jeune fille qui a vraiment le feu sacré. Duprez dirigeait lui-même l’exécution de son opéra et communiquait à tout le monde le zèle et l’ardeur dont il était animé. Il est impossible de trouver un homme plus sincèrement enthousiaste de son art, et l’on s’explique en le voyant à l’œuvre l’influence qu’il exerce sur ses élèves. Comme auteur et comme professeur, son succès a été très grand.
Nous ne parlerons que pour mémoire de la troisième partie du concert dans laquelle on a entendu non plus de simples élèves, mais des étoiles ; du chant, Mmes Nantier-Didiée, Carvalho, Ugalde, Van-den-Heuvel, c’était le bouquet. Là-dessus on s’est séparé par un temps affreux : des torrents de pluie après des torrents d’harmonie.
Meyerbeer et Rossini assistaient à cette séance : le premier un peu mélancolique comme d’habitude ; le second vif et souriant comme toujours, avec cette physionomie mobile et spirituelle qu’on lui connaît. Il était sans cesse en mouvement, et chaque fois qu’il se levait du canapé où il était assis, il semblait mettre une sorte de coquetterie à s’appuyer sur les bras jeunes et amis qui se tendaient vers lui avec empressement. Rossini est redevenu tout à fait à la mode ; il fait des bons mots et on lui en prête encore davantage : c’est le Talleyrand de la musique. Dans cette journée, on a colporté des mots de Rossini fraîchement éclos, en assez grande quantité pour remplir un almanach. Deux ou trois seulement dans le nombre étaient dignes de figurer dans Guillaume Tell ; il faut tenir le reste pour apocryphe. Cette première matinée, qui a été très brillante, fera impatiemment attendre les autres. Un vif intérêt s’attache à cette excellente école qui a déjà doté nos théâtres lyriques d’élèves dignes du maître.
Le Figaro 31 mars 1859
Extrait des Échos de Paris, de Jean Rousseau.
Lien : Retronews
À l’Opéra-Comique :
Un acteur. — Est-ce vrai que Duprez a fait un opéra sur Jeanne d’Arc ?
Berthelier. — Qu’est-ce qu’il y a d’étonnant ? Vous concevez que ça doit inspirer forcément un musicien, la bergère de Dorémy.
La Patrie 23 avril 1860
Extrait de la Revue musicale de M. Franck-Marie, en feuilleton.
Lien : Retronews
Dimanche dernier ; Duprez a donné une grande matinée musicale dans la jolie salle qu’il a fait construire dans son hôtel de la rue Turgot. Un public nombreux, et choisi parmi les notabilités de la presse et des arts, avait été convié à entendre exécuter un poème lyrique du maître, intitulé : Jeanne d’Arc.
Les rôles étaient distribués aux élèves de l’école spéciale fondée par lui ; quarante-cinq membres de la société chorale de M. Édouard Baptiste chantaient les chœurs ; l’orchestre, composé de trente musiciens, était dirigé par M. Maton, professeur et accompagnateur attaché à l’école. En tout, il y avait cent-trente exécutants environ dans cette petite salle d’amateurs, qui ce jour-là, par le luxe de la mise en scène et le choix du personnel, pouvait rivaliser avec une scène privilégiée.
La partition de Jeanne d’Arc ne manque pas de mérite. Plusieurs chœurs sont très beaux, et notamment celui qui forme le final du troisième acte. Les récitatifs où le célèbre ténor a retrouvé malgré lui des réminiscences de ses créations passées, ont de l’élévation, et quelque chose de cette largeur, de cette puissance de style, qui de son chant a passé dans sa manière d’écrire.
Duprez a joué parmi ses élèves avec une bonhomie charmante, une simplicité de commençant. Qui eût reconnu en lui l’Arnold qui a passionné tout Paris. On l’a retrouvé un moment dans une jolie chanson à boire, d’une coupe très originale, d’un rythme très animé. Duprez n’a presque pas chanté autre chose ; il cédait sa place à ses élèves. Son but était de les stimuler en leur donnant un exemple, et non de les décourager en prolongeant une comparaison écrasante.
Parmi les exécutants, nous avons remarqué un jeune homme appelé Lefranc, chargé du rôle de Charles VII. Sa voix est très belle, ou du moins pourra le devenir par les soins de son professeur. C’est encore un organe inculte, âpre, inégal, une sotte de diamant brute qui, taillé par la main d’un lapidaire et poli avec soin, peut refléter la plus pure lumière. M. Lefranc donne les la, les si, avec une prodigieuse facilité, et donnera l’ut dièse comme Tamberlick. La couleur de sa voix a quelque analogie avec celle de ce chanteur. Qu’il marche sur ses traces ; il le peut. N’a-t-il pas Duprez pour guide ?
Nous devons des éloges à M. Raynal, qu’on a vu dans plusieurs rôles déjà au Théâtre-Lyrique. Cet artiste a beaucoup de chaleur, de zèle, de conviction, don précieux ; avec la foi, tout est possible dans les arts. Si une observation, qui ressemble à un blâme, n’est pas déplacée à propos d’un exercice d’élèves, nous dirons à M. Raynal de se modérer un peu plus, ou plutôt d’être simple, d’éviter cette emphase à laquelle est portée la jeunesse et qui est l’exagération d’une qualité : l’excès de sentiment. Il est plus facile de modérer la vivacité de ses impressions que de s’émouvoir quand la nature vous a refusé la sensibilité.
Mlles Battu et Monrose, ces deux étoiles qui brillent maintenant d’un si doux éclat au ciel de l’art, chantaient (pour parler comme le libretto) deux voix du ciel. Cette qualification leur était bien due. Les sons purs, argentins des deux jeunes virtuoses avaient en effet quelque chose d’angélique.
Mlle Brunet, autre élève de Duprez, s’est acquittée avec distinction du rôle difficile de Jeanne d’Arc. Cette artiste fait partie actuellement du personnel du Grand-Opéra. Le programme distribué à l’entrée de la salle nous apprend, en outre, qu’elle est attachée comme prima donna assoluta au théâtre de la Reine, à Londres. Des titres aussi sérieux ne l’empêchent pas de continuer les leçons du maître, et de se placer sans amour-propre au rang de ses élèves. Aucune autre ne lui doit autant qu’elle. Quelque opinion qu’on puisse avoir du talent de cette jeune fille, il est impossible de ne pas être frappé des progrès qu’elle a faits depuis son premier début, c’est-à-dire depuis qu’elle travaille avec Duprez.
Dans la Reine Topaze, elle n’avait que quelques mots à dire, et comment les disait-elle ? Avec une voix aigrelette, mal posée, faible jusqu’à l’insuffisance. Il y a quelques semaines, elle chantait le rôle de Valentine des Huguenots au Grand-Opéra. C’est là un résultat qu’on ne peut méconnaître et qui fait le plus grand honneur à Duprez, Mlles Marie Battu et Monrose ont été plus loin que Mlle Brunet ; les progrès de celle-ci cependant prouvent davantage. Tout est relatif : transformer une voix, l’assouplir, la fortifier par des exercices, prudemment gradués ; développer et grandir les facultés restreintes d’une organisation peu douée, sont des faits qui prouvent plus en faveur du talent de professeur de M. Duprez que tout ce que nous pourrions dire.
Les faits sont concluants. Nous n’ajouterons rien à ceux que nous venons de constater, et qui parlent assez d’eux-mêmes.
Le Figaro 29 avril 1860
Extrait de la chronique À travers les théâtres, de Georges Davidson.
Lien : Retronews
L’empereur des ténors, le roi du récitatif, le protecteur de la Confédération des ut dièses, Gilbert Duprez a, comme on sait, fait construire un théâtre dans ses Tuileries de la rue Turgot. L’autre dimanche, on y a chanté un grand opéra de sa composition : Jeanne d’Arc.
Les interprètes principaux étaient : Mlle Marie Brunet, Mlle Eugénie Monrose de l’Opéra-Comique, Mlle Marie Battu, MM. Ballanqué et Raynal du Théâtre-Lyrique, M. Duprez fils, enfin M. Duprez dans quatre rôles. Le tout au piano.
Dans son exil, Dioclétien plantait des laitues ; dans sa retraite, Charles-Quint remontait des horloges ; depuis son abdication, Duprez compose des opéras. Ce dernier délassement vaut bien les autres, d’autant plus que, sans œufs durs, les laitues sont bien peu de chose.
Le Ménestrel 6 mai 1860
Extrait de la Semaine théâtrale, de Jules Lovy.
Lien : Retronews
De l’Opéra à l’École-Duprez, et par plus d’une raison, il n’est qu’un pas, qu’on nous permette donc d’y transporter notre semaine théâtrale. Nous assisterons à la seconde audition de Jeanne d’Arc, le nouvel opéra de Duprez, qui avait attiré une foule considérable. Les premiers arrivés ont pu seuls trouver place dans la jolie salle de l’illustre professeur ; les retardataires se pressaient dans les salons et couloirs, et beaucoup d’entre eux ont dû se contenter d’assister au spectacle dans le jardin. Comme nous sommes du nombre de ceux qui ont peu vu, nous parlerons surtout de ce que nous avons entendu : une musique colorée, originale, des chœurs d’une grande puissance, exécutés par la société Batiste avec un ensemble et un brio à faire envie à nos premières scènes lyriques.
Parmi les solistes, citons en première ligne Mlle Marie Brunet pour qui a été écrit le rôle de Jeanne. Pleine de grâces et de poésie, — nous a-t-on dit, — touchante et pathétique, énergique et inspirée, Mlle Brunet s’est faite l’incarnation vivante de l’immortelle vierge de Domrémy : la terrible scène du martyre a été rendue avec une grande vérité.
Raynal, du Théâtre-Lyrique, a fait du beau rôle de Lionel une très-remarquable création ; Ballanqué, son camarade, a donné au rôle ingrat de Jean de Luxembourg un cachet d’originalité, et comme chanteur il s’est fait applaudir dans un fort beau duo avec Raynal. Nous ne pouvons analyser chacun des morceaux de cette œuvre. Presque tous ont été vivement applaudis.
Un acte, entre autres, a produit un effet immense, c’est celui intitulé le Roi de Bourges. Il forme à lui seul un drame complet, plein d’intérêt, d’action, de mouvement ; c’est une splendide page musicale que le public sera bientôt appelé à juger, car nous apprenons à l’instant que le Roi de Bourges fera partie du riche programme de la représentation qui va être donnée au bénéfice de Mme Ugalde.
C’est dans cet acte que s’est fait entendre ce ténor, inconnu il y a quatre mois, et déjà célèbre quoi qu’il n’ait encore chanté qu’à la classe de son professeur. Lefranc est le nom de celui que nous avons surnommé le Tamberlick français. Il représente, dans Jeanne d’Arc, le roi Charles VII ; il le joue avec noblesse, aisance et distinction, et cet artiste improvisé compte à peine quatre mois d’étude. Dans un andante et dans un important finale, il fait éclater des ut dièse d’une formidable puissance.
Et maintenant que l’œuvre de Duprez va enfin paraître devant le vrai public, — le public qui paye et qui juge en dernier ressort, — nous attendrons le résultat de cette épreuve décisive pour joindre nos éloges à ceux qu’est en droit d’espérer l’artiste courageux et plein de foi, que rien n’arrête, qui lutte incessamment et qui s’écriait encore l’autre jour, en s’adressant à ses auditeurs : Anch’ io son pittore !
Le Ménestrel 13 mai 1860
Lien : Retronews
Voici le programme de la représentation extraordinaire organisée par Mme Ugalde, au bénéfice d’un conscrit, pour demain lundi, au Théâtre-Lyrique :
- 3e acte de Maria Stuarda. Mme Ristori remplira le rôle de Maria Stuarda ; Mme Sontoni celui d’Elisabetta.
- 4e acte d’Orphée de Gluck. Mme Pauline-Viardot remplira le rôle d’Orphée ; Mlle Marie Sax celui d’Eurydice.
- 1er acte du Toréador d’Ad. Adam. Mme Ugalde remplira le rôle de Caroline ; M. Battaille celui de Don Belflor ; M. Tramant celui de Tracolin.
- 2e acte de Jeanne d’Arc de G. Duprez, joué par les élèves de son école.
- Air et duo du Philtre d’Auber, chantés par M. Levasseur et Mme Charles Ponchard.
- Complainte de Gil Blas, chantée par Mme Ugalde.
- Chants populaires par MM. Lionnet frères.
- Les Voitures versées, opéra en un acte de Boieldieu. Mme Ugalde remplira le rôle d’Élise ; M. Bussine celui de Dormeuil ; Riquier, M. de Florville ; M. Potel, Arnaud ; Mme Duclos, Mme de Melval.
- Couplets du Chevrier du Val d’Andore, chantés par M. Battaille.
- Ave Maria de Ch. Gounod sur le prélude de Bach, chanté par Mme Ugalde, avec orgue tenu par M. Ch. Gounod, piano par M. V. Massé, et violon par le jeune Sarrasate.
Le Messager des théâtres et des arts 17 mai 1860
Article de Jules Ruelle.
Lien : Retronews
Théâtre-Lyrique. — Beaucoup d’artistes distingués ont rivalisé de zèle, lundi dernier ; il s’agissait d’une bonne œuvre : Bussine a chanté les Voitures versées ; — Levasseur, le duo du Philtre avec Mme Ponchard ; — Mme Viardot, le 4e acte d’Orphée avec Mlle Sax ; — enfin MM. Lionnet, Daubel et Larasate ont concouru généreusement au programme. Mme Ristori devait aussi le faire, mais une indisposition subite l’a retenue et le chant a remplacé le troisième acte de Maria Stuarda.
Dire que la soirée a été entièrement agréable est au-dessus de nos forces ! d’abord ces messieurs du parterre (bataillon du centre) ont été plus fatigants que jamais : c’était un vacarme monstrueux ! — Pour la circonstance, M. Duprez a exhibé le second acte de sa Jeanne d’Arc. M. Duprez est une des plus grandes illustrations de notre époque ; après une carrière théâtrale aussi magnifiquement remplie que la sienne, il s’est voué au professorat avec ce zèle infatigable et cette haute intelligence qu’on lui connaît ; nos principales scènes applaudissent ses élèves ! L’art lui doit beaucoup et lui devra toujours, car il l’a perfectionné et en a fait la pensée unique de sa vie ! Ne serait-il pas téméraire de lui voir exposer un glorieux passé, pour une mince satisfaction d’amour-propre dont sa renommée universelle n’a que faire ?
Honneur à Mme Ugalde ! Dans cette représentation, organisée par elle du reste, elle s’est prodiguée de bon cœur et nul ne s’en est plaint. Le premier acte du Toréador, qu’elle a chanté avec Battaille et Fromant, a eu un succès fou. Battaille, qui est toujours d’un comique spirituel et désopilant dans Don Belflor, a été applaudi à trois reprises après son air. Fromant a fort bien chanté sa romance ; et le trio : Ah ! vous dirai-je maman ? a été enlevé brillamment. Cet acte, et le quatrième d’Orphée ont eu les honneurs.
Total : salle comble ! là, surtout, était le but, et nous espérons que maintenant l’affiche va appartenir à Fidelio et à Gil-Blas ? Ces deux ouvrages, le premier surtout, doivent terminer la campagne. Dans quelques jours seulement on pourra se rendre compte du l’effet produit par Fidelio, car cette partition est de celles qu’il faut entendre plusieurs fois ; et que le public ne s’y trompe pas, il est certain que chaque nouvelle audition apportera des impressions meilleures ; qui en est plus digne que l’œuvre de Beethoven ?
Le Ménestrel 20 mai 1860
Extrait de la Semaine théâtrale, de Jules Lovy.
Lien : Retronews
Les représentations extraordinaires ont eu les honneurs de la semaine. Hier soir c’était l’Opéra avec son festival au bénéfice de la caisse des secours, festival dont nous avons publié le gigantesque programme.
Quelques jours avant, Mme Ugalde avait organisé, au bénéfice d’un jeune conscrit, une soirée exceptionnelle au Théâtre-Lyrique. Nous en avons également donné le formidable menu : Mme Ugalde s’est multipliée, passant du grave au plaisant avec un égal succès. On lui a redemandé l’Ave Maria de Gounod, dans lequel s’est produit le magique archet du jeune Sarrasate. On lui aurait redemandé le premier acte du Toréador si le programme l’avait permis ; mais, malgré l’absence forcée de Mme Ristori, cette soirée ne s’est terminée que le lendemain. Il est vrai qu’il y avait de larges compensations : MM. Levasseur, Battaille, Bussine, Fromant, les frères Lionnet, D’Aubel, Mmes Viardot, Sax, Ponchard, etc., etc., sans compter la Jeanne d’Arc de Duprez. Les Voitures versées seules, comme la recette, ont laissé à désirer.
Le Messager des théâtres et des arts 7 juillet 1864
Article de Louis-Félix Savard.
Lien : Retronews
Voici une nouvelle que l’on nous communique comme très-officielle : il s’agit de ce Grand-Théâtre-Parisien de la rue de Lyon dont on a tant parlé dans ces derniers temps, et sur le compte duquel jusqu’ici l’on ne paraissait pas savoir grand-chose. Les renseignements que nous avons pris et dont on nous a garanti l’exactitude, vont enfin, nous l’espérons, jeter un peu de jour dans cette affaire.
M. Alphonse Millaud, l’heureux fondateur du Petit Journal, a cédé, par acte passé le 24 juin devant Me Delaporte, la location de son théâtre à M. Alfred Massue, et n’en reste pas moins intéressé dans cette entreprise.
M. Massue est un homme très-versé dans l’Administration théâtrale, dont il s’occupe indirectement depuis vingt ans : il a même fait partie de la troupe de l’Odéon pendant la direction de notre cher Bocage. Frappé de la justesse de ses idées et de ses observations, M. Millaud, avec ce tact qui fait sa force, les a acceptées, et l’affaire maintenant est en train.
Le Théâtre Parisien est situé rue de Lyon, n° 12. Le gros œuvre est fait ; les aménagements intérieurs seront prêts dans le plus bref délai. Le terrain a 100 mètres de profondeurs sur 18 mètres de largeur. La décoration de la salle sera élégante, mais surtout sévère. Il y aura 3,000 places, toutes à très-bon marché.
On y jouera tous les genres, drame, vaudeville, opérette, pantomime.
La fantaisie y aura également ses entrées, et rien en somme ne sera négligé pour faire de cet établissement un véritable théâtre populaire.
Le Messager des théâtres et des arts 5 janvier 1865
Article de Jules Ruelle.
Lien : Retronews
On parle beaucoup en ce moment du Grand-Théâtre parisien et les nouvelles exagérées ou fausses vont leur train, comme toujours. Nous sommes en mesure de donner les détails suivant, et nous les donnons comme officiels :
- Le théâtre contiendra 2000 spectateurs ; les aménagements sont faits par la maison Alexis Godillot sur les plans de MM. Thomine et Brevet, architectes.
- Par acte notarié, l’entrepreneur s’est engagé à livrer la salle le 20 janvier 1865.
- L’éclairage, d’un style nouveau, se composera de douze lustres de grande élégance ; somme toute, l’ornementation sera d’une goût sévèrement artistique et le confortable parfait.
- La troupe est déjà en bonne voie de composition, ce qui ne doit pas empêcher les artistes, les musiciens, employés, soumissionnaires de café, vestiaires, etc., de se présenter s’ils veulent concourir à l’œuvre nouvelle.
- Le Grand-Théâtre parisien ouvrira par un drame populaire joué tous les deux jours, et les jours intermédiaires seront remplis par le vaudeville, les pièces de genre, etc., de façon à apporter toute la variété possible dans la composition du spectacle à attirer chaque soir le public du quartier.
- Le régisseur général, M. Marius, régisseur du théâtre de Vichy, est un homme dont la réputation dans le monde dramatique est une garantie sérieuse, et M. Massue lui a adjoint, comme machiniste en chef, M. Auguste Marie, le machiniste qui fit la renommée de la Porte-Saint-Martin sous la direction de MM. Cogniard frères.
L’Opinion nationale 4 mars 1865
Lien : Retronews
Le Grand-Théâtre-Parisien inaugurera dans quelques jours sa nouvelle salle, par la représentation d’un drame intitulé la Duchesse de Valbreuse, par MM. Ayasse, Julien Deschamps et Émile Prat. On annonce aussi, pour être joués au même théâtre, les Enfants de Paris, autre drame des mêmes auteurs.
Le Messager des théâtres et des arts 19 mars 1865
Lien : Retronews
L’ouverture du Grand-Théâtre-Parisien est définitivement fixée à mercredi 22 mars. Ce théâtre est situé, comme on sait, à l’entrée de la rue de Lyon, à l’issue du faubourg Saint-Antoine, près de l’embarcadère des chemins de fer de Vincennes et de Lyon, dans le voisinage de Bercy, des nouveaux boulevards et des quais. C’est certainement une situation excellente pour un théâtre populaire. La façade du bâtiment, simple, élégante, est ornée de statues et d’ouvertures d’un bon style ; une vaste baie donne accès dans un vestibule, et de là dans la salle, formant un parallélogramme en amphithéâtre, avec places numérotées au nombre de deux mille environ. Ces places coûtent cinquante centimes et un franc.
Il y a en outre, quelques petites loges et quelques stalles d’orchestre ; un arceau monumental sépare les deuxièmes places des premières, et semble former une immense loge de fond, ce qui corrige la profondeur exagérée de la salle. L’éclairage consiste en huit lustres. La scène a la largeur de celle de l’Opéra, seize mètres, avec une profondeur proportionnée, dix-huit mètres ; derrière existent des loges d’artistes et les locaux utiles au service. Sous le rapport de l’acoustique, cette salle ne laisse rien à désirer : de toutes les places, de la moins bonne, de celles de 50 centimes, comme de la meilleure des loges, on voit et on entend parfaitement les acteurs. Toutes les conditions requises pour un bon théâtre populaire paraissent donc réunies par le Grand-Théâtre-Parisien, dont le directeur est M. Alfred Massue, ancien pensionnaire de l’Odéon, sous la direction de Bocage, et depuis régisseur d’un théâtre de province. (Presse.)
Le Figaro 19 mars 1865
Extrait du Courrier de Paris, d’Henri Rochefort.
Lien : Retronews
Il est vrai que le Grand-Théâtre-Parisien est sur le point d’ouvrir et qu’il est peut-être destiné à faire jaillir un grand dramaturge. Mais ce nouvel établissement se trouvant situé par-delà la Bastille, le grand dramaturge aura bien des omnibus à prendre avant d’arriver à une situation dans le monde des lettres. Or, tout grand homme est tenu d’être, à son début, dans la dernière des misères. S’il a de quoi prendre l’omnibus il n’est plus intéressant du tout.
À propos du Grand-Théâtre-Parisien et de plusieurs autres nouveaux théâtres aussi parisien, mais moins grands, on m’assurait que les directeurs de ces différentes entreprises avaient l’intention d’adresser au Conseil d’État une réclamation relative au droit des pauvres.
Ces messieurs se fondent sur ceci : que, puisque nous avons la liberté des théâtres, il n’est plus rationnel de venir demander tous les soirs onze pour cent de la recette à un directeur, qu’il ne le serait d’exiger d’un cordonnier onze pour cent sur une paire de chaussures.
C’est là en effet une chose bizarre que les hommes de lettres soient traités comme des gens sans aveu par les personnages dit sérieux et que ceux qui passent leur vie à repousser les écrivains parce qu’ils sont trop pauvres, mettent tant de persistance à les appauvrir encore.
La Comédie 2 avril 1865
Compte-rendu d’A. Andréi.
Lien : Gallica
Le Grand-Théâtre-Parisien
Non, je n’assistai jamais à pareil jeu. Le public est bon diable, il souffre quelquefois que l’on se moque de lui ; cette fois la dose était un peu forte. M. Massue a réalisé l’impossible : en échec il a dépassé M. Dufour.
Le Grand-Théâtre-Parisien est construit dans un désert, là-bas, tout là-bas, après la gare du chemin de fer de Vincennes, — mais avant celle de Lyon, entre une forge et un atelier de construction, à deux pas d’un cloaque affreux le jour, dangereux le soir ; enfin, loin de toute civilisation. Si vous partez de la place de la Bourse, il vous faudra trois omnibus ; si vous prenez un fiacre, vous en aurez pour trois heures et demie, et je n’affirmerais pas que le cocher ne demandât un franc de retour. Jugez si un tel voyage a dû mettre en belle humeur ceux qui, ayant leurs places numérotées, n’ont pu entrer ! Il arriva un moment — mercredi — où les barrières furent renversées et la salle envahie, en dépit d’une armée de protecteurs de l’ordre public, qui ne purent rien maintenir du tout. Pour la sortie, l’affiche promettait des omnibus, il nous a été impossible de trouver même une brouette.
Le théâtre occupe l’emplacement d’un hangar servant autrefois de magasin de ferrailles ; on ne l’a pas changé. C’est un long corridor, un long tuyau figurant assez bien les tentes dans lesquelles on distribue les prix dans les institutions de Paris. Ou figurez-vous le grand égout collecteur se donnant des airs de fête, ayant ses parois peintes à la détrempe et garnies d’écussons surmontés de drapeaux, et vous aurez une idée de l’aspect du Grand-Théâtre-Parisien. La science et le bon goût de l’administration se sont révélés dans la réunion des noms qui ornent les écussons. Lisez, je n’invente rien : — Victor Hugo, Mélesville ; — Mürger, Anicet Bourgeois ; — George Sand, Donizetti ; — Musset, Soulié ; — Alphonse Karr, Bouchardy ; — Eugène Sue, Meyerbeer ; — Hérold, Dennery.
Que dites-vous d’Hérold et Dennery accouplés ? Un homme est jugé après ce trait. Les places du théâtre sont disposées en gradins, toujours comme à une distribution de prix, et il y a, de chaque côté de la scène, deux petites guérîtes figurant les loges d’avant-scène — et du plus original effet. La température est celle d’une cave, l’ornementation est nulle et l’éclairage insuffisant. Les acteurs ont l’air de jouer dans une lanterne magique, ils semblent des Lilliputiens. Quant à les entendre parler, il n’y faut pas songer. Cependant, rassurez-vous ; le bruit court qu’ils auront dorénavant des porte-voix et qu’on distribuera, au contrôle, des cornets acoustiques pour les spectateurs. Le moyen est bon, mais je le crois insuffisant ; il faudrait y joindre des télescopes.
Quoique bien placé, il m’a été impossible d’entendre le drame, pour deux raisons : les sifflets d’abord, l’éloignement ensuite. Pensez alors aux quinze-cents spectateurs parqués derrière moi ; ils ont chanté, toussé, crié, sifflé, hurlé toute la soirée. Je n’ai saisi de la pièce que trois mots fataliques : 1812 — confiture — mort. Traduisez comme vous le voudrez ces mots et tirez-en les présages qui vous plairont. L’œuvre dramatique, qui pourrait s’appeler : Les cinq filles Massue ou Les quatre frères Vigier — l’affiche dit pourtant la Duchesse de Valbreuse, — est peut-être un chef-d’œuvre ; je laisse à d’autres le soin de faire comme le public. Voici ce que nous avons compris de visu. Il y a un père qui fait semblant de s’empoisonner pour faire condamner sa fille qui n’est pas sa fille ; celle-ci meurt de faim dans un cachot et ressuscite dans un bal masqué. Saisissez-vous la nouveauté de cette situation palpitante ? Quant à moi, je m’abstiens. Je crois que l’administration a agi comme les propriétaires qui mettent du papier à dix centimes le rouleau dans un appartement neuf ; il faut essuyer les murs.
Une pareille représentation ne pouvait se passer sans incidents burlesques ; ils ont été nombreux. Dans quelque chose parée du nom de prologue, on voit arriver une toute petite fille, on rit ; puis une seconde petite fille, on siffle ; puis une troisième petite fille, on crie ; puis une quatrième, une cinquième… Oh ! alors, il y eut un éclat de rire général, un éclat de rire stupéfiant de deux-mille personnes, suivi de sifflets, de cris, de huées, de vociférations qui firent un charivari indescriptible. C’est ainsi que furent accueillies les cinq filles du directeur ; celui-ci se promenait dans la salle en mordant sa longue moustache ; il était vert. Il composait, dit-on, un vaudeville lugubre intitulé : Grandeur et décadence des cinq filles artistes d’un papa directeur. Si M. Massue tient à utiliser ses cinq filles, je croie qu’il ferait mieux de les placer à son contrôle que de les exhiber sur scène. De semblables expositions ne sont possibles que dans une charge d’atelier, comme dans Jean qui rit. Que dirait-on si l’on voyait M. Paul Féval toujours flanqué de ses sept filles ? Dans un autre acte, la fille, qui n’est pas la fille, meurt dans sa prison. Au moment de trépasser, elle tomba si lourdement que sa tête frappa sur les planches de la scène en produisant un bruit sourd qui éveilla un terrible écho ; deux-mille boums ! coururent dans la salle et firent relever l’artiste qui, oubliant qu’elle devait être morte, se sauva aux grands éclats de rire du public. On a eu tous les scandales, même celui du bouquet lancé, au dernier acte, à la femme d’un des auteurs, — ils sont trois, — qui venait de zézayer une romance incompréhensible. Le gaz, honteux d’éclairer un tel spectacle, se mit à fuir près des guérites en question ; il fallut l’éteindre. Il n’y a pas jusqu’à Timothée Trimm, qui, découvert par la longue vue d’un titi placé à un kilomètre, — aux places à cinquante centimes, — fut interpellé et dut méditer sur Les ennuis d’une trop grande popularité
. Il n’y pas jusqu’à M. Massue qui s’attira les quolibets de la foule en faisant lui-même la police de sa salle.
Parmi les interprètes n’ont pas été sifflés : MM. Marchetti, Laferté, Barrère, Rosambeau ; ce n’est pas un mince éloge.
Il ne faudrait pas préjuger de cet article que je sois ennemi des nouvelles entreprises théâtrales. Au contraire, ne voulant pas juger celle-ci d’après les sifflets d’une première représentation, j’ai assisté à la seconde, où les protestations, pour être moins nombreuses, ont été plus significatives ; elles venaient du vrai, du seul public qui doit soutenir ce théâtre. Si je parais accabler le Grand-Théâtre-Parisien de mes sarcasmes, c’est que je mets en pratique le mot de Figaro : Hâtons-nous de rire de crainte de pleurer.
De tels essais stérilisent la liberté des théâtres et compromettent au plus haut degré la dignité de l’art dramatique.
Le Jockey 4 avril 1865
Extrait de l’Échos des clubs de Clément de Chaintré.
Lien : Retronews
Le Théâtre-Parisien est situé entre la gare de chemin du fer de Vincennes et la gare du chemin de fer de Lyon.
C’était il y a moins d’un an, une sorte de grand hangar dont M. Millaud était propriétaire. Qu’en ferait-il ? un dock, un hôtel ou un magasin de charbon ? Il était encore indécis quand M. Massue se présenta.
M. Massue est un de ces acteurs pères de famille, comme on en trouve encore quelques-uns dans les provinces les plus reculées. Sa femme joue les duègnes et ses cinq filles tiennent les autres emplois, depuis la grande coquette jusqu’au baby. Quelques frères et une demi-douzaine d’oncles et de cousins complètement la compagnie.
— Donnez-moi votre hangar, dit M. Massue à M. Millaud. J’ai sous la main un capitaliste qui l’ornera de banquettes et une troupe aguerrie qui y jouera la comédie sous les sifflets croisés des gares. Les places ne coûteront qu’un franc, mais il y en aura beaucoup, et nous partagerons la recette !
M. Millaud accepta, à la condition que Timothée Trimm [rédacteur en chef du Petit Journal de Millaud] aurait ses entrées.
Le Théâtre-Parisien, commencé sous ses augustes auspices, a donné cette semaine son prologue d’ouverture et son grand drame de début. La Duchesse de Valbreuse, tel est le titre de ce drame, plus sombre, à ce qu’il paraît, que la salle qui n’est pas claire. Deux-mille-cinq-cents voisins assistaient à la représentation. Ils ont applaudi, les gares on sifflé, et Timothée Trimm a déclaré qu’il ne manquait au nouveau théâtre qu’un corps de ballet. — Attendez quelques années ! lui a répondu M. Massue ; je vais m’occuper de marier mes filles !…
Le Messager des théâtres et des arts 6 avril 1865
Article de Louis-Félix Savard.
Lien : Retronews
Grand-Théâtre-Parisien. — Entre Lyon et Paris, prologue en un acte, de MM. Julien Deschamps et Émile Prat. — La Duchesse de Valbreuse, drame en cinq actes et un prologue, de MM. E. Ayasse, Julien Deschamps et Émile Prat. (Première représentation le 29 mars.)
Il a été, vous le savez, terriblement tumultueux le baptême de ce nouveau-né de la liberté des théâtres, — réellement le premier qu’elle ait enfanté, — et franchement il fallait bien s’y attendre au milieu de ce quartier populeux qui a nom le faubourg Saint-Antoine. Le peuple, le soir de l’ouverture, avait pris bruyamment possession de ce théâtre, — qui avant tout est sien, — et s’y était largement ébaudi ; il avait pris ses aises et ne s’était pas inquiété du reste. Les places louées lui importaient peu : à ses yeux, les retenir d’avance, c’était les accaparer à son détriment, et se basant sur ce paradoxe : La propriété, c’est le vol
, il s’y installait sans façon : elles étaient libres, cela lui suffisait ; il enjambait lestement les balustrades et répondait aux observations par cette traduction du logique primo occupanti : J’y suis, j’y reste !
Lorsqu’il ne s’agit que de deux, trois, dix personnes même qui ont envahi les places louées, on peut facilement les faire déguerpir ; mais quand c’est par centaines que l’on compte les spoliateurs, comment voulez-vous que l’on en vienne à bout ?
C’est précisément ce qui est arrivé mercredi : la foule était turbulente, elle rompit les digues, et il n’y eut pas de force assez puissante pour lutter contre elle. De là les plaintes, les déceptions imméritées, les colères, les récriminations. Ce n’est pas à nous de donner tort à de telles plaintes. Compris parmi les malheureux de mercredi, le Messager ne peut cependant avoir de rancune après les loyales explications qui nous ont été données ; mais cependant il ne peut blâmer ceux auxquels un mouvement de dépit a dicté des lignes légèrement acerbes. Le Messager a pris la chose en bon garçon : c’est en souriant qu’il a exprimé ses griefs. Passons donc.
Mais il est temps enfin que nous vous parlions un peu sérieusement de ce Grand-Théâtre-Parisien, qui n’est pas sans avoir droit à toutes les sympathies.
Nous avons bravement, vendredi, entrepris ce voyage : tout le bruit avait cessé ; il y avait du monde, — beaucoup même, — et l’ordre était parfait.
Le théâtre est situé au numéro 12 de la rue de Lyon ; la façade est simple, mais de bon goût : une étoile de feu indique l’entrée. Le vestibule est espacé, long, large ; le contrôle est à l’extrémité : une fois le détroit des contre-marques franchi, on se trouve dans un second vestibule où est le vestiaire, et l’on arrive à l’un des deux escaliers qui conduisent aux stalles et aux fauteuils d’orchestre ; deux autres, tout à fait indépendants de ceux-ci, donnent accès aux dernières places. Grâce à ces dégagements, il ne faut pas plus de deux minutes pour que la salle, — quelque pleine qu’elle soit, — puisse être complètement évacuée.
Examinons-la un peu à présent, cette salle dont l’ensemble n’a pas de précédent dans nos théâtres : nous n’avons jamais rien vu d’analogue. Figurez-vous un vaste rectangle, long de 48 mètres, large de 20. Le plafond est légèrement cintré, et, grâce à une légère saillie, les places à 50 centimes ont l’air de faire partie d’une immense loge de face qui prendrait au fond le tiers environ du vaisseau. La nudité des murailles disparaît sous des cartouches ornées de drapeaux et sur lesquelles sont inscrits les noms de la plupart de nos célébrités littéraires et musicales. La salle contient deux mille personnes ; il y a trente-sept stalles par rangée, cinq de plus qu’à l’Opéra ; les fauteuils dits grands confortables, — le mot va devenir à la mode, — sont cotés à 2 francs, les orchestres, à 1 franc, et les places d’amphithéâtre à 50 centimes. De plus, deux avant-scènes élégantes et rappelant un peu les dais d’églises, viennent rompre ce qu’il peut y avoir de monotone dans cette salle sans galerie. Par suite de la pente graduée du plancher, on voit parfaitement de tous les côtés, et, — chose extraordinaire, — on entend aussi bien tout à fait au fond qu’aux premiers rangs ; nous en avons fait l’expérience et nous avons été on ne peut plus surpris de cette étonnante sonorité. L’éclairage se compose de six beaux lustres et de plusieurs bras de lumière ; l’amphithéâtre, que l’on avait trouvé un peu dans l’ombre, va avoir aussi très-incessamment sa bonne part de jour.
Quelques mots également sur la scène : elle a 11 mètres d’ouverture de rideau et 18 mètres de profondeur ; la hauteur est proportionnée au reste ; une double rampe, composée de 62 becs de gaz en tout, l’éclaire admirablement ; quant à ses aménagements intérieurs, ils sont des mieux agencés, des plus commodes : loges aérées, foyer, couloirs de dégagement, riels n’y manque ; les artistes, en somme, sont là comme les poissons dans l’eau.
Que vous dirons-nous de la pièce maintenant ? Nous avouons humblement nous en être peu préoccupé cette fois : l’aspect grandiose de cette salle, qui a quelque chose de vertigineux et fait songer aux constructions romaines, cette masse grouillante de têtes, toute la bizarrerie enfin de cette splendide réalisation du véritable théâtre populaire, dans lequel, au moyen du contact immédiat des spectateurs, peut s’établir ce courant électrique qui triple les impressions, tout cela tenait trop nos yeux en éveil pour que nos oreilles ne se ressentissent pas un peu aussi de ces puissantes distractions.
Le prologue d’ouverture, Entre Lyon et Paris, est très suffisant. Mlles Atala, Jeanne et Lucile Massue en font très agréablement les frais, — la première en personnifiant le nouveau théâtre, et les deux autres, le public, sous la forme de deux voyous. Le drame, la Duchesse de Valbreuse, n’est pas sans défaut ; mais, entre nous, c’est assez bon pour essuyer les plâtres ; on regarde trop pour écouter. Le sujet principal en est l’éternelle substitution d’enfant, qui nous a été rabâchée sur tout les tons : il n’est pas trop mal traité du reste et nous ne détestons pas, pour notre part, ces jeunes gens, — les quatre fils Aymon, — qui protègent l’innocence persécutée et défendent la pauvre déshéritée, une Cendrillon qui finit, grâce à eux, et à un tatouage qu’elle a sur le bras, par reconquérir son titre du duchesse. La pièce a quelques heureuses qualités : elle est bien montée ; les décors sont jolis et parfaitement en rapport avec l’apparence propre et même cossue du théâtre ; elle n’est pas mal jouée aussi : M. Marius surtout y est très remarquables dans un rôle à la Chilly ; il est véhément, terrible, plein de vigueur ; M. Marchetti a beaucoup de chaleur et de distinction ; M. Paul Massue est très amusant dans le rôle du comique de la chose, sur l’existence duquel les confitures paraissent avoir une très grande influence ; Mlle Rosa Dorès est touchante, et la gentillesse extrême des cinq sœurs Massue ne laisse pas que de faire l’ornement du prologue : nommons encore, par la même occasion, Mmes Alix Franat et Amélia, MM. Laferté, Maxwell et Rosambeau. Les costumes ont un certain éclat : le bal masqué du cinquième acte, où le traître est démasqué, offre un coup-d’œil brillant : on y applaudit grandement la danse de M. Victor Gobillot, un chorégraphe habile, et de Mme Morlot. L’orchestre n’est pas mauvais : il est composé de 30 musiciens, dirigés par M. Borssat, qui a, pour la circonstance, composé quelques airs très goûtés et dont les pieds des titis accompagnent joyeusement le refrains : cela suffit pour empêcher qu’on entende les sifflets des locomotives voisines, — ce sont les seuls aujourd’hui qui retentissent dans la salle ; mais que voulez-vous ? rien n’est sacré pour la vapeur !…
Cette tentative a tout pour réussir, et elle réussira, nous l’espérons, nous le souhaitons de bon cœur : nous l’avons prise ab ovo ; nous l’avons suivie dans ses péripéties, nous avons le premier annoncé sa mise à exécution et l’on nous trouvera toujours des premiers prêt à l’encourager, à la défendre, à la soutenir, tant toutefois que la direction ne s’écartera pas du but qu’elle se propose et persévérera dans ses bonnes intentions.
Il y a encore beaucoup à faire, sans doute ; mais M. Alfred Massue est homme de métier ; il ne sera pas long, dès qu’il le faudra, à faire machiner la scène, à flanquer la salle de loges et de galeries ; le principal pour le moment, c’est le répertoire : il faut en bannir totalement le drame intime ; le public a beau bien voir et bien entendre, la vastité de la salle l’empêche d’être en rapport direct avec les artistes, de suivre leurs jeux de physionomie : la perspective est utile, mais pas trop n’en faut, et cet éloignement qui est un avantage dans les théâtres lyriques, devient ici un inconvénient auquel on peut facilement remédier en jouant des vaudevilles tapageurs, des opérettes bruyantes, des drames à grands effets, des pantomimes, des ballets, le tout avec accompagnement de chansons et de coups de fusil. Du reste, M. Massue avait compris cela : le drame actuel devait primitivement porter le titre populaire des Enfants de Paris ; ce ne fut qu’aux dernières répétitions que l’on s’aperçut que les auteurs avaient complètement dévié de la voie qu’on leur avait indiquée, et qu’il fut résolu que la Duchesse de Valbreuse prendrait possession de l’affiche. C’est une leçon pour M. Massue, il en profitera : il connaît son public et il n’oubliera pas que lorsqu’on a affaire à des gens qui peuvent se trouver placés à un demi-hectomètre de la scène, il faut leur servir, avant tout, des pièces à longue portée, leur exhiber en un mot comme qui dirait des spectacles rayés.
Le Temps 6 mai 1865
Dimanche 7 mai, à deux heures, M. Alexandre Dumas inaugurera les Entretiens populaires, au Grand-Théâtre-Parisien, rue de Lyon. Le célèbre romancier a choisi pour sujet de cette conférence qui sera faite au bénéfice de la Société de sauvetage, le récit des aventures de la goélette l’Emma pendant la compagne des Deux-Siciles.
On peut se procurer des billets d’avance au théâtre.
Le Messager des théâtres et des arts 28 mai 1865
Début de l’article d’E. Boursin.
Lien : Retronews
Grand-Théâtre-Parisien. — Les Gardes forestiers, drame en cinq actes, de M. Alexandre Dumas. — (Première représentation à Paris le 25 mai.)
Je n’ai jamais beaucoup aimé les romans retournés en comédie ou en drame ; cela m’a toujours paru faire preuve, chez un auteur, de grande économie : c’est l’histoire de sa redingote, dont on coupe les pans pour s’en faire un gilet, ou une veste.
Certes, ce n’est pas là le cas de M. Alexandre Dumas, car le drame Les Gardes Forestiers, représenté, jeudi, sur la scène du Grand-Théâtre-Parisien, a précédé Catherine Blum, l’un des romans les plus saisissants de l’inépuisable conteur. M. Alexandre Dumas a pris sa première œuvre, il l’a caressée comme un enfant aimé, il a cherché pour elle toutes les délicatesses du sentiment, il l’a entourée de toutes les prévenances de l’art dramatique, de toutes les splendeurs et les richesses de la mise en scène, et en a fait un drame vrai, d’un intérêt immense, et qui émeut jusqu’aux larmes. […]
Le Temps 12 juin 1865
Extrait de la Revue théâtrale de Louis Ulbach.
Lien : Gallica
On annonce que le Grand-Théâtre-Parisien va passer en revue les principales pièces du répertoire de l’auteur des Girondins. Si cette revue est faite avec le soin de mise scène et le choix des interprètes qu’elle exige, l’idée sera fructueuse ; si elle échouait, il ne resterait rien de plus à tenter ; il faudrait renoncer à cette utopie d’un théâtre spécial, et associer, comme je le souhaite, les travailleurs aux émotions que se réservent les oisifs.
Croit-on, par exemple, pour le dire en passant, que le Supplice d’une femme ne serait pas aussi bien compris rue de Lyon que rue de Richelieu ? Cette pièce simple, forte, qui remue sous une forme saisissante des sentiments sacrés pour tous, ferait vibrer dans le cœur d’un public plus jaloux des droits de la famille, étranger à la casuistique mondaine, aux compromis de la bonne compagnie, une émotion généreuse. Je m’étonne que M. Girardin, ce théoricien de la liberté, qui n’admet le monopole qu’en matière de collaboration, n’ait pas eu l’idée d’une tentative de ce genre. Mais, en attendant, nous avons, au Grand-Théâtre-Parisien, une œuvre récente d’Alexandre Dumas père, une œuvre inconnue à Paris, et représentée pour la première fois au Grand-Théâtre de Marseille, le 23 mars 1858. Pourquoi Paris n’a-t-il pas eu la primeur de ce drame ? c’est ce que je ne saurais dire, et c’est ce que l’auteur n’a pas expliqué dans le 13e volume de son théâtre, qui renferme, les Gardes-forestiers.
Quoi qu’il en soit des motifs qui ont présidé à cet essai de décentralisation dramatique, la reprise du drame au Grand-Théâtre-Parisien continue en quelque sorte l’expérience. Ce n’est pas encore la capitale, et ce n’est plus tout à fait la province.
Le succès avait été complet à Marseille ; il a été très grand au débarcadère de Paris. La pièce a toutes les qualités et tous les défauts du maître. Une exposition vive, pittoresque, amusante, un commencement d’action lent, un peu embarrassé, une péripétie dramatique dont tous les détails se dégagent avec un naturel apparent, et enfin un dénouement serré, pressé, logique dans sa subtilité, très attendu pour le fond, très inattendu pour les accessoires. [S’en suit le compte-rendu critique de la pièce.]
La Presse théâtrale 22 juin 1865
Article d’A. Hernette.
Lien : Retronews
Quelques journaux ont annoncé que le Grand-Théâtre-Parisien de la rue de Lyon, après les conférences d’Alexandre Dumas, allait avoir la primeur d’un grand opéra de G. Duprez, intitulé : Samson. Bien que cette nouvelle me paraisse avoir besoin de confirmation, avant d’être accueillie comme une vérité, je n’hésite pas à déclarer combien je serais heureux d’entendre exécuter, dans des conditions normales, cette œuvre dont je connais quelques fragments, et sur laquelle le grand artiste compte, avec raison, pour ajouter un nouveau fleuron à sa grande renommée. Duprez est une expression musicale. Il y a trois hommes en lui : le chanteur qui, maintenant, appartient à l’histoire de la musique, laquelle lui a assigné une assez belle place ; le professeur, ses élèves Mmes Miolan, Caroline Duprez, Battu, la pépinière d’artistes qu’il forme dans son petit temple de la rue Turgot, les conseils que lui demandent tous les jours les chanteurs en renom, prouvent que, dans cette partie, il n’est pas le dernier venu ; et enfin, le compositeur, imparfaitement jugé dans son opéra Joanita, dont les situations, peu en rapport avec son tempérament énergique, ne lui ont pas permis de se révéler tel qu’il est.
La France est ainsi faite qu’il semble qu’elle ne veuille pas reconnaître à Aristide trop de motifs pour mériter le surnom de Juste. Parce que Duprez est un grand chanteur, beaucoup lui refusent, sans examen, le génie de l’invention. À ce compte là, ces mêmes critiques devraient aussi nier Shakespeare et Molière. Pour moi, et tous ceux qui les connaissent partagent mon avis, je suis persuadé que, si Samson, et un autre grand ouvrage de Duprez, Jeanne d’Arc, que j’ai eu le bonheur de connaître également, apparaissent jamais à la douce lumière, la puissante individualité de G. Duprez brillera sous son véritable jour, et la France comptera un grand compositeur de plus.
La Semaine musicale 22 juin 1865
Au mois de septembre prochain, M. Duprez, le grand chanteur, fera représenter un opéra de sa composition au Grand-Théâtre-Parisien. Cet opéra a pour titre Samson. M. Duprez choisira lui-même ses interprètes, qui seront engagés pour cette circonstance.
Le Petit Journal 16 juillet 1865
Article de Joseph Méry.
Lien : Gallica
Le Grand-Opéra populaire
L’art, a-t-on dit, n’a jamais assez de temples dans la monde, et l’art musical plus qu’aucun autre, l’art civilisateur par excellence. Si la mélodie courait les rues comme l’esprit, les sergents de ville donneraient leur démission.
Alexandre Dumas, que notre illustre Michelet appelle avec raison une des forces de la nature, a donné la vie et la popularité à un théâtre nouveau, qui devrait bien se nommer Théâtre-Dumas. Ce nom sera le sien un jour ; en attendant, c’est le Théâtre-Parisien.
Lorsqu’un été précoce coupait les queues à tous tes théâtres, Dumas remplissait de foule le Théâtre-Parisien, tantôt par l’attrait de ses merveilleuses causeries, tantôt par son beau drame si émouvant, les Gardes forestiers.
À cause de cette initiative glorieuse, prise par le premier de nos auteurs dramatiques, le Théâtre-Parisien sera toujours un théâtre de drame, et aujourd’hui, un autre écrivain populaire, M. Bouchardy, arrive après Dumas et donne à cette scène Jean le Cocher. C’est une œuvre de circonstance.
Mais en laissant au drame la moitié de la semaine, le Théâtre-Parisien donnera l’autre moitié à la musique. Il sera le Grand-Opéra populaire. Réjouissez-vous donc, jeunes prix de Rome, âgés de quarante à cinquante ans, et encore inédits aujourd’hui !
M. Millaud, esprit, artiste, malgré son génie financier, M. Millaud qui réussit toujours parce qu’il est doué de l’intelligence, mère du bonheur, a confié l’administration de son Théâtre-Parisien à un directeur très habile : c’est M. Massue qui a fait ses premières armes sous notre tant regretté Bocage, le modèle des directeurs.
Un heureux hasard a fait rencontrer chez M. Millaud, M. Massue et notre illustre Duprez, le Rubini de la France, le professeur de tous les élèves devenus maîtres aujourd’hui.
— Mon cher Duprez, a dit Millaud, tous les soins, tout le talent, tout le zèle que vous consacrez à votre conservatoire de la rue Turgot, pourquoi ne les donneriez-vous pas aussi à un théâtre populaire de musique qui serait le Pasdeloup du grand-Opéra ?
Duprez, toujours animé par la fièvre de l’art, a trouvé l’idée admirable, et, séance tenante, on a improvisé les plans, le programme, les statuts. Trois fois par semaine, le mardi, le jeudi, le samedi, on exécutera les grandes œuvres lyriques au Théâtre-Parisien, et à des prix que les besogneux mêmes trouveront légers. Il y aura un personnel complet de chœurs et d’orchestre, et l’on peut s’en rapporter à Duprez pour le choix des artistes et pour l’excellence de l’exécution.
En ces derniers temps, on a annoncé à tort que Duprez chanterait sur ce théâtre. Duprez se doit tout entier au travail de l’organisation ; il se contentera de former de bons chanteurs, et, ce qu’il fait avec tant de succès depuis vingt ans pour les autres théâtres, il le fera pour le sien. Cet égoïsme lui est permis.
Passé maître, non-seulement dans le professorat, mais encore dans la science du contre-point, et de la haute composition musicale, Duprez, secondé par une troupe d’élite, formée à son école, ouvrira la campagne par un opéra auquel il travaille depuis cinq ans, et dont le titre sera connu plus tard ; puis, il chantera aux jeunes musiciens ce fameux Suivez-moi, qui a électrisé tout Paris, et on le suivra, comme on le suivit, en 1837.
Les concerts de Pasdeloup ont démontré que le goût de la grande musique est dans les classes moyennes et infimes. Les orphéonistes, qui couvrent le sol de l’Europe, n’appartiennent pas au sommet de la pyramide sociale ; en général, ce sont des ouvriers. On n’a pas encore vu et on ne verra jamais une société orphéonique composée de notaires, d’agents de change, d’avocats, de poètes, de ducs, de marquis et de sportsmen. Un grand opéra populaire a donc d’infaillibles chances de succès.
Aux théâtres lyriques de l’aristocratie, il faut des salles splendides, les girandoles de gaz, les tentures de velours, les loges d’exhibition, les envergures des toilettes, les guirlandes de fleurs, les foyers babillards, les corridors tapageurs ; ensuite, si la grande musique arrive par-dessus le marché ; elle est assez-bien reçue ; on lui donne une oreille ; on accorde l’autre à la voisine ou au voisin.
Dans un grand opéra populaire, une place confortable suffit. Les yeux et les oreilles se réservent exclusivement pour la scène. Les lorgnettes ne s’agitent pas sur tous les horizons ; elles ne servent qu’aux aveugles de l’art.
La liberté des théâtres a fait ouvrir dans toutes les zones un trop grand nombre de ces cafés-hurlants qui menacent de falsifier le goût, comme les liquides, si les consuls n’avisent pas. Un grand opéra populaire est donc aujourd’hui une nécessité. Lorsque le grand et noble faubourg des travailleurs aura sa bonne musique et ses artistes sérieux à menus prix, le Pied qui r’mue sera tout de suite amputé. Ou désertera les stupidités nauséabondes pour les grands spectacles lyriques, où les hauts faits de l’histoire seront livrés au peuple dans la langue de la mélodie et seront d’harmonieuses leçons écoutées sans ennui.
La Semaine musicale 20 juillet 1865
Extrait de l’Avenir des théâtres lyriques dans Paris, par Louis Roger.
Lien : Gallica
Le bruit court que le Théâtre-Parisien sera affecté dans quelques semaines à des représentations de grand opéra. M. Massue en aurait la direction et M. Duprez serait spécialement chargé de la partie artistique. L’opéra alternerait avec le drame et serait joué le mardi, le jeudi et le samedi. C’est M. Millaud, l’heureux financier, qui est à la tête de cette entreprise.
Un théâtre populaire d’opéra semble chose toute nouvelle à Paris. Ceux qui n’ont cru possible jusqu’ici que l’existence de l’Académie Impériale de Musique et du Théâtre-Italien en sont tout émerveillés, quelques-uns même en sont stupéfaits. Ils éprouvent la même impression que les Péruviens entendant le bruit du canon pour la première fois.
Un théâtre de ce genre nous paraît, à nous, une création toute naturelle. S’il y a lieu de s’étonner, c’est qu’il n’y en ait pas au moins dix dans Paris depuis longtemps.
Le Ménestrel 23 juillet 1865
Article de Louis Julien.
Lien : Retronews
Le Grand Opéra populaire
Ce qui n’était il y a quelques jour qu’un projet va passer, on l’assure, à l’état de fait accompli. Paris aura son grand Opéra populaire, si vivement désiré par ceux qui s’intéressent aux justes aspirations inassouvies des compositeurs. On veut ouvrir à tous cette lice nouvelle, et, certes, ce, ne sont pas les juges qui manqueront !… Juges intelligents, impressionnables, passionnés, qui feront entendre aux vainqueurs comme aux vaincus cette grande voix du peuple que le proverbe appelle la voix de Dieu.
L’essai que l’on va tenter paraît devoir être sérieux. Sera-t-il concluant ? et, en cas de non-succès, le metteur en œuvre d’une généreuse entreprise devra-t-il se regarder comme battu ? Nous ne le croyons pas ; car, dans cette hypothèse, il faudrait faire la part de la position excentrique du Grand-Théâtre-Parisien. C’est la scène dont il s’agit, et l’on aurait encore le droit de se demander si le grand Opéra populaire n’eût pas trouvé meilleure chance de réussite sur un point plus central !
Quoi qu’il en soit, et toutes réserves faites en faveur des tentatives diverses qui pourront se produire, la projet actuel appartient à M. Duprez. En ce chanteur célèbre, en ce musicien accompli, fondateur de l’École spéciale de chant, toutes les idées généreuses trouvent un champion dévoué. Lutteur infatigable, artiste convaincu, Duprez poursuivait depuis longtemps cette idée, qu’il croit grande et féconde.
Un théâtre lyrique non subventionné
ouvert aux classes les moins favorisées de la fortune, à un bon marché incroyable ; la musique dramatique mise à la portée de tout le monde ; l’opéra, ce plaisir aristocratique, démocratisé et rendu accessible à tous. Combien de fois cette idée s’est-elle présentée à ceux qui aiment sérieusement la musique ! Certes, la réalisation est difficile, mais il ne s’agit pas ici de lutter de magnificence avec le premier théâtre du monde. Le tenter serait un acte de démence. Les splendeurs de l’Opéra ont leur raison d’être, et si elles n’ajoutent rien à la valeur de l’œuvre d’un maître, elles produisent, par la réunion de tous les arts, cet ensemble magique que l’étranger vient à prix d’or admirer parmi nous.
Si nous sommes bien informés, les splendeurs du nouveau théâtre lyrique se borneraient à une mise en scène intelligente, sans luxe inutile, et l’on ne chercherait le succès que dans le mérite de l’œuvre et dans sa parfaite exécution. Les compositeurs, ce nous semble, pourraient se confier en toute assurance au zèle et au talent de Duprez ; le chanteur éprouvé, le digne interprète des œuvres les plus sublimes, le professeur éminent qui a formé pour toutes les scènes de l’Europe tant de talents distingués, saura choisir et diriger ses artistes.
On pourrait craindre que Duprez ne profitât de sa position pour faire représenter ses œuvres à l’exclusion de celles de ses confrères : qu’on se rassure à cet égard, Duprez ne peut songer à créer un monopole en sa faveur. Dans l’expérience qu’il va tenter, il a voulu, le premier, payer de sa personne ; mais il ne fait que montrer le chemin, et se promet d’appeler à lui toutes les intelligences d’élite, tous les mérites connus ou ignorés, tous ceux qui voudront prêter leur concours à l’œuvre qu’il veut fonder.
On ne sait rien encore des engagements ni des ouvrages qui doivent être représentés, On a parlé d’un opéra de Samson, dont le poème est de MM. Alex. Dumas et Éd. Duprez, et d’une Jeanne d’Arc, de MM. Méry et Éd. Duprez.
Duprez, qui a écrit les partitions de l’un et de l’autre de ces ouvrages, commencera par l’un des deux : c’est son droit. L’automne prochain nous le montrera à l’œuvre…
Bon succès à l’Opéra populaire !
Le Petit Journal 28 juillet 1865
Lien : Retronews
Le Grand-Théâtre-Parisien, dirigé par M. Alfred Massue, le jeune et audacieux impresario, donnera samedi une véritable fête littéraire et artistique, au bénéfice d’un artiste.
Le Barbier de Séville, opéra-bouffe en trois actes, de Beaumarchais, musique de Rossini, avec le concours des premiers sujets des principaux théâtres de France : Lyon, Toulouse, Lille, Amiens, Metz et Nancy. L’orchestre sera dirigé par M. Borssat.
L’affiche de demain donnera des détails.
Le prix des places ne sera pas augmenté. On délivrera des billets au bureau du Petit Journal (places numérotées), sans augmentation.
Le Courrier artistique 6 août 1865
Article de d’Arpentigny.
Lien : Gallica
Grand-Théâtre-Parisien
On parle plus que jamais d’un Théâtre populaire parisien de grand opéra. Un célèbre financier, non satisfait d’avoir beaucoup d’affaires en train, et en particulier un journal dont le succès est extraordinaire, en serait dit-on, le fondateur. Le ténor Duprez serait directeur ; j’avoue humblement, qu’à la place de ces messieurs, je me garderais bien de me lancer dans une semblable affaire, dont je n’augure pas grand bien ; mais chacun est libre, lors même qu’il vit tranquille et heureux, de se donner des soucis et des ennuis, et tout ténor a le droit, si bon lui semble, de se risquer à compromettre sa réputation.
En attendant que cette nouvelle entreprise soit venue s’installer dans le Grand-Théâtre-Parisien, M. Massue, directeur actuel, a voulu se rendre compte sans doute de l’effet que pouvait produire l’audition d’un opéra dans le quartier de la gare de Lyon.
Le résultat a été excellent, et samedi dernier [29 juillet], le public a frénétiquement applaudi le Barbier de Séville.
La salle, cette affreuse grande salle, moitié grange, moitié amphithéâtre, était comble.
Un public fort turbulent couvrait les bancs, et les grands confortables, cette grotesque invention, étaient envahis par un grand nombre d’élèves du Conservatoire, hommes et femmes.
M. Massue avait en fort peu de temps monté l’opéra de Rossini, grâce à la présence à Paris de quelques artistes de province, qui se sont fort bien acquittés de leur tâche, rendue plus difficile encore par la faiblesse de l’orchestre, exécutant sans finesse, sans nuance, et accompagnant sans aucune mesure.
Néanmoins, le tout a marché convenablement, et certaines parties même ont été exécutées d’une façon remarquable.
Le rôle de Rosine était chanté par Mme Ida Massy, cantatrice en ce moment libre d’engagement. Sa voix est fraîche, souple et bien conduite ; elle a obtenu beaucoup de succès dans son grand air du deuxième acte, et dans un air de Bettly, choisi par elle, à l’acte de la leçon de chant.
Un baryton, jeune, élégant, dont la voix est fort belle, M. Diepdalle, nous est apparu dans le rôle de Figaro.
M. Diepdalle chante avec beaucoup de goût, et joue avec infiniment d’esprit. Sa voix est fraîche et sonore, elle manque un peu dans les notes graves, mais elle se prêtera supérieurement au répertoire de Martin et de Chollet. M. Diepdalle est un chanteur fort distingué et de bel avenir.
Basile nous est apparu sous les traits de M. Melchisédec, une des meilleures basses de province, ayant une voix superbe et beaucoup de talent.
Un jeune ténor, M. Michot, chantait le comte Almaviva. M. Michot est encore bien inexpérimenté, aussi bien comme chanteur que comme acteur, pour un rôle brillant, il est vrai, mais hérissé de difficultés.
La voix de ce chanteur est bien timbrée ; mais conduite sans modération elle a parfois des éclats qui manquent de justesse. M. Michot a beaucoup à apprendre, mais il y a en lui l’étoffe nécessaire à un bon ténor.
Les chœurs se sont bien acquittés de leur tâche ; j’en ai été d’autant plus étonné, qu’en pareille circonstance, ce n’est ordinairement pas le côté brillant des représentations.
La tentative de M. Massue, à bien prendre, a été heureuse ; il a donné plus et mieux qu’on était en droit de demander.
Extrait de la Chronique de la semaine, par Balthasar Robin.
Duprez, le grand Duprez, va rentrer, dit-on, dans la lice, non plus comme chanteur, cette fois, mais comme compositeur.
Il va prendre, l’hiver prochain, la direction du Grand-Théâtre-Parisien, — celui que les gamins du quartier appellent gaiement le corridor Massue.
Et Duprez y fera représenter un grand opéra de sa composition. Nous lui souhaitons bonne chance.
Le Petit Journal 8 août 1865
Lien : Retronews
C’est irrévocablement mercredi qu’a lieu au Grand-Théâtre-Parisien, la première représentation du beau drame de Bouchardy, Jean le Cocher. Cette éloquente étude populaire, qui, il y a quelques douze ans, dépassa, à l’Ambigu, le chiffre de cent représentations, est montée par M. Massue avec un soin artistique. Six décorations nouvelles ont été confiées à l’habile pinceau de M. Victor Simon. Le cinquième acte a été entièrement refait, et un tableau nouveau, d’un intérêt saisissant, ajouté. Les principaux rôles sont confiés à MM. Saint-Léger et Renaudin, ex-artistes de l’Ambigu ; Dubois, du Théâtre-Déjazet, et Marchetti ; bien connu au théâtre de la rue de Lyon. Mme Antonia, ex-grand premier rôle des principaux théâtres provinciaux, joue le rôle de Geneviève. La fille de Jeane le cocher, c’est Mlle Atala Massue, talent, grâce, beauté printaniers.
On peut se procurer des billets d’avance à la librairie du Petit Journal.
Le Petit Journal 18 août 1865
Lien : Retronews
Le Grand-Théâtre-Parisien, de la rue de Lyon, donnait pour la première fois, avant-hier 15 août, un spectacle gratis qui se composait de Jean le Cocher, le drame à succès du moment, et d’un à-propos-cantate, Paris au désert.
L’auteur, Mme Mélanie Waldor, dont le nom si populaire a été acclamé par le public, a retracé les faits principaux du récent voyage de l’Empereur en Algérie.
Plusieurs couplet ont été bissés ; entre autres celui-ci. C’est un Arabe qui parle :
Que Mahomet me le pardonne,
La haine s’est éteinte en moi…
J’ai baisé la main qui me donne
La sécurité dans ma foi.
J’aime cet homme l’âme fière
Qui nous laisse, dans sa bonté
Bien plus que l’amnistie entière.
La vie avec la liberté !
Les charmantes filles de M. Massue, directeur du Grand-Théâtre-Parisien, jouent et chantent parfaitement Paris au désert. Cette pièce survivra à la circonstance qui l’a fait naître ; elle est jouée tous les soirs avec Jean le Cocher.
La Semaine musicale 24 août 1865
Lien : Gallica
À l’occasion du 15 août, trois musiciens ont été promus au grade de chevalier de la Légion-d’Honneur : ce sont MM. Duprez, l’ex-ténor de l’Opéra ; Mermet, l’auteur de Roland à Roncevaux, et Laurent de Rillé, compositeur et président honoraire de l’Orphéon à Paris.
Le Petit Journal 26 août 1865
Lien : Retronews
Au Grand-Théâtre-Parisien, Jean le Cocher continue ses succès qu’expliquent suffisamment le vif intérêt du drame et le talent des artistes. Dimanche prochain, 21e recréation populaire avec le concours de M. Nicolas, un prestidigitateur original, qui opère coram populo, sans le secours d’aucun de ces appareils, indispensables aux autres physiciens
. Le charmeur paraît en vêtement collant et pose les objets qui lui servent sur une table nue. M. Nicolas a obtenu une véritable ovation à sa première apparition sur la scène populaire de la rue de Lyon, sa seconde représentation aura le même succès.
Le Ménestrel 10 septembre 1865
Extrait de la Semaine théâtrale de Gustave Bertand.
Lien : Retronews
Le Grand Opéra Populaire de la Bastille prépare la Jeanne d’Arc de Duprez, annoncée pour le mardi 19 de ce mois. L’orchestre, composé de cinquante instrumentistes de mérite, sera dirigé par M. Maton, le chef d’orchestre ordinaire et extraordinaire de l’école Duprez ; quarante-quatre voix, disciplinée par M. Simiot, composeront les chœurs. L’exécution générale, dirigée par l’auteur avec le concours de M. Léon Duprez, promet d’intéressantes et fructueuses soirées au Grand Opéra Populaire.
Le Figaro 10 septembre 1865
Extrait des Échos de Paris de Jules Claretie.
Lien : Retronews
Le chevalier Duprez n’a pas renoncé à monter sa Jeanne d’Arc.
On la répète, au pas de course, au Grand-Théâtre-Parisien, où elle passera vers la fin du mois.
L’opéra de Duprez ne sera d’ailleurs joué que trois fois par semaine. Les autres jours, les acteurs de drame laisseront aux chanteurs le temps d’avaler des œufs frais.
Le Petit Journal 11 septembre 1865
Lien : Retronews
Les répétitions de Jeanne d’Arc, l’opéra de Duprez, se poursuivent activement. Six décorations nouvelles, 150 costumes sont terminés. La première représentation est fixée au 19 septembre.
Le Petit Journal 12 septembre 1865
Article de Timothée Trimm, l’un des fondateurs du Petit Journal, et daté de la veille (11 septembre 1865).
À propos d'une représentation à bénéfice au Théâtre-Lyrique en 1864 :
Ce morceau, qui fut bissé avec enthousiasme, l’an dernier, dans une représentation à bénéfice, au Théâtre-Lyrique, sera chanté par un jeune ténor qui donne, les mains dans ses poches, l’ut dièse de Tamberlick.
Confusion de date avec la représentation à bénéfice au Théâtre-Lyrique en 1860 (14 mai) ?
Lien : Retronews
Les Trois Jeanne d’Arc
Il est des sujets historique qui, après avoir reposé durant des demi-siècles, reviennent tout d’un coup à la mode.
Qui se souvient de la Jeanne d’Arc, de Soumet ?
Qui chante les airs de la Giovanna d’Arco, de Rossini ?
On a longtemps rêvé, de 1840 à 1848, une Jeanne d’Arc pour la tragédienne Rachel Félix.
Mais l’héroïne de Vaucouleurs n’a reçu à cette époque que les honneurs de la statuaire.
Il est vrai que, comme la statue, l’artiste était charmante…
Celle qui avait taillé le marbre était cette intéressante princesse Marie d’Orléans, morte dans la fleur de l’âge et du talent.
Tout à coup, la vaillante Jeanne revient au souvenir des plus grands esprits.
Je ne parle pas de M. Willaumé qui s’est fait l’historien de la martiale porte-étendard ; elle est un peu de sa famille.
Je ne parle pas des fêtes commémoratives d’Orléans et de la statue nouvelle érigée en l’honneur de cette noble victime des Anglais.
Je parle des compositeurs de musique et des théâtres qui se préparent à ressusciter avec éclat le champion féminin du gentil roi Charles VII.
Jeanne d’Arc va avoir de nouvelles palmes tissées par les mains les plus sincères.
Procédons par ordre.
Je connais, à l’heure qu’il est, trois Jeanne d’Arc destinées aux périlleux hasards de la représentation théâtrale.
Il est vrai que Jeanne est une gaillarde qui n’a pas peur du bruit — et qui n’eut pas sa langue dans son escarcelle.
L’évêque de Beauvais lui ayant demandé, pour l’embarrasser, si l’archange saint Michel était nu quand il lui apparut :
— Croyez-vous, répondit-elle, que Dieu n’ait pas de quoi lui donner un vêtement ?
La première Jeanne d’Arc est de M. Mermet, l’heureux auteur de Roland à Roncevaux.
M. Mermet a mis vingt ans à donner ce dernier ouvrage.
À ce point, qu’on était obligé d’entourer les mélodies avec du vétiver… pour que le temps ne les moisisse pas.
Il travaille au poème de la Jeanne d’Arc, à sa façon c’est à dire qu’il s’ensevelit dans tous les bouquins qui ont trait à la vaillante, il suppute les actes du procès, rapportés par du Haillan, — il collige l’Histoire de Jeanne d’Arc, par l’abbé Lenglet du Fresnoy ; la Vie de Jeanne d’Arc, par Edmond Necker ; il a même retrouvé, dit-on, la médaille qui fut frappée en son honneur au sacre de Charles VII à Reims, et qui porte sa devise, c’est à dire une main tenant une épée, avec cette inscription :
Consilio firmata Dei.
Si l’ami Mermet ne va pas plus vite que de coutume,
S’il consacre cinq ans au poème,
Et dix ans à la partition,
Il fera bien de se mettre, dès à présent, en relation avec M. Jules Cohen, le jeune auteur des beaux chœurs d’Athalie, qui sera indubitablement directeur de l’Opéra… en 1880.
Je n’ai rien pu voir du travail de Mermet ; il ne laisse pas traîner le moindre alexandrin. On ne trouverait pas un hémistiche de rechange sur son bureau,
Et il me faudra attendre la marche du temps pour applaudir l’élégante concision de son poème et l’énergique harmonie de ses cantilènes.
Mais il est une deuxième Jeanne d’Arc dont j’ai saisi le manuscrit sur le pupitre du souffleur,
Et dont quelques vers charmante sont demeurés, au système cellulaire, dans ma fidèle mémoire.
Il en est de la poésie comme du vin.
De même que l’on reconnaît le clos-vougeot et le Saint-Perray, le Château-Laffitte et le Chambertin, à leur bouquet,
De même on devine le poète, au parfum de sa muse.
Au premier acte de cette seconde Jeanne d’Arc, on chante la légende de Geneviève de Paris.
Il fut autrefois
Une humble bergère,
Suivant sur la terre
Les célestes lois.
Reine d’innocence,
Elle s’ignorait ;
Mais sur notre France
La sainte priait…
Et Dieu choisi cette fille, cet ange
Pour arrêter le terrible Attila ;
Car Dieu peut tout ! par son ordre tout change,
Et qui s’abaisse, un jour s’élèvera…
À la coupe facile de ces vers, taillés expressément pour les caprices du musicien, on reconnaît l’improvisateur Méry.
La musique de ce livret de Jeanne d’Arc, que l’auteur d’Heva a composée en collaboration avec M. Édouard Duprez, est de notre illustre chanteur Duprez en personne.
L’opéra a quatre actes et un prologue.
Le prologue se passe dans une forêt, au coucher du soleil. — Jeanne entend les voix du ciel qui lui inspirent sa mission, et leur répond.
Le premier acte se passe dans le village de Domrémy, où Jeanne repousse un fiancé pour suivre la bannière de France.
Au second acte, Jeanne se présente au roi et l’entraîne au combat.
Au troisième acte, on assiste au sacre de Charles VII à Reims.
Au quatrième acte, Jeanne est prisonnière ; touchés par son courage, ses ennemis veulent la sauver en lui offrant d’abjurer, elle leur répond :
Cette main vous épouvante ;
Ce glaive est levé sur vous ;
La martyre est triomphante,
Les bourreaux sont à genoux.
Enfin le martyre de l’Inspirée occupe tout le cinquième acte.
L’œuvre de Dupiez renferme des parties remarquables, l’Air avec voix célestes, qu’on pourrait appeler le morceau de la Révélation.
La cavatine du ténor : Je suis un soldat de fortune,
Un duo dramatique qui produira un grand effet,
Des chœurs splendides, et entre autres merveilles, la chanson de guerre de Dunois :
Sur son noir coursier de bataille,
Les yeux d’ardeur étincelants,
Quel géant irait à la taille
Du noble bâtard d’Orléans ?
Lorsqu’il combat, c’est pour la France,
Dans ses mains sa pesante lance,
C’est le tonnerre, allons ! soldats !
Répétez son cri des combats !
Le chœur
Dunois ! à la rescousse !
Allons ! bannière au vent !
La victoire nous pousse
En avant ! en avant !
Ce morceau, qui fut bissé avec enthousiasme, l’an dernier, dans une représentation à bénéfice, au Théâtre-Lyrique, sera chanté par un jeune ténor qui donne, les mains dans ses poches, l’ut dièse de Tamberlick.
Ce grand opéra, avec décors, costumes, chœurs, cent musiciens à l’orchestre, sera représenté au… Grand-Théâtre-Parisien.
Ce sera le premier opéra populaire, dans la véritable acception du mot.
On payait aux Italien 10 francs par stalle pour aller entendre Tamberlick.
On aura un ut dièse jeune, loyal, sonore, plein, sortant d’une poitrine de vingt-cinq ans — pour 20 sous…
Voilà la véritable démocratie musicale.
La Jeanne d’Arc de Duprez sera représentée le 15 octobre. — On répète, — et je ne manquerai pas à la première représentation.
Mais j’ai assisté hier à la représentation de la troisième Jeanne d’Arc, dont j’avais à vous parler.
Dans une grande baraque de la foire de Saint-Cloud…
La musique qui jouait : Tu n’en a jamais rien su, et Il y a de l’oignette, il y a de l’oignon ; ne m’a pas paru complètement apte à représenter le siècle de la Pucelle illustre.
D’autre part, les personnages avaient une fonction administrative, avant d’aborder leur rôle dans la tragédie.
Charles VII délivrait les contremarques ;
Le général anglais faisait la parade ;
Le beau Dunois sollicitait la foule ;
Et Jeanne d’Arc recevait l’argent dans son casque.
Entre la grosse caisse et le chapeau chinois se montraient en costumes exacts les fidèles La Hire, Xaintrailles, Chabannes, La Trémouille, — tous les demi-dieux de ce temps.
En voyant d’aussi éminents personnages en plein vent, on ne plaisantera plus désormais sur les bagatelles de la porte.
La baraque, contenant cinq-cents personnes, était pleine jusqu’aux toiles. — La recette a dû s’élever au delà de 250 francs. — Je connais plus d’un théâtre de Paris qui n’en pourrait pas dire autant…
Librettistes et musiciens, qui mettez en scène la fille inspirée… défiez-vous ! Jeanne d’Arc a tué Chapelain et déconsidéré Voltaire ; tous ses juges, dit Rapin, de Thoyras, sont morts de mort vilaine
.
Faites-la donc belle, grande, majestueuse, cette belliqueuse enfant qui combattait avec un sourire, qui frappait avec onction.
Et rappelez-vous que l’impresario de la foire de Saint-Cloud a tout respecté, même la vérité historique ;
Il a eu l’audace de faire tirer sur elle quatre coups de pistolet.
Sous prétexté que l’arme à feu était, sous Charles VII, en usage… depuis la bataille de Crécy.
C’est un exemple de couleur locale que je ne saurais trop vous recommander…
Le Petit Journal 15 septembre 1865
Lien : Retronews
Au Grand-Théâtre-Parisien on répète activement la Jeanne d’Arc de Duprez. En même temps on fait de nombreux changements dans l’installation des places qui offriront tout le confort possible aux spectateurs. En attendant, Jean le Cocher continue son succès destiné à devenir centenaire.
Le Figaro 17 septembre 1865
Lettre de Gilbert Duprez à Benoît Jouvin (1810-1886), rédacteur en chef du Figaro.
Lien : Retronews
Mon cher Jouvin,
C’est en vain que je vous cherche à Paris ; j’apprends que sur les bords de je ne sais plus quelle rivière vous vous livrez à la passion entraînante et désordonnée de la pêche. Heureux mortel ! J’ai cependant besoin de vous conter mes petites affaires parce qu’elles se rattachent à l’art, au théâtre, au public. J’ai tellement peur, si je ne les dis moi-même, de voir dénaturer mes idées, que je vous fais part de celles qui sont déjà en pleine voie d’exécution. Or, écoutez :
Je suis homme d’initiative. J’ai rêvé qu’il ne serait pas impossible de créer un Grand-Opéra populaire à l’autre extrémité du Paris fashionable, théâtre qui, monté sur une grande échelle, serait accessible aux plus petites bourses.
Les grands drames lyriques, dont les sujets devraient être choisis de préférence dans les fastes de notre histoire, y seraient représentés, sinon avec les pompes de l’Académie Impériale, du moins d’une façon satisfaisante, le principal attrait devant toujours être dans le mérite des œuvres et la valeur de leurs interprètes.
J’ai trouvé dans le directeur du Grand-Théâtre-Parisien, M. Massue, un homme tout disposé à suivre mon programme, et nous nous sommes mis à l’œuvre. Comme de raison, je me suis chargé de toute la partie artistique, lui de la partie matérielle. Restait donc le choix d’un grand sujet dramatique. Jeanne d’Arc nous a paru réunir les meilleures conditions. C’est, par excellence, l’héroïne populaire ! Nous avons donc choisi l’opéra de MM. Méry et Édouard Duprez, musique de… votre serviteur. Ici je vous vois dresser les oreilles ! Que pourra être l’opéra de Duprez ? Mon cher Jouvin, je n’en sais rien encore moi-même, tout persuadé que je suis que ce sera du moins l’œuvre d’un musicien convaincu, d’un homme qui, en composition dramatique, aussi bien que dans le chant ou dans l’enseignement, a des idées parfaitement arrêtées et à lui propres.
C’est donc une affaire à juger devant ce grand tribunal du public, qui, sans prévention ni parti pris, prononcera son arrêt. J’attends !
On a pu croire que mon principal but était de produire mes œuvres et mes élèves ; si cela était, convenez que je serai encore dans mon droit. Il n’en est rien cependant.
Si j’entre le premier en lice, c’est que j’ai cru que le créateur d’une grande entreprise devait le premier payer de sa personne. Maintenant, que ceux qui auront foi en moi ne craignent pas de se présenter. Je mets à leur disposition ce que j’ai créé en six semaines : une troupe lyrique qui compte parmi ses premiers sujets des chanteurs qui ont déjà fait leurs preuves sur les principaux théâtres de France et de l’étranger. On dit qu’il n’y a plus de ténors. Mon opéra en réunit quatre, artistes faits ou artistes d’avenir.
Quarante-cinq excellents choristes ; un orchestre de cinquante musiciens d’élite ; voilà ce que j’offre pour ma part.
M. Massue a fait pour mon opéra six décors neufs et deux-cent-cinquante costumes. Vous voyez que nous prenons la chose au sérieux, et j’espère, je pourrais presque dire je suis sûr, que le public et la critique consciencieuse feront de même. C’est pour cela que je vous ai initié à mes petits mystères de coulisse. Faites de mes confidences l’usage qu’il vous plaira et croyez-moi toujours
Votre bien affectionné
G. Duprez.
Paris, 15 septembre.
Le Temps 17 septembre 1865
Extrait de la Correspondance de Paris, de Hector Pessard.
Lien : Retronews
M. G. Duprez, dans une lettre rendue publique, vient de donner un corps à une nouvelle artistique dont il était vaguement question depuis quelques mois. Bientôt au Grand-Théâtre-Parisien, une troupe lyrique, recrutée avec soin par le célèbre professeur, quarante-cinq choristes, un orchestre de cinquante musiciens interpréteront la Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes, paroles de MM. Méry et Édouard Duprez. Cette solennité sera fort intéressante, car ainsi que le dit lui-même M. Duprez, il a, en composition dramatique aussi bien que dans le chant ou l’enseignement, des idées parfaitement arrêtées, et à lui propres
.
La Presse théâtrale 21 septembre 1865
Extrait de la Chronique musicale.
Lien : Retronews
M. Duprez est un homme d’initiative
, c’est lui-même qui le dit dans une lettre adressée à M. Jouvin et que le Figaro a publié. M. Duprez a rêvé qu’il ne serait pas impossible de créer un Grand-Opéra populaire à l’autre extrémité du Paris fashionable, théâtre qui, monté sur une grande échelle, serait accessible aux plus petits bourses. Les grands drames lyriques, dont les sujets devront être choisis de préférence dans les fastes de notre histoire, y seront représentés d’une façon satisfaisante, le principal attrait devant toujours être dans le mérite des œuvres et la valeur de leurs interprètes.
L’opéra d’ouverture sera la Jeanne d’Arc de M. Duprez. Que pourra être l’opéra de Duprez ? M. Duprez n’en sait encore rien lui-même ; cependant il est persuadé que ce sera du moins l’œuvre d’un musicien convaincu, d’un homme qui, en composition dramatique aussi bien que dans le chant et dans l’enseignement, a des idées parfaitement arrêtées et à lui propres.
Le Petit Journal 23 septembre 1865
Lien : Retronews
La première représentation de Jeanne d’Arc au Grand-Théâtre-Parisien, est irrévocablement fixée au premiers jours de la semaine prochaine ; les dernières répétitions générales sont indiquées pour samedi et lundi.
Tout fait espérer un éclatant succès.
En attendant, Jean le Cocher, le drame populaire, interprété d’une façon très intelligente par les artistes de M. A. Massue, suffit pour remplir tous les soirs la salle de la rue de Lyon.
Le Petit Journal 25 septembre 1865
Lien : Retronews
Lettre de Gilbert Duprez
Paris, 19 septembre 1865
Cher monsieur Timothée Trimm,
J’ai lu comme tout le monde votre charmant article sur les trois Jeanne d’Arc. Grâce à vous, un million de personnes savent aujourd’hui que j’ai composé un opéra sur ce sujet éminemment national, et que cet opéra va bientôt être représenté sur le Grand-Théâtre-Parisien. Mais, cher monsieur, vous n’avez pas tout dit. Et voyez comme on devient exigeant ! Je voudrais que votre public sût pourquoi cet ouvrage va être représenté et dans quelles conditions il le sera. Permettez-moi donc d’ajouter quelques renseignements à ceux que l’indiscrétion de mon souffleur vous a déjà donnés.
Depuis que le théâtre est libre, j’avais rêvé (musiciens et poètes rêvent souvent), j’avais rêvé qu’il manquait un théâtre à Paris, non une scène de drame, de vaudeville ou d’opérette, mais une scène lyrique, spécialement consacrée à ce que l’on appelle le peuple !… c’est-à-dire à la classe laborieuse, intelligente, vivace, de la population. Pour cette classe, si digne d’intérêt, l’opéra, le drame lyrique avec ses grands développements, son formidable orchestre, son harmonieuse cohorte chorale n’existe pas ; le peuple sait qu’il y a quelque part à Paris un lieu où se jouent avec éclat les œuvres de Rossini, Auber, Halévy, Meyerbeer. etc. L’orgue de Barbarie lui apporte quelquefois les échos des mélodies de ces divins maîtres ! Mais, à l’exception de l’ouvrier, qui, une fois par an, profite du spectacle gratis, le reste de l’immense majorité de la population laborieuse ne connaît l’Opéra que de nom. Pourquoi tout le monde ne pourrait-il pas jouir de ce plaisir d’élite ?… Pourquoi l’homme de labeur ne serait-il pas initié aux beautés de l’art ?… Le peuple n’a-t-il pas prouvé qu’il pouvait les comprendre en se portant en foule aux concerts de musique classique !… Ne sera-ce pas pour lui un attrait plus grand encore lorsqu’au charme de la musique se joindra l’intérêt du drame dont le sujet, choisi avec soin, devant toujours rappeler un grand fait historique, tiré des fastes de toutes les nations, et surtout de la nôtre, si riche en glorieux souvenirs ! L’idée d’un opéra populaire me paraît grande et féconde ; mais il fallait la rendre pratique, là était la difficulté ; faire construire un théâtre immense dans le centre de Paris ; c’était mettre en avant environ deux millions, se créer un loyer de 100 à 120,000 francs par an, c’est à dire se mettre au niveau des autres théâtres lyriques, et par conséquent ne pouvoir faire autre chose que ce qui existe déjà.
Un homme intelligent qui, selon moi, est en train de conduire à bon port une barque difficile à diriger, M. Massue, m’a ouvert les portes de son vaste théâtre, théâtre assez étrange peut-être, mais offrant, pour l’opéra, un avantage immense, celui d’une excellente sonorité ; bien éloigné du Paris élégant, mais placé au centre d’une nombreuse population intelligente et laborieuse, à laquelle se joindront bien, je l’espère, quelques-uns de nos raffinés. Pour ces derniers, M. Massue, sans rien changer à la disposition primitive de sa salle, a ajouté d’excellentes places de loges d’avant-scène, de tribunes, dans lesquelles les plus difficiles pourront se croire encore dans nos théâtre impériaux. Pour mon opéra, M. Massue a fait six décors neufs et deux-cent-cinquante costumes. Voilà pour la partie matérielle. En ce qui me concerne, voici ce qu’en moins de deux mois j’ai accompli. J’ai réuni un personnel de cent-vingt membres ; je n’ai reculé devant aucuns sacrifices pour attirer à moi des artistes d’un mérite déjà reconnu et largement rétribué autre part. C’est ainsi que j’ai pu détourner Mlle Maria Brunetti de la carrière italienne dans laquelle elle a obtenu de si brillants succès dans le nord de l’Europe. Un jeune ténor de genre était lié à un théâtre de Belgique ; pour l’attacher à moi, j’ai payé un dédit assez considérable. Un baryton d’une puissance remarquable, M. Gaspard, m’avait été signalé ; je l’ai disputé aux premières villes de France.
Enfin, un jeune ténor de force, à notes excentriques, paraîtra pour la première fois dans le rôle de Charles VII. Ajoutez à cela une douzaine d’autres jeunes artistes qui gagneront à se faire connaître, quarante-cinq excellents choristes, un orchestre de cinquante bons artistes dirigé par M. Maton, et vous verrez, cher monsieur, que c’est bien véritablement du grand opéra que l’on viendra entendre. Ajoutez encore à cela qu’un père de famille y pourra conduire sa femme et trois enfants pour la faible somme de cinq francs. N’est-ce pas là démocratiser l’art !…
Si cette lettre vous semble intéresser vos lecteurs, disposez-en, et recevez, cher monsieur avec mes remerciements, l’assurance de ma parfaite considération.
G. Duprez.
Voulez-vous que je vous annonce ce que prouve la lettre de Duprez ?…
C’est qu’avant un mois la bonne boutiquière, l’excellente femme d’ouvrier, l’intelligente mère de famille du faubourg Saint-Antoine diront comme Mme de Metternich :
— Je ne puis pas aller demain manger des marrons et boire du cidre chez ma voisine… c’est mon jour de loge à l’Opéra… populaire.
La Semaine musicale 28 septembre 1865
Lien : Gallica
Compte-rendu de H. Peragoux.
Épreuve avant la lettre.
Opéra Populaire. Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes et un prologue, paroles de MM. Méry et Léon Duprez ; musique de M. G. Duprez.
La première tentation sérieuse de décentralisation artistique va se produire sous peu de jours. Cet événement, résultat de la liberté théâtrale, emprunte une importance réelle à la notoriété de l’homme qui en a pris l’initiative, à la valeur de l’œuvre d’inauguration et aux résultats qu’il est permis d’en espérer. L’idée serait-elle prématurée, l’insuffisance d’exécution entraînerait-elle l’insuccès, en un mot, des causes fortuites, inhérentes aux difficultés d’organisation première, feraient-elles avorter cette généreuse tentative, que nous ne pourrions néanmoins nous dispenser d’applaudir à la courageuse volonté qui essaye d’ouvrir une voie nouvelle, et surtout de l’ouvrir en sortant des sentiers battus. En effet, créer une nouvelle scène lyrique dans des conditions ordinaires, n’eût déjà pas été d’une mince audace. Mais improviser un théâtre musical en dehors de la périphérie du public accoutumé, l’inaugurer par une œuvre inédite, former un régiment de combattants qui n’ont vu que le feu peu ou point, en un mot tirer un monde du néant, faire surgir la lumière du chaos, voilà ce qui eût effrayé une intelligence ordinaire et purement spéculatrice.
Si vous ajoutez à cela, risquer dans une lutte de quelques heures une réputation universellement établie et longuement contenue, dans un autre ordre d’idée, c’est là ce que peu eussent osé et voilà pourquoi, selon moi, M. G. Duprez a bien mérité de la génération artistique actuelle.
Réussira-t-il ? Sans aucun doute ! Plus que la plupart des partitions que nous avons entendues depuis dix ans, celle de Jeanne d’Arc est faite pour réussir. Écrite dans la manière italienne à laquelle nous devons Don Pasquale, l’Elisir, la Favorite, la Lucia, etc., etc., c’est-à-dire essentiellement mélodique, Jeanne d’Arc est une œuvre capitale auquel il a bien peu manqué pour être tout à fait une sœur des partitions que je viens de citer. Toutefois, après avoir constaté la valeur de l’œuvre et lui avoir rendu une justice sommaire, mais sincère, qu’il me soit permis de faire quelques réserves quant au sujet et aux détails.
Si le sujet de Jeanne d’Arc était tentant en raison du but que l’on se proposait, l’accoutumance du peuple aux conceptions musicales, en faisant vibrer sa libre patriotique, et en se mettant à sa portée, en revanche la marche épisodique que l’on serait forcé de suivre, le peu d’intérêt dramatique qui en résulterait sous peine de fausser l’histoire, voilà des raisons décisives qui eussent dû le faire rejeter sans miséricorde. Si j’avais été des amis de M. Duprez, voici ce que je lui aurais dit : Quoi, cher maître, vous écrivez de la musique à la façon de Donizetti et de Bellini et vous allez choisir un sujet Wagnérien (pardon pour le néologisme). Mais où trouverez-vous ces belles situations pathétiques qui ont permis au maître de pousser ces sanglots déchirants, les soupirs admirables qui ont fait pleurer notre génération ?
Et c’est si vrai, qu’à l’exception du 4e acte, où une belle scène dramatique lui a permis de se livrer entièrement à son inspiration et d’écrire une page merveilleuse, un duo qui vaut le trio de Lucie, M. Duprez n’a pu déployer que des qualités moyennes, de la franchise dans le rythme, de l’abondance, de la grâce dans la mélodie, de la science dans l’orchestration, quelquefois même un peu trop ; mais ce souffle puissant qui fait les œuvres immortelles, mais le courant d’idées, de sensations qui font surgir les grandioses mélodies de la Juive ou des Huguenots, ces inspirations primesautières manquent presque complètement dans la Jeanne d’Arc.
N’allez pas cependant conclure de là que ce soit une partition médiocre ? Non. Un prologue d’un style large et bien nourri, un duo très-chaleureux, des chœurs fort gracieux au premier acte ; un air et un duo mélodique et d’un charme tout particulier au deuxième, la scène du quatrième acte, un beau final, en voilà certainement assez pour faire une œuvre hors ligne. Sans compter les morceaux que j’oublie et qui sont tous remarquables par une allure franche et bien déterminée. Si M. Duprez faisait disparaître quelques phrases qui ont comme un vieux parfum de Grétry et quelques autres empruntées à des opéras qu’il a chantés, entre autres trois ou quatre mesures du chœur du premier acte qui sont tout entières dans la Reine de Chypre, à la scène du jeu, il nous aurait doté d’un bon opéra qui certainement prendrait rang dans le répertoire entre Don Pasquale et le Cheval de Bronze.
En somme, je le répète, le succès n’est pas douteux, et c’est justice. Dans quelques jours, nous aurons une nouvelle scène lyrique. La direction accueillera-t-elle les jeunes compositeurs ? Quand je dis jeunes, c’est par hyperbole ! Combien attendent depuis plus de dix ans ? C’est probable, car ce sera là un de ses plus puissants éléments de succès. Nous verrons alors si l’art est dans une période de décadence aussi grande que le proclament quelques-uns, ou si plutôt la décadence dont on nous menace n’était pas due à la routine administrative.
Le Petit Journal 4 octobre 1865
Lien : Retronews
La répétition générale de Jeanne d’Arc, l’opéra de Duprez, a eu lieu, samedi dernier, au Grand-Théâtre-Parisien, devant un public d’amis. L’effet produit par la musique et le poème a été très grand et les artistes ont fait merveilles. Quelques détails de mise en scène, costumes et décors, retarderont cependant la première représentation, qui est, nous affirme-t-on, fixée au jeudi 5 octobre. D’ailleurs, le succès de Jean le Cocher, qui ne se ralentit pas, permet d’attendre cette solennité artistique.
Article de Timothée Trimm.
Le suffrage universel en musique
Depuis quelques années les ; musiciens ont fait des réflexions profondes.
Il se sont dit que les auditeurs habituels de leurs œuvres étaient bien blasés. — Les gens du faubourg Saint-Germain font souvent les délicats.
La bourgeoisie elle-même les oreilles pleines de toutes les finales, depuis la terminaison en soupirs du temps de Gosseck et la coda de Rossini jusqu’au point d’orgue actuel.
Les compositeurs se sont donc demandé si c’était bien l’art qui était en décadence.
Ou si ce n’était pas plutôt l’auditeur qui avait des cavatines et des morceaux d’ensemble par dessus la tête.
Puis, petit à petit on s’est souvenu qu’il existait une classe nombreuse, intelligente, chaude de cœur, enthousiaste d’esprit, qui se nommait la classe ouvrière.
Et on s’est mis à la compter pour quelque chose en matière d’intelligence musicale.
Il y a trente ans, il existait encore une grande ignorance de la musique dans cette majorité de la population qu’on appelle les masses.
On trouve encore plus d’un ouvrier qui n’est jamais entré à l’Opéra, ni même à l’Opéra-Comique.
Le Théâtre-Lyrique, ce troisième spectacle à ariettes, était encore, même quand il s’exploitait en plein boulevard du Temple, trop cher pour les petites bourses.
Les Bouffes-Parisiens ont une salle trop petite pour pouvoir démocratiser leurs prix.
Les compositeurs se sont donc dit ceci…
Il existe pour la musique un public d’auditeurs tout neufs, que la satiété musicale n’a point encore atteints.
Travaillons pour ce public là… pour obtenir de plus éclatants triomphes.
Et on a crié successivement :
Les Orphéons
C’est-à-dire la réunion des chanteurs populaires, assemblés en compagnies, sous la direction d’un chef initié aux mystères de l’art. Ces chœurs, si nombreux dans Paris, ont admirablement exécuté des œuvres inédites des premiers compositeurs ; ils ont conquis dans la hiérarchie artistique une place d’honneur.
Après la création de Wilhem, si prodigieusement étendue de nos jours à tous nos départements, sont venus :
Les cafés chantants
L’un des premiers fut établi vers 1840 dans une des caves du boulevard Bonne-Nouvelle ; on y jouait l’opérette devant des buveurs de bière, et l’emplacement n’était pas trop incommode, puisque le Vaudeville, incendié, s’y établit en attendant l’heure d’inaugurer sa salle actuelle.
Plus tard, Narcisse, le comique, et Alice, la prima dona, chantaient sur des tréteaux, aux Champs-Élysées.
On mit un soir qu’il faisait du vent, un rideau pour garantir la cantatrice des courants d’air et cela devint une scène.
Aujourd’hui, les recettes des cafés-concerts atteignent des chiffres de 4 à 5,000 fr. par. soirée.
Et le peuple y a trouvé sa musique tout organisée.
On n’y chante pas exclusivement le Sapeur, et On a d’ça, c’est-à-dire la chansonnette.
Il y a des lauréats du Conservatoire dans les orchestres.
Et on interprète des morceaux du Barbier, de l’Étoile du Nord, de Norma, de Freischütz, de Robert le Diable et de Guillaume Tell, pas beaucoup plus mal qu’ailleurs.
Le ténor Malt donne l’ut de poitrine.
La signora Marie Bosc chante les mezzo soprani, aussi bien que la première chanteuse de M. de Leuven.
Michot, Mme Saxe, Mme Chollet-Bryard, sont descendus du Café-Concert pour arriver aux théâtres impériaux.
Et grâce à cette vulgarisation de la musique on entend le gamin fredonner comme un merveilleux l’air charmant la Dona è mobile, qu’on a traduit pour lui en ces termes :
Souvent femme varie,
Bien fol est qui s’y fie.
Une femme souvent
N’est qu’une plume au vent.
Cette épigramme de François Ier n’a pas effarouché le beau sexe — qui est demeuré en majorité dans ces catés-chantants, ou Suzanne Lagier gagne 40,000 francs et Thérésa 100,000 francs par an.
Le goût bien accusé du peuple pour la musique de théâtre et de salon s’était manifesté ; des esprits intelligents ont songé à l’initier à la grande musique, et M. Pasdeloup a inauguré :
Les concerts populaires de la musique classique
Là, pour un franc, on entend Mozart et Beethoven, Wagner et Mendelssohn, Weber et Gluck,
On soupire la symphonie.
On déroule dans ses capricieuses arabesques, la fugue classique.
On interprète la grande langue des maîtres ;
Eh bien ! ce style sévère, cette harmonie grave, ont été acclamés par le peuple.
Il a applaudi aux bons endroits,
Et prouvé qu’il était mûr pour une éducation musicale complète.
Aujourd’hui, une nouvelle transformation de l’art s’est effectuée en faveur des plaisirs populaires ;
On va inaugurer jeudi… c’est à dire dans deux jours…
Le grand opéra populaire, installé dans cette vaste salle du Grand-Théâtre-Parisien, à laquelle, dès son début, Alexandre Dumas a porté bonheur.
J’ai assisté avant-hier à la répétition générale de Jeanne d’Arc.
C’est une véritable partition à grand spectacle ;
Des décors charmants,
Des costumes splendides,
Cinquante musiciens à l’orchestre,
Une prima dona, superbe sous son armure, et qui chantait avec un chœur d’anges invisibles, de façon à n’être pas au-dessous de ses partenaires célestes…
Un premier ténor, qui nous rend, d’une façon saisissante, le style, la grande manière, le phrasé splendide de Duprez, son maître.
Un second ténor qui, en attendant qu’il sache complètement le métier, donne des ut dièse qui ont soulevé un tonnerre de bravos.
Des vers charmants de Méry, qui percent, de ci, de là, l’harmonie comme les fleurettes de mai sortent de l’herbe verte…
Tout cela est en plein faubourg Saint-Antoine,
Et la classe ouvrière aura, en fait de musique, son grand répertoire.
Il naîtra d’autres scènes, et cela est nécessaire.
Alexis Azevedo, le savant critique de l’Opinion nationale, me disait hier avec son bon sens ordinaire :
— Nous sommes obligés d’aller chercher des chanteurs en Italie, parce que l’Italie a vingt scènes lyriques pour une… Le jour où, comme elle, nous ferons des chanteurs, les ténors et les barytons, les contraltos et les basses ne seront plus des objets d’importation…
Il y a encore un avantage dans la musique démocratisée.
L’exemple amène la révélation de la vocation.
Il existe des voix dans ces classes travailleuses, si sensibles à la mélodie.
Il suffit pour s’en convaincre d’écouter à la porte d’une usine, à la fenêtre d’un atelier de couturières ou de modistes…
Le peuple de Paris a une merveilleuse aptitude pour retenir les airs.
Les jeunes filles font tout naturellement la roulade à la tyrolienne, la roulade naturelle de l’école de Chollet.
Il existe des corps d’ouvriers, les peintres en bâtiments, par exemple, qui possèdent le répertoire de Gueymard et de Faure au complet,
Et qui font des variations, non sur la quatrième corde, à l’imitation des violonistes…
Mais sur la corde à laquelle ils sont suspendus, en passant leur pinceau sur le fronton des maisons… qu’ils décorent.
Multipliez les scènes lyriques, donnez à la foule les grands exemples du chant.
Et vous verrez plus d’un Gueymard en tablier de cuir ou de serge, plus d’une Damoreau en robe d’indienne… sortir de cet auditoire enchanté.
Le désir de retenir les classes populaires dans les anciens théâtres de musique a gagné l’honorable directeur du Théâtre-Italien, M. Bagier.
La Patti lui coûte cher.
Fraschini vend ses notes un prix fou.
La salle Ventadour n’est pas grande, et on a une très petite loge pour dix louis…
Toutefois l’impresario a voulu conserver des places aux classes populaires, un peu hautes il est vrai, mais où on entend bien,
Et qui seront livrées au public au prix de 3 francs la stalle numérotée.
Ceux qui cherchent plus entendre qu’à voir, et surtout qu’à être vus, ne dédaigneront pas ces places musicalement favorables… Il importe peu que l’on soit haut perché… puisque le son monte…
Et nous devons un bon point à M. Bagier pour sa récente décision.
Je sais plus d’une scène encore où la musique reparaîtra sous ses formes diverses.
Les nouveaux Délassements-Comiques qui s’achèvent au boulevard du Prince-Eugène vont avoir leurs opérettes.
La petite salle du boulevard des Italiens, occupée jusqu’à présent par des expositions de peinture, et qui sollicite pour sa partie mimique le concours de M. Champfleury, ce maître de la pantomime, organise son orchestre et ses chœurs.
On chantera bientôt partout.
On exécutera partout les chefs-d’œuvre de nos maîtres anciens et modernes.
L’art revivra plus fort que jamais.
Une large infusion de l’élément populaire dans le dilettantisme, dit M. Alexis Azevedo, peut seule le ressusciter en le remettant dans ses voies naturelles.
Nous avons eu le Suffrage Universel en politique.
Nous allons avoir, grâce aux innovations annoncées, le Suffrage Universel en musique.
Le Ménestrel 8 octobre 1865
Lien : Retronews
Nouvelles diverses. — Un de nos confrères nous indique une légère erreur commise à propos des diverses partitions ayant pour sujet Jeanne d’Arc, dont il a été question dans notre dernier numéro. Celle de Verdi, que nous croyions ne pas avoir été traduite en français, existe, paraît-il, à l’état de traduction, et, chose qui ne laisse pas d’être piquante, c’est précisément M. Édouard Duprez, l’un des auteurs de la Jeanne d’Arc du Grand-Théâtre-Parisien, qui en est le traducteur : réparation à qui de droit.
Gazette nationale ou le Moniteur universel 8 octobre 1865
Extrait du Bulletin des théâtres.
Lien : Retronews
Grand-Théâtre-Parisien. — Prochainement, première représentation de Jeanne d’Arc, grand opéra de M. Duprez. En attendant, Jean le Cocher continue son succès ; tous les soirs, salle comble.
Le Figaro 10 octobre 1865
Extrait du billet d’Albert Wolff.
Lien : Gallica
Jeudi on jouera au Grand-Théâtre-Parisien Jeanne d’Arc de Duprez.
Je parle donc du nouvel opéra avant de l’avoir entendu.
Seulement, Ernest Reyer, qui ne respecte rien, m’a dit après la répétition générale :
— L’opéra de Duprez tient le milieu entre Roland à Ronceveaux [opéra d’Auguste Mermet créé en 1864] et Jeanny l’ouvrière [romance populaire d’Émile Barateau et Étienne Arnaud, à la veille de la révolution de 1848].
Le Petit Journal 10 octobre 1865
La première représentation de Jeanne d’Arc, grand opéra en cinq actes de MM. Méry et Duprez, sera donnée demain mardi au Grand-Théâtre-Parisien.
L’opéra de M. Duprez a été monté avec un soin dont on ne saurait trop féliciter M. Massue, directeur de ce théâtre, qu’il a su placer en si peu de temps au niveau des grandes scènes parisiennes.
En représentant un grand opéra nouveau, M. Massue complète son programme qui avait été de créer un théâtre populaire de drame et d’opéra dans un quartier qui n’avais pas, jusqu’à ce jour, de salle de spectacle.
L’opéra de M. Duprez, dont le sujet est si éminemment patriotique, aura un immense succès ; l’enthousiasme des personnes qui ont assisté aux répétitions générales nous le fait espérer.
Le Petit Journal 11 octobre 1865
Lien : Retronews
Le Grand-Théâtre-Parisien devait donner aujourd’hui la première représentation de Jeanne d’Arc. Mais les médecins ont ordonné au ténor, M. Ulysse du Wast, deux jours encore de repos.
C’est donc jeudi, sans remise, qu’aura lieu cette solennité musicale.
La Comédie 15 octobre 1865
Article de Jean [Ledigre ?]
Lien : Retronews
Jeanne d’Arc Jettatore.
Il n’est que trop vrai, hélas ! la libératrice a porté malheur à tous ceux qui ont cherché un embrassement ou un regard d’elle. Chapelain fit une ode, et l’on cria merveille ; il fut à la Pucelle
héroïque, et l’on sait ce qu’il en advint.
Voltaire eut la prescience de son maléfice et se moqua d’elle. Ce diable de Voltaire avait le secret des exorcismes. Nul ne dénombrera combien d’esprits sérieux ou de poètes aventureux Jeanne a égarés et comme perdus sur ses traces. Épique, historien, tragique, commentateur, odelettier, tout y a sombré. Qui sait leur nom ? Un compilateur, Chaussard, au commencement de ce siècle ou la fin du dernier, a, dans un Traité historique et complet
, groupé un millier de noms, d’œuvres et d’essais consacrés à la vierge aux embrassements stériles. Et depuis, grand Dieu ! On loue Schiller, étranger, d’avoir consacré un panégyrique dialogué plutôt qu’un drame à l’héroïne française ; on blâme Shakespeare de l’avoir traité à la façon d’Arouet, bien qu’un peu moins plaisamment. Mais qui sait que d’Avrigny, Alexandre Soumet, M. de Puymaigre, M. du Haldat ont écrit sur elle quatre tragédies ? Nous en omettons. Des dramaturges même ont été sa proie. Enfin, Jeanne, inaccessible à la poésie, est-elle plus propice à la musique ? Déjà Verdi a répondu au monstre décevant avec Giovanna d’Arco. Gounod a reculé ; M. Germain, le maestro que nous envoie la Garonne, a sacrifié lui-même à l’idole, et alimenté le feu qui le consume avec les débris de l’autel qu’il lui avait élevé. M. Mermet, plus brave (Roland oblige !) ou plus candide (Roland dispose !) interroge aujourd’hui le sphinx d’Orléans qui, avant qu’il soit quinze ans, le dévorera. Enfin, ce vaillant Duprez, ce chanteur émérite, qui sacrifie encore à tous les dieux lyriques, ce maître ès-ut, traîne depuis dix ans — plus peut-être — le glorieux boulet que l’héroïne scelle à son pied. Après mille attentes et tous les sacrifices, il se croyait au port, et nous l’y croyions aussi. Mais la maligne influence est venue se mettre à la traverse. Oyez les incidents de cette incroyable soirée ! Nous devrions tracer ici une analyse minutieuse, écho d’une critique attentive, et c’est à la chronique, hélas ! que nous voilà forcé de passer la plume et le crayon.
Jeanne d’Arc est promise au Grand-Théâtre. Grand est le mot. On le juge bien surtout, alors qu’on le voit rempli ainsi qu’il était dès sept heures par les flots du Paris artiste, du Paris populaire, du Paris universel. Un océan de têtes était à tous les honneurs. Le rideau se leva devant l’émotion […] surexcitée […] enthousiasmée par avance. Nul ne s’interrogeait des yeux. Nul ne pouvait ni n’osait. D’abord il n’est possible de se voir de face, au Grand-Théâtre, qu’à la condition de gagner un torticolis, et puis l’on pressentait qu’une fée maligne était dans l’air. L’orchestre parut sourd. Le rideau s’éleva, le décor était sombre. Jeanne vint immerger sous cette feuillée frémissante au bruit de ses voix
et cherchant en vain la sienne, hélas ! Une éclaircie pourtant se fit à travers ces premiers nuages. Le rideau du fond se fendit. Un ciel lumineux se laissa voir et des archanges dans leur gloire entonnèrent un petit air héroïco-séraphique d’un rythme assez vif, sur lequel on eût pu galoper si l’on eût été chez Offenbach. Ce ne fut qu’un mirage. Jeanne s’évanouit… c’était dans la pièce. Mais à l’acte suivant, elle s’évanouit pour tout de bon. Cet acte était plus qu’à demi joué ; déjà on avait eu la fête de l’Aubépin
, riant tableau ; déjà on avait eu un chœur de paysans, la cavatine du ténor, un chœur de jeunes filles efflorescent et un grand duo assez largement traité et chanté avec beaucoup de vigueur et d’élan par M. Ulysse du Wast et le baryton Gaspard… À ce moment, Jeanne inspirée — mal inspirée…
Elle est folle !… ou tout comme.
Le croiriez-vous, elle s’habille en homme !
Jeanne apparut sous les traits d’un bel écuyer. Apparut est le mot, elle entrouvrit les lèvres et dit, avec un geste imité, deviné à l’acte de Caracalla dans les Folies Dramatiques : Je ne peux plus parler ! Je ne peux plus chanter.
Le rideau se baissa au milieu d’une anxiété inexprimable. Le régisseur vint : Mademoiselle Maria, dit-il, est assez gravement indisposée, mais elle a autour d’elle trois médecins et nous espérons pouvoir donner suite tout à l’heure à la représentation.
Un quart d’heure après, le régisseur encore reparu : L’indisposition de Mademoiselle Maria dure ! s’exclama-t-il avec une affliction profonde ; mais nous pourrons continuer cette petite fête de famille grâce à Mlle Antoinette qui a appris le rôle en entendant les répétitions et qui fera ses efforts pour mériter votre indulgence et vous satisfaire.
(On acquiesce et on applaudit). — Nous savons bien, ajoute le bon régisseur, que le spectacle sera indigne de vous être offert, mais pendent l’entracte les ouvreuses feront le tour de la société et distribueront des coupons pour une représentation prochaine, à laquelle nous désirons vivement vous voir encore accourir.
L’allégresse à ces mots se peint sur tous les visages. Mlle Antoinette, Jeanne IIe, apparut, essayant un duo avec le bouillant Lionel. Quelques-uns remarquèrent bien que la nouvelle Jeanne avait omis de revêtir le costume de Jeanne Ière et que pour monter sur le cheval qui devait la conduire à la cour et à la victoire elle avait conservé son costume de bergerette. Sa sortie, cependant, souleva un enthousiasme indescriptible, et si le cheval eût piaffé, nul doute qu’alors on n’eût rappelé le maestro.
Le deuxième acte offrit d’abord une petite scène assez réjouissante. La Trémouille et La Hire en viennent aux gros mots. La Trémouille eut un succès de voix, et Dunois, qui intervient, un succès de costume. Le roi Charles VII, apparaissant et chantant, eut le succès promis à tous les ut possibles. Aussi en donna-t-il un bientôt, trop tôt, un ut frémissant, prodigieux, éclatant, qui fut aux étoiles. On applaudit, on acclama, on répéta, le roi salua. On avait oublié Jeanne, et l’ivresse était universelle… mais Jeanne se remontra et avec elle le guignon… Le rideau se baissa brusquement, et la pièce fut interrompue… Un spectateur affolé demanda la tête de M. Maton, qui, selon lui, avait amené le dénouement hâtif en tirant inconsidérément la ficelle
. Le régisseur lui dit : Que ferez-vous de la tête d’un musicien, ce musicien fut-il un accompagnateur improvisé chef-d’orchestre ?
Le spectateur insistait et trouvait le spectacle bon. — Ah ! vous trouvez que cela allait bien, s’écria le directeur Massue avec un geste sublime… eh bien ! on va continuer ! ! !
Nous nous rassîmes en frémissant. Mais le rideau s’étant relevé encore, le commissaire de police de service parut sur la scène avec l’impresario, et dans une objurgation paternelle et pleine d’un excellent esprit […], obtint de l’auditoire et du […] impatient, (c’était un photographe, autrefois […]) de remettre la partie à des jours meilleurs […] d’applaudissements le commissaire, qui […] à un dieu, venait de jeter son : Quos ego
à des mots tempétueux ; puis chacun s’en fut coucher comme dans la ballade de Marlborough en devisant des événements de la soirée… et des frères Davenport.
Le Ménestrel 15 octobre 1865
Extrait de la Semaine théâtrale de Gustave Bertrand.
Lien : Retronews
Ce n’est pas encore pour cette fois que nous pourrons rendre compte de la Jeanne d’Arc, de G. Duprez. La première représentation, tant de fois retardée, avait commencé pourtant jeudi. L’assemblée était plénière et brillante ; on y remarquait M. Camille Doucet, chef de la division des théâtres, et M. Émile Perrin, directeur de l’Opéra. Déjà on avait applaudi l’ouverture, ainsi que le prologue, où Mlle Maria Brunetti avait chanté les strophes de l’extase avec beaucoup de grâce, et tout faisait présager une belle soirée, mais la fatalité s’en est mêlée. Mlle Brunetti, dès le premier acte, s’est trouvée tellement indisposée qu’il lui a fallu quitter la scène, et le rideau est tombé sur cet accident. Au bout d’un instant, le régisseur venait annoncer qu’une jeune artiste, Mlle Antoinette Arnaud, chargée du rôle de Perrine, s’offrait à jouer aussi celui de Jeanne d’Arc, qu’elle avait répété. Grâce à cette courageuse volontaire, la représentation reprit son cours, mais dès lors elle était en désarroi. On applaudit pourtant plus d’un endroit vaillamment enlevé par les chœurs, ou par le ténor Ulysse du Wast, le baryton Gaspard ; on fit même bisser un air de Charles VII d’une belle allure, et chanté par la haute-contre Gaston Aubert. Mais le chef d’orchestre, M. Maton, trouvant que l’ensemble n’avait pas toute la précision, tout l’aplomb nécessaire, fit baisser tout à coup le rideau vers la moitié du deuxième acte, au grand étonnement, je dois le dire, de tout le public, qui ne paraissait pas croire à la nécessité de cette mesure extrême. Peut-être, cependant, valait-il mieux s’y résoudre que de laisser juger une œuvre de cette importance sur une audition si incomplète. Sous peu de jours, Jeanne d’Arc sera donnée, et les spectateurs de la représentation de jeudi sont invités à venir reprendre leurs places à cette nouvelle et plus sérieuse audition. Nous l’attendons nous-même impatiemment pour juger en toute connaissance de cause l’intéressante et sympathique entreprise d’un artiste tel que Gilbert Duprez.
Le Journal des débats politiques et littéraires 15 octobre 1865
Extraits des rubriques Faits divers et Bulletin des théâtres de P. David.
Lien : Retronews
Faits divers. — Avant-hier, on donnait au Grand-Théâtre-Parisien la première représentation de Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes, paroles de M. Méry, musique de M. G. Duprez. La salle était comble. Le prologue avait été favorablement accueilli du public et un chœur de villageois avait excité des applaudissements.
Dans le cours du premier acte, Mlle Ida Brunetti, qui remplissait le principal rôle, celui de l’héroïne de Vaucouleurs, fut prise subitement d’un enrouement tellement grave qu’on dut immédiatement baisser le rideau. Il se releva bientôt, et le régisseur vint annoncer que le rôle allait être continué par une autre cantatrice, et ajouta que si le public le préférait on rendrait les billets. Il y eut un intervalle suivi d’une nouvelle annonce : l’actrice sur qui l’on comptait pour cet acte de complaisance craignit de ne pouvoir soutenir un si lourd fardeau, et se fit excuser.
Le commissaire de police de service intervint alors, et déclara qu’on allait rendre l’argent ou que les billets serviraient pour une autre représentation.
Les spectateurs ont accédé à cette dernière proposition.
Bulletin des Théâtres. — Les personnes auxquelles des billets ont été remis pour la première représentation de Jeanne d’Arc au Grand-Théâtre-Parisien sont priées de se rappeler les numéros des places qu’elles occupaient et de les envoyer à l’administration, qui leur remettra en échange un billet numéroté pour la nouvelle première représentation.
Le Figaro 15 octobre 1865
Extraits du Petit Courrier des Théâtres d’Adolphe Dupeuty.
Lien : Retronews
Hier, jeudi, a failli avoir lieu la première représentation de Jeanne d’Arc, au Grand-Théâtre-Parisien.
Mlle Brunetti, chargée du premier rôle, a été atteinte d’un enrouement subit qui l’a empêchée de chanter, et elle a ressenti un si vif regret d’apporter obstacle à la représentation, qu’une attaque de nerfs en a été la suite.
On a proposé de donner le rôle à une cantatrice qui avait assisté aux répétitions, mais n’était pas en état de le chanter. M. Massue, le directeur, qui tenait sans doute à conserver la recette encaissée, était fort de cet avis. Mais le chef d’orchestre, M. Maton, soutenait, avec raison, qu’il était impossible de mimer un opéra ; chose, en effet, qui ne s’est jamais faite.
La pièce a commencé, malgré toutes les oppositions ; mais M. Duprez et le commissaire de police ont autorisé M. Maton à tirer la sonnette au moment où la représentation lui paraîtrait compromise.
Ce n’est donc pas de lui-même, ainsi que le bruit en a couru dans la salle, que le chef d’orchestre a fait baisser le rideau au milieu du second acte.
M. Maton n’a fait qu’obéir à une consigne.
Extraits du Courrier de Paris d’Henri Rochefort.
Ce n’est pas en revanche pousser trop loin la curiosité que de chercher à supputer vers quelle heure de la nuit aurait fermé le Grand-Théâtre-Parisien, si la Jeanne d’Arc de Duprez était allée jusqu’à la fin. De cet opéra, qui est devenu comique par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, on n’a guère vu que le premier acte. Les spectateurs étaient pourtant pavés de bonnes intentions à l’endroit de l’ex-interprète de Guillaume Tell. La salle resplendissait de jeunes filles du Conservatoire, qui avaient des cheveux dans le cou et cinq cent mille francs dans le gosier. Toutes les voix qui avaient tenté vainement de donner l’ut s’étaient réunies à la gare de Lyon dans une commune admiration pour l’illustre chanteur. La majorité paraissait avoir été recrutée parmi ces artistes rêveuses qui ont à la fois les yeux au ciel et des repentirs derrière les oreilles. Dans notre monde on nomme ces femmes-là des Valentines. J’ai distingué parmi les hommes trois membres du conseil municipal de Vaucouleurs.
Tout faisait espérer un triomphe. On racontait dans les couloirs que le ténor était un jeune homme très, comme il faut qui s’était brouillé avec sa famille pour suivre son irrésistible vocation. Il avait triplé sa confiance en lui-même au moyen de ce raisonnement :
— Tous les véritables artistes ont commencé par être jetés à la porte par leurs parents ; j’ai été jeté à la porte par mes parents, donc je suis un véritable artiste.
On peut avoir été renié par sa famille et ne posséder aucun talent, mais le fait est que ce jeune inspiré est bien près d’en avoir. Malheureusement, dès le commencement du second acte, la pièce a été entremêlée de régisseurs qui se sont succédé presque sans interruption jusqu’à la chute du rideau. À peine un régisseur était-il sorti par une porte qu’il en rentrait un second par une autre. Longchamp pendant le vendredi, qui est le plus beau jour, peut seul donner une idée d’un tel nombre de régisseurs qui venaient tous annoncer quelque chose. Le vrai titre de l’ouvrage de M. Duprez, serait :
Jeanne d’Arc
opéra en cinq annonces
et neuf régisseurs.
Le déballage des régisseurs a commencé lorsque la cantatrice chargée du rôle de Jeanne d’Arc s’est trouvée subitement indisposée. On a cru d’abord que Duprez lui-même allait jouer la fameuse Pucelle. Pourquoi riez-vous ? on a vu des choses plus extraordinaires. Mlle Antoinette (comme le nom est bien italien !) s’est offerte avec un dévouement sans bornes à continuer le rôle à la place de sa camarade, et peut-être le Grand-Théâtre-Parisien compterait-il un succès de plus si l’arrivée du sire de La Trémouille n’avait pas tout gâté. Quand on a vu ce preux costumé en sorcier de Mabille et rendant des sons par la barbe, il n’a pas fallu moins de trois ou quatre régisseurs superposés pour calmer l’effervescence populaire. Si la famille assistait à la représentation, elle a dû être bien flattée de reconnaître son ancêtre sous ce travestissement moyen âge.
Au moment où l’ovation se dessinait, le chef d’orchestre, probablement jaloux de la gloire musicale de Duprez, a crié : Au rideau ! et un commissaire de police est venu prier l’assis-tance de vouloir bien évacuer le plus tôt possible les grands et les petits confortables.
Le grand coupable dans tout ceci c’est La Trémouille ; cependant, si M. Duprez s’imagine avoir composé un opéra, sa santé m’inquiète sérieusement. De temps en temps, un in-connu se présente au guichet de l’Échelle et dit au factionnaire :
— Je suis Pépin le Bref ; ma place est aux Tuileries. Veuillez me laisser passer afin que j’aille prendre possession de mon trône.
Le factionnaire, qui est habitué à ces sortes de déclarations, appelle un sergent de ville ; on fourre l’inconnu eu fiacre et on le dirige sur Charenton où il est reçu à bras ouverts.
Je ne crois pas friser la politique en constatant que M. Duprez, comme compositeur, me fait l’effet d’un homme qui ne tardera pas à se présenter au guichet de l’Échelle.
Le Siècle 17 octobre 1865
Extrait de la Partie littéraire, feuilleton du 17 octobre 1865, par Gustave Chadeuil.
Lien : Retronews
Lorsque le Grand-Théâtre Put inauguré, près de la Bastille, rue de Lyon, aux antipodes du nouveau Paris, il fut facile de prévoir que ses commencements seraient tourmentés, à cause de ses nombreuses place à prix réduit. Toute entreprise qui se fonde enrichit rarement son fondateur ; c’est la loi commune. En pourrait-il être autrement ? Évidemment non. Il faut d’abord tâtonner, refaire, et encore, jusqu’à ce qu’on ait rencontré le mieux relatif. Or, tous ces changements successifs ne s’opèrent pas sans que des intérêts en soient lésés. On arrive ainsi progressivement, avec des sacrifices imprévus, à constituer quelque chose de solide, au détriment des premiers calculs.
Le but du Grand-Théâtre-Parisien était originairement de faire entendre des drames, des comédies, des opérettes, des vaudevilles, comme dans une tour de Babel artistique, où tous le genres seraient confondus. Pour auditoire on aurait le public économe de deux faubourgs. On s’est aperçu depuis qu’on avait compté sans cet être impersonnel qui s’appelle monsieur Tout le monde, et il a fallu remanier de si beaux projets.
Alors, on s’est demandé pourquoi l’on ne transformerait pas cette vaste salle en un Grand-Opéra populaire, pour démocratiser la musique, comme aux concerts de Pasdeloup ?
Rien n’était plus simple, en apparence du moins.
Mais il manquait l’élément principal, l’argent, sans lequel toute œuvre est morte-née. Sur ces entrefaites, on est allé trouver un financier bien connu, qui s’est chargé de pourvoir à tous les frais. Que manquait-il encore ? Un nom célèbre comme drapeau. Duprez s’est chargé de fournir ce nom. Personne ne pouvait le récuser. Durant sa longue carrière d’artiste comme chanteur, comme professeur du Conservatoire, comme fondateur de son école spéciale de chant, partout, toujours, il a rêvé d’accomplir le miracle de la multiplication des talents et des théâtres lyrique à bon marché.
Et voilà comment le Grand-Théâtre-Parisien est devenu le Grand-Opéra populaire, en un tour de main, sans que les spirites s’en soient mêlés.
Restait un doute : N’était il pas à craindre que M. Duprez profitât de sa position pour faire jouer tous se ouvrages en réserve, Juanita, la Lettre au bon Dieu, Samson, la Folle de la reine, Jeanne d’Arc, l’édit et l’inédit, pour se dédommager des préjudices anciennement causés à sa réputation de compositeur, en ce qui concerne ses premiers essais, et des retards trop longtemps subis par ses dernières partitions ? À cet égard, on nous a dit qu’on n’avait rien à redouter, que les précautions étaient prises, qu’on aurait un répertoire fourni par tous les maîtres anciens et nouveaux. Très-bien.
Les récalcitrants (ils sont nombreux) se sont rabattus sur une autre objection : ils ont eu l’air de croire que le personnel comprendrait indistinctement tous les élèves de Duprez, et que, pour varier le menu, l’on aurait des ténors-Duprez, de barytons-Duprez, des basses-Duprez ; des sopranos, des mezzo-sopranos, des contraltos-Duprez, d’après la méthode Duprez, l’art du chant-Duprez ; Duprez toujours, c’est-à-dire des Miolan-Carvalho, des Van-den-Heuvel, des Marie Battu, des Marimon, etc. Où serait le mal ? Qu’il nous présente des sujets comme ceux-là, par douzaines ; ils valent ceux du Conservatoire.
Puis, a-t-on ajouté (que n’ajoute-t-on pas ?) après la série des élèves école Duprez, nous aurons encore Duprez, qui remontera gaillardement sur la scène, en qualité de ténor ou de baryton, tantôt l’un, tantôt l’autre, selon les exigences ou les cas. D’où l’on a conclu que le Grand Opéra populaire serait la vivante incarnation d’un seul homme, et qu’il y aurait sans doute un garde à la porte pour répondre aux auteurs profanes, aux chanteurs profanes, eut librettiste profanes : Hors de Duprez, point de salut !
Je répondrai volontiers, comme le Loustic d’Eugène Sue : Ayez pas peur !
M. Duprez peut avoir obtenu des succès d’enthousiasme dans Guillaume Tell, avoir joui pendant vingt ans de la faveur publique, avoir créé son école, il peut composer des opéras, posséder un frère qui écrit des poèmes, tirer encore parti de sa voix transformée, diriger une scène, distribuer des rôles, surveiller l’exécution d’ouvrages importants, engager des artistes, tout faire en un mot comme un autocrate de Saint-Pétersbourg ; il sera bien obligé de s’arrêter, s’il empiète, et de donner satisfaction au public, de qui l’on relève, qu’on soit directeur ou n’importe quoi. Je trouve là ce qu’il faut pour me rassurer.
Le Grand Opéra populaire a donc opéré sa réouverture, je me trompe, essayé d’opérer sa réouverture, par la Jeanne d’Arc, de M. Duprez, d’après le poème de M. Méry.
Ce serait ici le cas d’appeler à notre aide tous les esprits frappeurs des Davenport pour nous aider dans le récit de cette mémorable soirée. Bah ! nous nous en passerons ; ils nous dicteraient des fautes d’orthographe, ce qui leur arrive assez souvent, comme pour prouver qu’on peut être un pur esprit et ne pas même savoir sa langue. Tout s’oublie si vite dans les royaumes éthérés ! Puis, s’il faut tout dire, les malheureux ont bien assez à faire en ce moment ; on les sollicite de tous côtés pour mettre les tables et les têtes à l’envers, en attendant que le bon sens public fasse cesser ce vilain jeu.
Il y avait foule. Les confortables étaient occupés dans toute la longueur de la salle. Deux mille personnes, pour le moins, venues des quatre points cardinaux de Paris, pour assister à la représentation de la Jeanne d’Arc de M. Duprez.
On sentait qu’une grosse partie allait s’engager, avec des réputations pour enjeu.
Chut ! le rideau se lève.
Silence partout.
Et le prologue suit son cours, parfois interrompu par des bravos. On se regarde, on est content. Qui donc avait dit qu’on avait trop précipité les études, que la distribution laissait beaucoup à désirer, que l’ouvrage ne marcherait pas ? Je reconnais bien là les chers confrères : ils vendent la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Le premier acte s’avance, clopin-clopant ; mal soutenu par l’interprète principale, visiblement indisposée. Tout à coup Mlle Brunetti (Jeanne d’Arc) fait des signes de détresse, en ouvrant une jolie bouche d’où le son ne sort plus. Elle est donc frappée de mutisme subit, comme si la vraie Jeanne d’Arc s’opposait à l’usurpation ? Je serais presque tenté de le croire ; les esprits frappeurs sont capables de tout. Méfions-nous des esprits frappeurs.
Et la toile tombe sur cette mystérieuse intervention.
En province, on n’aurait pas manqué de pousser des cris, de siffler, de faire un sabbat d’enfer, et, pour peu qu’une voix perdue l’eût conseillé, de briser les bancs, les lustres, les fauteuils, tout à la plus grande joie des titis d’en haut. Le Parisien est plus sage, par éducation ou par tempérament. Quand il se fâche, il sait pourquoi. Il ne lui viendra certainement jamais à l’idée de rendre une administration responsable d’un malheur ou d’un accident. En conséquence, dans le cas actuel, il s’est contenté d’attendre l’explication du régisseur.
Le régisseur s’est présenté, et il a dit que Mlle Brunetti était tombée en syncope, et que plusieurs médecins lui prodiguaient des soins qui ne tarderaient pas à la ranimer.
Chacun s’est arrangé pour attendre sœur Anne, ou Jeanne d’Arc, si vous aimez mieux. Au bout d’un certain temps, qui ressemblait à un petit morceau d’éternité, le même régisseur a reparu pour annoncer que le mal prenait un caractère inquiétant, et qu’on offrait la pantomime expressive de Mlle Antoinette en remplacement de sa camarade Brunetti.
Des murmures irlandais ont répondu naturellement à cette proposition.
Dans une harangue improvisée, la direction aux abois a fait offrir des billets de rechange pour la seconde-première représentation, qui serait ultérieurement indiquée par des affiches.
— Bravo ! bravo ! a crié le parterre.
Ailleurs, on ne disait rien, mais on n’en pensait pas moins.
Troisième discours officiel, duquel il appert que chaque spectateur sortant se munira d’un billet en blanc pris au contrôle, et n’aura qu’à l’envoyer au théâtre, avec son nom et son adresse, pour recevoir un coupon en règle lui donnant droit à la deuxième audition de Jeanne d’Arc.
On paraissait causer en famille des petites affaires de son intérieur.
Pas moyen de s’entendre, hélas ! Les uns disent oui, les autres non, en français, en anglais, en allemand, dans toutes les langues connues et inconnues. Le tumulte augmente ; l’orage est près d’éclater.
Décidément Mlle Antoinette va se substituer à Mlle Brunetti.
Allons, la pièce continue.
On murmure.
Le directeur en personne se présente. Il est remplacé bientôt par le commissaire de police ; qui tout simplement invite la foule à se retirer.
Et la foule se retire.
On ne lui reprochera pas d’avoir un mauvais caractère.
J’espère qu’une expérience plus heureuse consolera bientôt l’administration et les auteurs. Toutes nos sympathie sont acquises d’avance à ce théâtre, qui se propose de vulgariser les belles œuvres et de faire pénétrer plus avant le goût de la musique dans les masses. C’est le complément des orphéons. Avant de parler sérieusement de Jeanne d’Arc, qui prétend ouvrir les voies, nous attendrons qu’elle ait été sérieusement répétée.
Voici la lettre que M. Duprez a écrite le lendemain de cette non-représentation.
Monsieur, hier matin, j’ai appris que Mlle Brunetti était atteinte d’une extinction de voix assez légère, provenant de l’humidité de la température ; en effet, je l’ai trouvée chez elle dans un état qui m’a paru peu rassurant pour la représentation du soir ; mais, en vaillante artiste qu’elle est, et craignant de compromettre une soirée déjà remise, elle a bravement accepté sa situation, et comptant trop sur ses forces et son zèle, elle s’est décidée à chanter. Sa tentative n’a pas secondé son courage, mais les grands artistes savent reprendre une revanche éclatante quand ils sont rentrés dans la plénitude de leurs moyens. Dans la perturbation qui a suivi le retrait de Mlle Brunetti et malgré le dévouement qu’a montré une intelligente jeune fille, Mlle Arnaud, des harangues ont été adressées au public ; ce public d’élite, qui a prouvé sa sympathie pour l’œuvre par des applaudissements, a répondu avec une extrême bienveillances aux discours du régisseur. On cherchait de part et d’autre un expédient qui pût satisfaire tout le monde ; on a même proposé de faire mimer le rôle ; mais j’ai cru trouver la seule solution possible, en priant mon excellent chef d’orchestre, M. Matou, de faire baisser le rideau et de se retirer, me réservant de donner prochainement une seconde-première représentation dans de meilleurs conditions. — Agréez, etc. G. Duprez.
Ni Mlle Brunetti, la grande artiste ; ni Mlle Arnaud, l’intelligente jeune fille ; ni M. Maton, l’excellent chef d’orchestre ; ni le public d’élite, ni M. Duprez applaudi ne se plaindront de cette bonne petite lettre. On n’est jamais mieux servi que par soi-même.
Le Temps 18 octobre 1865
Extrait de la Critique musicale de Johannès Weber.
Lien : Retronews
Vous êtes sans doute curieux d’avoir des nouvelles de l’opéra Jeanne d’Arc, de M. Duprez. Je m’abstiendrai de parler de la musique, avant d’avoir entendu la partition entière, exécutée dans de meilleures conditions que ce que nous en avons entendu jeudi dernier. Mais je puis du moins vous dire quelques mots de la pièce, qui est imprimée. Les titres des différentes parties indiquent la marche de l’action : les Voix du Ciel, la Fête des Fleurs, le Roi de Bourges, le Sacre, la Prison, le Martyre. Dans le prologue, Jeanne est appelée par les voix célestes à sauver la France. À la fin du premier acte, elle part en costume d’homme, avec un sauf-conduit et un écuyer que lui a donnés le sire de Baudricourt, en y joignant les deux chevaux nécessaires pour le voyage. À l’acte suivant, Jeanne se présente devant le roi Charles VII ; les chevaliers se moquent d’elle et s’indignent à l’idée de se laisser conduire par une femme ; mais l’enthousiasme du roi finit par les gagner, et ils crient : Dieu le veut !
Les trois actes suivants sont suffisamment caractérisés par leurs titres.
Pour faire rentrer la pièce dans les données vulgaires de l’opéra, MM. Méry et Éd. Duprez y ont introduit deux personnages assez singuliers. L’un c’est Jean de Luxembourg, une nouvelle incarnation de Don Salluste de Victor Hugo, et qui veut se venger de Jeanne pour des motifs qu’on ne voit pas trop. Le Ruy-Blas de ce diabolus ex machina c’est Lionel, un soudard qui sert quiconque veut le payer, un chenapan qui dit à tout le monde : Méfiez-vous de moi, je suis un franc vaurien
; du moins, s’il ne le dit pas, c’est tout comme
.
Cet aventurier déguenillé prétend au cœur de Jeanne. Au premier acte elle le repousse ; mais, par un fortuné hasard, ou peut-être grâce à l’influence de Jean de Luxembourg, c’est Lionel que Baudricourt donne à Jeanne pour écuyer. Il faut croire que dans la suite, ses entreprises galantes ne sont pas couronnées de plus de succès, car nous apprenons que de dépit il a passé dans le camp des Anglais. Puis il se ravise, et, au sacre du roi, il se présente encore devant Jeanne en lui offrant ses services. Nouvelle rebuffade ; il repasse dans le camp des Anglais, parlant de se venger, et escorté, comme toujours de son Méphistophélès, qui ne le quitte pas de l’œil. Quand Jeanne est en prison, il vient la trouver déguisé en moine. Je ne sais comment il se fait que la Pucelle avoue au loup encapuchonné qu’elle l’adore.
Stupéfaction du lecteur et transports passionnés du soudard. Jeanne se dresse sur son lit, brandit son épée, et comme elle est peu vêtue, le ciel l’entoure de l’auréole de l’ange exterminateur. Mais Luxembourg, qui avait dépêché le faux moine, écoute à la porte : il entre avec sa suite, et voilà la prisonnière convaincue du délit de parjure. Quand Jeanne, sur le bûcher, est enveloppée par les flammes et asphyxiée par la fumée, Lionel vient se percer le sein avec son poignard, en disant : À toi le Ciel, à moi l’enfer !
Ah ! mais je l’espère bien.
Un mot d’explication sur le litre du premier acte : la Fête des fleurs. MM. Méry et Éd. Duprez nous apprennent qu’autrefois, un certain jour de l’année, on bénissait dans l’église de Domrémy un arbuste d’aubépine, dont les jeunes filles se disputaient ensuite les rameaux, parce que la main du prêtre lui avait conféré une vertu magique. Le jeune homme à qui chacune donnait son rameau devenait son amoureux, et devait plus lard infailliblement l’épouser. Il faut, croire que le jeune homme était rigoureusement tenu d’accepter le gage, autrement la magie sacerdotale n’avait que faire.
Après tout, le Grand-Théâtre-Parisien n’est pas situé rue Le Peletier, mais au milieu du faubourg Saint-Antoine. Et puis, il faut juger un texte d’opéra moins d’après la lecture, que par l’effet qu’il produit à la scène et par le talent avec lequel le musicien a su en déguiser les défauts et utiliser les bons côtés. Nous connaissons les paroles de Jeanne d’Arc ; mais nous ne connaissons pas encore l’opéra de M. G. Duprez.
On a parlé aussi d’un opéra du même titre, dont M. Mermet s’occuperait d’écrire le poème et la musique, mais dont jusqu’à présent il n’est pas autrement question.
Le Foyer 19 octobre 1865
Extrait de la Chronique de la semaine d’Alphonse Baralle.
Jeudi soir la foule se pressait au Grand-Théâtre-Parisien pour assister à la première représentation de Jeanne d’Arc. Pendant le prologue et le premier acte tout a bien marché, et le public a montré par son attitude la vive sympathie que lui inspire l’institution si utile du grand opéra populaire. Au second acte, Mlle Brunetti, gravement indisposée, n’a pu continuer le rôle de Jeanne. Après quelques essais pour continuer la représentation, M. Duprez a jugé qu’il valait mieux la renvoyer au rétablissement complet de la prima dona. Les billets ont été rendus aux spectateurs et seront reçus à la prochaine première représentation. Ces incidents se sont produits sans provoquer le moindre trouble dans la salle. C’est partie remise.
Le Figaro 19 octobre 1865
Extrait du billet humoristique d’Albert Wolff.
Lien : Retronews
[Wolff évoque un accident ainsi rapporté par le Petit Journal du 12 octobre :]
Un homme de lettres fort connu, M. Louis Énault, passait lundi en voiture, rue de la Chaussée d’Antin. La femme et la jeune enfant d’un de ses amis se trouvaient avec lui. L’omnibus G., qui va du Jardin des Plantes aux Batignolles, vint heurter par derrière la voiture avec une telle violence qu’elle fut renversée, ainsi que le cheval en même temps que le cocher fut jeté à terre. La voiture était tombée du côté de là dame. M. Énault eut la présence d’esprit de l’attirer à lui et de lui éviter le contre-coup de la chute, et en s’appuyant du pied et du corps contre la portière de la voiture restée en l’air, il parvint aussi à garantir l’enfant.
À travers Paris
Depuis que j’ai assisté à la tentative de représentation au Grand-Théâtre-Parisien, depuis que j’ai lu les deux cents réclames que la presse a faites cette semaine à M. Louis Énault, je suis sous le coup d’une étrange hallucination.
Je vois constamment miroiter devant mes yeux un omnibus portant Jeanne d’Arc, et M. Louis Énault sous les traits du beau Dunois.
Je vais tacher de mettre un peu d’ordre dans mes idées.
Toutes les gazettes ont reproduit l’acte d’héroïsme de M. Louis Énault. Il se trouvait en voiture avec la femme d’un avocat quand l’omnibus G, n° 547, vint heurter le véhicule, renversa le cheval, le cocher et les voyageurs.
M. Énault, ajoute la réclame, que sa présence d’esprit n’abandonne jamais, put, en attirant contre lui madame J., la préserver d’un contre-coup dangereux, et, en s’arc-boutant des pieds et des épaules contre les parois, il parvint à faire un creux dans lequel s’abritât l’enfant.
Jusqu’ici tout va bien et je n’aurais point contesté à M. Énault la position de faiseur de creux qu’il ambitionne, si la réclame n’ajoutait pas :
Un homme du peuple accourut chez un pharmacien d’où il rapporta un flacon, et, quand M. Louis Énault lui demanda ce qu’il pouvait lui devoir : — Rien, a répondu l’ouvrier, je vous connais et je suis heureux d’avoir fait cela pour vous.
Et voilà comment l’omnibus G, n° 547 a, en un tour de roues, plus fait pour la popularité de M. Énault que les œuvres complètes du faiseur de creux.
Depuis l’accident de la rue de la Chaussée-d’Antin, l’omnibus G, n° 547, ne circule plus dans Paris.
Nos lecteurs comprendront parfaitement que la Compagnie ne peut mettre à la disposition du public un véhicule contre lequel s’est arc-bouté M. Louis Énault.
Un Anglais a immédiatement offert un million pour cet omnibus, mais l’administration, jalouse de conserver à la France les objets qu peuvent rappeler aux générations futures les grandes pages de l’histoire nationale, n’a pas permis que l’illustre omnibus passât à l’étranger.
Depuis dimanche, l’omnibus G, n° 547, se trouve au petit Trianon, entre la voiture du sacre de Charles X et une chaise à porteur, et telle est la popularité de M. Énault, qu’en peu de jours plus de dix mille ouvriers sont allés en pèlerinage à Versailles pour baiser le marche pied de l’omnibus qui a permis à M. Louis Énault de s’arc-bouter.
L’affluence de la foule a donné à la municipalité de Versailles l’idée de réserver un jour de la semaine aux gens distingués et aux nobles étrangers.
À partir de jeudi prochain et les jeudis suivants, M. Énault, orné de sa présence d’esprit qui ne le quitte jamais, sera visible sur l’impériale de l’omnibus G, n° 547, de midi à trois heures. Prix d’entrée : 5 francs pour les pauvres.
À deux heures précises. M. Énault descendra et s’arc-boutera. À deux heures un quart, il démontrera aux visiteurs la manière de faire un creux.
Il a été question un instant d’exposer également l’ouvrier qui a été content d’aller chez le pharmacien — on ne se figure pas ce qu’il y a d’ouvriers dans Paris qui iraient chez le pharmacien pour M. Louis Énault, — mais, malgré les plus actives recherches, il a été impossible de retrouver ce noble artisan.
Je suis vraiment heureux de l’occasion qui s’offre à moi pour vous parler à mon tour de M. Énault.
J’estime fort peu sa littérature.
Comme romancier, il appartient à l’école des orgeat, limonade, bière !
Mais, en revanche, je ne saurais refuser ma sympathie à l’arc-bouteur, au faiseur de creux, au sauveteur qui est si bien avec les ouvriers qui vont chez les pharmaciens.
Et maintenant, s’il faut tout vous dire, je crois qu’un sentiment de jalousie fait dérailler en ce moment mon impartialité.
Que voulez-vous ?
La fortune qui fait tout pour les uns et rien pour les autres m’a singulièrement négligé.
Tandis que le faiseur de creux s’enivre de la sympathie du peuple, je lutte contre les préjugés et les usages établis.
M. Énault a tout pour rien.
Et moi…
C’est étrange ! Toutes les fois que j’envoie un homme du peuple chez un pharmacien, il me réclame quinze sous pour la course.
Quel malheur pour Duprez que M. Louis Énault ne se soit pas arc-bouté six mois plus tôt !
L’accident de la Chaussée-d’Antin eût fourni à Méry un poème autrement intéressant que Jeanne d’Arc, qui a été remplacée de nos jours par Isabelle la Bouquetière.
Vous savez déjà en partie ce qui s’est passé au Grand-Théâtre-Parisien de la rue de Lyon.
Méry, qui est très frileux, a fait son poème pour le Midi de la France.
Sur ce poème, Duprez a composé une sorte de musique pour l’exportation.
On comprendra qu’après une demi-audition il m’est impossible de me prononcer sur la valeur de la partition de Jeanne d’Arc.
J’ai, de temps en temps, entendu un petit bruit indécent à l’orchestre.
Était-ce de la musique ?
Décors, partition, acteurs et costumes se valent.
Si l’on avait donné aux musiciens des habits rouges ornés de brandebourgs et des chapeaux à plume, la petite fête eût été complète.
J’engage aussi le directeur du Grand-Théâtre-Parisien à organiser avant la représentation des cavalcades dans son quartier.
C’est un usage que les directeurs parisiens oublient depuis quelque temps.
Ils ont tort.
Le poème de Jeanne d’Arc gagnerait beaucoup à être remanié.
Si l’on pouvait fusionner l’histoire de l’héroïne d’Orléans et l’accident de la rue de la Chaussée-d’Antin, on obtiendrait peut-être un scénario plus émouvant.
Je sais bien qu’il serait difficile d’expliquer la présence de M. Louis Énault à la cour de Charles VII, mais avec un peu de bonne volonté, rien n’est impossible.
Essayons :
Jeanne d’Arc
ou l’omnibus G, n° 547,
opéra en cinq actes, paroles de Méry, musique de Duprez.
Acte premier.
Jeanne d’Arc, assise au pied du chêne, entend des voix célestes.
Chœur des esprits :
Lève-toi, va sauver la France,
Dieu le veut. Jeanne, va ! va va ! va !
Jeanne, éperdue, tombe évanouie ; on voit passer dans le fond l’omnibus G, n° 547.
Entracte.
Le régisseur. — Messieurs et mesdames ! vous apprécierez la difficulté de nos auteurs de mêler deux actions, dont l’une se passe au quinzième et l’autre au dix-neuvième siècle. Je profite de cette occasion pour vous raconter le fait-divers que voici : Mardi dernier, M. Louis Énault passa sur la place de la Bastille quand une charrette de fruitière fut renversée par la voiture de remise n° 11227. M. Louis Énault, qui ne sort jamais sans sa présence d’esprit, se jeta sous le véhicule, s’arc-bouta et fit un creux qui permit à la marchande ambulante de quitter sa dangereuse position. M. Énault a voulu se soustraire par la fuite aux acclamations de la foule, mais les ouvriers l’ont poursuivi en criant :
— Nous vous connaissons ! Vive Énault !
Et maintenant, au rideau !
Acte deuxième.
Jeanne est décidée à sauver la France. Au moment où elle va partir, elle se trouve indisposée ; on la remplace par une autre chanteuse. — Un palefrenier amène deux chevaux : Jeanne enfourche un coursier.
— Qu’y m’accompagnera ? dit-elle.
— Moi ! dit Énault en entrant.
— Vous ?
— Oui, moi ! Une femme ne doit jamais voyager seule. Vous n’auriez qu’à rencontrer l’omnibus G. n° 547.
(Le rideau tombe.)
Entracte.
Le régisseur. — Messieurs et mesdames ; hier soir, M. Louis Énault passait rue Saint-Antoine, au moment où un ouvrier tombait du cinquième étage ; M. Louis Énault s’arc-bouta, reçut l’artisan sur ses épaules et fit avec lui trois fois le leur de la place de la Bastille.
— Combien vous dois-je ? demanda l’ouvrier à M. Énault.
— Rien, répondit l’écrivain populaire en montrant la maison en construction, rien, car je connais vos œuvres !
Au rideau !
Acte troisième.
Nous sommes à Bourges. Les principaux gentilshommes de l’époque se trouvent réunis. Voici La Trémouille, un ancien choriste de l’Opéra, qui vend des vins rouges à domicile et qui, après avoir représenté dans la matinée une maison de Bordeaux, représente le soir une des grandes familles de France.
Ici j’ouvre une parenthèse.
Si ce courtier-acteur veut m’honorer de sa visite, je lui ferai une petite commande.
Il me serait doux de dire à mes invités :
— Comment trouvez-vous ce Saint-Julien ? Il me vient de La Trémouille.
Fermons la parenthèse.
Entre le roi Charles VII. Il a tout pour lui, ce roi Charles : grâce, distinction, majesté et le nez d’Aline Duval.
— Messieurs ! dit-il, puisque vous êtes tous réunis chez moi, je vais vous flanquer quelques ut de poitrine.
Ensuite on introduit Jeanne d’Arc, ainsi que Louis Énault, qui voyage sous le pseudonyme de Lionel.
— Sire ! dit Jeanne, je viens sauver la France, mais si je suis encore vivante, c’est bien à mon cavalier que je le dois. Figurez-vous, sire, qu’à deux lieues de la ville nous avons rencontré l’omnibus G, n° 547.
— Je connais l’histoire, répond le roi.
Et s’adressant à Louis Énault il ajoute :
— Je vous connais aussi, monsieur ; si je m’étais trouvé sur le théâtre de l’accident, je serais allé chez le pharmacien.
(Le rideau tombe.)
Entracte.
Le régisseur. — Messieurs et mesdames, un incident imprévu nous met dans l’impossibilité de continuer la représentation. Le beau Dunois et La Trémouille viennent d’avoir une discussion violente à la suite de laquelle ils se sont alignés. M. Louis Énault, se trouvant dans les coulisses, s’est arc-bouté contre La Trémouille, a sur-le-champ désarmé les combattants, et, pour les empêcher de recommencer, il a avalé leurs sabres. Sa Majesté Charles VII, témoin de cet acte de courage, vient de nommer M. Louis Énault arc-bouteur et faiseur de creux du roi. Mais tant que M. Louis Énault ne nous aura pas restitué les deux sabres, nous ne pourrons continuer la pièce ; nous savons trop ce que nous devons au public pour lui présenter nos deux principaux gentilshommes sans armes. L’administration a donc l’honneur de vous prévenir qu’elle fera remettre dans un instant aux petits confortables, confortables moyens et grands confortables, de nouveaux billets pour une prochaine représentation de notre opéra.
Un spectateur. — De nouveaux billets ? Sauve qui peut !
(Panique dans la salle.)
Un titi. — La suite de la pièce !
Le commissaire de police (paraissant sur la scène). — Messieurs et mesdames, je vous engage à évacuer la salle ! Un mot encore ! M. Louis Énault vient d’être appelé par dépêche télégraphique aux Champs-Élysées pour s’arc-bouter contre une voiture qui vient de verser…
Un titi. — Je cours chez le pharmacien, car je connais ses œuvres !
(Tumulte épouvantable dans la salle.)
Le chef d’orchestre (à son premier violon). — Viens-tu au café ? Je te joue un grog au bézigue !
Le commissaire de police. — Les personnes qui ne pourront assister à la deuxième représentation de notre opéra sont priées de laisser leurs adresses au contrôle ; notre ténor ira leur porter des ut de poitrine à domicile.
Un monsieur. — C’est inutile ; nous partons tous pour la campagne !
Le commissaire. — Mais enfin…
Un spectateur livide. — Monsieur le commissaire, n’auriez-vous pas par hasard du laudanum sur vous ?
(À ces mots la foule recule épouvantée.)
Je pourrais aisément raconter la fin de ce livret émouvant, je pourrais vous montrer les Anglais se battant contre Jeanne d’Arc et M. Louis Énault, et vous faire assister à la mort de Jeanne, expirant sur l’omnibus G, n° 547, qui lui sert de bûcher.
Mais à quoi bon vous dire la fin d’un opéra qui ne sera jamais joué en entier ?
Il vaut mieux laisser le dénouement dans le vague.
D’ailleurs, il faut bien que je réserve une petite place aux autres historiettes de la semaine.
Et tout d’abord le mot de ce charmant et jeune esprit qui s’appelle Nestor Roqueplan.
— Mon cher, lui dit Duprez la veille de la première demi-représentation, je joue une grosse partie, c’est mon avenir qui se décide ce soir, et, ma foi ! je ne suis pas tranquille… j’ai tant d’ennemis !
— Des ennemis ? fit Roqueplan avec son plus fin sourire, vous n’avez pas d’ennemis, vous n’avez que des gens qui se moquent de vous !
C’est le mot de la situation.
Nous verrons ce que l’avenir réserve à cette partition.
Après la répétition générale Ernest Reyer me dit :
— Il y a dans l’opéra de Duprez quelques belles inspirations que d’ailleurs vous connaissez déjà.
Eh bien ! non.
Cela ne ressemble à aucune musique d’une autre école.
Duprez est tout au plus le Richard Wagner des Japonais !
Je ne puis trop engager les personnes qui assisteront à la seconde audition de prendre dans chaque entracte soit un petit verre d’Eau de mélisse des Carmes, soit quatre gouttes de laudanum sur un morceau de sucre.
À d’autres, maintenant ! […]
Le Monde illustré 21 octobre 1865
Extrait de la Chronique musicale d’Albert de Lasalle.
Lien : Retronews
Pendant que notre dernier numéro était sous presse, M. Duprez, le célèbre ténor, tentait une nouvelle fortune musicale en faisant représenter un opéra de sa composition au Grand-Théâtre-Parisien. Une mauvaise coïncidence de date ne nous a pas permis de raconter en temps utile les péripéties de cette représentation qui, par suite de l’indisposition de Mlle Brunetti, a été interrompue plusieurs fois et en est restée au second acte. Mais la Jeanne d’Arc de M. Duprez a six actes qui, sous peu de jours, nous seront joués intégralement. Notre compte-rendu se trouve donc forcément remis. D’ailleurs nous n’avons rapporté de ce premier voyage au théâtre de la rue de Lyon qu’une idée très-vague de la musique de M. Duprez. Tout ce que nous savons c’est que si les temps sont durs pour les compositeurs, les stalles du Grand-Théâtre-Parisien sont encore plus dures, et qu’il est toujours imprudent de solliciter les jugements d’un public mal assis.
Le Figaro 22 octobre 1865
Extrait du Petit Courrier des Théâtres.
Lien : Retronews
M. Duprez n’a pas de chance. Il espérait donner enfin une première représentation de sa Jeanne d’Arc. Mlle Brunetti était rétablie, mais elle vient de perdre subitement son père.
Le Charivari 22 octobre 1865
Extrait du Petit Courrier des Théâtres.
Lien : Retronews
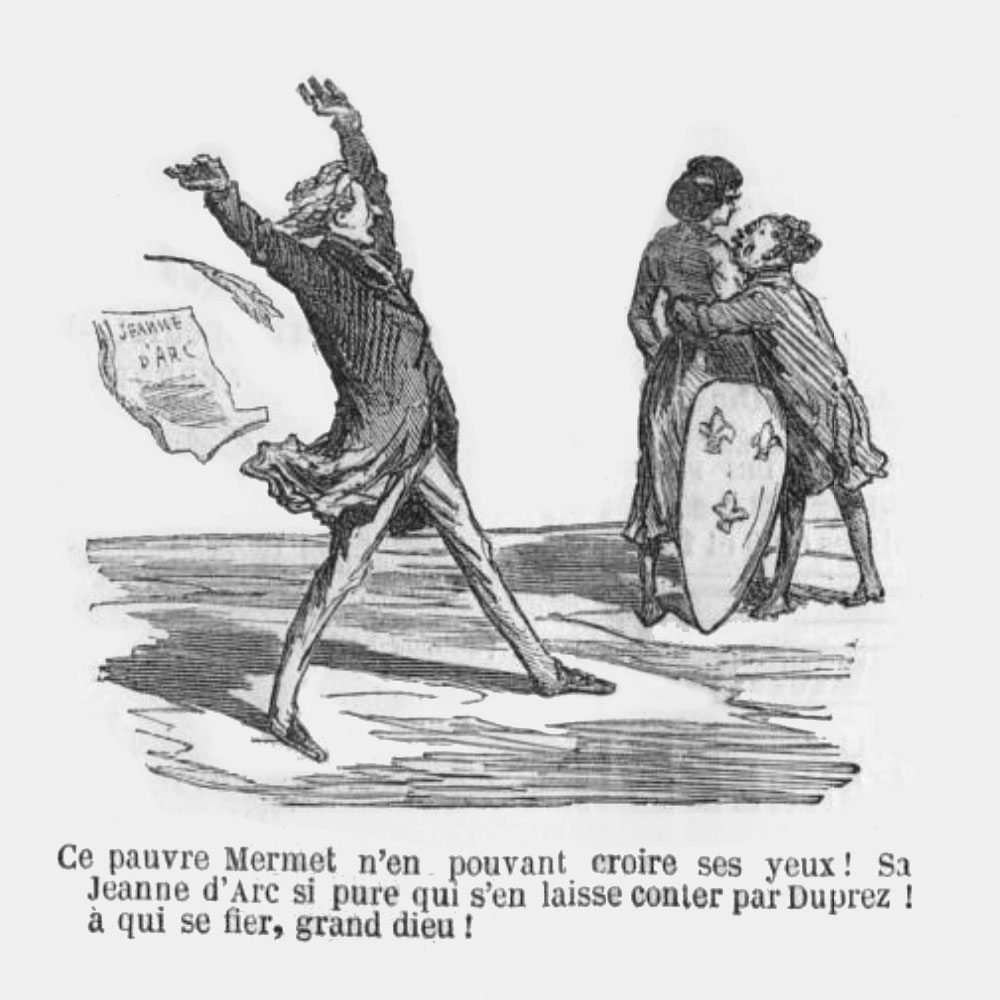
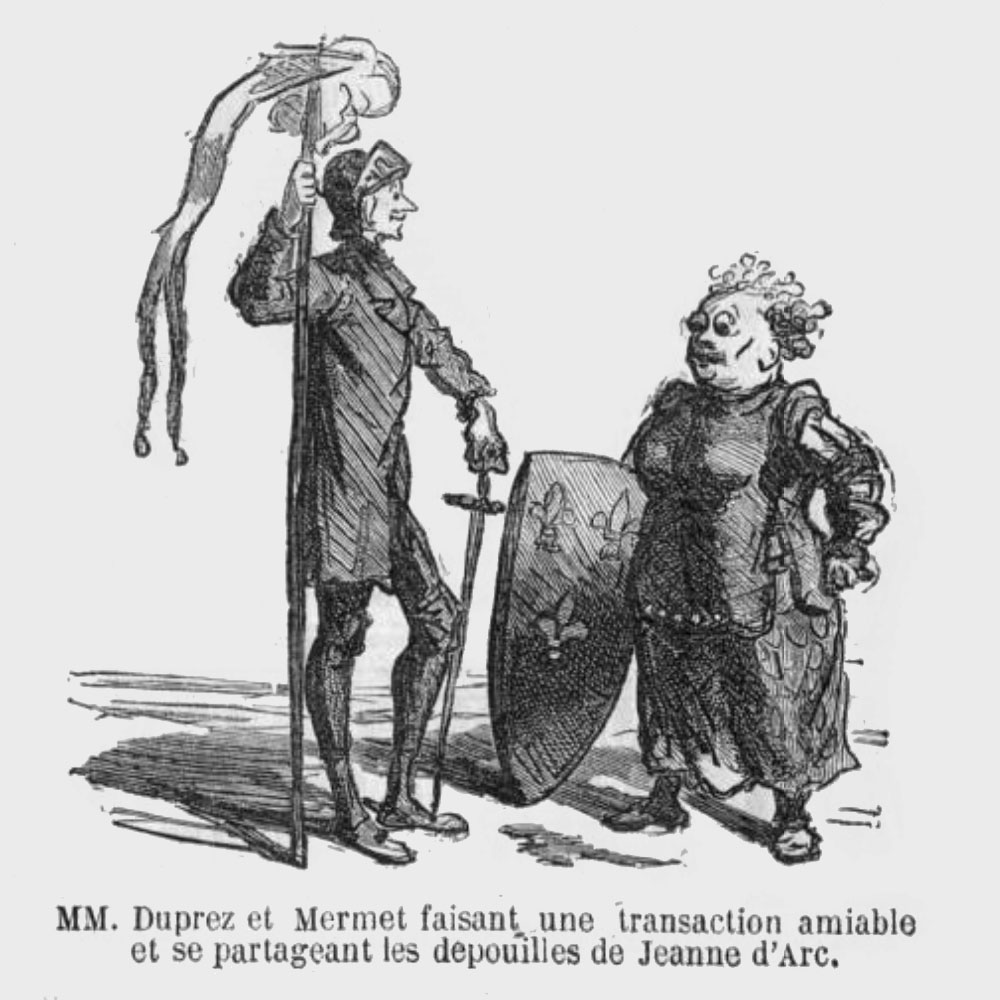
Le Droit, Journal des tribunaux 23 octobre 1865
Lien : Retronews
Juridiction commerciale. — Tribunal de commerce de la Seine. Présidence de M. Hébert. Audience du 20 octobre.
Grand-Théâtre-Parisien. — Jeanne d’Arc. — M. Massue contre M. Duprez.
M. Gilbert Duprez, le célèbre ténor, a voulu attacher son nom à la création de l’opéra populaire, et en même temps présenter au public ses œuvres musicales, et notamment son opéra de Jeanne d’Arc.
Au mois de juillet 1865, il s’est mis en rapport avec M. Massue, directeur du Grand-Théâtre-Parisien, et il a fait avec lui une sorte d’association pour une durée de sept mois.
M. Duprez engage et paie sa troupe chantante et son orchestre.
M. Massue donne son théâtre, et les recettes se partagent en moitié.
La pièce d’inauguration était Jeanne d’Arc. On sait que les répétitions de cette pièce ont été suspendues par la maladie de M. Ulysse du Wast, l’un des ténors, et que la première représentation a été interrompue par l’indisposition de Mlle Maria Brunetti, chargée du rôle de Jeanne d’Arc.
M. Massue, se fondant sur ces deux événements, a fait assigner M. Duprez devant le Tribunal de commerce de la Seine, en paiement de 7,000 fr. de dommages-intérêts.
Il lui reprochait d’avoir négligé la précaution indispensable dans un opéra, d’engager des artistes pour doubler les principaux rôles ; il insistait surtout sur l’imprudence qu’il avait commise en donnant le fardeau du rôle de Jeanne d’Arc, à Mlle Brunetti, artiste nerveuse, maladive, qui avait déjà arrêté des représentations sur d’autres scènes, et il rejetait sur M. Duprez la responsabilité des pertes causées au théâtre par des accidents qu’il aurait dû prévoir.
M. Duprez a répondu qu’il a organisé, parmi les élèves de son école, une troupe de choix, qu’on jugera bientôt à l’œuvre ; il a le droit de choisir ses artistes, puisqu’il les paie seul, et il ne peut être responsable des maladies dont les chanteurs ne sont pas plus exempts que les autres hommes. Enfin, in a invoqué un article spécial de son traité, où il a décliné toute garantie pour les relâches, et où il a promis seulement ses soins et son concours pour la bonne marche des représentations, qui l’intéressent autant que M. Massue, puisqu’il en partage les recettes avec lui.
Le Tribunal, après avoir entendu les plaidoiries de Me Hervieux, agréé de M. Massue, et de Me Albert Schayé, agréé de M. Duprez, a statué en ces termes :
Le Tribunal,
Attendu que par conventions, en date du 6 juillet 1865, Massue, directeur du Grand-Théâtre-Parisien, a mis son théâtre à disposition de Duprez pour y faire représenter des opéras et autres œuvres de musique à certains conditions déterminées, et notamment avec stipulation que la troupe chantante serait formée par Duprez, qui serait tenu de garantir l’exécution des engagements des sujets ;
Attendu que Massue prétend aux termes de ces conventions, rendre Duprez responsable : 1° des retards survenus dans les représentations de l’opéra de Jeanne d’Arc ; 2° de la suspension des représentations, occasionnée par l’indisposition des deux artistes, la demoiselle Brunetti, première chanteuse ; et Ulysse du Wast, deuxième ténor ;
Que Massue base sa prétention sur le motif que Duprez n’aurait pas eu la prévoyance d’engager des artistes chargés de doubler les sujets, et entend lui réclamer des dommages-intérêts s’élevant à 7,000 fr. Mais attendu que Duprez ne s’est point obligé à commencer les représentations projetées à un jour déterminé ; que les indispositions justifiées de la demoiselle Brunetti et du sieur Du Wast ne constituent pas une infraction aux engagements ;
Qu’il ressort au contraire des termes mêmes des conventions, qu’en cas d’interruption des représentations musicales pour cause de maladie d’un ou de plusieurs artistes, Massue ne pourrait exiger aucune indemnité : que Duprez ne s’est pas obligé davantage à engager dans sa troupe chantante des sujets en qualité de doublure ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de repousser la demande de Massue ;
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Déclare Massue, non recevable, en tous cas mal fondé en sa demande ;
L’en déboute et le condamne aux dépens.
La Presse 24 octobre 1865
Lien : Retronews
Nouvelles du jour. — Le Grand-Théâtre-Parisien annonce pour demain la représentation de Jeanne d’Arc, si malencontreusement interrompue le premier jour. À cette occasion, le Figaro-Programme nous apprend que le directeur du théâtre avait assigné, devant le tribunal de commerce, M. Duprez, qui s’était chargé de l’exécution, en 7,000 fr. de dommages-intérêts. L’affaire a été jugée vendredi, et le tribunal a débouté M. Massue de sa demande et l’a condamné aux dépens.
La Patrie 24 octobre 1865
Extrait de la Revue musicale de M. de Thémines (Achille de Lauzières), en feuilleton.
Lien : Retronews
Au Grand-Opéra populaire, l’affiche annonce pour demain mardi [24 octobre] la deuxième première représentation de Jeanne d’Arc, de M. Duprez. Toutes les places de grand confortable et de petit confortable sont retenues au théâtre de la rue de Lyon par les personnes qui les occupaient le premier soir. N’ayant pas reçu de bulletin de santé de la charmante artiste chargée du rôle de Jeanne, j’aime à supposer que le mieux se soutient.
Le Foyer 26 octobre 1865
Article de Ferdinand Schlosser.
Grand-Théâtre-Parisien. — Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes et un prologue, de MM. Méry et Éd. Duprez, musique de G. Duprez. (Première seconde représentation, lé 24 octobre 1865.)
Plus heureux que la première fois, nous avons pu assister jusqu’à la fin à la représentation de l’opéra de Duprez, qui n’avait pas eu la chance de se faire entendre jusqu’au bout la quinzaine dernière ; on se rappelle qu’il avait été interrompu au milieu du deuxième acte par une indisposition aussi subite qu’imprévue de Mlle Brunetti, chargée du principal rôle de la pièce.
Cette fois encore, la salle était remplie d’un public intelligent, bienveillant et tout disposé à acclamer l’œuvre nouvelle du célèbre ténor. Les artistes, les hommes de lettres, les amateurs les plus éclairés semblaient s’être donné rendez-vous au Grand-Théâtre-Parisien pour apprécier une œuvre dont l’apparition avait été retardée par tant d’accidents de divers genres.
Le populaire et aimé Timothée Trimm, le directeur de l’Académie impériale de musique et toute la presse parisienne se trouvaient là pour accueillir sympathiquement cette production étrange et originale, d’un ensemble si saisissant, qui contient de beaux chœurs et que la poésie de Méry accompagne de sa grande inspiration.
Les interprètes de Jeanne d’Arc étaient Mlle Maria Brunetti, représentant l’héroïne ; M. Ulysse du Wast, représentant Lionel ; M. Gaston Aubert, Charles VII ; M. Gaspard, Jean de Luxembourg ; nous avons reconnu la gentille Mlle Arnault dans le petit rôle de la sœur de Jeanne d’Arc, Perrine.
Quant à la mise en scène, elle ne laisse rien à désirer, costumes, décors armures, gens et chevaux ont été répandus à profusion sur la scène, les banderoles, les oriflammes dont les couleurs éclatantes frappaient la vue à la lumière du gaz, produisaient un effet grandiose et magique, aussi le public, émerveillé, a-t-il applaudi à outrance, redemandé les acteurs et montré une émotion violente à la scène du bûcher.
Cette analyse est très-incomplète, nous le savons, mais nous avons besoin de nous rendre compte à nous-même de l’impression que nous avons reçue, et d’ailleurs le temps nous a manqué pour faire un compte-rendu plus détaillé ; nous y reviendrons dans un prochain article et après une nouvelle audition de cette œuvre si diversement appréciée.
La Presse théâtrale 26 octobre 1865
Article d’A. Hernette dans la Presse théâtrale et musicale, hebdomadaire paraissant le jeudi.
Lien : Retronews
Grand Théâtre Parisien. — Jeanne d’Arc, opéra en 4 actes, paroles de M. Méry et Édouard Duprez, musique de M. Gilbert Duprez.
L’opéra de Duprez a été exécuté en entier hier au théâtre de la rue de Lyon. L’auditoire était aussi nombreux et à peu d’exception près aussi bien composé qu’à la première tentative de représentation qui a eu lieu il y a quinze jours. La pièce a été écoutée jusqu’au bout avec un intérêt inspiré presque exclusivement par la musique, car le poème est loin d’être un chef-d’œuvre et se trouve encadré dans une mise en scène splendide pour le Théâtre-Parisien, et qui témoigne de la bonne volonté de M. Massue, mais qui ne s’en trouve pas moins peu en harmonie avec la grandeur du sujet.
Les auteurs croyant éveiller un intérêt plus grand en faveur de la chaste héroïne de Domrémy ont créé je ne sais quelle fiction absurde qui la rend amoureuse d’un obscur soldat de fortune, un chenapan sans âme qui se fait auprès d’elle l’espion des Anglais. Il n’était pas nécessaire de chercher en dehors de l’authentique vérité pour trouver dans l’histoire de Jeanne d’Arc un sujet de tragédie lyrique. Son histoire n’emprunte rien à l’imagination, et cependant elle n’arrive jusqu’à nous qu’à travers les nuages du merveilleux et de la légende. Isabeau de Bavière, son fils Charles VII, Agnès Sorel, Dunois, le bâtard d’Orléans, légitimé par la victoire, etc., ce ne sont pas les personnages historiques qui manquaient, et besoin n’était pas d’inventer ce type peu sympathique de Lionel.
Je ne veux pas entreprendre de suivre pas à pas MM. Méry et Édouard Duprez dans l’intrigue qu’ils ont inventée, je me borne à constater qu’elle ne présente que très-peu de situations dont la musique puisse tirer parti, et que les vers ne sont pas des mieux faits. Je m’attendais certes à tout autre régal en lisant le nom de Méry sur l’affiche.
La musique de Duprez est d’une sonorité éclatante. Ce n’est pas lui qu’on accusera d’écrire avec du chloroforme. On y découvre une extrême facilité de composition, sans pédanterie aucune. Les idées mélodiques y abondent et en telle quantité que souvent le musicien ne s’est point inquiété de les développer, témoin la cavatine de Lionel : Je suis un soldat de fortune, et le magnifique duo de la prison dont l’intérêt eût été bien autrement grand si on en avait coupé le finale.
À part la scène de l’entrée du roi, déjà populaire en ce moment, sous le nom de l’air aux ut, le compositeur est toujours en situation. S’il ne s’est pas élevé jusqu’aux hauteurs meyerbeeriennes, ce n’est pas sa faute. Nul ne peut avoir du génie en deux genres différents, et Duprez, cette fois, a montré qu’il possède un talent sérieux de compositeur. C’est assez. Sa musique vaut beaucoup mieux que celle de bien des pièces qui ont eu les honneurs de nos premières scènes lyriques.
Le public le lui a témoigné par les applaudissements les plus vifs et en le rappelant à la fin de la pièce avec tous ses interprètes. Mlle Brunetti a eu de très-bons moments comme chanteuse et ne mérite que des éloges comme tragédienne. Elle s’est maintenue à la hauteur de son rôle et l’a très-bien rendu malgré l’émotion visible qui la tenait. Elle a dit avec un sentiment vrai et une exaltation contenue deux phrases du duo de la prison qui ont ému la salle entière. M. Ulysse du Wast s’est révélé au moins l’égal de nos meilleurs ténors. Sa voix a des accents tendres, passionnés et énergiques tout à la fois selon l’exigence des situations. C’est lui qui recueillera le plus clair bénéfice de la création de l’opéra au Théâtre-Parisien, car aujourd’hui aucun directeur ne le laisserait enlever par la province.
Mlle Arnault, dans un petit rôle épisodique, a conquis le suffrage du public. Elle est fort jolie et possède une voix très-agréable dont elle se sert avec beaucoup de goût.
Jean de Luxembourg a révélé un baryton d’une voix du plus beau timbre, beau comédien et excellent chanteur. M. Gabriel s’est fort bien acquitté du rôle effacé du père de Jeanne d’Arc.
L’orchestre, savamment dirigé par M. Maton, a fait merveille. On dirait que les artistes jouent ensemble depuis plusieurs années.
La pièce est assurée d’un succès durable à Paris, et nul doute que la province ne l’applaudisse sous peu.
Le Petit Journal 26 octobre 1865
Lien : Retronews
Hier soir a eu lieu, au Grand-Théâtre-Parisien, la première représentation de Jeanne d’Arc. Le succès de l’œuvre de MM. Méry et de Duprez a été complet.
Nous apprécierons plus tard cet opéra ; disons seulement aujourd’hui que nous avons été émerveillés des résultats obtenus par M. Massue, directeur du Grand-Théâtre-Parisien. Il a créé dans cette grande salle un véritable opéra, avec tous les accessoires nécessités par ces sortes d’ouvrages : beaux décors, mise en scène très soignée, etc.
À M. Duprez revient l’honneur d’avoir réuni une troupe excellente, un orchestre qui ne le cède en rien à ceux des autres théâtres, et surtout d’avoir produit son œuvre patriotique devant un public accessible à tous les beaux spectacles dans un quartier qui n’avait pas eu de théâtre jusqu’à ce jour.
L’Indépendance belge 27 octobre 1865
Correspondance théâtrale de l’Indépendance, Paris, mercredi 25 octobre.
Lien : Retronews
C’est hier soir enfin qu’a pu avoir lieu au grand complet la première représentation de Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes, avec prologue, à peine entrevu, il y a une quinzaine de jours, dans des circonstances qui feront époque au théâtre. Aussi, malgré une véritable tempête déchaînée à ce moment même sur Paris, l’immense place de la Bastille et la grande rue qui conduit au chemin de fer de Lyon et à la prison de Mazas étaient-elles sillonnées, entre sept et huit heures du soir, par des avalanches de voitures et de piétons se rendant au grand théâtre parisien, pour l’inauguration du grand opéra populaire, inauguré sous les espèces d’un grand poème de MM. Méry et Édouard Duprez et d’une grande partition de M. Giblert Duprez.
À huit heures, le grand parallélogramme oblong où sont appelés à s’étager, à perte de vue et suivant leurs goûts et leurs facultés pécuniaires, les spectateurs assis sur les grands, moyens et petits confortables, se trouvait à peu près rempli. Les avant-scènes se peuplaient ; car il y a une douzaine de loges d’avant-scènes dans cet étrange théâtre. La foule était si animée et si bruyante qu’à peine, en prêtant une oreille attentive, on eût pu distinguer le plus violent éternuement d’une des locomotives des trois chemins de fer entre lesquels on a eu l’heureuse idée de placer le grand théâtre parisien, sans doute dans l’intérêt des voyageurs arrivants.
Est-il bien nécessaire d’ajouter que ce qu’on veut bien appeler tout Paris était revenu là encore une fois — ah ! tout Paris a du courage ! — et qu’il y avait même des paris engagés sur la question de savoir si l’actrice chargée du rôle important de Jeanne d’Arc chanterait cette fois son rôle jusqu’au bout ? La négative avait été prévue et il y avait dans la coulisse une pucelle de rechange toute prête.
Je me hâte de vous dire qu’il n’y a pas eu lieu d’avoir recours à cet en-cas, que Mlle Maria Brunetti a rempli sa tâche avec beaucoup de zèle, de dévouement et de succès ; qu’elle a été parfaitement secondée par le jeune ténor Ulysse du Wast, que le roi Charles VII, personnifié dans un chanteur du nom de Gaston Aubert, doué d’une voix de haute-contre, comme nos bons aïeux ont eu seuls le privilège d’en entendre, a lancé des ut dièse à faire pâlir Tamberlick et Fraschini, que l’opéra de Duprez a été aux étoiles ; et que ce compositeur lui-même a dû reparaître sur la scène, vers minuit, devant ses admirateurs enthousiastes, non plus, comme au temps jadis, dans le costume pittoresque d’Arnold Melchthal ou d’Edgard de Ravenswood, mais en simple paletot, ou, tout au moins en habit de ville ; car je n’ai pas bien distingué la forme essentiellement contemporaine du vêtement.
Est-ce donc à dire que le grand artiste qu’on admirait, il y a vingt ans, soit devenu par quelque merveilleux avatar un grand compositeur, et qu’il y ait un astre de plus à cataloguer dans la pléiade des maîtres illustres de la lyre ? Je vous le dirais que vous ne me croiriez pas. Hélas ! Duprez a cessé d’être jeune et nous ne sommes plus au temps du docteur Faust.
Seulement, Duprez, dans le cours de sa longue et glorieuse carrière, a beaucoup vu, beaucoup entendu, beaucoup appris et il a voulu le prouver une bonne fois au public. À cette heure, le public doit être parfaitement convaincu, ou bien c’est qu’il y met de la mauvaise volonté.
Il y a dans l’opéra de Jeanne d’Arc, autant qu’on puisse en juger par une seule audition — je n’assistais pas à la première épreuve — un talent de facture vraiment remarquable, mais il faut bien le dire aussi, une certaine recherche du grand style d’opéra et de la déclamation lyrique qui exclut trop souvent l’invention mélodique. Tout cela peut être très-correct et très-conforme aux règles de l’harmonie et du contre-point ; mais enfin, puisqu’on veut bien nous convier à l’inauguration du grand opéra populaire, je voudrais, pour ma part, un peu moins de science, et je me permettrai d’ajouter, comme le coq de la Fable, que le moindre grain de mil ferait bien mieux mon affaire.
J’ajoute qu’étant donné un sujet à la fois vraiment national et populaire comme celui de Jeanne d’Arc, il était permis d’attendre de la collaboration de MM. Méry et Édouard Duprez un poème un peu plus intéressant et même plus poétique que celui dont j’ai le livret sous les yeux en vous écrivant.
Franchement, ces deux messieurs n’ont pas fait, dans cette circonstance, de grands efforts d’imagination, et, tout en tenant compte de la difficulté très-réelle qu’il y a à fabriquer un bon poème d’opéra, en peut s’étonner que MM. Méry et Édouard Duprez n’aient pas trouvé d’autre moyen, pour dramatiser la pathétique donnée qui leur était offerte par nos vieilles annales, que de faire de Jean de Luxembourg et de l’écuyer Lionel deux pâles silhouettes du don Salluste et du Ruy-Blas de Victor Hugo.
Quand je vous aurai dit, après cela, que le prologue se passe au pied de l’arbre où Jeanne d’Arc vient écouter les voix qui l’invitent à sauver la France, que le 1er acte se passe au village de Domrémy et représente son départ ; que le 2e acte est au château de Chinon et reproduit la scène fameuse de la visite au roi de France ; que le 3e vous transporte à Reims, pour la cérémonie du sacre ; le 4e à Rouen, dans la prison et le 5e au pied du bûcher, sur la place du Vieux-Marché, dans la fatale matinée du 30 mai 1432, vous vous rendrez parfaitement compte de la marche de l’action.
Cette action est claire, c’est là son grand mérite, et les actes sont généralement courts, ce qui n’est pas à dédaigner, quant on se trouve à l’une des limites de Paris.
L’interprétation est réellement au-dessus de ce qu’on pouvait espérer. D’abord, les 50 symphonistes de l’orchestre, tous en habit noir et en cravate blanches, s’il vous plaît, ont fait merveilles sous l’habile direction de Maton.
Mlle Brunetti, une élève de Duprez, qui a paru à plusieurs reprises sur diverses scène lyriques, fait à coup sûr honneur à son maître pour la hardiesse de ses vocalises ; mais sa prononciation m’a paru laisser à désirer. Je n’ai pas, bien que placé assez près de la scène, entendu un traître mot de son rôle. Je vous ai dit que cette artiste avait été on ne peut mieux secondée par Gaston Aubert (Charles VII), doué d’une voix de haute-contre d’un effet prodigieux, et surtout par le tenon du Wast (Lionel) que je crois appelé à de grande succès, car il a une voix charmante et un physique fort agréable. Il serait injuste de ne pas mentionner, à côté d’eux, le baryton Gaspard (Jean de Luxembourg), qui a un magnifique organe, une taille et une figure imposantes, mais dont les cordes vocales ne sont pas encore suffisamment liées.
Le directeur du Grand-Théâtre-Parisien, M. Massue, a fait de grands frais de décors, de costumes et de mise en scène pour monter cette partition de Jeanne d’Arc, destinée à opérer en matière d’opéra, dans le goût des masses populaires fixées aux environs de la Bastille, la révolution que Pasdeloup a si heureusement accomplie à quelques centaines de pas de là, en matière de symphonies. Reste à savoir si le nom de Duprez exercera la même attraction que les noms de Beethoven, de Mendelssohn et du vieil Haydn. Il ne faut désespérer de rien.
Le Journal des débats politiques et littéraires 27 octobre 1865
Extrait du Bulletin des Théâtres de P. David.
Lien : Retronews
Le succès de Jeanne d’Arc, au Grand-Théâtre-Parisien, a été complet. Chanteurs, orchestre, costumes, mise en scène, décors, tout a été applaudi. Aussi la salle est-elle trop petite pour contenir les spectateurs qui veulent applaudir l’ouvrage de M. Duprez.
Le Temps 28 octobre 1865
Extrait des Nouvelles des théâtres et des concerts.
Lien : Gallica
Au Grand-Théâtre-Parisien, la seconde représentation de Jeanne d’Arc a confirmé le succès de la première ; aussi tout le monde voudrait voir cette œuvre capitale qui a l’avantage de finir à 11 h. 1/2.
Le drame de Marie-Jeanne alterne avec l’opéra.
La Comédie 29 octobre 1865
Par Paul Ferry, en une de la Comédie, hebdomadaire paraissant le dimanche, dont Ferry était le rédacteur en chef.
L'École du maître en contre-ut :
Le maître a placé dans l'air chanté par le ténor une succession de notes suraiguës, inaccessibles à des voix qui ne seraient point pétries par lui.
Sur le réalisme du bûcher :
Le bûcher où monte Jeanne est d'un réalisme assez habile ; et les flammes, en léchant les vêtements de la martyre, ont épouvanté les cœurs sensibles de l'auditoire. On a criée :
Assez ! assez!
Lors de la représentation de 1860, Jeanne a failli suffoquer !
Or, il arriva qu'il s'éleva du bûcher, non point des flammes comme aujourd'hui, mais une fumée bien dense, et Jeanne, qui chantait avec une persistance sublime au milieu de cet incendie, perdit bientôt la voix et la connaissance dans le nuage qui l'enveloppait.
Lien : Retronews
Gilbert Duprez. — Jeanne d’Arc… triomphante. — Grand-Théâtre-Parisien. — MM. Gaspard, Ulysse du Wast, G. Aubert, Maria Brunetti.
Le supplice du maître a cessé mardi avec le supplice de l’héroïne. La flamme épura tout. On se rappela ce chanteur ayant renouvelé son art et électrisé une génération émue encore. Il y eut alors des acclamations, un enthousiasme, un beau soir. Quatre mille voix exclamèrent le nom célèbre… Et Arnold revint s’incliner comme autrefois, le front radieux, le cœur gonflé, devant cet auditoire qu’il retrouvait, et qui retrouvait encore le maître en lui. Ce fut un beau soir. On aura pour l’œuvre du maestro tard venu des restrictions nécessaires, mais nous ne méconnaîtrons point que le compositeur a vaincu mardi, et qu’il trouvera des auditoires attentifs, en dépit d’une ébauche de représentation néfaste, ayant engendré le doute et soulevé l’ironie. Il y a dans ce succès des souvenirs et des sympathies ; qu’importe, après cela, si l’illustre artiste est loin du but !
Jeanne d’Arc est le plus riche sujet que puisse caresser l’imagination d’un poète. Le merveilleux de son histoire semble créé exprès pour l’opéra et l’épopée ; cependant il se dérobe à l’inspiration comme à l’étreinte, et qui le poursuit devient Méry ou Chapelain.
M. Méry n’apparaît qu’au dernier moment pour la facture de ce poème. La Jeanne d’Arc mise en musique par Gilbert Duprez est bâclée par son frère depuis longtemps. M. Méry a refait quelques vers et sans doute altéré la prosodie musicale au lieu de s’y soumettre, car une oreille attentive y est à chaque minute outragée par d’incroyables césures, et le grand chanteur y semble incroyablement naïf. On n’a rien inventé. Il n’y a rien à inventer dans un tel sujet. Avec Jeanne il faut croire et s’enthousiasmer avec elle ; il faut la prendre à Domrémy, sous l’arbre des Fées, écoutant les voix
qui lui parlent de la patrie, la suivre à Bourges devant le roi, à Orléans — à la délivrance, à Reims — au triomphe, à Compiègne — à la trahison, à Rouen — au martyre : il faut sa simplicité, sa poésie native, sa grandeur sereine, sa sublimité naïve et son enthousiasme sincère. Son héroïsme s’est traduit dans des mots où Cambronne n’aurait point eu part. — Pendant son procès, un juge assesseur lui demanda : Disiez-vous point que les panonceaux (étendards) qui étoient en semblance avec les vôtres étoient heureux ?
Elle répondit : Je disois : entrez hardiment parmi les Anglois, et j’y entrois la première.
Jeanne n’eut pas seulement ce grand courage : elle eut l’esprit. Un autre juge l’interrogea : Les anges qui vous apparaissoient, Jehanne, estoient-ils nuds ?
C’était un piège, à quoi elle avisa en répondant : Pensez-vous que Dieu n’ait pas de quoi les vestir ?
M. Méry s’est rappelé, au dénouement, — ces vêtements célestes
. L’amoureux Lionel, en confesseur, excite Jeanne à s’échapper avec lui de sa prison : Songes-y, lui dit-il, au bûcher l’on te conduira nue !
À quoi Jeanne s’écrie :
La flamme des martyrs sera mon vêtement ! ! !
Il y a, dans la partition, dans le poème et dans l’interprétation même, beaucoup de vêtements
semblables, c’est-à-dire des transparences
. Un nymbe est là. Le prologue est peuplé d’extases, et Jeanne y parle — avec la voix de M. Méry, cette fois — un très sonore langage :
Le soleil disparate, et ses splendeurs sublimes
S’effacent lentement ;
Où va cet astre roi ? Dans quels profonds abîmes
Brille-t-il maintenant ?
Et voilà pourquoi Scribe fut le plus heureux et le plus recherché des librettistes. À vers trop sonores, accompagnement confus ! Les voix célestes
ont une hymne d’un ton plus vif.
Le premier acte est au village de Domrémy. Avec le premier chœur, les voix grimpent comme dans un assaut. La fête de l’Aubépin
est le premier épisode. Les jeunes filles
se partagent les rameaux bénits :
À nous les rameaux odorants
Pour en faire de doux présents ;
Car c’est encor l’antique usage :
Celui qui de nous recevra
La fraîche fleurette bénie
Nous acceptera pour amie,
Et plus tard nous épousera.
Lionel, un soldat, réclame la part de Jeanne. Lionel est un condottiere à la solde de tout le monde et qui s’est épris de la paysanne aussi sage que belle
. La morale du soudard épouvante les villageois. Il s’épanche en public dans une cavatine :
Je vends mon bras, je vends mon sang !
Un inconnu
les achète.
Et que m’ordonnez-vous, seigneur, présentement ?
demande ce Ruy-Blas à Bertram déguisé, qui répond :
… de suivre Jeanne, et d’être son amant !
Si la cavatine du soudard, bien que chantée d’une voix franche par M. Ulysse du Wast, est incolore, le duo chanté par cet artiste et l’Inconnu — M. Gaspard — est une page assez caractérisée, lumineuse, éclatante. L’ensemble : Pauvre fou !
est coloré, original, bien fondu, bien soudé, et est remarquablement chanté. La cabalette du basso : Sois heureux selon ton envie
, est d’une accentuation admirable, et l’interprète autant que le maestro lui-même s’y est distingué.
Le premier acte est couronné par un chœur et un accompagnement de haquenées ; les deux chevaux conduisant Jean et Lionel à la cour de Bourges sont accompagnés par un rythme assez entraînant. Les chœurs sont en général assez bien traités, quoique n’étant pas sans réminiscence ainsi que l’œuvre entière. On pourrait — malicieusement — prodiguer d’autres noms à chacun des historiques personnages que le choix du librettiste a placés là. Dans ce Jean de Luxembourg est l’accent comme le souvenir de Bertram ; la figure de Lionel est assez vague, assez inaccusée ; mais dans le duo du quatrième acte, où cette fois le maître a cherché la passion, tout le quatrième acte de la Favorite éclate à travers les mélodies déchirées et s’impose invinciblement à cette voix qui n’est pas celle qu’avait Fernand. Mais ce serait là une attention stérile. Le maestro réclame partout au nom des droits imprescriptibles du chanteur. Où la réminiscence, en dépit de lui surgit, il réagit bientôt et semble protester en couronnant ses chants de ce qui est tout lui-même. Il tire de la voix, pour laquelle il écrit, des accents tout nouveaux, des sons prodigieux et inconnus. Ces mélopées vraiment nouvelles s’empreignent alors d’une originalité curieuse. Le plus éclatant effet obtenu est celui de l’acte de la cour de Bourges, où le maître a placé dans l’air chanté par le ténor une succession de notes suraiguës, inaccessibles à des voix qui ne seraient point pétries par lui. Cela est bizarre et stupéfie, mais cela électrise et subjugue aussi. Le premier soir, aucun n’y a résisté, et sur ce dièse triomphant il est certain qu’on voulait finir. Le second soir, alors que l’interprétation tout entière est venue à bout de sa tâche, ces ut ont moins trouvé le chemin de l’oreille et du cœur. Un coryphée-ténor venait d’obtenir un succès hâtif et de bisser trop complaisamment la chanson de Dunois, dont les formules mélodiques sont vraiment étranges, sans avoir pour cela proprement un caractère distinctif. Le rythme des couplets semble celui d’une villanelle, et celui du refrain une sérénade chantée en chœur.
L’accompagnement de ce prétendu chant de guerre est remarquable ; il se détache du chant avec une netteté parfaite, tout en se fondant avec lui dans un nécessaire unisson. Ce chant de guerre est écrit pour ténor ; le maître, là encore, et dans tout, a peut-être trop marqué sa prédilection pour cette voix : on ne compte pas moins de quatre ténors dans son ouvrage : Ulysse du Wast, chargé du rôle de Lionel ; M. Braut, qui chante La Hire et la chanson de Dunois, un autre ténor faisant une partie très saillante au quatrième acte dans un duo bouffe entre deux archers ; enfin M. Gaston Aubert (Charles VII), plus spécialement chargé de lancer les ut. Malheureusement, mardi, ses ut ont eu peine à trouver grâce ; on les trouva mal venus, sans sonorité, sans éclat ; ils se sont perdus. Voilà le danger ! Une œuvre bien inspirée ne se met point ainsi à la merci d’un larynx. Après ces ut, il y a peu de choses, s’il en reste encore beaucoup à entendre. L’acte du Sacre est plein de lenteurs et de faiblesses. Lionel qui, depuis Domrémy a suivi Jeanne en qualité de d’écuyer, et qu’on n’entrevoit point à l’acte de Bourges, vient exhaler sa plainte et ses remords. Il a passé, dit-il, au camp anglais et lancé à Jeanne le trait mal assuré dont elle fut blessée à Orléans. Jean de Luxembourg, auquel est dévolu un assez bizarre caractère, ranime son courage, et le lance encore à la suite de Jeanne, au triomphe et bientôt au malheur.
De Reims, Jeanne passe à la prison de Rouen. Dans l’opéra primitif, opéra que beaucoup comme nous ont pu entendre exécuter chez M. Duprez lui-même, et dont l’héroïne était encore comme aujourd’hui Maria Brunetti, à laquelle on avait joint le baryton Raynal, que la création de Valentin, de Faust, venait de mettre en lumière au Théâtre-Lyrique, et qui créa véritablement, chez Duprez, le rôle de Lionel, échu maintenant à un ténor : Lefranc, déjà expert à lancer les ut ; Ballanqué, la basse à qui M. Gaspard aujourd’hui succède ; Caroline Duprez, Marie Battu (les voix célestes), enfin Duprez lui-même, qui jouait pour son compte jusqu’à quatre rôles, notamment le père de Jeanne, un La Trémouille quelconque, un malandrin, puis le bourreau ! Dans cette ébauche première était un tableau supprimé depuis et représentant une orgie soldatesque, ainsi que la vente de la prisonnière : il y avait là une chanson de malandrin que chantait Duprez et que fort on applaudissait. Ce tableau aura fait longueur sans doute. Le quatrième acte s’ouvre aujourd’hui sur la prison et commence par un duo bouffe exécuté par les sentinelles. Ces soldats sont gaillards ; l’un d’eux veut regarder Jeanne par-dessus la muraille : Je risque un œil
, dit-il ; l’autre répond C’est infâme
. On a souri, bien que la voix des deux soldats ne fût point sans sonorité et sans charme. Le baryton surtout, nommé Frédéric, possède une voix grave, ample et d’un excellent timbre. Après ce duo, se place un air chanté par Jean de Luxembourg, et dont M. Gaspard a fait une mélodie puissante. Luxembourg introduit un moine dans la prison : ce moine est Lionel. Jeanne se défend contre lui et s’arme de son épée comme l’archange. Le livret obéit ici à ce que rapporte l’histoire. Jeanne ne fut condamnée qu’à la réclusion dans un couvent et à l’amende honorable par le tribunal présidé par l’évêque de Beauvais, Pierre Cauchon ; mais il lui était enjoint, sous peine d’être abandonnée par l’Église au bras séculier, de ne plus retomber dans ses erreurs
. Revêtir de nouveau ses habits de guerre était tomber pour elle en impénitence finale, et les Anglais, voulant tenter de détruire, par sa mort ignominieuse, son œuvre émancipatrice dans l’esprit des peuples, eurent grand soin de lui laisser dans sa prison les vêtements qu’il lui était enjoint de ne plus porter. Elle s’en revêtit pour se défendre contre les outrages de la soldatesque. On intervint, et la prisonnière, appelée relapse, fut conduite au bûcher, d’où une blanche colombe, dit-on, s’éleva, alors que, nouveau martyr, elle jeta son Éli sabactani vers le ciel. Dans l’opéra de Duprez, c’est Jean de Luxembourg et ses soldats qui surprennent Jeanne armée du glaive. Le livret parle ainsi : Jeanne est debout sur son lit, dans la pose de l’ange exterminateur ; urne auréole entoure son front. La foule tombe à genoux…
Cette main vous épouvante,
Le glaive est levé sur vous
La martyre est triomphante,
Les bourreau sont à genoux !
Mais cette mise en scène est modifiée et l’auréole est restée à la cantonade et dans l’esprit du poète.
Le bûcher où monte Jeanne est d’un réalisme assez habile ; et les flammes, en léchant les vêtements de la martyre, ont épouvanté les cœurs sensibles de l’auditoire. On a criée : Assez ! assez !
Ce malheureux finale était né pour les incidents. À la représentation de 1860 chez Duprez, le bûcher était plus primitif. Le maître qui, comme nous l’avons dit, jouait le rôle du bourreau, avait attachée Jeanne au poteau avec une conviction réelle. Les cordes tenaient mieux que chez les frères Davenport. Or, il arriva qu’il s’éleva du bûcher, non point des flammes comme aujourd’hui, mais une fumée bien dense, et Jeanne, qui chantait avec une persistance sublime au milieu de cet incendie, perdit bientôt la voix et la connaissance dans le nuage qui l’enveloppait.
Ce dénouement ne s’est perfectionné qu’en ce qui concerne l’appareil crématoire. Le rideau tomba, mais-pour se relever bientôt et entendre proclamer un nom que cet essai n’amoindrit pas. Gilbert Duprez peut manquer de cette inspiration fougueuse qui saisit Verdi, de cette passion débordante qui entraînait Donizetti et de cette perfection acquise et innée qui fut la force de Meyerbeer. Il peut manquer, enfin, de cette personnalité robuste qui saute aux yeux, mais sa musique a son caractère, et on se familiarise avec elle, on la perçoit clairement, on la retient même ; elle est d’une audition facile, et ce qui la caractérise est surtout les effets qu’il sait, avec elle, tirer des voix.
Aussi pensons-nous qu’il faut avoir été instruit par lui pour la bien comprendre. Mlle Brunetti, qui cette fois ne l’a point trahi, a déployé, a mis, dès le prologue, une ardeur qui n’est plus allée par la suite qu’en s’affaiblissant. Comme femme elle réalise assez bien l’idéal prêté par le ciseau de la princesse Marie à l’héroïne. Nous doutons pourtant que Mlle Brunetti, dont la carrière est déjà peut-être trop remplie depuis ses débuts à Marseille, à l’Opéra, au Théâtre-Lyrique et sur intrusion dans le répertoire italien, puisse supporter longtemps le lourd fardeau qu’on vient de poser sur elle. Dans cette prévision, une autre Jeanne est déjà prête : son nom est Lustani-Mendès, une Espagnole ayant paru à Bade, et, ce dernier hiver, au théâtre de Strasbourg.
Le ténor Ulysse du Wast est doué d’une petite teille et d’une petite voix, mais il est plein de fougue, et sa voix, sans timbre, a de la franchise ; il est allé s’affaiblissant, lui aussi, et son duo du quatrième acte avec Jeanne eût pu atteindre à un éclat véritable, si cette voix eût épandu sur lui plus de richesse : sur cette mélodie du maître, il eût fallu des diamants.
Le ténor Gaston Aubert est un produit de l’art et de la nature. Sa voix n’est point factice, mais malaisée, et c’est moins le ténor rêvé que la haute-contre d’autrefois.
L’artiste qui recueillera le plus de fruits de cet essai lyrique est M. Gaspard ; il a été remarqué de tous ; sa prestance est belle et sa voix possède un timbre de bronze et d’or. Le son est large, coloré, vigoureux ; il accentue avec une merveilleuse netteté. Par moments, il rappelle l’émission si caractérisée d’un artiste dont on se souvient : M. Barielle. Le successeur de Cazaux est dans cet artiste, déjà remarqué et formé à l’école des grandes scènes, et avec lui l’Opéra n’aurait pas de plus imposant Saint-Bris et de plus puissant Guillaume-Tell.
Le Ménestrel 29 octobre 1865
Extrait de la Semaine théâtrale de Gustave Bertrand.
Durée de l'opéra :
La représentation peut durer environ quatre heures.
Sources historiques du livret, et graphie Darc :
Le livret que Duprez a mis en musique est de son frère Édouard et de Méry. Il suit assez, fidèlement l'histoire et a probablement profité des savants et curieux travaux de nos maîtres de l'École des Chartes, MM. Jules Quicherat et Vallet de Viriville : un tout petit détail suffirait à nous le persuader ; c'est que les auteurs ont scrupuleusement adopté l'orthographe authentique du nom de Jeanne Darc.
Le fameux contre-ut :
Gaston Aubert, qui jouait Charles VII, a fait applaudir deux ut dièse qui nous ont paru, à vrai dire, plutôt de fausset que de poitrine.
Lien : Retronews
Semaine théâtrale. Grand Opéra Populaire. — Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes, avec prologue, poème de MM. Méry et Éd. Durez, musique de M. Gilbert Durez.
Enfin elle a eu lieu la véritable première représentation de Jeanne d’Arc, l’inauguration sérieuse du Grand Opéra Populaire, et tous les mauvais pronostics ont été conjurés. D’abord, malgré les menaces du temps, qui semblait enrôlé par une cabale, l’assemblée s’est retrouvée aussi brillante qu’à la première soirée ; le directeur de l’Opéra était revenu, nombre de compositeurs et d’artistes étaient là, et parmi ces derniers nous voulons citer Mme Rosine Stolz, Poultier, Roger, qui applaudissaient de grand cœur la tentative de leur ancien camarade.
Mais venons sans tarder à l’œuvre-même.
L’œuvre se divise en cinq actes précédés d’un prologue ; mais il faut dire que les derniers actes sont relativement courts, et que la partition n’est pas, tant s’en faut, aussi compacte que certaines partitions du Grand Opéra, qui affichent quatre actes seulement, avec une modestie trompeuse. La représentation peut durer environ quatre heures, ce qui est, suivant nous, la bonne et parfaite mesure.
Je n’ai guère besoin de dire que le sujet est un des plus beaux que l’histoire puisse offrir. Aussi n’est-il pas inédit sur la scène lyrique. Outre la Giovanna d’Arco, de Verdi, il y a eu en 1821 une Jeanne d’Arc, de M. Carafa, à l’Opéra-Comique : l’Opéra-Comique se permettait alors les grands sujets historiques, tels que Guillaume Tell, Pierre le Grand, Masaniello… Parmi les sujets proposés vers 1830 à Rossini pour l’Opéra français, il y avait une Jeanne d’Arc : personne n’osa reprendre le livret qui n’avait pas su déterminer l’illustre maître à rompre le silence. Mais il faut dire que Halévy était inspiré dans Charles VI de tous les sentiments guerriers et patriotiques que la légende de Jeanne d’Arc éveille naturellement : il n’y manquait guère que l’héroïne, mais c’était beaucoup ; c’était assez pour que l’œuvre fût à refaire sur nouveaux frais. Plusieurs y ont pensé en même temps que M. Duprez : une Jeanne d’Arc fut proposée l’an dernier à M. Carvalho par M. Germain (de Carcassonne), et obtint une audition très-sérieuse ; mais c’est un autre ouvrage de ce jeune compositeur de province que le Théâtre-Lyrique a reçu et doit monter. Tous nos lecteurs savent aussi que l’heureux auteur de Roland à Roncevaux songe maintenant à une Jeanne d’Arc ; donnera-t-il suite à son projet ?
Le livret que Duprez a mis en musique est de son frère Édouard et de Méry. Il suit assez, fidèlement l’histoire et a probablement profité des savants et curieux travaux de nos maîtres de l’École des Chartes, MM. Jules Quicherat et Vallet de Viriville : un tout petit détail suffirait à nous le persuader ; c’est que les auteurs ont scrupuleusement adopté l’orthographe authentique du nom de Jeanne d’Arc. Le prologue nous transporte près de l’arbre des fées, dans le Bois des Chênes, à l’endroit même où la bergère de Domrémy entendit les voix célestes qui lui dictaient sa mission.
Le premier acte est intitulé la Fête des fleurs, à cause d’une sorte de cérémonie champêtre, qui sert de cadre aux adieux de Jeanne d’Arc, quittant son père et ses compagnes d’enfance pour se rendre à la cour. Le deuxième acte, intitulé le Roi de Bourges, nous montre l’héroïne à la cour de Charles VII, accueillie d’abord avec quelques sourires ironiques par les seigneurs qui se laissent ensuite gagner à son enthousiasme. Au troisième acte, c’est le Sacre, le cortège triomphal et Jeanne menant son roi à la cathédrale de Reims, suivant sa prophétie. Le quatrième acte nous mène à Rouen, dans la Prison. Le cinquième nous montre Jeanne sur le bûcher en flammes, c’est le Martyre. Tel est le plan très-simple de l’ouvrage. Pour y mêler quelque passion plus particulièrement dramatique, les auteurs ont imaginé un jeune soudard, sans foi ni loi, qui s’éprend de Jeanne et dont elle repousse l’amour avec dédain, tout entière aux voix qui l’inspirent et à sa mission. Ce Lionel devient un espion des Anglais, puis se repent et demande à Jeanne de lui rendre un peu d’estime. Plus tard, déguisé en moine, il s’introduira dans la prison, grâce à l’appui d’un certain seigneur de Luxembourg, qui favorise constamment ses mauvais desseins et poursuit l’héroïne d’une haine dont nous n’avons pas bien démêlé les motifs. Le faux moine, après avoir arraché à la prisonnière l’aveu d’un amour mystérieux pour le soldat Lionel, jette le froc et se fait reconnaître ; ses instances passionnées vont si loin, que la vierge de Domrémy saisit son épée, malgré le serment qu’elle avait fait au tribunal de ne plus reprendre les armes. Luxembourg, aposté avec des témoins, n’attendait que cet instant : la mort de Jeanne est ainsi rendue irrévocable. Cet incident, qui est presque historique, forme la seule situation vraiment dramatique du livret : tout le reste est purement d’histoire ou de fantaisie.
L’avantage de ce livret est d’être très-clair, très-simple à comprendre, et ce sera sans doute une des conditions du succès auprès du public populaire qui va succéder à l’auditoire de choix des deux premières représentations.
La partition a chance de plaire, car toutes ses qualités se laissent saisir à première audition. Elle est brillante, franchement sonore et vigoureuse quand il le faut, sans dédaigner le contraste de quelques morceaux d’un style léger, plus voisin de l’opéra comique ou de l’école italienne que du grand opéra. Tout y semble facile, bien qu’on y aperçoive à maint endroit un travail d’harmonie assez complexe ; l’orchestration est la partie qui trahit le plus d’inexpérience, et l’orchestre, fort bien conduit par M. Maton, nous a paru un peu insuffisant comme ressources. Les chœurs étaient mieux fournis.
La plus grosse critique qu’il y ait à faire à la partition de M. Gilbert Duprez, c’est qu’elle témoigne de plus de savoir-faire que d’originalité. — Citons les morceaux qui nous ont le plus frappé. Au prologue, les strophes de l’extase ont été justement applaudies, mais le chœur des voix célestes est peut-être d’une simplicité outrée. Au premier acte, il y a un chœur champêtre qui ne manque pas de grâce ; le duo de Lionel et de Luxembourg a été bien chanté par le ténor Ulysse du Wast et le baryton Gaspard. Le deuxième acte est tout guerrier ; on a bissé l’air de La Hire, avec chœur, qui est, en effet, très-brillant ; puis vient un air de Charles VII, qui a aussi beaucoup d’allure et qui obtint les honneurs du bis à la première-première représentation. Je demande la permission de passer plus vite sur le finale, sur les fanfares triomphales du troisième acte, et sur le grand air de Lionel, pour arriver au beau duo de la prison, qui a plusieurs phrases vraiment inspirées. Les intentions bouffes du duo des archers faisaient dissonance à cet endroit du drame ; le compositeur eût mieux fait de se priver d’un contraste que personne ne lui demandait. Au cinquième acte, il y a un grand air de Jeanne et un retour heureux de la phrase principale de l’Extase du prologue.
La charmante Mlle Brunetti n’avait sans doute pas encore toute la vaillance qu’elle doit donner au rôle de l’héroïne ; presqu’au lendemain du malheur cruel qui vient de la frapper, ce qu’elle a fait est un prodige de dévouement. Toutes les parties qui demandent de la grâce et de la tendresse ont été rendues en perfection. Le ténor Ulysse du Wast n’est pas sans défaut, mais il y a plus d’un ténor établi à Paris qui ne le vaut pas ; il tient hardiment la scène, chante avec méthode, et sa voix, qui pourrait être plus mâle et plus timbrée, a du moins de la souplesse. Un autre ténor, nommé Gaston Aubert, qui jouait Charles VII, a fait applaudir deux ut dièse qui nous ont paru, à vrai dire, plutôt de fausset que de poitrine ; cet artiste a fort à faire encore pour apprendre à lier la voix et à prononcer. Le baryton Gaspard est doué d’un physique et d’une voix qui en feront un superbe Guillaume Tell quand il aura fini ses études. N’oublions ni Mlle Arnaud, qui tient à son honneur le petit rôle de Perrine, ni ce jeune ténor à voix franche, nommé Braut, à qui l’on a redemandé l’air de La Hire, et qui s’est chargé de deux autres personnages accessoires. Le nombre des bouts de rôle est d’ailleurs considérable, et l’on voit que Duprez a compté sur les richesses de son école.
En somme, musique, livret, artistes ont été écoutés avec un intérêt sympathique et soutenu. La partie est donc presque gagnée pour Jeanne d’Arc et pour le compositeur. Reste la question du Grand Opéra Populaire : quel en sera le répertoire ? Il ne suffit pas de l’inaugurer, il faut en assurer l’avenir. Nous ne partageons pas les craintes qu’on exprime communément à cet égard ; nous croyons que le plus difficile, le plus hasardeux est fait, si Duprez s’est constitué définitivement l’impresario.
Le Figaro 29 octobre 1865
Lien : Retronews
M. G. Duprez a de la chance.
Je ne parle pas du compositeur Duprez, — je parle de Duprez le chanteur !
Au 15 août, décoré.
Et de plus, trois mois après, — c’est-à-dire dans quelques jours, — exproprié, et enrichi Dieu sait !
Après cela, pourquoi diable faire jouer des opéras.
La Gazette nationale ou le Moniteur universel 30 octobre 1865
Extrait de la Revue des théâtres de Théophile Gautier fils, en feuilleton du 30 octobre 1865.
Lien : Retronews
Théâtre du gymnase : Le Lion empaillé (reprise), de M. Léon Gozlan. — Théâtre Déjazet : Monsieur de Belle-Isle, vaudeville en deux actes, de M. Jaime fils, musique de M. Eugène Déjazet. — Grand-Théâtre-Parisien : Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes, avec prologue, paroles de MM. Méry et Édouard Duprez, musique de M. G. Duprez. — Cirque de l’Impératrice : Concerts donnés par le musique du 34e régiment de ligne prussien.
Après un faux départ, dont on connaît les péripéties, la Jeanne d’Arc de Duprez a été définitivement jouée d’un bout à l’autre et sans encombre mardi dernier. Le succès qui s’était ébauché à la précédente tentative s’est affirmé de la façon la plus éclatante, et le public du Grand-Théâtre-Parisien a prouvé qu’il était capable d’entendre autre chose que des drames sanguinolents.
L’histoire de Jeanne d’Arc, transformée en légende par l’imagination populaire, était un sujet qui devait se présenter naturellement à l’esprit d’un compositeur désireux de séduire par tous les moyens possibles un public auprès duquel la musique pure n’est pas une recommandation suffisante, et M. Mermet, qui a entrepris de créer une littérature musico-nationale travaillait, après le encres de Roland à Roncevaux, à un grand opéra de Jeanne d’Arc. Il ne s’arrêtera pas au milieu de son entreprise, espérons-le ; le sujet est assez riche peur supporter deux versions différentes et pour procurer succès à des auteurs divers.
Le principal écueil, lorsqu’on veut faire entrer dans le cadre étroit et régulier du théâtre une figure comme celle de Jeanne d’Arc, consiste en ceci, que l’élément amoureux, sous aucune des formes traduisibles en musique, ne peut être introduit dans la vie de l’héroïne de Domrémy. Au lieu d’être le pivot de la pièce, d’être l’astre central autour duquel gravitent tous les événements et tous les personnages de l’œuvre, le sentiment amoureux ne peut se glisser que timidement dans l’action et se trouve réduit au rôle de satellite ; ailleurs il brille et chauffe comme un soleil, ici il n’est qu’une triste lune sans éclat.
Enfermé dans le cercle de l’histoire, qui avec la meilleure volonté du monde ne peut dépasser un certain degré d’élasticité, le librettiste n’a guère autre chose à fournir que des scènes guerrières ou des épanchements mystiques au compositeur, qui de son côté se trouve réduit à alterner les fanfares et les chants d’église, tantôt à faire sonner la trompette et tantôt à faire vibrer les cordes des harpes, procédé qui finit par engendrer la monotonie.
Sans avoir complètement évité l’écueil, les auteurs de l’opéra de Jeanne d’Arc l’ont assez habilement tourné. Ils ont mis dans la pièce et dans la musique un certain mouvement, lui ont donné une allure entraînante, qui ont paru goûtée du public.
La vie de Jeanne d’Arc se déroule tout entière dans cette œuvre en six actes. Nous la voyons à Domrémy, simple bergère, agitée de rêves prophétiques, hantée par des visions héroïques, suscitée par des voix mystérieuses. Elle est déjà enlevée à la vie vulgaire, aux sentiments humains ; aussi, lorsque Lionel vient lui demander sa main promise par son père, elle le repousse et lui répond que Dieu lui a commandé de sauver la France ; Lionel, pris d’admiration pour la noble héroïne, lui jure de suivre ses pas et part avec elle pour la cour de Charles VII.
Nous voici à Bourges ; devenue capitale de la France par suite des victoires des Anglais. Les seigneurs de la cour, qui ne semblent pas trop vivement affligés des malheurs de leur patrie, plaisantent La Hire qui parle de la jeune bergère avec enthousiasme ; le roi lui-même, malgré ses assurances positives sur la mission providentielle de Jeanne, ne peut les ramener à prendre la chose au sérieux : mais leur ironie se transforme en admiration lorsqu’ils voient arriver Jeanne qui les nomme tous et leur ordonne de la suivre et de s’élancer avec elle contre les ennemis.
Après avoir fait sacrer le roi à Reims, qu’elle y avait amené à travers mille périls, Jeanne d’Arc, on le sait, voulait se retirer : ses voix intérieures lui disaient que sa mission était terminée ; le roi n’y consentit point, et la fortune commença dès lors à tourner contre elle. Au siège de Compiègne, dont les auteurs ont esquivé le tableau et même le récit, Jeanne fut prise par les Anglais et emmenée à Rouen, et emprisonnée dans une tour dont il est beaucoup question aujourd’hui.
C’est sur la paille de cette geôle que nous la retrouvons, après l’avoir vue trôner à Reims, auprès de Charles. None y revoyons aussi Luxembourg, un farouche personnage qui brûle de feux impurs pour la vierge guerrière, et Lionel, qui l’aime toujours, est introduit sons un déguisement de moine dans son cachot. Luxembourg les surprend dans ce tête-à-tête, et comme Jeanne, voulant se défendre des attaques de Lionel, a saisi l’épée de ce dernier, Luxembourg en profite pour accuser Jeanne de rébellion.
Le dernier acte est intitulé le Martyre. Le bûcher est dressé sur la place du Vieux-Marché à Rouen. La foule assemblées, commente le grand événement qui va avoir lieu. Enfin arrive le funèbre cortège Cauchon, l’évêque de Beauvais, le duc de Bedford, Luxembourg, le cardinal de Winchester, et Jeanne, vêtue de la robe blanche des anges, ses longs cheveux déroulés, déjà transfigurée par la joie de mourir pour son Dieu, pour son roi, pour sa patrie. Elle monte pur le bûcher, et à peine a-t-elle pardonné à Lionel, qui se tue à ses pieds, que les flammes l’enveloppent et sa voix disparaît dans les pétillements sinistres.
La musique que Duprez a écrite sur ce libretto rapide est fort simple et ne contient rien de bien génial
. Elle a, comme on dit, quelque chose de déjà entendu ; cependant, ce déjà entendu, on éprouve un certain plaisir à l’entendre de nouveau ; il règne dans l’œuvre une allure de santé et de force toute française qui a enlevé le public.
Parmi les morceaux qui ont produit le plus d’effet, — et c’est ceux-là qu’il convient de citer, l’effet étant le principal but de la musique populaire, — nous avons remarqué le chœur de la fête qui ouvre le second tableau très-habilement dialogué, le duo de Lionel et de Luxembourg, un air au troisième tableau qui permet à M. Aubert de lancer de nombreux ut dièse et de poitrine, un morceau chanté par Jeanne d’Arc dans la prison, une marche guerrière fort bruyante.
Mlle Brunetti n’a peut-être pas le tempérament nécessaire pour soutenir ce rôle si lourd de Jeanne d’Arc ; elle manque d’énergie réelle ; ses extases et ses élans ne sont point ceux d’une paysanne, d’une simple fille poussée par une vision intérieure ; mais quant à la méthode et au talent, on doit des éloges à Mlle Brunetti, qui se sert de sa voix avec une habileté dont seul Duprez pouvait lui donner le secret.
Le Siècle 31 octobre 1865
Extrait de la Partie littéraire, feuilleton du 31 octobre 1865, par Gustave Chadeuil.
Lien : Retronews
Revue Musicale. — Jeanne d’Arc au Grand-Théâtre-Parisien.
Les quartiers excentriques ne passent pas précisément peur favorisés. La pioche les respecte encore. Pourquoi les attaquerait-elle plus vite ? Elle mettrait des palais à la place de ces vieilles maisons où les pauvres gens trouvent encore à se loger. Il faut bien mieux laisser les choses comme elles sont, en se bornant à améliorer les conditions de salubrité. Tout faubourg consulté ne demande qu’à rester faubourg. Seulement, ce qu’il souhaite, c’est une faible part dans le fonds des plaisirs communs. Il paye l’octroi et la patente ; n’a-t-il pas droit à quelques distractions ?
Mais, dira-t-on, les théâtres, par exemple, sont avant tout des entreprises particulières, et il n’appartient pas à l’autorité de les imposer aux entrepreneurs. Je ne le conteste pas. Toutefois, je n’aurais pas vu le moindre mal à ce que la ville eût fait construire de vastes salles dans les arrondissements populeux, comme elle l’a fait libéralement à sa porte, sur la place du Châtelet transformée.
L’industrie privée s’est chargée de réparer cet oubli. C’est donc à nous de la féliciter. En fondant le Grand-Théâtre-Parisien dans un local que je considère comme provisoire, elle suivait les traces des concerts Pasdeloup, dont la succès était encourageant.
Restait à fixer le genre qu’on adopterait.
Le vaudeville, la comédie, le drame avaient leurs partisans. Aucune de ces œuvres ne s’excluait. On pourrait alterner en vertu de ce principe : in varietate voluptas.
Ce n’était pas encore là le mieux possible.
En fait de drame, de comédie, de vaudeville, les opinions sont partagées.
La musique seule (quand elle est bonne) a le don de plaire à tous indistinctement.
De plus, elle sert à quelque chose, témoin l’orphéon, qui fait une guerre impitoyable aux cabarets.
La solution du problème était trouvée ; restait à l’appliquer. Mais comment ? Aurait-on des opérettes, des opéras comiques ou des opéras ?
En général, nous aimons la difficulté.
Or, il était trop facile de monter un Tromb-al-ca-zar quelconque, qui ne s’adressât qu’aux désœuvrés, ou de s’emparer des compositeurs tombés dans le domaine public. L’audace voulait qu’on s’attaquât tout de suite au grand opéra.
Et M. Duprez est venu, et il a dit : J’ai votre affaire, une Jeanne d’Arc toute neuve, paroles de M. Méry et Édouard Duprez. Le sujet est essentiellement national ; nous avons taillé notre poème en plein dans l’histoire. Il faudrait avoir bien du malheur pour échouer.
Et l’on a mis immédiatement l’ouvrage en répétition : Audaces fortuna juvat.
Je me réjouis de cette courageuse initiative pour plusieurs raisons, toutes meilleures les unes que les autres : d’abord c’est que la musique sérieuse remplacera, là-bas, les abrutissants refrains des chansons populacières ; ensuite, c’est que j’aperçois une nouvelle porte ouverte à tous les talents.
Un chanteur naîtra peut-être, ou une cantatrice, ou un auteur, — et le besoin s’en fait vivement sentir. Les théâtres consacrés ne se gênent guère avec nous, n’étant pas stimulés par l’émulation. Ils se contentent d’un personnel par à-peu-près et d’une pièce tant bien que mal. Que fait cela ? Nous y allons par habitude.
Quand ils verront une scène jeune, mal située, mal vêtue, mal logée, les dépasser en activité, peut-être alors se décideront-ils à tenter quelques efforts pour nous satisfaire. Ainsi soit-il ! dirait un critique ultramontain.
Donc, on a joué la Jeanne d’Arc de M. Duprez.
Je vous ai raconté les impressions de la première soirée, qu’une indisposition de la principale interprète interrompait brusquement après le prologue. Je vous dois la légitime compensation d’un compte rendu plus complet, maintenant que le feu d’artifice est tiré.
J’ai dit tout à l’heure, ou plutôt M. G. Duprez l’a dit pour moi, la donnée de Jeanne d’Arc est empruntée scrupuleusement à nos annales. Résumer la vie de l’héroïne ce sera raconter la pièce depuis l’introduction jusqu’au dénouement.
Après la mort de Charles V, on fut en présence du duc d’Anjou, dont le caractère n’était pas fait pour le bonheur d’un peuple, écrasé déjà par mille impôts. Le duc d’Anjou commença par voler les bijoux et les économies de la couronne ; puis il alla s’associer à Jeanne de Naples, sans doute parce que leur infamie mutuelle se valait. À eux deux, ils commirent une foule de crimes politiques qu’il serait trop long d’énumérer. Les guerres intestines firent couler un fleuve de sang français. La folie de Charles VI vint augmenter encore tous ces fléaux. Ce fut à qui ruinerait le peuple, par tous les moyens possibles et impossibles. Les tuteurs du roi fou se disputaient entre eux le pouvoir ; la noblesse, cupide et barbare, s’emparait du reste, frappant des tailles et des corvées à tort et à travers, comme pour mettre le pays sens dessus dessous. On n’avait pas le temps de se reconnaître au milieu de ces exactions.
Par-dessus le marché, la reine Isabelle de Bavière se montra l’irréconciliable ennemie de la monarchie qu’elle avait mission de défendre et de soutenir. Elle commit fautes sur fautes ; horreurs sur horreurs, comme femme sans mœurs, comme épouse infidèle, comme princesse coupable. Pour déshériter son fils, elle fit couronner solennellement, à Paris ; Henri de Windsor, enfant de dix mois.
Et l’étranger pénétra chez nous.
Les Anglais récompensèrent leur complice Isabelle de Bavière, en l’outrageant selon ses mérites, et, quand elle mourut, ils jetèrent son corps à la voirie, pour de là le faire porter à Saint-Denis, en cachette, comme une chose dont on rougit.
Charles VI n’eut pas meilleure chance. Les mystères de l’hôtel Saint-Paul pourraient seuls vous dire sa fin.
La France, on le voit, était en train de périr.
Charles VII eût pu la sauver, mais il trouva plus commode de se laisser gouverner par ses favoris, comme un fantôme couronné.
La Hire le surprit un jour s’occupant dos préparatifs d’une fête, alors que le gouffre se creusait de plus en plus sous ses pas.
— Que penses-tu de mon sang-froid ? lui demanda le roi, qui prenait cette débauche pour une prouesse.
— Je pense, répondit La Hire, qu’on ne peut perdre plus gaiement un royaume.
Sur ces entrefaites, une jeune fille se présente résolument au capitaine de Baudricourt, qui gouvernait la ville de Vaucouleurs.
On était alors en 1429.
— Messire, lui dit-elle, sachez que depuis aucun temps Dieu m’a fait savoir que j’allasse par-devant le gentil Dauphin, qu’il me baillât des gens d’armes, et que je le mènerais sacrer à Reims.
Le gouverneur en rit aux éclats, et abandonna la visionnaire aux moqueries de la soldatesque.
Elle se rendit à Chinon, en Touraine, où résidait alors le roi.
Le roi était en train de se lamenter. Il n’avait plus que quatre écus dans ses coffres, et il parlait de se retirer dans le Dauphiné, moins pour réaliser des économies que pour échapper aux Anglais, qui faisaient le siège d’Orléans avec un formidable appareil de guerre. Il aimait mieux fuir que se défendre.
Lorsque Jeanne se présenta timidement, il lui dit en lui montrant un courtisan beaucoup mieux habillé que lui :
— Vous vous trompez, ma mie, car voici le roi.
— C’est vous le roi, répondit-elle. Votre air et le souvenir de mes songes me le disent. Ne cherchez pas à me tromper.
Et elle expliqua la mission céleste dont elle se croyait chargée, jurant qu’elle sauverait son pays et que le sacre se ferait à Reims.
On lui demanda quelque miracle, pour prouver que Dieu l’inspirait. Elle répondit :
— Je n’en ai pas sous la main ; mais que l’on m’accompagne à Orléans, et l’on verra des signes certains de ce que je promets.
La chronique ne dit pas si le roi mit à sa disposition ses quatre écus. Je serais presque tenté de croire qu’il les garda. Tant et si bien que Jeanne partit sous la conduite de Dunois, un capitaine expérimenté. Ce fut à qui s’enrôlerait sous sa bannière. Elle eut pour lieutenants principaux le maréchal de Rieux et l’amiral de Culant. L’armée se montait en tout à sept mille hommes. Elle en prit le commandement.
Elle somma les Anglais de restituer le pays usurpé, dans les vingt-quatre heures pour tout délai. Les Anglais répondirent à la sommation en mettant au cachot le messager.
Armée de pied en cap, dit Millet, maniant un cheval avec la plus grande adresse et portant à la main, une bannière consacrée, la jeune héroïne se met à la tête des troupes comme un ange tutélaire dont la présence fait mépriser les périls.
Il y avait cinq forts autour d’Orléans.
Elle en prit successivement trois. Le quatrième lui fit obstacle ; pas moyen de dresser les échelles contre ses murailles bien défendues. Alors la panique se mit dans les rangs et le sauve-qui-peut devint général. Mais elle marcha droit à l’assaut. Ses hommes prirent honte et se jetèrent en avant pour la protéger. Et la quatrième redoute tomba comme les autres.
Restait le poste du Tournelles, le plus terrible à forcer. Elle l’attaqua valeureusement. Dans la bagarre, elle reçut une flèche par le défaut de sa cuirasse.
— Ce n’est rien, dit-elle ; c’est un trait de faveur.
Il fallut quatorze heures de combat acharné pour s’emparer de la citadelle. Le comte de Salisbury était mort. Le général de Suffolk lui succédait ; il leva le siège d’Orléans.
Au lieu de s’endormir dans sa victoire, Jeanne d’Arc poursuivit ses ennemis jusqu’à Jargeau, sur la Loire, où tous les corps assaillants s’étaient reformés. Elle reprit Jargeau, puis Meung, Beaugency, Provins, Laon et Château-Thierry. À chaque pas une rencontre, à chaque rencontre un combat sanglant. Les Anglais y perdirent le meilleur de leurs troupes.
Pendant ce temps, que faisait le roi ?
Il s’abandonnait aux intrigues de ses courtisans, et s’amusait à réunir des conseils.
Jeanne d’Arc le tira de sa léthargie.
— Sire, lui dit-elle, c’est trop délibérer, agissons. Il faut vous faire sacrer à Reims.
Aller à Reims, c’est-à-dire traverser quatre-vingts lieues de pays, occupé par des ennemis exaspérés de leurs défaites ; lutter contre les siens, contre La Trémouille, contre le connétable de Richemont qui se détestaient, contre les ministres, les maréchaux, les généraux, c’était œuvre difficile. Elle l’osa. Et l’on partit pour la Bourgogne, qui laissa passer, et pour Troyes, qui se défendit.
— Qu’importe ! dit-elle au roi tremblant de peur ; avant trois jours nous serons à Reims.
L’archevêque de Reims était là ; il répondit en riant :
— Prenez-en sept, ma fille, et nous serons fort heureux si vous tenez parole.
Comme César, elle vint, elle vit, elle vainquit. L’armée royale entra tambour battant dans la ville où le sang des Capets était dans l’usage de recevoir l’onction sainte, à l’exemple des rois d’Israël. La cérémonie faite, Jeanne parla de retourner à ses moutons : Dieu nous en garde !
fit le roi. Elle consentit à rester encore.
Les Anglais assiégeaient Compiègne, où elle accourut en toute hâte, escortée de traîtres qui voulaient la perdre parce qu’ils ne savaient pu l’égaler. Un gendarme écossais la surprit par derrière et la fit tomber de son cheval. Elle essaya de gagner les portes de la ville pour échapper à la bande qui la poursuivait ; mais, elle eut la douleur d’entendre la voix du gouverneur qui ordonna de lever les ponts-levis pour lui couper la retraite, et la livrer ainsi pieds et poings liés à ses ennemis.
Elle se rendit à Lionnet, bâtard du duc de Vendôme, qui la vendit à Jean de Luxembourg-Ligny, lequel la revendit aux Anglais moyennant une somme de dix mille livres d’argent comptant, juste le prix de la rançon du roi Jean.
Tout le monde voulut visiter la prisonnière, depuis les grands seigneurs d’Angleterre jusqu’au duc de Bourgogne, Philippe le Bon.
Personne ne la défendit.
Après l’Université, qui fit une requête contre elle, avec l’appui des parlements, le clergé de France se chargea de lui donner le coup de grâce, à l’instigation d’un nommé Cauchon, évêque de Beauvais, plusieurs fois exclu de son siège pour toutes sortes de méfaits. Le digne prélat disputa l’honneur de l’accusation, qui revenait de droit à frère Martin, vicaire général de l’inquisition. Il s’en acquitta d’une façon merveilleuse, en écartant avec soin tout ce qui pouvait servir de décharge à l’accusée, qu’il voulait convaincre de sorcellerie. Et il la pressa perfidement de questions théologiques auxquelles elle ne comprenait rien, cherchant à l’embarrasser dans ses réponses et dans son maintien. Si, par hasard, elle se défendait par des raisons bonnes, il avait soin de falsifier les procès-verbaux, après avoir gagné les témoins. Comme les lenteurs de la procédure irritaient son impatience, il résolut d’appliquer à sa victime la question extraordinaire, afin de lui arracher les aveux dont son réquisitoire avait besoin.
Elle dit tout ce qu’on cherchait à lui faire dire.
Et, dans un lugubre appareil, on la conduisit devant l’abbaye de Saint-Ouen, à Rouen, où son odieux procès s’instruisait. Là, Nicolas Midi, théologien, digne suppôt de Pierre Cauchon, déclama contre elle toutes les invectives imaginables, selon le vocabulaire des écrivains et des orateurs cléricaux.
— Abjures-tu, abjures-tu ! lui criait cet énergumène.
— Qu’est-ce qu’abjurer ? demanda-t-elle, toute meurtrie par les tortures de la question.
Nicolas Midi lui lut un modèle d’abjuration contenant la promesse de ne plus porter les armes et de quitter à jamais son habit d’homme. Elle signa. Seulement, sans s’en douter, elle venait de signer un écrit plus complet qui la reconnaissait dissolue, idolâtre et invocatrice des démons.
Cette confession lui valut la prison perpétuelle et le pain d’angoisse.
Alors le comte de Warwick furieux s’écria :
— Sachez, messieurs les théologiens, que le roi d’Angleterre a acheté cette prostituée trop cher pour n’avoir pas la satisfaction de la voir brûler.
Et Pierre Cauchon prit la parole, et dit hypocritement :
— Ne vous embarrassez pas pour si peu, mon cher comte ; nous saurons bien la rattraper.
Voici comment il la rattrapa :
Elle dormait tranquillement dans sa prison ; or, pendant son sommeil, on remplaça ses vêtements féminins par un costume militaire au grand complet ; ce qui fit dire à Pierre Cauchon, dans un transport d’enthousiasme feint :
— Elle avait juré de renoncer à ces habits, elle les reprend ; nous la tenons.
Désormais elle appartenait au bras séculier. Autour de la tête, on lui mit une mitre infamante, et sur la poitrine un tableau qui la qualifiait d’hérétique, de magicienne et de relaps.
Et pendant ce temps, le bon roi Charles VII s’amusait dans les bals, les carrousels et autres fêtes.
Jeanne d’Arc fut donc condamnée à être brûlée vive, comme sorcière, dans le Vieux-Marché. Pour mieux l’exposer aux regards d’une foule avide, au-dessus de son bûcher on mit un échafaud de plâtre. On y gagnait doublement : elle serait vue partout à la ronde, et elle subirait ainsi plusieurs fois la mort, à mesure que les flammes inégales l’atteindraient. Le 30 mai 1431, elle mourut martyre de son héroïsme. Puis le cardinal de Winchester jeta ses cendres à la rivière, avec des gestes de profond mépris.
Plus tard, Louis XI ordonna la révision générale de ce honteux procès, et fit condamner les juges à la peine du talion. Il n’en restait que deux ; les autres avaient fini misérablement. La justice du peuple avait déjà lapidé Pierre Cauchon.
Eh bien ! c’est toute cette histoire, à la fois pathétique et lamentable, que le Grand-Théâtre-Parisien expose en cinq actes, avec prologue, en beaux vers qui trahissent la plume éloquente de M. Méry. On y retrouve les horizons de Domrémy où la jeune fille a fait son rêve ; le château de Bourges, où le roi couvre sa honte au bruit de l’orgie ; la cathédrale de Reims où se fait le sacre ; les cachots de Rouen, où Jeanne subit le questionnaire des inquisiteurs ; la place du Vieux-Marché, où le bûcher se dresse comme une menace et comme un remords. Et ils sont là, tous les acteurs de ce lugubre drame, le roi, Lionnet, Jean de Luxembourg, Dunois, La Hire, Xaintrailles, Chabannes, La Trémouille, l’évêque de Beauvais et Bedford, non compris des hommes d’armes, des hérauts, des moines, des écuyers, des pages, des archers anglais, et même le bourreau dont la torche flambe. Les scènes ont de la grandeur.
Quant à le musique, elle s’adresse à des foules dont l’éducation lyrique n’est pas encore faite, et elle a dû nécessairement sacrifier beaucoup à l’effet. Avant tout, le compositeur s’est préoccupé des masses chorales, dont il attendait les principaux éléments de son succès. Le sujet d’ailleurs s’y prêtait à cause du nombre considérable des personnages, sans cesse groupés autour de l’héroïne. Tout le prologue, que je considère comme une superfétation, et qu’on pourrait facilement supprimer sans nuire à l’action, se passe entre Jeanne d’Arc et les voix invisibles ; sa couleur n’est pas nettement tranchée.
Au deuxième acte, nous retrouvons le chœur des paysans fêtant l’aubépine. Le motif de ce chœur est original.
Au troisième acte est la querelle entre La Hire et La Trémouille, empêchée par les chevaliers ; — autre chœur. Plus loin est un chant de guerre dont l’allure martiale rappelle certains passages de Guillaume Tell ; — autre chœur. Puis c’est l’explosion finale qui veut faire de tous ou des héros ou des martyrs ; — autre chœur.
Au troisième acte, on trouve le chœur des gens du peuple préludant au sacre de Charles VII ; ensuite on a le chœur de Montjoie et Saint-Denis. Ils sont habilement traités tous les deux.
Au quatrième acte, c’est le chœur des sentinelles, au pied du cachot où Jeanne attend sa condamnation.
Enfin c’est le supplice, sur la place du Vieux-Marché. Là tout murmure, tout menace. Les curieux jurent, les archers repoussent la foule ; le tumulte croît.
En dehors des chœurs, bien traités, on entend çà et là des mélodies un peu courtes, comme si l’auteur n’était pas bien sûr de l’inspiration. Elles débutent bien, mais tout à coup elles s’arrêtent dans leur développement, pour ne former que des lambeaux. Je ne parles pas des réminiscences ; elles sont nombreuses. Pouvait-il en être autrement ? Quand un chanteur a traduit pendant vingt ans la musique des maîtres, elle lui revient toujours par bouffées, et il a beau dire et beau faire, il la mêle involontairement à ses propres œuvres.
Résumons-nous : avec ses chœurs énergiques, malgré ses cabalettes douteuses et ses romances d’amour sans chaleur, la partition de Jeanne d’Arc constitue néanmoins une œuvre estimable. Les qualités et les défauts y figurent en portions égales. Si le sentiment y manque, on y trouve la vigueur comme compensation.
L’interprétation est généralement satisfaisante. On a particulièrement applaudi Mlle Maria Brunetti (Jeanne d’Arc) et M. Ulysse du Wast (Lionel) un charmant ténor.
Sans prétendre égaler ceux de l’Opéra, les décors ont un certain prestige ; la mise en scène a de la couleur.
Souhaitons de nouveau bonne chance au Grand-Théâtre-Parisien, qui prend l’initiative de l’opéra populaire à bon marché.
[Extrait des annonces de fin de feuilletons] Mlle Lustani a débuté samedi dans Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes, de M. Duprez. Elle a chanté avec un grand talent. Mardi son second début.
La Patrie 31 octobre 1865
Extrait de la Revue musicale de M. de Thémines (Achille de Lauzières), en feuilleton.
Lien : Retronews
Le Grand-Théâtre-Parisien a réussi enfin à donner tout entière Jeanne d’Arc, de M. Duprez. Ce n’a pas été sans peine ! Encore, la perte douloureuse que Mlle Maria Brunetti vient de faire de son père l’a-t-elle forcée, à la deuxième représentation, de céder son rôle à une autre jeune cantatrice. Comme Brunetti, Mlle Lustani a su s’y faire applaudir. Les applaudissements, d’ailleurs, n’ont fait défaut ni aux artistes de la nouvelle scène lyrique, en général, ni à M. Duprez. Le public a voulu exprimer sa sympathie et apprécier les louables efforts du ténor-compositeur. Tel ouvrage, en effet, qui eût paru insuffisant s’il était signé d’un des musiciens connus par des opéras joués sur nos premiers théâtres de chant, peut être considéré comme un tour de force venant de l’heureux interprète des œuvres d’autrui et de l’habile professeur de chant. C’est surtout à ce point de vue que l’on a fait un aussi bienveillant accueil à l’opéra de M. G. Duprez.
Aussi ne vous parlerai-je que très sommairement de cet essai, auquel la mémoire prodigieuse de l’auteur, exercée par une longue et brillante carrière théâtrale, a dû involontairement nuire. Est-ce à dire que Jeanne d’Arc est une mosaïque de morceaux empruntés à cent maîtres divers ? Nullement. Mais sans qu’il y ait plagiat ou imitation, l’œuvre n’a pas ce cachet d’individualité qu’on exige des maîtres compositeurs. C’est la partition d’un musicien qui s’est inspiré, malgré lui, de toutes les beautés qu’autrefois il contribua tant à faire valoir, et dont il peut dire : Quorum magna pars fui (où j’ai pris une grande part
, dans l’Énéïde de Virgile) ; des beautés mêmes qu’il explique, aujourd’hui encore, à ses nombreux élèves.
Quelques mélodies heureuses et de tout point originales, nous reposent, çà et là, des fatigues d’une déclamation souvent emphatique, et se détachent comme des strophes ailées au milieu de pages compactes de ronflants alexandrins. Ces mélodies, charmantes d’elles-mêmes, ressortiraient davantage si le musicien ne s’était pas appliqué à en tourmenter le développement ou à les étouffer sous une orchestration qui abuse de la sonorité. On dirait qu’il a craint qu’on ne constatât en lui la vraie inspiration, plutôt que la froide science. Amour-propre, voilà bien de tes coups !
J’ai noté cependant de fort belles phrases dans l’extase de Jeanne, au prologue ; un gracieux chœur champêtre ; un duo de ténor et baryton fort bien agencé (je l’ai déjà signalé, lors de la malencontreuse première représentation) ; le chant de guerre de Dunois, accompagné par les chœurs : Dunois à la rescousse ! un air de ténor (celui de Charles VII) ; un autre duo fort bien écrit, pour soprano et ténor, au quatrième acte, et le retour heureux du passage de l’extase à la scène finale de Jeanne au cinquième acte. Je crois que c’est tout !
Le poème n’est qu’une succession de tableaux plus ou moins cousus entre eus — je devrais dire décousus. On eût pu l’intituler : Scènes de la vie de Jeanne d’Arc. — Les auteurs ne s’y sont pas ruinés en frais d’imagination. Méry, lui-même, le poète fécond, dont la plume diamantée sait colorer et pailleter si brillamment les vers, en a laissé se glisser quelques-uns dans ce genre :
Jeanne
Je n’aurai paru sur la terre
Qu’un seul matin… et puis je meurs !
Les amourettes de l’écuyer Lionel et de Jeanne d’Arc, qui dans la prison oublie un innocemment sa sublime mission pour faire des aveux de première communion au moine :
Venez-vous de mon cœur arracher les secrets ?…
Cet homme est Lionel, mon père… et je l’aimais.
ces amourettes, dis-je, me satisfont très médiocrement. — Je me souviens d’une conversation que j’eus avec Rossini à la villa Barbaïa, à Pausilippe. Je me plaignais — comme tout le monde, alors — du silence de l’auteur de Guillaume Tell. Le maestro s’efforçait de rejeter sa paresse sur les poètes : les sujets qu’on lui avait présentés ne lui souriaient que tout juste.— Il en en est un cependant, ajouta-t-il, qui pourrait me faire reprendre la plume. C’est Jeanne d’Arc. J’ai lu une demi-douzaine de livrets sur ce thème ; tous me montrent l’héroïne de Domrémy, la martyre d’Orléans, comme une amoureuse de mélodrame. C’est absurde.
Il avait raison. Ce sujet, d’ailleurs, a été plus d’une fois traité, mais toujours avec un succès douteux. On dirait qu’il écrase celui qui ose le soulever. En 1790, Kreutzer fit jouer une Jeanne d’Arc à la salle Favart ; en 1821, Carafa donna la sienne au théâtre Feydeau ; Verdi lui-même n’est pas très content de la sienne, bien qu’elle ait été applaudie sur plusieurs scènes d’Italie. Duprez en a voulu faire une quatrième, et nous attendons la cinquième de M. Mermet !
La troupe du Grand-Théâtre-Parisien est riche de bonnes intentions et de belles voix. Sans compter la charmante Mlle Brunetti, qui pourrait dire comme sa Jeanne d’Arc : Je n’aurai paru sur la scène qu’une fois, etc.
, on peut mentionner le ténor Ulysse du Wast, qui a encore beaucoup à travailler pour assouplir son bel organe, le baryton Gaspard, l’autre ténor. Gaston Aubert, qui ne doit pas se fier aux applaudissements prodigués à son ut dièse, ou en profiter pour ne plus étudier, etc., etc., car les rôles secondaires sont nombreux dans l’ouvrage de Duprez. Il lui eût fallu le personnel de l’Académie impériale de musique. Et qui sait ! Si je l’avais eu, doit se dire le musicien, mon opéra eût obtenu un plus grand succès. — C’est possible… au point de vue de l’exécution. Mais il serait ingrat de ne pas tenir compte du zèle et du bon vouloir des jeunes artistes du Grand-Théâtre.
Ce n’est pas cependant ainsi que nous comprenons l’opéra populaire. Eh quoi ! l’on veut répandre dans les classes les moins favorisées le goût de la grande musique, — ce qui est une excellente idée, — et on commence par des essais plus que douteux ! Est-ce un théâtre d’opéra populaire qu’on a l’intention de créer ou une salle d’expérimentation ? J’avoue que j’aurais peu de sympathie pour cette dernière. Les essais in anima vili, d’ailleurs, ne sont pas de notre époque, et notre peuple ne s’en accommoderait guère. Il a le goût-inné de l’art, et nous l’a prouvé en maintes occasion. Pour une fois, soit ; mais que l’on ne s’avise pas de continuer. Si tous les musiciens qui ont des opéras en portefeuille, et qui désespèrent d’arriver à l’une de nos grandes scènes lyriques, prennent le chemin de la rue de Lyon, le peuple désertera cette salle et se consolera, en allant, le dimanche, entendre de l’excellente musique aux concerts de M. Pasdeloup. Voilà de vrais concerts populaires, et qui méritent ce nom, comme ils méritent la vogue dont ils jouissent.
Si des compositeurs favorablement connus, plutôt que des débutants, quels que soient leur âge et leur renoms ne peuvent écrire pour le théâtre d’opéra populaire, qu’on accorde à cette scène l’autorisation de jouer les chefs-d’œuvre du répertoire de l’Académie impériale de Musique ; qu’on y laisse exécuter Guillaume Tell, Robert le Diable, la Muette de Portici, la Favorite, la Juive, le Trouvère, etc. ; qu’on offre au public les œuvres impérissables de Rossini, de Meyerbeer, d’Auber, de Donizetti, d’Halévy, de Verdi. Et qu’on n’ait aucune crainte ; l’Académie impériale de Musique n’en souffrira point ; le public d’élite du théâtre de la rue Le Peletier n’ira pas faire le voyage de la rue de Lyon. Le danger d’une concurrence nuisible est par trop imaginaire. Au surplus, l’Opéra est assez riche pour ne pas y regarder de si près, en faveur du but surtout ! Le Théâtre-Parisien n’est et ne sera jamais que ce que son nom indique : une salle ouverte au populaire. Encore faut-il qu’il justifie sa nouvelle dénomination de Grand-Opéra. Ce n’est certes pas de la façon dont il a débuté qu’il pourra la justifier. Quant à l’exécution, c’est autre chose.
Une scène ouverte dans ces conditions et visant à propager le grand opéra, ne saurait, avec ses simples ressources, payer une troupe de premier ordre. De jeunes artistes pourraient s’y essayer, souvent avec profit ; et c’est là que les grandes scènes iraient parfois chercher le ténor, le soprano, le baryton, pour tel ou tel rôle des Huguenots, de la Juive ou de Guillaume Tell. Le peuple passerait volontiers sur l’inexpérience de jeunes gens douée de belles voix, quand il pourrait entendre la musique des maîtres. Mais lui donner des débutants qui interprètent l’œuvre d’un débutant, s’est faire trop bon marché de ses oreilles.
Quelle plus utile et plus noble institution que celle d’un Grand-Opéra populaire ! Encore faudrait-il qu’elle fût une vérité. Tel qu’il est, cet Opéra n’a pas sa raison d’être ; et il y a fort à parier qu’il ne se soutiendra pas. On se plaint que le goût se gâte par d’ignobles et vulgaires chansons d’estaminet ; ne serait-ce pas une excellente chose que d’en détourner le peuple, en le mettant à même d’entendre à très bon compte la véritable musique ? Et il ne sera pas lent à préférer les pages des Huguenots ou de Guillaume Tell à la chanson du Sapeur ou de la Femme à barbe, soyez-en certains ! Les orphéons et les concerts populaires au Cirque ont prouvé son goût pour la bonne musique ; il ne lui manque plus que le grand opéra ; ou aurait tort de le lui refuser.
Le Temps 31 octobre 1865
Extrait de la Critique musicale de Johannès Weber (1818-1902), en feuilleton.
Lien : Retronews
Grand-Théâtre-Parisien : Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes avec prologue, paroles de MM. Méry et Édouard Duprez, musique de M. G. Duprez.
Pourquoi me fatiguer inutilement à chercher des atténuations ? Honneur au courage malheureux ! C’est le jugement le plus indulgent que je puisse porter sur Jeanne d’Arc. Les auteurs ne manqueront pas de m’accuser pour le moins de présomption ; ils doivent être convaincus que je me trompe du tout au tout, et que leur ouvrage aura une longue série de brillantes représentations. Qu’ils aient raison, je ne demande pas mieux ; ce n’est pas là ce dont j’ai à me préoccuper, quoique je ne croie pas à une bien-grande différence de goût chez le public des différents théâtres de musique. On s’extasie au Grand-Théâtre-Parisien devant des minauderies, des cris et de grands éclats de voix ; mais on ne fait pas autrement à l’Opéra, au Théâtre-Italien et ailleurs. Et puis, la tour Saint-Jacques n’est pas assez loin de la colonne de Juillet, pour que les habitants du faubourg Saint-Antoine aient dû tristement se priver des délices musicales auxquelles les conviait le Théâtre-Lyrique.
Ce n’est pas le moment d’examiner jusqu’à quel point il est vrai que l’artiste ne crée pas en réalité, et qu’il ne fait que combiner des éléments fournis par l’expérience. En tout cas, il y a des sujets qu’il ne réussit jamais à traiter d’une manière parfaitement satisfaisante, parce que rien dans le monde réel ne peut lui en donner une idée exacte, ou lui en offrir un modèle. Il existe une quantité incalculable d’images du Christ, et vous en avez certainement vu un bon nombre : en est-il une seule qui rende bien l’idée que nous nous faisons de l’Homme-Dieu ? Il en est absolument de même pour Jeanne d’Arc qui, elle aussi, s’intitulait : fille de Dieu. Aucune femme aujourd’hui ne peut donner au peintre ou au sculpteur une idée de ce que fut cette intelligence exceptionnelle, cette sainte et sublime visionnaire. C’est là un tort irréparable qu’a fait au beau sexe l’invention infernale de la poudre à canon.
Le poète dramatique peut trouver dans les documents historiques des ressources moins insuffisantes ; mais la difficulté fondamentale reparaît lorsqu’il s’agit de choisir une actrice pour interpréter le rôle de l’illustre héroïne. L’Opéra a pu rencontrer un Roland et même un Hercule qui n’avaient rien d’invraisemblable ; où prendrait-il une Jeanne d’Arc ? Outre les difficultés d’exécution, le musicien se heurte contre celles qui résultent des limites prescrites à son art. Sans doute, il ne saurait être question au théâtre d’observer scrupuleusement la vérité historique ; plusieurs raisons s’y opposent. Mais, dans un opéra, que fera-t-on de la Pucelle ! Une héroïne animée du plus noble enthousiasme, du plus ardent patriotisme, voire même un foudre de guerre, qu’en réalité elle n’était point ? Ce ne serait pas dépasser les conditions de l’art, mais ce serait très difficile,et cela exigerait un homme d’un très grand talent pour le poème, et un génie de premier ordre pour la musique.
Le moyen le plus commode de trancher la difficulté, c’est le grand ressort de l’opéra ordinaire, et en général des pièces de de théâtre : l’amour. Je n’ose en blâmer absolument l’emploi, puisque Schiller lui-même ne l’a point dédaigné ; mais dans sa tragédie, l’amour n’est pour Jeanne d’Arc qu’une surprise de la sensibilité féminine, un mouvement passager de faiblesse, qu’elle ne tarde pas à surmonter, et qu’elle paie d’ailleurs chèrement. MM. Méry et Édouard Duprez se sont montrés moins scrupuleux. Dès qu’on voit Jeanne, au premier acte, écouter avec complaisance et émotion les tendres aveux de ce Lionel, qui n’a de commun avec le Lionel de Schiller que le nom, elle est discréditée, et rien dans la suite ne sert à la relever à nos yeux, bien au contraire. Dans la prison, l’objet de ses rêves, et la première chose dont elle parle à son réveil, c’est sa mère, et la misérable brute ; le lâche assassin, le traître infâme, que MM. Méry et Édouard Duprez ont jugé digne de son inaltérable amour. Il suffit de lire les paroles du troisième acte, lequel ne dure guère qu’un quart d’heure, pour voir avec quelle irréflexion ils ont écrasé de non-sens cet impardonnable et impossible personnage, qui débute dignement par montrer sa passion stupide et féroce, en disant à Jeanne : Je t’aime, et je veux que tu m’aimes, ou sinon, tremble de me connaître.
Jeanne et son bien-aimé sont les deux rôles principaux. Le roi Charles VII ne chante qu’au second acte ; au troisième, il ne fait que passer sur la scène en comparse, pour entrer à la cathédrale de Reims. Jean de Luxembourg a beau prendre des allures mystérieuses, imitées, de Bertram, il n’est qu’odieux quand il n’est pas ridicule. Outre son duo avec Lionel, il n’a de morceau important à chanter qu’un air, au quatrième acte. La situation de cet air fait un double emploi choquant. Monseigneur parle de se venger de Jeanne, qui jadis a dédaigné ses hommages, tout comme dans l’acte précédent Lionel s’est ravisé quatre fois pour jurer deux fois de se venger de Jeanne pour le même honorable motif. En voilà assez sur la pièce ; je ferai seulement remarquer encore qu’on y rit beaucoup. Au premier acte, c’est Lionel, au second acte, ce sont les chevaliers de la cour de France ; ils rient tant et tant, que le pauvre roi a bien raison de ne pas trop se lier à leur bravoure. Au quatrième acte, l’une des sentinelles rit du sérieux avec lequel l’autre maintient sa consigne ; au dernier acte, la populace rit aux éclats, et fait de grossières plaisanteries devant le bûcher, comme on dit que c’est son habitude à toutes les exécutions capitales. Les amateurs de réalisme doivent être satisfaits.
On pourrait alléguer les défauts du texte comme excuse pour le compositeur ; c’est cependant un expédient dont il ne convient pas d’user pour le montent. Parfois il m’arrive de m’en prendre avant tout au musicien, s’il choisit une pièce mauvaise ; mais je saurais montrer pour M. G. Duprez la même sévérité que, par exemple, envers MM. Félicien David et Gounod. Toujours est-il que M. G. Duprez s’est volontairement privé du bénéfice des circonstances atténuantes. Ignorait-il donc qu’il est imprudent et dangereux, pour l’auteur d’un opéra, de commencer par parler de principes et de système ? En proclamant qu’il a sur la composition dramatique des idées à lui propres
, ne s’est-il pas exposé à être anathématisé comme réformateur, comme révolutionnaire, horribile dictu ! comme musicien de l’avenir ? Mais non, il n’a rien à redouter.
Il cherche certainement l’expression dramatique, mais il emploie des moyens on ne peut plus insuffisants pour y atteindre. S’il ne réussit pas à bien placer les vocalises, il ne les prodigue pourtant pas trop. Dans ses mélodies, il montre une prédilection marquée pour ce qu’il y a de plus faible, de plus banal, de plus usé dans la musique italienne moderne. Autant vaudrait vouloir peindre un lever ou un coucher de soleil avec de l’eau de Seine prise à Bercy, ou à l’île Saint-Ouen, selon votre bon plaisir. Les récitatifs sont ternes, la déclamation et la division des phrases sont souvent faites à contre-sens ; l’harmonie manque de relief, les morceaux d’ensemble ne produisent guère qu’un effet de sonorité ; l’instrumentation est une énigme. Ce jugement sommaire est dur, je l’avoue ; c’est la faute de ma maladresse. Mais que M. G. Duprez se rassure : être un grand chanteur et un grand compositeur sont deux gloires si merveilleuses, si rares, aujourd’hui surtout, qu’une seule doit suffire à l’ambition d’un homme. Avoir une voix de compositeur, est une locution presque devenue proverbiale pour dire : en avoir une mauvaise.
Les compositeurs en prennent fort bien leur parti, et se contentent de composer : pourquoi les chanteurs se montreraient-ils plus ingrats envers la nature ? Je jure que si j’avais le bonheur de gagner par an soixante, quatre-vingt ou cent mille francs en chantant Robert-le-Diable ou les Huguenots, je n’éprouverais pas le moindre chagrin d’être incapable de les avoir composés.
Mais, me dira-t-on, maussade et mal content personnage que vous êtes, vous ne trouvez donc rien de bon dans cet opéra ?
Si fait : le premier acte débute par un chœur assez agréable ; peut-être y a-t-il d’autres exceptions que, stupéfié et fatigué de vulgarités, j’ai laissées passer inaperçues. Un morceau a même été redemandé : c’est la chanson de guerre de Dunois, dont la fin est d’un bon effet vocal, renforcé de bras et de jambes. Cela ressemble plutôt à un boléro qu’à un chant guerrier.
Que M. G. Duprez ne me reproche pas de ne voir en lui que le chanteur et le compositeur, et d’oublier le fondateur de l’opéra populaire, puisque opéra populaire il y a. Je ne trouve jusqu’à présent au Grand-Théâtre-Parisien que l’opéra de M. Duprez ; il a usé de son droit en commençant par lui-même, selon les règles d’une charité bien ordonnée, mais nous attendons la suite. Jeanne d’Arc n’est d’ailleurs pas le premier ouvrage de musique qu’on ait donné sur cette scène. L’été dernier j’ai vu plusieurs fois sur les affiches du Grand-Théâtre-Parisien, en même temps que sur celles du Théâtre-Saint-Germain, le Barbier, de Rossini. Il faut croire que c’était une tentative de nulle importance.
Rappelons que le théâtre de Schikaneder aussi était un théâtre populaire, et ce n’était pas, en ce temps-là, le seul à Vienne. La Flûte enchantée, selon l’intention des auteurs eux-mêmes, était un opéra populaire ; elle l’est encore aujourd’hui, et j’espère, pour l’honneur de l’Allemagne, qu’elle le sera toujours. Puisse le Grand-Théâtre-Parisien trouver bientôt sa Flûte enchantée ! Je dois dire quelques mots des exécutants. Mlle Brunetti fait de louables efforts pour soutenir un rôle qui, s’il était bon, serait au dessus de ses forces, et qui l’est deux fois davantage, étant mauvais. M. Du Wast (Lionel) a une voix assez mince, mais d’un bon timbre ; il chante avec chaleur, c’est une qualité, en attendant les autres. M. Gaspard (Jean de Luxembourg) possède une voix de baryton forte et vibrante, mais inculte ; de bonnes leçons de vocalisation et de style ne lui seront pas inutiles. M. Gaston Aubert (Charles VII) donne des si et des ut dièses de poitrine à confondre Tamberlick ; mais il fera d’autant mieux de n’en pas abuser, que la partie grave de sa voix est faible. Et puis, on ne chante pas sur des ut dièses de poitrine, lors même qu’on sait chanter. En multipliant dans Jeanne d’Arc les épisodes et les personnages accessoires, les auteurs n’ont pas fait réflexion que les uns et les autres risquaient d’égayer mal à propos le public, et c’est ce qui est arrivé. À part l’excès de zèle et le manque de goût, les chœurs méritent une mention honorable. J’ai remarqué aussi dans l’orchestre d’excellents artistes qui m’étaient déjà connus. Il serait souverainement injuste d’oublier les deux chevaux qui sont venus piétiner sur les planches, d’abord pour emporter Jeanne et son écuyer, et plus tard pour conduire l’héroïne et son roi à la cathédrale de Reims. Ils ont rempli leurs rôles avec un talent digne du théâtre impérial de l’Opéra ; ils se sont comportés en gens pleins de tact et sûrs de leur art ; ils n’ont ni crié ni chanté faux, ni fait aucun geste inutile ou malséant. On ne les a pas applaudis ; mais le témoignage de leur conscience leur a certainement suffi. Jamais ils ne songeront à pactiser avec la claque ni à éprouver les hésitations de M. Monjauze. Combien ils doivent mépriser les misérables yahous qui claquent ! Ô fortuné pays des vertueux Houyhnhnms ! Pourquoi ce maladroit Gulliver ne nous a-t-il pas enseigné la route qui pourrait nous y conduire.
L’Opinion nationale 31 octobre 1865
Compte-rendu critique de Alexis Azevedo, dans le feuilleton du 31 octobre 1865.
Lien : Retronews
Musique. — Grand-Théâtre-Parisien : Première représentation de Jeanne d’Arc, grand opéra en cinq actes avec prologue, livret de MM. Méry et Édouard Duprez, musique de M. Gilbert Duprez.
La première représentation de Jeanne d’Arc a eu lieu au Grand-Théâtre-Parisien, mardi 24 octobre.
On peut dire, sans exagérer les choses, qu’à dater de ce jour, le grand opéra populaire a été fondé chez nous, car il y a trouvé enfin un domicile et des organes : une troupe de chanteurs qui fonctionne parfois très bien et toujours très convenablement, des chœurs et un orchestre déjà suffisants, et que l’habitude et l’expérience amélioreront et mettront au point, il n’en faut pas douter.
Ceux qui, en évoquant de vieux souvenirs, peuvent se rappeler ce que fut la soirée d’inauguration du Théâtre-Lyrique, où depuis on a vu de si bonnes représentations de quelques ouvrages, conviendront avec nous, nous en avons la certitude, que l’ensemble de l’exécution musicale à cette soirée, n’approchait pas, il s’en faut de beaucoup, de celui qui a été soumis au public, mardi dernier, au Grand-Théâtre-Parisien.
On est donc en droit d’espérer que :
Petit poisson deviendra grand
Pourvu que Dieu lui prête vie,
et que Dieu prêtera vie à cette institution si nécessaire, en vertu de la vaillante maxime : Aide-toi, le ciel t’aidera !
Comme la Jeanne d’Arc de l’histoire a fait sacrer Charles VII, celle de la fiction théâtrale a fait sacrer le grand opéra populaire, non pas à Reims, cela n’eût pas beaucoup avancé les affaires de l’art lyrique, mais à Paris, où se trouve la sainte ampoule qui mue la consécration aux entreprises artistiques.
Jeanne d’Arc ! ce nom, nous ne pouvons l’écrire sans une vive émotion, sans un sentiment de profond respect et d’inaltérable reconnaissance. Nous croyons, et nous en faisons l’aveu naïf, au risque d’être taxé de chauvinisme, qu’un Français ne devrait jamais le prononcer sans ôter son chapeau en signe de vénération et de gratitude, car elle fut la mère de la France, l’humble, la vaillance, la dévouée jeune fille qui sut si bien l’immortaliser.
Ce qu’elle fit est admirable. On ne le dira jamais trop.
Par les inspirations de son génie, qu’elle appelait ses voix, par son courage indomptable, son entier dévouement à sa sainte fission, son infatigable activité et son prodigieux coup d’œil politique et militaire, elle posa les bases de la nationalité française au milieu de l’anarchie féodale et de la conquête de la meilleure partie de notre territoire par les Anglais. Elle eut, la première, l’intuition de la manière de combattre qui devait donner le plus d’avantages à nos soldats : l’extrême mobilité des masses et la grande impétuosité imprimée à leurs mouvements offensifs ; et elle en fit victorieusement l’essai, en battant les Anglais qui, jusqu’à sa venue, étaient habitués à nous battre à plate couture depuis prés de cent ans.
C’est que nous avions le tort d’attribuer toute la force des armées à la chevalerie. Les archers anglais, très adroits et très libres de leurs mouvements, embrochaient comme perdreaux, avec leurs herbes, nos nobles chevaliers couverts de géantes armures et montés sur des chevaux massifs.
De la bataille de Crécy (1346) jusqu’à la journée des Harengs (1429), on trouve toujours ce déplorable résultat dans l’histoire. Imaginant un beau jour que les succès des archers anglais provenaient uniquement de leur habitude de combattre à pied, nos chevaliers eurent l’idée ingénieuse de quitter leurs chevaux et de batailler en fantassins. Mais la masse énorme de ferraille dont ils étaient couverts rendait leurs mouvements trop lourds et trop lents pour que cette méthode leur fût bien profitable. Ils furent battus à pied comme à cheval.
Mais Jeanne vint et eut, répétons-le, l’intuition de la manière de combattre qui convient le mieux à notre nation : l’extrême mobilité des masses et l’ardente impétuosité des attaques. Sa tactique lui survécut et fut perfectionnée graduellement par tous nos grands capitaines : nous devons à cette tactique le meilleur de notre gloire militaire et, par conséquent, de notre importance politique. La jeune fille de Domrémy est l’aïeule incontestable de nos plus illustres chefs de guerre. Son audacieuse pointe sur Reims est, ce nous semble, pour qui la sait comprendre, la préface de la prodigieuse campagne de 1796 et de celle d’Austerlitz, où les grognards disaient : Anciennement, on nous faisait faire la guerre avec nos bras ; l’Empereur aujourd’hui nous la fait faire avec nos jambes.
Au point de vue politique, cette audacieuse pointe sur Reims, à travers les forces ennemies, est un fait digne des plus grands hommes. D’un coup de génie, la croyante, la dévouée Jeanne avait vu que la masse du peuple ne reconnaîtrait pour roi le fils d’Isabeau de Bavière, que s’il était sacré à Reims, selon les us et coutumes de l’antique monarchie ; et elle l’y fît sacrer malgré lui-même, pour ainsi dire, à la barbe des Anglais et de leurs bons amis les Bourguignons.
Ainsi basée sur des faits d’armes éclatants et sur croyances religieuses qui avaient alors une puissance irrésistible, l’unité nationale grandit de siècle en siècle, et devint, par les travaux de Louis XI, de Richelieu, le Louis XIV et de la Convention, ce qu’elle est aujourd’hui : un indestructible faisceau.
Jeanne d’Arc, qui commença cette grande œuvre, avait de qui tenir. Sa mère, Isabelle Romée, fut une forte femme, une sorte de matrone à la fois romaine et chrétienne. Elle encouragea Jeanne à remplir sa mission, et l’y aida en neutralisant la volonté contraire de son mari, Jacques d’Arc.
Lorsque vinrent pour l’héroïne, la gloire et les honneurs, Isabelle resta paisiblement filer son lin dans son humble maisonnette de Domrémy. On ne la vit ni au sacre ni à la cour.
Mais, après l’horrible mort de sa fille, elle ne se donna pas un seul instant de repos, elle n’eut ni paix ni trêve tant qu’elle n’eut pas obtenu la révision et la cassation légale de l’abominable sentence qui avait livré Jeanne aux flammes du bûcher de Rouen ; sentence ai abominable, en effet, que, pour la rendre, il avait fallu violer même les règles positives de la caressante procédure de la Sainte-Inquisition.
Ce qu’Isabelle Romée déploya d’activité, de ténacité, d’ardeur dans cette poursuite, on ne pourrait le dire. Le cœur des mères héroïques peut seul le deviner. Pendant vingt-cinq ans, elle y consacra tout son temps, toutes ses forces et le reste de son modique patrimoine. Dans les dernières années de sa vie, elle n’eut pour toutes ressources, qu’une pension mensuelle d’environ cent-soixante francs de notre monnaie, que lui fit la ville d’Orléans, plus reconnaissante envers la mémoire de sa libératrice que ce piètre personnage, que ce gentil dauphin, comme le nommait l’admirable Jeanne avant de le faire roi de France.
Mais de quoi vous avisez-vous ? va-t-on nous dire. Vous vous lancez en pleine histoire, à propos d’un opéra. Rentrez donc bien vite dans votre spécialité des doubles-croches et ne vous avisez plus d’en sortir.
Hélas nous ne le savons que trop : nous sommes sorti de notre humble spécialité. Mais comment résister à la tentation ? Nous venons de lire pour la troisième fois et avec un intérêt toujours plus vif, le livre de M. Villiaumé intitulé : Histoire de Jeanne d’Arc et réfutation des diverses erreurs publiées jusqu’à ce jour, livre où les faits et gestes, et les grandes vues de la libératrice de la France sont établis sur les preuve les plus authentiques, et dégage de la masse des documents positifs avec une grande puissance d’investigation et une rare sagacité d’historien. Nous avons le cœur et l’esprit pleins de Jeanne d’Arc.
Or, quand on a le cœur et l’esprit pleins d’un sujet, on profite de toutes les occasions pour s’épancher. Puis, il nous a semblé qu’on ne saurait trop dire et redire, ce qu’a fait pour notre indépendance, et, par conséquent, pour notre liberté, cette héroïque fille, dont la vie véritable n’est pas aussi généralement connue qu’elle devrait l’être, parce qu’elle a été obscurcie et défigurée comme à plaisir, d’un côté par les légendes des mystiques, de l’autre, par les déplorables et trop spirituelles plaisanteries d’un prodigieux écrivain qui, dès qu’il sentait la plus légère odeur de miracle et de superstition, ne savait et ne pouvait plus se contenir.
Enfin, il nous a paru opportun de dire notre humble mot à propos de l’histoire de Jeanne d’Arc, au moment où, sur l’initiative d’un cœur généreux et vraiment français, il se fait une sorte d’agitation pour empocher la destruction de la tour, dernier vestige du château de Rouen.
Cet dans cette tour, notre excellent collaborateur M. Alexandre Bonneau vous l’affirme, et vous pouvez l’en croire sur parole, car il possède à un haut degré l’amour de l’exactitude et la sagacité de l’investigation, c’est dans cette tour que furent montrés à l’héroïque victime des Anglais et de l’évêque Cauchon, leur abominable séide, les instruments de la torture. Il y a des Ursulines devenues, nous ne savons comment, propriétaire de la tour, et un paisible rentier qui ne voudraient pas être dérangés.
Tout cela est d’un grand intérêt, sans doute ; mais il faut, à tout prix, que cette tour historique et commémorative soit expropriée, non pour cause d’utilité publique, la formule serait par trop sèche et par trop industrielle en pareille circonstance, mais pour cause de reconnaissance nationale, et qu’elle soit restaurée et conservée comme témoignage durable de qu’il en coûte au génie et au dévouement pour faire le bien général, de l’horrible ingratitude qui est d’abord la récompense de ses bienfaits, et de la reconnaissance tardive qui les signale enfin à la mémoire des hommes.
Outre l’intérêt historique, il y a donc, dans la conservation de la tour de Jeanne d’Arc, un grand et pressant intérêt moral, qui ne saurait échapper à personne.
Ceci dit, et trop longuement dit, hélas ! mais nous n’avons pu mieux faire, venons à notre opéra, qui se compose d’un prologue et de cinq actes, ou, pour mieux parler, de cinq tableaux, car ces actes sont assez courts, ce qui, à nos yeux, n’est pas un défaut, croyez-le bien.
Au prologue, Jeanne entend les voix mystérieuses qui lui ordonnent d’aller délivrer la France du joug ses Anglais. Au premier acte, elle cueille, comme toute ses compagnes, une branche de l’arbre béni, pendant la fête champêtre de l’Aubépine. Chaque jeune fille donne sa branche à son fiancé. Jeanne seule garde la sienne. Un soldat de fortune, Lionel, voudrait bien l’obtenir, car il adore Jeanne. Mais celle-ci dit :
Je la destine à Dieu, mon seul époux.
Le traître de la pièce, Jean de Luxembourg, profite du mécontentement de Lionel pour le gagner à ses noirs projets en lui donnant de l’argent et en lui promettant sa protection. Un messager du sire de Baudricourt vient apporter à Jeanne un écrit par lequel on lui mande d’aller de suite auprès du roi. Elle part accompagnée de Lionel, dont ou a fait son écuyer, après avoir reçu la bénédiction de son père et les vœux de toute la population de Domrémy.
Au second acte, elle se présenta à la cour, où elle est accueillie par les rires moqueurs de tous les chefs de guerre. Elle prouve la réalité de sa mission en reconnaissant, dans la foule des courtisans, le gentil Dauphin qu’elle n’avait jamais vu, et qui lui avait tendu un piège en mettant à sa place, sur le trône, un La Trémouille quelconque.
Elle lui dit :
Gentil dauphin de France,
Dieu me mande vers toi,
Simple, sans éloquence,
Mais forte par la foi.
Oui, ma route est tracée,
Plus de honteux repos ;
De la France abaissée,
Relevons les drapeaux.
Les nobles paroles ne suffisent pas à tirer de sa torpeur le gentil Dauphin. Jeanne alors lui montre qu’elle connaît ses faiblesses amoureuses, et lui lance au visage ces vers pleins d’ironie et de reproches :
Sais-tu que l’on disait,
Avec des mots de blâme,
Que le roi languissait
Au genoux d’une femme.
[…]
Riant de sa faiblesse,
Un étranger vainqueur,
Le laissait, sans honneur
Régner sur sa maîtresse.
Ta couronne avilie,
Et ton peuple qui crie ;
Charles, tu n’es plus roi ?
Charles, alors, s’éveille de de sa torpeur. Ses capitaines, enfin convaincus de la sincérité de la mission de Jeanne, s’écrient avec lui :
Dieu le veut ! Dieu le veut ! Guerrier, prenons la lance,
Abandonnons de vains loisirs,
C’est pour l’honneur, c’est pour la France,
Soyons donc héros ou martyre.
Le troisième acte est formé d’une scène entre Lionel et le traître, et du défilé du cortège du couronnement. Au quatrième, Jeanne dort dans sa prison ; elle a juré à ses aimables juges de ne pas reprendre son épée et son armure. Le traître lui tend un piège : il envoie Lionel, déguisé en moine, dans la cellule du l’infortunée jeune fille. Trompée par l’habit du faux moine, elle se confesse à lui et lui avoue qu’elle aine Lionel.
Aussitôt celui-ci, ivre de joie et d’amour, se démasque ; il ne veut plus trahir mais sauver Jeanne. Il se précipite sur elle pour l’entraîner hors de la prison. Mais la noble jeune fille, indignée de la ruse du déguisement et de la confession extorquée, saisit son épée et le repousse avec énergie. Des témoins apostés par le traître, constatent le fait. Jeanne est relapse : elle sera brûlée vive ; elle l’est, en effet, au cinquième acte, conformément à la trop véridique histoire.
Cette pièce, on le voit, ne manque ni d’intérêt dramatique ni de situations musicales. Elle contient, on devait s’y attendre, des vers très bien frappés ; celui-ci, par exemple :
L’éternité vaut bien la douleur d’un moment.
Comparée au livret de l’Africaine, elle est, au triple point de vue du drame, du livret et du style, un merveilleux chef-d’œuvre. Cependant, comparaison à part, il manque une chose essentielle à cette pièce de Jeanne d’Arc.
De la présentation de l’héroïne à la cour à la cérémonie du sacre, l’action ne fait qu’un saut, laissant de côté le plus beau de la carrière militaires et politique de la noble fille. C’est aller un peu trop vite, à notre avis. Certes nous n’aurions voulu qu’on nous montrât ni le siège d’Orléans, ni la bataille de Patay, ni la marche audacieuse de l’armée française sur Reims. Ces faits, admirables dans l’histoire, ne sont pas matières à croches et à doubles croches. Mais on pouvait nous mettre sous les yeux les luttes de Jeanne avec Charles pour l’engager à se rendre à Reims. Il y avait dans ces luttes une situation très dramatique et très musicale, situation qui naît comme d’elle-même. En voilà le scénario tel que nous le concevons :
Jeanne, pour vaincre l’irrésolution de Chartes, lui fait entendre les plus nobles, les plus fières paroles. Agnès Sorel, qui sait que les absents ont tort, use de toute son influence de femme aimée pour empêcher l’irrésolu d’aller courir les hasards de la guerre, et surtout de s’éloigner d’elle. Lutte entre la vierge dévouée et l’égoïste maîtresse de Charles. Celui-ci, dont l’irrésolution augmente, se met en prière pour demander au ciel une inspiration.
Pendage cette prière, Jeanne fait honte à Agnès Sorel de ses lâches conseils, et l’amène à seconder ses projets ; la prière de Charles finie, les deux femmes, la vierge et la maîtresse, unies dans une même pensée, joignent leurs voix et leur éloquence pour entraîner le faible roi de Bourges aux résolutions viriles qui doivent le faire roi de France. Vaincu par ce concert de volontés, il se décide enfin, et part avec Jeanne, pendant qu’Agnès, d’un geste énergique, lui montre le chemin.
Il nous semble qu’une telle situation, qui d’ailleurs eût complété la pièce, était faite pour tenter le poète et pour inspirer le compositeur. Nous trompons-nous ?
La part de M. Gilbert Duprez est double ; il est le fondateur de l’institution du Grand-Opéra populaire et le compositeur de Jeanne d’Arc ; il faut donc le considérer et comme fondateur et comme compositeur.
Comme fondateur, il mérite non seulement les éloges, mais la vive gratitude de tous les amis de la liberté et de la diffusion de l’art de la musique théâtrale. En ce temps de merveilleuse pénurie de chanteurs, il a su trouver et réunir les éléments d’une troupe parfois très bonne, toujours convenable ; pour qui connaît le fond des choses, c’est là un véritable tour de force, qui demandait une énergie de volonté, une foi dans le résultat final et une intelligence artistique exceptionnelles.
M. Duprez a su trouver aussi des choristes et un orchestre qui marchent déjà d’une façon suffisante et marcheront mieux de jour en jour en prenant de l’expérience. Pour un commencement, c’est beaucoup, et, nous l’avouons naïvement, mieux que nous n’espérions, car nous connaissons les terribles, les épouvantables difficultés d’une semblable entreprise.
Pour rendre justice à tout le monde, il faut dire qu’on est redevable au directeur du Grand-Théâtre-Parisien, M. Massue, des décors et des costumes du nouvel opéra.
La partition de Jeanne d’Arc est écrite dans les conditions d’une extrême clarté, et avec une grande entente de la perspective théâtrale et des exigences scéniques. Les voix y sont bien employées, surtout dans les chœurs, qui sonnent très bien. L’orchestration a souvent de l’intérêt et de l’effet. Toute la partie de la prosodie et de la déclamation lyrique y est traitée d’une façon remarquable. On devait le prévoir.
On voudrait, en certains endroits de cette musique, une forme un peu plus arrêtée, et, en certains autres, une moins grande abondance de récitatifs et de mélopées. Il était cependant bien difficile d’éviter cette abondance excessive dans un sujet historique où, nécessairement, il y a beaucoup à conter et à expliquer. Or, le récitatif et la mélopée sont la langue musicale naturelle de la narration et des explications. On n’y pouvait guère échapper.
Mais M. Duprez, qui sait, de manière à l’enseigner à tout le monde, que c’est plutôt par des motifs bien établis que par des récitatifs et des mélopées, qu’on s’empare du cœur et de l’oreille des masses, doit regretter cette nécessité imposée par le sujet même de la pièce. Il a peut-être aussi trop sacrifié aux incidents et aux personnages épisodiques. Tout cela, d’ailleurs, n’empêche pas sa partition d’atteindre le but, et c’est là l’essentiel.
Signalons les parties les plus importantes de cette partition. Le motif du prologue : Elle m’a dit : Pour la patrie ! est d’une bonne déclamation. Le chœur des voix du ciel, chanté beaucoup trop fort, a un rythme qui nous paraît un peu terrestre ; au premier acte, le chœur des jeunes filles, pendant la fête de l’aubépin, est frais et gracieux.
Le dialogue du commencement du duo pour ténor et baryton est très bien fait, et l’ensemble, Dieu, t’a mise en mon âme, est très joli. L’allegro qui termine ce duo est chaleureux et franc : il est accompagné d’une façon très heureuse par un pizzicato.
On trouve, au début du duo entre Jeanne et Lionel, un passage très touchant sur ces mots : Jeanne, il faut m’écouter.
Les chœurs d’hommes du second acte sont presque tous remarquables. Les voix y sonnent admirablement et ils sont très bien disposés pour le rendu des situations. Le chant de guerre est franc et très bien accompagné. Il a été bissé le premier soir. Il y a de très bonne choses dans le solo de Jeanne : Sais-tu que l’on disait, et l’ensemble qui suit : Un pouvoir suprême est très sonore et très bien écrit pour les voix.
L’andante de l’air de Lionel, au troisième acte, est un peu vague ; la cabalette de cet air est, en revanche, bien rythmée et assez entraînante. L’acte de la prison est assurément le meilleur de l’ouvrage. Il débute par un dialogue entre deux sentinelles, traité avec une grande entente de la scène. L’air de baryton qui suit ne manque pas de mérite ; il a été très bien dit. Le duo entre Jeanne et Lionel débute par un joli effet d’orchestre ; le reste de ce duo a beaucoup de mouvement dramatique et une certaine force excessive.
M. Gaspard (Jean de Luxembourg) possède une bonne voix, un peu trop timbrée peut-être, ce qui d’ailleurs n’est pas un défaut dans un rôle de traître. Il prononce admirablement ; son chant et son jeu prouvent qu’il a les dispositions qu’il faut pour devenir un véritable artiste.
Nous nous trompons fort si M. Gaspard ne fait pas bientôt parler de lui d’une façon très avantageuse. M. Ulysse du Wast (Lionel), dont la voix de ténor est sympathique, dit très bien certaines parties de son rôle. Assurément, il y a dans ce jeune homme l’étoffe d’un artiste. M. Gaston Aubert (Charles VII) a l’ut dièse, le fameux, l’introuvable ut dièse. Mais le médium de sa voix laisse beaucoup à désirer.
Mlle Brunetti porte avec un grand zèle et un grand courage le poids du rôle considérable de Jeanne ; elle y a beaucoup de bons moments et, dans la scène de la prison, elle est véritablement émouvante.
L’accueil fait à Jeanne d’Arc le soir de la première représentation a été très sympathique, et aux meilleurs endroits, très chaleureux.
Voilà donc, grâce à une généreuse initiative, à de grands efforts et de grands sacrifices, le théâtre du Grand Opéra Populaire fondé. C’est aux compositeurs maintenant à lui fournir le répertoire qu’il lui faut pour asseoir son existence sur des bases inébranlables.
L’Avenir musical 1er novembre 1865
Chronique musicale d’Armand Gouzien.
Lien : Gallica
J’ai plusieurs dettes à payer à plus d’un théâtre, et je les payerai prochainement.
Je l’eusse fait dès aujourd’hui, si je n’avais pas cru devoir vous donner d’abord quelques détails sur la première tentative d’opéra populaire, au Grand-Théâtre-Parisien, faits par notre grand chanteur Duprez, tentative favorablement accueillie par le public habituel de ce théâtre.
Je vous parlerai donc aujourd’hui de la Jeanne d’Arc, poème de MM. Méry et Édouard Duprez, musique de Gilbert Duprez.
Quelle héroïque et radieuse figure que celle de cette paysanne qui, poussée par un irrésistible fanatisme, tint un moment dans les plis de son blanc étendard les destinées de la France et au bout de son innocente épée la vie de ses plus cruels ennemis !
L’histoire en a fait une héroïne devant laquelle notre patriotisme s’incline ébloui, la légende en a fait un type de pureté idéale, enveloppant d’une auréole de sainteté cette fille des champs que des Voix appellent au secours de la patrie en danger, et à qui le doigt de Dieu montre le chemin de la victoire.
La légende et l’histoire ont tenté plus d’un poète, le théâtre s’est emparé de cette étrange et sympathique figure, et les librettistes, pour qui rien n’est sacré, ont déjà cherché, dans la vie de la bergère de Domrémy, des situations musicales pour les compositeurs.
Le livret qui a servi au chanteur-compositeur est plutôt une suite de tableaux esquissés faiblement sur la vie et la mort de Jeanne d’Arc, qu’un véritable poème d’opéra.
L’intrigue y est plus qu’embryonnaire et l’analyse pourrait en être faite dans les termes pittoresques qu’emploient ces montreurs de vues de Venise et de Saint-Pierre de Rome, qui interrompent leurs descriptions par l’interjection connue : Tir’ la ficelle, ma femme !
Prologue : Jeanne, assise au pied de l’arbre des Fées, entend les Voix célestes.
1er acte : La fête des fleurs ; adieux et départ de Jeanne escortée du jeune et bouillant Lionel, qui tient une place médiocre dans son cœur, mais qui l’aime au point de se vendre à Jean de Luxembourg sans la moindre hésitation.
2e acte : Jeanne reconnaît le roi, caché parmi ses courtisans, à ses ut dièses vraiment caractéristiques.
3e acte : Cortège du sacre.
4e acte : Jeanne d’Arc, dans sa prison, reçoit la visite d’un moine sous le costume duquel se cache le trop persévérant Lionel, qui essaie d’ouvrir ce cœur rebelle à l’amour avec la clef des paradis perdus
.
5e acte : Jeanne est conduite au supplice sous les yeux de ses implacables bourreaux ; elle leur demande un crucifix, symbole de résignation et d’espérance, qu’on lui refuse. Mais Lionel a percé la foule (où les femmes sont en majorité), et se précipitant vers Jeanne, exauce ce désir suprême et reçoit le pardon de celle qui va mourir.
Il se tue, et Jeanne monte au bûcher dont la flamme l’environne bientôt.
Voilà la frêle charpente sur laquelle sont bâtis ces cinq actes. Quel ciment musical il eût fallu pour consolider cet édifice !
À peine si l’on peut s’imaginer qu’un de ces génies puissants, vivante incarnation du drame lyrique, fut parvenu à donner la vie à ce livret chétif ; cela suffit à conclure le parti qu’en a pu tirer un homme d’un talent réel, qui a beaucoup appris, dans sa vie de ténor, et beaucoup retenu, dans sa vie de compositeur, qui a commencé le jour de la première représentation de Jeanne d’Arc pour le public du Grand-Théâtre-Parisien.
Il y a dans l’introduction une jolie phrase de violoncelle accompagnée par les violons en sourdines que l’exécution un peu molle et trop maigre n’a pas fait assez ressortir.
Le rideau se lève sur le bois Chenu, où Jeanne d’Arc, assise au pied de l’arbre des Fées, croit entendre des Voix l’appeler et lui dicter sa sainte et glorieuse mission.
La légende de sainte Geneviève, intercalée dans cet air de début, commence heureusement et se termine d’une façon modernement compliquée, qui en fait disparaître toute la naïveté.
Il y a de jolis détails dans le chœur chanté dans la coulisse, et entrecoupé par le récitatif de Jeanne ; l’exécution trop hachée du chœur de la vision lui a enlevé tout caractère mystique ; la strette qui termine cette scène qui sert de prologue, un peu trop bruyamment orchestrée, ne manque pas d’enthousiasme.
Le chœur C’est la fête des fleurs, au premier acte, a une certaine fraîcheur, et la chanson Je suis un soldat de fortune débute bien ; l’allure en est franche et décidée.
Il n’y a, dans les deux duos qui suivent, que deux phrases d’un dessin mélodique nettement accusé et bien coloré par l’orchestre, ce sont dans le duo entre Lionel et Luxembourg, la phrase J’aime avec délire
, chantée par le ténor, et dans le duo entre Lionel et Jeanne, la phrase de ténor que soutient un accompagnement de cor.
Le chant de guerre du jeune et beau Dunois
a une certaine allure populaire et se termine par un ensemble brillant, dans les notes sonores des ténors, qui a enlevé le bis du public.
C’est à la suite de cette chanson avec chœur que le roi Charles VII, qui emploie ses nombreux loisirs à la culture de l’ut dièse, en donne deux échantillons qui ne laissent rien à désirer sous le rapport du volume et de la qualité ; le reste de l’air se perd à peu près dans les brumes du médium couvert du chanteur, dont un grasseyement entêté amollit encore la diction malhabile.
Il ne m’est rien resté de l’air de Lionel, au troisième acte, sinon l’impression d’une mélodie assez pénible et d’une orchestration sans solidité. Quant au chœur triomphal, il renferme, à côté de parties trop brutalement éclairées, quelques qualités de belle et puissante sonorité.
Le duo des deux sentinelles, au quatrième acte, est bien dialogué, et si une malencontreuse rentrée de piston n’y donnait tout à coup à l’orchestration la teinte commune que cet instrument porte presque toujours avec lui, ce duettino serait un des meilleurs morceaux de la partition.
On a applaudi l’air du réveil de Jeanne, dont le début est heureusement accompagné par les flûtes et les clarinettes se détachant du fond des violons con sordini, et l’on a rappelé mademoiselle Brunetti à la fin de cet acte.
Dans le dernier acte, qu’un air très-développé de Jeanne remplit tout entier avec le chœur du début, il y a quelques récits d’une réelle élévation et une strette toute empreinte d’un saint enthousiasme qui a décidé, malgré la fatigue très-apparente de la vaillante élève de Duprez, du succès de ce dernier acte, où le réalisme brutal du supplice de Jeanne d’Arc a été conservé rigoureusement.
L’exécution de l’œuvre nouvelle se ressent de la main expérimentée et habile qui l’a conduite. On sent dans les ensembles et dans les détails secondaires de la partition que le maître en l’art de chanter a passé par là.
Si le ténor aux ut dièses trouve un bon médium sur sa route, qu’il le prenne sans hésitation ; avec celui qu’il possède il aura bien de la peine à tenir le lourd emploi des forts ténors.
On ferait un fort acceptable ténor d’opéra-comique de M. Du Wast, qui a bien tenu le rôle de Lionel, et nous devons signaler une belle voix, nommée Gaspard, qui chantait Jean de Luxembourg.
Quant à mademoiselle Brunetti, elle a rendu le rôle de Jeanne avec beaucoup de style et de passion. La voix lui fait souvent défaut dans le médium, mais l’octave supérieure est d’une grande pureté et l’on sent enfin l’influence du maître dans sa manière magistrale de phraser.
L’orchestre est bien conduit par M. Maton, dont la réputation comme accompagnateur était faite depuis longtemps.
Duprez a été rappelé à la chute du rideau, et le public, qui avait envahi l’immense halle qu’on appelle Grand-Théâtre-Parisien, a consacré par ses applaudissements significatifs la fondation du grand opéra populaire par le plus populaire des chanteurs de Grand-Opéra.
La Semaine musicale 2 novembre 1865
Compte-rendu de Robert Nuay.
Grand-Théâtre-Parisien. — Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes et un prologue. Paroles de MM. Méry et Édouard Duprez, musique de M. Gilbert Duprez. — (Première représentation mercredi 25 octobre 1865.)
Un journal est une tribune où les opinions les plus opposées se rencontrent quelquefois. On ne sera donc pas étonné de me trouver en contradiction, sur plusieurs points, avec le compte-rendu de Jeanne d’Arc qu’a publié la Semaine Musicale le lendemain d’une répétition générale.
L’opéra de Jeanne d’Arc a cinq actes et un prologue. L’œuvre commence par une ouverture qui n’est pas un des moins bons morceaux de la partition et qui s’enchaîne par un motif des violoncelles et des contrebasses avec le prologue. Là, ni les auteurs du poème, ni le compositeur, n’ont compris qu’il y avait à chercher un effet de contraste qui eût produit une impression des plus favorables. Jeanne est assise au pied d’un chêne, et, sans préambule, quoiqu’elle ait à ses côtés la quenouille traditionnelle, elle entonne un air de bravoure au lieu d’un motif villageois qui rappellerait si bien son état d’humble fille des champs. Le maestro s’est contenté de quelques petits traits des hautbois et des flûtes, après lesquels se font entendre les voix du ciel. Hélas ! Les anges ont-ils jamais chanté ainsi ? Lè — ve toi fem — me
, sur un rythme saccadé ; et puis des vocalises à croire qu’on assiste à une leçon de chant du Conservatoire. Jeanne, exaltée par cette musique séraphique, reprend un second air de bravoure qui est fort bien à sa place, et qui produirait un bel effet si celui qui précède ne l’avait pas déjà écrasé.
Je ne veux entrer ici ni dans l’analyse de la pièce, qui est impossible, ni dans le détail de tous les morceaux qui composent cet opéra. Je citerai seulement au premier acte l’air de Lionel ; le chœur suivant, sur lequel on danserait volontiers si l’on avait un corps de ballet, et le duo entre Jean de Luxembourg et Lionel, qui est certainement la meilleure page de la partition, surtout à partir de l’Allegro. Jean dit une phrase largement menée, qui conduit très-adroitement au final. On doit bien penser que la direction n’a pas oublié d’introduire des chevaux sur la scène. Il y en a deux qui se comportent comme il faut.
Au deuxième acte, le chant de guerre de Dunois, chanté par La Hire, est réellement inspiré, et j’allais enfin croire que l’auteur avait trouvé un chant de guerre, comme celui de Charles VI, lorsque le chœur a entonné à pleine voix un petit air de danse qui a fort égayé la salle. Néanmoins, comme pour prouver à M. Duprez qu’il avait cette fois presque atteint le but, on a bissé ce chant qui a été recommencé malgré les réclamations de quelques récalcitrants pas assez oublieux du chœur de danse chanté sur les paroles : Allons ! à la rescousse !
L’air du roi Charles VII n’a rien de remarquable, sinon plusieurs ut de poitrine bien lancés par son interprète, M. Gaston Aubert.
Le troisième acte, le Sacre, qui a le mérite d’être fort court, contient une marche assez bonne, avec les deux chevaux qui continuent à bien remplir leur rôle, et Jeanne qui chante en selle.
Le quatrième acte se passe dans la prairie. J’y ai remarqué plusieurs passages dramatiques bien écrits, et le duo des gardes à la porte de la prison. Il est seulement fâcheux que le compositeur ait essayé de faire rire les violons ; cette sorte de musique imitative a fait fausse route, car ce sont les spectateurs qui se sont chargés de cette interprétation.
Le cinquième acte n’offre rien de saillant, si ce n’est la phrase du bourreau demandant pardon à la Pucelle, et les imprécations de Jeanne à l’adresse de ses juges et du traître Jean de Luxembourg.
Si la partition de Jeanne d’Arc ne contient aucune page qui frappe, il faut aussi avouer que le feu sacré n’a pas une seule fois animé son auteur. Au point de vue strictement musical même, elle est d’une pauvreté désespérante. Je ne parlerai pas des réminiscences. Meyerbeer ne s’en privait pas, mais il s’appropriait le bien des autres en homme de génie. Ici, pas une modulation, pas un dessin d’orchestre pour relever celles qui sont venues se placer sous la plume du compositeur. Il n’emploie guère que des modulations à la quinte et par la gamme chromatique. Je ne veux pas cependant oublier de citer l’accompagnement de la chanson de Dunois, fait par les trompettes et la grosse caisse piano, et les notes arpégées par la clarinette à l’entrée de Jeanne dans la prison.
Les interprètes de Jeanne d’Arc font honneur à leur maître. Personne n’ignore, en effet, que presque tous sont élèves de M. Duprez. On reconnaît bien là cette méthode sûre, ce goût exquis, cette prononciation parfaite, qui ont valu au professeur la première place. M. U. du Wast, comme acteur et chanteur, s’est révélé dans le rôle de Lionel. C’est un ténor comme on n’en voit plus, avec une voix sympathique et des notes bien égales. Je lui prédis un bel avenir. M. Gaston-Aubert, ainsi que je l’ai dit, possède l’ut de poitrine ; je l’en félicite. M. Braut, qui joue La Hire, est encore un bon ténor, sans toutefois valoir M. du Wast. Les basses ne leur vont pas à la cheville ; mais le baryton, M. Gaspard, qui remplit le rôle de Jean de Luxembourg, nous a fait faire connaissance avec une des plus belles voix que j’aie entendues. Mlle Marie Brunetti s’est acquittée de son rôle de Jeanne avec une grande intelligence de chanteuse et de tragédienne. On regrette cependant que l’émotion l’empêche parfois d’atteindre la note avec une parfaite justesse. Mlle Arnaud est une jolie personne qui représente Perrine en artiste distinguée. Sa voix est aussi agréable que sa personne.
Les costumes et la mise en scène sont très-soignés. Et maintenant, devons-nous, après le peu de succès de l’opéra de Jeanne d’Arc, désespérer de l’avenir de l’opéra populaire ? Non… Le public est de bon compte ; il a foi dans la réussite de cette entreprise ; il y poussera de toutes ses forces, et le jour où on lui présentera des pièces convenables, il envahira le Grand-Théâtre-Parisien.
Nous apprenons à l’instant que Mlle Brunetti quitte le rôle de Jeanne d’Arc et qu’elle est remplacée par Mlle Lustani, jeune débutante qui, dit-on, promet beaucoup.
Quelques mots sur la prosodie, par Louis Roger.
La Jeanne d’Arc, de M. G. Duprez, représentée sur le Grand-Théâtre-Parisien, vient de rendre manifeste l’absence d’une théorie certaine en ce qui regarde la prosodie française. M. Duprez, qui porte un nom illustre au théâtre, qui a été l’un des plus grands chanteurs de son temps et dont l’enseignement a exercé une si grande influence sur la scène française, M. Duprez a commis dans sa partition des fautes de prosodie dont l’énormité n’a échappé à personne. Plusieurs journaux ont pris plaisir à en relever quelques-unes. Il en est qui passent tout ce qu’on a vu jusqu’à ce jour. C’est à croire que la langue française en est encore aux tâtonnements du XIIe siècle et que nous n’avons connu ni Corneille, ni Racine, ni Fénelon, ni La Fontaine.
Le beau langage du XVIIe siècle n’est pourtant pas complètement perdu. Si nos précieuses et nos petits-maîtres sont fiers de dire dans les salons, dans les théâtres et dans les académies : j’éme, je séme, ma mére, ma pérte, ma péne, j’appéle, ma béle ; si l’héritier des Didot a substitué dans ses éditions l’é fermé à l’è ouvert éclatant et sonore, on trouve encore des traces du bien dire parmi les paysans de la Touraine et de l’Anjou. Là vous sentez vivre la diction élégante des grands seigneurs de la cour de Louis XIV. Les traditions d’une société choisie se sont conservées dans ces belles contrées, à l’ombre des châteaux d’où semble s’échapper, quand la nuit tombe, un murmure d’abeilles.
J’ai assisté plusieurs fois aux leçons de M. G. Duprez, rue Turgot. Dans les exemples qu’il donnait à ses élèves, j’ai noté en passant des fautes grossières, je ne dirai pas contre les règles de la prosodie, mais contre le plus simple usage. Ainsi, dans l’air du quatrième acte de la Juive (Rachel quand dit Seigneur
) il disait avec un admirable sang-froid : à mes tremblantes mains confi-a ton berceau
. Plus loin, il n’accordait qu’une seule syllabe au verbe rouer qui en a deux dans tous nos poètes et dans tous les dictionnaires à rimes, depuis Richelet jusqu’à Napoléon Landais. Je fus singulièrement surpris de trouver de pareilles négligences dans la bouche d’un homme dont personne plus que moi n’a admiré le talent.
Dans son opéra, M. Duprez s’est trompé bien des fois sans qu’on puisse invoquer en sa faveur les circonstances atténuantes. Que le chanteur, qui traduit fidèlement la partition, estropie en passant l’accentuation de la langue, il n’est coupable qu’à demi. Mais qu’un compositeur, dont l’œuvre écrite doit durer, qui a eu le temps d’élaborer son travail, envoie à la gravure une prosodie défectueuse, c’est beaucoup plus difficile à admettre.
Si donc un maître en l’art de dire le récitatif a pu broncher ainsi sur un terrain qui lui est familier, il faut croire que l’on n’est pas encore fixé dans les écoles de chant et de composition musicale sur les règles de la prosodie.
On doit savoir pourtant que l’énergie et la grâce d’une langue parlée tiennent en partie à son accentuation. Comment obtiendra-t-on sur la scène les qualités essentielles du drame, sans la diction et les accents ? Si la musique de théâtre était exclusivement vocale, comme on l’a vu en Italie, il n’y aurait pas d’inconvénient à sacrifier le génie de la langue à l’effet musical. Mais elle est dramatique en même temps, et à ce point de vue elle exige le secours de la langue, de la parole accentuée, scandée selon le génie de la nation.
Eh bien, il est donc surprenant que jusqu’alors on n’ait pas su fixer les règles de la prosodie. Nous devions attendre cette conquête du mouvement dramatique accompli depuis Gluck. Loin de là, les compositeurs et les chanteurs les plus renommés affichent dans leurs œuvres le plus grand mépris pour cette partie importante de l’art.
Nous croyons cependant qu’il ne serait pas impossible de constituer, d’après nos poètes, d’après nos grands comédiens et d’après l’usage, une théorie générale qui empêcherait les musiciens et les chanteurs de s’égarer.
Nous avons rassemblé nombre de matériaux et d’idées sur ce sujet. Peut-être un jour en formerons-nous un ouvrage.
En attendant, nous allons offrir à nos lecteurs quelques données qui ne seront peut-être pas sans utilité pour eux. Elles sont loin sans doute de suffire à tout et de lever toutes les difficultés qui se présenteront ; mais nous osons croire qu’elles ouvriront la voie à des remarques plus avancées.
Nous distribuons les mots de la langue française en trois grandes familles. Les uns ont un accent sur la dernière syllabe, les autres sur l’avant-dernière syllabe, les troisièmes sur l’antépénultième.
Les italiens ont des termes spéciaux pour exprimer ces trois effets. Un mot qui a l’accent sur la dernière syllabe est tronco, sur la pénultième piano et sur l’antépénultième sdrucciolo (qui glisse).
Dans la première famille (accent sur la dernière syllabe) nous ferons entrer tous les mots qui n’offrent pas une résonance à la fin ; dont la rime, comme on dit en versification, est masculine. En voici quelques-uns : arrêt, tourment, humain, chargé, matelot, audacieux, époux, confus, Calchas, ennuis, étonner, indiscret, ennemis, genoux, etc.
Dans la seconde famille (accent sur l’avant-dernière syllabe) nous classerons tous les mots qui offrent à l’oreille une résonance ou rime féminine. Exemple : fameuse, père, mère, nouvelle, charmante, fortune, épouse, apprendre, suivre, hyménée, immobile, éperdue, écoute, Ulysse, attache, etc.
Dans la troisième famille (accent sur l’antépénultième) nous placerons tous les mots de trois et de quatre syllabes qui ont un point d’arrêt sur la première ou sur la seconde syllabe et qui se précipitent sur la dernière au moyen d’une sorte de glissade (sdrucciolo). Exemple : renouvellement, providentiel, convenablement, discrètement, héroïquement, favorablement, gauchement, complètement, douloureusement, débarrasser, désintéresser, etc.
C’est avec intention que nous n’avons pas mentionné les mots qui se terminent par une consonne sonore, comme douleur, évanouir, amer, pâleur, avoir, etc. Si l’on voulait tenir compte de l’effet que produit à l’oreille, et non aux yeux, chacun de ces mots, on verrait qu’ils doivent être classés dans la seconde famille, celle dont l’accent est sur l’avant-dernière syllabe. Raisonnons. Dans douleur, l’accent est sur eur, eur est en effet la dernière syllabe. Oui pour l’œil, mais pour l’oreille non. La dernière syllabe c’est re, sous-entendu pour l’œil, mais réel pour l’oreille. Une consonne ne sonne pas toute seule ; le mot le dit assez. C’est si vrai que dans certains mots la consonne finale est absolument inutile à la prononciation. Voyez ce mot : partout ; supprimez le t, il reste encore pour l’oreille partou. Mais si l’on était convenu de faire entendre le t, on ne pourrait avoir ce résultat qu’au moyen d’une voyelle sous-entendue. En écrivant partout, on prononcerait en réalité partoute. Conséquemment tous les mots de cette espèce appartiennent bien à la seconde famille : avoir, douleur, avenir, ont l’accent sur la pénultième, qui est oi, eu, i, puisque la finale pour l’oreille, seul juge en pareil cas, est évidemment re.
Avec ce simple aperçu, on sera en garde contre bien des bévues. Le compositeur saura que le temps fort de la mesure ou la partie forte du temps ne pourra recevoir que la syllabe accentuée du mot. Il en sera de même pour les chanteurs qui ont pris l’habitude, excellente selon nous, de rectifier les erreurs du compositeur. Ainsi un mot étant donné : timide, par exemple, il vous est défendu de placer le temps fort, ou un trait mélodique, sur ti ou sur de. Pourquoi ? Parce que le mot appartient à la seconde famille qui a l’accent sur la pénultième : C’est sur mi que tout doit porter.
L’espace nous manque aujourd’hui pour continuer cette petite étude. Si elle offre quelque intérêt aux artistes chanteurs et compositeurs, nous la continuerons à la prochaine occasion.
Le Foyer 2 novembre 1865
Extrait de la chronique des Théâtres de Paris, d’Alphonse Baralle.
Lien : Gallica
Grand-Théâtre-Parisien. — Jeanne d’Arc. (Deuxième article.)
Nous pouvons aujourd’hui nous prononcer en toute connaissance de cause. Le nouvel opéra de Duprez n’a pas réussi ainsi que l’espéraient les nombreux amis de l’illustre ténor.
C’est à regret que nous enregistrons le résultat négatif de cette tentative dans le domaine de l’opéra populaire. Ce n’est pas, d’ailleurs, une raison, pour décourager les autres ; ce qu’il fallait avant tout, c’était d’abord un drame largement campé, et ensuite une partition saisissable dans les détails comme dans l’ensemble. Malheureusement, tout cela a manqué. Le poème est puéril, les situations mauvaises et quelquefois ridicules, la partie musicale est pour ainsi dire nulle, pas une romance réussie complètement, pas un grand air bien coupé, pas un chœur à effet.
Nous ne saurions trop le répéter, nous pensons que le peuple aime la musique, mais ce qu’il recherche avant tout, ce sont les émotions que peuvent lui procurer le théâtre ; or, dans un quartier qui ne contient guère que des ouvriers, il est inutile de chercher à acclimater, quant à présent, le grand opéra, fut-il cent fois plus réussi que Jeanne d’Arc. Le directeur de l’Opéra National l’avait bien compris lors de l’ouverture de ce théâtre au boulevard du Temple. Gastibelza n’était pas autre chose qu’un bon mélodrame, très-bien fait pour l’époque, et la musique de notre ami Aimé Maillard avait toutes les qualités requises pour produire un très-bon effet, même après une seule audition, ce qui prouve que la clarté est toujours la première qualité, surtout dans un théâtre populaire. Mais arrivons à Jeanne d’Arc.
Le prologue est une des choses les plus soporifiques que nous ayons eu le bonheur d’entendre. Jeanne, seule, assise au pied d’un chêne
, dit le livret, raconte ses extases et ses visions ; puis, après avoir chanté la légende de Geneviève de Paris, s’endort. (Est-ce la faute de la musique ?… Nous serions presque tenté de le croire). Alors le fond du théâtre s’ouvre et laisse voir des anges portant, qui, une bannière, qui, un glaive, qui, un rameau. Ils chantent un chœur assez pâle pour rappeler à Jeanne qu’elle doit sauver la France. La jeune fille s’éveille alors et chante un Credo, dont les vers brillent plus par l’intention que par la facture. Qu’on en juge :
Je crois !… Je crois !…
Le Seigneur se révèle !
Je vois !… Je vois !…
Il commande, il m’appelle :
Dieu bénit dans les cieux
Ma mission divine,
Et d’un bras glorieux
Anoblit l’héroïne.
Nous en passons, et des plus mauvais !…
Voilà donc Jeanne persuadée des grands desseins de la Providence, et l’on peut croire que dès-lors les scènes dramatiques vont commencer. Point… Les auteurs profitent de la situation pour nous faire assister à la fête de l’aubépine. Les jeunes filles de Domrémy vont se partager les rameaux de l’arbre béni pour les offrir ensuite à leur fiancé, quand un soldat d’aventure, un assez mauvais drôle, s’il faut en juger sur sa mine, vient réclamer en faveur de Jeanne absente. Il faut qu’on lui laisse aussi son rameau, qu’il espère bien qu’elle lui adjugera. Jeanne, bien entendu, a trop bon goût pour se jeter ainsi à la tête du premier soudard venu, et c’est à Dieu qu’elle offrira le précieux rameau.
Lionel, le soldat, va entrer chez Jeanne avec toute la famille, quand Jean de Luxembourg l’arrête, et refait avec lui le fameux duo de Robert le Diable : Ah ! l’honnête homme ! etc., etc.
Mais nous en sommes fâché pour M. Duprez, Meyerbeer conserve cette fois tout l’avantage. — Après ce joli marché ayant pour but de faire de Jeanne la maîtresse de Lionel, Jean de Luxembourg s’éloigne et fait place à Perrine, qui nous apprend que sa sœur… Mais nous ne pouvons résister au désir de citer quelques vers… ils en valent la peine :
Je vais la voir. — Beau sire, où courez-vous ?
La trouver. — Jeanne ! Ah ! plutôt comme nous
Fuyez-là. — Jeanne ! — Elle est folle ! ou tout comme.
Le croiriez-vous ? Elle s’habille en homme !
Elle veut partir pour la cour.
Mais le sire de Baudricourt
L’a chassée… Et vraiment sa démence est complète,
Vit-on jamais sage fillette
Sur un cheval monter comme un soudard ?…
J’en ai grand honte et pour ma part…
Mais il paraît que le sire de Baudricourt s’est ravisé, car deux minutes après un héraut vient amener deux chevaux, l’un pour Jeanne, l’autre pour Lionel, élevé tout à coup, et sans qu’on sache trop pourquoi, à la dignité d’écuyer.
Le tableau suivant nous transporte à Bourges. La Hire et La Trémouille se disputent et tirent l’épée ; mais le jeune et beau Dunois s’interpose, déclare l’honneur satisfait, et les épées rentrent au fourreau. Voilà une étrange déception pour nous, qui croyions nos pères de bien moins bonne composition ; mais comme cela amène tout naturellement le chant de guerre de Dunois, nous nous en consolerions si ce chant, bissé à l’unanimité le premier soir par messieurs du lustre, n’était d’un élan… à porter le diable en terre. Il est vrai qu’on y trouve des vers de cette force :
Quand il combat c’est pour la France,
Dans ses mains sa puissante lance ;
C’est le tonnerre !…
Mais voici le roi Charles VII ; lui aussi a eu des visions, et il annonce à ses guerriers qu’il va confier l’oriflamme à une femme
. La rime n’est pas riche, mais bast !… comme disait Léonce dans Orphée aux Enfers, la richesse ne fait pas le bonheur. On introduit Jeanne sur cette singulière réplique, qui, le premier jour, a soulevé un homérique éclat de rire :
Comment trouvez-vous la donzelle ?…
— Ma foi, pas trop mal !…
Jeanne marche droit au roi, caché parmi les chevaliers, lui reproche ses amours avec Agnès Sorel… Oh ! Shocking !… Et l’on part pour les combats en entonnant un chœur dans lequel il est question de lance, de héros, de martyrs et de beaucoup d’autres choses encore.
Les derniers actes sont consacrés au sacre, à la prison et au bûcher. Nous ne suivrons pas les auteurs dans ces nouvelles inspirations, aussi nulles que fastidieuses. Qu’il nous suffise de constater que cela est complètement insignifiant, et que l’intérêt fait complètement défaut à cette œuvre qui aurait pu être si dramatique.
Quant à la partition, qu’en dire ?… Rien de saillant, rien d’original, rien de trouvé ; quelques lambeaux de phrases, puis des réminiscences, pas un air complet, les chœurs sont assez habilement traités, mais ils manquent de cette ampleur, de cette puissance qui enthousiasment les masses. On sent, en écoulant tout cela, que M. Duprez sait écrire pour les voix et l’orchestre, mais l’inspiration lui manque. De là une teinte triste et monotone qui paralyse tout effet.
Décors et costumes méritent une mention spéciale. Tout est magnifique et fait vraiment regretter que le succès n’ait pu saluer cette tentative ; espérons que l’avenir paiera tout cela.
L’interprétation n’est pas de nature, du reste, à relever la pauvreté de l’opéra. Mlle Brunetti est loin d’avoir la force nécessaire pour jouer et chanter le rôle de Jeanne d’Arc, sa voix n’est pas toujours de la plus grande justesse ; quant à son jeu, il est complètement nul, son geste est étriqué, c’est une élève, ayant encore presque tout à apprendre, rien de plus, rien de moins. M. Gaston Aubert a deux ou trois belles notes pleines et puissantes, mais c’est tout ; son médium et le registre ordinaire sont mous et chevrotants ; s’il continue à chanter comme il l’a fait lors des premières représentations de Jeanne d’Arc, nous lui prédisons à regret que dans trois mois au plus il aura perdu ses meilleures qualités. M. Gaspard a besoin de travailler encore longtemps, et M. Gabriel n’est pas beaucoup plus fort. Seul, M. Ulysse du Wast a droit a de sincères éloges ; s’il n’a pas l’étoffe nécessaire pour pour faire un ténor de grand opéra, il a du moins tout ce qu’il faut pour devenir un charmant ténor d’opéra-comique ; il chante sagement et joue d’une façon fort agréable. Si le rôle de Lionel eût été meilleur et surtout plus sympathique, nul doute que M. du Wast n’ait obtenu un véritable succès.
Le Grand Journal 5 novembre 1865
Compte-rendu critique d’Albert Vizentini.
Lien : Retronews
La Jeanne d’Arc de Duprez
Que n’a-t-on pas dit sur cette pauvre Jeanne d’Arc et son malencontreux voyage à l’espèce de manège décoré pompeusement du titre de Grand Théâtre parisien. Tout le monde connaît les incroyables péripéties d’une demi-première audition, interrompue par les pâmoisons d’une prima donna trop sensible, et dans laquelle les apparitions nombreuses d’un régisseur enrhumé, vinrent remplacer désavantageusement les exploits fameux de l’illustre Pucelle d’Orléans.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus de rires et d’annonces, à la soirée bouffonne du douze octobre a succédé la triste représentation du vingt-quatre et nous avons entendu tout au long (hélas !) l’œuvre dont nous avons à rendre compte.
Tout d’abord, qu’on nous permette de proclamer hautement nos sympathies pour Duprez. C’est justement afin de ne pas être taxé de parti pris, au moment où nous examinerons la nouvelle partition, que nous désirons retracer brièvement la carrière du célèbre ténor.
Né à Paris, le 6 décembre 1806, Gilbert Duprez était élève de Choron, lorsqu’il s’essaya, en 1820, au Théâtre-Français dans l’Athalie de Racine ; il y chantait sa partie de soprano dans un trio de Fétis et l’on remarqua l’instinct musical et l’expression dont il faisait preuve. Profitant de la mue de sa voix pour travailler la composition, il fit jouer à Versailles un petit opéra intitulé la Cabane du Pêcheur, tombé sons des sifflets obstinés. Enfin, il débuta à l’Odéon, le 3 décembre 1823, dans l’Almaviva du Barbier de Séville. Sa voix alors faible, sa personne assez gauche, font vivement contester sa réussite. L’Odéon ferme en 1828 ; Duprez entre à l’Opéra-Comique, y joue entre autres rôles secondaires un assassin dans la Violette et quelques mois après il part pour l’Italie, où il débute, pendant le carnaval de 1829, au théâtre de San-Benedetto de Venise. Le mal du pays le ramène, en 1830, à l’Opéra-Cornique. Cette fois, il y chante la Dame blanche avec un certain succès ; mais sa voix ne répondait pas encore au feu sacré qui l’animait. Désirant essayer l’étude de la voix sombrée, voulant s’aguerrir à la scène, il repart de nouveau et ce n’est qu’à Turin, dans il Pirata, qu’un succès unanime vient le récompenser de ses courageux efforts. Dès lors, l’élan fut donné. Sûr de lui, de son organe, il révéla au public ébloui tous les trésors lentement acquis par le travail ; Rome, Naples, Florence, toutes les villes de la péninsule l’admirèrent et l’acclamèrent, et son rêve se réalisa.
Duprez revint à Paris et débuta à l’Opéra dans Guillaume Tell, le 17 mars 1837. On sait quels transports d’admiration accueillirent le successeur de Nourrit. L’élévation de son style, son charme indicible, son grand art de phraser, ses qualités profondes de vrai musicien, l’énergie des notes chaudes, enivrantes qui s’échappaient de son puissant organe, sa manière admirable de dire le récitatif, transportèrent le public.
Après avoir chanté successivement Robert, les Huguenots, la Juive, Duprez créa : Guido et Ginevra (Halévy, 5 mars 1838) ; Benvenuto Cellini (Berlioz, 3 septembre 1838) ; le Lac des Fées (Auber, 1er avril 1839) ; les Martyrs (Donizetti, 10 avril 1840) ; la Favorite (2 décembre 1840) ; la Reine de Chypre (Halévy, 22 décembre 1841) ; Charles VI (Halévy, 15 mars 1843) ; Dom Sébastien (Donizetti, 13 novembre 1843) ; Marie Stuart (Niedemayer, 6 décembre 1844) ; Lucie de Lammermoor (Donizetti, 20 février 1846) et Jérusalem (Verdi, 26 novembre 1847).
Tant de triomphes avaient altéré sa voix si aimée ; victime du lourd répertoire que ses épaules d’athlète avaient porté, le grand artiste comprit que sa volonté n’était plus secondée par la nature, et craignant de voir le public, cet enfant ingrat, briser l’idole qu’il adorait la veille, il se décida à abdiquer sa royauté. Sa représentation de retraite eut donc lieu le vendredi 14 décembre 1849, et fut composée du 4e acte de Lucie, 3e acte d’Othello, avec Mme Viardot, et 2e acte de la Juive, dans lequel il présentait son élève, Mlle Miolan.
Retiré du théâtre, Duprez pouvait, comme professeur, payer sa dette à l’art et nous donner des représentants de sa belle méthode. Cette fois encore, il réussit au delà de toute espérance. Faisant accepter sa démission au Conservatoire, où une classe du chant lui était confiée depuis 1842, il fonda, vers 1850, une école dans son hôtel de la rue Turgot, véritable sanctuaire de la musique vocale. C’est la que, secondé par d’habiles accompagnateurs, il forma d’excellent chanteurs applaudis sur nos scènes lyriques. On l’a souvent accusé de casser les voix ; nous répondrons victorieusement que les deux premières cantatrices françaises, Mmes Van-den-Heuvel-Duprez et Miolan-Carvalho sont en tête d’une liste d’élèves sur laquelle on remarque : Mmes Marie Battu, Marimon, Monrose, MM. Lefranc, Wicart, Agnesi, Léon Duprez, Ballanqué, du Wast, etc.
Environné de glorieux souvenirs, décoré de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, jouissant de la considération générale, qu’est-ce donc que M. Duprez peut encore désirer ? Hélas ! ainsi que Garcia, il est insatiable de bravos ; après avoir interprété magnifiquement les créations des autres, il a voulu se montrer créateur. N’est pas créateur qui veut.
Jeanne d’Arc, il nous est pénible de le dire, est une bataille perdue, perdue sans retour. Sans doute, nous devons remercier l’homme qui vient consacrer son temps, son argent, ses élèves a populariser l’opéra dans quartier éloigné, mais M. Duprez devait réfléchir que M. Pasdeloup n’aurait pas trouvé tant de sympathies pour ses concerts s’il ne les avait fondés que pour faire entendre sa propre musique. Nous n’avons pas ici d’égards à observer, comme s’il s’agissait d’un prix de Rome ou d’un jeune débutant ; la vérité se doit surtout aux riches ; or, Duprez est un des riches de l’art. Nous lui avons rendu justice comme chanteur et comme professeur ; jugeons-le maintenant comme compositeur, et disons-lui franchement que jamais partition ne fut plus molle, plus dépourvue de rythme, de couleur, que son infortunée Jeanne d’Arc, de soporifique mémoire.
Modulant souvent dans ses morceaux, M. Duprez ne module pas assez dans ses récits, qui sont d’une platitude extrême. Sa musique, comme style, flotte entre l’italien et le français moderne. Ses chœurs sont bien écrits pour les voix et d’une bonne sonorité ; quel dommage que le rythme en soit toujours si commun ! rien de large, rien de grand ; pas un éclair de puissance ; toujours le même moule, la même monotonie. Son orchestration est simple et correcte, mais elle manque de piquant sous le rapport des combinaisons et des timbres. Les deux premiers actes sont ce qu’il y a de mieux à partir du troisième, nous tombons en plein mauvais Mercadante. Ce qui nous étonne le plus, ce sont les défauts de prosodie contenus dans ce pénible assemblage de tableaux mal cousus. Voici, par exemple, le repos d’un vers du quatrième acte :
… Cet homme, objet de ta haine,
Ingrate, a — gémi de ton sort.
Vous en trouverez beaucoup comme cela. Ne sachant pas faire ce qu’on nomme une scène, M. Duprez se sert du style orné dans les moments les plus pathétiques ; ainsi, lorsque Jeanne vient offrir au roi de relever sa couronne chancelante, la voix du soprano s’unit à la clarinette pour vocaliser sur ces paroles : Gentil Dauphin de France, Dieu me mande vers toi.
Puis, ce sont des points d’orgue interminables ; et dès que l’utilité d’un allegro se fait sentir, en avant la grosse caisse, les cris, les notes impossibles que ces pauvres seigneurs sont obligés de hurler ! On ne peut s’imaginer tout ce qui se lance de la et de si dans le palais de Bourges, à commencer par le gentil Charles VII, dont la voix est aussi blonde que sa perruque. Ce monarque est représenté par un jeune homme doué d’un aplomb superbe et d’une voix faible dans le médium. Il a beaucoup à faire pour arriver, et ne doit pas trop compter sur son cri de vitrier (qu’on m’a dit être un ut dièse) pour faire passer un accent détestable.
Les andantes et morceaux moins… bruyants sont généralement bien faits, quoique manquant d’originalité. Essayons de citer ce qui nous a paru digne d’être remarqué. Dans l’introduction symphonique, une assez jolie phrase chantée par les violoncelles et au prologue la légende de Sainte-Geneviève, d’un bon sentiment. En revanche l’apparition des anges est totalement manquée. Rien de plus burlesque que ce chœur de jeunes filles vêtues de blanc, accompagné sur un rythme sautillant par un harmonium invisible ; on se croirait à la distribution des prix d’un pensionnat de demoiselles. Le Credo de Jeanne a de l’énergie et de l’enthousiasme, il est gâté par la péroraison hachée du chœur sur ces vers destinés à donner à nos descendants une belle idée de la poétique française :
… Dieu te protégera ;
Jeanne ! va ! va ! va ! va !
L’acte suivant est le meilleur de l’ouvrage. Débutant par un chœur : C’est la fête des fleurs, dont le motif a de la fraîcheur, il renferme une cavatine : Je suis un soldat de fortune d’une allure franche, un second chœur de jeunes filles assez gracieux, un grand duo pour ténor et baryton, calqué sur de nos célèbres duos et dont je louerai l’andantino en ut majeur : Dieu t’a mise en mon âme, jolie phrase bien écrite pour le ténor et le petit ensemble final, un deux quatre à la Meyerbeer, avec contrepoint du quatuor accompagnant pizzicato. Il y a encore une assez jolie idée dans le cantilène en sol de Lionel : Tu vas prier, ton Dieu t’écoute, où le cor solo suit la voix à la tierce et à la sixte. Le si et la demi-gamme descendante sur le vers : Je t’en payerai le prix en faisant ton bonheur, sont vraiment d’un bon effet.
Hélas ! à partir du tableau suivant, il faut abandonner l’éloge. Le chant de guerre de La Hire commence bien, le dessin d’orchestre promet, mais dès la 8e mesure, l’idée est hachée, tourmentée et le refrain ferait plutôt une polka-mazurka qu’une Marseillaise moyen âge. Quant au chœur : Dieu le veut, guerriers prenons la lance, c’est un deux-quatre trivial pouvant servir à la chaîne des dames. — L’acte du sacre se compose d’une cavatine de ténor dont le premier motif n’est pas mal et d’une marche triomphale offrant beaucoup de bruit pour rien. La brochure indique des chants religieux et l’orgue au lointain, nous n’avons entendu que le sifflet d’une locomotive du chemin de fer de Lyon. Le rappel de la légende et le réveil de Jeanne au tableau de la prison ont un semblant de poésie, mais je n’aime pas le grand duo dans lequel on chercherait en vain une lueur de passion.
Deux artistes se sont particulièrement distingués et ont révélé de bonnes et sérieuses qualités. L’un, M. Ulysse du Wast fera un charmant ténor d’opéra-comique ; sa vois est sympathique, et sa manière de chanter dénote un véritable talent. L’autre, M. Maton, est dès à présent un excellent chef d’orchestre, à qui l’honneur d’une bonne exécution revient en majeure partie. C’est la jolie Mlle Brunetti qui s’est chargée du rôle écrasant de Jeanne d’Arc, et nous l’avons retrouvée avec les mêmes qualités, les mêmes défauts qu’au Théâtre-Lyrique. Toujours de l’élégance, de la bonne volonté et un certain style ; mais une voix insuffisante et une absence totale de justesse. En femme, elle se promène légèrement au-dessus de la note ; revêtue du costume masculin, elle chante franchement un quart de ton trop haut. Il n’y a qu’a cheval qu’elle chante à peu près juste. (Ô mystères de l’équitation !) — La mise en scène et les décors témoignent de louables efforts ; les rôles secondaires et les masses, à part quelques petites défaillances, sont plus que convenables.
Allons, MM. Duprez et Massue, à l’œuvre, vous voilà de bons éléments ; profitez-en pour chercher le succès avec de la vraie musique. Mettez des chefs-d’œuvre justement appréciés à la portée des petites bourses qui composent votre auditoire ; faites de votre théâtre le temple musico-lyrique du faubourg Saint-Antoine ; en un mot, justifiez votre titre d’Opéra populaire, et vous aurez bien mérité de l’art ; et nous, qui ne faisons partie d’aucune société d’admiration mutuelle, nous serons les premiers à vous crier : Bravo !
Le Hanneton 5 novembre 1865
Extrait de l’article de Rigoletto.
Lien : Retronews
Enfin, on a joué Jeanne d’Arc au Grand-Théâtre-Parisien, et cette fois bout à l’autre — sans encombre et sans le moindre régisseur à la clef.
L’opéra-tion de Duprez a réussi. La partition contient de belles pages ; n’est pas un chef-d’œuvre, — oh ! non, — mais enfin cela fait plaisir à écouter.
La pièce est bien montée et pas mal chantée, surtout par Mlle Maria Brunetti, MM. Ulysse du Wast et Gaston Aubert.
Bravo, Jeanne d’Arc !
a hurlé un titi, j’arbore vos couleurs !
Il y a de l’éclat dans la cérémonie où Charles VII est sacré, — pour un sapeur.
La scène du bûcher a été très-chaude ; Mlle Brunetti brûlait… du désir de ne pas faire trouver Duprez salé : les bûches ne manquaient pas.
Seulement on ne voit pas Jeanne réduite en cendres.
En somme, nous espérons pour M. Massue que, — ne fût-ce que par curiosité — tout Paris ira voir cette œuvre capitale qui a l’avantage de finir à onze heure et demie
.
Oh ! ne riez pas de cette réclame administrative, envoyée aux journaux !
Cet avertissement n’est pas à dédaigner quand il s’agit d’un théâtre situé comme celui-là à 512 kilomètres, — de Quimperlé.
Le Ménestrel 5 novembre 1865
Lien : Retronews
Semaine théâtrale. (p. 4). — La Jeanne d’Arc de Duprez a maintenant deux cantatrices en titre pour interpréter le rôle de l’héroïne, Mlle Brunetti ayant dû être remplacée pour cause de nouvelle indisposition. Toutefois, elle était annoncée pour hier soir samedi. C’est Mlle Lustani, que nous avons connue autrefois à l’Opéra sous le nom de Mendès et sous le costume de page, qui a pris l’intérim de Jeanne d’Arc et y a obtenu un véritable succès de cantatrice à grande voix. l’exécution est du reste aujourd’hui complètement satisfaisante.
Lien : Retronews
Nouvelles diverses. (p. 7). — G. Duprez vient de mettre en vente, chez tous les éditeurs de musique, une édition à bon marché de sa partition complète de Jeanne d’Arc, cinq actes, piano et chant, pour le modeste prix de 6 francs. Le célèbre chanteur-compositeur a voulu ainsi justifier le baptême donné à son œuvre par le Grand-Théâtre-Parisien, en lui méritant plus complètement encore le titre d’Opéra Populaire.
La Liberté 7 novembre 1865
Extrait de la Quinzaine musicale de Charles Colin.
Lien : Gallica
Grand-Théâtre-Parisien. — Jeanne d’Arc, opéra en cinq actes.
Aucun sujet, au premier abord, ne paraît mieux convenir au théâtre ou à l’épopée que le poème de Jeanne d’Arc. Aussi, musiciens, grands et médiocres poètes, s’y sont dès longtemps essayés. Cette guerrière, cette inspirée, dont l’extase est l’état normal, ces luttes grandioses entre les deux plus illustres peuples de l’Europe, la prodigieuse variété des épisodes, tout promet d’offrir les situations les plus pathétiques. Pourquoi faut-il que Jeanne d’Arc n’ait pas encore inspiré de chef-d’œuvre, car on ne prendra pas pour tel le drame de Schiller qui, au milieu de très-grandes beautés de détail, renferme une faute capitale, l’amour subit de Jeanne d’Arc pour un soldat anglais.
Nous nous faisons cette question l’autre soir en sortant du Théâtre-Parisien où M. Duprez vient, comme on sait de faire représenter une Jeanne d’Arc. Comment se fait-il, nous disions-nous, que l’histoire simple et nue paraisse ici plus grande que les imaginations des poètes ? Nous touchons peut-être à la difficulté capitale du sujet. Quand l’histoire est trop grande elle écrase la poésie. Que reste-t-il pour l’imagination si la donnée tout entière avec toutes ses péripéties est fournie par l’histoire ? tout ce qu’inventera le dramaturge paraîtra grêle et mesquin à côté d’une réalité monumentale.
Mais, dira-t-on, il reste les enjolivements, les épisodes, le détail sur lequel l’imagination peut s’exercer. Eh non, précisément. Il en est de Jeanne d’Arc passée à l’état de légende comme de ces grandes figures bibliques qu’on ne saurait orner sans les profaner ; il faut suivre pas à passes testes, autrement vous créez un personnage de fantaisie, qui même ne peut intéresser, parce qu’on a toujours l’autre personnage, le vrai, dans l’idée, et que ce qu’on se rappelle de celui-ci fait tort à ce qu’on apprend de celui-là.
MM. Méry et Édouard Duprez ont bien essayé d’égayer leur sujet en donnant à Jeanne d’Arc une émotion, si ce n’est un amour pour un soldat de fortune, un soudard étranger, et ils ne se sont pas aperçus que cette froide amourette ne pouvait sérieusement intéresser. Une seule passion peut se concevoir dans cette héroïne, sa vie tout entière en est l’expression : c’est, comme elle le dit dans son interrogatoire, le sentiment qui lui a fait quitter son vieux père et sa vie innocente de bergerette, la pitié qu’il y avait au royaume de France
. L’amour de la France, voilà tout Jeanne d’Arc. C’est en faisant ressortir cet élément national et populaire que les auteurs avaient quelque chance d’empoigner leur public, et voilà précisément ce qu’ils ont un peu oublié.
M. Duprez nous dira que l’amour de Jeanne d’Arc pour Lionel est épisodique, je le veux bien, et personne ne sera tenté de voir là le sujet de la pièce, mais c’est un épisode qui tient trop de place ; qu’il se rappelle le caractère d’Odette dans Charles VI ; l’amour de la jeune fille pour le dauphin est à peine entrevu au premier acte.
Le prologue de M. Duprez est intitulé les voix du ciel. Nous voyons Jeanne assise sous l’arbre des fées. Ses réflexions sont quelquefois un peu métaphysiques pour une simple fille qui dans sa jeunesse savait à peine Pater et Ave, et qui, pour signer son nom ne sut que faire un rond au bas du procès-verbal de son abjuration. Peut-on lui prêter des abstractions de ce genre ?
Mon esprit incertain flotte et cherche sa route,
Mais mon âme a déjà trouvé la vérité !
La vérité c’est Dieu !…
Le premier acte, qui représente la Fête des fleurs, renferme d’assez jolis vers frais et printaniers comme tout ce qu’écrit M. Méry. Dans cet acte nous voyons Lionel l’amoureux, puis un individu bien étrange. Il est désigné sous le nom ‘de l’inconnu, et plus tard nous saurons que c’est Jean de Luxembourg qui livra Jeanne aux Anglais. Il parait que ce personnage satanique a vu jadis son amour repoussé par Jeanne et maintenant il emploie les ruses les plus machiavéliques pour qu’elle appartienne’ à Lionel : singulière fantaisie pour un ex-amoureux. L’acte se termine par le départ de Jeanne à qui le sire de Baudricourt envoie un superbe destrier sans compter une magnifique paire de bottes molles qui fait l’admiration des spectateurs.
Acte deuxième : Le Roi de Bourges. Nous sommes en pleine cour de Charles VII et nous allons voir ce roi qui perdait si gaîment son royaume transformé en rêveur sentimental et mélancolique, à qui Jeanne d’Arc vient demander de sauver la France.
Acte troisième : Le Sacre. Ne nous laissons pas trop allécher par ce titre magnifique ; nous, ne verrons du sacre que le défilé du cortége royal. Jeanne d’Arc passe, rapidement à cheval pour dire en montrant Lionel, qui a trahi la France pour l’Angleterre :
Éloignez cet homme et qu’on le chasse ;
Je ne le connais pas…
C’est la vérité vraie, cet acte ne renferme pas autre chose.
Acte quatrième : La Prison. Ici les auteurs ont voulu faire du romantisme et se conformer aux traditions historiques qui nous apprennent que Jeanne était en butte aux outrages des soldats qui la gardaient. Ils nous mettent en scène deux archers anglais, dont l’un veut voir Jeanne sur le lit de sa prison. Son camarade l’avertit que le bon ange de la prisonnière aveugle ceux qui la regardent.
Eh bien ! ma foi, je risque un œil,
dit l’autre. Ce vers grotesque a obtenu un succès de fou rire. Mais que dire de la scène qui va suivre. Lionel est introduit dans la prison par Luxembourg sous l’habit d’un ermite. Il a pour mission de faire reprendre à Jeanne ses vêtements d’homme ou son glaive, afin que, convaincue de parjure, elle soit livrée au supplice.
Il attendrit Jeanne, obtient l’aveu de son amour, et, rejetant alors son déguisement de moine, il poursuit si vivement la prisonnière, que pour se défendre elle saisit son épée. Cette scène nous a paru un peu trop risquée.
Acte cinquième : Le martyre. Nous n’avons rien à dire contre cet acte, si ce n’est que le dénouement prévu et inévitable traîné un peu en longueur. Au pied du bûcher finit l’épisode des amours de Jeanne et de Lionel ; c’est le soudard qui lui donne la croix faite avec son bâton, et il se tue ensuite sous les yeux de la sainte.
Après avoir parlé du libretto, disons quelques mots de la musique.
M. Gilbert Duprez, on le voit, n’y va pas de main morte, car pour aborder un tel sujet et en faire un opéra en cinq actes, il faut se sentir les reins solides. Doit-on le condamner tout de suite sans examen sérieux et déclarer que l’ex-chanteur n’a rien de ce qu’il faut pour être compositeur ? Nous ne le pensons pas, car s’il y a dans la musique de M. Duprez bien des défauts, il se trouve aussi des qualités réelles, et puis, il ne faut pas juger ici le compositeur comme un débutant auquel on peut donner des conseils, ni l’accepter tout à fait comme compositeur sérieux ; à ces titres, il a droit au moins au bénéfice des circonstances atténuantes.
M. Duprez a été l’une des gloires de notre scène française, et son nom est resté en quelque sorte attaché aux rôles qu’il a joués à l’Opéra ; il a eu depuis bien des imitateurs, mais jamais ceux ci n’ont pu le faire oublier. Forcé un jour de renoncer au théâtre, il s’est mis à former des élèves, et nul autre,ne le pouvait faire avec de plus grands éléments de succès.
Dans sa maison de la rue Turgot il fit construire un théâtre, et là donna aussi bien des leçons de déclamation dramatique que des leçons de chant. Il a entrepris ce qui s’appelle une spécialité, et forme des sujets pour les théâtres de musique : parmi ses disciples quelques-uns lui ont fait le plus grand honneur.
Enseignant chaque jour tous les rôles possibles des opéras connus, comment aurait-il pu résister à la tentation de créer des types nouveaux. Doué d’une intelligence d’élite., d’une mémoire prodigieuse, il a cru qu’avec tout cela il pouvait reparaître en quelque sorte sur la scène, et ne pouvant plus chanter lui-même les mélodies des autres, entendre au. moins chanter les siennes. C’était un moyen de se faire illusion, de se croire encore au théâtre, qu’un artiste de sa valeur n’abandonne jamais sans regret.
Il se mit donc à composer, et le public avait déjà entendu, avant Jeanne d’Arc, deux de ses ouvrages. Ces essais ne furent pas complètement heureux, et, toutefois, le public ne les accueillit pas mal. On se souvenait de ce Duprez qu’on avait jadis tant acclamé, et son nom revenant au théâtre, ne pouvait y être que fêté. L’autre soir, aussi, après la pièce, quand Duprez est venu lui-même, entraîné sur la scène, les trépignements n’ont pas manqué. On ne pensait plus, pour ainsi dire, au compositeur, et l’on entendait dire de tous côtés : Quel malheur qu’il ne chante plus !
La musique de Jeanne d’Arc n’est ni française, ni allemande, ni italienne, et si c’est une qualité, on peut dire que c’est de la musique éclectique. La mélodie, chose assez bizarre pour un chanteur compositeur, n’y est pas très-abondante, l’auteur se préoccupant plutôt de l’effet scénique que de tes morceaux.
L’opéra n’a pas d’ouverture, seulement une introduction dans laquelle nous avons remarqué une jolie phrase de violoncelle. La première scène jusqu’à la. vision est un peu longue. Le chœur des voix du ciel est d’un rythme trop sautillant, puis il nous semble qu’il y a ici un contre-sens de mise en scène. Jeanne devrait être endormie quand se font entendre les voix, et non avoir l’air de céder au sommeil sous l’influence de la musique. Pourquoi se réveille-t-elle aussi au bruit d’un superbe coup de grosse caisse, renforcé par un grand tapage d’orchestre ; ces paroles :
Où suis-je ? qui me parle ? Ô céleste mystère !
tournent ainsi au comique.
Parmi les morceaux de l’ouvrage nous avons remarqué : au prologue, l’allegro final, d’un rythme assez franc. Dans le premier acte, un chœur gracieux et de couleur allemande, le duo de Lionel et de Luxembourg renferme un ensemble d’une jolie mélodie. Nous avons remarqué, par exemple, dans la scène des adieux de Jeanne et de Lionel un passage où la partie de cor, écrite trop haut, est d’une sonorité étranglée et mauvaise.
Au second acte, la chanson de Dunois est d’alluré assez martiale ; mais nous n’avons véritablement retenu de Pair que chante le roi qu’un ut dièse, que ce monarque lance tout à coup comme une bombe et au moment où l’on s’y attend le moins.
Dans le troisième acte, le cantabile que chante Lionel est charmant ; c’est, selon nous, le passage le plus heureux de l’ouvragé. Le quatrième acte commence par un duo entre deux sentinelles qui est, sous le rapport de la musique aussi bien que du poème, tout à fait étrange. Dans le duo de l’ermite et de Jeanne, se trouve un andante fort gracieux et bien écrit pour la voix. Au cinquième acte, nous ne comprenons pas bien le premier chœur. Pourquoi ces différentes successions d’harmonies chantées à bouche fermée, avec ces dialogues presque parlés qui brodent sur le tout ? L’effet en est mauvais et l’exécution en sera toujours difficile.
L’interprétation de l’ouvrage est bonne s’il faut songer que ce sont presque tous de jeunes débutants pour la plupart élèves du maître dont ils interprètent là musique.
Mlle Brunetti que nous avons vue jadis remplir un petit rôle dans la Fanchonnette a fait depuis d’énormes progrès. Sa voix a beaucoup gagné. Comme actrice ce n’est pas là la figure de Jeanne d’Arc dans sa grandeur sculpturale, mais c’est une gracieuse statuette que l’on regarde avec plaisir et qui fait rêver. Nous conseillons cependant à Mlle Brunetti de corriger ses intonations qui sont quelquefois douteuses.
M. Du Wast qui remplissait le rôle de Lionel, et M. Aubert, chargé de celui de Charles VII, sont deux ténors : le premier a la voix d’un ténor léger, et phrase avec goût ; le second n’a eu que bien peu de chose à chanter, et s’il n’avait à lancer son fameux ut dièse, il passerait presque inaperçu. M. Gaspard, chargé du rôle de Luxembourg, a une voix fort belle ; cet artiste, avec du travail, pourra à coup sur devenir un sujet remarquable.
Le théâtre d’opéra populaire a donc enfin fait son apparition ; nous ne pouvons lui souhaiter que succès et longévité.
Le Journal des débats politiques et littéraires 8 novembre 1865
Extrait du feuilleton du Journal des Débats, par Joseph d’Ortigue.
Lien : Retronews
La Jeanne d’Arc, de MM. Méry et Duprez, au Grand-Théâtre-Parisien.
L’événement musical de ces derniers temps a été l’apparition de l’opéra de Jeanne d’Arc au Grand-Théâtre-Parisien. G. Duprez, notre grand chanteur, s’attaquant à un sujet tel que Jeanne d’Arc, avec un collaborateur comme M. Méry, il y avait là de quoi vivement piquer la curiosité. La curiosité a été eu effet très excitée le jour où tous les admirateurs de Duprez se sont mis en route pour ce théâtre situé près de la gare de Lyon, et par cela même bien plus à proximité de cette dernière ville que de Paris, — car, puisqu’il est passé en proverbe qu’aujourd’hui, grâce aux chemins de fer, on ne voyage plus, mais qu’on arrive, il est évident que le nouveau théâtre est bien plus à la portée des Lyonnais et même des Marseillais que des Parisiens, non de ceux du faubourg Saint-Antoine, mais de ceux de la Chaussée-d’Antin et du faubourg Saint-Germain, qui, pour se rendre à ce théâtre, ont à entreprendre un voyage de long cours. Malheureusement la déroute de cette représentation, suspendue à cause d’une indisposition de la première chanteuse, Mlle Maria Brunetti, reprise grâce au bon vouloir d’une seconde chanteuse, Mlle Antoinette, interrompue par de fréquentes apparitions du directeur, du régisseur, voire du commissaire de police, et finalement brusquement arrêtée avant la fin du second acte, cette déroute dis-je, a refroidi le zèle des auditeurs. La véritable première représentation a eu lieu néanmoins quelque temps après. La pièce a bien marché cette fois, et le compositeur n’a pas, eu à se plaindre de l’accueil fait aux principaux morceaux de son ouvrage. Il y a effectivement dans cette partition des chœurs animés, des endroits pleins de verve, des détails ingénieux, d’heureuses combinaisons de voix et d’instruments ; il y a quelquefois même des passages de récit bien sentis, tels que ces paroles du père de l’héroïne :
Si tu savais, enfant, dans quel chagrin tu plonges
Ton père désolé !
En général, l’expression est juste et vraie. J’ai remarqué dans le premier acte un duo où l’on trouve d’excellentes intentions, mais il y a aussi trop souvent un style pénible, laborieux et tourmenté, une trop grande tendance vers les formes italiennes. Parfois l’auteur gâte une idée musicale qui se présente bien par une orchestration bruyante et violente.
Quand un artiste a le bonheur, en dehors de son talent dominant, de celui qui a fait sa renommée et lui a valu tant de triomphes, de posséder un talent secondaire, ce dernier ressort d’autant plus que l’artiste met de réserve et de discrétion à n’en pas faire parade. Si Duprez s’était contenté d’écrire pour ses élèves, pour son école ou son théâtre, divers morceaux de divers genres, les biographes ne manqueraient pas de dire de lui : Non seulement il est le premier chanteur français de son temps, mais il montre qu’il est capable de composer des morceaux bien écrits, bien instrumentés, et d’en bon sentiment dramatique. Voilà certes un éloge dont un chanteur a lieu d’être fier. Mais que Duprez, aujourd’hui honoré, estimé, aimé de tous ; Duprez, à qui il ne manque rien de ce qui peut flatter l’amour-propre et embellir la vie ; que Duprez veuille courir la carrière de compositeur après avoir couru celle de chanteur et subordonner en quelque sorte celle-ci à celle-là, c’est là une illusion, une erreur. Si le compositeur, chez Duprez, pouvait être l’égal du chanteur, il ne faudrait parler de rien moins que de Mozart, de Weber ou de Rossini. On ne court pas deux lièvres à la fois, dit le proverbe ; et si l’on me répond qu’on peut courir deux lièvres l’un après l’autre, je dirai alors : Non bis in idem. Le public est assez avare de réputations pour s’obstiner à ne pas en accorder une deuxième, dans un genre tout différent, à celui qu’il a déjà favorisé d’une première, et fort belle.
Cet ouvrage nous a fourni l’occasion d’apprécier le talent de plusieurs élèves de Duprez, d’Ulysse du Wast, chargé du rôle de Lionel, de Gaston Aubert (Charles VII), de Gaspard (Jean de Luxembourg), de Mlle Maria Brunetti (Jeanne), de Mlle Armand (Perrine). Dès la troisième représentation, Mlle Brunetti a cédé le principal rôle à Mlle Félicia Lustani, un beau mezzo-soprano qui a obtenu des succès sur le théâtre royal de Madrid, et qui fait aujourd’hui admirer aux habitués du Grand-Théâtre-Parisien une voix étendue, puissante et dramatique.
Le Foyer 9 novembre 1865
Extrait de la Chronique de la semaine, de Ferdinand Schlosser.
Lien : Gallica
Nous avons été cette semaine voir Marie-Jeanne au grand Théâtre-Parisien, et les bravos décernés par un public enthousiaste à ce bon vieux drame, nous ont prouvé que ce qu’il faut encore avant tout à ce quartier, drame ou opéra, c’est une pièce largement mouvementée, et dont les effets soient un peu forcés. Profitons donc de cette occasion pour adresser à Mme Marie Daubrun et à MM. Saint-Léger et Devaux nos plus sincères compliments pour la façon dont ils ont interprété leurs rôles ; nos éloges aussi à Mlles Atala, Lucie et Jeanne Massue, qui, dans l’opérette de notre collaborateur Julien Deschamps, ont rivalisé de gentillesse et de talent.
De l’opérette à l’opéra il n’y a pas assez loin pour que nous ne franchissions pas la distance pour reparler un peu de cette pauvre Jeanne d’Arc ; à ce sujet on a fait sonner bien haut le nom de M. G. Duprez, que beaucoup de nos confrères se sont amusés à prôner comme le fondateur de l’opéra populaire. Il nous semble qu’en ceci on a un peu trop passé M. Massue sous silence. M. G. Duprez avait depuis longtemps en portefeuille un opéra qu’il désirait faire jouer, il s’est adressé au Grand-Théâtre-Parisien, rien de mieux, mais nous ne voyons-là qu’un amour-propre d’auteur à satisfaire. — Mais examinons à côté de cette vanité, bien pardonnable du reste, le rôle de M. Massue. Il a ouvert toutes grandes les portes de son théâtre au nouveau venu, il a fait les dépenses, dépenses relativement immenses, des décors, des costumes, de la mise en scène ; il a sacrifié des recettes certaines avec le drame aux recettes problématiques du nouvel opéra. — Enfin il s’est opposé de tout son pouvoir à l’augmentation du prix des places, augmentation si contraire à une bonne administration. — De quel côté est l’initiative ? Bien plus, dès l’été dernier, qui donc songeait à monter le Barbier, et cela sans augmenter le prix des places ?… Qui avait eu l’idée gigantesque, de faire jouer Robert le Diable, ce chef-d’œuvre immortel de Meyerbeer, pour l’inauguration de la saison musicale ?… Est-ce M. Duprez ?… Nous sommes forcés de répondre non. Seul, M. Massue avait rêvé tout cela. Où donc est dès lors le créateur de l’opéra populaire ?…
Cet opéra est-il possible ou non, nous ne pouvons rien affirmer, l’insuccès de Jeanne d’Arc ne prouve rien, qu’on essaie d’une bonne œuvre et seulement alors on pourra juger en toute connaissance de cause.
La Presse théâtrale 9 novembre 1865
Extrait de l’article d’A. Hernette.
Lien : Retronews
Grand-Théâtre-Parisien. — Début de Mlle Lustani-Mendès. Mlle Lustani-Mendès a chanté très bien le rôle de Jeanne d’Arc de l’opéra de Duprez. Il est à regretter que le maître ne l’ait pas choisie tout d’abord ; il se serait épargné bien des ennuis et aurait en plus eu la grande satisfaction de voir la partie principale de son ouvrage interprétée, de la première note jusqu’à la dernière, sans défaillance et d’une façon admirable. Mlle Lustani-Mendès a fait ressortir des beautés de son rôle, que le talent de chanteuse, froid et incolore de sa devancière n’y faisait aucunement soupçonner. Le duo avec le roi, à peine remarqué lorsque Mlle Brunetti le chantait, a obtenu un grand succès. Le duo de la prison avec Lionel qui m’avait semblé trop long à la première représentation, m’est apparu sous son véritable jour, interprété par Mlle Lustani-Mendès ; c’est un morceau de haute inspiration, d’un puissant intérêt dramatique et musical. La vaillante artiste a soulevé la salle dans la phrase finale Cette main vous épouvante
qu’elle a dite avec toute la chaleur et toute la sincérité de son talent.
Mlle Lustani-Mendès possède une voix de mezzo soprano, nette, vibrante, d’une égalité parfaite et atteignant sans difficultés aux notes les plus élevées du soprano. Elle possède un grand sentiment dramatique et met dans l’interprétation de son rôle une vérité et une intelligence peu communes. À ses avantages elle joint la beauté, la grâce et ce charme affectueux des manières qui lui conquiert la sympathie de ceux qui l’entourent et dont le public lui-même se sent aussi tout d’abord pénétré.
Aujourd’hui que ses débuts à Paris sont effectués j’espère bien qu’elle ne nous quittera plus ; nous la reverrons d’abord dans les premiers rôles des ouvrages que va monter le théâtre de la rue de Lyon et plus tard dans l’un ou l’autre de nos théâtres lyriques.
Les autres rôles de Jeanne d’Arc sont toujours tenus admirablement par les artistes de la création : la gentille Mlle Amant, dont la voix n’est pas moins charmante que le visage, chante avec goût et méthode le solo du chœur des anges et ensuite le rôle de Perrine.
M. Ulysse du Wast, Lionel, se fait applaudir dans chacun de ses morceaux. C’est une des voix de ténor léger les plus belles et les mieux cultivées que j’aie entendues.
M. Gaston Aubert emporte le succès à la pointe de ses ut de poitrine.
M. Gaspard joue et chante son rôle fort convenablement ; lorsqu’il aura débarrassé sa voix de ce qu’elle a de trop rude et qu’il aura corrigé quelques unes de ses intonations quelque peu communes, il sera certainement un de nos premiers barytons.
Mmes Gabriel, Angèle et Braut continuent à se montrer fort convenables dans leurs rôles, tout secondaires qu’ils sont.
C’est merveilleux de voir un orchestre, composé depuis si peu de temps, marcher avec un ensemble aussi parfait ; il est vrai que la plupart des exécutants sont des artistes de premier ordre. Il y a surtout dans la phalange de musiciens que dirige M. Maton, un hautboïste hors ligne, M. Dubrucq, que j’avais eu déjà l’occasion d’applaudir ailleurs.
Le Monde illustré 11 novembre 1865
Chronique musicale d’Albert de Lasalle (1833-1886).
Aimer la musique est tout. La comprendre, savoir comment on la fait, c'est l'affaire des artistes de profession. Or on naît musicien au faubourg Saint-Antoine, aussi bien qu'au faubourg Saint-Honoré ; le saint n'y fait rien, le faubourg non plus.
Lien : Retronews
Grand-Théâtre-Parisien : Jeanne d’Arc, opéra en six actes dont un prologue de MM. Méry et Édouard Duprez, musique de M. Gilbert Duprez (24 octobre).
Cela ne fait point de doute ; M. Duprez, en créant l’opéra populaire, aura puissamment aidé à la propagation de la musique.
Je parle, bien entendu, de M. Duprez impresario ; tout à l’heure, j’en viendrai à M. Duprez, compositeur.
Il est évident, en effet, qu’il fallait employer les grands moyens pour battre en brèche le préjugé qui refuse tout sentiment musical à la foule illettrée. Combien de gens se figurent qu’ils ne sont pas musiciens, parce qu’ils ignorent la gamme et n’ont jamais cherché à approfondir le mystère de ses combinaisons ! Vous entendez dire souvent : J’aime la musique ; mais je n’y comprends rien !…
Ce qui est une absurdité énorme, un trait d’imbécillité à classer au musée de l’idiotisme français, section des antiques.
Aimer la musique est tout. La comprendre, savoir comment on la fait, c’est l’affaire des artistes de profession. Or on naît musicien au faubourg Saint-Antoine, aussi bien qu’au faubourg Saint-Honoré ; le saint n’y fait rien, le faubourg non plus. Le hasard qui préside à la distribution de nos facultés naturelles, est aveugle comme un hasard qu’il est ; aussi était-ce par un abus singulier que les théâtres lyriques avaient été si longtemps agglomérés dans un seul quartier de Paris.
Il faut que la musique luise pour tout le monde. Et quelle meilleure forme de vulgarisation que celle de l’Opéra ? Pour peu que l’on soit doué d’un tympan sensible, comment ne pas pénétrer le sens de la mélodie, quand déjà il se trouve indiqué par le geste, la physionomie, l’attitude du chanteur ? L’opéra est la musique dans sa forme la plus humaine, donc la plus accessible.
M. Duprez aura pesé ces considérations avant de se lancer dans l’entreprise si louable de l’opéra populaire ; et s’y étant déridé, il s’est voté du même coup la récompense la mieux faite pour le tenter. Il a voulu qu’une partition de sa main inaugurât le répertoire du nouveau théâtre.
Comme compositeur, M. Duprez se trouvait dans la situation défavorable de tous les interprètes qui ambitionnent de devenir des créateurs. Son imagination a dû se sentir paralysée par les souvenirs de sa carrière de chanteur. Car après s’être assimilé pendant trente ans la musique des autres, il faudrait être un génie singulièrement puissant pour vider sa mémoire de tout ce qu’elle a gardé. L’auteur de Jeanne d’Arc, qui a été tour à tour Arnold de Guillaume Tell, Raoul des Huguenots, Fernand de la Favorite…, s’est trouvé obsédé de réminiscences le jour où il a voulut composer de la musique nouvelle. Aussi ce n’est pas à proprement parler une œuvre inédite que la partition de Jeanne d’Arc : M. Duprez aurait pu l’intituler : Les Mémoires d’un grand chanteur.
La légende de Jeanne d’Arc devait certainement tenter les librettistes ; et on s’étonne que vingt fois déjà la bergère de Domrémy n’ait pas sauvé la France en musique. M. Verdi a dans son répertoire une Giovanna d’Arco à peu près inconnue à Paris ; du moins ne l’avons-nous jamais vue affichée à la porte du Théâtre-Italien. On sait que M. Mermet compose à l’heure qu’il est un opéra sur le même sujet ; mais nous ignorons si d’autres tentatives ont été faites pour évoquer avec le secours de la musique cette grande et si sympathique figure de femme.
M. Méry et M Édouard Duprez (le frère du compositeur), ont pris leur héroïne à Domrémy et l’ont conduite jusqu’à Rouen, à travers toutes les péripéties sanglantes dont l’histoire a gardé le souvenir, et ils faut les louer de ne s’être point écartés de la vérité historique.
M. Gilbert Duprez a été moins heureux dans la traduction musicale de cette poétique légende. Quelques morceaux pourtant sont dignes d’être cités. En général les chœurs sont écrits dans de bonnes conditions de sonorité, et en cela, ils sont supérieurs à l’orchestre qui n’accuse pas une grande recherche dans la combinaison des timbres. Le chœur que je remarque tout d’abord est celui qui ouvre le premier acte, et dont on ne peut nier la bonne tournure rythmique. Un autre chœur, en forme de valse, est encore très-intéressant, bien qu’il soit très-déplacé dans un opéra dont l’action se passe sous Charles VII… Le premier acte est d’ailleurs le mieux venu des cinq ; un duo pour ténor et baryton y fait une certaine sensation, parce qu’il est très-scénique. Au second acte, nous entrons déjà dans la partie la plus aride de la partition ; cependant on y a applaudi une chanson guerrière dont le refrain dit en chœur est assez saisissant.
Je n’aime pas du tout l’air que le compositeur fait chanter au roi Charles VII, à l’heure où confiné à Bourges, presque prisonnier, il désespère de lui et de la France. M. Aubert, le ténor débutant, lance très-vaillamment les ut dièses ; il n’en est pas moins vrai que l’ut dièse, cette note excessive, ne passera jamais pour un gémissement, un sanglot étouffé ; c’est un cri de rage qu’il faut savoir placer en situation.
Du troisième acte — l’acte du couronnement — il n’y a rien à citer que le commencement d’un air de ténor.
Au quatrième, le duo des deux sentinelles, quoique trop long, renferme quelques passages bien traités.
Le cinquième acte, qui met en scène le supplice du Jeanne d’Arc, est le plus pauvre en mélodie, et j’avoue même n’en avoir pas conservé un souvenir très-net.
Les chanteurs ont fait des prodiges de zèle ; eux aussi voulaient fonder l’opéra populaire. Il n’en est pas moins vrai que Mlle Brunetti n’a ni la voix, ni l’encolure d’une Jeanne d’Arc. M. Ulysse du Wast, qui a été très-fêté par le public, possède une voix de ténor très-franchement timbrée, mais dont cependant les notes aiguës ne sont pas toujours d’une justesse irréprochable…
Les décors sont tristes à l’œil, car on y a prodigué les couleurs sombres avec intention. Les costumes méritent, au contraire des éloges, en ce qu’ils sont historiquement exacts, et d’ailleurs assez nombreux pour prêter de l’éclat au spectacle.
La Gazette de France 15 novembre 1865
Extrait de la Revue musicale d’Edmond Bach, en feuilleton.
Lien : Retronews
Le Grand-Théâtre-Parisien a représenté dernièrement un opéra de M. Duprez, de Duprez le célèbre chanteur, l’éminent professeur, qui a essayé de mettre à la scène la figure de Jeanne d’Arc. La tentative était hardie ; mais M. Duprez est un rude lutteur ; l’obstination dans une idée est le caractère de son talent, le signe de sa personnalité. Malheureusement ici, la persistance dans la volonté, l’énergie ne suffisaient pas à mener à bien une si rude tâche. On devient chanteur, mais on naît compositeur. Ni l’étude, ni l’assiduité ne donnent l’inspiration.
M. Duprez a entièrement échoué dans sa tentative, et la chute a été d’autant plus rude que notre auteur avait montré plus d’ambition dans son but. On ne s’attaque pas impunément à une épopée trois fois sainte comme l’est cette merveilleuse histoire de la Vierge de Domrémy. Qu’un génie puissant, sûr de soi, fût sollicité par la pensée de traduire cette page étonnante de nos annales, où la Providence fait éclater de si hauts enseignements, nous le comprenons ; cette épopée chrétienne et nationale pouvait tenter un Mozart, un Rossini, un Meyerbeer même ; mais M. Duprez aurait dû comprendre qu’il fallait apporter autre chose que ce qu’il pouvait donner pour oser une pareille entreprise. Il y a des tentatives qui, lors même qu’elles avortent, attirent des éloges à celui qui a eu l’audace de s’y engager : celle de M. Duprez n’est pas de ce nombre. On ne s’explique pas pourquoi il s’est embarqué dans une si colossale expédition, avec les faibles ressources qu’il pouvait mettre au service de son idée. Pourquoi M. Duprez a-t-il fait un opéra ? Pourquoi le Grand-Théâtre-Parisien a-t-il représenté cet opéra ? Je ne saurais trancher la question.
On a dit qu’on voulait créer une grande scène populaire ! Très bien. Mais il ne faut pas avoir réfléchi longtemps sur les conditions d’un théâtre ayant ce caractère pour constater que M. Duprez et, avec lui, le directeur du Grand-Théâtre, se sont absolument trompés, et qu’ils ont pris le contre-pied des choses. Sans s’en rendre compte, ils recommencent l’œuvre de ce pauvre et courageux Adam au Théâtre-Lyrique, et il la recommencent dans une condition cent fois plus défavorable à tous égards. Adam était un compositeur de mérite, dont le talent savait se plier aux exigences d’un public qui aime les mélodies facile, parce que ce sont les seules qu’il comprenne. Adam ne cherchait pas les compositions grandioses, son instinct lui disait que les sujets épiques devaient systématiquement être exclus du répertoire d’un pareil théâtre. Ce n’est pas que les grandes compositions ne soient comprises de la foule. Non, mais elles ne supportent pas le médiocrité. Adam avait toutes les qualités qui pouvaient faire le succès d’un théâtre de la nature de celui qu’en veut créer aujourd’hui ; cependant il échoua, et l’on sait comment : il mourut à la peine.
Le Théâtre-Lyrique voulu ensuite ouvrir ses portes aux jeunes compositeurs qui ne pouvaient aborder nos premières scènes ; on a eu ce qu’il en advint. Plus tard, un homme hardi, intelligent, M. Carvalho, entreprit de sauver l’œuvre en changeant de voie. Il lit représenter sans hésiter les chefs-d’œuvre des maîtres anciens, et ne craignit pas de demander à Mozart, à Gluck, à Weber, et à des compositeurs modernes en renom, les moyens de conquérir les faveurs du public. Le succès vint, mais le directeur se retira ruiné, et le problème posé courageusement par Adam n’a été résolu que par la subvention de l’État.
Aujourd’hui il est prouvé, jusqu’à l’évidence, qu’un théâtre lyrique quelconque ne pourra vivre à Paris que si le gouvernement l’aide de nos deniers. Les exigences des décorations et des mises en scène, auxquelles s’ajoutent les prétentions exorbitantes des chanteurs en vogue, rendent toute entreprise particulière impossible. C’est la ruine peur l’entrepreneur et les bailleurs de fonds. Peut-être y a-t-il place à Paris, dans la capitale de la démocratie de l’univers, pour un théâtre lyrique populaire ; cela est probable, mais c’est à la condition de résoudre, avant d’en ouvrir les portes, ce problème : donner les places à bon marché, représenter des œuvres de maîtres avec de grands artistes pour interprètes.
Oui, le peuple ira à un théâtre de chant, à un Opéra ; mais, qu’on ne s’y trompe pas, il faudra que ce théâtre soit plus parfait que les autres. Jamais on ne décidera le public à payer sa place pour écouter une médiocrité. Ce public-là ne sait pas faire les succès d’estime. Il ne fait pas d’hypocrisie sur sa banquette ; il demande au théâtre des émotions, et manifeste ses sentiments tout haut et sans fard. Il n’a aucune répugnance pour l’opéra proprement dit, bien que cette forme scénique lui soit moins familière que celle du drame ; et s’il redoute les grandes compositions, c’est que trop souvent on lui a fait entendre des élucubrations assommantes interprétées par des médiocrités, sous l’étiquette menteuse d’opéra. Donnez-lui Guillaume Tell, chanté par un Duprez, avec un orchestre puissant et des masses chorales bien conduites, et l’on verra si le peuple n’aime pas l’opéra.
M. Pasdeloup a fait une démonstration complète de cette vérité. Ses concerts ont pleinement réussi, et l’on se dispute les places pour aller entendre Beethoven, Mozart, Gluck, Mendelssohn, des sonates et des symphonies en ut dièse et en si bémol, mais interprétés par un orchestre excellent. Si le peuple va au concert, il ira certainement avec plus d’empressement écouter un drame lyrique qu’animent le jeu des artistes, la splendeur de la mise en scène et l’intérêt du sujet traité.
Le théâtre populaire est donc possible, mais c’est à la condition express de faire justement le contraire de ce qu’ont fait MM. Duprez et Massue.
Parlerons-nous de la Jeanne d’Arc arrangée par MM. Méry et Duprez, et le petit roman d’amour qu’ils ont imaginé et autour duquel ils ont groupé les actions merveilleuses de l’héroïne d’Orléans ? Le talent de MM. Méry et Duprez faisait espérer mieux que cela.
Quant à la partition en elle-même, elle ne supporte pas un examen sérieux, attentif. De la première à la dernière phrase, ce sont des réminiscences d’effets ou de mélodies qui fatiguent l’esprit à force de tourmenter la mémoire. Rien n’est plus énervant pour l’auditeur que ces motifs dont on se rappelle malgré soi l’origine et que le compositeur, effrayé lui-même de son plagiat, veut dissimuler dans des combinaisons harmoniques vagues, sans idée. Ce que cette partition a de particulier, c’est qu’elle est écrite comme une méthode de chant ; on dirait une suite d’exemples habituellement disposés et gradués par le professeur pour obtenir de l’élève une bonne émission de l’organe vocal.
L’exécution présente une uniformité qui est aussi une fatigue. C’est la méthode Duprez dans toutes ses manifestations. Les chanteurs émettent la voix selon les prescriptions du maître ; ils jouent comme il jouait et prononcent comme il prononçait. Aimez-vous Duprez ? on en a mis partout. Sans doute, on aimait Duprez, et passionnément, mais cette monnaie du grand chanteur, du grand artiste, n’est pas l’artiste lui-même, et il y a bien des qualités et des défauts, qui étaient admirés chez l’éminent ténor, qui ne séduisent pas dans ses imitateurs. Cependant il est incontestable que plusieurs des interprètes de la Jeanne Arc de M. Duprez sont des chanteurs de mérite doués de belle voix ; mon avis est qu’ils gagneraient beaucoup à ne pas être partie dans ce tout où M. Dupera s’impose sous toute les formes.
Le Figaro 16 novembre 1865
Lien : Retronews
Le maestro Verdi doit arriver au premier jour à Paris.
Deux livrets l’attendent à l’Opéra… il choisira.
En attendant que le compositeur dramatique nous donne du nouveau, l’Opéra a repris le Trouvère, pour les débuts de Mademoiselle Bloch.
— Comme cette jeune personne prononce bien ! disais-je à mon voisin de l’orchestre que je n’ose pas nommer.
— Elle prononce si bien, me répondit-il, que, si elle avait la voix abîmée, on la prendrait pour une élève de Duprez.
Où est-il, Duprez ?
À Rouen, où il est vaguement question de monter Jeanne d’Arc. Que diable La Trémouille, courtier de vin de Bordeaux ira-t-il faire dans le département de la Seine-Inférieure, où l’on ne boit que du cidre ?
Encore si les Rouennais profitaient de la présence de Jeanne d’Arc pour brûler la partition !
Au Grand-Théâtre-Parisien, on a donné un drame nouveau, le Fils aux deux mères.
Deux ? c’est bien peu !
Le succès eût été plus grand si l’on avait engagé les trois cents jolies femmes d’Hostein et appelé la pièce, le Fils aux trois-cents mères.
Du moment qu’un jeune homme a plus d’une mère, il n’y a pas de raison pour qu’il s’arrête.
Le Petit Journal 16 novembre 1865
Le Fils au deux mères, de MM. Henri de Kock et Léon de Marancourt, continue son succès Ce drame, si bien joué par Mmes Duguerret, Marie Daubrun et M. Marchetti, alterne avec l’opéra de M. Duprez, Jeanne d’Arc, qui est applaudi avec enthousiasme par le public.
Le Monde illustré 18 novembre 1865
Extrait de la chronique des Théâtres, par Charles Monselet.
Lien : Retronews
Le Grand-Théâtre-Parisien s’efforce, s’ingénie, et gagne petit à petit sa place. Il est vrai de dire qu’il est autant fréquenté par les habitants de Lyon que par ceux de Paris ; c’est à la fois le théâtre du faubourg de Perrache et du faubourg Saint-Antoine ; on l’affiche également sur la place Bellecour et sur la place de la Bastille. Pour le moment, les lendemains de Jeanne d’Arc y sont remplis par un drame en cinq actes, intitulé : Le Fils aux deux mères (on dit bien : La Femme aux deux Maris). Le sujet n’en n’est pas très-nouveau ; il est même absolument décrépit. C’est encore, et toujours, la lutte entre la femme du peuple et la grande dame, à propos d’un enfant changé en nourrice. Il est à moi ! — Non pas, c’est le mien !
Le Ménestrel 19 novembre 1865
Extrait de la Semaine théâtrale de Gustave Bertrand.
Lien : Retronews
Malgré le succès de son opéra de Jeanne d’Arc, M. G. Duprez, après une épreuve de onze représentations, a définitivement retiré son œuvre du Grand-Théâtre-Parisien, convaincu que les conditions d’éloignement de ce théâtre ne lui permettront jamais de mettre les recettes en rapport avec les frais immenses nécessités par l’exécution d’une grande œuvre musicale.
La Presse théâtrale 23 novembre 1865
Article d’Adolphe Giacomelli.
Lien : Retronews
Deux tristes nouvelles.
Duprez a retiré sa Jeanne d’Arc du Grand-Théâtre-Parisien. M. Massue intente un procès à Duprez, qui, de son côté, va poursuivre reconventionnellement M. Massue.
Mlle Brunetti, à son tour, actionne M. Duprez. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas réussi dans le rôle de Jeanne, trop lourd pour ses frêles épaules.
À Duprez, presque ruiné par la fâcheuse issue de son entreprise, Mlle Brunetti demande 50,000 fr. de dommages-intérêts ! Mais là n’est pas la question.
Mlle Brunetti, poursuivant M. Duprez, c’est tout simplement monstrueux. C’est une fille dénaturée demandant la tête de son père.
Ah ! mademoiselle, vous êtes… bien mal conseillée.
Le Foyer 23 novembre 1865
Extrait de la Chronique de la semaine d’Alphonse Baralle.
Lien : Retronews
Les journaux spéciaux ont annoncé dimanche que M. Duprez avait retiré du répertoire du Grand-Théâtre-Parisien son opéra de Jeanne d’Arc. Un de nos confrères a même été plus loin. Nous croyons devoir reproduire les quelques lignes qu’il a consacrées à cet événement [Gustave Bertrand dans le Ménestrel du 19 novembre.] :
Malgré le succès de son opéra de Jeanne d’Arc, M. G. Duprez, après une épreuve de onze représentations, a définitivement retiré son œuvre du Grand-Théâtre-Parisien, convaincu que les conditions d’éloignement de ce théâtre ne lui permettront jamais de mettre les recettes en rapport avec les frais immenses nécessités par l’exécution d’une grande œuvre musicale.
Voilà, il nous semble, des mots qui doivent être bien étonnés de se trouver ainsi rapprochés. Quoi, voilà un succès qui ne fait pas d’argent ? Alors ce n’est pas un succès. Et chacun sait trop aujourd’hui que l’éloignement n’a été pour rien dans la non-réussite de l’œuvre de M. G. Duprez. Le poème était nul et la partition complètement ennuyeuse et insignifiante. Voilà la vérité constatée, il faut bien le dire, par presque tous nos confrères de la grande et de la petite presse, et affirmée par le public. Non, ce qui a tué l’opéra populaire, ce n’est pas l’éloignement, mais bien le ridicule de cette première représentation arrêtée au second acte, c’est le prix exagéré des places, c’est surtout Jeanne d’Arc elle-même.
Arrivons maintenant à la partie financière et administrative. De quel droit M. G. Duprez a-t-il retiré sa pièce après onze représentations ?
Ce droit, les tribunaux nous l’expliqueront peut-être, mais ce qu’ils n’expliqueront pas, c’est le côté moral de la question. Et c’est là que nous pensons pouvoir porter un peu la lumière.
Nous ne parlerons que pour mémoire cette fois, quitte à y revenir un peu plus tard de tous ces pauvres diables vivant du théâtre et qui ont dû se trouver bien désappointés en présence de ce relâche inattendu ; mais nous nous occuperons de la situation faite à M. Massue en présence de la résolution inexplicable de M. Duprez. En effet, M. Massue a fait tous les frais et est loin d’en avoir récupéré la plus minime partie, et, en outre, il était lié par un traité de sept mois !… En présence de l’insuccès bien constaté de Jeanne d’Arc, M. Massue écrivait à l’illustre ténor pour le prier de s’occuper de suite d’un nouvel opéra. Cette première lettre resta sans réponse, ainsi qu’une seconde plus pressante encore. Le papier timbré dût remplacer dès-lors la correspondance amicale. M. Massue demandait cette fois par ministère d’huissier, de monter, dans la quinzaine, l’opéra destiné à remplacer Jeanne d’Arc. M. Duprez consentit enfin à répondre par la même voie, et fit signifier à M. Massue que quinze jours ne pouvant suffire à semblable travail, il livrerait en un mois : Les Deux chasseurs et la laitière !… Un opéra comique en un acte pour remplacer un grand opéra… Quelle charmante et spirituelle plaisanterie !… Puis à la suite arriva enfin l’avis du retrait de Jeanne d’Arc. Cette fois, ce fut le dernier coup, et le célèbre pseudo-fondateur de l’opéra populaire tuait du même coup son enfant et son œuvre !
Dans quelques jours, le tribunal aura à se prononcer sur cette malheureuse affaire. Nous ne pouvons donc aujourd’hui que faire des vœux pour que le droit soit cette fois encore d’accord avec la raison. Bonne chance donc à M. Massue, et à bientôt des détails. Mais la décision de M. Duprez ne serait-elle pas un peu dictée par les nouveaux traités passés par l’auteur de Jeanne d’Arc avec le théâtre de M. Briet, traités par lesquels la trop célèbre partition doit très-prochainement aller charmer le pauvre public rouennais ?
La Comédie 26 novembre 1865
Extrait de la Chronique de Paul Ferry.
Lien : Retronews
Duprez a retiré Jeanne d’Arc, après onze représentations an Grand-Théâtre-Parisien. La douzième représentation était affichée samedi, et un public plus empressé que de coutume était accouru ; mais il se retira après que le commissaire de police eût constaté l’absence des interprètes. Un procès est pendant. Le directeur Massue réclame des dommages-intérêts au maestro pour la non-exécution de son traité. De son côté, Duprez forme contre M. Massue une demande reconventionnelle, et prétend avoir donné avis du retrait de sa pièce en temps utile. La question des engagements des artistes vient s’ajouter à ce désastre. On dit même que Mlle Brunetti se serait élevée la première contre son maître, et lui demanderait des dommages-intérêts énormes pour avoir vu son rôle passer à Mme Lustani-Mendès.
Le Temps 26 novembre 1865
Extrait de la Comédie Contemporaine, d’Auguste Villemot, en feuilleton.
Lien : Retronews
Le directeur du Grand-Théâtre-Parisien se dispose à plaider contre Duprez et Méry. Le fond de la querelle, c’est que les grands et les petits confortables du théâtre se meublaient difficilement pendant les représentations de Jeanne d’Arc. MM. Duprez et Méry disent : Nous n’y pouvons rien ; votre théâtre est situé aux antipodes du monde civilisé. — À cela, M. Massue, le directeur, répond : Mon théâtre est un lieu de délices ; c’est le seul qui offre un refuge aux voyageurs qui ont manqué le train de Lyon ; peut-être devrais-je en faire un buffet et un dortoir. En attendant, votre odieux poème et votre détestable musique ont effrayé les voyageurs. Je demande des dommages et intérêts. Nous verrons comment Méry et Duprez pareront ce coup de Massue.
(Je ne me dissimule pas que c’est le second calembour qui s’échappe de ma plume mais je m’ennuie tant à Paris en l’absence de la cour impériale, que j’ai recours aux distractions les plus grossières.)
Le Charivari 29 novembre 1865
Extrait des Causeries de Jules Prével.
Lien : Retronews
Jeanne d’Arc est à la mode.
L’opéra de Duprez, qui n’a eu que onze représentation, hélas ! a remis sur le tapis la gardeuse de mouton de Domrémy et de Vaucouleurs.
M. Ernest Morin fait une croisade en sa faveur.
M. Sarcey la célèbre à son tour en son feuilleton dramatique de l’Opinion nationale.
Il avoue qu’il a même fait le voyage à Rouen pour aller entendre une Jeanne d’Arc au Théâtre-Français de cette ville.
Tout cela est très bien.
Pourvu que le Théâtre-Français de la rue de Richelieu ou l’Odéon, alléchés par l’actualité, ne profitent pas de l’occasion pour remettre à la scène le drame d’Alexandre Soumet !
Oh ! alors, nous ne pardonnerions pas à ces messieurs d’avoir ressuscité la touchante héroïne.
Le Temps 1er décembre 1865
Extrait de la Chronique du jour, d’Henry de La Madelène.
La Jeanne d’Arc de Duprez n’est pas restée longtemps sur l’affiche, bien qu’on eût crié au succès par-dessus tous les toits. Aujourd’hui, Duprez plaide contre M. Massue, directeur du Grand-Théâtre-Parisien. Nous apprenons, grâce à ces discussions, que malgré le prix relativement élevé des places, les représentations de Jeanne d’Arc n’ont jamais produit plus de cinq ou six cents francs de recettes. Est-ce assez triste !
Le Siècle 4 décembre 1865
Extrait de la Revue des Théâtres d’Edmond de Biéville, dans le feuilleton du 4 décembre 1865.
Lien : Retronews
Aujourd’hui le rachat de la tour de Jeanne d’Arc nous semble certain. Tout le monde le veut à Rouen. Jamais le nom de la glorieuse martyre n’y a été si populaire. Deux théâtres de la ville, pour répondre aux sentiments de la population, ont repris deux Jeanne d’Arc, le petit théâtre des Variétés, la Jeanne d’Arc de Soumet ; le Théâtre-Français, la Jeanne d’Arc de Charles Desnoyer. Sans doute le premier théâtre de Rouen, le théâtre des Arts, qui est subventionné par la ville, ne voudra pas rester en arrière et tiendra à honneur de donner aussi une Jeanne d’Arc, soit l’opéra de M. Duprez, soit la tragédie de d’Avrigny, soit le drame de Daniel Stern, qui n’a jamais été joué en France, mais qui l’a été à Turin avec un brillant succès.
La Jeanne d’Arc de Soumet, toute froide qu’elle est, et malgré une exécution forcément insuffisante, a été applaudie au théâtre des Variétés. Le drame de Charles Desnoyer, qui suit l’histoire assez fidèlement et presque pas à pas, et qui reproduit beaucoup des paroles, ou touchantes, ou naïves, ou sublimes de l’héroïne de Domrémy, a excité un véritable enthousiasme. Cette circonstance, connue de tous les Rouennais, que le Théâtre-Français est bâti sur l’emplacement même où fut brûlée la noble martyre, a singulièrement augmenté l’émotion au moment où l’actrice qui la représentait est montée sur le bûcher.
Dans l’histoire, Jeanne d’Arc, près de mourir, interpelle l’évêque de Beauvais, l’infâme Cauchon, en lui criant : Évêque, je meurs par vous !
Dans le drame de Charles Desnoyer, les exigences de la censure ont fait remplacer l’évêque de Beauvais par un recteur de l’Université, et Jeanne d’Arc s’écrie : Promoteur, je meurs par vous !
Sic vos non vobis.
Les journaux de Rouen sont d’accord pour constater les applaudissement qui ont accompagné pendant tout le cours de la représentation l’actrice chargée du rôle de Jeanne d’Arc, Mlle Nantier.
Il est impossible qu’après de telles démonstrations, la ville de Rouen ne fasse pas honneur à la lettre de change tirée sur son patriotisme. Si cependant son conseil municipal ne se trouvait pas assez riche pour payer aux Ursulines le prix de la tour de Jeanne d’Arc, une souscription nationale fournirait bien vite l’argent nécessaire.
Le Tintamarre 10 décembre 1865
Extrait de la chronique théâtrale de Louis-Auguste Commerson.
Lien : Retronews
Grand-Théâtre-Parisien. — Le directeur de cette entreprise dramatique avait organisé son répertoire de façon à donner au faubourg Saint-Antoine alternativement le drame et l’opéra. — Cette combinaison, qui avait le mérite assez rare de la nouveauté, aurait pu réussir, si M. Duprez, oubliant un contrat non verbal, mais écrit, n’avait fait disparaître Jeanne d’Arc et son armée, le soir même où elle était annoncée sur les affiches et dans les journaux.
Cet événement inattendu a nui nécessairement à la considération et aux intérêts matériels de M. Massue, dont le répertoire a été bouleversé de fond en comble. Les tribunaux sont saisis, et l’opinion publique lui semble déjà favorable. Nous attendrons cependant avant de nous prononcer, car les illusions sont si fréquentes dans le monde dramatique, qu’il ne faut jamais se fier aux apparences.
Le Temps 10 décembre 1865
Lien : Gallica
La Jeanne d’Arc de Duprez reparaît aujourd’hui sur les affiches du Grand-Théâtre-Parisien. Je remarque que, pour cette nouvelle série de représentations, le prix des places reste le même que pour les jours où le drame rugit dans la salle.
Le Petit Journal 12 décembre 1865
Lien : Tetronews
La reprise de Jeanne d’Arc au Grand-Théâtre-Parisien a eu lieu devant une nombreuse assemblée. L’œuvre de Duprez et ses imminents [éminents ?] interprètes ont reçu le plus chaleureux accueil. Mlle Lustani, MM. du Wast et Gaspard ont été plusieurs fois rappelés.
Le prix des places est le même pour l’opéra que pour le drame.
La Semaine musicale 14 décembre 1865
Par suite d’un nouvel arrangement intervenu entre la direction du Grand-Théâtre-Parisien et M. Duprez, Jeanne d’Arc vient de reparaître sur l’affiche. Nous lui souhaitons bonne chance.
L’Opinion nationale 14 décembre 1865
G. Duprez vient de mettre en vente, chez tous les éditeurs de musique, une édition à bon marché de sa partition complète de Jeanne d’Arc, cinq actes, piano et chant, pour le modeste prix de 6 francs. Le célèbre chanteur-compositeur a voulu ainsi justifier le baptême donné à son œuvre par le Grand-Théâtre-Parisien, en lui méritant plus complètement encore le titre d’Opéra populaire.
Le Droit, Journal des tribunaux 20 janvier 1866
Lien : Tetronews
Juridiction commerciale. — Tribunal de commerce de la Seine. Présidence de M. Boudault. Audience du 16 janvier 1866.
Grand-Théâtre-Parisien. — M. Massue et M. Duprez. — Jeanne d’Arc. — Résiliation de traité.
M. Duprez, voulant associer son nom à la fondation de l’opéra populaire, a fait, avec M. Massue, directeur du Grand-Théâtre-Parisien un traité dont voici l’économie.
M. Duprez engageait et payait une troupe de chanteurs, recrutés parmi les meilleurs élèves de son école.
Il engageait également un orchestre complet dirigé par M. Maton.
Il était chargé du soin de monter les opéras et il a commencer par donner son œuvre personnelle : Jeanne d’Arc.
M. Massue, de son côté, fournissait la salle, le matériel, l’éclairage et le service des représentations.
Les recettes, sous certaines déductions convenues, devaient être partagées par moitié.
Ces déductions opérées par M. Massue pour se couvrir des frais de costumes et décors, ont absorbés les recettes, et M. Duprez n’a rien touché.
M. Massue a fait assigner M. Duprez devant le Tribunal de commerce pour le contraindre à monter un autre opéra que Jeanne d’Arc, et à organiser des concerts le dimanche.
Il a ensuite formé contre lui une demande en paiement de 50,000 fr. de dommages-intérêts pour inexécution de ses engagements.
M. Duprez a répondu par une demande en résiliation de son traité avec M. Massue, fondée sur l’impuissance absolue où se trouvait ce directeur, dont le théâtre était mis sous séquestre, et qui vient d’être déclaré en faillite par jugement du 16 janvier 1866.
Voici le jugement rendu sur les plaidoiries de Me Hervieux, agréé de M. Massue, et de Me Albert Schayé, agréé de M. Duprez.
Le Tribunal,
Vu la connexité, joint les causes et statuant par un seul et même jugement, tant sur la demande de Massue que sur la demande reconventionnelle de Duprez ;
En ce qui touche la demande de Massue :
Attendu que Duprez a pris l’engagement vis-à-vis de Massue de donner, sur le Grand-Théâtre-Parisien, des représentations à frais communs ; qu’il a été stipulé entre les parties que, dans le cas où les représentations ne donneraient pas un produit de 1,200 fr., les pièces seraient changées d’un commun accord. Mais que, dans le cas où Duprez voudrait continuer les représentations des mêmes pièces, il garantirait à Massue un produit de 600 fr. ;
Attendu que Duprez a commencé l’exécution de son engagement par les représentation de Jeanne d’Arc ; que, s’il est vrai que dès la cinquième représentation, Massue l’ait averti que la pièce n’aurait aucun succès, et qu’après la huitième représentation il y aurait lieu de la retirer de la scène, il est constant que Massue a continué à faire jouer Jeanne d’Arc, sans le consentement de Duprez ; que Massue a agi pour son propre compte, et que dès lors la somme pour parfaire le produit net de 600 francs par chaque représentation ne saurait lui être accordée ;
Attendu que d’ailleurs Duprez a toujours offert de remplacer Jeanne d’Arc par d’autres pièces mises en répétition ;
Qu’il s’est toujours tenu à la disposition de Massue tant pour les représentations de ses opéras que pour les concerts du dimanche ;
Que ces faits sont suffisamment justifiés par la correspondance ;
Que Massue, de son côté, par des motifs qui lui sont imputables, n’a pu mettre en scène des nouvelles pièces ; que dès lors, sa demande contre Duprez, tant en exécution d’engagements qu’en dommage-intérêts, ne saurait être accueillie ;
En ce qui touche la demande de Duprez en résiliation des conventions ;
Attendu qu’il ressort des débats que Massue par le fait de sa position pécuniaire n’a pu continuer les représentations d’une manière régulière, que, poursuivi par ses créanciers, son exploitation a été mise sous séquestre ;
Qu’il ne peut donc aujourd’hui exécuter son engagement vis-à-vis de Duprez ;
Qu’il y a donc lieu de prononcer la résiliation au profit de ce dernier ;
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort ;
Déclare Massue mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
L’en déboute ;
Déclare résiliées par le fait de Massue les conventions dont s’agit ;
Et condamne Massue aux dépens.
La Comédie 27 mai 1866
Extrait de la chronique de Paul Ferry.
Lien : Gallica
Les artistes [du théâtre] Beaumarchais sont passés au Grand-Théâtre-Parisien avec les Nuits de la Place Royale [drame d’Émile Richebourg et Léon Pournin]. Mme Douglas y joue avec beaucoup d’expression. C’est un talent, l’affiche en fait une étoile. La direction — toujours provisoire — de ce théâtre est dévolue à M. Léon Pournin, l’un des auteurs du drame représenté.
[À noter, la brève suivante :] Le théâtre Beaumarchais donnait, un des soirs de la semaine dernière, Jeanne d’Arc sous l’arbre des fées, monodie de M. E. d’Anglemont…
L’Événement 16 juin 1866
Extrait de la chronique des Théâtres d’Adolphe Dupeuty. (À noter que le jeune Émile Zola tenait alors la chronique littéraire du journal.)
Lien : Retronews
Ce soir, au Grand-Théâtre-Parisien, première représentation des Volontaires de Sambre et Meuse, grand drame militaire de MM. Eugène Moreau et L. Pournin.
Le Foyer 9 août 1866
Extrait de la chronique des Théâtres de Paris de Julien Deschamps.
Lien : Gallica
Grand-Théâtre-Parisien. — Jeanne d’Arc, drame historique en 5 actes et 10 tableaux, par M. Charles Desnoyers. — Mlles Jeanne, Atala et Lucie Massue.
La campagne d’été, tentée par MM. Pournin et Ce, a été déplorable. Il a fallu de nouveau fermer les portes du Léviathan dramatique… au grand déplaisir de ces pauvres artistes, qui attendent bien souvent, hélas ! après la recette du jour pour manger le lendemain !
M. Pournin, à bout d’expédients pour forcer le public à venir quand même voir et applaudir ses œuvres, rien que ses œuvres ! a eu la singulière idée de lui offrir, d’après la mode anglaise :
Une chope !
Un cigare de la Havane, dit bordelais et… l’assurance de sa parfaite considération.
Aux dames, il se promettait de donner, si le succès avait couronné son entreprise commerciale brevetée S. G. D. G. :
Un pain de gruau !
Un cervelas (avec… ou sans ail), ou un chausson aux pommes, à leur choix… le tout arrosé d’une douce Augustine !
Où allons-nous, mon Dieu ! où allons-nous ?
Croyez-moi, mon cher Pournin, renoncez à tout autre essai directorial… de ce genre, contentez-vous de composer des pièces de théâtre, et laissez-les exploiter par qui de droit.
À chacun son lot, ici-bas !
Vous êtes jeune, vous avez de l’esprit… vous en avez donné des preuves dans plusieurs de vos productions ; vous entendez parfaitement le mécanisme du drame… voire même du mélodrame ; vous troussez gaillardement le vaudeville.
Rappelez-vous donc que :
L’homme n’est pas parfait !
Cette digression m’était nécessaire pour faire comprendre aux lecteurs du Foyer que le moment paraissait très peu favorable pour essayer une nouvelle réouverture au Grand-Théâtre-Parisien.
Abattu par Jeanne d’Arc, M. Massue a voulu se relever… un instant (la permission que lui a délivrée la préfecture ne s’étend que jusqu’au 1er septembre prochain) par une autre Jeanne d’Arc, qui n’a aucun rapport avec celle de la fabrication Duprez frères.
Cette représentation, donnée dimanche au bénéfice de Mlle Jeanne Massue, a été superbe… surtout au point de vue de la recette.
Qui le croirait ? on a refusé du monde.
Le vendeur de programme habituel paraissait consterné : L’Orchestre ne faisant nulle mention du Grand-Théâtre-Parisien… il a dû remporter ses programmes… et sa veste !…
M. Massue, lui, était radieux de voir le public répondre avec tant d’empressement à son appel… ou plutôt à l’appel de ses charmantes filles.
Atala, Jeanne, Lucie.
Trois anges consolateurs qui sont là pour le soutenir dans son infortune.
Atala a fait des progrès immenses. La noble jeune fille comprend qu’il lui faut aujourd’hui récompenser sa famille des sacrifices qu’elle s’est imposés.
Elle a dignement rendu la belle et sympathique physionomie de Jeanne d’Arc.
N’a-t-elle pas toutes les qualités requises pour représenter ce personnage légendaire ?
Jeanne et Lucie se sont associées de tous leurs efforts au succès de leur sœur bien-aimée.
Néré, Gobert et Renaudin ont crânement enlevé leurs rôles. Voilà trois bonnes colonnes capables de supporter un théâtre… fût-il aussi lourd que le Grand-Théâtre-Parisien.
Avec une semblable tête de troupe on doit ramener le public… bon gré malgré.
Brunet ou Brunel a fait rire… comme au beau temps de Beaumarchais.
Quant à la mise en scène et aux décors… l’affiche dit : splendide !
Et, vous le savez, les affiches ne mentent jamais !
Le Ménestrel 14 octobre 1866
Lien : Retronews
— On lit dans [la Liberté] sous la signature de notre collaborateur A. de Gasperini :
M. Duprez dirige, comme chacun sait, dans son hôtel de la rue Turgot, une école spéciale de musique et de déclamation. Les réunions du vendredi, véritable résumé des travaux de la semaine, sont de plus en plus suivies. Nous avons assisté, vendredi dernier, à l’une de ces intéressantes séances, et nous nous proposons de revenir, dans un article spécial, sur l’esprit, les tendances qui caractérisent la méthode du célèbre artiste. Tout à fait consolé de l’échec de Jeanne d’Arc, Duprez s’est tourné depuis quelque temps du côté de la musique sacrée. Ses premières études se sont faites dans le Conservatoire royal de musique religieuse, que Choron dirigea avec tant d’éclat sous la Restauration, et d’où tant d’artistes distingués sont sortis. À la fin de sa carrière, Duprez retourne à ses premières études, et il vient de composer un Requiem qu’il fera bientôt entendre à son public ordinaire. Nous parlerons certainement à nos lecteurs de cette importante composition.
Le Rappel 2 octobre 1869
Extrait de la chronique théâtrale Derrière la toile d’Ernest Blum.
M. Duprez rouvre son école de chant.
Il a adjoint à ses cours un orchestre complet, ce qui lui permet de faire suivre à ses élèves un enseignement à peu près complet du chant et du théâtre.
M. Duprez serait vraiment un homme précieux, — musicalement parlant, — s’il n’avait pas fait Jeanne d’Arc.
À ce propos, je risque une plaisanterie lancée par l’ancien ténor lui-même, au moment de la chute mémorable de son grand opéra au théâtre de la rue de Lyon.
Comme quelqu’un lui reprochait cette tentative bizarre, il répondit en riant (il y a toujours un moment où on rit, même après qu’on a reçu une tuile sur la tête) :
— Mon cher, il vaut encore mieux faire des Jeanne d’Arc que d’en défaire !
Les Annales politiques et littéraires 28 octobre 1883
Article de Gabriel Ferry.
Lien : Gallica
Les dernières années d’Alexandre Dumas
La vieillesse d’Alexandre Dumas fut attristée par de cruels besoins d’argent. Cette gêne qui envahissait de plus en plus le foyer du maître l’attristait, et il s’efforçait de l’écarter dans la mesure de ses moyens.
Déjà l’activité de ses démarches avait provoqué à l’Odéon une intéressante reprise de la Conscience, drame de Dumas qui avait obtenu un grand succès quelque temps auparavant.
Victor Leclerc avait été trouver, de la part de Dumas, Chilly — alors directeur de l’Odéon ; il lui avait représenté que la Conscience, reprise avec Laferrière, avait toutes les chances de rencontrer de nouveau le succès d’autrefois, Chilly se laissa persuader, et cette reprise donne raison aux prévisions de Dumas.
Ce drame avait été représenté pour la première fois le 4 novembre 1854.
Il sut rendre intéressante cette reprise de la Conscience en 1869.
Elle fournit encore une belle carrière à l’Odéon.
Ce précédent inspira à Victor Leclerc l’idée de porter au directeur du Châtelet la première partie de Les Blancs et les Bleus, et de solliciter la commande d’un drame pour ce vaste théâtre.
Le directeur du théâtre était alors M. Fischer.
Il venait de monter, avec un grand luxe de mise en scène, le Théodoros, de Théodore Barrière.
La lecture du premier volume de Les Blancs et les Bleus l’empoigna ; il vint prier Dumas de tirer un drame de son ouvrage et lui promit de le représenter immédiatement après Théodoros.
Dumas se mit immédiatement à la besogne, et, en quelques jours, il eut écrit le drame.
Chez lui, le roman est toujours si mouvementé, si scénique, que la pièce sort facilement.
Comme le Châtelet ne possédait pas une troupe d’ensemble suffisante pour jouer un drame de l’importance de Les Blancs et les Bleus, on alla chercher des interprètes au dehors.
Laray fut embauché spécialement pour remplir le rôle de Pichegru.
Taillade fut demandé à l’Odéon pour tenir le personnage de Saint-Just.
Dumas avait placé dans son drame Charles Nodier enfant. On confia ce rôle à Mlle Gabrielle Gautier, qui s’y montra pleine de naturel et de gentillesse.
Un sergent loustic de l’armée du Rhin, appelé Falou, personnifiait la partie comique de la pièce.
Ce rôle, très franc, très gaulois, échut à l’acteur Courtes.
Ce comédien consciencieux, qui a acquis une légitime notoriété sur le boulevard, était une vieille connaissance pour Dumas. En 1865, il avait fait partie de la troupe que le romancier recruta alors pour jouer d’abord son drame des Gardes forestiers sur le théâtre de la rue de Lyon.
Ce souvenir nous rappelle une anecdote rétrospective qui aurait dû prendre sa place plus haut.
Dumas, avons-nous dit, avait fait une mauvaise opération commerciale en louant pour son compte cette salle, qui devait rester perpétuellement enguignonnée sous le nom de Grand Théâtre-Parisien. L’élévation de la température et l’indélicatesse d’un secrétaire lui frustrèrent des recettes qu’il pouvait espérer de la représentation des Gardes forestiers.
Il dut fermer le théâtre et arrêter les représentations.
Il restait débiteur de cinq ou six-cents francs envers chacun de ses artistes, et il n’avait pas alors les ressources nécessaires pour les désintéresser.
Du jour au lendemain, ces artistes se trouvèrent sur le pavé, sans engagement. Cette situation émut le romancier.
Le lendemain de la fermeture, il réunit ses acteurs dans le foyer du théâtre, et leur tint à peu près le langage suivant :
— Mes enfants, vous savez pourquoi je suis obligé de fermer le théâtre. Vous êtes sans engagement ; mais il m’est venu une idée qui, si vous l’adoptez, peut remédier à la situation, Cette idée, la voici :
Les Gardes forestiers sont faciles à jouer partout, en raison de leur peu de mise en scène ; formez-vous en société et allez jouer mon drame dans toutes les villes des départements limitrophes. Je vous autorise à prendre sur l’affiche le nom de troupe dramatique de M. Alexandre Dumas ; et, quand vous jouerez dans une ville voisine de Paris, télégraphiez-moi le matin. Je vous promets d’arriver le soir pour la représentation. Je crois donc fermement que vous aurez du succès et que vous ferez de l’argent, si vous vous ralliez à mon projet.
L’idée, en effet, était pratique, originale. Les artistes l’adoptèrent.
Ils se constituèrent en société, et allèrent jouer les Gardes forestiers dans les départements de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l’Oise et de l’Aisne.
Quand on jouait, on envoyait quelquefois une dépêche à Dumas.
Il arrivait le soir, et assistait à la représentation dans une loge bien en vue.
On faisait salle comble.
Quelquefois, les artistes faisaient une seconde représentation du drame ; car tous les empressés ne trouvaient pas toujours de la place pour la première audition.
Un jour, la troupe donnait une représentation à Laon. On avait envoyé une dépêche au romancier, et le bruit de sa venue se répandit rapidement dans la ville.
Sept heures sonnent, la salle est bondée de spectateurs, et Dumas n’est pas encore arrivé.
Cependant, on lui avait envoyé une dépêche.
On attend encore une demi-heure : personne ! Alors les artistes pensant que le maître ne viendra pas, se décident à faire lever le rideau, et commencent la représentation.
Mais les spectateurs, qui comptaient sur la présence de Dumas, croient à une mystification et deviennent furieux.
Cette fureur se traduit par un vacarme qui remplit l’enceinte du théâtre.
Sur la scène, les acteurs étaient consternés ; et le commissaire de police de la ville se montrait inquiet des suites de ce tapage.
Au moment de lever la toile sur le second acte, un grand bruit se fait dans la salle, des acclamations retentissent de toutes parts : c’est Dumas qui entre dans sa loge et qui salue le public.
Il avait manqué le train, de là son retard.
Les artistes respirèrent.
Ils allaient entamer le deuxième acte, quand tous les assistants s’écrièrent :
— Le premier acte ! nous voulons le premier acte !
Comme ils n’y avaient pas fait la moindre attention, ils désiraient qu’on le recommençât.
Les acteurs obéirent, et la représentation se poursuivit sans encombre.
Villers-Cotterêts — patrie de Dumas et lieu de la scène des Gardes forestiers — fut une des étapes de la tournée dramatique.
Les habitants reçurent avec enthousiasme Dumas et ses artistes.
Ils réclamèrent une seconde représentation du drame pour le lendemain.
Les acteurs, électrisés par cet accueil, se surpassèrent.
Dumas, ravi de la cordialité de ses compatriotes et du zèle de ses interprètes, rayonnait. Parfois, la joie lui inspirait des idées originales.
À l’ issue de la représentation, il alla dans les coulisses serrer la main de tous ses artistes.
— Mes enfants, leur dit-il, vous avez admirablement bien joué ce soir ; aussi, demain matin, j’irai à l’hôtel où vous êtes descendus, et je vous ferai moi-même à déjeuner.
Il tint parole ; le lendemain, il s’installait devant les fourneaux de la cuisine de l’hôtel, et confectionnait un excellent déjeuner pour ses interprètes.
Il avait même poussé la couleur locale jusqu’à coiffer le bonnet de chef et à ceindre le tablier blanc.
Les fenêtres de la salle à manger étaient au rez-de-chaussée, et ouvraient sur la rue.
Pendant deux heures, les habitants de Villers-Cotterêts défilèrent devant ses fenêtres pour voir Dumas servant lui-même ses artistes en tablier blanc.
Ces derniers récupérèrent largement, pendant cette tournée, les appointements qu’ils avaient perdus au Grand Théâtre-Parisien.