Texte
Les lettres de Jeanne d’Arc et la prétendue abjuration de Saint-Ouen
par
(1911)
Éditions Ars&litteræ © 2017
Avant-propos1
Ajouter quelque chose de nouveau à tout ce que l’on a écrit sur Jeanne d’Arc semblait impossible ; et cependant l’accueil fait aux Reliques de Jeanne d’Arc, ses lettres2, montre l’intérêt que suscitent les moindres détails de cette merveilleuse existence.
Vous rendez un bien grand service aux historiens — m’écrivait M. Germain Lefèvre-Pontalis3 — en leur offrant, ainsi rapprochés, ces documents splendides.
Les lettres de Jeanne d’Arc étaient peu connues, et jamais n’avait été élucidée la question de sa signature. Lorsqu’on les avait publiées, ce n’était qu’à titre d’illustration ; et cependant, mieux étudiées, elles peuvent jeter un rayon de lumière sur toute une partie de la vie de Jeanne.
Si, de tous les côtés et de tous les milieux, m’est venu le témoignage du très grand intérêt que l’on prenait aux lettres de Jeanne d’Arc, j’ai vu aussi, par les questions posées, les détails réclamés, que je n’avais fait qu’aborder le sujet. Des regrets aussi m’étaient exprimés que je n’eusse pas donné à la reproduction des lettres une plus grande perfection.
Ne pas répondre à ces désirs serait manquer à tout ce que nous impose le si précieux héritage de famille que nous possédons.
Des documents aussi exceptionnels que les lettres de Jeanne d’Arc doivent être conservés avec un soin jaloux. Les montrer, les déplier, les exposer à la lumière, c’est venir en aide au temps pour hâter l’œuvre de destruction. Et cependant tous les admirateurs de la Pucelle aimeraient à contempler ces lettres ! Les paléographes le désireraient peut-être encore plus vivement !
J’entends encore l’un d’eux me dire : Songez, Monsieur, à ce que serait une lettre de Charlemagne ! Combien une lettre de Jeanne d’Arc n’est-elle pas d’un prix plus inestimable !
Grâce aux procédés de M. Marty4, nous leur offrons des fac-similés qui donnent l’illusion de la réalité5. On y trouve non seulement l’écriture, les signatures, mais on croit avoir sous les yeux le papier du XVe siècle, et l’on y voit les déchirures, les taches, les sceaux brisés ; en un mot, tout ce qui est l’œuvre du temps.
La ville de Reims ne s’est jamais consolée de ce que, vers 1628, les échevins aient pu se dessaisir des lettres en faveur de Charles du Lys ; aussi, en 1903, Charles Arnould, maire de Reims, faisait-il demander si l’une des lettres, au moins, ne pourrait être rendue à Reims, disant que, pour l’obtenir, aucun sacrifice ne paraîtrait trop élevé6. Cette démarche, faite auprès du marquis de Maleissye, montre à quel point tous les Français, quelles que soient leurs opinions, sont unis dans le culte de Jeanne d’Arc.
D’Amérique venaient également des propositions pour acquérir ce précieux trésor. Il est inaliénable ; mais toutes ces demandes sont un motif de plus pour que, d’une manière aussi complète que possible, nous cherchions à faire connaître les lettres de Jeanne d’Arc ; et, en même temps, nous en tirerons les conséquences historiques.
C. M.
Lettre du père Hertzog7
Rome, 23 juin 1911.
Monsieur le Comte,
J’ai l’honorable mission de vous transmettre cette réponse et ce remerciement de Sa Sainteté, qui sera pour vous, je n’en doute pas, la plus grande récompense de tous vos travaux.
C’est le samedi 17 que j’ai présenté, en audience privée, au Saint-Père votre beau volume, lui en donnant l’explication. Sa Sainteté a voulu de suite le parcourir, examiner les reproductions si parfaites des lettres et surtout de la signature, et a beaucoup admiré tout l’ensemble du travail.
Très spontanément, le Saint-Père m’a dit vouloir vous remercier par un mot venant de lui-même ; vous voyez qu’il n’a pas tardé à réaliser sa promesse.
Mercredi matin, j’avais l’honneur de lui présenter notre communauté ; en me voyant, il a fait comme un geste d’excuse de n’avoir encore rien envoyé et m’a dit ces paroles qui vous toucheront :
J’ai déjà préparé la minute, mais n’ai pas encore eu le temps de la recopier !…Je vous offre encore, Monsieur le Comte, mes respectueuses félicitations et y joins l’expression de mes sentiments les plus dévoués.
X. Hertzog.
Lettre de Sa Sainteté Pie X
À monsieur le comte Conrad de Maleissye, avec les plus sincères félicitations pour l’heureuse découverte8 des précieuses lettres de la Bienheureuse Jeanne d’Arc, et avec bien des remerciements pour le très-élégant exemplaire qu’il Nous a donné en faisant le vœux que la Bienheureuse lui obtienne du bon Dieu les meilleures grâces du ciel, comme gage de notre particulière bienveillance Nous donnons en retour de grand cœur la Bénédiction Apostolique.
Du Vatican, le 21 juin 1911.
Pius SS. X.
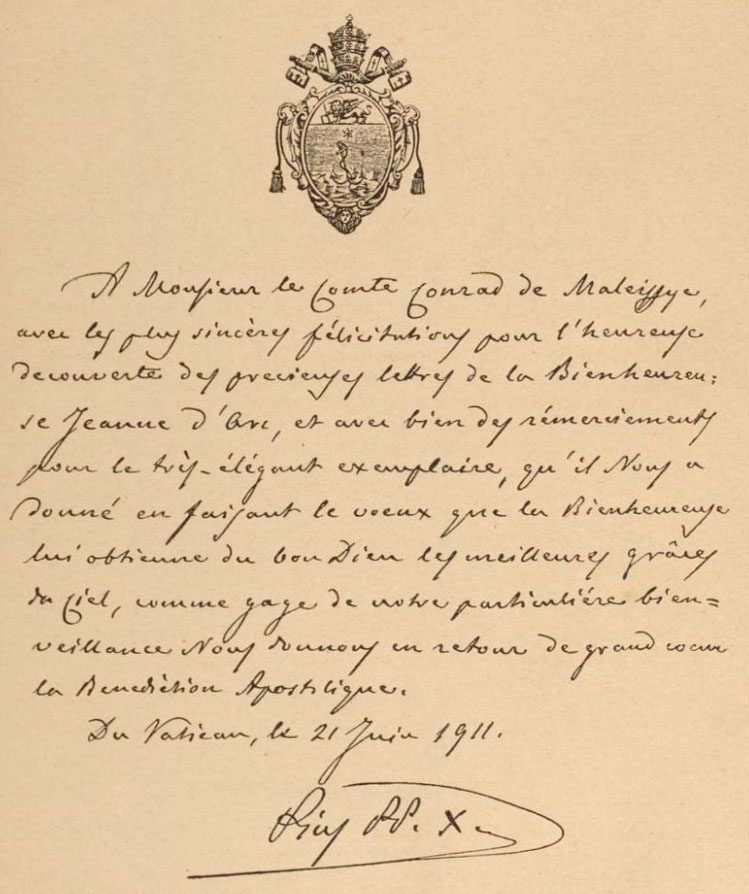
Lettre de Mgr Touchet9 évêque d’Orléans
Monsieur le Comte,
De cette fois, j’ai lu et relu votre volume sur la bienheureuse Jeanne d’Arc. Vous m’avez absolument conquis. Il sera désormais impossible d’écrire une
Vie de Jeannesérieuse et vraie sans tenir compte de votre contribution.Rien de plus démonstratif ne se pouvait rêver sur ce point obscur de la prétendue abjuration de Saint-Ouen. Merci et merci !…
Veuillez agréer, Monsieur le Comte, mes très sincères respects.
✝ Stanislas,
évêque d’Orléans.Orléans, 21 juin 1911
Préface de M. Gabriel Hanotaux10 de l’Académie Française
M. le comte de Maleissye, descendant de Charles du Lys, petit-neveu de Jeanne d’Arc, possède trois lettres originales de la Pucelle. Ces lettres, adressées par la Pucelle aux échevins et bourgeois de Reims, ont été, au XVIIe siècle, remises par les autorités de cette ville à Charles du Lys et elles sont conservées, depuis lors, dans les archives de la famille.
M. le comte de Maleissye ne s’est pas montré un gardien inattentif et, si j’ose dire, oisif de cet incomparable trésor : sa vigilance pieuse s’est penchée, avec une application intense, sur ces documents qui reflètent de si près l’âme de Jeanne d’Arc. Il les a étudiées, non pas seulement comme des titres de famille, mais comme des reliques. À force de les contempler, de les scruter, il en a perçu, avec une divination — où il entre de la gratitude, — le sens intime ; il leur a découvert une valeur historique, ignorée jusqu’à lui.
Il a tiré de cette étude les éléments d’une enquête très serrée et des conclusions très nettes sur l’un des points les plus importants de l’histoire de Jeanne d’Arc : Jeanne d’Arc savait-elle signer ? Savait-elle lire et écrire ?
J’irai tout de suite jusqu’au bout des conséquences que M. de Maleissye a tirées de ses ingénieuses recherches : si, comme il l’affirme, en s’appuyant sur les plus fortes présomptions, Jeanne d’Arc savait signer et même lire et écrire, le fait quelle n’a pas mis son nom au bas du fameux document de l’abjuration — lors de la cérémonie dérisoire du cimetière de Saint-Ouen — suffit pour établir quelle n’a pas abjuré : toute la scène n’aurait été qu’une infâme comédie, arrangée, pour tromper les contemporains et la postérité, par l’évêque Cauchon, par le cardinal de Winchester et par les autres meneurs du procès.
Avant de brûler le corps de Jeanne on a tenté de flétrir l’âme. On a préparé, avec un art diabolique, la cérémonie de la rétractation et le procès-verbal falsifié de cette duperie. Ainsi on obtenait un double avantage : Jeanne, en désavouant sa mission divine, détruisait elle-même l’appui moral qu’elle avait apporté à la cause de Charles VII ; en outre, niant le caractère céleste de sa mission, elle se condamnait elle-même ; il suffisait d’un incident de procédure pour que, selon le mot de Cauchon, on sût bien la rattraper
et la faire tomber au piège si perfidement tendu ; cet incident, ce fut la reprise des habits d’homme. Jeanne, en les revêtant, était passible des peines de relapse. Les Anglais avaient ainsi toute satisfaction : la pauvre fille s’était portée d’elle-même au bûcher.
Cette manœuvre, exécutée hardiment au grand jour, a trompé les contemporains ; elle a trompé l’histoire. Il a été admis, pendant plusieurs siècles, que Jeanne d’Arc, dans un moment d’abandon et de faiblesse, mise en présence de la mort par le feu, avait fléchi, avait abjuré. L’étude plus exacte et plus attentive des documents et, surtout, une connaissance plus approfondie du caractère de Jeanne avaient cependant mis en garde la plupart des historiens récents de Jeanne d’Arc. Mais, si les arguments contraires à la thèse de l’abjuration étaient assez nombreux et assez forts pour incliner les esprits vers ce sentiment, ils n étaient pas assez décisifs pour apporter une certitude. Or, cette certitude, M. de Maleissye entend la dégager de l’étude nouvelle à laquelle il a soumis les lettres originales de Jeanne, tant celles qui sont en sa possession que celles qui sont conservées aux archives de Lille et aux archives de Riom.
Je laisse au lecteur le soin de suivre la démonstration si forte exposée dans le présent ouvrage ; il aura le plaisir de reprendre, pied à pied, les voies par lesquelles a passé l’auteur. Ce que je veux dire ici, c’est que l’ingéniosité de la découverte me paraît de nature à éclairer d’un jour entièrement nouveau l’histoire de l’héroïne. Il était, pour ainsi dire, impossible d’admettre moralement que Jeanne se fût menti à elle-même ; aujourd’hui que la preuve matérielle arrive, on ressent comme une plénitude de joie à contempler l’admirable unité d’intelligence et de caractère de la noble enfant.
Ainsi, la main de Jeanne d’Arc, la main qui tenait l’étendard, celle qui tenait l’épée de Fierbois, a écrit ce nom, son nom, au bas de ces lettres ! D’elle, il ne reste plus rien : pas une image, pas une relique. Les Anglais ont brûlé son corps et jeté ses cendres au pont de Rouen ; rien. Ou plutôt une seule chose : ce procès abominable qui condamne les juges et qui la montre si grande. Un procès et un nom. Or, ce nom, le voilà, répété trois fois : Jehanne, Jehanne, Jehanne ; et voici le papier que sa main toucha, que ses yeux regardèrent, où son cerveau s’appliqua : ces témoins surgissent, du fond de l’histoire, pour nous dire qu’elle fut et ce qu’elle fut.
Jeanne d’Arc, en arrivant à Chinon, ne savait, selon sa propre expression, ni A ni B. Dans la hâte de l’entreprise sur Orléans et de la marche sur Reims, elle ne put rien apprendre que les armes et la cour ; et c’est un fait assez extraordinaire que l’aisance avec laquelle cette jeune paysanne des Marches de Lorraine occupe, d’emblée, l’autorité et le rang dus à sa mission.
Mais, dans l’hiver de 1430, comme l’intrigue a brisé son élan et l’attarde aux loisirs douloureux des châteaux de la Loire, elle apprend à signer d’abord et, probablement, à lire et à écrire. De telle sorte quelle peut confirmer, de son propre seing, l’exposé de ses conceptions politiques, — si différentes de celles de Charles VII, — adressé par elle à ses bons amis et chauds partisans les bourgeois de Reims ; de telle sorte que, au procès, elle peut lire de ses yeux et réfuter pied à pied le réquisitoire de ses adversaires érigés en juges ; de telle sorte que, au cimetière de Saint-Ouen, son refus de signer apporte, au tribunal de l’histoire, la plus pathétique des protestations contre les machinations de ses ennemis.
Elle sait signer et elle ne signe pas. Donc elle n’a pas abjuré.
Jeanne est restée fidèle à elle-même. Sur cette figure, il ne reste plus une ombre. L’étonnante vivacité intellectuelle de cette nature toute spontanée, l’unité et la pureté de sa pensée apparaissent dans ses réponses aux juges ; comme elles s’affirment, partout et toujours, dans ses conversations, dans ses réparties, dans ses conseils, dans ses jugements. Partout et toujours, c’est la même verve, la même sérénité, la même promptitude joyeuse, — le trait toujours vivant et toujours vibrant ; partout, et au-dessus de tout, c’est le même bon sens, la même raison, la même clarté. Mais si cet ensemble de faits nous permet d’entendre, en quelque sorte, l’accent de son âme, combien l’émotion sera plus intense si l’on sent que, sur ce papier, qui témoigne pour elle, son haleine et son âme ont passé !
Remercions M. le comte de Maleissye : il doit beaucoup à Jeanne d’Arc, Jeanne d’Arc lui devra quelque chose. Tous ceux qui liront ces pages, tous ceux qui regarderont — grâce à la consciencieuse fidélité de la reproduction de M. Marty — les cinq lettres originales de Jeanne, élargiront le cercle de leurs émotions nobles. Ces jambages tracés, d’abord d’une main hésitante, puis d’une main plus ferme, mais toujours avec une élégance et une grâce charmantes, sont vivants. Ils parlent, ils disent l’intelligence et ils disent l’âme.
Dans une histoire si magnifique et si mystérieuse, pouvait-on espérer une découverte à la fois plus lumineuse et plus émouvante ?
Gabriel Hanotaux.
Les lettres de Jeanne d’Arc et la prétendue abjuration de Saint-Ouen
I. Examen des signatures
Des nombreuses lettres qu’écrivit la Pucelle, cinq seulement nous sont parvenues en original. Si toutes les autres ont disparu dans le naufrage général de ce qui se rattache à Jeanne d’Arc, l’histoire, heureusement, nous a transmis le texte de ces lettres où se peint admirablement l’esprit vif, alerte, de Jeanne ; toutes accusent une personnalité très marquée, un caractère plein d’énergie et de décision.
Des cinq lettres qui nous ont été conservées, trois sont signées, deux ne le sont pas. Elles sont présentées par ordre chronologique, et, pour chacune, nous donnons les fac-similés, non seulement du texte, mais aussi du verso où se trouve la suscription.
1. Lettre de Jeanne au duc de Bourgogne, écrite à Reims le jour du sacre du roi (17 juillet 1429)11
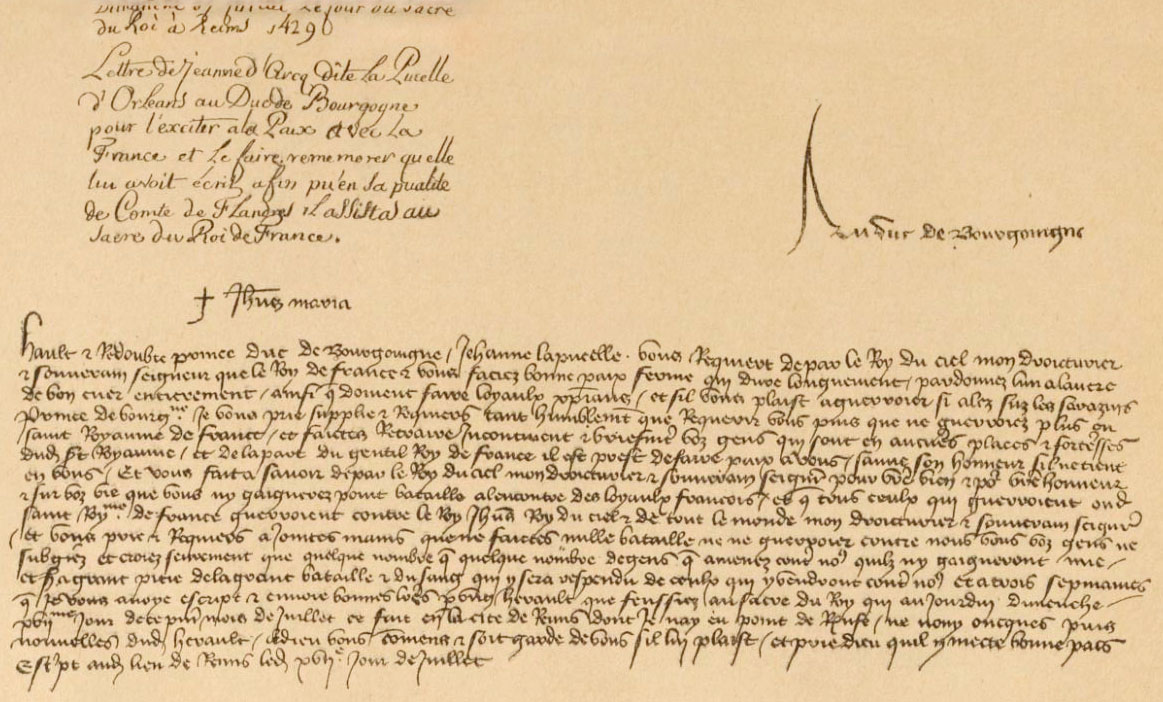
✝ Jhesus Maria12.
Hault et redoubté prince duc de Bourgoigne, Jehanne la pucelle vous requiert de par le Roy du ciel mon droicturier // et souverain seigneur que le Roy de France et vous faciez bonne paix ferme qui dure longuement, pardonnez l’un à l’autre // de bon cuer13 entièrement, ainsi que doivent faire loyaulx christians, et s’il vous plaist à guerroier si alez suz les Sarasins. // Prince de Bourgoingne, je vous prie, supplie et requiers tant humblement que requérir vous puis que ne guerroiez plus ou // saint Royaume de France, et faictez retraire incontinent et briefment voz gens qui sont en aucunes places et forteresses // du dit saint Royaume, et de la part du gentil Roy de France il est prest de faire paix à vous, sauvé son honneur, s’il ne tient // en vous14, et vous fait à savoir de par le Roy du ciel mon droicturier et souverain seigneur pour votre bien et pour votre honneur // et sur voz vie que vous n’y gaignerez point bataille à l’encontre des loyaulx francois, et que tous ceulx qui guerroient ou dit // saint Royaume de France guerroient contre le Roy Jhesus Roy du ciel et de tout le monde mon droicturier et souverain seigneur ; // et vous prie et requiers à jointes mains que ne faictes nulle bataille ne ne guerroies contre nous, vous, voz gens, ni // subgiez15 et croiez seurement16 que quelque nombre17 de gens que amenez contre nous qu’ilz n’y gaigneront mie18 et sera grant pitié de la grant bataille et du sang qui y sera respendu de ceulx qui y vendront19 contre nous et à trois sepmaines // que je vous avoye escript et envoié bonnes lettres par ung hérault que feussiez au sacre du Roy qui aujourd’hui dimenche //, XVIIe jour de ce présent mois de juillet ce fait en la cité de Reims, dont je n’ay eu point de réponse, ne n’ouy oncques20 puis // nouvelles dudit hérault, à dieu vous commens21 et soit garde de vous s’il lui plaist, et prie Dieu qu’il y mette bonne pais. // Escript du dit lieu de Reins le dit XVIIe jour de juillet.
Cette lettre ne porte aucune signature. Elle est écrite sur parchemin.
Sur le verso, on lit comme suscription : Au Duc de Bourgoigne et des annotations historiques de la main d’un des Godefroy, archivistes de père en fils, à Lille, pendant deux siècles.
Cette lettre est admirable de dignité et de jugement politique.
Jeanne y supplie le duc à mains jointes
d’entendre sa requête et son conseil :
Quant au noble roi de France, il est prêt à faire la paix avec vous, sauf son honneur, si vous ne vous y refusez. Et je vous fais savoir de par le Roi du ciel […] que vous n’y gagnerez pas de bataille, etc.
C’était en quelque sorte prédire l’avenir, car les Bourguignons échouèrent devant Compiègne.
Mais à quelles conditions, nous dit M. Hanotaux22, veut-elle la paix avec le duc, cette paix entre Français ?… Un désaccord — non assez remarqué — existe à ce sujet, entre la conception de Jeanne et celle des conseillers de Charles VII. Ici encore la qualité, la rectitude d’esprit de la Pucelle se signale avec une autorité essentielle. Elle considère comme le premier gage des sentiments du duc, s’il veut réellement la paix, l’hommage qu’il doit au chef de la famille et au chef de l’État, en pleine cérémonie du sacre.
Dans sa pensée, il ne s’agit nullement d’une négociation entre deux égaux, mais bien d’une réconciliation de famille qui commence par un acte de soumission du vassal à l’égard du souverain. Or, voilà précisément ce que ne voulait à aucun prix le duc de Bourgogne ; il prétendait, au contraire, dénouer les liens de vassalité qui l’attachaient à la couronne de France ; il visait à l’indépendance ; et c’est ce que les conseillers du roi, en cela si différents de Jeanne, consentaient à lui accorder, pour prix de cette pacification qui était devenue leur unique pensée.
Philippe le Bon se dérobe ; ayant entre les mains les propositions du roi et les lettres de la Pucelle, il se retourne du côté des Anglais.
C’est ainsi qu’à propos de cette lettre M. Hanotaux fait ressortir la haute conception de Jeanne sur la royauté pour sauvegarder l’unité française.
2. Lettre de Jeanne aux habitants de Reims (environs de Paris, 6 août 1429)23
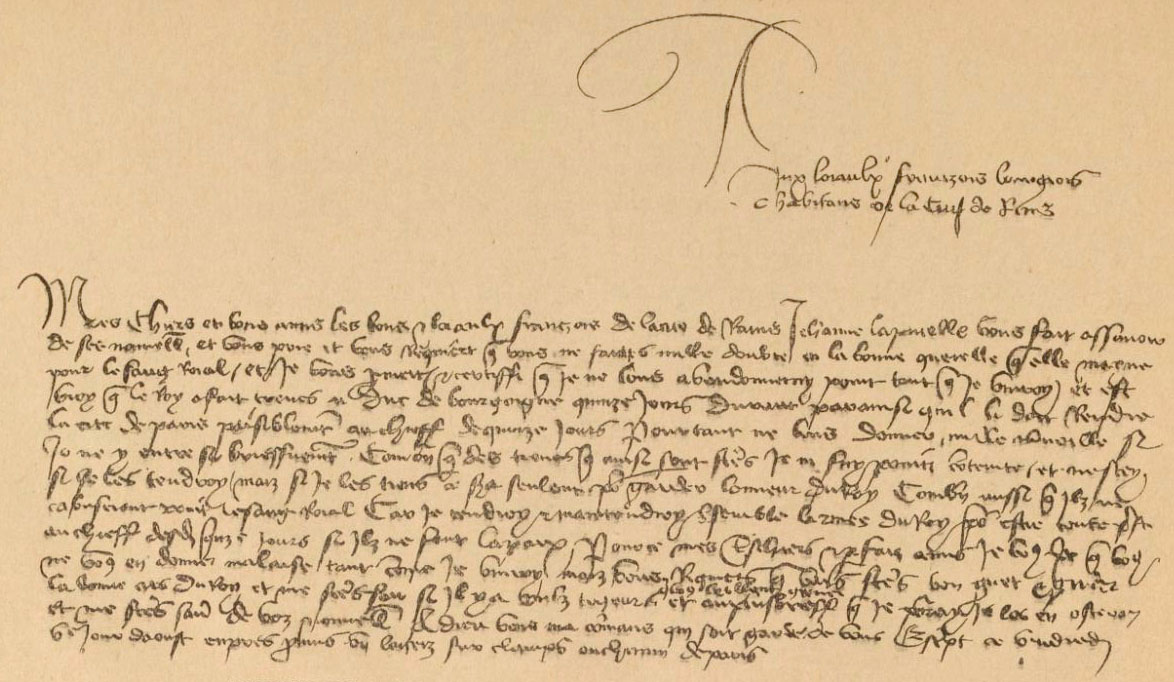
Aux loiaulx franczois bourgeois
habitans en la cité de Rains.
Mes chiers et bons amis les bons et loiaulx franczois de la cité de Rains, Jehanne la pucelle vous fait assavoir // de ses nouvelles et vous prie et vous requiert que vous ne faictes nulle doubte24 en la bonne querelle que elle mayne // pour le sang roial ; et je vous promeit et certiffi que je ne vous abandonneray point tant que je vivroy et est // vroy que le Roy a fait trèves au duc de bourgoigne quinze jours durant par ainsi qu’il li doit rendre // la cité de paris paisiblement au chieff de quinze jours25. Pourtant ne vous donnez nulle mervoille si // je ne y entre si brieffvement ; combien26 que des trèves qui ainsi sont faictes je ne suy point conteinte, et ne scey // si je les tendroy ; maiz si je les tiens ce sera seulement pour garder l’onneur du Roy ; combien aussi que ilz ne // cabuseront point le sang roial27 car je tendroy et maintendroy esemble l’armée du Roy pour estre toute preste au chieff28 des dis quinzes jours si ilz ne font la pais. Pour ce mes très chiers et parfais amis je vous prie que vous //ne vous en donnés malaise29 tant comme je vivroy maiz vous requiers que vous faites bon guet et gardés // la bonne cité du Roy et me faites savoir se il y a nulz triteurs30 qui vous veillent grever31 et au plus brieff que je pourray je les en osteray // et me faites savoir de voz nouvelles. A dieu vous commans qui soit garde de vous. Escript ce vendredi // 6e jour d’aoust enpres provins un logeiz sur champs ou chemin de paris32.
Cette lettre, écrite dix-neuf jours après celle au duc de Bourgogne, ne porte également aucune signature.
La Pucelle commence à ouvrir les yeux : c’est le moment où elle exhale ses premières plaintes à ses amis de Reims qui craignent d’être abandonnés.
Comme le fait observer M. Hanotaux, cette lettre exprime, avec une netteté absolue, l’opinion de Jeanne sur les trêves et sur la politique du roi et de ses conseillers : preuve incomparable, dit-il, du génie divinatoire de Jeanne d’Arc : dans ces circonstances où ses voix ne la guident pas, elle découvre, mieux que les plus fins limiers, la tactique décevante et les avances illusoires du Bourguignon33
.
Du côté de la suscription, on remarque ce qui reste du sceau et la manière dont on avait disposé la cire en forme de croix.
Sous la cire se fixait un ruban qui entourait la lettre en passant par les six petites coupures que l’on voit très distinctement ; le passage du ruban se retrouve sur toutes les lettres.
3. Lettre de Jeanne aux habitants de Riom (Moulins, 9 novembre 1429)34
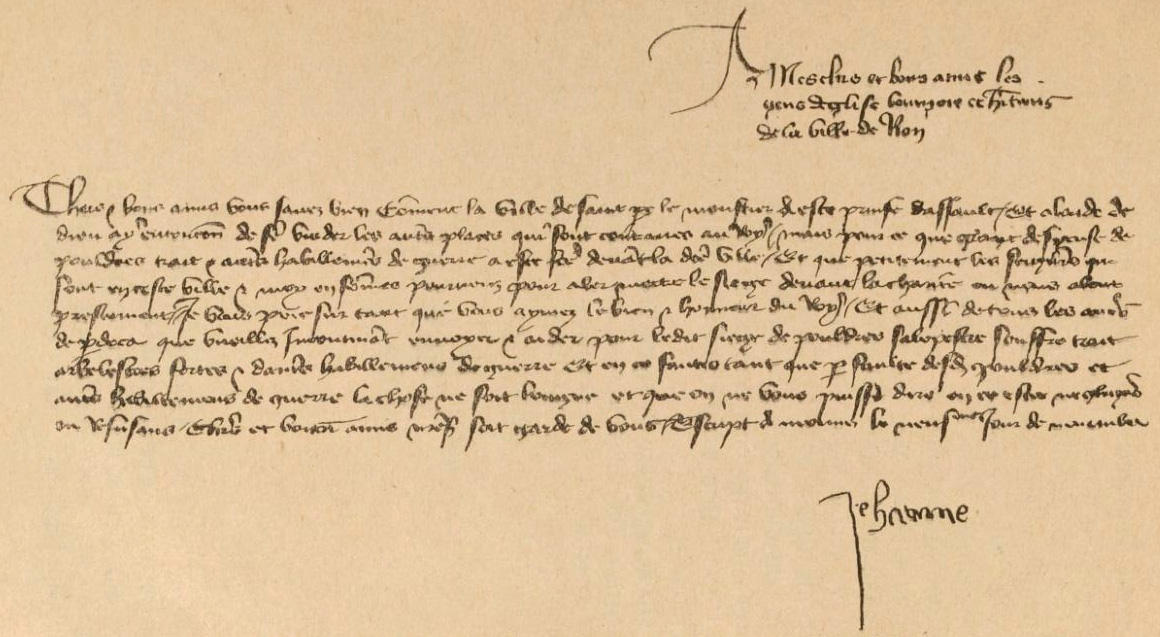
A mes chers et bons amis les gens d’église, bourgeois et habitans de la ville de Riom.
Chers et bons amis vous savez bien comment la ville de saint perre le moustier35 a esté prinse d’assault ; et a l’aide de // Dieu ay entention de faire vuider les autres places qui sont contraires au Roy ; mais pour ce que grant despens de // pouldres, trait et autres habillemens36 de guerre a este faite devant la dite ville, Et que petitement les seigneurs qui // sont en ceste ville et moy en sommes pourveuz pour aler mettre le siège devant la charité ou nous alons // prestement. Je vous prie sur tant37 que vous aymez le bien et honneur du Roy, Et aussi de tous les autres // de par deçà que38 vueillez incontinant envoyer et aider pour le dit sieige de pouldres salepestre souffre trait // arbelestres fortes et d’autres habillemens39 de guerre, Et en ce faictes tant que par faulte des dites pouldres et // autres habillemens40 de guerre la chose ne soit longue, et que on ne vous puisse dire en ce estre negligens // ou refusans, Chers et bons41 amis notre Seigneur soit garde de vous, Escript à Molins le neufme jour de novembre.
Signé : Jehanne.
Elle fut découverte, en 1844, parmi les papiers de l’hôtel de ville, par M. Tailhand, président à la cour royale de Riom.
Voici la description que nous en donne M. le chanoine Cochard42 :
À la lettre de Jeanne adressée aux habitants de Riom (9 novembre 1429) […] est appendu un cachet de cire rouge dont l’avers est détruit. Le revers seul est conservé ; on y voit la marque d’un doigt et le reste d’un cheveu noir43 qui paraît avoir été mis originairement dans la cire. Le docte, mais toujours circonspect M. Quicherat44 n’a pas osé écrire : intentionnellement, quoique ce mot fut dans sa pensée. Il a peut-être craint qu’on ne s’en servît pour en tirer une conclusion trop rigoureuse. Pour le prouver, il est vrai, on objecte une coutume usitée au moyen âge, qui consistait, de la part de celui qui écrivait une lettre, à insérer un de ses cheveux dans la cire encore molle du sceau. Jeanne a-t-elle observé cet usage ? L’a-t-elle fait observer par le clerc qui libellait et scellait ses lettres ? […] À la rigueur, on peut le présumer, mais non l’affirmer.
Le sceau a malheureusement disparu, et depuis cette époque les mesures les plus sévères ont été prises pour assurer la conservation de cette lettre.
La pièce est écrite sur du papier portant un gantelet en filigrane. Elle fut envoyée trois mois après la lettre aux habitants de Reims et porte la signature de la Pucelle.
C’est l’époque des sièges de Saint-Pierre-le-Moûtier et de La Charité. Mal soutenue par le roi et par ses conseillers qui ne voulaient que la paix, Jeanne substitue son action personnelle à l’inertie royale. Elle se montre chef de guerre et s’occupe à réclamer tous les approvisionnements nécessaires. Elle s’adresse à nombre de villes, entre autres à Riom, pour en obtenir des secours. Une missive de Charles d’Albret, lieutenant du roi en Berry, écrite aussi de Moulins le 9 novembre, accompagnait la lettre de Jeanne.
À Clermont, les registres du temps attestent que cette ville a également reçu une lettre de Jehanne la Pucelle et messaige de Dieu
faisant les mêmes demandes.
On remarquera la signature de Jeanne qui est encore d’une main novice, peu exercée.
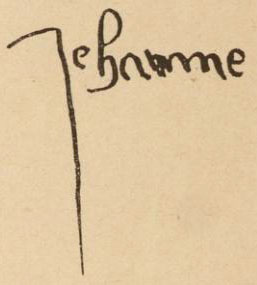
Le premier n
, par suite d’une surcharge, a trois jambages au lieu de deux ; le second jambage du second n
, visiblement tracé à deux reprises, descend trop bas. Les trois premières lettres, au contraire, sont remarquablement fermes, sans liaison entre elles, mais bien formées. On les croirait tracées par un débutant qui s’applique et réussit certains jambages mieux que d’autres.
Tout y indique une main libre et non tenue. Il ne parait donc pas douteux que Jeanne ne savait pas signer, ou du moins hésitait à le faire en juillet et août 1429, ce qui explique que les deux premières missives ne soient pas signées ; tandis que, trois mois après, Jeanne avait appris ou s’était perfectionnée, et, désormais, nous ne trouverons plus aucune lettre sans sa signature.
4. Lettre de Jeanne aux habitants de Reims (Sully, 16 mars 1430)45
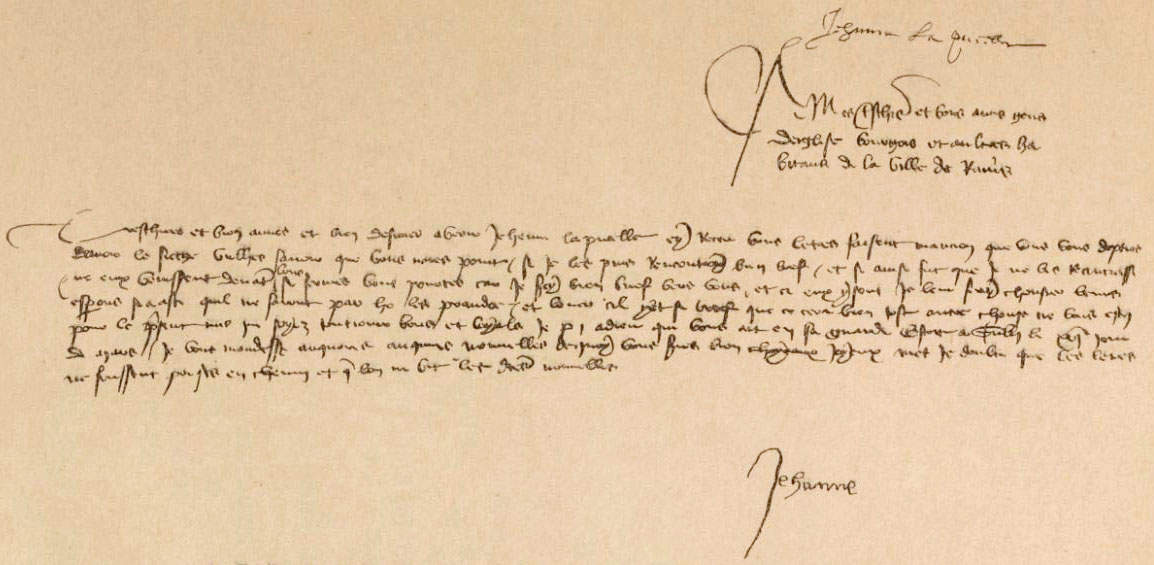
À mes très chers et bons amis gens // d’Eiglise bourgois et aultres ha // bitans de la ville de Rains.
Très chiers et bien aimés et bien desiriés aveoir46, Jehenne la pucelle ey receu vous letres faisent mancion que vous vous dopties47 // davoir le sieige. Vulliés savoir que nous nares point, si je les puis rencontreys bien bref48 et si ainsi fut que je ne les recontrasse // ne eux venissent devant vous, si fermes vous pourtes49 car je serey bien brief50 vers vous, et ce eux y sont je leur ferey chousier51 leurs // espérons si a aste52 quil ne saront par ho les prandre, et lever, cil y et si bref que ce sera bien tost53 autre chouse ne vous escri // pour le présent mes que soyez toutjours bons et loyals je pri a dieu que vous ait en sa guarde Escript a Sully le XVIe jour // de mars. Je vous mandesse anquores auqunes nouvelles de quoy vous fussiez bien joyeux54 mes je doubte que les letres // ne feussent prises en chemin et que Ion ne vit lesdites nouvelles.
Signé : Jehanne.
Cette lettre porte la signature de la Pucelle. On peut y constater les progrès accomplis depuis quatre mois. Jeanne n’a plus d’hésitation pour tracer son nom ; les caractères sont liés ensemble ; c’est maintenant une signature facile et courante.
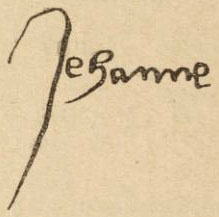
L’hiver s’était passé en vaines négociations. L’expiration des trêves avait été reportée de Noël jusqu’au 15 mars, puis jusqu’au 15 avril. Le duc de Bourgogne réunissait cependant des troupes nombreuses ; aussi les habitants de Reims écrivaient-ils à la Pucelle pour lui dire toutes leurs inquiétudes.
Combien, dans sa réponse, Jeanne se peint elle-même en leur disant :
Je serai bientôt près de vous […] et leur ferai chausser leurs éperons en telle hâte qu’ils ne sauront par où les prendre.
Elle ajoutait :
Je vous manderais encore quelques nouvelles dont vous seriez bien joyeux ; mais je craindrais que les lettres ne fussent prises en chemin et que l’on ne vît les dites nouvelles.
Une conjuration avait été ourdie dans Paris pour livrer la capitale à Charles VII, et c’est à cette bonne nouvelle que Jeanne faisait allusion, conjuration qui fut malheureusement découverte ; six conjurés furent exécutés par les Anglais, le 8 avril 1430, parmi lesquels un procureur au Châtelet et un clerc de la Cour des Comptes. Les détails du complot nous sont fournis par la lettre de rémission accordée à l’un des conjurés55.
Sur la suscription de la lettre de Jeanne aux habitants de Reims, on peut voir, en travers, l’indication Jehanne la Pucelle
. Quicherat y reconnut la main de Jean Rogier, prévôt à l’échevinage de Reims en 1625.
Cette inscription a une très grande importance ; aussi bien pour établir l’authenticité des lettres, que pour fixer le moment où elles quittèrent Reims et passèrent en la possession de Charles du Lys.
Nous voyons, en 1630, Peiresc lui demander d’en prendre copie56 ; ce fut évidemment au moment de remettre les lettres à Charles du Lys que Jean Rogier fit la copie qui existe encore, nous dit Quicherat57, dans les archives de Reims.
La même inscription Jehanne la Pucelle
, et de la main de Jean Rogier, se retrouve sur la lettre du 28 mars 1430, tandis que pour celle du 6 août 1429, non signée, aucune indication n’a été mise. On voit donc l’importance que, dès cette époque, on attachait à la signature et la différence que Rogier faisait entre les trois lettres.
Comme sur les autres suscriptions, le sceau est disposé en croix, aucune empreinte ne se reconnaît sur la cire, et l’on peut se demander si cette forme de croix, adoptée par la Pucelle, ne constituait pas le seul emblème qu’elle acceptât. Nous y verrions l’expression des mêmes sentiments qui avaient empêché Jeanne, ainsi qu’elle nous le dit au procès, de prendre les armoiries données à sa famille ; elle n’était rien par elle-même, elle était seulement l’envoyée de Dieu.
Au milieu du sceau se trouve une petite ligne brisée. Serait-ce l’endroit où était un cheveu de Jeanne d’Arc, comme le veut une tradition58 ?… Tout ce que je puis affirmer, c’est que dès 1867, époque où je me suis livré à un examen très attentif de ces lettres, le sceau était alors intact (sauf la petite ligne brisée), et aucun cheveu ne s’y trouvait. Si nous remontons à des dates plus éloignées, mon père, né en 1804, m’a bien souvent dit n’en avoir jamais vu et que cependant telle était la tradition.
5. Lettre de Jeanne aux habitants de Reims (Sully, 28 mars 1430)59
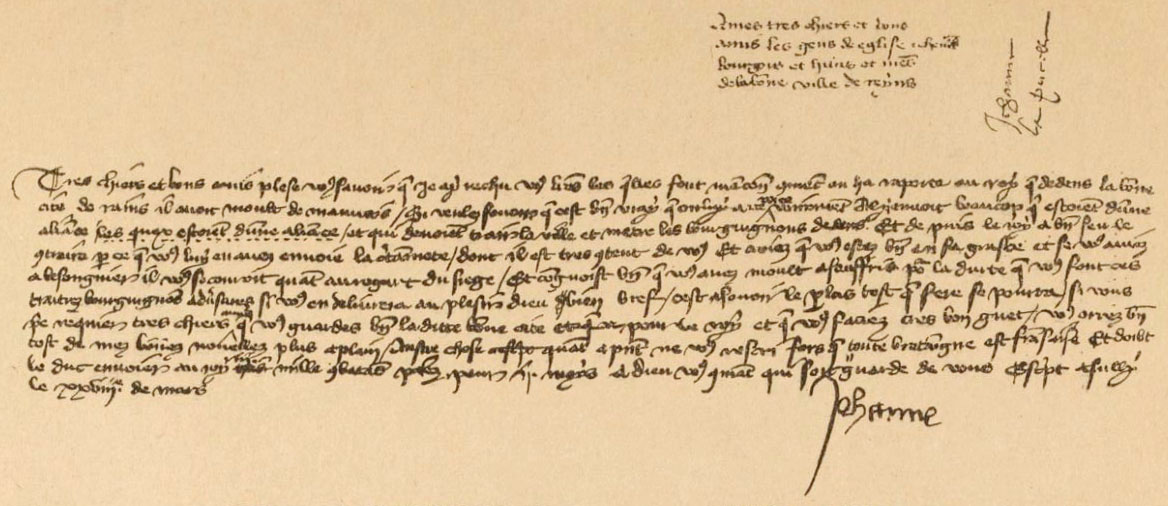
A mes très chiers et // bons amis les gens de église, échevins // bourgeois et habitons et manens60 de la bonne ville de Reyns.
Très chiers et bons amis plese61 vous savoir que je ay rechu62 vos letres lesquelles font mencion comment on ha raporté au roy que dedens la bonne // cité de rains il avoit moult de mauvais. Si veulez savoir que c’est bien vray que on luy a raporté voirement63 qu’il y en voit beaucop qui estoient d’une // aliance64, et qui dévoient trair65 la ville et metre les bourguignons dedens. Et depuis le roy a bien seu le // contraire pour ce que vous luy en avez envoié la certaineté66 dont il est très content de vous. Et croiez que vous estes bien en sa grasce et se67 vous aviez // a besongnier il vous secouroit quant au regart du siège68. Et congnoist bien que vous avez moult a souffrir pour la durté que vous font ces // traitrez bourguignons adversaires, si vous en délivrera ou plesir dieu a bien bref69, cest asavoir le plus tost que fere se pourra, si vous // prie requier très chiers amiz70 que vous guardés bien la ditte bonne cité pour le roy71 et que vous faciez très bon guet, vous orrez bien // tost de mes bonnez nouvellez plus à plain. Austre chose72 quant à présent ne vous rescri fors que toute bretaingne est fransaise. Et doibt // le duc envoier au roy IIII mille73 combatants paiez pour six moys. A dieu vous commant74 qui soit guarde de vous. Escript a Sully // le XXVIIIe de mars.
Signé : Jehanne.
Sur la suscription, la cire du cachet a presque entièrement disparu, et nous appelons encore l’attention sur les mots Jehanne la Pucelle
inscrits par Jean Rogier.
Douze jours seulement s’étaient écoulés depuis que Jeanne avait écrit aux habitants de Reims, et, de nouveau, elle leur envoie une longue lettre de bonne amitié. Elle sait qu’il y a un parti bourguignon qui veut livrer la ville ; aussi cherche-t-elle à confirmer leur fidélité. L’âme de cette conjuration était un certain Labbé, membre du Chapitre, dont les projets furent heureusement déjoués. Pour montrer que le roi aura les troupes nécessaires, elle leur dit que toute la Bretagne est française et que le duc doit envoyer au roi quatre mille combattants payés pour six mois75.
La signature de cette lettre confirme les précédentes observations.
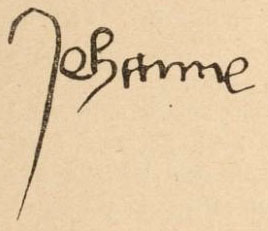
Les caractères très fermes, bien reliés ensemble, indiquent que Jeanne les trace facilement, tantôt plus forts comme à celle-ci, tantôt plus faibles comme à celle du 16 mars, ce qui indique une personne écrivant couramment.
II. Les preuves
Cette question de la signature avait tellement éveillé mon attention que je peux dire avoir, en toute occasion et pendant plus de quarante ans, cherché à l’éclaircir sur le document humain.
L’homme ne change pas, et Jeanne n’a pas eu plus de difficulté pour apprendre à écrire que les illettrés de nos jours. C’est donc avec curiosité que j’ai toujours suivi l’évolution, aussi bien de l’enfant qui commence à écrire que de l’homme fait qui s’applique à mettre sa signature. Nombre de fois j’ai vu de braves gens, complètement illettrés, devenir conseillers municipaux et mettre, alors, leur amour-propre à ne pas être au-dessous de leurs collègues. Très promptement, ils apprenaient à mettre leur signature, et jamais je n’ai vu d’exception. Je constatais seulement qu’aucun n’arrivait à une signature courante ; les caractères restaient tremblants, les jambages non liés, et il leur était à peu près impossible d’écrire d’une manière rectiligne.
Chez Jeanne, grâce à ses lettres, nous suivons cette évolution. Le progrès de ses signatures est là pour en faire foi et convaincre les plus hésitants.
Ces mêmes études sur le document humain m’ont amené à constater qu’une signature, aussi courante que celle du 16 mars, indique quelqu’un qui ne s’est pas simplement borné à vouloir tracer son nom. Les personnes qui ont une écriture aussi déliée savent, toutes, lire et écrire.
Oserais-je le dire pour Jeanne ?… Sans pouvoir la résoudre par l’affirmative, cette question s’impose à notre attention.
Tout concourt donc à établir une opinion très ferme au sujet des signatures de Jeanne d’Arc. Faute d’avoir rapproché les dates, on pouvait croire que, parfois, elle signait et, d’autres fois, négligeait de le faire, sans qu’on pût s’en expliquer le motif. Telles que nous présentons les lettres, par ordre de date, la cause en apparaît bien évidente : le 17 juillet 1429, jour du sacre du roi, lorsque Jeanne écrivait au duc de Bourgogne, elle ne savait pas signer, et 19 jours après, le 6 août 1429, ne le savait pas davantage (première lettre aux habitants de Reims). Trois mois s’écoulent, et, le 9 novembre 1429, nous trouvons dans la lettre de Riom une signature qui est encore peu exercée.
Elle a donc appris pendant cet intervalle, et cela s’explique d’autant plus que les trêves lui ont imposé un repos relatif.
Ce repos, elle l’a employé à s’instruire : elle était adroite, elle était intelligente ; entourée de nombreux clercs pour lesquels l’instruction était chose capitale, n’étaient-ils pas tout indiqués pour lui en donner les premiers éléments ?… Et l’on ne peut supposer que Jeanne n’ait pas cherché à en profiter. Quatre mois passent ; et, le 16 mars 1430, nous nous trouvons en présence d’une écriture tellement facile et courante qu’elle ne peut avoir été tracée que par une main habituée non seulement à signer, mais encore à écrire.
Les armistices avaient été prolongés. Très marrie de ce que le roi n’entreprenait de conquester de ses places sur ses ennemis76
, que pouvait-elle faire de mieux que de s’instruire pour occuper ses loisirs ?…
On la flattait, on l’accablait d’honneurs et de cadeaux à faire fléchir une tête moins haute. C’est le moment où le roi accorde, à la famille de la Pucelle, des lettres de noblesse ; on lui fournit de beaux chevaux, des armes brillantes, des vêtements magnifiques ; — moyens des cours. Si elle s’en amuse, elle ne se laisse pas séduire. Elle bout d’ impatience77.
Nous arrivons à l’instant où Jeanne, se voyant impuissante à entraîner Charles VII, se décide à quitter la cour. Elle part, sans prendre congé du roi. Elle s’éloigne avec quelques fidèles et va se jeter dans Compiègne assiégée. Malgré les armistices, le duc de Bourgogne en avait fait l’investissement. Jeanne voyait ainsi toute son œuvre compromise, car Compiègne était alors le boulevard de la France contre le Bourguignon, comme Orléans l’avait été contre les Anglais. Il fallait qu’elle sauvât Compiègne, comme elle avait sauvé Orléans.
Quelle que fût son humilité, Jeanne n’ignorait pas la puissance de son nom, et combien des lettres, où l’on verrait sa signature, auraient plus d’action, acquerraient plus d’importance vis-à-vis de ceux qui les recevraient ; car l’humilité consiste, non à s’ignorer, mais à rapporter à Dieu tout ce que l’on est.
Besognons, Dieu besognera, disait-elle. Or, ne devait-elle pas s’instruire pour mieux concourir à sa mission divine par une action personnelle ?… Prétendre qu’en plusieurs mois d’application, elle ne serait pas arrivée à un meilleur résultat que de savoir tracer sa signature, ce serait douter de sa merveilleuse intelligence.
Jeanne maniait un destrier comme un parfait cavalier, elle, qui n’avait jamais monté à cheval ; et l’on voudrait que, pour acquérir un peu d’instruction, Dieu ne lui eut pas donné les mêmes secours qu’en toute autre occasion !…
Quant à l’opinion de signatures, obtenues en lui tenant la main, ou d’une première signature, décalquée ensuite : ce sont deux hypothèses qui ne résistent pas au moindre examen, et qui, d’ailleurs, sont entièrement réfutées par la comparaison des lettres.
Nous sommes donc en présence de faits positifs : Jeanne avait appris à signer ; elle était arrivée à le faire facilement, et, probablement, savait lire et écrire78.
III. Affirmations de Jeanne
Pour compléter cet exposé, à qui pouvons-nous mieux nous adresser qu’à Jeanne elle-même ?
Au début de sa mission, Jeanne avait dit à Poitiers : Je ne sais ni A ni B
, et l’on est toujours resté sur cette déclaration. L’examen auquel on avait tenu à la soumettre se prolongeait depuis trois semaines ; la Pucelle en témoignait parfois son impatience. S’adressant un jour à Pierre de Versailles :
— Je crois bien, dit-elle, que vous êtes venu pour m’interroger : je ne sais ni A ni B, mais je viens de la part du roi des cieux pour faire lever le siège d’Orléans et mener le roi à Reims, afin qu’il y soit couronné et sacré.
Et passant de la parole aux actes :
— Avez-vous du papier, de l’encre ? dit-elle à Jean Érault. Écrivez ce que je vous dirai :
Roi d’Angleterre et vous, duc de Bedfort, qui vous dites régent du royaume de France ; vous, Guillaume de la Poule, comte de Suffolk ; Jean, sire de Talbot ; et vous Thomas, sire d’Escale, je vous somme de par le roi des cieux que vous vous en alliez en Angleterre.
La lettre écrite alors (22 mars) ne fut envoyée de Blois qu’un mois plus tard, lorsque, sa mission reconnue, Jeanne eut enfin le droit de la faire parvenir aux Anglais.
Les procès-verbaux des séances de Poitiers ayant malheureusement disparu, c’est par Cousinot, Maître des requêtes, auteur de la Chronique de la Pucelle, que ces détails nous ont été conservés. Pour Rouen, au contraire, le résumé de toutes les séances a été conservé, et quelle que soit la partialité, souvent la mauvaise foi qu’on y trouve, les déclarations qu’on y relève, restent la source où il faut toujours puiser pour mieux connaître Jeanne.
Lorsque, le procès-verbal en mains, on reconstitue toutes les scènes de ces interrogatoires, on ne peut s’empêcher d’éprouver le sentiment du seigneur anglais, à qui l’admiration arracha ce cri :
— Quelle répond bien ! Que n’est-elle Anglaise79 !
Le signe, que Jeanne avait donné au dauphin, était une des questions qui revenaient constamment dans les interrogatoires. Or, c’était le point sur lequel elle avait dit, maintes fois, ne devoir jamais rien révéler. Le mercredi, 2 mai, eut lieu une séance solennelle dans la salle des parements ; le tribunal était entouré de soixante-sept assesseurs. Jean de Châtillon80, docteur en théologie, archidiacre d’Évreux, fut chargé de faire à Jeanne ce qu’ils appelaient une monition charitable81 et de l’interroger, ensuite, sur tous les articles à elle reprochés. C’est donc en cette séance solennelle que Jean de Châtillon lui dit :
— Au sujet du signe remis à votre roi, voulez-vous vous en rapporter à l’archevêque de Reims, au sire de Boussac, à Charles de Bourbon, La Trémoille, La Hire, etc. ?
Et Jeanne de répondre très finement :
— Je veux bien qu’on leur envoie un messager, mais c’est moi qui leur écrirai ce que c’est que ce procès ; autrement, inutile.
Tous les termes de cette réponse sont à peser. Impossible de ne pas y trouver, dans la bouche de Jeanne, la confirmation de ce que ses signatures nous avaient fait supposer : qu’elle avait appris à écrire.
C’est moi qui leur écrirai.
Ce n’est plus comme à Poitiers où, dix-neuf mois auparavant, elle disait à Jean Érault : Écrivez ce que je vous dirai.
Ce moi n’est-il pas la négation de tout recours à un secrétaire, en qui elle n’aurait aucune confiance ; car elle se sait entourée d’hommes résolus à la perdre.
On avait compté sur un refus de sa part, et sa réponse déjoue toutes les manœuvres82. Cependant ni les juges ni les soixante-sept assesseurs ne relèvent cette déclaration. Leur silence est un acquiescement, et indique bien que personne n’ignorait qu’elle pût écrire, comme elle se disait décidée à le faire.
Si on se reporte à la séance du samedi 24 février, Jeanne avait déjà donné une affirmation non moins positive. À diverses questions qui lui étaient posées, elle avait répondu ne pouvoir rien dire sans en avoir obtenu la permission de ses Voix ; et, à une dernière question de Jean Beaupère, elle ajoutait :
— Je ne suis pas tenue de vous répondre à ce sujet. Je demande que l’on me donne, par écrit, les points sur lesquels je ne réponds pas en ce moment83.
Elle seule pourra lire et relire cet écrit, en demandant à ses Voix de l’inspirer ; car, abandonnée dans sa prison, à qui pourrait-elle avoir recours ?… Peut-on demander une preuve plus péremptoire que Jeanne savait lire ?
Un autre témoignage nous en est encore apporté par les réponses de Jeanne, à la séance du 1er mars. Le comte d’Armagnac, qui avait été excommunié par le pape Martin V, comme un des plus fougueux partisans de Benoît XIII et de Clément VIII, songeait à rentrer dans le sein de l’Église. Dans ces conjonctures, il écrivit à la Pucelle. La lettre parvint à Jeanne le 22 août 1429, au moment où elle s’apprêtait à quitter Compiègne pour marcher sur Paris. Compiègne venait de faire sa soumission, le roi s’y était rendu et paraissait s’y oublier. C’est là, en effet, qu’il décida la trêve désastreuse où il se laissait berner par le duc de Bourgogne. Jeanne appelle alors le duc d’Alençon et lui dit :
— Mon beau duc, faites apprêter vos gens et ceux des autres capitaines… par mons. Martin, je veux aller voir Paris de plus près que je ne l’ai vu.
Or, à la séance du 1er mars, on lui posa les questions suivantes :
— Que dites-vous de notre seigneur le pape, et quel est celui que vous croyez être le vrai Pape ?
Jeanne. — Est-ce qu’il y en a deux ?
L’assesseur. — N’avez-vous pas reçu des lettres du comte d’Armagnac, qui voulait savoir auquel des trois papes il devait obéir ?
Jeanne. — Le comte, en effet, m’a écrit certaine lettre à ce sujet ; dans ma réponse, je lui disais que quand je serais à Paris, ou de loisir en tout autre lieu, je lui ferais réponse ; je me disposais à monter à cheval quand je lui fis cette réponse.
On lut à l’accusée la lettre du comte d’Armagnac et la réponse donnée, et, après la lecture, il fut dit à Jeanne :
— Avez-vous écrit la réponse dont la copie vient de vous être lue84 ?
Jeanne. — Je pense avoir fait en partie cette réponse, mais pas dans son entier.
L’assesseur. — Avez-vous dit que vous sauriez, par le Conseil du Roi des rois, ce que ledit comte devait tenir sur ce point ?
Jeanne. — Je ne sais rien sur cela.
L’assesseur. — Est-ce que vous vous doutiez à qui devait obéir le comte susdit ?
Jeanne. — Pour ce qui est de moi, je tiens et je crois que nous devons obéir au pape qui est à Rome…
L’assesseur. — Pourquoi donc, puisque vous croyez au pape qui est à Rome, écriviez-vous au comte que vous lui donneriez conseil ailleurs ?
Jeanne. — La réponse donnée par moi portait sur une autre matière que sur le fait des trois papes.
L’assesseur. — Est-ce sur le fait des trois papes que vous disiez que vous auriez conseil ?
Jeanne. — Je n’ai jamais écrit, ni fait écrire, sur le compte des trois papes. J’affirme sous la foi du serment que jamais je n’ai écrit, ni fait écrire, à ce sujet.
L’accusateur d’Estivet étaya sur cet incident les articles 27, 28, 29 et 30 de son réquisitoire. Jeanne avait vu le péril, et sentant sur quel terrain dangereux on voulait l’engager, ce fut par deux affirmations, faites sous la foi du serment, qu’elle déclara : Je n’ai jamais écrit, ni fait écrire, à ce sujet.
Cette déclaration solennelle de Jeanne nous apporte, sur le point qui nous occupe, une lumière que l’on ne saurait demander plus éclatante, car Jeanne y précise, sans ambiguïté, que si elle faisait écrire des lettres, il lui arrivait aussi d’en écrire elle-même.
Savoir écrire implique nécessairement de savoir lire ; mais, pour écrire facilement, il faut un exercice constant que la vie active de Jeanne ne put, évidemment, lui permettre. Il n’en est pas de même pour la lecture, et Jeanne devait s’y appliquer, d’autant plus qu’elle tenait à vérifier ce qu’elle dictait. Les ratures et mots ajoutés, qu’on remarque dans ses lettres, le prouvent surabondamment.
À cet égard, nous ne saurions trop fixer l’attention sur les lettres du 16 et du 28 mars 1430, où les corrections faites immédiatement dans le texte prouvent que Jeanne lisait à mesure qu’écrivait son scribe, tandis que dans les lettres précédentes, non signées, les corrections sont en surcharge85.
IV. Signes sur les lettres
En constatant dans les interrogatoires combien tout ce qui regarde les lettres de Jeanne fut l’objet de minutieuses recherches, et quelle place elles y occupèrent, ne devons-nous pas y attacher la même importance et, par les réponses de la Pucelle, nous éclairer à leur sujet ?
Le 22 février, séance dans laquelle l’accusée donnait un bref sommaire de sa vie ; Jeanne disait :
— J’envoyai aux Anglais, qui étaient devant Orléans, une lettre dans laquelle je leur intimais de se retirer. C’est celle qui m’a été lue, dans cette ville de Rouen, excepté deux ou trois mots, qui ne sont pas dans l’original. Ainsi, on voit dans la copie : Rendez à la Pucelle
, on doit écrire : Rendez au roi
; on y lit : corps pour corps
, et chef de guerre
; ce qui ne se trouve pas dans les lettres expédiées86.
Nous avons déjà parlé de cette lettre dictée à Poitiers à Jean Érault.
D’après les réponses de Jeanne, cette missive, qui blessait si profondément les Anglais, lui fut lue à Rouen au moins trois fois ; et, chaque fois, elle protesta contre trois mots seulement, en avouant tout le reste.
L’avoir écrite, c’était, d’après d’Estivet, présomption et témérité.
Jeanne répondit :
— Quant à la lettre, je ne l’ai point faite par orgueil ou par présomption, mais par le commandement de Notre-Seigneur ; je confesse bien le contenu de cette lettre, excepté trois mots. Si les Anglais eussent cru ma lettre, ils n’eussent fait (été) que sages ; avant qu’il soit sept ans, ils s’apercevront de ce que je leur écrivais, je m’en rapporte sur cela à la réponse déjà faite. […] Pour ce qui est d’être chef de guerre, j’en ai autrefois répondu ; et si j’étais chef de guerre, c’était pour battre les Anglais87.
Vision extraordinaire de l’avenir !… Elle est dans les fers, à la merci des Anglais : et par cette prophétie qui, avant sept ans, fut en effet réalisée, Dieu manifeste, une fois de plus, aux yeux des plus incrédules, la mission qu’il avait confiée à la Pucelle.
On l’interroge sur tous les détails de ses lettres :
— À quoi servaient le signe, que vous mettiez sur vos lettres, et ces mots Jhesus-Maria
? lui était-il demandé le samedi 17 mars (deuxième séance dans l’après-midi).
Jeanne. — Les clercs qui écrivaient mes lettres l’y mettaient, et quelques-uns me disaient qu’il était convenable que je misse ces deux mots : Jhesus-Maria
.
À la séance du 1er mars, cette même question lui avait été posée :
— N’aviez-vous pas coutume d’écrire dans vos lettres ces mots : Jhesus-Maria
avec une croix ?
Jeanne. — Je les mettais quelquefois et quelquefois je ne les mettais pas…
Sur les lettres, dont nous donnons le fac-similé, on n’en verra qu’une seule, celle au duc de Bourgogne, portant comme en-tête une croix et Jhesus-Maria
. La lettre aux Anglais, écrite de Poitiers, portait également les mots Jhesus-Maria
, précédés et suivis d’une croix ; de même celle aux habitants de Tournay, écrite le lendemain de la miraculeuse victoire de Patay. Cette ville, extrêmement française, méritait de la Pucelle une attention particulière, aussi invite-t-elle les habitants à venir au sacre.
À cette époque, ces signes paraissaient être d’un usage fréquent, car la lettre de Jacques de Bourbon, retrouvée dernièrement à Vienne (Autriche) et rendant compte du sacre de Charles VII, débutait de la même manière : Jhesus ✝ Maria
.
D’après la réponse de Jeanne, nous voyons que les mots Jhesus-Maria
et la croix, qui se trouvent en tête de quelques lettres, n’étaient pas mis sur son ordre, mais étaient plutôt l’œuvre de ses secrétaires. De plus, on ne saurait trop faire remarquer que, lorsque Jeanne employait ces signes, c’était toujours comme en-tête.
Nulle part, on ne les trouve sous forme de signature. Toutes ses paroles, toutes les pièces qui nous sont parvenues établissent, en effet, que jamais la Pucelle ne se servit d’une croix comme signature, même à l’époque où elle ne savait pas écrire ; aussi ne peut-on comprendre comment de nombreux historiens ont pu dire qu’une croix fut sa signature habituelle.
Jeanne y oppose au contraire un démenti absolu. N’a-t-elle pas dit à la séance du 1er mars :
— Quelquefois, je mettais une croix, comme un signe à celui de mon parti à qui j’écrivais de ne pas faire ce que je lui écrivais.
Cette déclaration de Jeanne fut considérée comme ayant une telle gravité qu’elle devint un des motifs invoqués pour sa condamnation. Dans les douze articles envoyés à l’Université de Paris, et qui sont le résumé du procès, l’article 6 est entièrement consacré à cette question : Ladite femme avoue avoir fait écrire de nombreuses lettres […] elle mettait parfois une croix et c’était une marque qu’il ne fallait pas exécuter ce qu’elle ordonnait88.
Du moment que Jeanne prit le parti de se servir d’une croix comme désaveu, il paraît certain qu’elle empêcha ses clercs de mettre ce signe, même comme en-tête, afin d’éviter toute confusion. La preuve nous en est donnée par l’absence de croix, sur les quatre dernières lettres que nous reproduisons et qui se rapportent à des époques de combats.
On doit conclure de cette déclaration, faite au procès, qu’elle s’arrangeait pour faire tomber certaines lettres entre les mains des Anglais, afin de les induire en erreur sur ses projets, et qu’à ces lettres seulement, elle mettait une croix comme signature.
Peut-on faire un reproche à Jeanne d’avoir eu recours à ce stratagème ? Personne ne contestera l’autorité du savant P. Ayroles qui nous dit à ce sujet :
Lorsqu’elle avouait qu’une croix, apposée dans ses lettres, signifiait qu’il ne fallait tenir nul compte de ce qu’elle exposait, cela pouvait être une ruse de guerre fort permise, ou même une manière de se débarrasser d’importuns, sollicitant des recommandations89.
Il résulte de toutes ces déclarations de Jeanne que jamais elle n’a employé une croix comme signature, mais que parfois elle en mettait une, à titre de ruse de guerre, comme désaveu de ce que comportait sa lettre.
Ce point bien établi, n’est-il pas évident qu’elle se servit du même stratagème le jour de la scène de Saint-Ouen, où elle mit une croix au bas de la cédule qui lui était présentée ?…
Alors, s’explique parfaitement le sourire qui éclaira sa physionomie et dont, à ce moment tragique, furent frappés tous les assistants. Jeanne refusait de céder et de faire aucune abjuration. Si insignifiante que lui parût la cédule, elle prit encore la précaution d’y refuser sa signature, en ne traçant qu’une croix ; ce que, dans le procès, elle avait elle-même et hautement déclaré n’être qu’une ruse de guerre et un désaveu. Par l’article 6, les Anglais l’avaient eux-mêmes reconnu.
Quelle audace ne fallut-il pas à Jeanne pour venir apposer ce même signe à la face de ses juges !…
Telle qu’elle était aux Tourelles, montant la première à l’assaut et brandissant son étendard, Jeanne va au-devant du danger, et, à cet acte, ne craint pas d’ajouter par son rire l’ironie et le dédain. Jamais Jeanne n’a été plus sublime que dans ce drame du cimetière de Saint-Ouen et il a fallu des mensonges, accumulés au delà de l’invraisemblable, pour transformer en un jour de déshonneur le jour où elle a montré le plus de courage, de fermeté et de mépris de la mort.
C’est ce que nous allons démontrer dans le chapitre suivant, en examinant tous les témoignages qui se rapportent à la scène du cimetière de Saint-Ouen.
V. Les motifs secrets
La scène du cimetière de Saint-Ouen n’avait, on peut le dire, de raison d’être que parce que Jeanne savait signer.
Cette scène fut préparée, organisée par Cauchon pour obtenir une signature, qu’il voulait à tout prix, dût-on l’extorquer par terreur ou par force ; et si Jeanne, toujours fidèle à elle-même, faisait échouer ce dessein, Cauchon n’en était pas moins résolu à prétendre qu’elle avait cédé. Pour arriver à ce but, ni le mensonge ni la substitution des pièces ne devaient l’arrêter.
À tous les efforts de ses adversaires, Jeanne avait jusqu’à ce jour opposé une fermeté admirable, sans jamais rien rétracter de sa mission : depuis un an qu’elle était prisonnière, et depuis trois mois que se déroulait le procès, les enquêtes tournaient à sa gloire, et les interrogatoires à la confusion de ses juges.
Bedford, Warwick, s’impatientaient de ces lenteurs, car une crainte superstitieuse continuait à planer sur leurs soldats. Pour leur rendre courage, il fallait que Jeanne ne restât pas l’héroïne sans tache, l’envoyée de Dieu. Une signature surprise, fût-ce de force ou par ruse, c’était Jeanne elle-même qui désavouait sa mission divine et tombait, alors, au rang d’une aventurière ; c’était son prestige détruit et la confiance rendue aux soldats anglais. La déshonorer était plus nécessaire que de la faire périr. De là, un intérêt capital à dénaturer la scène du cimetière de Saint-Ouen.
Par la maladie, Jeanne avait déjà failli leur échapper ; et nous voyons à cet instant Cauchon, escorté de sept assesseurs, vouloir profiter des plus saints désirs de la prisonnière pour l’amener à une rétractation. Mourante, elle ne recevrait son Dieu que si elle se rétractait !…
En face de la mort, Jeanne, privée de tous les secours de la religion, répond encore :
— Quelque chose qu’il m’en doive advenir, je n’en ferai ou dirai autre chose que ce que j’ai dit au procès.
Quels moyens, cependant, n’avait-on pas employés ? Au médecin, Jean Tiphaine, qui lui demande la cause de son mal, Jeanne répond simplement :
— L’évêque de Beauvais m’a envoyé une carpe ; j’attribue ma rechute à ce que j’ai mangé de ce poisson.
D’où venait cette attention subite de son plus mortel ennemi, qui provoque d’elle cette parole :
— Il me semble, vu le mal que j ‘ai, que je suis en grand danger de mort…
Et c’est précisément le moment où Cauchon se présente, avec ses affidés, pour inquiéter son âme et obtenir d’elle une soumission. À peine remise, les interrogatoires furent repris. Jeanne restait toujours inébranlable et savait déjouer les projets de ses juges, comme nous l’avons vu à la séance du 2 mai, lorsqu’elle leur déclarait que ce serait elle-même qui écrirait et dirait ce qu’était le procès.
Les ordres des Anglais devenaient de plus en plus pressants ; il fallait en finir. Le 24 mai, Jeanne fut donc amenée au cimetière de Saint-Ouen ; deux estrades y avaient été dressées : l’une, de peu d’importance, où se trouvaient, à côté de Jeanne, le prédicateur Guillaume Érard, l’huissier Massieu, les deux greffiers Manchon et Guillaume Colles (dit Boisguillaume) ; l’autre estrade, beaucoup plus grande et très richement ornée, où prirent place le cardinal de Winchester, grand oncle du roi d’Angleterre, Louis de Luxembourg, évêque de Thérouanne, chancelier de France pour Henri VI, Jean de Mailly, évêque de Noyon, pair de France, membre du Conseil privé du roi d’Angleterre90, William Alnwick, évêque de Norwich, garde du sceau privé du roi d’Angleterre ; Cauchon, évêque de Beauvais91, les abbés de Fécamp, de Saint-Ouen, de Jumièges, du Bec, de Cormeilles, de Mortemer, de Préaux et Robert Jolivet, abbé du Mont-Saint-Michel, qui avait voulu livrer sa forteresse aux Anglais ; puis, venaient les prieurs de Longueville et de Saint-Lô, 28 maîtres et docteurs en théologie, enfin les secrétaires et clercs de tous ces personnages.
Pourquoi cette séance, en plein air, avec tout un appareil qu’on ne vit jamais dans aucun procès criminel ou religieux ? On appelait, en quelque sorte, le peuple entier à venir assister à la déchéance de Jeanne. Il ne s’agissait pas de l’exécution, l’heure n’était pas encore venue… Plus tard on dressera le bûcher !
L’arrivée du bourreau, avec son char, n’était que la mise en scène, l’apparition sensationnelle qui devait, pour les contemporains et devant l’histoire, expliquer comment Jeanne avait pu subitement se contredire et ne plus être elle-même.
Si, armé de critique historique, on étudie cette heure sombre du cimetière de Saint-Ouen, la vérité ne tarde pas à apparaître. En cherchant l’explication de tous les actes de Cauchon, on découvre la trame bien ourdie qui doit donner une apparence de réalité à une abjuration supposée. Plus Cauchon sentait l’odieux du crime qu’il allait commettre, plus il mit d’artifice à le réaliser. Le peuple accouru, les hauts personnages convoqués, n’étaient là que pour couvrir de leur présence et de l’autorité de leurs noms la fourberie sacrilège qui se préparait.
Toute cette scène du cimetière de Saint-Ouen n’avait d’autre but, comme nous l’avons déjà dit, que d’obtenir de Jeanne sa signature. Les cédules avaient été préparées d’avance, les rôles assignés à chacun. Guillaume Érard et Laurent Calot étaient les deux complices que Cauchon avait désignés pour arriver à ce dénouement.
À mesure que le drame se déroule, un seul mot retentit autour de Jeanne : Signez, signez.
Il lui est dit par ses ennemis, qui veulent la déshonorer ; et, dans la foule accourue, il lui est répété par des amis, qui croient la sauver du bûcher.
Indifférente à tous ces appels et n’entendant que ses Voix, Jeanne n’a pas signé. Alors, les deux principaux affidés de Cauchon, chargés de lui arracher par force ou par ruse sa signature, se trouvent dans la nécessité, pour expliquer leur déconvenue, de chercher à faire croire qu’elle aurait dit ne pas savoir signer. L’histoire se trouvait ainsi écrite comme le voulait Cauchon. Mais, grâce à la lumière nouvelle que nous apportent les lettres de Jeanne, la fourberie se découvre, le mensonge devient évident.
VI. Examen des témoignages
Deux témoignages apportés au procès de réhabilitation : celui d’Aymond de Macy et celui de l’huissier Massieu, ont contribué à répandre la légende que Jeanne ne savait pas signer. Il nous faut donc les examiner d’une manière toute particulière.
Aymond, seigneur de Macy, était un gentilhomme au service du comte de Ligny, Jean de Luxembourg. Il avait connu Jeanne, lorsqu’elle avait été amenée prisonnière au château de Beaurevoir, l’avait revue à la forteresse du Crotoy, puis à Rouen.
Voici d’ailleurs le procès-verbal de sa déposition, lors de l’enquête de 1456 :
Sire Aymond, seigneur de Macy, chevalier, âgé de cinquante-six ans environ, a été présenté et admis comme témoin, et a été interrogé par nous, archevêque susdit (de Reims)92, en présence de frère Thomas Verel (Dominicain sous-inquisiteur), l’année et le jour susdits (7 mai 1456). Interrogé, il a répondu, sous la foi du serment, de la manière suivante :
Jeanne fut ensuite conduite dans le château de Rouen et renfermée dans une prison du côté des champs (versus campos). Pendant qu’elle était détenue dans cette même prison, le seigneur comte de Ligny vint à Rouen ; et moi, qui vous parle, j’étais en sa compagnie. Un jour, le comte de Ligny voulut voir Jeanne, il vint vers elle en compagnie des seigneurs comtes de Warwick et de Stafford ; son frère, le chancelier d’Angleterre (de la France anglaise) alors évêque de Thérouanne, était présent, je l’étais aussi. Le comte de Ligny l’aborda par ces paroles :
— Jeanne, je suis venu ici pour vous mettre à rançon, à condition que vous promettrez de ne jamais vous armer contre nous.
Elle répondit : — En nom dé, vous vous moquez de moi, car je sais bien que vous n’en avez ni le vouloir ni le pouvoir.
Elle répéta plusieurs fois ces paroles, parce que le seigneur comte persistait dans son dire, et elle ajouta :
— Je sais bien que ces Anglais me feront mourir, dans la créance qu’après ma mort ils gagneront le royaume de France, mais quand ils seraient cent mille godons de plus qu’ils ne sont maintenant, ils n’auront pas le royaume.
Ces paroles indignèrent le comte de Stafford, qui tira sa dague à moitié pour la frapper, mais le comte de Warwick l’en empêcha.
À quelque temps de là, pendant que j’étais encore à Rouen, Jeanne fut conduite sur la place qui est devant Saint-Ouen. Là, fut faite une prédication par Nicolas Midi (erreur, c’était Guillaume Érard). Entre autres choses, je l’ai entendu dire :
— Jeanne, nous avons la plus grande pitié de vous ; il faut que vous rétractiez ce que vous avez dit, ou que nous vous abandonnions à la justice séculière.
Jeanne répondit qu’elle n’avait fait aucun mal ; qu’elle croyait les douze articles de la foi et les dix commandements de Dieu ; elle ajoutait qu’elle s’en rapportait à la cour de Rome, et qu’elle voulait croire tout ce que croyait la Sainte Église.
Malgré toutes ces paroles, on la pressait fortement de se rétracter. Elle répondait :
— Vous vous donnez beaucoup de peine pour me séduire.
Pour éviter le péril, elle dit qu’elle était contente de faire tout ce qu’on voudrait.
Alors un secrétaire du roi d’Angleterre, là présent, son nom était Laurent Calot, tira de sa manche une petite feuille écrite et la donna à Jeanne pour qu’elle la signât ; Jeanne répondait qu’elle ne savait ni lire ni signer. Nonobstant cette réponse, le secrétaire Laurent Calot lui présentait la feuille et la plume pour qu’elle signât ; et Jeanne, en se moquant, fit un rond. Laurent Calot prit alors la main de Jeanne avec la plume et lui fit faire un signe dont je n’ai pas souvenance.
Je crois Jeanne en paradis93.
Autant Aymond de Macy est précis dans la scène de la prison, autant il est incomplet pour ce qui se rapporte à Saint-Ouen. Il se trompe sur le nom du prédicateur, il omet beaucoup de détails et n’a pu entendre les paroles qu’il rapporte, puisqu’il n’était pas sur l’estrade auprès de Jeanne. C’est cependant par lui que nous connaissons le nom du personnage qui prit la main de Jeanne pour la forcer à signer.
Manchon dit : un Anglais
; l’évêque de Noyon un secrétaire du roi
; seul Macy le désigne par son nom : Laurent Calot.
Il faut, d’ailleurs, expliquer comment Laurent Calot put s’approcher de Jeanne, car il n’y avait aucun titre. C’est au moment du tumulte, sur un signe fait évidemment par Cauchon, que Calot exécute la mission qui lui était confiée ; il monte précipitamment sur l’estrade et veut forcer Jeanne à signer. Par dérision, elle fait un rond, disent les témoins.
Calot s’empare alors de sa main. Ce seul acte indique qu’il n’ignorait nullement que Jeanne savait signer, puisqu’il voulait de force lui faire tracer son nom.
Il y a tout lieu de croire que la pièce apportée par Calot était l’abjuration dont, plus tard, se servit Cauchon pour la faire condamner comme relapse, pièce que ne virent jamais ni les juges ni les greffiers, et dont on trouve seulement une copie, jointe au procès, sur laquelle fut inscrit : Jehanne ✝
; mais jamais on ne connut l’original.
Aucun des témoins les plus rapprochés ne relate les soi-disant paroles de Jeanne : Je ne sais ni lire ni signer.
Ni Manchon, le principal greffier, ni Guillaume Colles, ni Massieu, tous trois sur l’estrade, près de Jeanne, ne les ont entendues. Sur les trente-cinq témoins appelés au procès de réhabilitation, Aymond de Macy est le seul à rapporter ces paroles. Tout fait ressortir qu’il n’est que l’écho d’un mensonge habilement répandu par Laurent Calot, sur l’ordre de Cauchon.
Le second témoignage dont il faut nous occuper est celui de Massieu. Jean Massieu nous dit que, chargé par Érard d’expliquer à Jeanne la cédule, elle lui aurait répondu :
— Je ne sais pas signer93.
À peine quelques instants s’écoulent, le même Massieu prétend que Jeanne lui aurait dit :
— J’aime mieux signer que d’être brûlée94.
Les deux déclarations se contredisent. Si Jeanne lui a déclaré ne pas savoir signer, elle ne peut presque au même moment lui dire : J’aime mieux signer que d’être brûlée.
L’une ou l’autre est fausse, ne fût-ce que par leur contradiction ; bien plus, nous allons voir que toutes deux sont contraires à la vérité.
Qui donc était ce Massieu ?
Un homme d’une inconduite notoire95, à tel point qu’à une époque où l’on n’était guère sévère pour la moralité, même à l’égard des prêtres, le scandale de sa vie était si grand qu’il fut relevé de son titre de doyen de la chrétienté ; à plusieurs reprises, le chapitre ou l’officialité durent lui adresser des admonestations sur ses mœurs scandaleuses. Lors de la première enquête de 1450, Massieu était alors curé de la paroisse Saint-Candé-le-Vieux, à Rouen, il se dit âgé de cinquante ans ; appelé de nouveau en 1452, il se donne cinquante-cinq ans, et en 1456, à sa troisième déposition, il n’a plus que cinquante ans. À l’époque du procès, c’était donc un homme de trente-trois ans environ. Choisi par Cauchon comme huissier ou appariteur, il ne pouvait que lui être entièrement dévoué. Il avait la charge d’amener Jeanne devant ses juges et de la reconduire dans son cachot.
D’après ses dépositions, Massieu cherche à faire croire qu’il aurait témoigné à Jeanne une certaine bienveillance, au point de se compromettre vis-à-vis de l’évêque de Beauvais. Il voudrait disposer, par là, ses auditeurs à ajouter foi à ce qu’il rapporte. Il n’était en réalité, au cimetière de Saint-Ouen, que le porte-paroles d’Érard et de Cauchon.
Voici d’ailleurs ce qu’il dit de son rôle :
À la première prédication, j’étais sur l’estrade avec Jeanne. […] Érard, à la fin du prêchement, lut une cédule contenant les articles de quoi il la causait de abjurer et révoquer. À quoi ladite Jeanne lui répondit qu’elle n’entendait point ce que c’était qu’abjurer, et que sur ce elle demandait conseil. Et alors, fut dit par Érard, à celui qui parle qu’il la conseillât sur cela96. […] Le prédicateur, maître Guillaume Érard, me demanda ce que je lui disais :
— Je lui lis la formule et lui dis de la signer, et elle me répond qu’elle ne sait pas signer97.
Je me rappelle bien que dans cette cédule il était spécifié que, désormais, elle ne porterait ni armes, ni habit d’homme, ni cheveux taillés, et beaucoup d’autres choses que j’ai oubliées. Je sais bien que cette cédule contenait huit lignes environ, et pas davantage. Je sais, à n’en pas douter, que ce n’est pas celle qui est mentionnée au procès. Différente de celle qui est au procès est celle que j’ai lue et que Jeanne a signée.
Pendant que l’on requérait Jeanne de signer ladite cédule, un grand murmure se produisit dans l’Assemblée. J’entendis l’évêque dire à quelqu’un :
— Vous me ferez réparation.
Il disait qu’on lui avait fait injure et qu’il ne procéderait plus outre avant cette réparation. Pendant ce temps, j’avisais Jeanne du péril qui la menaçait à propos de la signature de ladite cédule ; je voyais bien qu’elle ne comprenait ni la cédule ni le péril. Jeanne, pressée de signer, répondit :
— Que la cédule soit examinée par les clercs et l’Église entre les mains desquels je dois être remise, et s’ils me disent qu’il est de mon devoir de la signer et de faire ce que l’on me dit, je le ferai volontiers.
Maître Guillaume Érard lui dit alors :
— Signe maintenant, sans quoi, aujourd’hui même, tu finiras tes jours par le feu.
Jeanne répondit qu’elle aimait mieux signer que d’être brûlée.
Il y eut en ce moment un grand tumulte dans la multitude, beaucoup de pierres furent jetées, je ne sais par qui.
La cédule signée, Jeanne demanda au promoteur si elle ne serait pas mise dans les mains de l’Église, et dans quel lieu elle devait être ramenée. Le promoteur répondit :
— Dans le château de Rouen. Elle y fut conduite et vêtue d’habits de femme98.
La mentalité qui nous a été révélée chez Massieu permet-elle d’accepter, sans contrôle ni vérification, tout ce qu’il avance ?… Voyons donc les dépositions de ceux qui étaient, comme lui, près de la Pucelle au moment de la prétendue abjuration.
Manchon, premier greffier, nous dit que, le 24 mai, Loyseleur99 avait été donné comme conseil à Jeanne. Après le sermon d’Érard, Loyseleur vint sur l’estrade, et Manchon nous cite ses avis cauteleux. Il en ressortirait que si Massieu a pu se joindre à lui, son rôle n’a pas été entièrement celui qu’il s’attribue.
Nicolas Taquel, troisième greffier, mais qui n’était pas sur l’estrade, déclare que Massieu lut à Jeanne la formule ; à cela se réduirait peut-être son intervention.
L’émotion, la crainte, s’emparèrent-elles de Jeanne à la vue du bourreau et de son char ?… Massieu, lui-même, constate le contraire. Le calme de la martyre l’étonne, à tel point qu’il en déduit qu’elle ne comprenait pas le danger. Lorsqu’il met dans la bouche de Jeanne : Je ne sais pas signer
et J’aime mieux signer que d’être brûlée
, il est évident qu’il lui prête des paroles qu’elle n’a pas prononcées. Massieu ment dans le premier cas, puisque nous avons des lettres de Jeanne revêtues de sa signature ; il ment encore dans le second, puisqu’il fait dire à Jeanne : Mieux vaut signer
, et qu’elle ne signe pas.
Que vaut le dire de Massieu, de cet homme suspect que nous venons de peindre ?… Et peut-on admettre que lui seul ait vu, lui seul ait entendu, quand tout le contredit ; lorsque ses deux affirmations se détruisent l’une l’autre ?
Un troisième témoin, très autorisé, donne, d’ailleurs, un démenti absolu aux assertions d’Aymond de Macy et de Massieu sur le point qui nous occupe. Ce témoignage, d’une importance capitale, laissé jusqu’à présent dans l’ombre, faute de pouvoir l’expliquer, tant on était convaincu que Jeanne ne savait ni lire ni écrire, mérite d’être étudié avec soin.
Guillaume de La Chambre nous dit en termes formels que Jeanne lut elle-même la formule.
Voici d’ailleurs sa déposition :
Vénérable personne, Maître Guillaume de La Chambre, maître ès arts, maître en médecine, a été produit et accepté comme témoin, etc.
Il nous raconte comment il connut Jeanne.
Le cardinal d’Angleterre et le comte de Warwick m’envoyèrent chercher ; je comparus en leur présence avec Maître Guillaume Desjardins, maître en médecine, et d’autres médecins. Le comte de Warwick nous dit que Jeanne était tombée malade, ainsi qu’on le lui avait rapporté, et qu’il nous avait mandés pour que nous en délibérions, car, pour rien au monde, le roi ne voulait qu’elle mourût de mort naturelle ; elle était d’un grand prix pour le roi, car il l’avait achetée cher ; il voulait qu’elle ne mourût que par voie de justice et dans les flammes ; de faire si bien, de la visiter avec tant de soin, qu’elle recouvrât la santé. Nous allâmes vers la malade, moi, Guillaume Desjardins, et d’autres, etc.
J’étais au sermon fait par Maître Guillaume Érard, bien que je n’aie pas souvenir de ce qui fut dit. Ce que je me rappelle bien, c’est que Jeanne fit une abjuration100, encore qu’elle ait mis beaucoup de temps à s’y décider. Elle fut déterminée à la faire par Guillaume Érard, qui lui promettait que si elle faisait ce qui lui était conseillé, elle serait délivrée de prison.
Elle la fit à cette condition et non autrement, lisant101 ensuite une petite formule de six ou sept lignes, sur le revers d’une feuille de papier doublé. J’étais si rapproché, moi qui dépose, que vraisemblablement j’aurais pu voir les lignes et la manière dont elles étaient tracées102.
Au lieu des dépositions si sèches de la plupart des témoins, on sent, dans celle-ci, l’intérêt très vif avec lequel La Chambre a suivi le procès. Les moindres détails l’ont frappé : il nous dit que la formule lue par Jeanne était sur une feuille de papier doublé. Pour qu’on ne puisse douter de ce qu’il avance, il prend soin de préciser : J’étais si rapproché, moi qui dépose, etc.
Sa déclaration se trouve contrôlée, confirmée par tout ce que nous avons établi précédemment, et ce témoignage, si détaillé, apporte une preuve nouvelle que Jeanne savait lire.
La Chambre est un homme respectable, indépendant, puisqu’il n’est pas compromis dans le procès. Par habitude professionnelle, ayant une chaire de médecine à l’Université de Paris, il relate, analyse tout ce qui peut aider à établir un diagnostic.
D’après lui, Jeanne est très calme ; elle lit la cédule non pas à haute voix, mais pour elle-même, ne voulant pas s’en rapporter à la lecture qu’Érard et Massieu lui en ont déjà faite. Elle met ses conditions, et après avoir constaté que cette cédule ne rétracte rien, elle prend la plume que lui tend Massieu ; toujours prudente et avisée, elle refuse cependant sa signature et ne met qu’une croix, signe de dénégation. La conscience tranquille, satisfaite de se débarrasser par cette ruse103 de toutes les sollicitations et d’échapper peut-être au bûcher, un sourire lui monte aux lèvres. C’est ce que constate, dans sa déposition, Manchon, qui, en parlant de cet instant, dit : Ce que je sais, c’est qu’elle souriait104.
Le sourire (subridebat) qui avait frappé Manchon, quand Jeanne mettait une croix au lieu de sa signature ; ce sourire, d’après tous les témoins, s’accentue et devient une moquerie quand, par dérision, elle fait un rond sur le papier que lui apporte Laurent Calot. À ce moment, l’impression unanime est que Jeanne n’a agi que par dérision : Per modum derisionis105. Ce sentiment se manifestait même sur l’estrade des juges, où un docteur l’exprimait à Cauchon en termes si violents que le cardinal de Winchester dut lui imposer silence.
Pour bien saisir la situation, c’est au témoignage de l’évêque de Noyon qu’il faut nous reporter. Ce haut personnage106, dans sa brève déposition, résume la question d’une manière très nette, en nous disant que la plupart des assistants attachaient peu d’importance à cette espèce d’abjuration, que ce n’était qu’une moquerie. Jeanne elle-même, à ce qu’il me parut, n’en faisait pas grand cas et n’en tenait pas compte107.
D’après tous ces faits, nous voyons que Cauchon, fidèle à son programme, a simulé une abjuration qu’il n’avait pas obtenue. Sa fourberie éclate par les déclarations mêmes de tous ceux de son parti : Quod non erat nisi truffa.
C’est le mot (truffa, farce) qu’on entend sur l’estrade pour caractériser l’incident. Ce sentiment est, alors, si général qu’un docteur anglais croit à la trahison de Cauchon et l’injurie. Il venait d’entendre Jeanne, par trois fois, mise en demeure de s’en rapporter à ses juges de ses dits et faits, répondre par trois fois : C’est à Dieu que je m’en rapporte et à Notre Saint-Père le pape.
Comment aurait-il pu admettre que, subitement, sur une simple parole d’Érard que personne n’avait entendue, Jeanne se serait soumise ? Cauchon l’assure pourtant ; il poursuit son œuvre de perfidie. Le tumulte organisé pour éclater à cet instant, les pierres jetées, etc., n’avaient qu’un but : détourner l’attention pour permettre à Cauchon d’accomplir son forfait ; et, grâce à ce tumulte, empêcher les assistants de bien entendre, empêcher Jeanne elle-même de se rendre compte des paroles qu’on lui attribuait. En réalité, Cauchon n’avait entre les mains qu’un signe de dénégation et un rond, signe de moquerie ; aussi n’a-t-on jamais osé produire ces deux pièces, qui eussent été la glorification de Jeanne.
Leur valeur était nulle ; mais, pour leur donner une apparence de vérité, il fallait prétendre que Jeanne ne savait pas signer. Or, toutes les preuves accumulées font litière de cette légende mensongère.
VII. État d’esprit
Après avoir analysé tous les détails de la scène du cimetière de Saint-Ouen, nous serions cependant incomplet si, par le récit de la séance de la veille, nous ne montrions dans quel état d’esprit Jeanne arrivait à cette séance publique, où elle devait entendre sa condamnation. La maîtrise d’elle-même, le calme, si extraordinaire, que nous avons dû constater, d’après tous les témoins, et qui ne furent altérés ni par la vue du bourreau, ni par la menace du bûcher, ne peuvent plus surprendre après les déclarations que Jeanne avait faites la veille.
Le 23 mai, mercredi de la semaine de la Pentecôte, pour la première fois, les évêques avaient été convoqués. La séance se tint dans une salle voisine de la prison. Cauchon ordonna à Pierre Maurice, docteur en théologie, chanoine de Rouen, d’exposer en français les erreurs condamnées par l’Université de Paris dans les paroles et les actes de l’accusée, et de dire, après chacun des douze articles108, le jugement porté par la faculté de théologie. Maurice prononça son factum tout d’un trait, sans qu’on eût permis à Jeanne, si ce n’est à la fin, d’interposer une réponse.
Pierre Maurice, qui avait entendu Jeanne en confession et qui, d’après la déposition de Guillaume de La Chambre, assurait n’avoir jamais entendu ni religieux, ni docteur lui faire confession avec une telle perfection, semble avoir eu un sincère désir de la sauver, comme le prouve la touchante péroraison de son exhortation. Mais, pour lui, être soumis à l’Église, c’était, manifestement, être soumis à l’enseignement de l’Université de Paris, lumière de toute science, extirpatrice des hérésies109.
À tout cet étalage, Jeanne se contenta de répondre :
— Quant à mes dits et à mes faits, ceux que j’ai déclarés au procès, je m’y rapporte et veux les soutenir.
— Ne pensez-vous pas, ne croyez-vous pas que vous êtes tenue de soumettre vos dits et vos faits à l’église militante, ou à d’autres qu’à Dieu ?
— Je veux en ce maintenir la manière que j’ai toujours dite et tenue au procès, si j’étais en jugement, si je voyais le feu allumé, les bourrées flamber, le bourreau prêt à bouter le feu, si j’étais dans le feu, je n’en dirais pas autre chose, et jusqu’à la mort je soutiendrais ce que j’ai dit au procès110.
Cauchon demanda au promoteur et à l’accusée s’ils avaient quelque chose à ajouter. Sur leur réponse négative, il conclut que la cause était entendue et lut la formule écrite, qu’il tenait en mains et qui se terminait ainsi : Nous assignons la journée de demain pour entendre la juste sentence que nous prononcerons.
Quatorze jours auparavant, le 9 mai, Jeanne avait déjà tenu le même langage, et sa décision pleine de fermeté avait produit sur Cauchon une si vive impression qu’il ne lui fit pas appliquer la torture, convaincu que les plus grands tourments ne pourraient l’ébranler. Cauchon et le vice-inquisiteur s’étaient rendus dans la grosse tour du château, accompagnés de Châtillon, Érard, Loyseleur, Massieu, les greffiers, etc. Les instruments de torture avaient été préparés et étalés ; les deux appariteurs chargés d’en faire l’application étaient là. Jeanne fut alors amenée. Il lui fut dit que si elle ne confessait pas la vérité, ces instruments la lui feraient avouer. Sans se troubler, elle répondit :
— Vraiment, si vous deviez me faire disloquer les membres et faire partir l’âme du corps, je ne vous en dirais pas pour cela autre chose ; et si je vous en disais quelque autre chose, après, je vous dirais toujours que vous me l’avez fait dire par force.
Et pour attester que son refus vient de Dieu :
— À la dernière fête de Sainte-Croix, j’ai eu confort de saint Gabriel […] j’ai demandé conseil à mes Voix pour savoir si je me soumettrais à l’Église, parce que les gens d’Église me pressaient fort de me soumettre à l’Église. Elles m’ont dit que si je voulais que Notre-Seigneur me fût en aide, je m’en attende à lui de tous mes faits […] j’ai demandé à mes Voix si je serai brûlée, elles m’ont répondu de m’en attendre à Notre-Seigneur, et qu’il m’aidera111.
Aux arguments terrestres, Jeanne apporte la réponse des Voix du Ciel, et quelle admirable réponse !
Elle s’en attend à Notre-Seigneur, et Notre-Seigneur l’aidera.
Dans ces terribles instants, Jeanne nous montre d’une manière plus saisissante encore cet état d’esprit, qui est la caractéristique de toute sa vie et sur lequel on ne saurait trop insister : son abandon complet entre les mains de Dieu ; abandon, qui vient d’une confiance absolue et d’un amour sans limite. Abandon raisonné, qui ne va pas jusqu’à la négation de sa personnalité ; mais, au contraire, stimule sa volonté pour coopérer aux desseins de Dieu.
Elle ne craint pas d’envisager ses membres disloqués et son âme prête à partir de son corps, elle voit le feu allumé, les bourrées flamber, le bourreau prêt à bouter le feu. On sent, par cette peinture, qu’elle y apporte non la résignation, mais plus que l’adhésion, une acceptation complète de tout souffrir pour concourir, par son action personnelle, à la volonté de Dieu.
Ces sentiments, qui ont inspiré toute la vie de Jeanne et qu’elle nous exprime avec tant de force, le 9 mai, devant la torture, qu’elle nous redit encore avec plus d’énergie le 23 mai, lorsqu’elle se met en face du bûcher, nous les retrouvons, le lendemain, à Saint-Ouen, à un degré sublime dans ses paroles et dans son attitude. Par la calomnie et le mensonge, joints à la fourberie la plus éhontée, ses ennemis avaient voulu jeter un voile sur les derniers jours de son agonie. Il a fallu que, pendant tant de siècles, ses lettres fussent conservées d’une manière presque miraculeuse pour que ce voile fût enfin déchiré d’une manière complète, et qu’au nom de la critique historique on pût enfin glorifier Jeanne dans cette journée de Saint-Ouen.
VIII. La vérité historique
Tous les témoignages, que nous avons examinés, nous ont déjà apporté une claire lumière sur la journée du cimetière de Saint-Ouen. Il ne nous reste donc plus qu’à envisager, dans leur ensemble, les événements tels qu’ils se sont déroulés.
Guillaume Érard, docteur en théologie, chanoine des églises de Langres et de Laon, chargé de faire l’admonestation publique, avait pris pour texte de son discours cette parole de l’Évangile : La branche ne peut pas porter de fruit par elle-même, il faut qu’elle reste attachée au cep de la vigne112.
À entendre Érard, Jeanne n’appartenait plus à la foi catholique, aussi se laisse-t-il entraîner aux plus violents emportements, l’appelant sorcière, hérétique, schismatique. Il va jusqu’à s’écrier :
— Charles, qui se dit ton roi et ton gouverneur, a adhéré comme hérétique et schismatique — car il est tel — aux paroles et actes d’une femme inutile, diffamée, pleine de tout déshonneur ; et non pas lui seulement, mais encore tout le clergé de son obéissance et seigneurie.
À ces mots, Jeanne l’interrompt :
— Parlez de moi et non du roi.
Plus ardent encore, Érard insiste :
— Oui, je te le dis à toi, Jeanne, et le répète, ton roi, puisqu’il t’a écoutée, est schismatique et hérétique.
— Par ma foi, réplique la Pucelle, révérence gardée, j’ose bien vous dire et jurer, sous peine de ma vie, que mon roi est le plus noble chrétien de tous les chrétiens, et qui mieux aime la foi et l’Église.
Cette apostrophe, si calme et si énergique, arrête Érard ; aussi l’évêque de Beauvais intervient-il en s’écriant :
— Faites-la taire !
Érard reprend alors son sermon, et sous des apparences plus modérées veut l’amener à se soumettre :
— Voici Messeigneurs les Juges qui, plusieurs fois, vous ont sommée et requise de vouloir soumettre tous vos faits et dits à notre Mère Sainte Église, et que, en ces dits et faits, étaient plusieurs choses, lesquelles n’étaient pas bonnes à dire ni à soutenir.
— Je vous répondrai, repartit Jeanne. Pour ce qui est de la soumission à l’Église, je leur ai dit sur ce point que toutes les œuvres que j’ai faites, que tous mes dits soient envoyés à Rome devers Notre Saint-Père le pape, auquel, et à Dieu premier, je me rapporte. Mes dits, les faits que j’ai faits, je les ai faits de par Dieu. De mes dits, de mes faits, je ne charge personne au monde, ni mon roi, ni tout autre ; s’il y a quelque faute, c’est à moi et non à un autre qu’il faut l’attribuer.
— Dans vos faits et dans vos dits, ce qui est réprouvé, voulez-vous le révoquer ?
— Je m’en rapporte à Dieu et à Notre Saint-Père le pape.
— Cela ne suffit pas. On ne peut aller quérir le pape si loin. Il faut que vous teniez ce que les clercs et gens, en ce connaissant, disent et ont déterminé de vos dits et faits.
Et de ce fut admonestée jusqu’à la tierce monition113.
Comme le dit le P. Ayroles :
Rien de plus important à étudier, pour avoir la clef du brigandage de Rouen, que de peser chacune des paroles de l’instrument judiciaire :
Je leur répondrai.La diatribe d’Érard ne l’a pas plus intimidée que l’immense assistance qui a les yeux sur elle.
Je leur ai dit.Ce n’est pas une réponse nouvelle qu’elle va faire. Elle va répéter celle qu’elle a déjà donnée, si souvent que le procès-verbal l’a déjà consignée deux fois, tout en atténuant l’énergie. L’appel au pape n’est nullement amoindri par le motDieu premier. Elle savait bien qu’il ne saurait y avoir de désaccord entre Notre-Seigneur et son Vicaire. […]Elle affirme pour la millième fois l’origine divine de sa mission ; elle répond à l’emportement du prêcheur contre son roi, en revendiquant pour elle seule la responsabilité de ses actes et de ses paroles114.
Nous venons de voir l’énergie et la fermeté de Jeanne, non pas grandir, car elles sont restées toujours égales ; mais se manifester de plus en plus à mesure que s’approche l’heure du sacrifice.
La veille, elle n’avait pas interrompu Pierre Maurice dans sa prédication, tandis que le 24, au contraire, elle ne craint pas d’apostropher vivement Érard. Ses Voix lui disaient : Réponds !
et Jeanne refuse, hardiment, de rétracter aucun de ses actes.
N’est-il pas admirable qu’au moment où la papauté est le plus violemment discutée, Jeanne, inspirée par ses Saintes, soit devenue l’interprète de Dieu ?
Les docteurs s’obstinent à lui répéter que le pape est trop loin. Elle, au contraire, par son appel réitéré, affirme qu’il est le chef et le Père de tous. Au protestantisme qui va naître, elle oppose la vraie doctrine du Christ, elle en appelle au Pape : Dieu premier servi.
À ces instants, où Jeanne s’élève à une telle hauteur, Dieu aurait-il pu l’abandonner ? Dieu en qui elle a mis tout son amour et toute sa confiance !
La séance se terminait par un triomphe pour Jeanne qui, loin de se rétracter, avait au contraire porté l’attaque au camp de ses adversaires. La condamnation allait être prononcée, mais la Pucelle resterait l’envoyée de Dieu. Cauchon pouvait-il le tolérer ? C’est à ce moment que, voulant à tout prix obtenir une signature, l’évêque de Beauvais, par l’intermédiaire d’Érard, parut vouloir tout céder et promit à Jeanne même la liberté, si elle consentait à abandonner le costume viril.
N’avait-elle pas dit le 24 mars : Donnez-moi un habit de femme pour aller à la maison de ma mère, et je le prendrai. C’est pour être hors de prison, et, une fois hors de prison, je prendrai conseil sur ce que j’ai à faire115.
Jeanne, qui était toute loyauté et droiture, refuserait-elle sa signature à une cédule où on ne lui demanderait plus autre chose que ce qu’elle avait déjà accepté ?…
Mais la Pucelle ne peut croire que ces loups soient devenus agneaux. Elle résiste, elle hésite longtemps. Elle ne peut comprendre que ses insulteurs soient pris d’un intérêt subit et qu’ils veuillent la sauver. Elle redoute un piège… Ses Voix ne lui ont-elles pas annoncé qu’on chercherait à la tromper ?
Érard lui lit la cédule, Massieu lui en donne une seconde lecture ; mais Jeanne refuse de s’en rapporter à eux : elle connaît trop leur perfidie ! C’est elle-même qui prend cette cédule, qui la lit, dépose Guillaume de La Chambre. Elle met ses conditions, nous dit le même témoin. Cependant elle doute toujours de la bonne foi de ses ennemis ; ce n’est donc pas sa signature qu’elle appose, mais simplement une croix, ruse de guerre qui, comme nous l’avons vu, était pour elle un signe de dénégation.
C’était au moment où l’on prononçait le jugement que s’établissait entre Érard et Jeanne ce colloque que l’on pourrait appeler une séance secrète. Les témoins nous en rapportent quelques mots saisis au hasard : Nous avons si grand pitié de vous, etc.
et Jeanne de répondre : Vous vous donnez beaucoup de peine pour me séduire.
Un tumulte se produit alors ; Cauchon interrompt la lecture de son jugement, demande au cardinal de Winchester de recevoir Jeanne à pénitence, car il prétend qu’elle vient de se soumettre ; et Jeanne qui, par ses paroles, venait en public d’opposer, à une triple monition, un triple refus est reconduite en prison sans qu’on ait osé affronter un nouvel interrogatoire, où elle aurait confondu la fourberie de ses juges.
Après avoir rétabli, d’après tous les témoignages, cette scène telle qu’elle s’est passée, il nous faut affirmer avec le promoteur du procès de réhabilitation, dans son article 24 : Dans leur malice, ils en sont venus à une abjuration machinée par avance imposée à celle qui en rien, ainsi qu’il a été dit, n’avait porté la moindre atteinte à la foi116.
Il faut avec l’évêque de Noyon dire :
que ce n’était qu’une espèce d’abjuration, une dérision, et que Jeanne n’avait fait que se moquer et n’en tenait pas compte117.
Avec les Anglais :
Plures dicebant quod non erat nisi truffa et quod non faciebat nisi deridere118. [Plusieurs disaient que ce n’était rien d’autre qu’une comédie et qu’elle ne faisait que se moquer.]
Enfin Manchon, premier greffier, toujours le mieux placé pour tout voir et tout entendre, nous résume cette dernière partie de la scène de Saint-Ouen, en nous apportant le témoignage de Jeanne elle-même :
Ce que je sais, c’est qu’elle souriait119.
Mieux encore que tous ces témoins, Cauchon savait qu’aucune abjuration n’était entre ses mains ; il avait vu Jeanne, le 24 mai, non moins énergique, non moins admirable que dans toutes les autres séances, s’opposer à toute rétractation ; mais il n’en est que plus résolu à transformer pour la postérité ce jour d’héroïsme en un jour de faiblesse. Il annexe au dossier une pièce fausse, une abjuration qu’il compose à sa guise, que personne n’a jamais vue, ni entendue, que Jeanne n’a jamais connue. Il ne met pas la pièce elle-même, puisqu’elle n’existait pas ; c’est une copie
, dit le procès-verbal. La cédule de six à sept lignes que Massieu avait lue, que Guillaume de La Chambre avait vue de si près qu’il aurait pu la lire, qui dura le temps d’un Pater Noster
, nous dit Miget, prieur de Longueville, formule d’environ six lignes de grosse écriture
, ajoute Taquel, troisième greffier, etc., ne paraît nulle part dans les procès verbaux. Or, la cédule annexée et où Cauchon avait inscrit le nom de Jehanne ✝
(aveu qu’elle savait signer) contient, non pas 6 lignes de grosse écriture, mais plus de 500 mots en menus caractères.
Tout est changé, truqué, falsifié. Durant le procès, Jeanne avait déjà dit : Vous écrivez ce qui est contre moi et non ce qui est pour moi.
Si elle protestait autrefois, désormais, elle ne le pourra plus ; elle ne paraîtra plus en public, Jeanne ne sera plus amenée devant ses juges.
Cauchon, seul, nous apportera de ses paroles un écho défiguré, où il s’appliquera à rendre vraisemblable l’abjuration qu’il a simulée à Saint-Ouen. II n’avait pas obtenu ce qu’il cherchait, mais on avait vu Jeanne tracer un signe ; et sans montrer les pièces, il prétendra que ce signe était sa signature.
Cet escamotage de fin de séance, si on ose employer ce mot, n’eût pas été possible dans une salle d’audience ; et c’est pourquoi Cauchon avait voulu une séance en plein air, où un tumulte organisé à propos, des pierres jetées, etc., amenèrent un désordre propice au brigandage judiciaire le plus éhonté qu’ait jamais enregistré l’histoire.
IX. Le fait nouveau
Jeanne n’avait pas signé ; elle n’avait mis qu’une croix, qui, en certaines occasions, constituait pour elle un désaveu, ainsi qu’elle l’avait dit à ses juges.
Voilà le fait nouveau qui domine tout le procès et donne aux paroles de la Pucelle, dans les événements qui vont suivre, leur valeur positive et réelle.
Lorsque Cauchon, le 28 mai, lui dira :
— Vous aviez promis et juré de ne pas reprendre l’habit d’homme.
— Oncques, répondit Jeanne, je n’ai compris faire serment de ne pas le prendre120.
C’est bien l’affirmation que la croix, tracée au bas de la cédule, ne constituait, pour elle, aucun engagement. Cauchon le sait mieux que tout autre, aussi n’ose-t-il pas relever cette déclaration. La scène de Saint-Ouen avait eu lieu dans la matinée du 24, et, la séance à peine terminée, Jeanne s’était adressée à ses gardiens :
— Or ça, gens d’Église, menez-moi en vos prisons, et que je ne sois plus entre les mains de ces Anglais121.
Cauchon, consulté, répondit :
— Menez-la où vous l’avez prise.
Cette interpellation de Jeanne est très caractéristique. Ce n’est pas une prière, mais un ordre qu’elle donne ; on y découvre les promesses faites et le doute de la Pucelle quant à leur réalisation : Or ça, gens d’Église, etc.
Le même jour de jeudi, après midi, Jean Lemaître, vice-inquisiteur, assisté de Thomas de Courcelles (celui qui avait réclamé la torture), Nicolas Midi, Loyseleur, etc., tous les ennemis les plus acharnés de Jeanne se rendirent à sa prison. Quoique son nom ne soit pas porté au procès-verbal, Cauchon nous dira, le 28, avoir assisté à cette séance, car c’était le moment décisif. Il savait que la cédule n’engageait pas Jeanne ; et pour la décider à quitter le costume viril122, nous allons voir que lui-même dut renouveler les engagements pris en son nom par Érard. Elle ne pourra être conduite dans les prisons ecclésiastiques qu’après avoir revêtu les habits de femme.
Les réticences du procès-verbal montrent, une fois de plus, que la crainte dominait tellement le timide Manchon, qu’il n’hésitait pas à supprimer demandes ou réponses quand elles accablaient les juges. Le 28 mai, lorsqu’on demandera à Jeanne : Pourquoi avez-vous repris l’habit d’homme ?
elle répondra :
— Je l’ai repris parce qu’on n’a pas tenu ce que l’on m’avait promis, à savoir que j’irais à la messe, recevrais mon Sauveur, et que l’on me mettrait hors des fers.
Et lors du procès de révision, Manchon déposera en ces termes :
On demanda à Jeanne, en ma présence, pourquoi elle avait repris l’habit d’homme. Elle dit que les juges123 lui avaient promis qu’elle serait entre les mains et dans les prisons de l’Église et qu’elle aurait une femme avec elle124.
Manchon complète ainsi ce qu’il n’a pas osé écrire dans le procès-verbal du 24.
En se reportant à la séance du 17 mars, nous voyons Jeanne annoncer par avance quelle serait sa conduite en pareille circonstance. À cette question : Vous avez dit que vous prendriez l’habit de femme si l’on vous laissait aller ; est-ce que cela plairait à Dieu ?
Elle répond :
— Si l’on me donnait congé en habit de femme, je me mettrais aussitôt en habit d’homme et je ferais ce qui m’est commandé par Notre-Seigneur. C’est ce que j’ai répondu précédemment, pour rien au monde je ne ferais le serment de ne point m’armer et de ne pas me mettre en habit d’homme, et cela pour faire le plaisir de Notre-Seigneur125.
Jeanne avait donc prévu, et à plusieurs reprises, qu’elle pourrait momentanément quitter l’habit viril, sans manquer aux ordres de ses Voix126. Ne croirait-on pas que nous lisons d’avance et fait par elle-même, le récit de ce qui s’est passé au jour de la prétendue abjuration de Saint-Ouen ?… Si, le 24 mai, elle accepte l’habit de femme, c’est dans les conditions qu’elle a déjà posées ; elle n’a pas mis sa signature et a, par conséquent, refusé tout engagement :
— Onques je n’ai compris faire serment127.
Pour Jeanne, en effet, l’habit et les armes qu’elle porte sont les emblèmes de sa mission. Quand on lui avait demandé le 27 février : Est-ce Notre-Seigneur qui vous a dit de prendre le vêtement d’homme ?
— Le vêtement est peu de chose, c’est un point de peu d’importance, ce n’est point sur le conseil d’homme du monde que j’ai pris le vêtement d’homme. Je n’ai pris le vêtement, je n’ai fait quoi que ce soit que par l’ordre de Dieu et des anges.
Et le 28 mars :
— Je ne le laisserai pas sans l’ordre de Notre-Seigneur, quand on devrait m’en trancher la tête, mais si cela plaît à Notre-Seigneur, il sera aussitôt mis bas128.
X. La condamnation
Le dimanche de la Trinité, 27 mai, se répandait dans la ville de Rouen le bruit que Jeanne avait repris le costume viril.
Que s’était-il passé pendant ces deux jours ? Aucun témoignage précis ne peut nous renseigner. Jeanne avait-elle conservé à sa portée ses vêtements masculins, comme le raconte un chroniqueur ? Lui furent-ils, au contraire, rendus sur sa demande ? Jeanne, qui avait pu affronter impunément un tête-à-tête continuel avec des soudards auxquels elle apparaissait moins comme une femme que comme un ange, eut-elle à redouter les outrages de Warwick et de sa soldatesque, ainsi qu’en ont déposé Isambart de la Pierre et Martin Ladvenu129 ?
Tout ce que nous savons, c’est que, dans sa détresse, Dieu ne l’abandonna pas. Les Voix célestes, qui l’avaient toujours soutenue, lui firent encore entendre leur appel : Jeanne la Pucelle, fille de Dieu130.
Sainte Catherine et sainte Marguerite lui donnèrent une claire vision des dangers qu’elle courait, et lui recommandèrent d’affirmer de plus en plus sa mission. Elles durent aussi lui rappeler la promesse tant de fois répétée : Ne te chaille pas de ton martyre, tu t’en viendras enfin au royaume du paradis.
Aussi, quand, le lundi 28, Jeanne est amenée devant Cauchon, avec quelle tranquille assurance ne lui dit-elle pas, au sujet de l’habit d’homme :
— Je l’ai pris de ma volonté et sans nulle contrainte.
L’évêque de Beauvais, qui, en certaines séances, avait convoqué jusqu’à cinquante et soixante assesseurs, n’en fit venir qu’un fort petit nombre à cet interrogatoire. Sur sept assesseurs, trois paraissent pour la première et unique fois ; tous lui sont entièrement dévoués, ligués contre Jeanne et décidés à tous les mensonges. Le procès-verbal de cette séance n’a qu’un but : faire croire qu’à Saint-Ouen, Jeanne a abjuré.
Pour mieux caractériser l’acceptation soi-disant donnée, on prend soin de relater que les Saintes auraient adressé à Jeanne des paroles de reproche ; et, passant par la bouche de la martyre, elles prennent la forme d’un aveu. Quelle habileté dans la perfidie !…
Manchon terrifié avait refusé de venir, et Warwick lui-même dut aller le chercher. Que pouvait le pauvre greffier qui tremblait à ce point, et comment s’étonner des infidélités de son procès-verbal ?
On mettra dans la bouche de Jeanne que tout ce qu’elle a fait, ce fut par peur du feu
, lorsque, dans le récit de Saint-Ouen, nous avons vu, au contraire, quelle fut sa maîtrise d’âme et comment, à la triple monition, elle répondit par un triple refus. Son sourire et tous les témoignages que nous avons rapportés ne font que mieux ressortir la fourberie de Cauchon. Jeanne n’a jamais connu la peur, sa vie entière l’atteste ; et pendant le procès, si une crainte vient inquiéter son âme, c’est la crainte de déplaire à Dieu.
Le moindre sens critique ne révèle en ce procès-verbal que contradictions, lacunes ou mensonges. Comment Cauchon peut-il oser dire que les Voix auraient ordonné à Jeanne de confesser qu’elle n’avait pas bien fait
? Si cela était vrai, si ses Voix lui avaient dit la grande pitié de sa trahison
, quelle amère douleur se fût emparée de son âme !… C’est en public, c’est sur le bûcher que Jeanne eût confessé son erreur, demandé à Dieu son pardon dans un cri de regret et de douleur, et non à Cauchon, évêque prévaricateur, dans le secret d’un interrogatoire.
Lorsqu’on voit de quelle haine féroce131
étaient animés contre la Pucelle tous ces hommes, dont elle était venue troubler la jouissance, inquiéter les intérêts, on ne peut s’étonner que le procès-verbal n’ait été pour eux qu’un instrument destiné à tromper la postérité et à défendre leur mémoire. Lors de la réhabilitation, Manchon, mis en présence de textes falsifiés, avoua qu’il n’avait pas osé se mettre en opposition avec des hommes si haut placés :
Non fuisset ausus tantos viros redarguere132. [Il n’aurait osé contredire de si grands hommes.]
Combien Jeanne, au contraire, dut être sublime en cette séance, lorsqu’en termes plus énergiques que jamais, par une double affirmation, elle proclame encore sa mission :
— Si je disais que Dieu ne m’a pas envoyée, je me damnerais moi-même, car en toute vérité c’est Dieu qui m’a envoyée133.
Elle ose jeter à la face de ses juges qu’Érard n’est qu’un faux prêcheur et qu’eux-mêmes ont menti, car jamais elle n’a prêté serment. Ses accents ont été tels que le lendemain, Cauchon ne voudra pas la faire paraître devant ceux qui doivent la condamner.
Le 29 mai, plus de quarante assesseurs étaient convoqués pour juger de la rechute. L’invraisemblance des récits de Cauchon et la fausseté des pièces apportées réveillèrent-elles chez les membres du tribunal un tardif sentiment de justice ? Pour la première fois, les juges se séparent de l’évêque de Beauvais. Il avait tenu à rendre compte lui-même de l’interrogatoire de la veille, et lecture fut donnée de la formule d’abjuration que, d’après lui, Jeanne avait signée ; pièce fausse qu’elle n’a jamais connue et que tous les témoins affirment ne pas être celle qui lui fut présentée134.
Gilles Duremort, abbé de la Sainte-Trinité de Fécamp, fut appelé le second à donner son avis. Le brigandage de la fin de séance de Saint-Ouen était-il trop présent à son esprit ?… Il osa demander que Jeanne fût entendue et qu’on lui lût de nouveau la formule d’abjuration. Sur quarante et un votants, trente-huit voix suivirent l’abbé de Fécamp. Qui croirait que Cauchon ne dût pas s’incliner devant ce vote du tribunal ? Mais la présence de Jeanne, les réponses qu’elle eût faites, auraient mis à nu trop d’infâmes machinations ; aussi l’évêque de Beauvais ne songe-t-il qu’à hâter l’exécution de son plan criminel. Le soir même, il prescrit à Massieu d’avoir à citer la femme, appelée vulgairement la Pucelle, pour comparaître, le 30 mai, à 8 heures du matin, sur la place du Vieux-Marché, où le crime sera consommé.
Quel écrasant témoignage Cauchon ne porte-t-il pas contre lui-même, en refusant de faire entendre Jeanne, et peut-on demander un aveu plus formel de ses prévarications ?
Trois Dominicains assistèrent Jeanne en ses derniers instants. Furent-ils pour elle des consolateurs ?
Leur conduite et l’analyse de leurs dépositions font ressortir, au contraire, qu’ils n’osèrent pas se séparer de leur supérieur, le vice-inquisiteur Lemaître, prieur du couvent de Rouen, et qui, dans tout le procès, fut le second très fidèle de l’évêque de Beauvais. Il est évident que Lemaître et Cauchon n’avaient envoyé près de Jeanne que des hommes entièrement dévoués à leurs idées et partageant leurs sentiments. Frère Isambart fut parmi les juges, il assista à toutes les séances et condamna la Pucelle. Martin Ladvenu accompagna son prieur à de nombreuses séances. Désigné par Cauchon pour annoncer à Jeanne sa mort prochaine, l’induire à vraie contrition et aussi pour l’ouïr de confession
, il se rendit à la prison avec Jean Toutmouillé. Ces hommes, qui avaient entendu toutes les réponses de Jeanne pendant son procès, réponses qui ont fait l’admiration de toutes les générations et même des Anglais, appellent Jeanne une pauvre femme assez simple qu’à grand-peine savait Pater noster et Ave Maria
. Ils se montrent les fidèles interprètes de Cauchon en cherchant à diminuer le caractère, la personnalité et la mémoire de Jeanne.
Nous avons vu que Pierre Maurice, docteur en théologie, affirme au contraire la haute intelligence de la Pucelle, en nous disant n’avoir jamais entendu ni religieux, ni docteur faire confession avec une telle perfection. C’est à frère Martin Ladvenu et à Toutmouillé que s’est adressé l’évêque de Beauvais pour obtenir contre Jeanne des témoignages posthumes que Manchon, même, refusa de sanctionner par sa signature135, et où pour tout esprit critique, éclatent inanité et fausseté.
Le Procès nous dit que
la sainte Eucharistie fut apportée sur une patène recouverte d’un corporal, sans lumière, sans escorte, sans surplis et sans étole, par un certain Me Pierre136,
et que ce fut Ladvenu qui donna à Jeanne la sainte Communion137.
En accompagnant Jeanne au supplice, frère Martin Ladvenu n’a même pas un crucifix à lui présenter, et il faut que ce soit un soldat anglais qui, du bout de son bâton, fasse une petite croix qu’elle serrera dévotement contre son cœur. Jeanne réclame, cependant, l’emblème de son Sauveur. Isambart de la Pierre avoue
qu’elle lui demanda, requit et supplia humblement qu’il allât en église prochaine et qu’il lui apportât la croix pour la tenir élevée tout droit devant ses yeux.
Ces témoignages font ressortir, malgré eux, combien Jeanne fut admirable de foi, d’héroïsme et de confiance en Dieu. Devant une foule immense, elle se montre sublime, toujours calme et maîtresse d’elle-même138. En quittant la prison, Jeanne avait dit à Pierre Maurice :
— J’ai bonne confiance, je serai ce soir en paradis.
Qu’était la mort… qu’était le bûcher… en présence de cette vision céleste que lui donnaient ses Saintes ?
Dix-huit cents Anglais139 ayant haches et glaives accompagnent la guerrière ; pas une plainte ne s’élève de sa bouche, et la voix du peuple s’écrie : Nous avons brûlé une Sainte !
Plus de dix mille témoins accourus se dispersent en proclamant la mission divine de la Pucelle, et, du haut de son bûcher, Jeanne fait la conquête de Rouen pour la France.
Que Jeanne ait su lire, écrire, ou qu’au contraire elle n’ait même pas su signer, peu importe dans une vie aussi merveilleuse, cela appartiendrait à peine aux miettes de l’histoire ; mais tout ce qui doit projeter plus de clarté sur une gloire aussi pure ne saurait être négligé.
L’habileté de ses ennemis avait su jeter une ombre qui, longtemps, a plané sur sa mémoire. On se demandait si Jeanne n’avait pas connu un instant de faiblesse… Ses lettres ont été le fil conducteur sans lequel on ne pouvait se reconnaître dans le drame de Saint-Ouen. Du moment que Jeanne savait écrire, et que, le 24 mai, elle a refusé d’apposer sa signature, toute ombre se dissipe, et cette question qui semblait secondaire : Jeanne savait-elle signer ?
acquiert une importance capitale. Une défaillance passagère n’aurait pas terni sa gloire, mais elle n’a pas eu cette défaillance. L’unité de sa vie n’a pas été rompue. Les secours qui lui venaient d’en haut ne lui ont jamais fait défaut. S’il importait pour la gloire de Jeanne que la lumière fût faite sur le drame de Saint-Ouen, la gloire de Dieu le demandait encore plus pour montrer que jamais Il n’abandonne ses saints140 !…
Lorsqu’il plaît à Dieu d’appeler une créature d’une manière plus évidente à prendre une part vraiment active à l’exécution de ses desseins, il fait de cette âme un vase d’élection, un être vraiment supérieur. Destinée à sauver la France et le monde catholique, Jeanne fut, jusqu’à la mort, fidèle à sa mission. Rien ne l’ébranla, ni séduction ni crainte, et son âme s’échappa dans un cri d’amour : Jésus ! Jésus !
Les lettres de Jeanne d’Arc
I. Leur histoire
En présentant les lettres de la Pucelle, nous avons en même temps montré quel était leur intérêt au point de vue historique ; il nous reste maintenant à les suivre à travers les siècles et à indiquer comment elles sont parvenues jusqu’à nous.
Les lettres de Jeanne d’Arc ont été si nombreuses qu’on peut toujours espérer que de nouvelles recherches nous en rendront quelques-unes. Nous avons vu comment, en 1844, M. Tailhand, président à la cour royale de Riom, découvrit dans les archives de cette ville la lettre que Jeanne adressait aux habitants et échevins en novembre 1429. Cette lettre est un témoin précieux qui, dans son immobilité de plus de quatre siècles, vient attester l’identité parfaite entre les différentes signatures de Jeanne.
L’authenticité des cinq lettres ne peut être mise en doute, mais toutes les preuves qui viennent la confirmer ont un intérêt d’autant plus grand que ces lettres se trouvent avoir acquis, pour l’histoire de Jeanne, une réelle importance.
La lettre au duc de Bourgogne, écrite le jour du sacre, parvint à ce prince lorsqu’il était dans ses États des Flandres ; aussi est-ce dans les archives de Lille qu’elle a été conservée. Pour les trois lettres de Jeanne aux bourgeois et habitants de la ville de Reims, divers témoignages permettent de les a suivre d’une manière si précise qu’on ne peut demander une plus grande certitude.
La famille de Jeanne d’Arc se trouvait représentée à la fin du XVIe siècle par Charles du Lys141 (1559-1634), qui, après avoir été substitut du procureur général au Parlement, était devenu, en 1602, avocat général en la Cour des aides de Paris. Rempli d’un culte pieux pour la mémoire de sa grand-tante, toute sa vie fut consacrée à recueillir les souvenirs qui se rattachaient à la Pucelle ; et ce fut certainement grâce à sa situation considérable qu’il put obtenir de la ville de Reims les lettres de Jeanne d’Arc.
Les autres branches de sa famille s’étaient toutes éteintes par les mâles avant 1619. Ce fut donc comme unique représentant et chef incontesté de la famille de Jeanne d’Arc que les échevins de Reims crurent ne pas devoir lui refuser ces précieuses reliques. De 1429, où Jeanne les écrivit, jusque vers 1630, ces lettres étaient restées dans les archives de la ville. Elles sont indiquées dans un inventaire des archives fait, en 1625, par Jean Rogier, prévôt à l’échevinage de Reims ; or, en faisant cet inventaire, Jean Rogier écrivit de sa main : Jehanne la Pucelle
sur la suscription des deux lettres portant la signature de Jeanne.
Sur les fac-similés que nous donnons se trouve reproduite cette indication, mise en 1625 par Jean Rogier.
Quicherat y reconnaît parfaitement l’écriture de ce fonctionnaire de l’échevinage, et déclare, avec l’autorité qui lui appartient, qu’il ne peut y avoir d’hésitation : les lettres transmises par Charles du Lys sont bien celles qui étaient à Reims en 1620. La publication, faite en 1864, par M. de Villemessant, directeur du Figaro, d’un recueil de documents historiques, l’Autographe, lui avait donné occasion de demander à mon père s’il voudrait bien l’autoriser à y reproduire une des lettres de Jeanne d’Arc.
Pour garantir l’authenticité de cette lettre, M. de Villemessant songea à s’adresser au savant professeur, M. Jules Quicherat, dont le nom avait acquis une notoriété universelle en faisant connaître les pièces du procès de Jeanne d’Arc et de sa réhabilitation. Rien de plus positif ni de plus intéressant que la réponse de Quicherat, aussi tenons-nous à la faire connaître :
Paris, le 20 octobre 1864.
Monsieur,
Vous me demandez mon opinion sur la valeur d’une lettre du XVe siècle, qu’on vous assure être signée de la main de Jeanne d’Arc.
Ma réponse ne saurait se faire attendre.
Le texte de cette pièce figure dans mon recueil des documents relatifs à la Pucelle ; je l’ai donné comme authentique d’après une copie qu’en fit, du temps de Louis XIII, un fonctionnaire de l’échevinage de Reims, appelé Jean Rogier. L’original reposait alors dans les archives de la ville de Reims. Nul doute pour moi que votre autographe ne soit cet original lui-même. Je reconnais la main de Jean Rogier dans les mots
Jehanne la Pucelle, ajoutés à la suscription, et la teneur fournit plusieurs corrections à la copie dont je fis usage. J’ajoute que la signature est conforme à celle d’une autre lettre, également publiée par moi, que la ville de Riom possède en original. Bien loin donc que j’aie à revenir sur mon premier jugement, je regarde comme un complément d’authenticité pour la pièce en question la production qui a lieu aujourd’hui par vos soins.Agréez, Monsieur, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Signé : J. Quicherat.
Comme on le voit, c’était la première fois que les lettres de Jeanne d’Arc étaient portées à la connaissance du public. Quelques années après, M. Firmin-Didot, dans l’édition illustrée de Jeanne d’Arc, par M. Wallon, reproduisait cette même lettre du 16 mars 1430 et celle du 6 août, qui ne porte pas la signature de Jeanne. Une lettre restait inédite, celle du 28 mars 1430, que j’ai tenu à faire connaître, au moment de la béatification, en publiant les Reliques de Jeanne d’Arc.
À la suite de M. Quicherat, dont les travaux avaient ravivé en France le souvenir de la Pucelle, de nombreux auteurs furent amenés à rechercher tout ce qui pouvait se rattacher à elle-même ou à sa famille. C’est ainsi qu’en 1856, Vallet de Viriville découvrait, à Carpentras, dans les manuscrits Peiresc, le Traité sommaire142 de Charles du Lys.
Plus qu’étonné d’une publication de documents que notre famille, héritière de Charles du Lys, était seule à posséder, le comte de Maleissye se mit en rapport avec M. Vallet de Viriville, et ce fut lui qui, le premier, eut connaissance de nos lettres de Jeanne d’Arc. Lorsque Vallet de Viriville vit ces lettres, il ne pouvait en croire ses yeux !… et en profond érudit, en détachait une parcelle, la goûtait, pour s’assurer si le papier était bien du XVe siècle, et s’écriait :
— Mais c’est admirable !… c’est inouï !… Ce sont bien les lettres de Jeanne d’Arc.
Il ajoutait :
— Laissez toujours avec soin ces lettres où elles sont, ne les exposez pas au jour ; qu’elles restent avec tous les papiers de Charles du Lys.
Plus tard, en 1867, examinant ces archives, je découvrais une petite feuille insignifiante, toujours passée inaperçue et qui donnait l’explication des copies trouvées à Carpentras : une lettre de Peiresc à Charles du Lys, trop importante pour ne pas être reproduite :
Monsieur,
Enfin je vous envoyé votre papier et vous demande mille pardons de ce que je le vous ay trop longtemps gardé ; si votre courtoisie incomparable ne m’eut osté l’appréhension de pouvoir faillir en votre endroit, je n’en eusse pas abusé de la sorte. Il n’est presque point de si grand bien qui ne soit suivi de quelque inconvénient.
Au surplus, j’ay appris que le cardinal-duc de Bar mourut la veille de la Saint-Jean, en l’année 1430. De sorte que ce ne fut que plus de huict ou neuf moys après le sacre. On m’en a remis l’épitaphe tout au long. Monsieur de la Verrière, auditeur des comptes, vous ira voir et observer la tapisserie, et faire la médaille de la Pucelle. Faictes-Iui, je vous supplie, bon accueil. Monsieur Antin s’y en ira aussy, et si je ne parts bien topt, je vous les mèneray tous deux. Si je suis contrainct de partir, je vous supplie d’avoir le soing de m’envoyer ladite pièce de tapisserie à Monsieur Chapellain et de le prier qu’il ne la laisse confondre parmy les autres, afin que si on avait besoin de la revoir, on la puisse facilement trouver.
Je vous renvoyé aussi votre livre de Hordal et demeure, Monsieur, votre très humble serviteur,
Peiresc.
Il faut que vous me donniez une coppie bien escripte des lettres de la Pucelle si vous ne voulez que je les face prendre moy-même.
Fabri de Peiresc, conseiller au Parlement d’Aix, était un érudit célèbre et un collectionneur passionné.
Cette missive est du plus grand intérêt, puisqu’elle nous indique à quel moment (1630) les lettres de Jeanne d’Arc avaient quitté Reims pour se trouver en la possession de Charles du Lys. Grâce au post-scriptum, dont nous n’avons pas à faire ressortir l’importance pour l’histoire des lettres de Jeanne d’Arc, nous avons la preuve matérielle que ces lettres, qu’un inventaire montrait à Reims en 1625, se trouvaient en 1630 entre les mains de Charles du Lys : Il faut que vous me donniez une coppie bien escripte des lettres de la Pucelle si vous ne voulez que je les fasse prendre moy-même.
Comment ces lettres vinrent-elles de Charles du Lys jusqu’à nous ?… Pour l’établir, je ne peux mieux faire que d’emprunter les lignes suivantes à M. Boucher de Molandon, le savant Orléanais qui consacra sa vie à des recherches sur Jeanne d’Arc.
Charles du Lys, né vers 1559, descendait au cinquième degré d’un frère de la Pucelle. Comme s’il eût voulu retremper son nom aux sources de son illustration originaire, il vint, vers 1594 ou 1595, se choisir une épouse en la famille orléanaise des Cailly dont le nom se rattachait au premier souvenir de la vierge de Domrémy.
Catherine de Cailly descendait, elle-aussi, au cinquième degré, de Guy de Cailly, qui reçut Jeanne d’Arc en son manoir lorsque, au début de sa mission, elle mena de Blois à Orléans un convoi de munitions et de vivres, et qui, depuis, paraît s’être attaché fidèlement à sa fortune.
Charles du Lys mourut vers 1634. De son mariage avec Catherine de Cailly étaient nés quatre enfants.
Sa seconde fille, demoiselle Françoise, épousa Louis de Quatrehommes, conseiller à la Cour des Aydes et du Conseil privé des Finances. Sa descendance s’est seule continuée jusqu’à nos jours. C’est par elle que se perpétue en notre vieil Orléanais le sang des du Lys… par elle que se rattache à Charles du Lys et par Charles du Lys à l’un des frères de Jeanne d’Arc la noble famille fidèle et bienveillante gardienne des précieuses archives de cette race historique, digne héritière de ces belles traditions de patriotisme et d’honneur143.
Personne n’ignore que Charles VII donna aux frères de Jeanne d’Arc le nom de du Lys en même temps que pour armoiries il leur attribuait les lys de France : d’azur à une épée en pal, accostée de deux fleurs de lys d’or ; l’épée soutenant une couronne de France.
D’où vient qu’on ait songé à leur donner un nom ? Les lettres de Jeanne d’Arc vont nous donner la réponse.
Elle signait Jehanne
et n’ajoutait pas d’Arc.
Au procès, elle répondra : Dans mon pays, l’on m’appelait Jeannette ; depuis que je suis venue en France, l’on m’appelle Jeanne. Je ne sais pas mon surnom.
Le 24 mars, à la lecture du procès-verbal, elle compléta cette réponse en disant : Mon surnom est d’Arc ou Romée. Dans mon pays, les filles portent le surnom de leurs mères144.
Au XVe siècle, les noms de famille n’existaient pas encore, ou du moins dans le peuple. Chaque individu était désigné par son nom de baptême, auquel on ajoutait, pour le caractériser, soit sa profession, soit un détail physique, ou encore le lieu d’où il était originaire. C’est ainsi que nous voyons Henri de Vouthon, curé ; Jehan de Vouthon, tous deux frères d’Isabelle Romée et ainsi désignés parce qu’ils sont originaires du village de Vouthon. Pour les d’Arc, la même désignation s’était peut-être transmise plusieurs fois et cependant n’était encore qu’un surnom.
Le nom patronymique (nom du père) fut la conséquence de l’édit de Villers-Cotterêts (1539), qui ordonnait l’établissement de registres paroissiaux, d’où les actes de l’état civil. Les enfants furent naturellement amenés à continuer les qualificatifs de leurs parents, comme l’habitude en existait déjà pour les classes élevées. La particule indiquait donc un lieu d’origine, et c’est bien à tort que, de nos jours, on a voulu y voir un signe de noblesse. Il en est de même pour les signets ou sceaux, qui étaient à cette époque d’un usage général. On les figurait comme des armoiries, mais sans timbre ou heaume, caractère essentiel du blason, et que seuls portaient les gentilshommes. Un arc bandé de trois flèches était le sceau des ancêtres de Jeanne d’Arc. La branche de Jean du Lys, échevin d’Arras, avait conservé ces trois flèches145, les écartelant avec les fleurs de lys données par Charles VII.
Louis XIII ajouta pour Charles du Lys et tous ses descendants le droit de porter comme cimier
une figure de la Pucelle vestue de blanc, portant en sa main droite une couronne d’or soutenue sur la pointe de son épée, et, à la gauche, sa bannière blanche figurée et représentée comme de son vivant elle la portait, laquelle estait de thoille blanche semée de fleurs de lis d’or avec la figure d’un ange qui présentait un lis à Dieu, porté par la Vierge sa mère, et le cri : La Pucelle146.
II. Synthèse de la vie de Jeanne.
Sa vie intime — Sa mission
Sa vie intime — Sa mission
Le père de Jeanne147, né à Ceffonds en Champagne148, vers 1365, semble avoir tiré son nom du village d’Arc-en-Barrois, d’où sa famille était originaire. Il vint, au moment de son mariage, s’établir à Domrémy, qui est près Vouthon, lieu d’origine d’Isabelle Romée. Le nom de Romée était un surnom donné en général aux personnes ayant fait le pèlerinage de Rome. Ce qualificatif est absolument personnel à Isabelle et n’a jamais été porté par aucun autre membre de sa famille. Une foi ardente lui faisait accomplir les plus pénibles voyages, car en 1429 nous la voyons assister aux fêtes du jubilé qui se célébrèrent, le 25 mars, au sanctuaire de Notre-Dame du Puy-en-Velay.
Jacques d’Arc avait eu plusieurs fois, en songe, une sorte d’avertissement des destinées de sa fille. À ce sujet, Jeanne dit au procès : Ma mère ma rapporté que mon père disait à, mes frères : Si je pensais que ce que j’ai songé d’elle arrivât, je vous ordonnerais de la noyer, et si vous ne le faisiez pas, je la noierais moi-même.
Ce propos, où l’on trouve une âme digne de l’ancienne Rome, suffit à nous faire connaître le père de la Pucelle. On y voit avec quelle rigidité et dans quels sentiments de devoir et d’honneur il dut élever ses enfants. Il s’en fallut de bien peu, ajouta Jeanne, qu’ils ne perdissent le sens quand je fus partie pour aller à Vaucouleurs.
Jacques d’Arc vint cependant au sacre de Reims pour voir sa fille dans l’éclat du triomphe, et, esprit pratique, il en profita pour obtenir du roi que les villages de Greux et de Domrémy fussent exempts de tout impôt. Ce privilège dura jusqu’en 1774, où il fut définitivement abrogé à l’avènement de Louis XVI. Dans tous les actes du temps, le père de la Pucelle est cité comme l’un des principaux notables de Domrémy. — En 1423, il est qualifié doyen149 de ce village
, et le 31 mars 1427 nous le trouvons comme procureur fondé des habitants de Domrémy, dans un procès de grande importance.
D’après Siméon Luce, l’étendue de ses biens était d’environ vingt hectares : douze en terre, quatre en prés et quatre en bois, et parmi ces derniers le Bois Chesnu. Jacques d’Arc possédait, en outre, des biens dans d’autres paroisses, sur lesquels il avait établi Jacquemin150, son fils aîné. Jeanne était de beaucoup la plus jeune des cinq enfants151 de Jacques d’Arc et d’Isabelle Romée ; et malgré la tradition qui nous présente Jeanne comme une bergère, nous voyons, par ses réponses au procès, que ce n’était pas son occupation habituelle : Pendant que j’étais dans la maison de mon père, je m’occupais à l’intérieur des soins du ménage ; je n allais pas dans les champs à la suite des brebis et du bétail152.
À la séance du 24 février, lorsque lui fut posée cette question : Ne conduisiez-vous pas le bétail aux champs ? — Je vous ai déjà répondu sur cela. Lorsque j’ai été plus grande, et que j’ai été jeune fille, je ne gardais pas habituellement le bétail ; cependant, j’aidais à le conduire dans les prés et dans un château appelé de l’Île, où on le renfermait par crainte des hommes d’armes153.
Quand on lit les dépositions des habitants de Domrémy, dans le procès de réhabilitation, on voit que le besoin de prier sans cesse, à toute heure, en tout lieu et en toute circonstance, était, dès son enfance, le trait caractéristique de la vie de la Pucelle. L’intensité de cette vie intérieure qui constituait tout son être se reflétait à tel point sur sa personne que l’usage s’établit, de bonne heure, de ne désigner la libératrice d’Orléans que par un seul mot : l’Angélique
.
Elle vivait depuis longtemps dans les deux par l’élan de sa prière, et elle y transportait plus ou moins, bon gré mal gré, tous ceux qui la voyaient. Par l’héroïsme de la vertu, la femme — et c’est son plus beau privilège — peut s’élever jusqu’à l’ange. Parvenue à ces hauteurs sublimes, elle devient invulnérable et en quelque sorte immatérielle. Si éclatante qu’elle puisse être, sa beauté cesse alors de faire appel aux sens ; on ne désire pas posséder les anges, on tremble devant eux et l’on adore à genoux devant leur face un reflet de l’idéal divin154.
Dès l’âge de treize ans, les Voix préparent Jeanne à sa mission, et deux vierges martyres, sainte Catherine et sainte Marguerite, se font en quelque sorte ses maîtresses pour la conduire dans l’amour de Dieu. L’archange saint Michel lui apparaît aux moments décisifs : Va, va, Fille de Dieu
, et, dans sa prison, elle a le confort de saint Gabriel.
Elle parlait très bien, multum bene loquebatur155, et tout en elle, exerçait une grande séduction156. Dieu lui avait donné l’autorité, le don du commandement ; chose inouïe, quand on pense que la Pucelle n’était qu’une paysanne, une jeune fille de dix-huit ans. Comment ne pas y reconnaître un reflet de l’action divine ?
Aujourd’hui, où avec raison, tout est passé au crible, l’analyse de ses actes de guerre, uniquement au point de vue technique, montre en elle le génie militaire, et un étranger, le général Dragomirov157, n’hésite pas à dire : Il n’est qu’une campagne qu’on puisse comparer à celle de Jeanne d’Arc sur la Loire, c’est la campagne d’Italie de Bonaparte !
Lorsque le succès n’a pas couronné ses efforts, on arrive même à constater que ses avis n’avaient pas été suivis et qu’ils eussent donné la victoire.
Le même examen nous montre en ses réponses l’habileté qui permet de ne jamais dire au delà de ce qu’on veut, et pendant son procès, elle ne se laisse surprendre par aucune argutie ; toujours ses paroles seront conformes à la doctrine la plus pure et à la théologie la plus éclairée.
Jeanne échappe aux lois ordinaires de la nature : si graves que fussent deux blessures reçues, l’une à l’assaut des Tourelles, l’autre sous les murs de Paris, ces blessures semblèrent ne pas exister pour elle ; Jeanne fut guérie sans aucun secours.
Eût-on pu rêver une plus belle glorification humaine que d’avoir été l’envoyée de Dieu, l’ange de la victoire !… et mourir à dix-neuf ans dans un combat !… Mais Dieu ne le voulait pas.
Au milieu de ses triomphes, les Voix lui annonçaient son martyre158, et elles ajoutaient
qu’il fallait que ce fût ainsi fait, de ne pas s’esbahir, et que Dieu l’ayderait.
Il fallait que ce fût ainsi fait !…
C’était la prison, c’était le bûcher !… Mais, la prison, le bûcher ne nous ont-ils pas révélé, encore mieux que dans ses triomphes, l’âme incomparable de Jeanne d’Arc ?…
Quelques auteurs se sont demandé si la mission de la Pucelle ne finissait pas à Reims ?… Elle devait y conduire le roi, pour recevoir l’onction divine ; et Dieu, après avoir miraculeusement manifesté à tous que le gentil dauphin
était son élu, n’aurait plus inspiré Jeanne d’Arc. Ainsi s’expliqueraient les victoires merveilleuses de la Pucelle, et comment, depuis son apparition jusqu’au sacre, les étendards royaux avaient, en quelque sorte, volé de clocher en clocher, tandis que, depuis Reims, la présence de Jeanne ne suffisait plus à assurer le triomphe.
Telle fut, en effet, la version que voulut accréditer la cour ; et nous en trouvons la preuve dans tous les témoignages apportés au procès de réhabilitation. Éclairé, peut-être, sur la faute qu’il avait commise, le roi cherchait-il à l’atténuer, en laissant croire qu’à Reims, le mandat, que Jeanne avait reçu de Dieu, se trouvait accompli ? L’histoire, au contraire, nous montre que si le roi eût suivi les inspirations de la Pucelle, Paris, la Normandie fussent tombés entre ses mains. Ne voyons-nous pas qu’au soir de Patay, Talbot prisonnier s’écriait : Maintenant, le roi Charles est maître de tout, il n’y a plus de remède !
mais ce n’était pas ce que voulaient les conseillers de Charles VII. Le rôle de Jeanne était devenu trop grand, trop prépondérant ; aussi, après Reims, ne cherchèrent-ils plus qu’à la perdre. — L’abandon vint des hommes, et non de Dieu…
Ce fut l’heure des politiciens, dont Jeanne sentait déjà les premières atteintes, lorsque le 6 août elle écrivait aux habitants de Reims : Des trêves ainsi faites, je ne suis point contente et ne sais si je les tiendrai…
La mission de Jeanne n’était donc pas finie ; mais les hommes refusèrent le don de Dieu.
Dans la nature, tout obéit inconsciemment à l’ordre de son Créateur ; l’homme seul jouit de son libre arbitre : supériorité magnifique, mais terrible, qui permet à l’homme de concourir à la volonté divine ou, à son gré, de s’en éloigner. Il ne peut cependant faire obstacle aux vues de Dieu ; or, Dieu, qui voulait sauver la France et, par elle, le catholicisme, reprit son œuvre par d’autres moyens ; et, comme Jeanne l’annonçait dans sa prison, avant sept ans l’Anglais fut, en effet, bouté hors de France159.
L’élan avait été donné ; l’appui de Dieu s’était manifesté ; le roi de Bourges était devenu le roi de France ; la force anglaise se trouvait brisée et l’on peut affirmer que Jeanne, par son bûcher, acheva la conquête commencée par ses victoires.
Si on a beaucoup écrit sur la Pucelle, aucun historien ne l’avait présentée telle qu’elle se montre à nous dans ses lettres : femme de haute intelligence qui eut le juste sentiment des intérêts en jeu dans les rapports avec le duc de Bourgogne et une sorte de prescience des destinées, pour lesquelles Dieu réservait la monarchie et la France.
Avec la Pucelle nous voyons la continuation de ce que le moyen âge avait appelé Gesta dei per Francos. Par elle s’accomplissent les gestes de Dieu !
Le savant père Ayroles, qui en cinq gros volumes a étudié la Pucelle, d’après Quicherat et les chroniques, en analysant tous les mouvements de son âme, tous les battements de son cœur, ne craignait pas de mettre comme épigraphe à son ouvrage : À la plus méconnue des femmes.
Pour bien comprendre tout ce que fut Jeanne d’Arc, il faut non seulement l’étudier en elle-même, mais envisager dans quelles circonstances elle parut, et quel était à ce moment l’état de la France, de l’Église et de l’Europe.
Il appartenait à l’historien de Richelieu de nous révéler des aperçus nouveaux sur la personnalité de la Pucelle et sur la mission divine qui lui était confiée. C’est en homme d’État que M. Hanotaux l’a considérée, avec les perspectives et la hauteur de vue que lui donnait d’avoir dirigé, comme ministre, nos affaires extérieures.
À certains carrefours d’histoire, — nous dit-il, — des êtres admirablement doués et organisés paraissent : leur existence est un prodige et leur mémoire ne s’effacera jamais. Sur le fait et les causes de leur apparition, toutes les tentatives d’explication rationnelle sont vaines. Ils naissent parce qu’ils doivent naître. Leur astre paraît et disparaît comme un météore. Leur mission accomplie, ils tombent, laissant derrière eux une longue traînée de lumière.
Jeanne d’Arc fut un de ces êtres prédestinés. Le critérium comparé des grands esprits et des âmes supérieures la place sans conteste à ce rang. Considérées ainsi, son apparition et sa parabole échappent aux calculs humains comme celles d’un Alexandre le Grand, d’un Mahomet, d’un Napoléon, d’un Pasteur160.
Et il déclare que :
De ces volontés célestes, révélées par des faits terrestres, la divinité n’a pas à rendre compte à la raison humaine. Il faut reconnaître pourtant que, s’il s’est présenté, depuis la mort du Christ et la conversion de Constantin, une circonstance où, au point de vue chrétien et spécialement catholique, l’intervention de la Providence ait pu paraître nécessaire, c’est à l’heure où parut Jeanne d’Arc. […] Si la volonté divine eut jamais à corriger ou à prévenir les conséquences des erreurs humaines, ce fut alors161.
Après nous avoir montré les motifs de la mission céleste, voici en quels termes M. Hanotaux étudie Jeanne en elle-même :
Entre sainte Catherine de Sienne, sainte Brigitte, sainte Colette de Corbie et Jeanne d’Arc — pour ne parler que des femmes, — les ressemblances sont nombreuses et ont été bien des fois signalées. […] Ces femmes
visionnaireset les hommesvisionnaires, comme saint François d’Assise, saint Bernard, saint Vincent Ferrier, etc., sont à la fois de très grands cœurs et de très grands esprits, créateurs, réformateurs, organisateurs, inspirateurs en même temps qu’inspirés. Personnages à la tête ferme, au regard sûr, à la main prudente et délicate, voyant le mal et le corrigeant, agissant avec autorité et perspicacité pour le bien, ils sont des meneurs d’hommes et de peuple162.
La
visionest, en somme, la suprême retraite de la personnalité, de la personnalité active, indépendante et volontaire. Elle est le refuge dans le sein de Dieu pour y capter la force de Dieu. Elle est la source desvocations; elle retombe sur le cœur d’où elle s’élance, comme un jet d’eau rejaillit sur lui-même, du ciel. […] Le propre de Jeanne d’Arc fut d’appliquer l’autorité de lavisionet de l’inspiration célestes aux actes de la vie civile et laïque. Sur ce champ qui échappe en partie à la religion, elle se fait une loi d’agir conformément à la volonté divine, ayant le sentiment, réaliste et nouveau, que leschoses du sièclesont, non moins que celles de la religion, sous le regard de Dieu. […]Comme il était fait et créé, ce cœur écoutait en lui-même
la voixqui était celle de son Créateur et de son objet, Dieu. L’amour de Dieu était la seule jouissance qui pût le satisfaire, et la volonté seule à laquelle il pût se ranger. Or, la volonté divine ne doit viser que des choses grandes, surhumaines, les plus grandes choses et lesplus surhumainesque l’on pût concevoir ou rêver en ce temps. Pour une catholique et pour une Française, la plus grande chose, laplus surhumaine, celle qui tirait tout ensemble de l’abîme, l’État et l’Église, n’était-ce pas le salut du royaume de France ?Il ne fallait pas moins que la vertu courageuse de Jeanne d’Arc pour bien fixer les destinées de la France et orienter, dans une crise unique, celles du monde163.
Ces conclusions, qui nous sont apportées par un esprit critique des plus éminents, nous montrent qu’en ne se laissant guider que par la seule raison, ont arrive, en étudiant Jehanne d’Arc, à la contemplation des choses divines. C’est que, pour la comprendre, il faut, avec elle, s’élever au-dessus des contingences humaines.
Dieu premier servi ! Ces mots nous livrent toute la vie de Jeanne, toute son âme, toute sa raison d’être. Ces trois mots que, dans leur concision, elle jeta à ses juges lors de sa condamnation, nous révèlent la constante préoccupation de son esprit. Tout en elle tend à Dieu et est fait en vue de Dieu ; c’est la perfection que Dieu demande à ses saints. Saint Paul ne nous dit-il pas que toutes les vertus sont vaines sans la charité ?… Or, la charité, mot mal interprété lorsque l’on y voit uniquement le bien qu’on doit faire aux déshérités, a, comme véritable signification, l’amour de Dieu164. Et Bossuet affirme que Dieu nous comptera un soupir et un verre d’eau donné en son nom165 ; mais il faut que ce soit en son nom. Comme le disait Jeanne : Dieu premier servi !
Telle est cette âme que ses ennemis, pour se laver eux-mêmes de leur forfait, avaient voulu dénaturer et réduire à notre commune mesure. Par des mensonges habilement présentés et avec une audace inouïe, ils avaient cherché à travestir les sept derniers jours de la vie de la Bienheureuse ; mais, pour reconnaître cette âme incomparable, il suffit de s’attacher à ses pas.
En rétablissant, minute par minute, les agissements des juges et l’attitude de la Bienheureuse, nous l’avons vu, à Saint-Ouen et dans l’interrogatoire du 28 mai, aussi grande, aussi héroïque qu’elle le fut pendant toute sa vie. Dans cet interrogatoire secret du 28, où sept juges choisis avec soin se sont donné pour mission de la trahir devant l’histoire, nous n’avons eu qu’à reprendre ses réponses pour retrouver la vérité et que cette vérité confonde ses juges.
En toutes ces occurrences, Jeanne reste tellement française de vivacité, de cœur et d’esprit, que par toutes ses fibres on la sent une des nôtres. Si elle élève la nature humaine, elle reste cependant humaine. Elle est au-dessus de nous, mais nous la touchons, nous la comprenons. De là vient qu’elle est la sainte charmante, séduisante, aimée de tous : elle est la Française par excellence.
III. Les lettres jusqu’à nos jours
Après cet aperçu rapide sur la vie intérieure de Jeanne, revenons à l’histoire de ses lettres depuis 1630 jusqu’à nos jours.
Nous avons vu, par Peiresc, que Charles du Lys possédait non seulement les lettres, mais aussi une tapisserie se rapportant à Jeanne d’Arc, et une médaille du temps représentant la Pucelle. À ces précieux objets, il faut ajouter une épée qu’elle avait portée et aussi une reproduction de son étendard.
Ces souvenirs, tels que les avait laissés Charles du Lys, avaient été pieusement recueillis au château de Mons en Poitou, terre patrimoniale de sa petite-fille, Anne de Barentin. Ils y sont restés jusqu’au moment où, dans le château du Vigean, construit par le marquis de Maleissye, leur fut consacrée une salle spéciale (1780). Sur un autel se trouvait l’épée de la Pucelle et à côté son étendard. On y voyait les tapisseries et tous les objets qui pouvaient se rattacher au souvenir de Jeanne d’Arc.
Cette terre du Vigean, d’où relevait la ville de l’Isle-Jourdain (Poitou), avait les droits seigneuriaux les plus importants ; aussi les premiers troubles révolutionnaires eurent-ils pour effet de faire brûler sur la place publique tous les titres relatifs à ces droits. En même temps, disparurent nombre de pièces très rares, qui provenaient du cabinet de Charles du Lys
, entre autres, l’original d’une charte de saint Louis de l’an 1235, dont parle Peiresc dans une lettre du 26 juillet 1625 et qui venait également de Reims.
Comment une foule égarée ne mit-elle pas, également, les lettres de Jeanne d’Arc dans le brasier où l’on jetait tout au hasard ?… C’est déjà merveilleux. On est encore plus étonné qu’elles aient échappé au désastre de la Révolution, lorsqu’on sait qu’accusé d’avoir fomenté le complot du Luxembourg, le marquis de Maleissye166, sa femme et deux de ses filles périrent sur l’échafaud révolutionnaire (21 messidor an II)167.
Avec les perquisitions faites pour une soi-disant conjuration, comment les lettres de Jeanne d’Arc ont-elles pu ne pas être confisquées et détruites ?… car tout disparut alors : épée, étendard, tapisserie et tous les autres souvenirs.
M. de Maleissye laissait trois fils, tous trois émigrés, servant à l’armée des princes. Seule, se trouvait en France sa fille aînée, la marquise de Goulaine168, femme d’une énergie exceptionnelle ; de Bretagne, elle accourait en Poitou, à Paris pour empêcher les confiscations, défendre les intérêts des siens, et c’est à elle que l’on doit d’avoir sauvé les lettres de Jeanne d’Arc. Ne pouvant songer à les emporter et n’ayant confiance en aucune cachette, ce fut à la terre, dans un trou profondément creusé, qu’elle-même les confia169.
La terre du Vigean fut vendue après la Révolution ; les lettres et toutes les archives de Charles du Lys furent ensuite conservées au château d’Houville, près Chartres, où se trouvent encore tous ces précieux documents.
Si de nombreux admirateurs sont venus les y contempler, ces lettres restaient cependant presque ignorées ; et à propos d’un fait, qu’on pourrait appeler un miracle, j’eus occasion de constater combien il était nécessaire de les faire connaître et d’en établir l’authenticité d’une manière indiscutable. Ce fait extraordinaire fut examiné à Rome pour la béatification ; mais si frappée qu’elle en fût, la Commission crut ne pouvoir faire état de cette guérison miraculeuse, obtenue par l’attouchement des lettres, dont l’origine et l’authenticité n’avaient pas été suffisamment étudiées. Plus tard, toutes les preuves apportées à l’un des membres de la Commission provoquaient cette exclamation : Ah ! si nous avions su170 !
Cette prudence de la Commission était la même qui, au cours du procès de béatification, ne permettait pas de proclamer Jeanne d’Arc bienheureuse, tant que n’aurait pas été éclaircie la scène du cimetière de Saint-Ouen.
Toutes les merveilles de la vie de Jeanne ne pouvaient suffire si l’héroïcité de ses vertus avait faibli, ne fut-ce qu’un seul jour !
Le cardinal Parocchi, ponent de la cause, avait déclaré à l’évêque d’Orléans que s’il ne trouvait pas un historien en mesure de prouver par les documents que cette prétendue abjuration canonique de la Pucelle était un faux inventé par Cauchon, il fallait renoncer à voir Jeanne d’Arc béatifiée.
À toute tentative future de canonisation, l’évêque de Beauvais avait en effet dressé un obstacle insurmontable par le seul fait de la présence au procès de cette abominable cédule comme pièce soi-disant officielle et authentique. Ce ne fut qu’en 1901 qu’une étude critique de M. l’abbé Dunand171 établissait la thèse précisée par le cardinal Parocchi.
Si complète que fût cette étude, nous apportons aujourd’hui, grâce aux lettres, et en établissant que Jeanne savait signer, la preuve matérielle du faux commis par l’évêque de Beauvais.
Les intérêts coalisés de tous ceux qui s’étaient attachés à la fortune de l’Angleterre et de tous ceux qui, dans le parti royal, avaient abandonné Jeanne, la poursuivirent même après sa mort, en cherchant à étouffer sa mémoire dans le silence et l’oubli.
Pour ne pas reconnaître la main de Dieu dans les victoires de Jeanne, qui avaient eu un tel retentissement, le XVIIIe siècle, dans son scepticisme, voulut prolonger cet oubli ; mais le souvenir de la Pucelle n’en était pas moins resté dans l’âme du peuple comme un mythe glorieux qui dominait toute notre histoire.
Il était réservé à notre siècle de critique et de positivisme de vouloir approfondir la mission de Jeanne. Or, plus on examine sa vie et plus on l’analyse ; plus on étudie ses pensées et plus on scrute son âme, plus on arrive à trouver que sa hauteur morale l’élève encore au-dessus des grandes choses qu’elle a faites.
Le temps qui la vit, les siècles qui suivirent s’épuisent à l’expliquer172.
L’Église seule, en plaçant Jeanne sur les autels, apporte une explication qui satisfasse pleinement la science et la raison.
Cimier173 de Charles du Lys
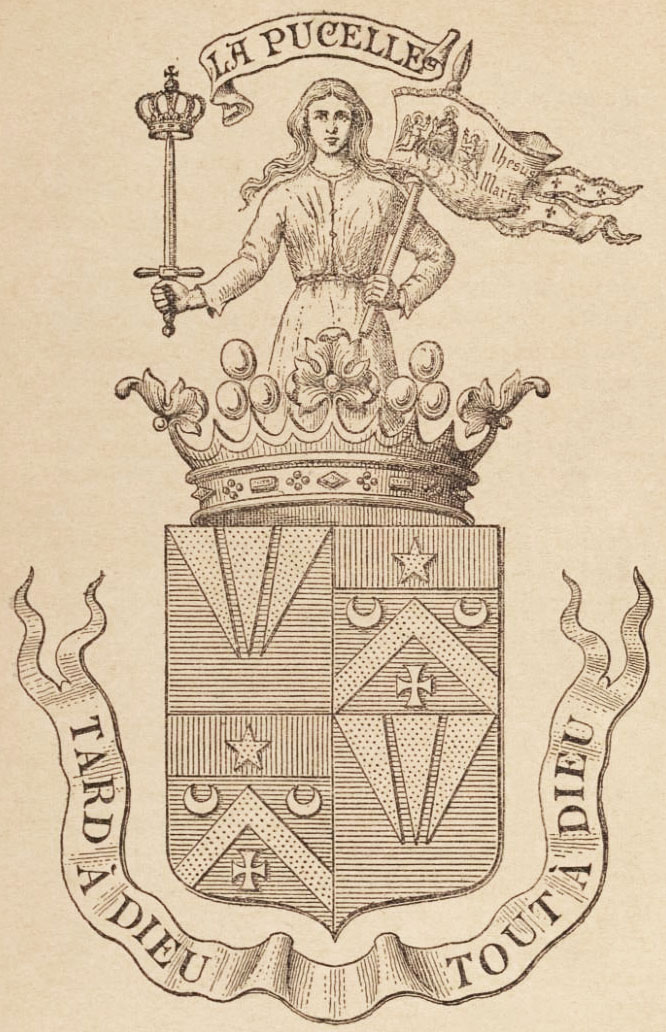
(Lettres patentes de 1612)
Fin
Notes
- [1]
L’ouvrage parut d’abord sous forme d’article dans la Revue des Deux Mondes du 1er février 1911, avant d’être édité séparément dans la présente version six mois plus tard, précédé d’un avant-propos et d’une préface de l’académicien Gabriel Hanotaux.
- [2]
Comte de Maleissye, Reliques de Jehanne d’Arc, ses lettres (1909).
- [3]
Germain Lefèvre-Pontalis (1860-1930), archiviste-paléographe, ancien élève de l’École des chartes (1879-1883), il fut secrétaire d’ambassade, attaché aux archives du ministère des affaires étrangères.
- [4]
André Marty (1857-1928), imprimeur lithographe, et éditeur d’art.
- [5]
Les fac-similés des lettres par M. Marty n’ont été tirés qu’à 150 exemplaires pour l’édition de luxe ; — mais c’est avec une fidélité scrupuleuse qu’ont été faites les reproductions au trait que nous donnons et qui ont été naturellement réduites au format de notre publication.
- [6]
Henri Jadart, Jeanne d’Arc à Reims (1887). Notes additionnelles, p. 23. Le lecteur y trouvera les détails des pourparlers dont mon frère m’avait alors entretenu.
- [7]
L’abbé François-Xavier Hertzog (1857-1945), procureur général de Saint-Sulpice, fut l’un des principaux artisans de la béatification de Jeanne (1909) au côté de Mgr Touchet (1848-1926), évêque d’Orléans, du père Ayroles (1828-1921) et de Mgr Henri Debout (1857-1936).
- [8]
Les lettres de Jeanne d’Arc n’ont jamais été ni perdues ni ignorées. Les mots : heureuse découverte, employés dans la lettre du Saint-Père, s’appliquent au sens intime des lettres et à leur valeur historique. — C’est dans ce même sens que M. Hanotaux termine sa préface, en disant :
Pouvait-on espérer une découverte à la fois plus lumineuse et plus émouvante ?
- [9]
Mgr Stanislas-Arthur-Xavier Touchet (1848-1926) fut surnommé l’
évêque de Jeanne d’Arc
pour son rôle tout au long du procès en canonisation.- 1894 : introduction de la cause par Léon XIII ;
- 1897 : ouverture du procès en vue d’étudier l’héroïcité des vertus ;
- 1904 : proclamation de l’héroïcité des vertus par Pie X ;
- 1909 : béatification par Pie X ;
- 1920 : canonisation par Benoît XV ;
- 1922 : proclamation de sainte patronne secondaire de la France par Pie XI.
- [10]
Gabriel Hanotaux (1853-1944), élève de Jules Quicherat à l’École des chartes, mena de front une carrière d’historien et de diplomate. Durant toute la cause de canonisation, c’est lui qui représenta la France comme ambassadeur extraordinaire au Vatican.
- [11]
Archives du Nord, à Lille.
- [12]
Les deux petites barres que l’on retrouvera dans toutes les traductions sont mises pour indiquer où finit chaque ligne, si l’on veut se reporter à l’original.
- [13]
De bon cœur.
- [14]
Il est prêt à faire la paix avec vous, sauf son honneur, si vous ne vous y refusez.
- [15]
Vous, vos gens ni sujets.
- [16]
Soyez sûrs.
- [17]
Les mots que quelque nombre sont répétés deux fois.
- [18]
Pas.
- [19]
De ceux qui y viendront.
- [20]
Et depuis je n’ai eu aucune nouvelle du dit hérault.
- [21]
Vous recommande à Dieu.
- [22]
G. Hanotaux, Jeanne d’Arc (1911), p. 197.
- [23]
Archives du marquis de Maleissye.
- [24]
Que vous n’ayez nulle inquiétude.
- [25]
À condition qu’il lui doive rendre la cité de Paris pacifiquement au bout de quinze jours.
- [26]
D’autant.
- [27]
Croyez bien aussi qu’il ne dépriseront pas le sang royal.
- [28]
Au bout.
- [29]
Tourment.
- [30]
Traîtres.
- [31]
Les mots qui vous veillent grever sont écrits en surcharge. Et me faites savoir s’il y a quelques traîtres qui vous veuillent nuire.
- [32]
L’adresse paraît indiquer un campement sur la route de Paris.
- [33]
G. Hanotaux, Jeanne d’Arc (1911), p. 212.
- [34]
Archives de la ville de Riom.
- [35]
Saint-Pierre-le-Moûtier.
- [36]
Provisions.
- [37]
Autant.
- [38]
De par deçà veut dire : les autres qui sont avec moi, qui sont ici, qui sont de par deçà.
- [39]
Provisions.
- [40]
Provisions.
- [41]
Le mot bon, bien qu’écrit en toutes lettres, porte une abréviation.
- [42]
Th. Cochard, Existe-t-il des reliques de Jeanne d’Arc ? (1891), p. 19.
- [43]
Selon Philippe de Bergame (De claris electisque mulieribus, 1497, cap. CLVII.), Jeanne avait les cheveux noirs :
Erat nigro… capillo.
- [44]
Procès, t. V, p. 147.
- [45]
Archives du marquis de Maleissye.
- [46]
Que je désirerais bien voir, je Jehanne la Pucelle ai reçu vos lettres.
- [47]
Vous redoutiez.
- [48]
Veuillez savoir que vous ne l’aurez point, si je les puis rencontrer bientôt.
- [49]
Et s’il arrivait que je ne les rencontrasse pas et qu’ils vinssent devant vous, fermez vos portes.
- [50]
Car je serai bientôt près de vous.
- [51]
Chausser.
- [52]
En telle hâte.
- [53]
Et si le siège était mis, je le ferais lever si bref que ce sera bientôt.
- [54]
Un mot effacé, choyaux, prouve que le scribe écrivait comme il entendait, et par conséquent que Jeanne dictait séance tenante. — Ce serait une nouvelle preuve que Jeanne savait lire, car la correction, faite immédiatement dans le texte, prouve que Jeanne lisait à mesure qu’écrivait son scribe, et elle a fait remplacer le mot
choyaux
parjoyeux
. Dans la lettre du 6 août, au contraire, lettre qui n’est pas signée, toutes les corrections sont en surcharge, ce qui indique qu’elles n’ont été faites qu’après coup, lorsque Jeanne s’est fait relire sa lettre. - [55]
Joseph Stevenson, Letters and Papers (1861), t. I, p. 34-50. — P. Ayroles, La vraie Jeanne d’Arc, t. III (1897), p. 553-557.
- [56]
Voir la lettre de Peiresc.
- [57]
Voir la lettre de Quicherat.
- [58]
Francis Pérot, Jeanne d’Arc en Bourbonnais (1889), p. 13.
- [59]
Archives du marquis de Maleyssie.
- [60]
Manants.
- [61]
Plaise.
- [62]
Reçu.
- [63]
Sachez donc qu’il est bien vrai qu’on le lui a rapporté, en effet.
- [64]
Alliance veut dire complot. Les cinq mots qui suivent : lesqueux estoient d’une alliance, répétaient la même pensée. — En relisant la lettre, la Pucelle les a donc fait annuler, non en les barrant, mais par un pointillé au-dessous. Ce détail affirme une lettre prise immédiatement sous la dictée.
- [65]
Trahir.
- [66]
Parce que vous en avez envoyé l’assurance.
- [67]
Si.
- [68]
Il vous secourrait en cas de siège.
- [69]
Il vous en délivrera bien vite, s’il plaît à Dieu.
- [70]
Le mot amiz est en surcharge.
- [71]
On a effacé trois mots que l’on commençait à écrire,
et que v…
, pour introduire les mots :pour le Roy
, qu’oubliait le secrétaire ; ce qui confirme la remarque déjà faite pour la lettre du 16 mars, à savoir que l’on prenait les lettres immédiatement sous la dictée de Jeanne. Tout en dictant, elle lisait ce qu’écrivait son secrétaire, puisqu’elle l’a interrompu pour compléter sa pensée. - [72]
La même observation s’applique à un mot commencé et rayé peut-être :
à présent
, pour mettre :Autre chose quant à présent ne vous écris, si ce n’est que toute la Bretagne est française
. - [73]
On avait écrit d’abord trois et on a mis le chiffre IIII en surchage.
- [74]
Confie.
- [75]
Le mot trois a été effacé, et on a mis le chiffre IIII en surcharge.
- [76]
Procès, p. 31.
- [77]
G. Hanotaux, Jeanne d’Arc, p. 222.
- [78]
J’ai tenu à contrôler, par d’autres avis, mes observations personnelles, et il m’a paru que c’était en m’adressant à des instituteurs primaires que j’aurais la meilleure source de renseignements. Tous sont arrivés aux conclusions que je donne.
L’un d’eux, instituteur laïque, ayant près de trente ans de pratique, assez intelligent pour s’être intéressé aux vieux registres de sa commune, me faisait des réponses tellement positives que je tiens à les reproduire. Je ne lui avais pas dit le but que je poursuivais, ni qu’il s’agissait de Jeanne d’Arc. À propos de vieux registres, je lui montrai la signature de Riom, lui disant :
— Voilà une personne qui devait signer pour la première fois ou à peu près ?
— Oh ! cela non, répondit-il, les jambages sont trop bien faits.
J’insistai de nouveau. Il répondit :
— Cette personne pouvait encore se tromper sur le nombre de jambages, mais elle avait bien l’habitude de signer.
— On devait lui tenir la main ? ajoutai-je.
— Oh ! jamais, ce n’est pas possible avec la manière dont sont formées les lettres.
Lui montrant ensuite la signature du 16 mars :
— Ah ! dit-il, c’est joliment bien écrit et d’une personne sachant tout à fait écrire.
Quand, après ces réflexions, je lui fis connaître que les trois signatures étaient de Jeanne d’Arc, très étonné, il ajouta :
— On reconnaît bien la même écriture. Comme elle savait écrire !
- [79]
Procès, t. III, p. 48. Déposition de Jean Tiphaine.
- [80]
Jean de Châtillon, ou plutôt de Castiglione, Italien, devint par la suite, en 1444, évêque de Coutances, en 1453 évêque de Pavie, puis cardinal. (Beaurepaire, Notes sur les juges, 1890, p. 114.)
- [81]
Procès, t. I, p. 392.
- [82]
Cette réunion extraordinaire n’avait qu’un but : confondre Jeanne au sujet du signe au roi, car Jean de Châtillon lui déclare :
Attendu les mensonges évidents que vous avez dits au sujet de la couronne apportée à Charles (chose que ceux de votre parti comme des autres savent n’être que fictions et impostures, etc.)…
Ne devrait-on pas croire, d’après cette phrase et plusieurs autres, que les membres du Conseil de Charles VII, ennemis de Jeanne, seraient intervenus par une secrète communication au sujet de ce qui s’était passé à Chinon en mars 1429 ? - [83]
Procès, t. I, p. 62-65.
- [84]
Comment les Anglais ont-ils pu avoir la copie de cette lettre ? Nous y voyons encore un indice trop certain que, même dans le parti de Charles VII, Jeanne avait des ennemis qui cherchaient à la perdre.
- [85]
La note 54 qui accompagne la traduction de la lettre du 16 mars 1430 et les notes 71 et 72 de la traduction de la lettre du 28 mars ont une telle importance pour établir que Jeanne savait lire, que je demande instamment au lecteur de s’y reporter. — Ces notes fournissent des preuves qu’on peut dire matérielles.
- [86]
Procès, t. I, p. 55.
- [87]
Procès, t. I, p. 239.
- [88]
Procès, t. I, p. 85 et 183.
- [89]
P. Ayroles, La vraie Jeanne d’Arc, t. I (1890), p. 303.
- [90]
C’est à tort que l’on a souvent indiqué Jean de Mailly parmi les juges de Jeanne. Il n’a assisté qu’à la séance du 23 mai, à celle de Saint-Ouen le 24, et enfin le 30 au supplice, où il fut requis, de même que tous les évêques cités plus haut. À l’exception de Cauchon, aucun des évêques ne condamna Jeanne d’Arc.
- [91]
Cauchon mourut évêque de Lisieux en 1442 — Les habitants de Beauvais ne lui avaient jamais permis de rentrer dans leur ville.
- [92]
Jean Juvénal des Ursins.
- [93]
Massieu, déposition de 1452, Procès, t. II, p. 331.
- [94]
Massieu, déposition de 1456, Procès, t. III, p. 157.
- [95]
Beaurepaire, Recherches sur le Procès de condamnation, p. 114.
- [96]
Massieu, déposition de 1450. Procès, t. II, p. 17.
- [97]
Massieu, déposition de 1452, Procès, t. II, p. 331.
- [98]
Massieu, déposition de 1456, Procès, t. III, p. 156.
- [99]
On connaît le rôle indigne et odieux de Loyseleur qui, sous un déguisement, s’était introduit près de Jeanne, feignant d’être un compatriote, un ami dévoué et un sujet fidèle du roi Charles VII. Il lui disait ne pouvoir pénétrer près d’elle qu’en cachette, tandis que, sur l’ordre de Cauchon, toutes les portes s’ouvraient devant lui. Il avait mission de surprendre les confidences de Jeanne. Ce même homme, au conciliabule tenu chez Cauchon le 12 mai, opinait que la torture serait un bon remède pour son âme.
- [100]
Mot impropre, car, dans cette cédule, Jeanne ne rétractait rien de sa mission.
- [101]
Le texte latin porte :
Et sub hac conditione et non alias hoc fecit, legendo post aliam (alium ?) quamdam parvam schedulam.
[Elle le fit sous cette condition, et non autrement, lisant ensuite une petite cédule.]
Ce texte est formel ; ce fut Jeanne qui lut elle-même.
- [102]
Procès, t. III, p. 52.
- [103]
Jeanne devait-elle refuser la planche de salut qui paraissait lui être offerte ? Investie d’une mission divine, son devoir était de ne rien négliger pour conserver sa vie, pourvu que ce fût sans désobéir à ses Voix.
- [104]
Procès, t. III, p. 147. Manchon, qui fut chargé, plusieurs années après, de rédiger en latin le compte rendu du procès, ne le fait qu’en termes très vagues pour ce qui se rapporte à Saint-Ouen. Comme le fait remarquer le P. Ayroles, t. V, p. 168, Manchon ne pouvait pas s’expliquer clairement sans se déclarer coupable d’un nouvel acte de lâcheté.
- [105]
Guillaume du Désert emploie les termes suivants (Procès, t. II, p. 338) :
Quod erat una derisio.
- [106]
Jean de Mailly, évêque de Noyon, appartenait aux Mailly l’Orsignol, branche cadette de la maison de Mailly, dont le chef, Colard de Mailly, régent de France pendant la folie de Charles VI, commandait la noblesse de Picardie sous 40 bannières à la bataille d’Azincourt et y périt avec ses deux fils, son gendre et deux autres bannerets du nom de Mailly.
- [107]
Procès, t. III, p. 55.
- [108]
L’article 6 concernait la croix mise au bas de ses lettres comme signe de dénégation.
- [109]
Paroles de Pierre Maurice dans son exhortation.
- [110]
Procès, t. I, p. 440-441.
- [111]
Procès, t. I, p. 399-402.
- [112]
Jean, XV, 4.
- [113]
Procès, t. I, p. 445.
- [114]
P. Ayroles, La vraie Jeanne d’Arc, t. V (1902), p. 418.
- [115]
Procès, t. I, p. 191.
- [116]
Procès, t. II, p. 223.
- [117]
Procès, t. III, p. 55.
- [118]
Procès, t. III, p. 55.
- [119]
Procès, t. III, p. 147.
Ce sourire nous montre une âme entièrement entre les mains de Dieu, et qui attend tout de Notre-Seigneur :
— J’ai demandé à mes Voix si je serais brûlée, elles m’ont répondu de m’en attendre à Notre-Seigneur et qu’il m’aidera.
- [120]
Procès, t. III, p. 149.
- [121]
Déposition de Manchon.
- [122]
Nous devons nous étendre assez longuement sur la question de l’habit viril, parce que bien des auteurs ont considéré l’abandon de ce costume comme le signe de l’abjuration faite par la Pucelle ; et que, tout en l’excusant de l’avoir repris pour la défense de sa vertu, elle aurait par cet acte manqué à son serment.
- [123]
Cette déposition montre que Cauchon et ses assesseurs avaient renouvelé les engagements pris par Érard, comme nous venons de l’établir :
les juges lui avaient promis
. - [124]
Procès, t. III, p. 149.
- [125]
Procès, t. I, p. 177. (4)
- [126]
À la séance du 15 mars en particulier, lorsqu’on lui certifie qu’elle entendra la messe si elle se met en habit de femme (Procès, t. I, p. 165) :
— Et que me dites-vous si j’ai promis et juré à notre roi de ne pas quitter cet habit ? Toutefois je vous réponds : Faites-moi faire une robe longue jusqu’à terre, sans queue ; baillez-la-moi pour aller à la messe, et puis je reprendrai l’habit que j’ai.
- [127]
Procès, t. III, p. 149.
- [128]
Procès, t. I, p. 247.
- [129]
D’après ces témoins, Jeanne se serait plainte à eux d’avoir été
battue et deschoullée
. Ce mot deschoullée signifie : jetée par terre, foulée aux pieds. (Procès, t. III, 8, pièces de condamnation et de réhabilitation.) - [130]
Ce surnom la Pucelle lui venait du Ciel, comme le prouve la réponse qu’elle fit le 12 mars à ceux qui lui demandaient (Procès, t. I, p. 130) :
— Vos Voix vous ont-elles appelée fille de Dieu, fille de l’Église, fille au grand cœur ?
— Avant le siège d’Orléans levé, et depuis tous les jours quand elles me parlent, elles m’ont appelée plusieurs fois Jeanne la Pucelle, fille de Dieu.
- [131]
Procès, Déposition de Miget.
- [132]
Procès, déposition de Manchon.
- [133]
Les deux allégations que Jeanne d’Arc se serait rétractée par crainte du feu et que les Saintes lui auraient dit la grande pitié de sa trahison ne sont que la continuation du brigandage judiciaire de Saint-Ouen. — Les faits, les témoignages que nous avons rapportés, l’établissent d’une manière positive, et le seul examen du procès-verbal fait ressortir le mensonge par la contradiction absolue entre ces allégations et la réponse si affirmative de Jeanne :
Item dixit quod si dixisset quam Deus non misisset ipsam damnaret se, quod veraciter Deus ipsam misit.
[De même elle dit que si elle avait dit que Dieu ne l’avait pas envoyée, elle se serait damnée, car en vérité, Dieu l’avait envoyée.]
Le greffier ajouta en marge :
Responsio mortifera.
- [134]
Le P. Ayroles, M. Marius Sepet, le chanoine P. Dunand et l’abbé Ulysse Chevalier ont démontré d’une manière tellement péremptoire la substitution des pièces que je n’ai pas à revenir sur cette question déjà jugée.
- [135]
Au procès de réhabilitation, ils affirmeront que Jeanne n’a jamais renié sa mission ; et cependant, dans de nombreux détails, on retrouve les acolytes de Cauchon. L’invraisemblance des confidences que Jeanne leur aurait faites devient une impossibilité si on réfléchit au peu d’instants qui s’écoulèrent entre l’arrivée des Dominicains à la prison et le départ pour la place du Vieux-Marché, où Jeanne était rendue à 8 heures du matin. Or, Jeanne a tenu à se confesser deux fois. Ce seul détail prouve que la Sainte ne s’était pas répandue en vaines paroles, surtout après avoir reçu la sainte Communion.
- [136]
Procès, t. II, p. 334.
- [137]
Cauchon excommuniait Jeanne et permettait en même temps qu’on lui donnât la sainte Communion. N’était-ce pas pour qu’on pût en déduire qu’elle s’était véritablement soumise au tribunal ?… Il faudrait y voir la continuation du plan que nous avons dévoilé. Cependant, nous préférons croire que Cauchon, qui, pour condamner Jeanne d’Arc, venait de fouler aux pieds toutes les lois canoniques, eut dans sa conscience de prêtre un réveil qui le fit s’écarter des règlements ecclésiastiques pour accorder à sa victime cette dernière consolation.
- [138]
En la prédication,
elle eut grant constance et moult paisiblement l’ouït. […] En réquérant à toutes manières de gens, tant de son parti que d’autre, qu’ils voulsissent prier pour elle, en leur pardonnant le mal qu’ils lui avaient fait. (Procès, t. II, p. 19.)
- [139]
De l’Averdy. — Les Anglais avaient tenu à convoquer toutes leurs troupes disponibles pour que les soldats constatassent de leurs yeux la destruction de l’héroïne qui était pour eux une cause de terreur.
- [140]
Jeanne nous laisse entendre quels secours particuliers elle devait recevoir de Dieu, lorsque le Mardi-Saint, 27 mars, elle répond :
— Si les juges refusent de me faire ouïr messe, il est au pouvoir de Notre-Seigneur de me la faire ouïr sans eux, quand il lui plaira.
- [141]
Jeanne d’Arc avait trois frères : Jacquemin, Jean et Pierre.
I. L’aîné, Jacquemin, eut deux enfants : Jeanne, qui épousa Jean de Lys, son oncle, second frère de la Pucelle ; Jean qui suit.
II. Jean d’Arc du Lys (le jeune), né vers 1430, suivit la profession des armes où il se distingua, et fut très aimé par le roi Louis XI qui le nomma échevin de la ville d’Arras par lettres patentes données à Chartres en juillet 1481, enregistrées en la Cour des aides le 10 septembre de la même année. Il y est dit que le roi le nomma
eschevin lorsqu’il eut pris cette ville et qu’elle était toute détruite et dépeuplée, pour veiller à la relever et la repeupler de sujets loyaux et fidèles
. Jean mourut en 1493 à Lihons-en-Santerre (Picardie), où il s’était réfugié après avoir été pillé et dépouillé par les partisans de Maximilien lorsqu’ils s’emparèrent d’Arras en 1491. Il eut pour fils :III. Jean du Lys, dit le Picard, ou le capitaine Grand-Jean, compagnon d’armes de Bayard, mort en 1540, laissant un fils :
IV. Michel du Lys, gentilhomme ordinaire du roi Henri II, mort en 1062, lequel fut père de :
V. Charles du Lys, dernier représentant mâle de la famille de Jeanne d’Arc, n’eut qu’une petite fille laissant postérité : Anne de Barentin, marquise de Maleissye, 1684.
Pour indiquer la situation acquise par la famille de Jeanne d’Arc, Bouteiller nous dit que la petite-fille de Charles du Lys se trouvait être nièce d’une Montmorency-Laval et tante de quatre ducs et pairs. (Bouteiller et Braux, La famille de Jeanne d’Arc, p. 2, 9, 82, 116, 212, 262, etc. Comte de Maleissye, Les reliques de Jeanne d’Arc, p. 71-84.)
- [142]
Vallet de Viriville, Opuscules historiques relatifs à Jeanne d’Arc, chez Auguste Aubry, 1856.
- [143]
Boucher de Molandon, La famille de Jeanne d’Arc (1878), p. 92-99, et 115-121. Note de M. B. de Molandon :
Marie de Quatrehommes, fille de Louis de Quatrehommes et de Françoise du Lys, épousa, en 1654, Achille de Barentin, conseiller au Parlement de Paris, frère de Jacques de Barentin, premier président du Grand Conseil. Des onze enfants nés du mariage de Marie de Quatrehommes et d’Achille de Barentin, une fille Anne de Barentin eut seule postérité. Elle s’unit, en 1684, à Jacques de Tardieu, marquis de Maleissye et de Melleville, capitaine aux gardes françaises, mort en 1694, dont quatre fils.
Charles-Étienne de Tardieu, comte de Maleissye, arrière-petit-fils de Jacques de Maleissye et d’Anne de Barentin, est mort à Houville le 1er novembre 1872, laissant après lui le souvenir vénéré des plus éminentes qualités. Son dévouement dans la guerre néfaste de 1870. fut au-dessus de tout éloge. Ancien officier* et presque septuagénaire, il fit, comme volontaire, les campagnes de la Loire et du Mans. Son fils aîné** était chef de bataillon des mobiles d’Eure-et-Loir ; un autre de ses fils, capitaine***.
* Le comte de Maleissye, démissionnaire en 1830, avait été mis à l’ordre du jour de l’armée d’Afrique pour les combats de Chapelle et Fontaine et une seconde fois pour ceux du 29 juin, qui lui valurent la croix de Saint-Louis. Le brevet signé par le roi ne lui fut pas remis, l’ordre ayant été supprimé par le gouvernement de Juillet. (Théodore Anne, Histoire des chevaliers de Saint-Louis, t. III, p. 318.)
** Marquis de Maleissye, 1833-1909, mis à l’ordre du jour de l’armée pour le combat de Marchenoir, chevalier de la Légion d’honneur.
*** Comte Conrad de Maleissye, chevalier de la Légion d’honneur, pour faits de guerre 1870.
- [144]
On savait déjà, par la déclaration de la Pucelle, qu’elle ne porta jamais le blason accordé par le roi à la famille du Lys. Grâce à M. Quicherat (Revue historique, juillet-août 1877), on connaît quel était le symbole, témoignage de piété et d’humble soumission, qui tenait dans ses insignes militaires la place où tout chef de guerre mettait son blason.
[Elle] fit faire au lieu de Poictiers son estendart, auquel y avoit un escu d’azur, et un coulon blanc dedans icelluy estoit : lequel coulon (colombe) tenoit un roole en son bec où avoit escript : De par le Roy du ciel.
- [145]
Jean, échevin d’Arras, ajouta aux armes des d’Arc
le chef d’un lyon passant à cause de la province (Picardie) à laquelle son roy (Louis XI) l’avait habitué. (Lettres patentes 1612.)
- [146]
Voir aux Archives, lettres patentes de 1585 à 1619, folio 332, verso. On trouvera à la fin de ce livre, la reproduction du cimier donné à Charles du Lys.
- [147]
Jacques d’Arc avait deux frères : Nicolas et Jean. Ce dernier vivait encore en 1436 et était arpenteur du roi pour les bois et forêts. En 1390, le chanoine Pierre d’Arc, à Troyes, et en 1404 le curé Michel d’Arc, à Bar-sur-Seine, au diocèse de Langres, paraissent également tous deux appartenir à la famille de Jacques d’Arc (Archives de Charles du Lys).
- [148]
Ceffonds : Village attenant à Montier-en-Der, siège alors d’une importante abbaye.
- [149]
Le doyen était préposé à la vérification des poids et mesures, et chargé de la collecte des tailles, rentes et redevances.
- [150]
En 1427, nous trouvons Jacquemin établi à Vouthon, où il est cité dans un exploit de justice ; et dans un autre acte il cautionnait de ses biens deux fermiers de la seigneurie.
- [151]
Jeanne avait une sœur très aînée, Catherine, qui avait épousé Colin, maire de Greux. — Elle était morte avant que la Pucelle eut commencé son héroïque carrière. Lorsqu’à Crépy-en-Valois (juillet 1429), Jeanne disait à Regnault de Chartres :
Dieu veuille que je puisse me retirer avec ma sœur et mes frères, etc.
elle parlait (ses deux autres frères n’étant pas encore mariés) de sa belle-sœur, la femme de Jacquemin, aïeul de Charles du Lys.
- [152]
Procès, t. I, p. 51.
- [153]
Procès, t. I, p. 66.
- [154]
Siméon Luce, Jeanne d’Arc à Domrémy (1887), p. 226.
- [155]
Procès, t. II, p. 450.
- [156]
Procès, t. III, p. 31.
- [157]
Mikhaïl Dragomirov (1830-1905), général et écrivain militaire russe, auteur de plusieurs textes sur Jeanne d’Arc.
- [158]
Procès, t. I, p. 115 :
Prends tout en gré, ne te chaille de ton martyre ; tu t’en viendras au royaume du Paradis.
- [159]
Procès, t. I, p. 239.
- [160]
G. Hanotaux, Jeanne d’Arc, p. 129.
- [161]
G. Hanotaux, Jeanne d’Arc, p. 126.
- [162]
G. Hanotaux, Jeanne d’Arc, p. 141.
- [163]
G. Hanotaux, Jeanne d’Arc, p. 152.
- [164]
Et quand j’aurais distribué tout mon bien aux pauvres, et que j’aurais livré mon corps pour être brûlé, si je n’avais point la charité, tout cela ne me servirait de rien. — (I Corinthiens XIII, 3.)
- [165]
Servez donc ce roi immortel et si plein de miséricorde, qui vous comptera un soupir et un verre d’eau donné en son nom, plus que tous les autres ne feront jamais tout votre sang répandu. — (Oraison funèbre de Louis de Bourbon.)
- [166]
Antoine Charles de Tardieu, marquis de Maleissye (1727-1793), chevalier de Saint-Louis (1760), capitaine aux gardes françaises avec rang de colonel (1777), maréchal de camp (1782), lieutenant général (1789). Député de la noblesse pour le bailliage de Châteauneuf-en-Thymerais.
- [167]
Lacretelle, Histoire du XVIIIe siècle, t. XII, p. 52. — Voir également Riouffe, Samson le bourreau. Mémoires ; Wallon, Histoire de la Terreur ; V. Sardou, Robespierre.
- [168]
Anne-Marie de Maleissye, née le 1er novembre 1760, épousa, le 2 juillet 1781, le marquis de Goulaine, lieutenant aux gardes françaises ; elle était veuve au moment de la Révolution et mourut à Paris en 1837 sans postérité.
- [169]
Je tiens ces détails de mon père le comte de Maleissye, né en 1804, mort en 1872, qui les tenait de tous les siens et en particulier de sa tante, la marquise de Goulaine, morte en 1837, et du général marquis de Maleissye, mort à Paris en 1851, âgé de quatre-vingt-cinq ans. Ce dernier a laissé : Mémoires d’un officier aux gardes-françaises, Plon, 1897.
- [170]
Le samedi 20 mai 1905, Mlle de M… était atteinte d’une congestion pulmonaire avec état typhique. Le 21, menace d’appendicite et, le soir, crise violente avec une fièvre de 40 degrés. Le 23 mai, à la suite d’une consultation entre les professeurs Berger et Chauffard avec les docteurs Routier et Fenkind, une opération immédiate était décidée. Au moment d’y procéder, le Dr Routier disait au père de la jeune fille :
Nous avons tout contre nous. Rien pour nous ! Je n’ai jamais fait qu’une opération dans les mêmes conditions et je n’ai pu sauver la malade.
Le lundi 29, les trois docteurs demandaient à la famille d’appeler avec eux qui l’on voudrait, tant l’état leur paraissait désespéré. Le 31 mai, le Dr Routier ne pouvait s’empêcher de laisser échapper ces mots avec une profonde tristesse :Dire que rien, rien ne pourra la sauver !
Le 1er juin,teint terreux subictérique, 41° 6/10
(bulletin de la maladie communiqué par le Dr Routier). Les docteurs appelaient à leur consultation le père de la malade et ne lui cachaient pas qu’elle ne passerait probablement pas la journée. Ce fut alors que, sous une inspiration soudaine venue à l’église, je pensai à recourir aux lettres de Jeanne d’Arc qui furent baisées par la malade et déposées à son chevet. Aussitôt, la fièvre céda, et les médecins qui ne s’étaient même plus donné rendez-vous, s’attendant à l’agonie, ne pouvaient que constater dans la soirée un mieux inespéré. Il ne leur fut pas caché à qui on avait eu recours et le professeur Chauffard de répondre :Dans l’état où nous sommes, vous pouvez bien essayer de tout ce que vous voudrez !
Le lendemain, comme on demandait au Dr Routier :Peut-on avoir quelque espérance ? — Si la fièvre ne revient pas. — Mais alors, à quoi attribuez-vous ce mieux ? — À tout ce que vous voudrez !
La fièvre ne revint pas et ce fut la convalescence. Deux ans après, revenant sur ces faits, l’un des médecins répétait encore :C’est extraordinaire, extraordinaire !… Cela ne peut s’expliquer.
- [171]
Philippe-Hector Dunand (1835-1912), chanoine de Toulouse et auteur d’une Histoire complète de Jeanne d’Arc en trois volumes (1898-1899), reprit en 1901 son chapitre consacré à l’abjuration pour en faire une étude critique, qu’il publia indépendamment : L’abjuration du cimetière Saint-Ouen, d’après les textes.
- [172]
G. Hanotaux, Jeanne d’Arc, p. 120.
- [173]
En héraldique, le cimier est la partie supérieure du casque, lequel surmonte l’écu des armoiries.