Texte : Marie-Edmée Pau (1897)
Marie-Edmée Pau Extrait de Lis et Violettes
, 1897, par Myriam
Lis et Violettes, 1897, par Myriam
Sous le pseudonyme de Myriam
, Marie Pesnel publia chez l’éditeur Hatier l’ouvrage Lis et Violettes, un ensemble de douze biographies de femmes catholiques, dont celle de Marie-Edmée, que nous reproduisons ici.
Marie-Edmée Pau 1845-1871
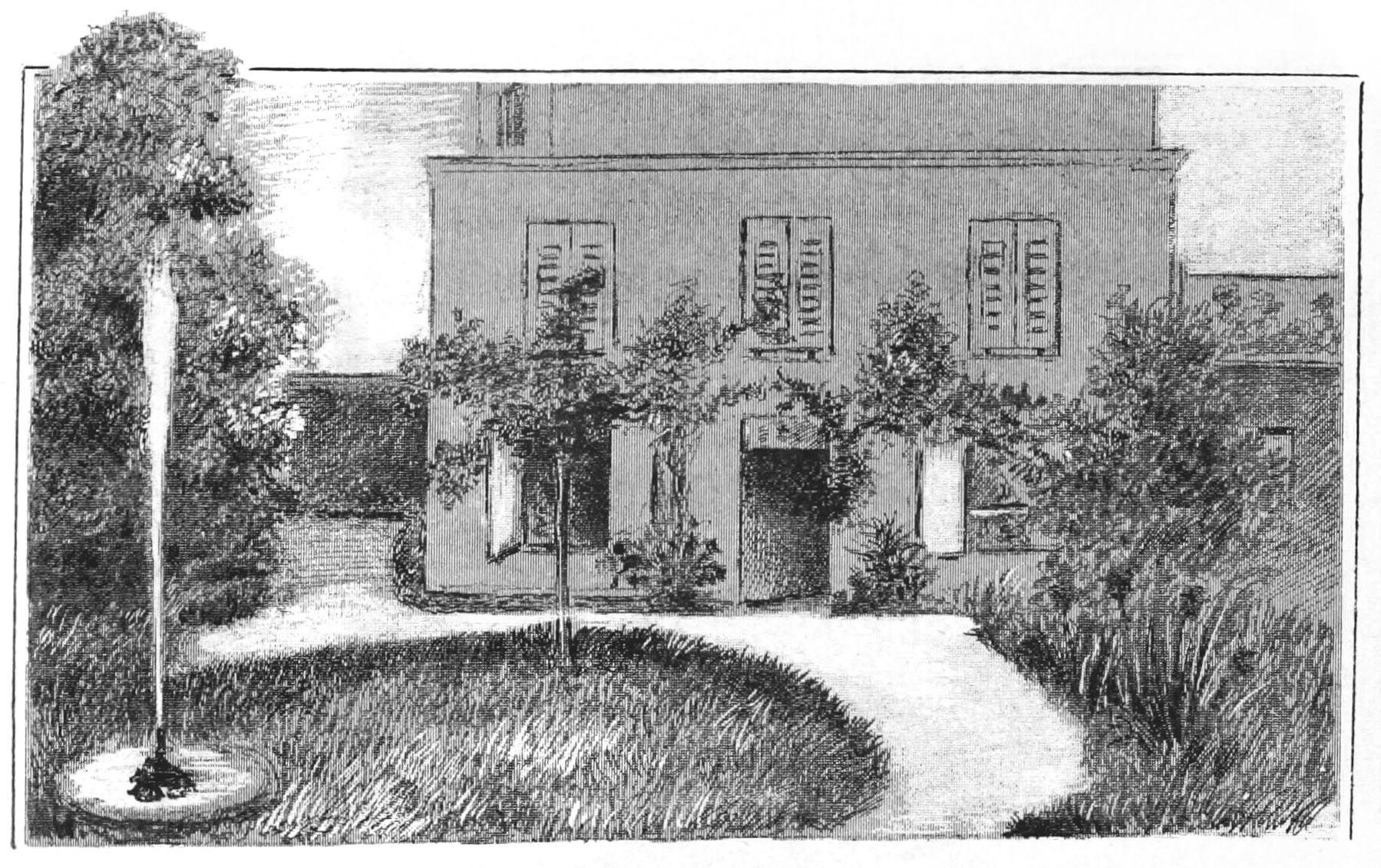
Sachons être un peu artistes à l’égard des âmes et trouver un vrai bonheur, une jouissance sérieuse, à regarder dans les belles âmes le reflet de Dieu.
Ces paroles si élevées du saint abbé Perreyve1 nous semblent convenir merveilleusement au début de cette étude. Oh ! en effet, que ne sommes-nous artistes dans la meilleure et la plus large acception de ce mot, afin de montrer, de faire resplendir, dans ces quelques pages consacrées à Marie-Edmée, l’harmonieuse perfection et l’idéale beauté de son âme !
Cette admirable jeune fille
, ainsi que la nomme Mgr Dupanloup, connut tous les généreux élans, les nobles ardeurs, les saints enthousiasmes. Elle aima Dieu, Jeanne d’Arc qui, à ses yeux, incarnait la patrie, sa famille, ses frères, surtout les déshérités, les petits selon le monde ; mais ces amours ne restèrent pas stériles en son cœur, et, sans jamais rien perdre de la rayonnante pureté, de la modestie qui est une des grâces et la plus séduisante parure de la jeunesse, elle sut agir, se dévouer et enfin mourir. Quand, aux premières heures du jour, le père de famille l’appela pour recevoir le denier de la vie éternelle, elle put se présenter à lui, les mains pleines d’une gerbe abondante et pressée, lorsqu’à cet âge — vingt-cinq ans — la plupart ont à peine glané quelques épis.
Lorraine par les origines de sa famille et par son éducation, elle vint au monde en 1845, à Lyon, la cité de Marie, où le régiment de son père tenait garnison. Mme Pau ne tarda pas à rentrer à Nancy, sa ville natale, pendant que son mari était envoyé à Rome ; celui-ci contracta en Italie une maladie dont il devait mourir en 1856. Il revint dans ses foyers prendre un repos devenu nécessaire et essayer si la vie de famille et des soins dévoués pouvaient lui rendre la santé. C’est sans doute au chevet du lit où elle voyait souffrir son père, que la jeune Marie-Edmée puisa cette gravité précoce, cette maturité de sentiments qui la distinguait des fillettes de son âge et, à quatorze ans, lui faisait écrire les lignes suivantes, en sortant de visiter la cathédrale de Chartres :
Que de générations ont passé successivement sous ces voûtes ! Que d’âmes saintes ont prié Dieu à l’endroit où je m’agenouille, où je passe !… Hélas ! ces milliers d’âmes sont oubliées. Dans cent ans, que restera-t-il de moi, de mon nom, de mon souvenir ? Rien. Ainsi va le monde : tout passe et tout meurt. Vous seul, ô mon Dieu, êtes immuable et éternel, et votre nom subsistera toujours !…
Le jour anniversaire de ses quinze ans, elle trace les lignes suivantes :
À quinze ans, on secoue pour toujours la fraîche couronne de l’enfance, on la voit s’effeuiller. C’est une première halte dans la vie, le chemin s’élargit peut-être, mais en est-il plus beau, plus souriant ? La pensée s’élèvera-t-elle ainsi qu’on le dit ? Et le cœur y gagnera-t-il ? Et l’expérience, cette fleur qu’on ne possède qu’au prix de tant de défloraisons et de douleurs, mérite-t-elle sérieusement la perte de nos brillantes, douces et suaves illusions d’enfant ?…
Comme tout cela est sérieux, profond même et bien exprimé ! Dieu lui avait prodigué ses dons sans compter : élévation de sentiments, intelligence, dispositions poétiques et artistiques, enthousiasme, elle possédait tout, et, afin que tant de trésors ne fussent point gaspillés, il avait placé à ses côtés une femme supérieure, une mère vraiment digne de ce nom et du précieux dépôt qui lui était confié. Quand il en est ainsi, que la mère est à la hauteur de sa mission, personne ne convient mieux pour la bien remplir ; à elle d’achever, de parfaire l’ébauche du divin Ouvrier… Nous voudrions en dire davantage, mais nous craignons de blesser celle qui n’ambitionne l’admiration et la louange que pour la mémoire de sa fille2. D’ailleurs, combien nos paroles sembleraient faibles, insignifiantes à ceux qui ont la bonne fortune d’approcher de Mme Pau, de jouir de cette intelligence lumineuse, d’être aimée de ce cœur si chaud !… et que pourraient-elles apprendre à ceux qui ne la connaissent pas ?…
Sous la direction d’une telle éducatrice, aussi tendre qu’éclairée, l’âme de Marie-Edmée s’ouvrait à tous les nobles sentiments, à toutes les généreuses émotions, tandis que son esprit, d’une souplesse merveilleuse, s’ornait de connaissances variées. Les travaux à l’aiguille, les soins domestiques, avaient aussi leur tour, et la jeune fille savait répandre sur le labeur le plus prosaïque, sur les occupations les plus vulgaires, un rayon de la poésie qui débordait en elle. Ensemble, la mère et la fille allaient à l’église, chez les pauvres, les malades, donnant à ceux qui souffraient, outre le secours matériel qui souvent humilie, l’aumône d’une bonne parole et d’une douce compassion. Elles faisaient la classe aux petites filles délaissées du quartier, leur enseignaient le catéchisme, essayant d’allumer ou d’entretenir dans ces jeunes âmes l’étincelle divine qui, seule, peut guider la créature humaine ici-bas et la conduire sûrement au but.
Revenons au journal et lisons ensemble ce passage d’une grande élévation de pensées, écrit alors que Marie-Edmée n’avait pas encore seize ans :
Nous longions les rues étroites de la ville vieille ; nous venions de franchir la porte de la citadelle, et je regardais tristement les fortifications, les bastions, dont il reste à peine quelques vestiges, et je me disais : Quel est celui qui ne pense pas, à la vue de ce qui reste, aux jours d’autrefois ? Alors, dans ces intimes conversations de l’âme avec les souvenirs, les pierres noircies ont un langage plein d’éloquence qui nous parle de Dieu. Elles nous disent le néant de l’homme et la vanité des grandeurs. En les voyant, nous pensons à ceux pour qui elles furent des tours et des murailles, à ceux pour qui elles devinrent des palais, et les mœurs chevaleresques et religieuses de nos pères nous reviennent à la mémoire… Ces boîtes blanches alignées et confortables, ces belles maisons neuves, lorsqu’on leur demande quelque chose qui parle au cœur, que nous disent-elles ? Nous sommes nées d’hier, ne nous demandez rien du passé… Aussi fragiles que la Fortune dont nous sommes les temples, attendez quelques années encore, et nous ne serons plus, et nul souvenir bienfaisant au cœur, salutaire à l’âme, ne témoignera de nous. Voilà ce que me disent à moi ces coffres si bien clos. Que diront-ils de plus aux siècles futurs, si le temps, par extraordinaire, en laisse un debout ?…
Deux mois plus tard, à l’occasion de la fête de la Pentecôte, elle écrivait les réflexions suivantes :
Il est dit, dans l’Évangile de ce jour, qu’au moment de la descente du Saint-Esprit il se fit un grand bruit dans le ciel, et la terre non plus n’est pas silencieuse au jour de cet anniversaire. Depuis ce matin, le son joyeux des cloches ne cesse pas de se faire entendre. Je suis vraiment aux premières places pour en jouir, et je ne me lasse pas de les écouter. Pour moi, il n’y a aucune harmonie qui vaille celle-là.
Citons un fragment d’un autre genre, écrit un peu plus tard, — à dix-sept ans, — nous y trouverons le même charme, et, à côté d’une fraîcheur d’âme incomparable, un sentiment religieux exquis, et cette soif de dévouement qui, chez la jeune Lorraine, était une passion.
2 juillet. Marie, se levant à la hâte, s’en alla vers les montagnes. Si nous voulons suivre l’exemple que nous donne en ce jour la mère de Jésus, levons-nous, mon âme, et partons… Nous voyons encore la trace des pas de Marie ; mais pourquoi nous conduisent-ils au sommet d’une montagne ? Le voyage d’une humble vierge ne doit-il pas s’accomplir dans l’ombre et les sinuosités de la plaine ? N’en est-il donc pas de même dans le monde de notre esprit que dans celui de nos corps ? Les vallées de notre terre sont si belles pour le voyageur ! Il y a des arbres pour le protéger du soleil, des fleurs pour égayer sa vue, des herbes pour se reposer où il fait une halte, tandis que la montagne rocailleuse et stérile ralentit sa marche et la rend plus pénible. Il faut les ailes de l’aigle pour en atteindre le sommet sans douleur, et le bâton du pèlerin se brise trop souvent en route. Où nous conduisez-vous, Marie ? Vous n’êtes pas encore la Mère de douleur ; ces montagnes qui vous attirent ne sont ni le mont des Oliviers, ni le Golgotha. — Non, mais la charité vous guide, et c’est vers les hauteurs, où règne l’amour de Dieu, que vous nous appelez. Sursum corda ! En haut notre regard, en haut nos cœurs, en haut nos désirs, et nous deviendrons grands, parce que nous serons plus près du ciel et que la terre sera plus loin de nous. Qu’il est pur, l’air de nos montagnes terrestres ! Comme en le respirant nous sentons la vie, et comme il rafraîchit le front et le cœur ! Nous comprenons mieux, sur le sommet des montagnes, et notre grandeur et notre néant. Ainsi, faites, ô Vierge sainte, que dans la charité nous comprenions ce qui fait notre gloire et ce que nous sommes sans Dieu, qui est tout. Puisqu’il renverse les orgueilleux, apprenez-nous à devenir humbles, et faites qu’à votre exemple, si nous quittions jamais notre obscurité, ce ne soit que pour accomplir le bien.
Plus tard, nous verrons comment cette prière de Marie-Edmée fut exaucée.
Elle avait à peine quinze ans, quand elle lut la Vie de Jeanne d’Arc, de Görres3 ; cette lecture acheva de la passionner pour la vierge guerrière, qui était déjà son héroïne de prédilection. Son enthousiasme, son admiration, tiennent du culte ; elle rapporte tout à la bergère de Domrémy, et on peut dire qu’elle a commencé ce grand mouvement qui, depuis vingt ans, s’opère en faveur de la libératrice du territoire. N’était-ce pas, en effet, à une jeune fille, à une Lorraine, que devait revenir l’honneur d’être la promotrice de cet élan de reconnaissance, ou plutôt de justice ? Comme elle eût tressailli de joie en entendant Rome la proclamer vénérable ! et avec quelle allégresse elle se fût associée aux fêtes, aux manifestations qui, de tous les points de notre France, s’organisent pour honorer Jeanne la sainte, Jeanne la martyre !…
Presque à chaque page de son Journal, on retrouve la trace de ce grand amour de son cœur.
En réunissant toutes mes amitiés en une seule, je ne crois pas trouver un amour comparable à celui que j’ai pour cette jeune fille, morte il y a plus de quatre-cents ans. Qu’on appelle cela folie, exaltation, chimère, je demanderai s’il est possible que l’imagination soit plus féconde que la réalité. Or, cette chimère obtiendrait de moi tous les sacrifices. Ce nom, quand je l’entends prononcer ou quand je le lis écrit quelque part, me remplit d’une émotion impossible à décrire ; mon cœur bat ; mes yeux se remplissent de larmes ; un je ne sais quoi d’immense comble le vide affreux qui existe en moi ; un souffle divin me soulève, et je voudrais avoir des ailes pour aller chercher dans le ciel ma Béatrix à moi !… J’aime les saints qu’elle aimait ; j’écoute les anges qui lui parlaient, et son étendard devient celui de ma vie. […]
Cet amour est au-dessus de toutes mes affections, comme une étoile fixe et brûlante qui m’envoie lumière et chaleur, selon qu’il fait chaud ou froid dans mon âme. C’est la seule beauté qu’aucun souffle n’a jamais ternie, que je ne me suis jamais repentie d’avoir aimée, la seule grandeur dont je n’aie pas douté !
Ailleurs, la même pensée sous une autre forme :
Cette guerrière, cette enfant, cet archange, cet être incomparable absorbe tout mon amour. Elle est le seul sentiment immuable de mon cœur. J’ai douté de tout, hormis de sa mission divine, j’ai ri de tous mes enthousiasmes, et, plus je vis, plus j’admire, plus je tombe à genoux devant son histoire. […]
C’est aujourd’hui l’anniversaire de la mort de Jeanne d’Arc. Depuis le premier rayon de soleil d’aujourd’hui jusqu’à la dernière heure du soir, j’y pense, je la vois, je l’entends !
Dans les années 1861 et 1863, elle fait un pèlerinage à Domrémy, avec quelle joie, quels transports ! Son ange gardien, témoin de ses purs ravissements, pourrait seul le dire. En 1863, ce n’est pas un simple pèlerinage particulier, c’est une fête nationale pour la remise de l’étendard qu’ont brodé les dames d’Orléans. La veille de la solennité, la jeune fille écrit ce qui suit :
Je ne suis pas entrée encore dans la sainte maison, car j’avais l’esprit trop préoccupé du logement pour risquer ainsi de me familiariser avec les reliques de mon culte chéri ; j’en ai salué le seuil trois ou quatre fois, mais je me suis réservé de le franchir demain, avant ou après ma communion.
Quelle délicatesse exquise dans ce retard qu’elle impose à son impatience ! Voyons ses impressions durant la cérémonie :
Je suis au ciel, car il me semble que Jeanne d’Arc est sur la terre. Toute une foule est là sous mes yeux : l’étendard de Jeanne flotte au vent ; les noms de ses victoires écrits sur des écussons entourent la place ; le soleil fait étinceler le tout d’une gloire et d’une allégresse nationales que je n’espérais jamais voir sur la terre de France. Les grands peupliers se balancent et tendent leurs branches vers le ciel, avec un élan de prière que je traduis par une action de grâce.
Ce n’est pas assez pour elle d’aimer seule son héroïne, elle voudrait insuffler dans toute âme française, dans l’âme des enfants en particulier, la flamme enthousiasme qui la dévore. Elle prépare une histoire de la grande Lorraine qu’elle dédie à ses jeunes compatriotes sous ce titre charmant : Histoire de notre petite sœur Jeanne d’Arc. Le texte sera accompagné d’eaux-fortes, d’après ses dessins ; elles représenteront les principales scènes de l’enfance de la pieuse bergère, car, nous avons oublié de le dire, Marie-Edmée dessine à merveille. Là encore sa mère a été son premier professeur et, ses essais juvéniles faisant pressentir un talent réel et original, elle a suivi plus tard les leçons d’un excellent maître.
Que de gracieuses compositions sont écloses sous son crayon ! Un Canon d’autel ; un Ave Maria, dont presque chaque mot est illustré avec autant de charme que de foi ; une traduction de l’Ange et l’Enfant, la poésie si connue de Reboul ; l’Écolier de Mme Desbordes-Valmore. Comme ce conte ferait un ravissant album pour les bébés ! Citons encore, car il faut savoir se borner : l’Angélus au Ciel. Quelle expression de suavité céleste elle a donnée à ses anges ! C’est à se demander si, dans ses rêves de vierge, elle a vu les esprits bienheureux…
Marie-Edmée a une facilité d’invention qui tient du prodige ; aussi un artiste lui dit-il :
Vous avez une imagination unique et étonnante de fécondité ; il suffit de vous donner une poésie, et vous en illustrez chaque verset, au besoin, chaque mot.
Ce qui attire et retient le regard dans ses charmantes compositions, c’est qu’on sent l’âme de l’artiste y palpiter tout entière : on ne cherche pas à se servir des procédés de critique ordinaire, on est touché et séduit. Elle nous paraît appartenir à l’école des imagiers naïfs du moyen âge, qui nous ont légué tant d’œuvres sublimes et inspirées, discutables peut-être au point de vue d’une esthétique étroite et rigoureuse, mais que nos artistes modernes ne sauraient imiter. Pour la jeune Lorraine, l’art est une prière, un sacerdoce. Écoutons-la elle-même.
Pour moi, l’art est la manifestation d’une pensée par une forme aussi pure, aussi parfaite que possible, qui ait un but moral, religieux, surnaturel, qui puisse attirer nos cœurs vers l’autre monde, sur les ailes de la poésie et de la prière.
Revenons à l’Histoire de notre petite sœur Jeanne d’Arc4. Illustrations et textes sont de Marie-Edmée et se complètent admirablement. Afin de commenter ces dessins, d’une conception si pure, si élevée, on ne peut rêver mieux que la poétique légende qui les accompagne et doit facilement être comprise par les jeunes intelligences auxquelles on l’a destinée. Cette histoire est plus et mieux qu’une fantaisie d’artiste, qu’un bon livre ; c’est une œuvre patriotique, c’est une bonne action. Elle a réalisé ce que l’auteur en espérait, quand elle traçait les lignes suivantes :
Je te donne à l’enfance lorraine, ô chère légende qui doit lui montrer sur notre sol la trace des pas de ma sainte héroïne, afin qu’on l’aime, qu’on l’admire dans l’ombre de la pauvreté, comme dans la splendeur du sacre, après l’enivrement de la victoire.
Retournons un peu en arrière. Alors que l’Histoire de Jeanne d’Arc était presque terminée, qu’une partie des bois étaient gravés, Marie-Edmée ressent un scrupule qui l’arrête. Elle craint de n’être point dans le bon chemin, et, pour la rassurer, elle a besoin d’une voix puissante et autorisée. Réunissant, ses manuscrits, ses esquisses, ses feuillets achevés, elle part consulter à Orléans Mgr Dupanloup, celui qu’elle nomme l’évêque de Jeanne d’Arc, et solliciter son suffrage et sa bénédiction. L’éminent prélat, qui a écrit Femmes savantes et Femmes studieuses, pouvait et devait comprendre celle qui venait à lui avec tant de simplicité et de confiance. La jeune artiste quitte Orléans la conscience rassérénée et ayant reçu, pour sa chère histoire et pour elle-même, d’utiles conseils et de précieux encouragements.
Après son admiration pour la vierge guerrière, le trait distinctif de Marie-Edmée, et qui semble bien étrange dans une toute jeune fille, c’est sa prédilection pour la mort, ce roi des épouvantements
, qui lui apparaît, à elle, comme une libératrice, une amie. Cette passion, une autre âme d’élite, Eugénie de la Ferronnays, l’avait aussi connue ; mais elle se voila dans la suite sous le charme des tendresses humaines, tandis que, chez notre jeune artiste, elle semblait grandir d’année en année. Le journal, écho fidèle de son âme, le prouve surabondamment.
Le saint et le poète ont comparé la vie à bien des choses, ce n’est, en réalité, qu’un court pèlerinage et une halte au milieu de tombeaux. À mesure qu’on avance, ceux qui s’étaient mis en marche avec nous s’arrêtent et se couchent dans une de ces fosses ouvertes. Quelquefois, vieux et courbés par la fatigue et les aspérités du chemin, on arrive au bout d’une longue carrière, mais on est seul !…
Ne dirait-on pas que ces réflexions sont nées sous la plume d’un philosophe ou d’un penseur, et c’est une enfant de quinze ans qui les écrivait !
Quelques mois après :
Ce but effrayant de toute existence — la mort — ne m’apparaît pas toujours sous le même aspect. Il y a des jours où, creusant cette idée pendant de longues heures, je ne retire de ma méditation qu’un effroi plus raisonné et une tristesse plus grande. Alors tout me paraît si beau et si bon sur la terre que je tremble à la pensée de la quitter… D’autres fois, en des instants semblables à celui d’aujourd’hui, car j’écris le jour des Morts, je ne réfléchis pas à la mort, j’en rêve. Et lorsque tout, autour de moi, murmure une prière pour les trépassés, je laisse mes terreurs s’endormir aux sons doux et graves qui s’échappent de l’orgue ; la nef s’agrandit à mes yeux pour contenir les défunts avec les vivants. Sur ces murs blancs, se reflète l’ombre du catafalque qui s’illumine. La mort revêt pour moi une forme moins terrible. C’est le point de séparation d’avec la terre, mais n’est-ce pas celui où nous retrouvons le ciel ?…
Plus tard, la note consolante domine, l’attrait mystérieux vers l’au-delà s’accentue ; une autre année, à cet anniversaire de la commémoration des défunts, elle écrit :
Oh ! le rassasiement céleste ! le ciel ! le ciel ! il y a des instants où ce désir devient une passion plus ardente que tout ce que j’ai vu de plus passionné dans les autres cœurs. Ce cri part de mon âme aux heures de souffrances, il me soulage, et je me sens presque douce en fermant ce livre où je l’ai exhalé.
Ailleurs :
La vie dont on use ici-bas, c’est une mort qui ne s’anéantira jamais, voilà tout. C’est une course sans halte, un chemin sans ombre ; c’est l’exil, toujours l’exil ! un voyage, toujours un voyage… une agonie… Quand donc la mort ? […]
Depuis deux jours, ma passion pour l’autre monde s’est réveillée plus ardente que jamais. Je voudrais être sainte, c’est-à-dire n’avoir qu’une seule intention et agir sans relâche ni crainte. Faire du bien et moins de mal, aimer sans faiblesse, connaître et aimer toujours pour l’unique vérité, le Dieu de mon salut, le Christ ! Puis je voudrais mourir, échapper à cette loi terrible de misère et d’incertitude, m’élever au-dessus de tant de petitesses, respirer à l’aise dans l’infini ; voir et posséder cet inconnu qui laisse un vide insondable dans mon cœur. Oui, je voudrais mourir !
On le sent, cette âme de feu souffre des entraves de tout genre qui pèsent sur elle, arrêtent l’essor de ses facultés, compriment ses aspirations, refoulent ses élans ; au fur et à mesure qu’elle avance en âge, cette souffrance devient plus vive, plus intense. La vie réelle, avec son cortège inséparable d’ennuis et de désenchantements, de calculs et de petitesses, est pour elle comme un flot, une marée montante qui grandit sans cesse. Il lui faut lutter, combattre sans repos ni trêve, afin de ne pas se laisser envahir et submerger. Sursum corda5 ! répète-t-elle souvent.
Écoutez les nobles plaintes, les viriles espérances dont son discret confident est l’écho :
La distraction me déflore l’âme au moins cent fois par jour. Rien ne m’afflige autant que cela. Par distraction, j’entends, ô mon Dieu, tout ce qui me détourne de vous, bien ou mal, tout ce qui fait trembler mon âme aussi légèrement qu’une aile d’abeille au souffle du vent de mai. Le meilleur de mon être est à vous, comme la racine est à la terre, et quelquefois même au rocher, mais la surface ! Un regard brillant ou sombre, un geste fier ou délicat, un mot, un rayon de soleil sur un toit, mais surtout les yeux et les sourires m’émeuvent toujours plus que je ne voudrais. C’est faible.
Mon espérance et presque ma certitude, c’est d’exercer sur la marche du monde une influence, quelque imperceptible qu’elle soit ; de ne pas mourir sans avoir imprimé pour ma part, à force de désirs, de prières et de conviction, et aussi par quelques paroles ou actes, une impulsion qui dure et qui concoure à ce prochain triomphe de la justice, de la lumière.
Marie-Edmée n’avait guère que vingt ans, lorsque des amis de sa famille, la voyant si admirablement douée, firent des démarches pour la placer comme lectrice auprès de l’impératrice Eugénie. Cette haute situation, qu’on faisait miroiter à ses yeux, ne la séduisit pas un instant. J’ai failli, écrit-elle dans son journal, être élevée plus haut que je n’avais souhaité l’être dans mes rêves présomptueux et fantastiques d’enfant de huit ans.
Aucune amertume, aucun regret dans cette phrase si simple mais, quelques années plus tard, quand l’impératrice déchue, humiliée, quittait la France et se voyait abandonnée par bon nombre de flatteurs et de courtisans, la noble enfant soupira peut-être en songeant qu’elle eût été heureuse et fière alors de se dévouer à cette grande infortune…
Une tout autre vie l’attend : vie de travail, de sacrifices, et celle-là convient beaucoup mieux à son tempérament moral ; nous en avons pour preuve ces paroles qu’elle adresse à sa mère :
Je ne fais rien pour moi, et le désir du bien par le sacrifice est toujours le plus ardent désir de mon cœur.
Ailleurs :
Et pourquoi ne serions-nous pas heureux dans la souffrance ? Nous qui mourons pour vivre, ce doit être notre destinée ; donc, c’est notre devoir. Or, l’accomplissement d’un devoir n’est-il pas une des plus douces jouissances de la vie ? Pour celle-ci, elle est âpre, austère ; mais, je le répète avec conviction, il y a du bonheur à souffrir !…
Au commencement de l’année 1868, elle ouvre un cours de dessin ; elle donne également des leçons particulières :
Le rôle de professeur me plaît. J’aime cette communication des intelligences.
Afin d’être plus apte à enseigner, elle étudie elle-même et s’absorbe dans les traités de perspective, de géométrie, d’anatomie. Dans l’intervalle, elle achève son livre sur Jeanne d’Arc. Ses journées sont pleines et l’oisiveté ne saurait s’y glisser. Le matin et le soir, elle se rend à l’église ou à quelque chapelle du voisinage, afin de retremper son âme dans le calme divin qui émane des lieux consacrés. Dans ses courses, dans ses promenades, quand elle peut échapper un instant à ses occupations absorbantes, elle est toujours accompagnée de Mme Pau ; d’un mot charmant sorti du cœur, la jeune fille nous peint la joie que lui apporte ce tête-à-tête :
Il fait bon avec mère.
Dans les impressions, les émotions qu’elle ressent à l’église, l’artiste se retrouve sous la chrétienne. Après avoir assisté à un chemin de croix, elle écrit :
Admirable office où la forme est presque à la hauteur de l’idée. Ce douloureux pèlerinage aux flambeaux, la forme variée de ces prières qui, de la méditation à la belle prose du Stabat, épuisent toutes les impressions de la supplication la plus ardente, ces enfants, ces pauvres, ces riches suivant pêle-mêle, et dans un respectueux silence, la croix et les prêtres devant chaque station qui devient à son tour le centre de la masse des fidèles agenouillés dans la nef. Tout cela est une œuvre d’art religieuse, morale, philosophique, qui donne à la grande pensée du drame de Jérusalem une vie singulièrement forte et durable.
Au mois de septembre de cette même année 1868, Marie-Edmée, suivant de sérieux conseils qui lui ont été donnés, prend le chemin de Paris afin d’étudier d’après nature ; elle part sans sa mère, cette fois, et c’est avec une certaine appréhension qu’elle songe à la solitude où elle va se trouver.
Je vais partir… seule ! oui. Mais est-ce que je n’ai pas tout arrangé pour cela ? Est-ce qu’il n’est pas temps pour moi de faire l’apprentissage de l’abandon dans cette voie que je dois parcourir seule désormais ?…
Elle a lu et relu les ouvrages du père Gratry6, et, comme tous ceux qui ont recueilli plus ou moins quelques rayons de cette noble intelligence, quelque étincelle de ce cœur brûlant de charité, elle éprouve pour le savant oratorien une respectueuse sympathie et une profonde admiration. Elle a le projet de lui offrir un dessin fait par elle et représentant l’abbé Perreyve emporté dans la sainte demeure par les anges. Encouragée par les Dames de la Retraite, chez qui elle prend sa pension, munie d’un mot d’introduction dû au père Perraud, elle se présente émue et tremblante devant le père Gratry. Celui-ci l’accueille avec une indulgente bonté, il lui remet comme souvenir son dernier ouvrage, la Morale et la Loi de l’histoire, et, sur la première page, il écrit de sa belle et lisible écriture ce mot vraiment prophétique : Courage !
Mon enfant, ajoute-t-il, me comprenez-vous ? La vie de la femme est habituellement passive. Il n’en sera pas ainsi de la vôtre, il vous faudra beaucoup de persévérance et d’énergie.
Revenue en Lorraine, la jeune artiste poursuit sa vie sérieuse, occupée ; plus que jamais, elle marche avec légèreté et assurance dans la voie qu’elle s’est tracée, les yeux et le cœur en haut.
Je préserve jalousement mon cœur de tout sentiment d’égoïsme ; je ne me garde pas pour moi-même, mais pour Celui qui se donne à tous, et cette consécration de tout mon être à l’idéal vivant que j’aime de la plus grande force dont je sois capable, cette consécration m’incline à me faire la servante des serviteurs de Dieu. Je m’éprends toujours davantage de tout ce que je rencontre de bon, de simple et de petit. Cette disposition me donne un fonds de paix bien précieux dans l’activité de ma vie ; je me vois vieillir sans inquiétude, et mon culte pour la mort se dégage des désirs qui m’assombrissaient tant autrefois…
Elle a au plus haut point l’esprit de détachement ; comme les saints dont elle s’inspire, elle ne fait aucun cas des joies mondaines, des biens terrestres.
Bienheureux ceux qui ne tiennent pas plus aux biens de la terre que l’hirondelle à son toit, le passereau à sa branche, le voyageur au ruisseau qui le désaltère, le rayon aux fleurs qu’il épanouit !…
Cette austérité, cette énergie douce, qui est le ton habituel de son âme, ne nuit en rien à son exquise sensibilité. Voyez plutôt ce passage empreint d’une émotion si pénétrante :
Qu’il est bon de s’aimer, d’être sûr l’un de l’autre, de se reposer dans un cœur tout dévoué, comme les hirondelles qui traversent la mer se délassent un instant sur les vergues d’un navire pour reprendre plus vaillamment leur périlleux voyage ! Oui, voilà bien l’effet que produit sur moi l’affection ; je sens qu’elle est de même nature que cet amour divin et suprême qui nous attend au terme, et pour lequel notre cœur s’élargit à mesure qu’on y jette d’autres pures et nobles amours !
De bonne heure, elle a compris que les tendresses humaines, si pures soient-elles, sont impuissantes à nous rassasier ; elle sait que Dieu seul est plus grand que notre cœur
. Elle ne veut tendre qu’à Lui, n’aimer que Lui. Ils sont nombreux, les passages de son Journal où l’on peut lire ces mots :
Aujourd’hui je suis heureuse, j’ai communié !
Ah ! elle devait goûter dans toutes leurs divines suavités les joies eucharistiques, la chrétienne qui écrivait ces lignes enflammées :
Les Juifs contemporains du Christ sont morts ; Lui-même, cet adorable objet de notre amour, a quitté le monde avant ses amis, et nous, qui avons autant de droits à sa tendresse, nous ne l’avons pas vu. Je sais bien qu’il a fait pour moi ce qu’il a fait pour eux : grâce à son Évangile, je suis instruite ; par sa mort, je suis délivrée ; par son Église, je suis pardonnée ; mais qui me le donnera Lui-même à voir, à entendre, à suivre ? Je veux baiser ses pieds et le bord de sa robe ;je veux qu’il me distingue dans la foule, rencontrer son regard, être sûre enfin qu’il répond à mon amour !
Ce désir était fou, quoique légitime ; il eût dû nous suffire d’espérer en la possession de Jésus-Christ dans le ciel, mais notre cœur ne peut se nourrir d’espérance abstraite ; il lui faut déjà un gage, s’il doit attendre longtemps la réalisation de son parfait bonheur, un gage sensible qui contienne une partie de tout ce qu’il promet. Vous seul avez compris notre nature humaine, ô Fils de l’homme, et vous avez inventé l’Eucharistie !… Ô Christ, vous n’avez plus à rivaliser avec un amour humain, fût-il le plus doux et le plus pur, car notre âme ne peut communier qu’avec Vous, et elle se dilate, elle aspire à s’élever et à se fondre dans son amour. Quel esprit sera capable d’éclairer le mien par la Vérité pure, à quelle volonté la mienne voudra-t-elle se soumettre sans craindre de rougir, quel cœur battra si près du mien et lui donnera plus de force pour créer la vie et la conserver à d’autres cœurs ?…
On n’arrive pas à de telles hauteurs, on ne se dépouille pas de l’égoïsme sans déchirements et sans combats. Écoutez ce passage significatif du Journal :
Et comme vous, ne suis-je pas attirée, émue, fascinée par les beautés humaines ? Croyez-vous que je n’ai pas éprouvé leur incomparable puissance ? Mais jamais, non, jamais elles ne m’ont vaincue ; jamais elles ne m’ont absorbée tout entière, comme cet attrait fort et doux qui me réclame avec une force dont le paroxysme doit être la mort. Quoi que j’éprouve, je sens que la passion humaine, si pure, si dévouée qu’elle soit, est une déchéance pour les femmes, l’autre, la passion divine, nous élève et nous rassasie…
Et cet autre fragment, admirable de profondeur et de calme résolution :
Tout en s’élevant au-dessus de la terre, il faut que notre âme s’y incline encore, et là, comme un miroir fidèle, il lui faut refléter tout ce qui passe sans en rien conserver… Oui, tu aimeras, ô mon cœur, mais ici et non pas là, mais plus loin qu’ici, mais seulement jusque-là.
Un peu plus tard, toujours le même cri.
Allons, courage, mon cœur ! bats, palpite, fais-moi trembler, rougir, souffrir tant que tu voudras vivre ; qu’importe si tu ne jouis pas de ce qui passe, mais si tu palpites cent fois plus fort pour l’Éternité, le Bien suprême et la Beauté !
Quoi qu’elle fasse et quoi qu’elle écrive, l’instinct maternel, que Dieu met au cœur de toute femme, l’agite parfois et l’émeut plus qu’elle ne voudrait. Un jour qu’elle a senti se serrer autour de son cou les bras caressants d’une fillette qu’elle portait, tandis que d’autres enfants accrochés à sa robe l’entouraient, sa plume laisse échapper les lignes suivantes :
Il m’est resté de cette promenade un instinct d’amour maternel. Cette enfant dans mes bras, ces têtes blondes et brunes à l’aile de mon manteau, les sourires et les caresses un peu timides de ces enfants, tout cela m’a fait éprouver quelque chose de tendre et de fort, qui m’a prouvé que je ne suis pas incomplète. Ce je ne sais quoi qui m’est resté dans le cœur, il éclaire l’amour de ma bonne mère pour me le faire mieux apprécier ; il réchauffe mon cœur ; il attendrit ma voix et mon regard pour tous les petits enfants.
Ce sentiment maternel, elle le connaissait en quelque sorte par la tendresse sérieuse, toute de protection et de sollicitude, qu’elle avait vouée à son frère Gérald, de cinq ans plus jeune qu’elle. Le journal est rempli d’effusions de cœur à l’adresse de ce frère chéri.
Oh ! oui, mon Dieu, je l’aime, ce bon frère, que Vous m’avez donné ; je l’aime avec une force d’âme dont je ne me croyais pas capable, et mon cœur, qui me semble peut-être froid, est tout feu et toute ardeur, quand il s’agit de Gérald.
À la fièvre d’action qui la dévore, à l’activité sans pareille qu’elle déploie durant la dernière année qu’elle passe ici-bas, on dirait qu’elle a le pressentiment secret que sa vie sera courte, et qu’elle n’atteindra pas le midi. C’est d’ailleurs son désir, et elle s’en accuse comme d’une faute :
Moi, je n’ai qu’un vrai désir au fond du cœur, celui de ne pas survivre à ma belle saison. Mais ce désir est humain et méprisable ; il n’a guère de fortes racines, ô mon Dieu, puisqu’il ne vient pas de Vous. Prenez-moi, vieille ou jeune, pourvu que vous me preniez à l’heure de la Miséricorde ; ô mon Dieu ! j’ai confiance en Vous !
Et ce souhait, après la lecture du panégyrique de Jeanne d’Arc :
Je pense que je voudrais bien mourir comme elle, non pas dans son martyre et dans sa gloire, je n’en suis pas digne, mais dans sa jeunesse, son enthousiasme et son espérance !
L’égoïsme, l’amour passionné du luxe qui, comme un chancre rongeur, s’étend chaque jour davantage, ne saurait entamer cette riche nature. Marie-Edmée n’a jamais formé qu’un rêve : vivre et mourir pour quelque noble cause. Elle avait à peine vingt ans, quand elle écrivait ces paroles qu’on peut lui appliquer :
Qu’elles sont heureuses les âmes qui ont sacrifié la vie mortelle pour leur Dieu ou pour leur patrie ! Est-il un plus bel enchâssement pour un nom que le martyre ? Est-il un plus beau titre à la miséricorde de Dieu ?
Et ce fragment d’un tout autre genre qui nous la montre dévorée de cette faim, de cette soif qui ne saurait être satisfaite ici-bas :
Les affamés de la terre, toujours incertains s’ils amassent les miettes du festin qu’ils convoitent, sentent quelquefois à côté de la misère de leur corps la plaie du désir immense qui ronge plus ou moins toutes les âmes. Pour les affamés de la Justice, contents du côté de la terre, ils ont la certitude encore inébranlable d’être encore mieux rassasiés au ciel ; sans doute ils ont faim et soif, mais cette douleur accroît leur vie au lieu de la restreindre, et plus ils avancent vers l’éternelle demeure, plus ils découvrent de beautés à la justice, à ce trésor qu’ils n’auront pas espéré en vain.
Nous arrivons en 1870, à cette année terrible dont les tristes souvenirs sont encore si vivants. De toutes parts circulent des bruits de guerre ; mais ce ne sont peut-être que de vaines rumeurs, et l’on espère contre toute espérance. Bientôt ces bruits, ces rumeurs, se changent en certitude : la déclaration de guerre à la Prusse est affichée. La patrie est menacée ; Gérald Pau est soldat ; Nancy se trouve sur la frontière : quelles angoisses pour Marie-Edmée !…
Le 7 août, lorsqu’elle lit la dépêche se terminant par ces mots : L’ennemi est sur le territoire
, la pensée que sa chère France est souillée, envahie par l’étranger, lui est insupportable.
J’arrive de la messe où je pleure abondamment, sans remords d’être faible : car j’entends dire que le Christ a pleuré sur Jérusalem. Ô Lorraine, Lorraine, boulevard héroïque de la vieille Gaule, tu vas donc la livrer aux ennemis.
Peu de jours après le désastre de Sedan, date inoubliable, en méditant au pied de la croix sur la cause de nos malheurs, elle écrit :
Le mal a pénétré jusqu’à la moelle de nos os, et ce mal c’est la faiblesse.
— Hélas ! depuis vingt-sept ans, sommes-nous guéris de ce mal ? —
Nous sommes envahis au dedans comme au dehors par cet ennemi qui nous a livrés à tous les autres ennemis de notre gloire ; la faiblesse nous a terrassés. Relevons enfin la tête, regardons-la bien en face ; sachons au juste ce qu’elle est pour apprendre à la vaincre, s’il est possible, avant d’être tués par elle. Nous courbons la tête sous un poids terrible, nous pleurons des larmes intarissables, nous poussons un cri de détresse qui se fait entendre jusqu’au rivage du nouveau monde, car notre douleur n’est pas la douleur d’une créature éphémère ; nous assistons au désastre d’un grand peuple dont nos pères ont vu la gloire. Ô France, mère chérie, sommes-nous destinés à te voir ensevelie comme la Pologne, ta sœur ? Tes enfants n’ont-ils pas le sang généreux de leur père ? Mais ils en ont trempé les sillons de tes champs à Wissembourg, à Wœrth, plus abondamment qu’à Poitiers sous Charles Martel ! Ton ennemi était-il donc bien formidable ? Ce n’était pourtant pas l’Europe entière, comme il y a 80 ans. Non, mais ils étaient forts, et chacun de nous est faible… Éveille-toi, sentinelle de mon âme, et ne forfais plus à ton devoir. Pousse le qui-vive au moindre bruit, car ce peut bien être l’ennemi ou le sauveur qui rôde autour du camp.
Et ces accents virils, énergiques, pleins d’une noble ardeur, sortaient de l’âme d’une jeune fille de vingt-quatre ans !
Ah ! c’est alors et surtout qu’elle déplore de n’être qu’une femme, elle qui brûle de répandre son sang jusqu’à la dernière goutte pour son pays. Elle essaie d’adoucir ce regret poignant en s’occupant des blessés, dans les ambulances ; après les soldats français, les soldats prussiens. Sous le nom de Compagnie de Jeanne d’Arc
, elle a groupé ses amies et ses élèves ; outre le brassard de l’Internationale, ces jeunes filles ont adopté en signe de ralliement la croix de Lorraine avec le nom de Jeanne et la devise de celle-ci : Vive labeur !
Elles distribuent des vivres, des vêtements, des cigares, et elles ont pour les malheureux vaincus un regard de compassion et un sourire d’espérance.
Gérald, dont le régiment a donné l’un des premiers, a reçu de sérieuses blessures qui l’ont mis hors de combat. Il n’a pas été emmené prisonnier, il est resté à Reichshoffen ; sa mère et sa sœur espèrent que bientôt il leur sera rendu. Des semaines passent, nos désastres se multiplient avec une effrayante rapidité : aucune nouvelle du blessé.
Une inquiétude dévorante s’empare des cœurs qui l’aiment si tendrement. Marie-Edmée n’y tient plus ; forte de la protection divine, de la bénédiction maternelle, elle part, au milieu d’un pays envahi, à la recherche de son frère bien-aimé. Pas un retour sur elle-même, elle oublie qu’elle est belle, qu’elle est jeune, délicate, que des dangers de toutes sortes la menacent ; sa mère se meurt d’angoisses : Gérald est peut-être seul, abandonné ; son cœur lui dit de partir, et elle obéit. Elle retrouve le jeune lieutenant à Reichshoffen ; mais, pour l’emmener, il faut l’autorisation du prince de Bismarck. Trois fois, la jeune fille se présente devant ce puissant personnage, qui ne veut pas consentir à ce qui lui est demandé : il exige une promesse formelle que l’officier français ne reprendra pas les armes. Quoique amputé du bras droit, le vaillant soldat n’a pas renoncé à tenir son épée : n’a-t-il pas la main gauche ? Il ne prendra jamais un engagement qu’il est résolu de violer. Enfin, après l’attestation d’un médecin allemand, vaincu peut-être par la persévérance de la jeune Lorraine, doutant aussi que le lieutenant Pau pût redevenir un adversaire sérieux, le prince donna la permission si ardemment sollicitée, et, dix jours après son départ, Marie-Edmée a la joie de ramener Gérald à sa mère.
Deux mois plus tard, le jeune officier convalescent, mais non guéri de son affreuse blessure qui est à peine cicatrisée, parle d’aller rejoindre son régiment. Sa mère et sa sœur, tout en larmes, essaient d’ébranler cette résolution. C’est inutile. Je ferai mon devoir
, répond-il simplement. C’est ainsi qu’il nomme la sublime folie qu’il veut tenter. Alors la mère, immolant son amour maternel à l’amour de la patrie, aussi héroïque, aussi admirable que le fils formé par ses leçons et par ses exemples, ne résiste plus et le laisse partir…
D’abord, le capitaine, car Gérald a été promu à ce grade, écrit plusieurs lettres qui rassurent sa chère famille, puis le silence se fait et on ne sait plus rien de lui. Est-il de nouveau blessé, prisonnier ?… Mme Pau et sa fille n’osent aller au-delà de ces tristes prévisions, et pourtant… Cet état d’incertitude, d’anxiété mortelles ne saurait se prolonger. Marie-Edmée qui, peu de temps auparavant, écrivait cette plainte sublime : Je suis jalouse de ceux qui meurent pour mon pays, jalouse quelquefois jusqu’à la folie
, ne peut rester dans l’inaction et voir couler les larmes de sa mère sans essayer de les tarir.
Le 9 février, se confiant en Dieu, en son bon ange, en Jeanne d’Arc, pour retrouver une dernière fois le cher combattant, elle quitte Nancy. Elle va de villages en villages, d’ambulances en ambulances. Elle visite les hôpitaux, prenant des informations, compulsant les registres des blessés et même celui des morts, interrogeant les aumôniers, les sœurs de charité, arrêtant les prisonniers, les traînards. Elle passe la frontière, recommence le même labeur, sans que son courage faiblisse, sans que l’espérance l’abandonne.
Si préoccupée qu’elle soit de son frère chéri, elle ne se désintéresse pas pour cela des souffrances, des douleurs qu’elle côtoie à chaque pas, et son ingénieuse charité lui fait trouver les moyens de les adoucir et de les consoler. Elle prend le nom, l’adresse des soldats mourants, et elle fait parvenir des nouvelles aux familles qui pleurent et attendent. Elle fait plus encore : grâce à son talent d’artiste, plus d’une pauvre mère reçoit, comme consolation suprême, une esquisse lui retraçant les traits d’un fils à jamais perdu pour elle ici-bas.
Après des fatigues, des misères inouïes, Marie-Edmée apprend que son frère est en sûreté. Dans sa tâche ardue, elle a été puissamment aidée par un généreux étranger, M. Jurgensen, qui, Danois d’origine et établi en Suisse depuis plusieurs années, a, dès le début de la guerre, prodigué toutes ses sympathies à notre malheureuse France. Elle n’a plus qu’un désir, retourner au plus tôt consoler celle qui l’attend avec une fiévreuse impatience.
Avant de s’éloigner, elle écrit longuement à son frère ; en terminant, elle lui dit :
Que Dieu te garde, mon vaillant et bien-aimé Gérald, qu’il te ramène à ta mère et qu’il te garde au pays !…
Ce vœu, ainsi que d’autres plus intimes ont été entendus. Ce frère tant aimé est resté digne de sa sainte et héroïque sœur ; aujourd’hui, comme il y a quinze ans, la parole du général Ambert, si éloquente dans son énergique concision, est toujours vraie :
Gérald honore l’armée française.
Le 25 février, brisée par les fatigues et les privations, brisée surtout par les douleurs de la patrie, Marie-Edmée rentrait à Nancy. Le rêve de toute sa vie allait bientôt être une réalité ; elle qui ambitionnait uniquement la joie austère du dévouement et du sacrifice, elle allait mourir parce qu’elle s’était dévouée et sacrifiée. La vierge lorraine, Jeanne d’Arc, à qui, peu de mois auparavant, elle adressait l’ardente invocation qui suit :
Sœur, ange, amie, toi que j’aime de toute la force de mon âme, toi qui m’as sauvée de l’esclavage dans la personne d’une de mes aïeules, toi qui croyais à la justice, à la liberté, à la victoire, obtiens-moi quelques étincelles de ta foi, de ton espérance, de ta vaillante charité.
Jeanne d’Arc l’a exaucée : elle a noblement accompli sa tâche, l’heure de la récompense a sonné…
Comment peindre la douleur de Mme Pau, qui ne revoyait sa fille que pour la perdre sans retour ?… Laisse-moi partir, disait l’angélique malade, laisse-moi partir, mère, il me semble que je suis prête, et plus tard, qui sait ?…
Et la mère, dont le cœur se brisait à la pensée d’un irréparable adieu, ne répondait que par ses pleurs… Que se passa-t-il entre ces deux âmes si étroitement unies et qui allaient être momentanément séparées ? Leurs anges gardiens descendirent-ils des saintes demeures pour les encourager et les soutenir ?… Vint-il de l’au-delà une lueur, un éclair, qui permit à celle qui restait d’entrevoir quelque chose des splendeurs de cet invisible caché aux regards mortels ?… Qui saurait parler de ces mystères ?… Mais la mère, soulevée au-dessus des sentiments de la nature, ravie par un élan sublime dont Dieu seul eut le secret, avec une résignation toute d’amour, prononça le Fiat qui lui était demandé…
Le 7 mars 1870, Marie-Edmée avait écrit ce qu’on va lire :
Faites, ô Christ, la part du bien que j’accomplis, et ne rendez que moi responsable du mal qui vous scandalise. Ce mal, je l’amoindrirai, et quand je serai parvenue à ce que Dieu veut que j’atteigne, alors que l’heure de la récompense me trouvera debout.
Un an plus tard, jour pour jour, heure pour heure, le 7 mars 1871 la jeune agonisante, qui n’apercevait plus sa mère à son chevet, par un dernier effort de son énergique volonté, s’échappait de sa couche et venait tomber dans les bras de Mme Pau accourue aussitôt ; elle ne devait plus se relever ; dans cet élan suprême, son âme s’était exhalée, et Jeanne d’Arc introduisait sa sœur dans les célestes parvis…
La ville de Nancy tout entière, s’associant au deuil d’une famille aimée et respectée, tint à honneur de faire cortège à la mère en pleurs qui suivait le cercueil de sa fille. En voyant cette foule nombreuse et affligée, un Prussien demanda :
— Qui est-ce que vous pleurez ainsi ? Est-ce une princesse ?
— Non, répondit une enfant que Dieu sans doute inspirait, c’est une sœur de Jeanne d’Arc.
Ah ! si elle a pu entendre ces paroles naïves et si vraies, la jeune héroïne a dû tressaillir sous son suaire ; n’était-ce pas le résumé le plus admirable qu’on pût faire de sa vie, de ses aspirations et de sa mort ?…
Citons, pour terminer, quelques pensées qu’on chercherait vainement dans le journal.
Un seul désir mauvais ou mesquin suffit pour découronner une âme.
L’âme du saint ou du parfait artiste n’est qu’une âme altérée de la beauté.
L’amitié n’est pour moi que le bâton du voyage, l’eau de la citerne, l’ombre du peuplier sur le chemin de la vie. Je suis prête à le donner, Seigneur, ou à le recevoir suivant votre sainte volonté.
Sacrifice du sang, sacrifice du cœur, n’importe, l’âme ne se couronne que par le sacrifice.
La vie n’est pas seulement un voyage, c’est une épreuve.
J’ai une inébranlable foi dans cet unique bonheur de la vie humaine : passer en faisant le bien.
La grâce de la véritable paix, qui est la plus douce et la plus rare, ne saurait descendre que dans un cœur humble.
Demain n’est à personne ; il est souvent à la mort, il est toujours à Dieu, et il n’appartient qu’à Lui.
Notes
- [1]
Abbé Henri Perreyve (1831-1865), docteur en théologie, professeur à la Sorbonne et légataire des manuscrits du père Lacordaire.
- [2]
En 1897 Mme Pau vivait encore. Elle mourut le 8 avril 1908, à l’âge 82 ans.
- [3]
Guido Görres : Die Jungfrau von Orleans (1834), traduit en en français par Léon Boré : Vie de Jeanne d’Arc, d’après les chroniques contemporaines (1843).
- [4]
Grand in-quarto de 84 pages, édité par E. Plon et Cie, Paris, 1874.
- [5]
Haut les cœurs ! courage !
- [6]
Père Alphonse Gratry (1805-1872), oratorien, philosophe, professeur de morale évangélique à la Sorbonne, élu à l’Académie française le 2 mai 1867.