Texte : Livre I
1Livre I La mission
3Chapitre premier La prédestinée
I
Les champs de Vaucouleurs
La vallée charmante s’émaille au printemps de fleurs diaprées, une vraie vallis colorum, qui donne son nom au lieu le plus important de la contrée, Vaucouleurs. La Meuse y promène, calme et ondoyante, ses méandres capricieux. Sur les bords frais et verts de la rivière, s’asseyent pittoresquement divers villages, tous plus importants que le plus célèbre d’entre eux, tous placés là comme pour servir d’avenues à leur humble et glorieux protégé, le village de Domremy.
Les avenues de Domremy
Venez-vous de l’Ouest, par la route de Bar-le-Duc à Épinal, vous rencontrerez Vouthon, où naquit la mère de 4Jeanne ; Greux, où l’enfant assistait à l’office quand un parti de Bourguignons brûla l’église.
L’avenue du Nord place, sur la route du pèlerin, d’abord Vaucouleurs où tant d’épreuves inaugurèrent la mission de l’héroïne ; puis Maxey-sur-Vaise où plusieurs fois elle s’ouvrit de sa vocation à noble homme Geoffroy du Fay
; enfin là haut, sur la côte chargée de vignes et de blé, le village de Burey qu’elle habita deux fois chez son oncle Durand, en un logis modeste qu’on montre encore.
Mais, si vous venez du Midi, c’est par Neufchâteau, à 11 kilomètres en amont de Domremy, que vous commencez à reconnaître les vestiges des pas de la Pucelle. Sa statue orne l’antique asile des religieux Cordeliers, à qui elle aimait de préférence confier les chastes secrets de sa conscience innocente. À Coussey, au chevet de l’église, encore la statue de Jeanne. Ces images semblent posées là pour préparer l’âme du voyageur au but de son pèlerinage. Pendant tout le trajet, comme pour bercer son rêve, à sa gauche, serpente le cours sinueux de la rivière, qui traîne ses eaux paresseuses aux pieds des saules, à travers de gras pâturages. Devant lui, Domremy, à l’extrémité de l’immense prairie et du long ruban d’argent qui s’y déroule, Domremy s’enveloppe de verdure, comme une fleur printanière dans son bouton. On y entre par un pont de cinq arches, construit récemment sur la Meuse, et qui porte la route d’une rive à l’autre1.
Le bourg natal
Nous voici enfin au village qu’on a pu appeler le Bethléem de la nouvelle rédemption
. Le patronage du Baptiste de la nation française couvre de temps immémorial la modeste bourgade. Saint Remi a baptisé la France, son nom est entré dans la composition même du nom de Domremy.
Bâti dans les humbles proportions d’un village rustique, tel qu’on les rencontre au pays lorrain, le bourg natal de 5Jeanne est traversé du Nord au Sud, dans toute sa longueur, par une rue, dont la première moitié est formée, jusqu’en face de l’église et du pont, par la route qui vient de Greux. La seconde est parallèle à la rivière et passe devant la maison de Jeanne, puis devant le moulin dont elle prend le nom. Cette voie transversale a gardé le cachet rustique et lorrain : l’attirail du labourage, les monceaux de bois entassés, encombrent le seuil des habitations.
Comme Jeanne l’aimait
Ceux qui résident sous ces humbles toits se distinguent, même en Lorraine, par les traits qu’ils ont hérités des contemporains de Jeanne, qui disait de ses compatriotes :
— Je n’ai connu qu’un seul Bourguignon à Domremy.
Tous les autres étaient Armagnacs, c’est-à-dire dévoués à la cause de la France. Sous la forme ardente d’un patriotisme que leur héroïque concitoyenne allait fixer à tout jamais ès cœurs des Français
, ils ont déposé leurs généreux sentiments dans l’âme de leurs enfants. Aujourd’hui encore les habitants de Domremy sont universellement réputés pour être unis et pacifiques entre eux, hospitaliers, polis et bienveillants envers les étrangers.
Jeanne aimait de prédilection son village et ses habitants.
— Plût à Dieu mon Créateur, s’écriait-elle à Reims, en pleine gloire après le sacre de son roi, plût à Dieu que je m’en retournasse maintenant, quittant les armes, et que je revinsse servir mon père et ma mère, à garder leurs troupeaux, avec ma sœur et mes frères, qui seraient bien aises de me revoir !
II
Au foyer de la famille
L’humble demeure, où l’on s’aimait de si bon cœur, existe encore.
Entre les mains des descendants de la famille, la
maison de Jeanne la Pucelle, assise proche de l’église, la cymetire 6d’une part, etc., [acte notarié du 15 février 1586]
est resté un dépôt sacré. Un pèlerinage national s’y renouvelle depuis cinq siècles, sans lasser la persévérance des visiteurs qu’attirent la grandeur des souvenirs et le parfum de la sainteté dans le patriotisme.
Déjà, en 1580, Michel Montaigne y venait, comme tous ses contemporains, et notait, dans ses Récits de voyage en Italie, comment
le devant de la maison où naquit Jeanne d’Arc est tout peint de ses gestes, mais l’aage a fort corrompu la peinture.
À quel prix la maisonnette fut conservée en ce siècle
Par son généreux désintéressement, le dernier héritier en ce siècle des trois familles d’Arc ou du Lys, de Salm et Gérardin, Nicolas Gérardin, se montra digne de ses devanciers. D’étranges pèlerins avaient envahi l’humble maisonnette. C’était lors de l’invasion des troupes alliées en 1815. Enthousiasmés par la tragédie de Schiller, les Allemands visitèrent en amateurs la célèbre maison. À coups de sabre, ils se firent des reliques dans les meubles et les poutres. Des princes autrichiens y vinrent entourés d’une brillante escorte, se tenant inclinés nu-tête devant la statue de la Pucelle et sollicitant, comme souvenirs de leur visite, des éclats de bois, des fragments de pierres et même les herbes parasites des murailles. L’archiduc Ferdinand détacha de ses propres mains une petite pierre, dont la place est encore visible au-dessus du linteau de la porte principale. Un comte prussien, plus ambitieux, demanda le tympan sculpté et la statue qui le couronne, Gérardin refusa. Le comte fit briller un trésor et offrit 6.000 francs de la maisonnette tout entière. Gérardin était pauvre et chargé de famille, mais, en vieux dragon français qu’il était, il demeura inflexible devant le déshonneur offert à l’héritier de Jeanne. Toutes ces tentatives cependant émurent le Conseil général des Vosges qui voulut assurer au département le berceau de la Pucelle et le sauver ainsi d’une ruine qui semblait prochaine. Trois ans après qu’il eut repoussé l’offre tentante du Prussien, Gérardin, le 20 juin 1818, 7signait l’acte de cession au Conseil général, pour une somme près de trois fois moindre. La ville d’Orléans lui décerna une médaille d’or et Louis XVIII décora le généreux cessionnaire. La maison devenait un monument national et, classée comme tel, elle recevait les secours qui en assurèrent la conservation2, après l’avoir isolée de l’îlot de maisons qui l’enveloppaient et en obstruaient l’avenue.
L’extérieur
La façade présente un demi-pignon inclinant le toit de gauche à droite. Les rameaux entrelacés de la vigne sauvage la tapissent de verdure et encadrent des baies ou fenêtres dans le style du XVe siècle. La porte est ornée de plusieurs rangs superposés de sculptures, formant cintre, et surmontées d’une accolade qui embrasse trois écussons. Celui du milieu, plus élevé que les autres, présente les armes de France soulignées par la devise en lettres gothiques :
Vive le roi Loys !
Celui de gauche porte les armes des Thiesselin, dont la fille Nicole épousa, en 1460, Claude du Lys, alors propriétaire de la maison. L’écu de droite est meublé des armoiries données, en décembre 1429, par Charles VII à la famille de Jeanne d’Arc : deux lys d’or en champ d’azur, côtoyant une épée nue d’argent à la garde dorée, placée en pal, et dont la pointe soutient une couronne3. Au sommet de l’ogive, l’œil attendri retrouve les attributs du travail champêtre auquel Jeanne se livrait avant de manier l’épée : une gerbe debout et des ceps de vigne chargés de 8raisins. Au-dessous, en style épigraphique du temps, ces mots :
Vive labeur ! [puis la date] 1481.
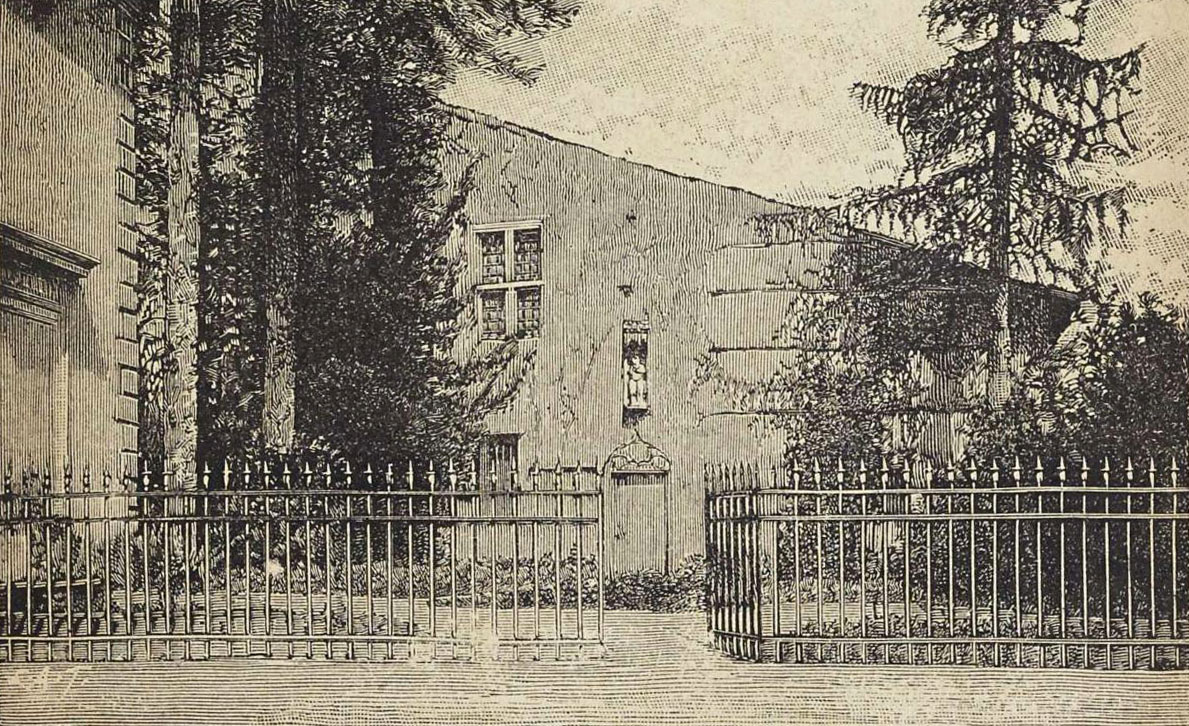
La chambre familiale et la cellule de Jeanne
Pénétrons maintenant dans l’intérieur de l’humble demeure, qui devait être le Nazareth de l’héroïque et sainte libératrice de la France.
L’habitation se compose de quatre pièces au rez-de-chaussée.
En franchissant le seuil de la porte que nous avons décrite, nous sommes dans la chambre de famille, où Jeanne naquit le 6 janvier 1412, où elle fut élevée par sa pieuse mère, où elle grandit dans la prière, l’obéissance et le travail. À gauche, auprès de la fenêtre géminée, l’enfant apprit à manier si habilement l’aiguille et le fuseau, qu’à Rouen, lors de son procès, elle put se rendre le naïf témoignage, que, dans l’art de coudre et de filer, elle n’avait pas peur d’être vaincue par les meilleures ménagères. Un peu plus loin, la plaque de fer de la cheminée, aux armes de Lorraine et de France, indique l’âtre du foyer au coin duquel la jeune fille passait la nuit, quand elle avait eu le bonheur d’amener un pauvre à la maison et de lui céder sa propre couche. Près de là, un morceau de bois, posé dans le mur, tenait suspendue la lampe pour les travaux des longues veillées d’hiver. Dans cette pièce, tout à la fois cuisine, salle à manger et chambre à coucher, suivant l’usage du pays, Jeanne vaquait, avec sa mère et sa sœur, aux occupations vulgaires du ménage, car on ne la rencontrait jamais oisive sur les chemins. C’est dans cette laborieuse et chrétienne éducation de famille qu’elle se préparait au grand œuvre du salut de la France, auquel Dieu la prédestinait.
Jetée, par les hasards de la guerre, loin de ce nid doux et pur de son enfance, elle en portait partout au doigt le souvenir. C’étaient deux anneaux donnés, l’un par son frère l’autre par son père et sa mère. Ce dernier portait gravés les noms sacrés Jhésus Maria.
Ayant cet anel en sa main et en son doigt, — dit un vieux chroniqueur, — elle 9avait touché à sainte Catherine.
Aussi, chaque fois qu’elle se lançait dans la bataille, elle le regardait
par plaisance et honneur de ses père et mère, car la Pucelle aimait tout ce que bon chrétien doit aimer, et le dict anel lui remembrait tout ce qu’elle aimait.
Saluons la belle statue de Jeanne qui s’élève aujourd’hui au centre de la pièce sur un piédestal de marbre noir, et, après avoir jeté un coup d’œil aux belles couronnes envoyées là en mai 1878 par les dames françaises en protestation contre la célébration du centenaire de l’immonde insulteur de la Pucelle, franchissons le seuil de la cellule de Jeanne, au fond, en face de l’entrée de la cuisine.
Au nord et au niveau du sol, éclairée seulement par une petite lucarne, elle est presque obscure. Par les traces de la cheminée qui subsistent encore dans le grenier, on voit que c’était le fournil de la maison. À gauche de la petite fenêtre, Jeanne serrait ses vêtements dans un placard, dont le châssis tailladé témoigne à la fois du vandalisme et de la vénération des visiteurs.
C’est bien là, dans ce pauvre réduit, qu’elle a reposé, qu’elle a reçu plusieurs avertissements célestes, qu’elle lutta pendant cinq ans contre son cœur et les ordres de ses voix
. C’est là qu’elle combina, sous l’œil de Dieu qui éclairait cette chambrette obscure, les moyens d’accomplir sa volonté manifeste. Qui comptera les souvenirs et les larmes dont ces murs noircis furent les témoins muets ! Ce qu’elle répandit de prières, agenouillée sur la terre nue, devant cette étroite lucarne par où son regard plongeait sur la maison de Dieu ; de quelles lumières elle fut éclairée et par quels encouragements fortifiée, dans cette demeure indigente, elle seule le sait et a pu le dire !… La paix, la nudité de ces murs, les souvenirs qui revivent là, l’obscurité mystérieuse de cette chambrette, en font comme le second sanctuaire de Domremy, dans le secret duquel, entre le ciel et une humble paysanne, s’est préparée la rédemption de la France. Toute proportion gardée, là, comme 10jadis la Vierge ignorée de Nazareth, le Tout-Puissant l’a choisie pour humilier les forts et se glorifier en elle.
Quand il sort de ce sanctuaire, le visiteur pénètre successivement dans le cellier, la chambre des frères de Jeanne, le grenier, puis termine son pèlerinage par le petit musée, où la piété des souvenirs a réuni bien des gages de la vénération française pour la sainte héroïne4.
Mais il est temps de commencer notre récit5.
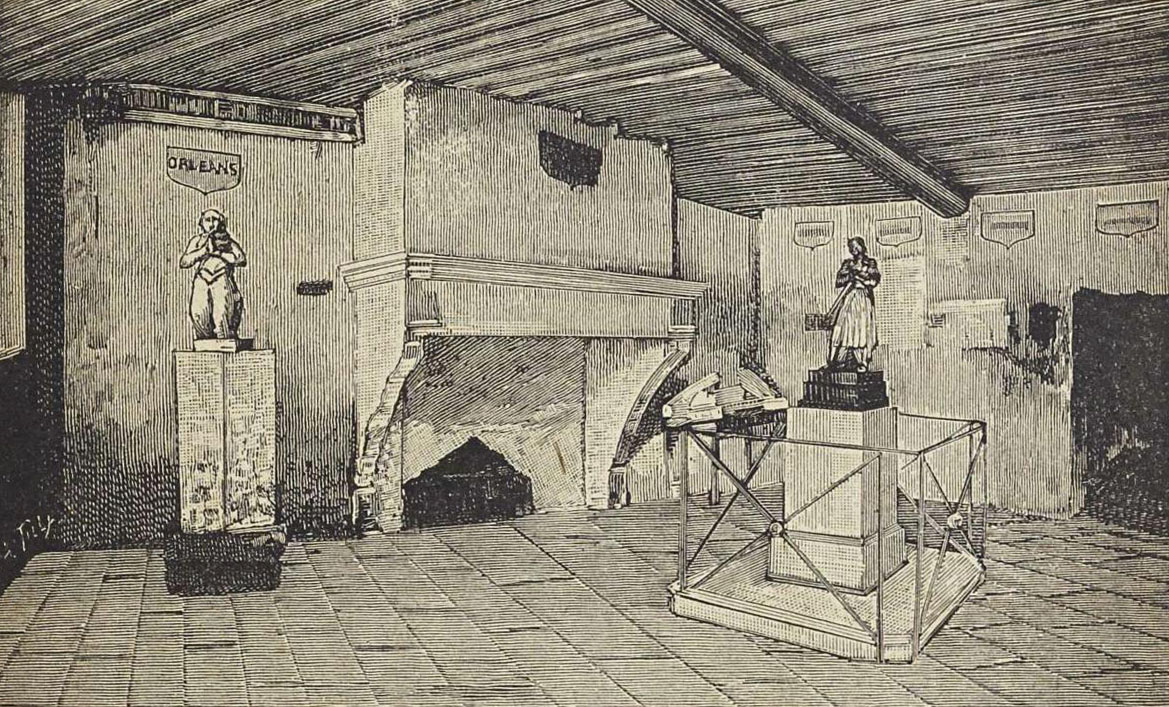
III
Sa naissance
Jeanne naquit le 6 janvier 1412.
Son père, Jacques d’Arc, et sa mère, Ysabellette Romée, étaient de modestes laboureurs, de bonne vie et renommée
, bons catholiques, fidèles Armagnacs du parti national. Avec leur maisonnette, ils ne possédaient qu’un bien petit champ, mais leur pauvreté gardait l’honneur qu’ils inculquèrent à leurs cinq enfants.
Ses frères et sœurs
Trois fils, Jacques, Jean et Pierre, et deux filles, Jeanne et Catherine — celle-ci mourut avant le départ de son aînée — grandissaient sous la sauvegarde de ces braves campagnards, qui en faisaient de bons chrétiens et de bons Armagnacs.
La mère semble avoir pressenti les grandeurs de sa fille Jeanne. Elle cultivait avec un soin jaloux les premières 11aspirations de cette âme innocente et droite. Jeanne, dit une compagne de son enfance, était bonne, simple et douce fille
; point paresseuse
, ajoute un voisin, elle travaillait volontiers, elle filait, elle allait au labour avec son père, hersait la terre et sarclait les herbes parfois même elle gardait les troupeaux
. Souvent le même témoin la vit prolonger ses veillées laborieuses au logis, en filant aux côtés de sa mère.
Influence de la mère sur l’éducation de sa fille aînée
Sa grande foi, cette croyance ferme qui illumina sa vie et transfigura son martyre, Jeanne la tenait encore de sa pieuse mère. Le procès de Rouen l’a constaté en termes exquis. La grâce de sa prédestination se surajouta à cette influence première et en fit une âme élevée de bonne heure aux plus sublimes états de la perfection chrétienne.
Son attrait pour la maison de Dieu
À travers la petite baie qui éclaire encore sa modeste chambrette, l’enfant apercevait l’église, le sanctuaire eucharistique où l’attirait l’irrésistible élan de son âme candide. Pour y arriver, il suffisait de franchir le petit jardin de la maison paternelle, le cimetière où reposaient les anciens à l’ombre des murailles saintes, et Jeanne se trouvait au pied de l’autel, dans la douce et calme solitude du tabernacle, ses délices d’enfant prédestinée.
La foi de l’enfant
Elle y allait le plus souvent qu’elle pouvait dans la journée, disent les témoins du procès, mais surtout le matin, à l’heure de la messe, et le soir, quand sonnaient les complies, cette sublime prière vespérale que les chrétiens d’alors, mieux initiés à l’esprit de la sainte liturgie, récitaient avec les prêtres et les clercs.
Comment elle réprimandait et exhortait le sonneur négligent
Parfois le sonneur, c’est lui-même qui le confesse, oubliait de sonner à l’heure, et Jeanne l’en reprenait, lui disant que ce n’était pas bien et, pour le rendre plus docile à ses exhortations, elle lui promettait de petits gâteaux6 confectionnés au logis des d’Arc.
Jeanne enfant à l’église de Domremy
Le pèlerin de Domremy ne peut se soustraire à une religieuse émotion, quand il visite la pauvre église où Jeanne 12a exhalé ses premiers soupirs vers l’hôte divin qui déjà se communiquait si intimement à la virginale enfant. C’est sur ces dalles que Jeanne s’est prosternée, sous ces voûtes que tant de fois elle a levé les mains et les yeux vers l’autel. Ce sont bien ces piliers qui ont entendu sa voix, ses soupirs, et peut-être ont été les secrets témoins de quelque mystérieuse vision. Un artiste lorrain, M. Paul, a exprimé cette idée en adossant à la façade de l’église une statue de fonte de la Pucelle, en habits rustiques, un genou en terre, le regard et des bras levés vers le ciel.
Les fonts baptismaux et l’autel de la Vierge
De l’église primitive bien des choses ont disparu, lors de l’incendie que lui infligèrent les bandes bourguignonnes7. Il en reste encore assez pour réveiller d’émouvants échos au fond des âmes.
Voici les fonts baptismaux de l’époque romane (XIe siècle), où, selon toute vraisemblance, la fille de Jacques et de Romée fut baptisée par messire Jean Minet, curé de Dreux et de Domremy. Selon l’ancien usage, qui subsista jusqu’au 13concile de Trente, elle fut présentée par une foule de parrains et marraines, heureux de lui servir de caution devant la sainte Église8.
Des fonts baptismaux où elle était devenue enfant de Dieu, fille Dé
, comme ses saintes l’appelèrent plus tard, Jeanne fut déposée sur l’autel de Notre-Dame, en signe de consécration de la néophyte au cœur immaculé de la Mère de Dieu. Bien souvent, elle revint là, pour en ratifier et en accomplir les filiales obligations9.
IV
Le pèlerinage de Notre-Dame de Bermont
Deux petits sanctuaires champêtres attirèrent de bonne heure les pèlerinages de Jeanne. Tous deux ont gardé le parfum de son passage.
Le premier, Notre-Dame de Bermont, au delà du village de Greux, est encadré de grands bois, sur une petite éminence, d’où l’œil plonge sur un gracieux et vivant paysage.
Une inscription touchante, en forme d’épitaphe au petit 14cimetière qui l’avoisine, y rappelle que
cette chapelle, suivant la tradition confirmée par l’histoire, est bien véritablement celle où Jeanne d’Arc reçut les inspirations qui la portèrent à se dévouer au service de son pays. Respectez cette chapelle en mémoire de l’héroïne qui arracha la France des mains des Anglais.
L’ermitage Sainte-Marie
L’autre sanctuaire, l’ermitage Sainte-Marie, dont les fondations subsistent encore, s’élevait du côté opposé de Domremy, sous le bois Chesnu, non loin des fontaines et de l’arbre des Fées, si souvent rappelés dans le procès de Rouen.
Auprès de l’arbre des Fées
Cet arbre était un vieux hêtre, d’une remarquable beauté, large, touffu, dont les branches, en se recourbant jusqu’à terre, formaient un vrai dôme de verdure. Majestueux encore au XVIIe siècle, quand Richer le visita, il tomba depuis sous la hache des soudards suédois. La place servait aux ébats de la jeunesse10, et ce fut de ces ébats que les juges de Rouen firent le pivot de la procédure dirigée contre leur innocente victime, qu’ils s’efforçaient d’incriminer de superstitions, de maléfices et de sorcellerie.
— Depuis que j’ai l’âge de raison, répondit Jeanne à ses 15accusateurs, je ne me souviens pas y avoir été danser… J’ai pu y danser auparavant avec les autres enfants… J’y ai plus chanté que dansé. Mais depuis que j’ai su qu’il fallait que je vinsse en France, je me suis livrée à ces jeux et à ces distractions le moins que j’ai pu… J’ai entendu des anciens (ils ne sont pas de mon lignage) dire que les Fées hantent cet arbre… Quant à moi, je ne les y ai jamais vues.
16Chapitre second L’appel
I
La grande pitié du pays de France
En ce temps-là, il y eut grande pitié
au royaume de France.
Vainement, la sagesse de Charles V, si heureusement secondée par la vaillance de Duguesclin, avait à peu près cicatrisé les blessures faites à la France sous les deux premiers Valois, réparé les malheurs de Crécy et de Poitiers, effacé les hontes du traité de Brétigny, la folie de Charles VI et les folies de son règne précipitèrent la France dans de nouveaux et plus profonds abîmes. Le flot 17de l’invasion étrangère, un instant contenu par l’épée de Duguesclin, reprit sa marche offensive. L’honneur de la dynastie était traîné dans la fange par les scandales d’Isabeau de Bavière ; et, tandis que ce n’eût pas été trop de toutes les forces de la France pour lutter victorieusement contre l’ennemi du dehors, ces forces se divisèrent. Le fléau de la guerre civile déchaînait ses fureurs sur le pays.
Un sombre tableau
La société, remuée jusque dans ses dernières profondeurs, vomissait à sa surface l’écume du genre humain, ces scélérats sans conscience et sans entrailles qu’aucun forfait n’arrête. En 1407, le duc d’Orléans, assassiné par des affiliés du duc de Bourgogne, rougit de son sang le pavé de Paris. En 1413 et en 1418, une Commune insurrectionnelle déchaîna sur cette malheureuse capitale toutes les horreurs d’une démagogie en délire. C’est le boucher Caboche, c’est le bourreau Capeluche, qui se promènent en maîtres dans les rues de la grande ville, et qui, avec leurs valets d’abattoir, les manches retroussées et sanglantes, hurlant le meurtre, vont briser les portes des prisons où étaient détenus les otages des Armagnacs ; et cela, pendant que les Anglais, s’avançant par la Normandie, prenaient successivement Saint-Lô, Caen, Honfleur, Évreux, et venaient mettre le siège devant Rouen. Peu de temps après, le traité de Troyes (1420) mettait sur cette époque désastreuse le sceau de l’infamie. Isabeau de Bavière, affichant son déshonneur, reconnaissait pour héritier de la couronne de France Henri de Lancastre. La France n’était plus qu’une province anglaise ; Paris devenait un faubourg de Londres.
Bientôt, le fils de Charles VI, errant et fugitif dans ses propres États, doutant même de son droit, ne sera plus que le roi de Bourges ; et encore, ce titre dérisoire sera-t-il singulièrement menacé lorsque les Anglais, poussant toujours en avant leur conquête, viendront mettre le siège devant Orléans, boulevard de la ligne de la Loire et protection des provinces du Midi.
18En vérité, s’écrie l’éloquent historien de cette catastrophe nationale à qui nous en empruntons le sombre tableau11, en vérité, quand on relit l’histoire lamentable de ce demi-siècle, depuis 1380, il semble qu’avec le Dante, on descende un à un les cercles toujours plus sombres de cet enfer sur les portes duquel le poète florentin a lu ces terribles paroles :
Vous qui entrez ici, laissez toute espérance.
Dans un coin ignoré
Humainement, la France était perdue.
Mais, dans un coin ignoré de cette France envahie, retentissait devant Dieu la prière de l’Imitation de Jésus-Christ, traduite précisément en ce siècle malheureux, comme pour donner à l’âme française une voix, qui disait :
Ô mon Dieu, à moy venez, et réconfortez votre pauvre serviteur, et le resjouissez ; estendez votre main, et délivrez-le de toute douleur et angoisse. Venez, sire, venez !
Et l’infinie miséricorde répondait, dans le silence de sa solitude, à l’âme qui la suppliait ainsi :
Beau filz, je suis le Seigneur qui réconforte au temps de tribulacion….. Tiens-toy ferme et persévérant. Soyes courageux, et la consolacion te viendra, quand je saurai que sera ton proffict. Attends-moi et surattends. Je viendrai et je te guérirai12.
Elle vint, à l’heure marquée dans les desseins éternels de Dieu sur la vocation de la nation française et sa mission dans le monde.
II
Première apparition de l’Archange
C’était un jour d’été, à l’heure de midi.
Jeanne avait treize ans. Elle se trouvait, à ce moment, dans le jardin du logis paternel, attendant peut-être le son 19de la cloche pour saluer la Vierge dont le Fiat a sauvé le monde. Tout à coup, une voix retentit à droite, du côté de l’église, et une grande clarté parut au même endroit.
— J’eus grand-peur, racontait-elle elle-même devant ses juges, mais je reconnus que la voix était digne
, et qu’elle me venait de Dieu. À la troisième fois, je vis que c’était la voix d’un ange.
Or, l’ange n’était pas seul. D’autres messagers célestes accompagnaient celui qui lui parlait. Elle les vit et s’affermit de plus en plus dans sa calme et ferme croyance.
— Je les ai vus des yeux de mon corps aussi bien que je vous vois, ajoutait-elle en parlant à ses accusateurs, et, lorsqu’ils s’en allaient de moi, je pleurais, et j’aurais bien voulu qu’ils m’emmenassent au ciel avec eux.
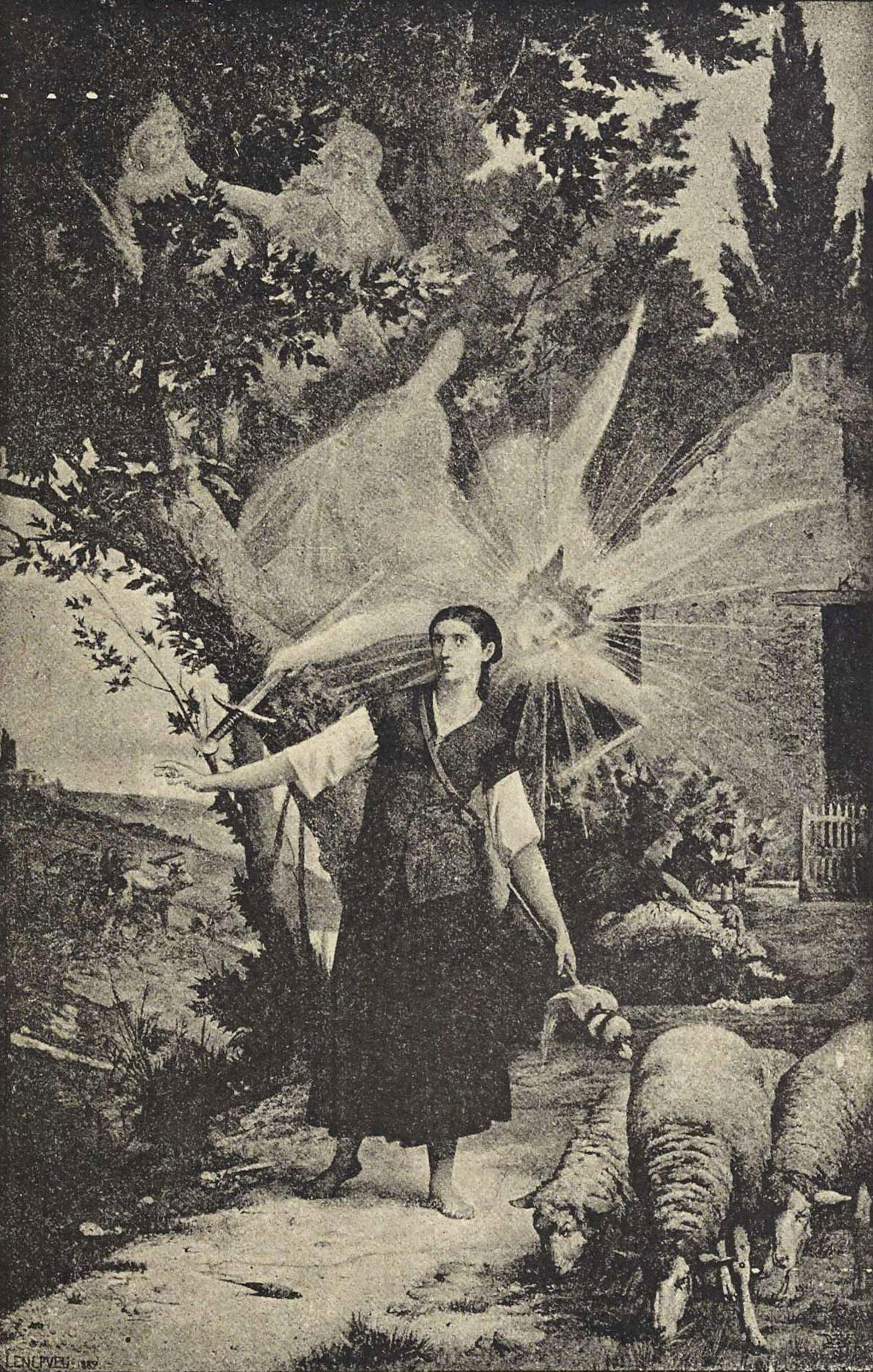
Ses recommandations
L’ange ne dit pas son nom, et, voulant sans doute la disposer peu à peu, dans l’humilité et la foi, aux grandes choses de son élection, il se bornait, les premières fois, à lui recommander de bien se conduire, de fréquenter l’église, d’être bonne fille, et que Dieu lui aiderait :
— Mon ange me disait que je sois bonne fille, que j’aille souvent à l’église, et gardasse mon âme de tout péché mortel.
L’enfant se montra docile aux exhortations du messager céleste. Sa piété, dès lors, sans cesser un instant d’être active, pratique et laborieuse, revêtit un caractère plus ferme encore. Elle restait longtemps en prière et entrait de plus en plus dans cet esprit de pénitence, qui est la caractéristique des saints. Sans cesse, elle voulait purifier sa conscience. Elle se confessait fréquemment13. En un mot, dit naïvement le curé lui-même qui a déposé dans le procès, elle n’avait pas sa pareille au village
; et un 20autre prêtre disait qu’il n’y avait jamais eu meilleure fille dans la paroisse
. Les jeunes gens, qu’elle n’aimait pas à fréquenter, se moquaient d’elle quelquefois, mais elle n’en tenait compte. Ses petites amies, même celles qu’elle aimait le plus, Mengette et Hauviette, qui pleura beaucoup quand elle partit de Domremy, lui disaient qu’elle était trop dévote : ce qui lui faisait confusion, mais ne l’arrêtait pas14.
L’extrême délicatesse de sa conscience la tenait à l’abri des périls de son âge.
— Il n’est rien au monde, répondra-t-elle à ses juges, dont je serais aussi affligée que de me savoir sans la grâce de Dieu.
Puis, comme les interrogateurs la pressent, elle laisse échapper naïvement le secret de sa belle âme :
— Je ne sais pas avoir jamais fait péché mortel.
Jeanne a gardé l’innocence baptismale. L’Esprit-Saint, qui habitait en elle, la poussa au mystérieux attrait des plus belles âmes.
— La première fois que j’ai entendu les voix, j’ai fait vœu de virginité.
Furieux de sentir le témoignage invincible de l’Esprit qui est en elle, les juges la pressent encore. Eh quoi ! elle est assez présomptueuse, pour croire qu’elle ne peut pécher mortellement, pour être aussi assurée qu’elle l’est de son salut.
— Si je puis pécher mortellement, répond la candide vierge, je n’en sais rien ; mais je m’en rapporte à Notre-Seigneur. Quand je dis que je crois fermement que je serai sauvée, c’est à condition que je garderai la virginité de corps et d’âme.
Comme à ces souvenirs on comprend l’affection que Jeanne sut inspirer de bonne heure à tous ceux qui la voyaient et ne pouvaient la voir sans l’aimer. Ses compatriotes 21s’expliquaient de mieux en mieux la joie mystérieuse15 que leur causa sa naissance.
III
Saint Michel et la France
L’ange, après l’avoir rassurée de sa première impression qui fut, comme il arrive dans les grandes visions venant de Dieu, une crainte salutaire, l’instruisit et la prépara à sa sublime vocation. Mais ce n’est que quand il l’eut trouvée bien docile à l’appel de Dieu, qu’il lui révéla son nom.
— Je suis, dit-il à l’enfant, l’archange Michel !
Tous les panégyristes de Jeanne se sont arrêtés à ce mot, pour saluer le grand protecteur de la France. Saint Michel, en effet, est la lumineuse explication des merveilles accomplies par Jeanne d’Arc. C’est celle que donne Jeanne elle-même. Qui donc pouvait en donner une meilleure ?
L’archange l’a suscitée, formée et conduite. Il lui a été donnée pour la gouverner. Il lui a appris à se diriger. Il lui donne sans cesse son réconfort. Tous les jours, il l’assiste, sans jamais lui faire défaut. Ce sont tout autant d’affirmations et d’expressions tombées de la bouche de l’héroïne. Elle va plus loin. Elle lui attribue sa mission tout entière. Dans certaines séances du procès de Rouen, elle s’identifie à saint Michel, se donne pour l’archange en personne agissant par son intermédiaire et présente comme ayant été invisiblement accompli par saint Michel ce qui 22n’était visible qu’en elle. Elle en avait le droit, disent les avocats et les docteurs de la réhabilitation : les saintes Écritures offrent des exemples semblables, et le mandataire peut attribuer au mandant ce qu’il accomplit par son ordre et en vertu de la puissance qu’il en reçoit.
Saint Michel forme, avec les deux saintes dont nous allons parler, le Conseil invisible qui inspire et soutient tout ce que Jeanne entreprend. Jeanne en réfère à ce Conseil des difficultés suscitées par les guerriers, des questions posées par les faux docteurs de Rouen ; et elle oppose hardiment les décisions et les réponses qu’elle en reçoit aux décisions et aux sophismes des guerriers et des faux juges.
Les deux saintes
Saint Michel n’apparaît pas seul ; il est dignement accompagné comme il sied au premier des purs esprits. Jeanne les a souvent vus parmi les hommes, auxquels ils se mêlent sans être aperçus.
La révélation de ce protectorat de saint Michel sur la France datait de l’an 708. Une nuit, saint Aubert, évêque d’Avranches, avait été averti, par révélation céleste, de construire, au sommet d’un mont, autrefois occupé par les druides et objet d’un religieux effroi, un temple en l’honneur du grand archange. Une deuxième et une troisième apparition ayant dissipé les premiers doutes du pieux pontife, il se mit résolument à l’œuvre. La dédicace de la nouvelle église se fit avec une grande solennité le 16 novembre 709. La fondation d’une abbaye bénédictine y assura la pompe et la perpétuité du service divin.
À partir de cette époque, le mont Saint-Michel — tel fut désormais son nom, — devint le but d’un pèlerinage qui n’a pas discontinué jusqu’à la Révolution, et qui a repris, dans ces derniers temps, comme tous les autres, sur la terre encore très chrétienne de France. Il n’est point d’honneurs que nos rois n’aient rendus à saint Michel, se plaisant à lui donner le titre et le rang de Prince de l’empire des Gaules
.
La question du surnaturel dans la mission de Jeanne d’Arc
23Mais, la plus belle, la plus constante apparition de saint Michel, c’est Jeanne la Pucelle, la Pucelle acceptée telle qu’elle s’est donnée. Elle a constamment affirmé qu’elle avait été suscitée, formée, fortifiée, conduite par saint Michel. Il m’assiste tous les jours, disait-elle, sans jamais me faire défaut.
Saint Michel répondait ainsi à la confiance de la France16, car, affirme M. Siméon Luce, la France attendait de saint Michel un secours surnaturel.
L’ancienne France voyait l’archange guidant Clovis quand il allait à Vouillé briser la puissance politique de l’Arianisme ; elle le voyait donnant au bras du fils de Pépin d’Héristal la dureté du marteau pour broyer l’infidèle ; Charlemagne l’avait fait peindre sur ses étendards ; plus d’une fois les rois de France gravèrent son effigie sur 24la monnaie. La chevalerie se conférait au nom de saint Michel. Dans l’idéal et l’esprit de l’institution, que devaient être les chevaliers, sinon autant d’anges revêtus d’une chair immaculée ? La terre de France était parsemée d’oratoires, d’églises, en l’honneur de saint Michel. Toute cathédrale, toute grande église, avait sa chapelle, son autel dédié à l’archange. Le nom des places et des rues qui, en tant de lieux, gardent encore le nom de saint Michel, nous rappelle à quel point son nom fut populaire.
Il nous est donc permis de conclure, avec le P. Ayroles, que Jeanne d’Arc, cette enfant suscitée par saint Michel, remplie de la force de saint Michel, devenait dès lors l’apparition de la miséricorde divine sur la France.

IV
La Pucelle
Depuis sa plus tendre enfance et à l’aube même des premières lueurs de sa raison naissante, Jeanne témoignait d’un singulier attrait pour deux saintes, toutes deux d’ailleurs très populaires dans la dévotion des peuples, toutes deux vierges martyres, et célèbres dans les annales de l’héroïsme chrétien.
Dieu voulut que toutes deux devinssent, comme l’archange Michel, les conseillères et en quelque sorte les compagnes assidues de leur virginale cliente. Les interrogatoires de Rouen sont remplis des effusions naïves de Jeanne, quand elle parle de ses saintes
.
L’archange lui avait annoncé leur prochaine apparition et leur assistance continue, lui recommandant de les écouter, de croire à leurs paroles, parce que tel était l’ordre de Dieu. Aussi, quand les saintes lui apparurent, elle n’éprouva aucune surprise et n’eut aucune peine à les croire.
Sous leur direction, la Vierge de Domremy fit d’admirables progrès dans les voies de la sainteté. Le noviciat de 25héroïne prédestinée ne connut point de défaillance. Les anges demeuraient dans l’admiration et le lui prouvaient, en redoublant de soins, tandis que ses institutrices célestes achevaient de l’instruire en vue de sa redoutable mission.
Nous avons déjà dit de quelle vénération l’entouraient tous les témoins de sa vertu précoce. Ils sentaient l’approche de la divinité, en l’abordant, mais sans se rendre compte du mystère qui était en elle, tant elle gardait précieusement son secret17.
Nul ne songeait à mal auprès d’elle. Comme autrefois la Vierge de Nazareth, de qui l’Aréopagite raconte que sa seule vue écartait les pensées terrestres, la vue de la chaste et pudique adolescente inspirait le respect.
Une chronique contemporaine nous a conservé son portrait.
Elle était, dit le chroniqueur, très grande de corps, et tous ses membres forts et robustes. Le visage était plutôt viril que de dame. Elle avait les yeux blonds et beaux et de très gaie expression. Le nez et la bouche bien placés. Elle paraissait en tout bien conformée. Ses cheveux étaient très longs et blonds, qu’elle nouait, et pendant les batailles elle les portait hors du casque, bien que cela fût périlleux. Les siens la reconnaissaient à cela, et sa chevelure répandue sous le casque ressemblait à des houppes d’un chapeau18.
De plus en plus réservée, la docile élève des saintes recevait leurs leçons et assistait de plus en plus fréquemment à leurs colloques.
Elle les voit chaque jour et entend leurs voix, dit le rapport de la Faculté de théologie 26de Paris. Elle les a quelquefois embrassées, baisées, touchées de ses mains… Elles se montrent à elle, avec de très riches couronnes sur la tête19.
Les progrès de l’enfant dans la piété, le rare bon sens qui caractérise toujours la conduite de Jeanne, la droiture de son jugement, le calme de son âme même au milieu des actions les plus faites pour enthousiasmer son imagination, toutes ces qualités extraordinaires et bien d’autres considérations, mises en lumière par les critiques les moins prévenus en faveur du surnaturel, garantissent à l’histoire impartiale qu’elle n’a obéi, ni à l’illusion, ni à l’hallucination, ni à la suggestion plus ou moins morbide, que les ennemis de l’Église et de la France ont tenté de lui opposer20.
27V
Sens et beauté de ce nom
Entre les communications que recevait journellement la virginale adolescente, il en est une, sur laquelle les contemporains ont insisté, c’est celle du nom que lui donnaient ses sœurs du Paradis, les saintes qui l’assistaient. Le nom venait du ciel, Jeanne l’aimait pour cela et le prenait volontiers. À chaque page des Mémoires, ce nom revient et on voit qu’il avait été adopté de tous.
On l’appelait Jeanne la Pucelle.
Ce nom, que l’infâme Arouet a tenté de salir de sa bave immonde, doit rester cher aux vrais amis de Jeanne, qui se plaisent à la nommer comme la nommaient les voix et comme l’appelaient les contemporains.
Jeanne la Pucelle, c’est-à-dire la jeune adolescente, l’adolescente idéale, dans toute la délicate fraîcheur de son innocence et de sa virginale pureté.
Le chant enthousiaste de l’abbé Pie au premier lever de cette apparition virginale
Un jeune prêtre, au cœur grand et haut comme son esprit, rencontrant, au début de sa carrière oratoire, ce nom et les chastes beautés qu’il révèle, ne put contenir son ardent enthousiasme. C’était à Orléans, le 8 mai 1844. Le prêtre s’appelait Pie, il était alors vicaire à la cathédrale de Chartres et devait mourir sur le siège de saint Hilaire, à Poitiers, sous la pourpre méritée par tant d’illustres services dans l’Église de son pays. Son discours fut un chant de l’inspiration la plus élevée, digne prélude de tant de chefs d’œuvre. C’est un magnifique traité théologique de la mission de Jeanne, une intuition du génie qui devine ce que l’érudition historique ne devait pas tarder à établir. Mais, quand il voulut saluer la Vierge de Domrémy, l’abbé Pie trouva des accents incomparables.
Ô Dieu, — s’écria-t-il au milieu du religieux saisissement de son auditoire, — ô Dieu, dont les voies sont si belles et les sentiers pacifiques, vous qui marchez par un chemin 28virginal, soyez béni d’être venu à notre aide par des mains si pures et si dignes de vous ! Soyez béni d’avoir fait Jeanne si belle, si sainte, si immaculée ! Je cherche en vain ce qui pourrait manquer à mon héroïne ; tous les dons divins s’accumulent sur sa tête ; pas une pierrerie à joindre à sa couronne.
Par l’esprit et par le cœur, je ne connais rien de plus français et de plus chrétien que Jeanne d’Arc, rien de plus mystique et de plus naïf. En elle, la nature et la grâce se sont embrassées comme sœurs ; l’inspiration divine a laissé toute sa part au génie national, tout son libre développement au caractère français ; c’est une extatique chevaleresque, une contemplative guerrière ; elle est du ciel et de la terre… C’est une sainte qui n’a pas d’autels ; que l’on vénère, que l’on invoque presque, et qu’il est permis de plaindre ; que le prêtre loue dans le temple, que les citoyens exaltent dans les rues de la cité ; modèle à offrir aux conditions les plus diverses, à la fille des pâtres et à la fille des rois21, à la femme du siècle et à la vierge du cloître, aux prêtres et aux guerriers, aux heureux du monde et à ceux qui souffrent, aux grands et aux petits ; type le plus complet et le plus large au point de vue de la religion et de la patrie, figure historique qui n’a sa semblable nulle part.
Jeanne d’Arc, c’est une douce et chaste apparition du ciel au milieu des agitations tumultueuses de la terre, une île riante de verdure dans l’aride désert de l’histoire humaine, un parfum de l’Éden dans notre triste exil ; et, pour parler le langage de saint Augustin, c’est Dieu venant à nous, cette fois encore, par un sentier virginal.
29VI
Les prédestinations de la miséricorde divine sur la France
La virginale héroïne était donc la prédestinée des miséricordes divines sur la France. Sa venue, attendue, désirée, ardemment souhaitée par tous les cœurs vraiment français, leur avait été prédite et prophétisée. On a trop oublié ces prédictions, auxquelles Jeanne elle-même n’hésitera pas à faire allusion, quand il s’agira d’affirmer sa mission surnaturelle. Elles ont été recueillies avec soin par Jean Bréhal, le grand inquisiteur, chargé par commission apostolique de présenter l’ensemble des sentiments des docteurs appelés à se prononcer dans le procès de réhabilitation. L’œuvre du savant dominicain constitue une collection, ou, pour emprunter son expression même, une Récapitulation de ces sentiments et des raisons qui les motivaient.
C’est, dit-il, pour donner toute évidence à ces merveilles, que Dieu a voulu les faire annoncer de longues années avant leur accomplissement.
Jeanne prophétisée
Bréhal cite d’abord la prédiction du vénérable Bède, annonçant, d’une façon précise, l’année même où Jeanne, à la suite de ses révélations, se met héroïquement à l’œuvre.
Puis, celle de Jean de Montalcin, écrivant de Sienne au roi de France :
Votre victoire sera dans le conseil d’une vierge.
Puis encore les strophes étranges de l’Anglais Merlin.
Du bois chenu sortira la pucelle, qui apportera le remède aux blessures.
Dès qu’elle aura abordé les forteresses, de son souffle elle desséchera les sources du mal.
Des ruisseaux de larmes couleront de ses yeux ; elle remplira l’île (l’Angleterre) d’une horrible clameur.
Elle sera tuée par le cerf à dix ramures (le jeune roi Henri âgé de dix ans) dont quatre porteront des diadèmes d’or 30(les quatre premières années d’Henri furent marquées par l’exercice d’une autorité juste) et les six autres seront changées en cornes de buffles (symbole d’une tyrannie barbare et sans frein) ; elles rempliront les îles de la Bretagne d’un horrible fracas ; le bois Danois (la Normandie, parce que les Normands étaient sortis du Danemark) sera sur pied. D’une voix d’homme, il criera :
Viens, Cambrie (couronne de France, ainsi nommée parce que les Francs sortirent de l’antique cité de Sicambrie, en Pannonie), et joins Cornouailles (l’Angleterre) à ton flanc.
Bréhal cite encore une autre prophétie, non moins célèbre et répandue dans le peuple, qui la commentait volontiers sous le chaume, à la veillée, quand les nouvelles de France devenaient de plus en plus mauvaises. On y lisait :
Ô lys insigne, arrosé par les princes, le semeur te plaça dans un délectable verger, au milieu de vastes campagnes. Sans cesse fleurs et roses d’un merveilleux parfum te forment ceinture.
Le lys est dans la stupeur, le verger dans l’effroi.
Des animaux divers, les uns étrangers, les autres nourris dans le verger, s’unissant cornes à cornes, ont presque suffoqué le lys. Il s’étiole par sa propre rosée, on le resserre ; on lui arrache une à une ses racines ; ils croient l’anéantir de leurs souffles d’aspic.
Mais, voici la vierge, originaire du lieu d’où se répandit le brutal venin ( ?)
Elle est distinguée par un petit signe rouge, qui émerge derrière son oreille droite.
Son parler est lent.
Son cou est court.
Par elle, ils seront ignominieusement bannis du verger ;
Elle donnera au lys des courants rafraîchissants ;
Elle chassera le serpent ;
Elle montrera où est le venin ;
31Par elle, le gardien du lys, Charles, appelé fils de Charles, sera couronné à Reims d’un laurier fait d’une main non mortelle.
Autour se soumettront des voisins turbulents ; les sources trembleront ; le peuple criera : Vive le lys, loin la brute (le léopard), fleurisse le verger…
Sans prétendre donner à ces diverses prédictions plus d’autorité, ni même plus d’authenticité qu’il ne convient, le texte, recueilli par le grand inquisiteur, a du moins son importance, au point de vue de l’attente universelle au pays de France, confiant, dans sa détresse, en la libération qui lui viendrait du Christ qui aime les Francs.
VII
L’approche de l’heure
Cependant, le terme fixé par Dieu approchait. L’humble et forte vierge de Domremy était devenue, sous la direction des anges et des saintes, la grande âme religieuse et parfaite qui animait son corps sain et vigoureux. Les voix
devinrent plus pressantes.
Dernières recommandations des voix
— Il faut, disait saint Michel ; il faut, répétaient les saintes Catherine et Marguerite ; il faut que tu ailles trouver le capitaine de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, et qu’il te donne une escorte de gens armés qui te conduisent devers le dauphin ; il te faut faire sacrer le roi à Reims ; chasser l’étranger du royaume.
— Mais, répondait la vierge, je ne suis qu’une paysanne ; comment donnerai-je des ordres aux gens de guerre ?
— Fille de Dieu, fille au grand cœur, insistaient les voix, va, il le faut ; Dieu te sera en aide.
C’est que le péril était devenu imminent. Tout manquait à Charles VII, on lui conseillait de se retirer en Dauphiné, lui-même se surprenait songeant à se réfugier en Espagne ou en Écosse, et à commencer cette vie si dure de roi exilé. 32L’Anglais devenait de plus en plus insolent. Le duc de Bedford voyait ses alliances se resserrer sur le sol français. Salisbury débarquait, résolu à porter la guerre au cœur même des pays demeurés fidèles au roi malheureux.
Partir !
Les voix se firent plus pressantes.
— Pars, disent-elles un jour, va trouver Robert de Baudricourt, au lieu de Vaucouleurs, il te donnera des gens pour t’accompagner en France.
Partir, quitter sa mère, ses jeunes amies, ses paisibles travaux, pour se jeter en pareille compagnie, dans cette vie de hasards, c’était chose qui devait troubler étrangement cette âme simple et recueillie. Elle disait plus tard qu’elle eût mieux aimé être tirée à quatre chevaux, que de venir en France sans la volonté de Dieu. Jusque-là, le caractère de sa mission pouvait se dérober à ses yeux dans les ombres de l’avenir et l’attirer par le mystère. Quand les voix lui disaient qu’il fallait aller au secours de la France, elle se sentait pleine d’ardeur et d’impatience :
Elle ne pouvait durer où elle était.Mais, quand les voiles tombèrent, quand le présent se montra avec toutes les misères, tous les dégoûts de la réalité, et qu’il fallut partir, elle s’effraya. Elle répondit qu’elle n’était qu’une pauvre fille, qui ne saurait ni monter à cheval ni faire la guerre. Mais la voix avait parlé ; elle triompha de ses répugnances. Et Jeanne, pour étouffer le cri de son cœur, n’eut plus qu’une pensée : ce fut de concourir de toute sa force à l’accomplissement de la volonté de Dieu22.
Anxiétés et dispositions des parents de Jeanne
Or, elle ne pouvait compter sur l’appui, ni même sur l’assentiment de son père ou de sa mère23. Elle avait eu beau cacher avec soin son secret, quelque chose en avait transpiré autour d’elle. Sa piété de plus en plus ardente, les élans de son âme, les vivacités d’expressions qui sans doute lui échappaient trahissant son patriotisme indigné à la nouvelle des désastres du beau pays de France, ces 33indices et d’autres semblent avoir inquiété avant l’heure Jacques d’Arc, le rude et franc laboureur.
Je la noierais moi-même !
Deux ans avant la première vision de Jeanne, ce brave campagnard rêva, la nuit, qu’elle l’abandonnait, qu’elle partait en compagnie de gens de guerre. Le lendemain, encore tout ému de ce songe, il disait à ses fils :
— Si je croyais qu’une telle chose arrivât, j’aimerais mieux vous voir noyer ma fille, et, au cas où vous y manqueriez, je la noierais moi-même.
Quant à Isabelle Romée, la bonne et pieuse ménagère, elle vivait, elle aussi, dans l’angoisse. Pendant qu’elle la portait dans son sein, elle rêva qu’elle accouchait de la foudre.
On l’assigne devant l’officialité
On s’avisa d’un stratagème.
De concert avec les parents de Jeanne, un jeune homme des environs, très épris de ses grandes et belles qualités, la demande en mariage, et, comme la vierge, déjà consacrée à Dieu par un vœu spécial, repoussait avec horreur cette proposition, le prétendant l’assigne devant l’officialité de Toul, affirmant qu’elle lui avait promis fiançailles. Mais ses voix la soutinrent dans cette épreuve, la première qui l’habituait à comparaître devant les tribunaux, pour défendre son honneur et sa vertu. Elle se rendit à Toul, comparut devant ses juges, plaida elle-même sa cause, confondit l’imposture de son adversaire et gagna sans peine son procès.
Découragés, les parents la soumirent à une plus étroite surveillance. Mais, leurs précautions seront vaines et leur fille, dirigée par les célestes conseillères, allait déjouer leurs desseins.
VIII
À Burey-le-Petit
À Burey-le-Petit, un petit village à deux lieues de Domremy, vivait un honnête laboureur, que Dieu avait choisi pour être le Mardochée de la nouvelle Esther. Durand Lascart, 34oncle par sa femme de Jeanne d’Arc, sera l’instrument de la vocation de son héroïque nièce24.
Le Mardochée de la nouvelle Esther
Jeanne, sans doute sur le conseil de ses voix, demanda et obtint l’autorisation d’aller passer huit jours à Burey. Les huit jours passés, elle entretint le bon villageois de son dessein.
— Je veux, dit-elle, aller en France, voir le dauphin pour le faire couronner.
Ébahi de la confidence, Lascart fit, naturellement, toutes les objections qu’on devine.
— N’est-il pas dit, répliqua modestement sa jeune nièce, qu’une femme (Isabeau de Bavière) perdrait la France et qu’une jeune fille des marches de la Lorraine la relèverait ?
L’oncle reconnut que la prophétie était bien telle. Puis, touché de l’accent divin qui se faisait sentir dans les paroles de sa nièce, cet homme, au cœur simple et droit, se rendit à l’appel du ciel.
On était en plein mois de mai 1428, aux environs de l’Ascension.
Sur la route vers Vaucouleurs
La nièce et l’oncle cheminaient sur la route qui mène de Burey-le-Petit à Vaucouleurs, et que nous avons déjà décrite. L’oncle semblait soucieux. Quelle que fût sa confiance en l’inspiration de Jeanne, il se demandait quel accueil lui réservait le sire de Baudricourt, si tant est que le capitaine consentît à les recevoir. Mais, Jeanne marchait sereine et assurée, dans ses habits de paysanne. Ses voix lui disaient, comme autrefois le Maître aux disciples :
— Ne vous inquiétez point de savoir comment vous leur répondrez. Mon Esprit vous suggérera lui-même ce qu’il faut répondre.
Jeanne est prise pour folle
35Ses voix la guidèrent vers Baudricourt et le lui firent reconnaître, au milieu de ses soldats, quoiqu’elle ne l’eût jamais vu.
— Je viens, dit-elle avec fermeté, de la part de mon Seigneur, afin que vous mandiez au dauphin25 de se bien tenir et de ne point assigner bataille à ses ennemis, parce que le Seigneur lui donnera secours, avant le milieu du Carême prochain.
Baudricourt la regardait, stupéfait, se demandant si cette fille inconnue jouissait de tout son bon sens. Elle ajouta :
— Mon Seigneur veut que le dauphin devienne roi et qu’il ait ce royaume en commende26. En dépit de ses ennemis, il sera roi, et c’est moi qui le conduirai au sacre.
Pour le coup, Baudricourt l’estima folle. Il lui demanda, en riant :
— Et quel est ton Seigneur ?
— 36Le Roi du ciel, répondit Jeanne.
Sire Robert de Baudricourt haussa les épaules.
— Bon homme, dit-il à l’oncle de la Pucelle, elle mériterait que je la livre à mes gens, mais je veux bien la ménager, car elle est folle. Vous ferez bien de la ramener à son père, après l’avoir bien souffletée.
Les voix lui avaient prédit cet affront. L’humble enfant ne s’en émut point, c’était le prélude de bien d’autres résistances qui l’attendaient sur la route de son héroïque mission. Elle ne se laissa donc point abattre, elle venait d’entrer dans la période active de sa carrière.
Le doigt de Dieu lui indiquait le chemin que son héroïsme devait suivre, route glorieuse où bien des triomphes l’attendaient, bien des angoisses, et au bout de laquelle la Providence distinguait, dans sa prescience éternelle, le bûcher, encore enfoncé dans la brume de l’avenir, où la sainteté de l’héroïsme devait recevoir, avec la palme des martyrs, la couronne des bienheureux27.
IX
Son retour à Domremy
Jeanne revint à Domremy, sans s’émouvoir du premier échec humiliant que ses voix lui avaient annoncé. Elle reprit sa vie douce, humble et docile, mais rien n’était changé au fond de son cœur. À quelques mots qui lui échappaient de temps à autre et que les témoins du procès ont relatés, un observateur attentif pouvait reconnaître la fermeté de ses résolutions. Le père et la mère de Jeanne ne s’y trompèrent point. Elle attendait l’heure de Dieu.
Son secret lui échappe
La veille de la Saint-Jean d’hiver, elle dit à un jeune garçon du village, Michel Lebuin de Domremy :
— Il y a entre Coussey et Vaucouleurs c’est-à-dire à Domremy même, qui est entre les deux une jeune fille 37qui, avant qu’il soit un an, fera sacrer le roi de France, à Reims.
On était au 26 décembre 1428, quand elle fit cette confidence à l’un de ses amis d’enfance. Le jeune villageois en fut frappé et il en témoignait avec émotion devant les juges de Jeanne.
Une autre fois, c’est à Gérardin d’Épinal, lequel n’était pas Armagnac, qu’elle dit, à demi-mot :
— Compère28, si vous n’étiez Bourguignon, je vous dirais quelque chose.
Mais Gérardin ne comprit point. Il crut qu’il s’agissait d’un projet de mariage, que la jeune Lorraine aurait voulu lui confier.
D’ailleurs, on n’ignorait pas à Domremy son voyage à Vaucouleurs et l’opinion devenait de plus en plus attentive parmi ces bons villageois, tous, sauf un, bons Armagnacs c’est-à-dire bons patriotes.
Le roi lieutenant du Christ
À quelques jours de là, peu après le commencement de l’année 1429, la grande et glorieuse année où le Christ qui aime les Francs allait déployer en leur faveur ses puissantes miséricordes, les voix se firent plus pressantes.
Partir ! et cette fois pour toujours, le ciel le voulait, Jeanne obéit.
— Quand j’aurais eu cent pères et cent mères, répondra-t-elle à ses juges qui lui reprocheront cette docilité aux ordres d’en haut, et, quand j’aurais été fille de roi, je serais partie.
Ce n’est pas que son cœur ne saignât, à la pensée du chagrin mortel où elle allait laisser son père et sa mère.
L’angoisse s’assoirait au foyer de la famille, là même où sa place, demeurée vide, rappellera, le soir, aux siens désolés, les charmantes qualités et les douces vertus de l’absente.
38Mais, encore une fois, Dieu avait parlé et la France attendait.
Pour ménager la douleur des siens et leur épargner les tristesses de la séparation, elle eut de nouveau recours à son oncle de Burey. Durand Lascart accourut à l’appel de cette nièce, qu’il vénérait à l’égal d’une sainte. Jeanne n’eut point de peine à le persuader qu’il demandât à son père de l’autoriser à repartir avec lui, sous le prétexte d’aller servir à Burey la femme de Lascart, pour lors en couches.
Les adieux
Elle partit donc, sans prendre autrement congé de son vénérable père, de cette mère bien-aimée qui lui survivra pour faire réhabiliter la mémoire de la chaste héroïne. Plus tard, elle rappelait le serrement de cœur qui la prit, quand elle franchit le seuil de cette chaumière natale, qu’elle ne devait plus revoir.
Au sortir de la maison paternelle, elle passa devant celle où habitait Mengette, l’amie préférée de son cœur. Elle y entra, lui dit adieu et s’éloigna en hâte, la recommandant au ciel. Elle dit aussi adieu au père de Gérard Guillemette, un des amis de son père. Mais le courage lui manqua d’embrasser une dernière fois son autre compagne de choix, Hauviette. Elle n’aurait pu lui cacher son secret, et Hauviette, dans sa déposition, témoigne naïvement comme elle a pleuré, parce que Jeanne était partie sans la voir, et elle ajoute, en son simple langage :
— C’est que Jeanne était bonne !
Départ
Enfin, la voici aux dernières maisons du village. Une fois encore, elle se retourne vers l’église de son baptême et, le cœur angoissé mais ferme, elle continua sa route.
Plus tard, Jeanne écrivit à ses parents, pour leur demander un pardon qu’elle obtint.
C’est la beauté, — dit M. Marius Sepet, — c’est le mérite sans égal des vertus domestiques, d’inspirer aux nobles âmes des sentiments si hauts, qu’au jour marqué, ceux qui les ont pratiquées les sacrifient, avec douleur, mais avec courage, à des vertus d’un ordre plus élevé : le patriotisme et l’obéissance à Dieu.
39Chapitre troisième Épreuve
I
Trois semaines à Vaucouleurs
La jeune villageoise de Domremy se présenta de nouveau devant Robert de Baudricourt, vêtue en paysanne avec une robe grossière de couleur rouge. En l’apercevant, le sceptique capitaine de Vaucouleurs, moins sensible que son entourage à l’insistance de la comparante, la tourna encore en dérision et sans doute s’étonna que les soufflets
de l’oncle n’eussent pas été plus efficacement appliquées sur les joues de l’obstinée. Il la congédia donc en qualifiant 40son entêtement de folie manifeste. Mais, cette fois, la sublime entêtée ne broncha pas d’une ligne. Ses voix lui disaient que l’heure était sonnée. Elle demeura à Vaucouleurs.
Elle avait pris gîte chez un habitant, charron de son état, nommé Henri Le Royer, dont la femme, Catherine, conçut pour elle une vive amitié, ou plutôt, pour traduire exactement le sens des témoignages contemporains, une véritable vénération, car la Pucelle était sage, laborieuse, pieuse comme un ange.
Pendant les trois semaines de son séjour chez le charron, toujours simple, bonne fille, Jeanne aidait son hôtesse aux travaux du ménage. Elles filaient et cousaient ensemble. Puis, quand elle en avait loisir, la fervente dirigée des saintes courait à l’église, pour s’entretenir avec son Seigneur dans la prière.
L’enfant de chœur, qu’ils appelèrent pour en témoigner, racontait plus tard, devant les juges, comment il avait remarqué cette étrangère à la paroisse, qui venait, chaque matin, à l’église de Vaucouleurs, entendant plusieurs messes et prolongeant sa prière. Il dit encore, ajoute le procès-verbal de son interrogatoire, qu’il la vit souvent, dans la crypte souterraine de ladite église, s’agenouiller devant la statue de la Bienheureuse Vierge Marie et y demeurer longtemps en prière.
Le but de sa venue à Vaucouleurs n’était plus un secret. On savait qu’elle entendait des voix et qu’elle se disait la Pucelle envoyée de Dieu pour sauver le royaume de sa grande pitié.
Elle le disait d’ailleurs à tout venant, et le charron témoigna l’avoir entendue dire ouvertement :
— Il faut que j’aille trouver le dauphin. Mon Seigneur, le roi du ciel, le veut. Je viens de sa part. Dussé-je y aller sur mes genoux, j’irai.
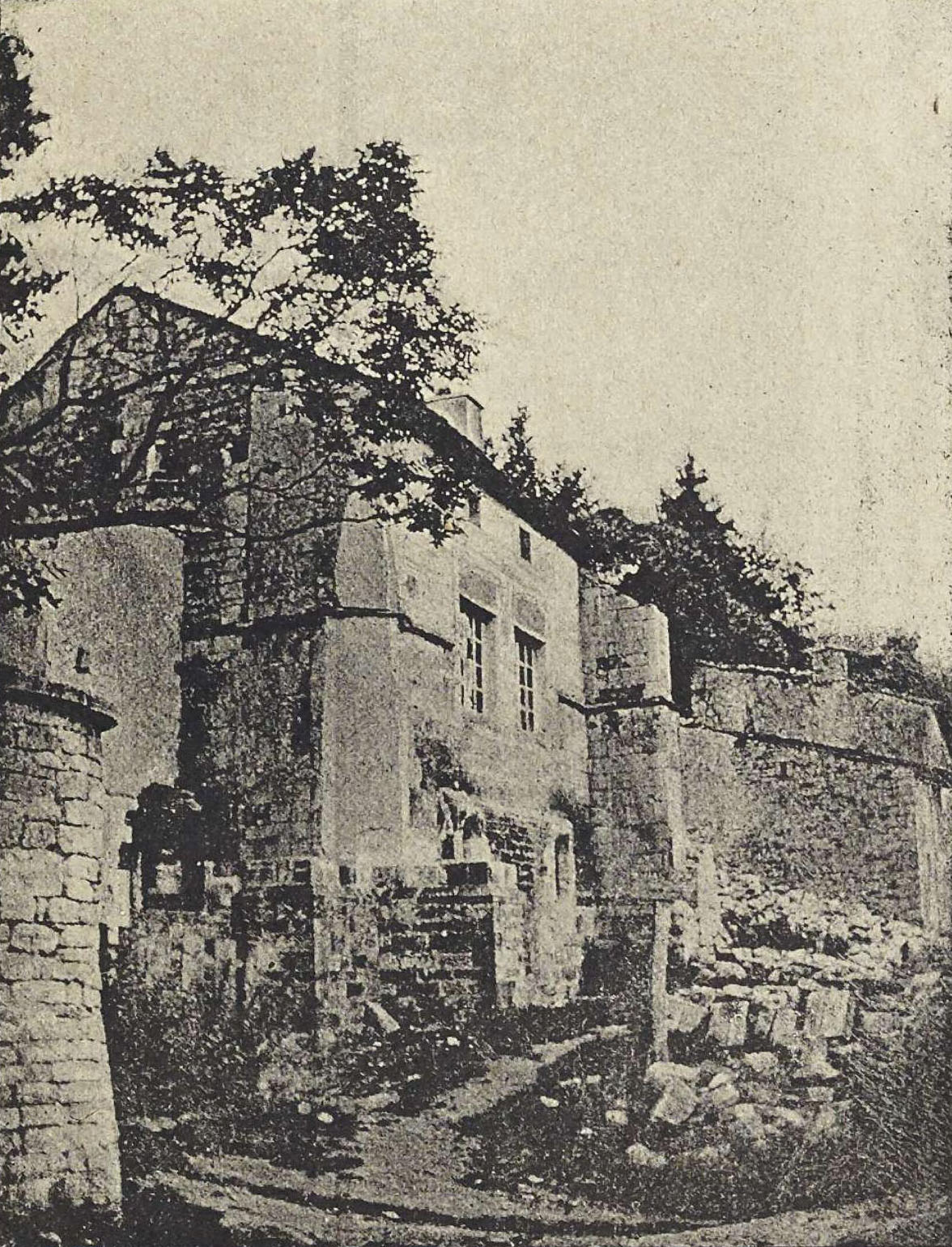

Ma mie, que faites-vous céans ?
Les hommes d’armes, de l’entourage du capitaine, venaient l’entendre. L’un d’eux, Jean de Metz, qui se souvenait 41de l’avoir vue à son précédent voyage, vint la trouver, et, n’y tenant plus, gagné par l’ascendant mystérieux de la pieuse voyante, il lui dit :
— Ma mie, que faites-vous céans ? Faut-il donc que le roi soit chassé du royaume et que nous devenions Anglais ?
— Je suis venue ici, répondit-elle, à chambre de roi29, parler à Robert de Baudricourt, pour qu’il me veuille mener ou faire mener au dauphin. Mais il ne prend souci ni de moi ni de mes paroles. Et pourtant, avant le milieu de Carême, il faut que je sois devers le dauphin, quand je devrais user mes jambes jusqu’aux genoux ; car nul au monde, ni rois, ni ducs, ni fille du roi d’Écosse30, ni aucun autre ne peut recouvrer le royaume de France ; et il n’y a point de secours que de moi : et certes, j’aimerais bien mieux filer auprès de ma pauvre mère, car ce n’est point mon état ; mais il faut que j’aille et que je le fasse, parce que mon Seigneur veut que je le fasse.
— Et qui est votre Seigneur ? redemanda Jean.
— C’est Dieu !
Plutôt aujourd’hui que demain
Le ton pénétré de Jeanne, en affirmant de nouveau sa mission surnaturelle, saisit le loyal soldat. Tout à coup, il s’approcha de la vaillante inspirée, mit ses deux mains dans les siennes et jura, sur sa foi de chrétien, que, Dieu aidant, il la mènerait au roi :
— Quand voulez-vous partir ? demanda-t-il.
— Plutôt maintenant que demain, répondit la Pucelle, plutôt demain qu’après.
Gagné comme lui par l’ascendant mystérieux de l’héroïne, un autre compagnon de Jean de Metz, Bertrand de Poulengy, s’engagea aussi à la conduire.
L’exorcisme
Robert de Baudricourt en fut aussitôt instruit et ébranlé. Mais, il hésitait encore.
42Que savait-on, si la Pucelle parlait véritablement au nom de Dieu ? L’esprit qui la poussait était-il le bon, ou bien n’obéissait-elle pas au malin ?
Pour s’en éclaircir, en bon chrétien qu’il était, il recourut aux prières de l’Église. Sur son invitation, le curé de Vaucouleurs l’accompagna chez le charron, revêtu de son étole et se mit en devoir d’exorciser la voyante.
— S’il y a maléfice, dit l’exorciste, retire-toi de nous. Sinon, approche.
Jeanne s’approcha et se mit à genoux.
Toujours humble et docile enfant de l’Église, elle gardait sa candeur et sa noble liberté de langage.
— Messire, fit-elle, vous n’avez pas bien fait, puisque vous m’avez entendue en confession : vous devez donc savoir si c’est l’esprit malin qui parle par ma bouche.
Le curé la voyait souvent à l’église, il l’avait confessée trois fois31, depuis son retour à Vaucouleurs. Pourquoi donc recourir aux exorcismes, envers une jeune fille dont il avait pu apprécier la sincérité et la droiture ?
Malgré tout, Baudricourt hésitait encore.
— Ne connaissez-vous donc pas la prophétie ? lui dit Jeanne.
Et elle rappela la prédiction populaire dans le pays, qu’une femme perdrait la France et qu’une jeune fille la sauverait.
La femme du charron, présente à la scène, témoigna du saisissement qu’elle éprouva, en entendant Jeanne s’appliquer aussi résolument à elle-même la prophétie qu’elle connaissait bien.
43Le capitaine, plus difficile à convaincre que ses gens d’armes, ne se rendit point. Jeanne s’en impatientait. Le temps, dit la femme de Henri Le Royer, le temps lui durait, comme à une femme qui va être mère.
II
L’équipement militaire
Cependant, Jean de Metz songeait à tenir sa parole jurée.
Lorsque Jeanne lui avait témoigné son impatience de partir plutôt aujourd’hui que demain
, il s’était écrié :
— Mais, voulez-vous donc partir avec les vêtements que vous avez là ? Cela ne me semble pas possible.
— Je sais, répliqua la Pucelle à qui ses voix donnèrent à cet égard les instructions qui lui furent plus tard si perfidement reprochées à Rouen, je sais qu’il me faut prendre des habits d’homme ; eh bien ! je le ferai volontiers.
Le loyal soldat lui fit remettre l’équipement d’un de ses serviteurs.
Mais, le menu peuple, de plus en plus gagné à la vocation de la Pucelle, voulut y concourir. Les pauvres se cotisèrent pour offrir à la vaillante envoyée de Dieu son complet équipement militaire : justaucorps, chausses longues rattachées au justaucorps par des aiguillettes, tunique tombant jusqu’aux genoux, guêtres hautes, avec les éperons, le haubert, le chaperon, la lance et le reste du costume des gens de guerre à cette époque.
L’oncle acheta le cheval, avec le concours d’un habitant de Vaucouleurs. Tout le peuple voulait être représenté dans les frais d’équipement et de route. Jeanne était du peuple, et par elle tout le peuple s’en allait au secours de son roi malheureux.
Mais elle ne voulait pas partir, comme une aventurière, au hasard et sans honneur. Son oncle et un certain Jacques 44Alain de Vaucouleurs, lui ayant fait prendre un jour le chemin de France, la conduisirent à Saint-Nicolas-de Séfonds, pèlerinage célèbre, où elle pria longtemps. De Saint-Nicolas, elle demanda à être ramenée à Vaucouleurs parce que, dit-elle, il ne serait point honnête de s’en aller de la sorte
.
Chez le duc de Lorraine
Cependant, la renommée avait porté jusqu’au duc de Lorraine, alors malade dans sa capitale, les merveilleux récits qui commençaient à se répandre dans la vallée de la Meuse et dans les marches de Lorraine, sur la Pucelle de Domremy. Ce prince désira la voir et lui envoya un sauf-conduit. Jeanne consentit à se rendre à son invitation, espérant que peut-être il lui viendrait en aide. Elle lui demanda de lui donner son gendre, René d’Anjou, et quelques hommes d’armes pour la conduire au dauphin.
Mais le duc lui parla surtout de sa maladie, et, confondant cette jeune fille avec la troupe vulgaire des charlatans et des guérisseur, il la pria de lui dire s’il recouvrerait la santé. Jeanne répondit qu’elle n’en savait rien, mais qu’il lui accordât sa demande, et qu’elle prierait pour sa guérison. Elle lui donna aussi, dit-on, le conseil de reprendre sa bonne femme, qu’il avait lâchement renvoyée. Le prince ne prit point cet avis en mauvaise part ; il la congédia32 [avec honneur, et lui donna, diton, encore un cheval et quelque argent pour sa route.]
En quittant Nancy, la pieuse héroïne n’oublia point d’aller faire ses dévotions à Saint-Nicolas-du-Port, le célèbre pèlerinage lorrain, situé à trois lieues environ de la ville.
Elle rentra bien vite ensuite à Vaucouleurs, car le moment était venu.
Départ de Vaucouleurs
On était aux premiers jours du Carême 1429. Baudricourt résistait encore. Jeanne vint le trouver, le samedi après les Cendres, et lui tint ce langage inspiré :
— 45En nom Dieu33, vous mettez34 trop à m’envoyer, car aujourd’hui le gentil35 dauphin a eu assez près d’Orléans un bien grand dommage ; et sera t-il taillé36 encore de l’avoir plus grand, si ne m’envoyez bientôt vers lui.
C’était le 12 février, jour où Charles VII perdit, à Rouvray-Saint-Denis, la bataille connue dans l’histoire sous le nom de Journée des Harengs. Jeanne avait eu révélation, par ses voix, de cette défaite, au moment même où elle se produisait.
Pour le coup, le sire de Baudricourt se rendit, et Jeanne obtint de lui licence de partir.
Dès le lendemain, qui était le premier dimanche de Carême, 13 février 1429, elle put se disposer à partir, avec sa petite mais fidèle escorte. C’étaient Jean de Metz et Bertrand de Poulengy avec leurs servants Jean de Honcourt et Julien, et deux autres, Colet de Vienne, le messager royal, et Richard l’archer.
D’aucuns s’effrayaient de la voir partir, en si faible compagnie, pour traverser un pays ennemi, infesté par des gens de guerre pillards et bandits. De Vaucouleurs à Chinon, où était Charles VII, le trajet est long. Il fallait traverser plusieurs cours d’eaux37, et les Anglais ou les Bourguignons gardaient les ponts et les passages. Les villes aussi jusqu’à la Loire leur appartenaient, on ne pouvait pas s’y hasarder.
Le bon charron de Vaucouleurs le représentait à sa jeune hôtesse. Mais, elle, qui mettait sa confiance dans le Seigneur, lui répondit, tranquille et sereine :
— Je ne crains pas les hommes d’armes, mon chemin est préparé. S’il y a des ennemis sur le chemin, moi j’ai 46Dieu, mon Seigneur, qui saura m’ouvrir une voie pour aller jusqu’au dauphin ; car je suis née pour le sauver.
Ce n’était point une armée que ses voix l’avaient amenée à demander à Vaucouleurs, mais uniquement la première reconnaissance officielle de sa mission. Une petite escorte lui suffisait. Elle partit.
Au départ, le capitaine de Baudricourt vint saluer la petite troupe. Il recommanda aux compagnons de Jeanne de faire bonne et sûre conduite. Il alla même jusqu’à donner une épée à la vaillante enfant, mais, hésitant jusqu’au bout, il laissa percer ses angoisses, quand il lui dit, en adieu :
— Va donc, va, et advienne que pourra !

III
Les anxiétés de Jean de Metz
Jean de Metz, lui, tout confiant qu’il fût en la mission de Jeanne, estimait nécessaire de se précautionner. Au grand désespoir de la pieuse voyante, qui se scandalisait de cette prudence trop humaine, il prit les chemins les moins fréquentés, marchant le plus ordinairement de nuit, évitant les villes et les gros bourgs.
Le premier soir, on fit halte à l’abbaye de Saint-Urbain. Jeanne en eut une grande joie, parce qu’elle entendrait ainsi la messe, le lendemain, avant de se remettre en marche. Elle n’eut ce bonheur que deux fois, à Saint-Urbain et à Auxerre, pendant les onze jours que dura le voyage. Elle s’en plaignait à Jean de Metz, qui le rapporte au procès :
— Si nous pouvions entendre la messe tous les jours, lui disait-elle, nous ferions bien.
Mais Jean redoutait les embuscades et les surprises de l’Anglais.
— N’ayez peur, répondait la Pucelle, j’ai une mission à 47remplir, car mes frères du paradis et mon Seigneur Dieu m’ont dit qu’il fallait que j’aille guerroyer pour recouvrer le royaume de France.
En racontant ces détails devant les juges, le loyal chef de l’escorte ajoutait :
— Je croyais de tout mon cœur aux paroles de la Pucelle. Ses affirmations et son amour pour Dieu m’enflammaient. Je crois qu’elle était envoyée de Dieu.
Puis, il lui rendait courageusement témoignage :
— Pendant tout le voyage, je l’ai trouvée bonne, simple, dévote, bonne chrétienne, bien ordonnée dans sa conduite et craignant Dieu.
Et tous les autres compagnons de la route confirmèrent la déposition du chef.
Durant le trajet
Aux yeux de tous ces hommes d’armes, habitués à la licence des camps, Jeanne apparaissait déjà, nimbée d’une auréole de sainteté qui leur inspirait le respect. Ce n’était pas une guerrière, une amazone plus ou moins inspirée, qu’ils suivaient à l’aventure du combat, c’était la sainte chargée d’en haut de les mener à la victoire. Les naïves et franches dépositions de ces gens, peu habitués à cette réserve, révèlent déjà la virginale pudeur de la grande héroïne. Il a fallu l’imagination souillée d’un cynique vieillard pour essayer de ternir la chaste libératrice de la patrie.
Les soldats de Vaucouleurs ont d’avance confondu l’infâme imposture de Voltaire, en racontant, devant les bourreaux de la Vierge de Domremy, les précautions dont s’entourait dès lors sa vertu au milieu de tous ces hommes, qui redevenaient presque vertueux au contact de sa sainteté.
Enfin, après bien des alertes, Jean de Metz respira. On était en vue de Gien et on allait pouvoir passer la Loire.
Or, la Loire passée, le danger semblait fini, au moins pour l’escorte et sa mission, car, le péril restait le même, de la part des Anglais qui pouvaient toujours surprendre la faible armée du roi de France, réduit à l’extrémité.
À Sainte-Catherine de Fierbois
48Mais Jeanne lui apportait le secours. Elle voulut le mettre sous la protection de l’une de ses deux saintes. On était à Fierbois, en Touraine, et il y avait là une église, dédiée à la patronne du lieu, sainte Catherine. La pieuse enfant y courut, elle y entendit trois messes. Puis, elle fit savoir au dauphin son arrivée, sollicitant une audience le plus tôt possible.
Il n’y avait plus lieu d’ailleurs de cacher le but du voyage, tenu soigneusement secret durant le trajet de Vaucouleurs à Gien ; les soldats de l’escorte en parlaient ouvertement, et le bruit s’en répandit jusqu’à Orléans.
Voici, disait-on, qu’une bergerette nommée la Pucelle, conduite par quelques gentilshommes de Lorraine, est arrivée à Gien, disant qu’elle vient faire lever le siège d’Orléans et conduire le roi à Reims pour l’y faire sacrer.
Une embuscade
Dans l’entourage de Charles VII, on s’émut de ces bruits. Obéissant à je ne sais quels sentiments de jalousie, comme Jeanne en rencontra si souvent sur sa route, ou peut-être voulant se ménager ce titre à la faveur de l’Anglais qui sera certainement victorieux demain, quelques soudards s’échappèrent de Chinon, où était le roi, et, sachant les chemins par où devait venir la Pucelle, ils vinrent lui tendre une embuscade pour l’enlever et piller son escorte.
Ainsi, ce que n’avaient pu tenter Anglais ni Bourguignons, les gens mêmes de l’entourage royal l’essayèrent. Dieu et les saintes veillaient sur la Pucelle. Les conjurés se sentirent tout d’un coup cloués au sol et il leur fut impossible de bouger38.
IV
Jeanne écrit à Charles VII, pour lors aux abois
49Cependant, Charles VII avait reçu la lettre de Jeanne.
Elle mandait au roi de France qu’elle venait de faire cent cinquante lieues pour lui venir en aide, qu’elle savait plusieurs bonnes choses qui le concernaient et lui déclarait, en signe de sa mission surnaturelle, que, bien qu’elle ne l’eût jamais vu, elle saurait le reconnaître entre tous les autres.
Or, Charles VII était aux abois. Le trésor royal était vide. En réunissant toutes leurs ressources, les courtisans n’arrivaient pas à trouver quatre écus en tout.
C’est le temps, — dit M. du Fresne de Beaucourt, — où Charles VII vend ses joyaux et tout ce qu’il possède, où il fait remettre des manches à ses vieux pourpoints, et où un cordonnier lui retire du pied une bottine qu’il venait de lui chausser, le roi ne pouvant lui payer comptant la paire, et l’ouvrier ne voulant pas la lui laisser à crédit, en sorte que le prince dut rechausser ses vieilles bottines.
À bout d’expédients, il songeait à fuir, car, Orléans pris, la Touraine même n’était plus sûre pour lui. Irait-il en Dauphiné ? Se réfugierait-il en Castille ? On juge de l’émotion que durent apporter les bruits de la venue de Jeanne à Gien et sa lettre au roi désespéré. On en était à l’un de ces moments où l’on se raccroche à toute planche, dans le naufrage universel et l’effondrement de tout autour de soi.
Il se décide à donner audience à la Pucelle
Et pourtant, il y avait, auprès du prince malheureux, un courtisan, La Trémouille, qui avait su s’imposer à sa confiance, au point, dit un contemporain, que personne n’osait même le contredire. Jouet entre d’indignes mains, Charles VII hésita ; La Trémouille craignait l’arrivée de la jeune inconnue, qui pourrait changer la face des choses et diminuer son crédit, en arrachant le 50prince insouciant à sa torpeur. La reine de Sicile, mère de la femme de Charles VII, osa lutter contre le favori.
— Pouvez-vous, dit-elle à son trop faible gendre, pouvez-vous refuser de voir au moins la Pucelle, qui promet de si grandes choses, au nom de Dieu ?
Les fidèles serviteurs de la royauté disaient comme elle, et Charles VII donna ordre, malgré la résistance de l’homme en faveur, de laisser venir Jeanne d’Arc à Chinon.
C’était quelque chose, mais ce n’était point tout.
Les conseillers royaux, gagnés au favori, objectèrent qu’il ne convenait pas à la majesté du prince de se commettre directement avec une petite paysanne, folle peut-être, une aventurière sans mission. Toujours cette maudite étiquette, qui a si souvent perdu les grands et les a privés d’entendre leur peuple, dont les courtisans ont intérêt à les tenir éloignés.
Ils allèrent trouver Jeanne à son arrivée à Chinon, et lui demandèrent de leur dire à eux-mêmes ce qu’elle venait dire au roi. Sauf des secrets réservés au prince, Jeanne leur découvrit, avec une noble candeur, le but de sa venue. Ils crurent en elle, et, par une inconséquence qu’explique seule leur fanatique attachement à la cause de La Trémouille, ils en conclurent qu’il fallait d’autant plus l’empêcher de voir le roi.
Les clercs, sur ce que Jeanne se disait envoyée de Dieu, lui furent aussi députés. Ils furent bientôt convaincus que rien, dans les récits de la jeune inspirée, ne mettait obstacle à ce qu’elle fût admise à l’audience royale, et Jeanne vint au château.
Jusqu’au bout, sa mission devait être contrariée. À la porte de la résidence de Charles VII, on l’arrêta et on voulut l’empêcher d’entrer. Un véritable ami de la monarchie en péril, un vrai Français, prit sur lui de secouer la torpeur du trop faible dauphin.
— Eh ! quoi, cette jeune fille est porteuse d’une lettre 51de crédit de Robert de Baudricourt, un loyal serviteur du roi. Elle a traversé tant de pays où l’ennemi est maître, échappant par miracle à d’innombrables périls. Les Orléanais ont appris sa venue, c’est leur dernier espoir, comme vient de le faire connaître leur message à leur roi. Les députés de la ville assiégée et aux abois sont là qui attendent la réponse…
On manda les deux chefs d’escorte de la Pucelle, devant le Conseil. Ils parlèrent avec chaleur, disant comment leur confiance en leur sainte compatriote s’était accrue durant le voyage, au souffle de son ardent patriotisme et de ses exhortations inspirées. Ils finirent par obtenir cette audience tant disputée.
Après deux jours d’attente à Chinon, Jeanne fut admise à voir le roi.
V
Comment elle le reconnut dans la foule des courtisans
Jeanne, conduite par le comte de Vendôme, se présenta enfin à l’audience.
Mais, comme il fallait que l’ennemi jusqu’au bout lui prodiguât l’outrage, pendant qu’elle arrivait sur le seuil du château, un homme à cheval la toisa ironiquement et dit, sur un ton railleur :
— C’est donc ça, la Pucelle ?
Puis, il jura le saint nom de Dieu et proféra une injure obscène à l’adresse de la virginale enfant, qui le regarda tristement et dit :
— Ah ! tu jures par ton Dieu, et tu es si près de paraître devant lui !
Une heure après, l’homme tombait à l’eau et se noyait.
Arrivée dans l’appartement où se tenait Charles VII, Jeanne
fit les inclinations et révérences accoutumées de faire au roi, ainsi, [dit Jean Chartier], que si elle eût été nourrie en la cour. 52[Mais, continue le même chroniqueur,] le roi, pour la mettre à l’épreuve, s’était confondu parmi d’autres seigneurs plus pompeusement vêtus, et quand Jeanne, qui ne l’avait jamais vu, le vint saluer, disant :
— Dieu vous donne bonne vie, gentil prince !
— Je ne suis pas le roi, dit-il : voilà le roi.
Et il lui désignait un des seigneurs. Mais Jeanne répondit :
— En mon Dieu, gentil prince, vous l’êtes, et non un autre.
La salle, où se passait la scène, au premier étage du château, longue de quatre-vingt-dix pieds et large de cinquante, était éclairée vivement de cinquante torches, L’assistance nombreuse considérait curieusement la jeune paysanne, qui se présentait avec grande timidité, mais sans embarras.
Elle était, [dit l’Anonyme de La Rochelle], en habit d’homme, c’est à savoir qu’elle avait pourpoint noir, chausses attachées, robe courte de gros gris noir, cheveux ronds et noirs, et un chapeau noir sur la tête.
Charles VII, impressionné par ce début, l’interrogea sur son nom et le but de sa visite.
— Gentil dauphin, répondit-elle, j’ai nom Jeanne la Pucelle, et vous mande le roi des cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims, et que vous serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France.
L’entretien
La lumière spirituelle
qui se dégageait de l’inconnue saisissait le roi. Il continua l’entretien à voix basse. Charles posa plusieurs questions, auxquelles Jeanne répondit à sa visible satisfaction, quand, tout à coup, la jeune inspirée élevant la voix, s’écria :
— Je te dis, de la part de Messire, que tu es vrai héritier de France et fils du roi.
C’était une réponse directe et inattendue au doute secret, qui torturait l’âme du prince, au sujet de la légitimité de sa naissance. Le roi rayonna de joie visible. Jeanne n’avait point parlé d’abord sur ce ton, c’est Dieu lui-même qui parlait 53ainsi à son lieutenant par la bouche de la virginale envoyée, et le prince non seulement allait croire en elle, mais il croira maintenant à son titre et à son droit. La sublime inspirée ajouta, toujours à voix haute :
— Je suis envoyée vers toi pour te conduire à Reims, afin que tu y reçoives le sacre et la couronne, si tu le veux.
Entrée du duc d’Alençon dans la salle
À ce moment, un des rares princes que La Trémouille n’avait point écartés de Charles VII39, le jeune duc d’Alençon, entra dans la salle.
Fait prisonnier à Verneuil en 1424, il était demeuré prisonnier des Anglais pendant trois ans, résistant à toutes les séductions pour rester fidèle à la cause de Charles VII et ne pas passer sous les drapeaux de l’usurpateur. Le roi l’aimait. Quand il le vit entrer, il le nomma à Jeanne, qui le salua, en disant :
— Soyez le très bien venu, gentil duc : plus il y en aura ensemble du sang royal de France, mieux en sera-t-il.
Puis, l’entretien à voix basse, que nous avons déjà mentionné, reprit entre la Pucelle et son royal interlocuteur.
On raconte qu’au sortir de l’entretien, Charles VII rayonnait de joie. C’est l’épisode, important dans la vie de la Pucelle, qui fera l’objet de ses plus cruels interrogatoires, et connu sous le nom de Secret du Roi. Il convient de s’y arrêter.
VI
Le secret du roi
— 54Gentil Dauphin, dit Jeanne, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Je vous dis que Dieu a pitié de vous, de votre royaume et de votre peuple : car saint Louis et Charlemagne sont à genoux devant lui, en faisant prière pour vous ; et je vous dirai, s’il vous plaît, telle chose qu’elle vous donnera à connaître que me devez croire40.
Accablé de revers, vaincu et abandonné du grand nombre, Charles VII avait douté, comme nous le disions tantôt, de lui-même et de ses droits. Était-il vraiment le fils du roi, Charles VI ? Avec une femme telle qu’Isabeau de Bavière, on pouvait douter, et, dans ce cas, les malheurs de la maison royale s’expliquaient, comme une malédiction du ciel sur l’imposture. Dieu ne voulait-il pas transférer, de l’héritier illégitime, les droits à la couronne de France, au jeune roi d’Angleterre, petit-neveu de Charles VI. Pris d’angoisse, le dauphin, un jour, — c’était le 1er novembre 1428, — adressait, du fond de son cœur, dans le secret de son âme, au Seigneur, la prière suivante :
Dieu puissant, si je suis le véritable héritier de la couronne, accordez-moi de recouvrer mon royaume ; sinon, 55que j’aie au moins la vie sauve et que je trouve un refuge assuré, soit en Espagne, soit en Écosse.
Or, les voix avaient révélé cette prière à leur envoyée, qui la répéta au prince stupéfait. On s’explique dès lors sa joie et l’expression rayonnante de son visage. Le secret pourtant fut bien gardé. Les Anglais en eurent vent et nous les verrons, à Rouen, torturer la Pucelle pour qu’elle le trahisse. Mais elle put dépister leur curiosité, sans livrer un mystère qu’ils n’auraient pas manqué d’exploiter au profit de l’usurpateur.
Charles VII dut tressaillir, quand la jeune inspirée s’écria, assez haut pour être entendue des assistants41, sur le ton du supérieur qui parle au nom de Dieu :
— Je te dis, de la part de Messire, que tu es vrai héritier de France et fils du roi.
Comment Jeanne reçut le royaume de France en donation et le rendit, au nom du Seigneur Jésus, à son lieutenant
Le lendemain, Jeanne fut admise à la messe du roi. Puis il la prit à part avec Alençon et La Trémouille, et là elle lui fit plusieurs demandes, entre autres celle-ci justement demeurée célèbre42 :
— Gentil Dauphin, demanda Jeanne, faites-moi un présent. Je veux que vous me donniez le royaume de France lui-même.
Le roi étonné le lui donna après quelque hésitation ; et la jeune fille l’accepta. Elle voulut même que l’acte en fût solennellement dressé et lu par les quatre secrétaires du roi. La charte rédigée et récitée à haute voix, le roi resta un peu ébahi, lorsque la jeune fille, le montrant à l’assistance, dit :
— Voilà le plus pauvre chevalier de son royaume.
56Après un peu de temps, continue la chronique, en présence des mêmes notaires, disposant en maîtresse du royaume de France, elle le remit entre les mains de Dieu tout-puissant. Puis, au bout de quelques autres moments, agissant au nom de Dieu, elle investit le roi Charles du royaume de France ; et de tout cela elle voulut qu’un acte solennel fût dressé par écrit.
VII
Les frères mineurs envoyés à Domremy en informations
Cependant, Charles VII s’entourait de tous les moyens d’information que suggéraient la prudence et peut-être la secrète animosité des courtisans jaloux. Dieu le permettait ainsi pour donner au caractère surnaturel de la mission de son envoyée tout son éclat.
Des frères mineurs, envoyés secrètement à Domremy, s’y informaient du passé de Jeanne et recueillaient les plus beaux témoignages de sa vertu. Pendant ce temps, une commission d’ecclésiastiques sages et doctes la soumettait à de longues interrogations, qui la fatiguaient, sans l’intimider un seul instant. Mais, quand elle se retrouvait seule, elle se jetait à genoux et, versant d’abondantes larmes, conjurait son Dieu d’abréger cette épreuve.
On l’avait confiée à la garde de Guillaume Bellier, qui la logea dans une chambre de la tour de Coudrai, où sa femme, témoin de la ferveur de Jeanne, ne tarda pas à se déclarer pour la vertueuse jeune fille.
On envoie Jeanne à Poitiers
Toutefois, avant de se décider à accepter la direction de Jeanne, Charles VII voulut faire examiner à fond la question de savoir si, étant donné le caractère surnaturel de sa mission, celle-ci venait du bon ou du mauvais esprit, de Dieu et de ses anges ou de l’infernal ennemi du Christ et de son Église.
57Le Parlement et l’Université royale siégeaient à Poitiers. Il fut décidé que Jeanne irait à Poitiers, où elle serait examinée de plus près encore par les plus savants docteurs du royaume.
On fit donc savoir à la Pucelle, qu’elle allait partir avec le roi, mais on ne lui dit qu’en route où on la conduisait. Quand elle le sut :
— En nom Dieu, fit-elle, je sais que j’y aurai bien à faire : mais Messire m’aidera, Or, allons de par Dieu.
L’interrogatoire des docteurs
À Poitiers, on la logea chez un avocat général au Parlement, nommé Jean Rabateau. Puis, une Commission fut nommée, composée de l’archevêque de Reims, de l’évêque de Castres, du futur évêque de Senlis, de l’évêque de Maguelone, de l’évêque de Poitiers, du futur évêque de Meaux, de chanoines, de dominicains, entre autres Seguin qui nous a conservé les précieux détails de ces conférences, et d’autres théologiens.
Ils vinrent trouver Jeanne chez l’avocat général et lui montrèrent par belles et douces raisons
qu’on ne pouvait croire à sa mission.
Ils y furent plus de deux heures où chacun d’eux parla sa foi ; et elle leur répondit, dont ils étaient grandement ébahis, comme si une simple bergère, jeune fille, pouvait ainsi répondre.
Les réparties de la Pucelle
L’héroïque enfant raconta simplement ce que nous savons déjà de ses visions et de ses voix. Les docteurs lui opposèrent leurs objections.
— Jeanne, dit le dominicain Guillaume Aymeri, vous demandez gens d’armes, et dites que c’est le bon plaisir de Dieu que les Anglais laissent le royaume de France et s’en aillent en leur pays. Mais, si cela est, il ne faut point de gens d’armes, car le seul plaisir de Dieu peut les déconfire et faire aller en leur pays.
— En nom Dieu, répondit Jeanne, les gens d’armes batailleront, et Dieu donnera victoire.
Cette sublime réponse désarma maître Guillaume, qui avoua que c’était bien répondu.
58Maître Seguin, autre dominicain, un bien aigre homme
, dit la chronique, s’enquit assez curieusement de la langue que parlaient les voix. Pour lui, il parlait limousin. Jeanne repartit, non sans ironie :
— Meilleure que la vôtre !
Le docteur, blessé de la saillie, demanda :
— Croyez-vous en Dieu ?
— Mieux que vous, répondit Jeanne avec l’assurance de sa foi et de sa confiance en Celui qui l’envoyait.
— Eh bien ! reprit maître Seguin, Dieu défend de vous croire, sans un signe qui oblige à le faire. Pour moi, je ne donnerai point conseil au roi de vous donner gens d’armes pour les exposer à péril de mort, sur votre seule parole.
— En mon Dieu, répliqua Jeanne, je ne suis pas venue à Poitiers pour faire signes ; mais menez-moi à Orléans, et je vous montrerai les signes pourquoi je suis envoyée. Qu’on me donne si peu de gens qu’on voudra, j’irai à Orléans.
Selon la juste remarque de M. Wallon, le frère Seguin, si aigre homme que le dise la chronique, a eu du moins la bonhomie de nous garder ces traits sans leur rien ôter de ce qu’ils avaient de piquant pour lui-même, moins soucieux de son amour-propre que de la vérité.
Je ne sais ni A ni B
Pendant trois mortelles semaines, cet examen se prolongea, au prix de fatigues inouïes pour l’envoyée du ciel qui, reconnaissant un jour entre les docteurs l’écuyer du roi Gobert Thibault, eut un mouvement de joie et lui dit, en lui frappant militairement sur l’épaule :
— Je voudrais bien avoir plusieurs hommes d’aussi bonne volonté.
Puis, se tournant vers Pierre de Versailles, elle lui dit résolument :
— Je crois bien que vous êtes venu pour m’interroger : je ne sais ni A ni B ; mais je viens de la part du roi des cieux pour faire lever le siège d’Orléans, et mener le roi à Reims, afin qu’il y soit couronné et sacré.
59S’adressant à Jean Erault, le compagnon, ce jour-là, de Pierre de Versailles, elle ajouta :
— Avez-vous du papier, de l’encre ? Écrivez ce que je vous dirai : Vous, Suffort, Classidas et La Poule, je vous somme, par le roi des cieux, que vous alliez en Angleterre.
Témoignage des femmes de Poitiers chargées de la surveiller
Cependant, les femmes, chargées de surveiller l’innocente Pucelle, rendaient bon et élogieux témoignage de sa conduite, de sa retenue et de sa piété. Les docteurs eux-mêmes, tout piqués qu’ils fussent des saillies de la vive Lorraine, se voyaient obligés de reconnaître qu’elle avait raison, quand elle répondait aux objections tirées de leurs livres :
— Il y a ès livres de Notre Seigneur plus qu’ès vôtres.
VIII
Les conclusions du Conseil ecclésiastique de Poitiers
Le peuple d’ailleurs, les grands comme les petits, se sentait gagné à la confiance.
La maison de Jean Rabateau devenait comme un centre de pèlerinage. Sans doute, il s’y mêlait plus d’un sceptique, mais le grand nombre croyait en la Pucelle. Les prophéties qui couraient la France43 semblaient trouver en elle leur accomplissement. Quelques-uns, la vénérant déjà comme une sainte, s’efforçaient de lui faire toucher médailles, chapelets et objets de piété.
— Mais, leur disait joyeusement l’humble bergerette, touchez-les donc vous-mêmes, ce sera tout aussi bien que si je les touchais.
Tout le temps libre, elle le passait dans une chapelle voisine, 60priant et pleurant pour que Dieu voulût bientôt venir en aide à la grande pitié du royaume.
Les frères mineurs, de retour de leur enquête, rendaient témoignage de la vie de Jeanne à Domremy et à Vaucouleurs.
Le Conseil ecclésiastique de Poitiers se rendit à l’évidence des faits. Il rédigea
l’opinion des docteurs que le roi a demandée, touchant le fait de la Pucelle envoyée de par Dieu.
Le rapport commence par féliciter le roi d’avoir procédé dans cette affaire avec lenteur et maturité, et d’avoir fait examiner Jeanne sérieusement, en se conformant ainsi aux conseils de la Sainte Écriture. Puis, il constate que, depuis six semaines, la jeune fille a été examinée, tant publiquement que secrètement, par des savants, des gens d’Église, des chefs militaires, de nobles et prudentes dames ; qu’elle a reçu la visite d’un nombre immense de personnes de toutes conditions, et qu’en elle on n’a pas trouvé de mal, mais au contraire bien, humilité, virginité, dévotion, honnêteté, simplicité.
L’opinion des docteurs
déclare ensuite que, de sa naissance comme de sa vie, on raconte des choses merveilleuses ; pour le miracle qu’on lui demande, elle répond que ce sera la délivrance d’Orléans, parce qu’ainsi Dieu le veut.
En conclusion, les docteurs disent qu’il faut, pleins d’espérance en Dieu, la conduire avec des soldats devant Orléans, car douter d’elle ou la délaisser sans apparence de mal, serait résister au Saint-Esprit et se rendre indigne des grâces de Dieu44.
Avec l’Église
61C’est aussi la conclusion du traité spécialement composé pour étudier la nature des inspirations de la Pucelle, par l’archevêque d’Embrun, Jacques Gelu :
Nous conseillons donc, — écrit ce savant prélat, — qu’en toutes choses on se guide d’abord sur l’opinion de la Pucelle, et que le roi s’attache à suivre les conseils précis qu’elle pourra donner, parce qu’ils viennent de Dieu… Son avis doit être demandé avant tout, et l’on doit le rechercher de préférence à celui de tous les autres conseillers… Que le roi, avec humilité et reconnaissance, courbe la tête et fléchisse les genoux devant la majesté divine, et qu’il exécute les ordres de Dieu avec vigilance et promptitude.
Les juges de Rouen auront donc beau dire, Jeanne s’est soumise humblement et filialement à l’autorité de l’Église, avant de commencer sa mission. Si elle a répondu quelquefois avec cette spirituelle brusquerie, qui fait le charme des récits de Joinville et trouve son explication toute naturelle dans les façons de parler de ces âges naïfs, jamais elle ne s’est dérobée aux questions posées par ceux qui avaient charge de les lui faire, et la conclusion du Comité de Poitiers dit bien haut que la mission de Jeanne eut dès l’abord l’approbation de l’Église.
Les habits d’homme
Une dernière question restait à trancher, celle des vêtements de guerre45 que Jeanne, sur l’invitation de ses 62voix, avait revêtus. Le bon sens, si elle fut discutée, suffit à la résoudre, comme le fit observer l’archevêque d’Embrun, en résumant toute la question par ces simples mots :
Il est plus décent de faire ces choses (de la guerre) en habit d’homme, puisque c’est avec des hommes qu’on doit les faire.
63Chapitre quatrième La veillée des armes
I
Nouveau portrait de Jeanne d’Arc ; comment elle se tenait à cheval
L’attention, ou, pour parler plus exactement, l’espérance universelle se fixait sur la virginale héroïne. Grande, bien proportionnée de tous ses membres, remarquablement vigoureuse et saine46, elle se tenait droit et ferme à 64cheval47, dans sa taille svelte. Ses cheveux étaient coupés à l’écuelle, c’est-à-dire que le haut du front, les tempes et la nuque étaient rasés, et les cheveux coupés ainsi en rond sur la tête, suivant la mode dite des Augustins48. Sa voix, au timbre d’or, retentissait avec une harmonie qui a frappé les contemporains49. 65Le duc d’Alençon le constate dans une lettre à sa mère50.
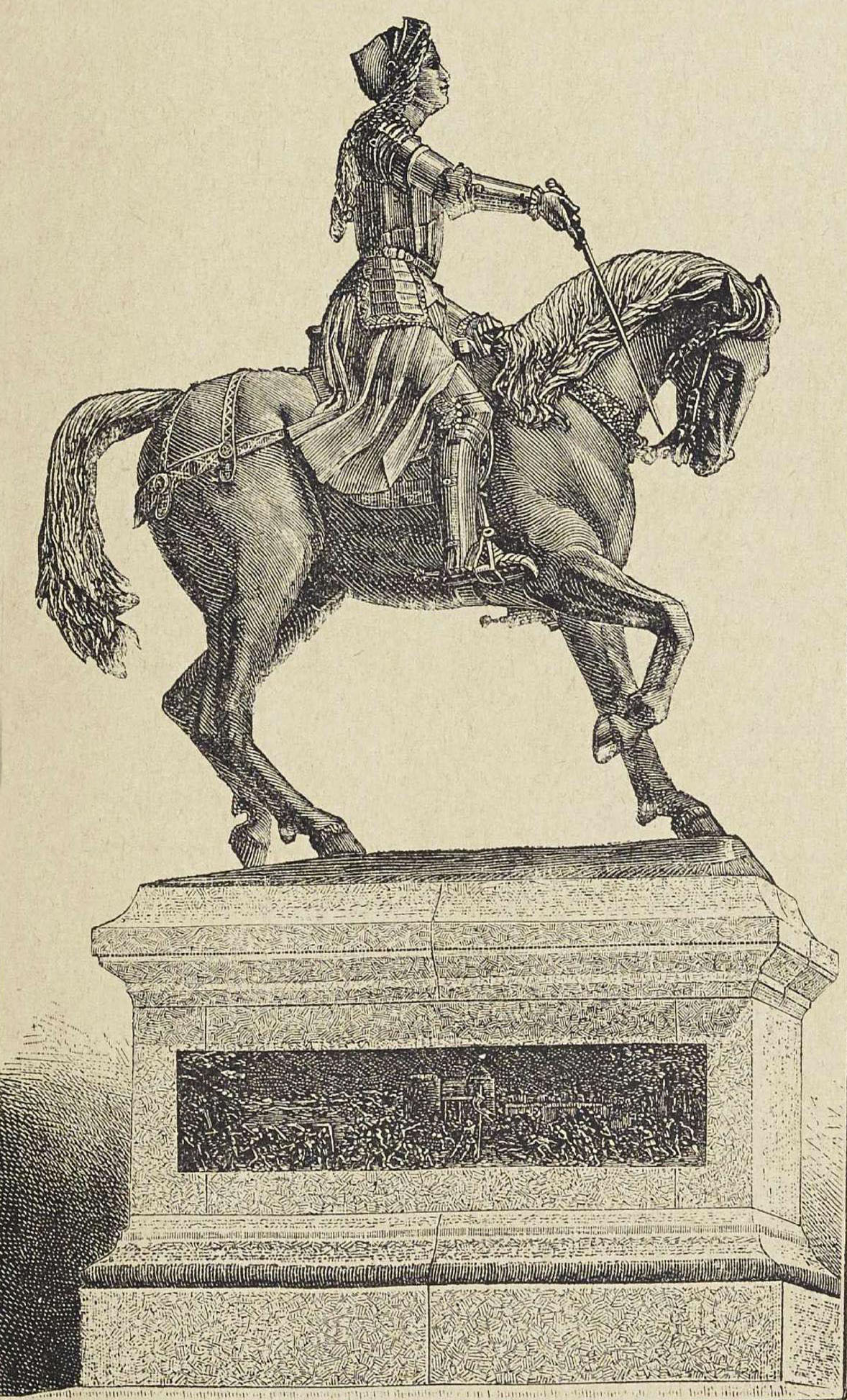
On organise un convoi de vivres pour ravitailler Orléans
Le Conseil du roi, malgré ses répugnances et l’hostilité marquée que nous avons déjà constatée, cédait aux conclusions du Comité ecclésiastique et à l’élan du peuple autour de l’envoyée de Dieu, dont la mâle et chaste bravoure réveillait les cœurs désespérés.
Il fut décidé qu’on formerait un convoi de vivres et de munitions pour essayer de ravitailler Orléans et que Jeanne en prendrait le commandement.
Charles VII quitta donc Poitiers, emmenant la Pucelle, et s’en revint à Chinon, en passant par Châtellerault. Puis, il la dirigea sur Tours, où devait être confectionné son équipement et organisée sa maison militaire.
Séjour à Tours
Elle entra à Tours vers la fin du mois d’avril 1429 et y fut logée dans le bel hôtel qu’habitait le seigneur de La Roche Saint-Quentin, Jean Dupuy, conseiller du roi. Entre temps, grâce à la patriotique générosité de Yolande d’Aragon, qui engagea sa vaisselle pour fournir aux dépenses, le 66convoi de ravitaillement s’organisait à Blois, et le roi pourvoyait à l’équipement de la Pucelle.
Deux pièces de cet équipement sont demeurées célèbres : l’épée et l’étendard. Mais, ces deux pièces-là, ce ne fut pas le roi qui les fournit. L’histoire vaut d’en être contée par son merveilleux détail.
II
L’épée de Sainte-Catherine-de-Fierbois
— Pendant que j’étais à Tours ou à Chinon, a-t-elle raconté elle-même dans l’interrogatoire de son procès à Rouen, j’envoyai chercher une épée qui se trouvait dans l’église de Sainte-Catherine-de-Fierbois, derrière l’autel, et on l’y trouva aussitôt toute souillée51.
— Comment saviez-vous que cette épée fût là ?
— Cette épée était en terre, toute rouillée, et la garde était ornée de cinq croix. Je sus qu’elle se trouvait là par mes voix, et l’homme qui l’alla chercher ne l’avait jamais vue. J’écrivis aux prêtres dudit lieu de bien vouloir m’envoyer cette épée, et ils me l’envoyèrent. Elle n’était pas très enfoncée en terre, derrière l’autel, comme il me semble ; cependant, je ne sais pas bien si elle était devant l’autel ou derrière ; mais je pense bien avoir dit alors qu’elle se trouvait derrière l’autel. Aussitôt après que l’épée eut été trouvée, les ecclésiastiques dudit lieu la frottèrent, et aussitôt la rouille tomba sans difficulté. Ce fut un armurier de Tours qui l’alla chercher. Les prêtres de Fierbois me firent don d’un fourreau, et les habitants de Tours d’un autre. On fit donc faire deux fourreaux, l’un de velours vermeil, et l’autre de drap d’or. Et moi, j’en fis faire un troisième, de crin solide.
Comment elle se rompit
67Cependant, cette épée était lourde, et mal en main. Elle se rompit à Saint-Denis, un jour que, poursuivant à cheval une de ces femmes de mauvaise vie dont elle cherchait à purger son armée, elle lui en administra un coup de plat sur les épaules52.
L’étendard de Jeanne
Mais, bien plus que son épée, quarante fois plus
, comme elle le dit dans son procès, elle aimait son étendard, ce signe et cet instrument de ses victoires, car, jamais elle ne se servit de l’épée pour frapper à mort et jamais ne tua personne. L’ennemi, elle l’abordait, le poursuivait, le chassait, son glorieux et saint étendard à la main. Sur ses instructions, un Écossais, de résidence à Tours, lui confectionna un étendard, en tissu de fil, blanc, avec des franges de soie. Sur la face, en champ d’argent (blanc) semé de lis d’or, on voyait Dieu représenté en majesté
(tenant en mains le globe du monde et trônant sur les nuées), avec deux anges adorateurs qui lui présentaient des fleurs de lis. Le tout accompagné en devise de l’inscription : Jésus, Maria. Sur le revers, à l’opposite de cette face ainsi ornée, on voyait l’écu de France, tenu par deux anges.
Son pennon
En outre, Jeanne se fit faire une petite bannière, nommée pennon, représentant une Annonciation, un ange qui présentait une branche de lis à la Vierge.
III
Elle apparaît soudain comme une guerrière accomplie
68Ainsi équipée, Jeanne apparut soudain comme une guerrière accomplie.
Elle parlait et devisait des ordonnances et du fait de la guerre, autant et en aussi bons termes qu’eussent su et pu faire les chevaliers et écuyers étant continuellement au fait de la guerre.
Les chroniqueurs, qui l’affirment, ajoutent :
Et s’émerveillaient docteurs et capitaines et autres de son fait et des réponses qu’elle faisait, tant de la chose divine que de la guerre, et en autres choses elle était la plus simple bergère que oncques l’on vit53.
Non seulement la Pucelle parlait du fait de la guerre, elle montrait dès lors qu’elle excellait dans les exercices du parfait chevalier :
Elle courait la lance aussi bien et mieux qu’homme d’armes qui fût ; elle chevauchait les coursiers noirs, tels et si malicieux, qu’il n’était nul qui osât bonnement les chevaucher54.
Et cependant, d’après le premier secrétaire du roi, Alain Chartier, c’était seulement à son départ de Vaucouleurs, quelques semaines avant, qu’elle était montée à cheval pour la première fois55.
Elle avait le goût de son nouveau métier. C’est ce qui ressort du portrait que trace d’elle un des grands dignitaires de la cour, de Boulainvilliers, dans une lettre au duc de Milan. Le voici dans son entier.
La Pucelle a la beauté qui convient, quelque chose de viril dans le port ; elle parle peu, mais toujours avec un merveilleux à-propos. Sa voix est grêle comme celle d’une femme, elle ne mange presque pas, et en fait de vin, boit moins encore.
69Elle se plaît au maniement du cheval et des belles armes, affectionne les hommes de guerre et les gentilshommes, n’a que de l’éloignement pour les réunions nombreuses et les conversations bruyantes ; ses larmes sont habituelles et abondantes ; son visage est avenant et serein ; nul ne fut jamais si dur à la fatigue ; si bien qu’elle peut rester six jours et six nuits sans détacher une seule pièce de son armure… Elle vénère le roi56.
Les détails de cette lettre du 21 juin 1429 sont complétés par un extrait d’une autre lettre, qu’à la date du 8 juin le jeune seigneur de Laval écrivait à sa mère et à sa grand-mère, de Selles où il avait rejoint l’héroïne.
Je la vis monter à cheval armée tout en blanc, sauf la tête, une petite hache en main, sur un grand coursier noir, qui, à l’huis (porte) de son logis, se démenait fort, et ne souffrait qu’elle montât, et lors elle dit :
Menez-le à la croixqui était devant l’église, auprès, au chemin ; et lors elle monta sans qu’il se mût, comme s’il était lié ; et lors se tourna vers l’huis de l’église qui était bien prochain, et dit en assez voix de femme :Vous les prêtres et gens d’Église, faites processions et prières à Dieu.Et lors, se retourna à son chemin, en disant :Tirez avant, tirez avant, son étendard ployé que portait un gracieux page, et avait sa petite hache en main, et un sien frère qui est venu depuis huit jours partait aussi avec elle, tout armé en blanc.
D’où lui vint cette expérience subite des choses de la guerre
70Un ange guerrier, prenant chair et sang, apparaîtrait-il sous d’autres traits ? L’ange apparaîtra bien mieux encore dans la bataille57.
Le duc d’Alençon en témoigne son ardente admiration.
— Tout le monde, répondit-il nettement aux juges de la Pucelle, tout le monde s’étonnait qu’elle se conduisît avec tant de prudence et de prévoyance, comme un capitaine qui, servant depuis vingt ou quarante ans, aurait été rompu aux secrets de l’art militaire.
L’un de ses plus récents biographes58 le fait justement observer, à ce propos.
D’où lui serait venue une telle expérience, puisque, à peine sortie de son village, elle fut mise à la tête de gens armés, sinon de Celui qui sait tout et qui peut tout, et qui, non content de lui avoir donné, dès sa naissance, un grand cœur et une grande intelligence, se plaisait encore à l’instruire chaque jour, et lui révélait par ses
saintesce qu’elle devait fairepour le fait de la guerre59.
71IV
Ses deux frères
On l’aura sans doute remarqué dans la lettre du jeune sire de Laval, Jeanne avait dès lors auprès d’elle un de ses frères. Elle en avait même deux. Les deux plus jeunes Jean et Pierre, en effet, la rejoignirent à Tours et constituèrent avec ses deux fidèles compagnons, Jean de Metz et Bertrand de Poulangy, les premiers éléments de sa maison militaire.
Domremy et Vaucouleurs auprès de Jeanne
Domremy et Vaucouleurs se retrouvèrent donc auprès d’elle, quand il fallut commencer sa rude et glorieuse mission. D’autres s’adjoignirent à ces fidèles et chers représentants du pays natal : Jean d’Aulon, qui fut toujours pour Jeanne un si dévoué compagnon ; Louis de Contes et Raymond, ses deux pages, et quelques varlets d’armes.
Le bon frère Jean Paquerel
Les frères de Jeanne, en s’arrêtant à Notre-Dame du Puy, où leur mère les avait accompagnés pour prier la future Notre-Dame de France en faveur de sa Jeannette laissée en de si graves périls, y rencontrèrent un bon ermite de l’ordre de saint Augustin, frère Jean Paquerel.
— Venez avec nous, lui dirent-ils, trouver Jeanne.
Et, pour achever de décider le saint religieux, ils ajoutèrent :
— Nous ne vous laisserons point aller, que vous ne consentiez à venir avec nous vers elle.
Pasquerel se décida et ils le présentèrent à leur sœur.
— Jeanne, nous vous amenons ce bon père ; si vous le connaissiez, vous l’aimeriez beaucoup.
Or, Jeanne le connaissait, peut-être par ses voix, elle avait entendu parler de lui :
— Je suis contente de le voir, dit-elle. Dès demain, je veux qu’il m’entende en confession.
Le lendemain, en effet, frère Jean Paquerel la confessa, 72chanta la messe devant elle et devint son aumônier en titre. Il ne la quitta plus, pendant toutes ses campagnes.
Transformation morale de l’armée française
Toute l’armée se trouva en un clin d’œil transformée60.
Le spectacle vaut d’être considéré d’un peu près. Nous en empruntons le détail au P. Ayroles.
Un guerrier de dix-sept ans, possédant toutes les qualités du parfait soldat et du général accompli : l’histoire en connaît-elle ? Un homme d’armes paraissant pour la première fois au milieu des hommes du métier, et se montrant du premier coup rompu à tous les exercices, aux plus hauts comme aux plus humbles secrets de la noble profession, n’est-ce pas en dehors de toutes les lois de la nature ? Si ce guerrier si jeune, maître sans avoir jamais été élève, est une jeune fille, une villageoise, qui ne sera forcé de la croire, quand elle affirme être sous l’action d’une puissance supérieure, de saint Michel ?
Faut-il d’autres preuves ? Contemplez ceux qu’elle va conduire à la victoire. Ce sont ces Armagnacs qui blasphèment comme ils respirent, sans frein dans leur luxure, pillards, au point que leurs déprédations les rendent aussi redoutables au pays pour lequel ils disent combattre, que les étrangers qu’ils combattent. La Pucelle paraît ; et voilà qu’à sa voix, momentanément du moins, leur-langage se transforme ; ils deviennent pieux et moraux, respectueux du bien d’autrui ; ils souffrent que la jeune fille proscrive l’immonde troupeau qu’ils traînent à leur suite, et lui donne la chasse.
Le premier ordre qu’elle donne en arrivant à Blois, c’est celui de renvoyer des rangs de l’armée les femmes 73de mauvaise vie, qui y foisonnaient ; de se confesser et de mettre la conscience en bon état. Elle promettait la victoire, à l’aide de Dieu, si l’on obéissait.
Même commandement à son arrivée à Orléans. Elle menaçait de renvoyer de l’armée quiconque ne se serait pas confessé, ou même elle menaçait de se retirer.
Le blasphème la mettait hors d’elle-même. On l’a vue courir vers de hauts personnages qui s’oubliaient, les prendre au collet et leur dire :
— Vous osez bien renier ainsi notre sire et notre maître ; en nom Dieu, vous vous en dédirez, avant que je parte d’ici.
Les grands seigneurs s’exécutaient, faisaient amende honorable et promettaient de se corriger.
— J’ai été sévèrement réprimandé par elle, déposait un des premiers princes du sang, le duc d’Alençon, pour m’être laissé aller à cette habitude invétérée. Sa seule vue arrêtait sur mes lèvres la parole prohibée, prête à s’échapper.
— Ses exhortations produisaient les transformations les plus entières. Des guerriers d’une indicible dissolution revenaient à la pureté des mœurs chrétiennes, déposait le chanoine André.
Le juron de La Hire
Le brave de l’époque, Étienne de Vignobles, qui devait aux fureurs de ses emportements le nom depuis si populaire de La Hire (la colère), La Hire se calma devant l’agneau. Il lui fallait un mot pour laisser échapper les bouillons de son humeur gasconne. Il se mit à jurer par son martin, son bâton, comme le Béarnais converti devait jurer plus tard par son confesseur, et faire entrer dans la langue populaire son Jarnicoton61.
74Ennemie du blasphème, celle qui était venue pour les opprimés, l’était de la rapine. Elle la prohibait sévèrement, et préférait manquer du nécessaire plutôt que de le devoir à la violence. Un homme d’armes écossais ayant osé lui dire qu’elle avait trouvé bon un morceau de veau, fruit de la maraude, elle en fut comme exaspérée et se mit en devoir de le frapper.
La guerre qu’elle fit aux femmes de mauvaise vie fut implacable, comme celle qu’elle fit à l’envahisseur. L’ordre qu’elle donna en arrivant à Blois, elle le renouvela et fit publier un cri
par lequel il leur était défendu de paraître dans l’armée. Les impudentes, pour échapper à cette proscription, prenaient des vêtements d’hommes et se glissaient dans les rangs des gens de guerre. Jeanne leur donnait la chasse, les poursuivait, lance en main, et la menace aux lèvres. Elle les frappait du plat de son épée. C’est ainsi qu’elle brisa sur le dos de l’une d’entre elles son arme de prédilection, l’épée de Fierbois.
V
Sa prière à Dieu
Plus on sonde cette âme si fortement chrétienne, et plus on s’éprend d’admiration pour les dons surnaturels et les vertus qui l’ont caractérisée. Les témoignages, versés au procès d’introduction de sa cause en cour de Rome, surabondent 75à cet égard. La vénérable servante de Dieu a pratiqué, à un degré véritablement héroïque, les grandes vertus théologales et cardinales, qui sont le fonds de la sainteté chrétienne.
Ce qu’était au fond l’ardeur de Jeanne contre les Anglais
Son ardeur contre les Anglais elle-même n’est point de la haine, c’est une généreuse indignation patriotique, tempérée par la charité envers les ennemis de son pays tant aimé62.
— Ce qu’il faut, ne cesse-t-elle de répéter à ses juges, c’est qu’ils s’en retournent en leur pays.
Sa lettre au soi-disant régent du royaume
Aussi, sur le point de leur livrer bataille, s’inspirant de son grand cœur, elle se recueillit et dicta la lettre suivante, monument de sa foi en la mission qu’elle avait reçue de Dieu, aussi bien que de son amour sincère de la paix et de la concorde entre les deux peuples :
Jésus, Marie,
Roi d’Angleterre, et vous, duc de Bedford, qui vous dites régent du royaume de France ; vous, Guillaume de la Poule (Pole), comte de Sulford (Suffolk) ; Jean, sire de Thalebot (Talbot) ; et vous, Thomas, sire d’Escalles (Scales), qui vous dites lieutenants dudit duc de Bedford, faites raison au roi du ciel de son sang royal ; rendez à la Pucelle, qui est envoyée ici de par Dieu, le roi du ciel, les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées ensemble. Elle est venue ici,de par Dieu, pour réclamer les droits du sang royal. Elle est toute prête à faire la paix, si vous voulez lui faire raison, c’est-à-dire si vous abandonnez le territoire de la France, en nous indemnisant des maux que vous nous avez causés. Et vous tous, archers, gentils compagnons 76de guerre et autres, qui êtes devant la ville d’Orléans, allez-vous-en dans votre pays, de par Dieu, et si ainsi ne faites, attendez des nouvelles de la Pucelle, qui vous ira voir bientôt, à votre grand dommage. Roi d’Angleterre, si vous ne faites ainsi, je suis chef de guerre, et, en quelque lieu que j’atteigne vos gens en France, je ferai qu’ils s’en aillent, qu’ils le veuillent ou non ; et, s’ils ne veulent obéir, je les ferai tous tuer. Je suis envoyée ici, de par Dieu, roi du ciel, coups pour coups, pour vous jeter hors de toute la France. Et si vos gens veulent obéir, je les prendrai à merci. Et n’allez pas vous imaginer que vous tiendrez jamais le royaume de France de Dieu, le roi du ciel, fils de sainte Marie. Celui qui le tiendra, c’est le roi Charles, vrai héritier ; car telle est la volonté de Dieu, le roi du ciel, qui a été révélée au roi de France par la Pucelle, et il entrera à Paris en bonne compagnie. Si vous ne voulez croire les nouvelles que Dieu vous envoie par la Pucelle, en quelque lieu que nous vous trouvions, nous frapperons de bons horions, et nous ferons un si grand tumulte, que depuis mille ans il n’y en aura pas eu de si grand en France, si vous ne nous faites raison. Et croyez fermement que le roi du ciel enverra plus de force à la Pucelle que vous n’en pourrez rassembler contre elle et ses vaillants hommes de guerre ; et l’on verra bien aux horions qui a meilleur droit, du Dieu du ciel ou de vous. Vous, duc de Bedford, la Pucelle vous prie et vous supplie que vous ne fassiez détruire. Si vous lui faites raison, vous pouvez encore venir en sa compagnie, là où les Français feront le plus beau fait d’armes qui ait jamais été accompli par la chrétienté. Répondez si vous voulez faire la paix en la cité d’Orléans, et, si vous ne faites ainsi, qu’il vous souvienne qu’il vous adviendra bientôt de grands dommages.
Écrit ce mardi de la semaine sainte.
De par la Pucelle.
77En souscription la lettre portait cette adresse :
Au duc de Bedford, se disant régent du royaume de France, ou à ses lieutenants étant devant la ville d’Orléans.
Comment les Anglais l’accueillirent
Quand les Anglais reçurent cette lettre, si fière et si française, ils entrèrent en fureur.
— Que nous veut, disaient-ils, cette ribaude, cette vachère ? Nous la ferons brûler !
En attendant, contrairement à tous les usages dans les nations civilisées et à tous les principes du droit des gens, ils retinrent le héraut, porteur de la missive, prisonnier, n’attendant plus que l’avis conforme de l’Université de Paris pour le faire périr par le feu.
Une date célèbre
Lorsque Jeanne apprit ces indignes traitements, elle ne se ressouvint plus que de sa mission de libératrice. Comme autrefois Débora et Judith — ce sont les figures bibliques auxquelles l’Église la compare dans un document officiel — elle se leva, pour délivrer Israël63.
C’était le 27 avril, au matin. L’armée française, conduite par ce nouveau chef de guerre, se mit en marche.
Pars, ange de Dieu
Comment s’empêcher de saluer l’héroïque enfant, qui guide la vaillante armée, dont elle est l’espoir, l’honneur et l’inspiratrice ! Un éloquent prélat l’avait saluée, à son départ de Vaucouleurs. Nous ferons nôtre cet hommage, en l’appliquant au départ de Blois :
Pars donc, fille de Dieu, comme disait Baudricourt, advienne que pourra !
Pars donc, ange de Dieu, son esprit est sur toi. Tes champs ne te reverront plus ; tu ne verras plus, de l’huis de ta chaumière, l’église où tu restais 78si longtemps à genoux, que tes compagnes disaient que tu étais trop dévote. Tu n’entendras plus là ce son triste et doux de la cloche que tu as tant aimé. Tu n’iras plus porter des couronnes nouvelles à Notre-Dame du Vert-Mont, ni prier au bois Chesnu, ni t’asseoir recueillie sous cet arbre des Fées, beau comme le lis
, ni te désaltérer aux fontaines limpides ombragées de groseilliers. Tes amies te pleureront ; tes pauvres, te voyant partir, ne s’en consoleront pas ; ton vieux père en mourra de douleur ; toi-même tu verras couler le sang de ton cœur, tu mangeras le pain de l’angoisse, tu boiras l’eau d’amertume, toi-même, comme Élie, tu monteras un jour sur le char du feu qui t’enlèvera de terre. Mais tu auras été fidèle à ta mission. Le roi te reconnaîtra, l’Église t’adoptera, le peuple t’acclamera, l’armée te bénira, la France te glorifiera, l’Europe te vénérera ; car qui ne vénérerait l’ange de l’innocence ? Un seul s’est rencontré qui, dans le cours des siècles, n’a pas craint de jeter à la face de cette vierge les grossières injures que lui jetaient les Anglais. Mais la Bible nous apprend que, jadis, ceux de Sodome reçurent ainsi les anges et l’insulteur de Jeanne est précisément celui dont le comte de Maistre a dit :
Paris le couronna, Sodome l’eût banni64.
79Chapitre cinquième Orléans
I
Le cœur de la France
Ouvrons65 la carte du beau pays de France.
Au centre, en suivant le cours du grand fleuve français, voyez, sur le plus haut point du parcours de la Loire, cette 80ville qu’elle semble porter là comme à son faîte, pour être le partage et aussi le boulevard de la France du Midi et de la France du Nord.
C’est Orléans !
On vante la grâce de ses rives, la majesté de ses forêts, la fertilité de ses plaines ; mais son plus beau trésor est celui de ses souvenirs, et, quatre fois dans l’histoire, elle reçut de Dieu l’honneur incomparable d’être le rempart suprême de la nationalité, de la vérité et de la liberté.
Quand César nous foulait sous le pas de ses légions, elle avait combattu pour la patrie gauloise, et, ne pouvant pas vaincre, elle avait su périr. Quand Attila roulait sur nous la barbarie, elle avait lutté pour la patrie gallo-romaine, et la prière d’Aignan avait vaincu pour elle. Quand l’Anglais nous enlaçait déjà comme une proie, elle combattit héroïquement pour la patrie française, qui fut sauvée chez elle. Quand, enfin, le protestantisme entoura le pays, une des premières, elle s’arma pour la patrie catholique ; c’est chez elle et par elle que fut faite la Ligue, et nous avons gardé la vérité par elle66.
Ces souvenirs ont valu à la cité orléanaise son nom de Cœur de la France. Mère des grandes choses et mère des grandes âmes
, les lis et les lauriers s’unissent dans sa couronne, l’étoile est sur son front qui n’a jamais pâli, la flamme est dans son cœur, et, dans un jour de ténèbres, peut-être le feu sacré se fût éteint parmi nous, si la dernière étincelle ne se fût trouvée en elle.
Le siège d’Orléans
C’était au milieu d’octobre 1428 ; toute la France s’étendant au-dessus de la Loire était aux mains de l’ennemi, quand, un matin, les Orléanais aperçurent briller, dans la direction d’Olivet, derrière les arbres à demi-dépouillés 81de leurs feuilles, les lances de Salisbury. C’était près de là, à Saint-Mesmin, entre le cours de la Loire et du Loiret, que Clovis et Clotilde étaient, il y avait neuf cents ans, venus fonder un lieu de prière pour le salut de la France.
Ce siège fut admirable. David Hume a écrit :
L’Europe avait les yeux fixés sur ce théâtre.
Héroïsme des assiégés
L’élite des chevaliers s’était jetée dans la place : le bâtard d’Orléans Dunois, Archambauld de Villars, les deux Xaintrailles, La Hire, Gilles de Rais, Jean de Brosses, La Fayette. La société bourgeoise s’associait à ces preux : Jacques de Thou, Louis de Contes, Jean Beauharnais. Les prêtres y apportaient leur ardeur et leurs biens. Les procureurs de la commune apportèrent leur intelligence. Les citoyens brûlaient, pour ôter tout refuge aux assiégeants, leurs faubourgs, les plus beaux faubourgs du royaume
.
Ce fut même aux lueurs de ce magnanime incendie que l’ennemi reconnut l’héroïque cité qui venait de mettre entre elle et l’Anglais un rempart de feu et de ruines. Les femmes rivalisaient d’ardeur et de dévouement : il n’y avait personne d’aussi français que les françaises
, et la première victime du siège, fut une femme frappée par un boulet à la porte Chesneau. Les enfants eux-mêmes gouvernaient le canon ; et l’un d’eux pointa si juste qu’il tua Salisbury de l’autre côté de la Loire.
Hélas ! tout cet héroïsme sembla ne servir de rien. À la journée de Rouvray, le 12 février 1429, Journée des Harengs, le désastre fut complet. Pour achever de porter le désespoir dans le cœur des assiégés, La Hire revenait de Chinon, voir le roi, qui n’avait pas quatre écus dans ses coffres et disait de lui que l’on ne pouvait perdre plus gaiement son royaume.
Un présage
Mais, comme on l’a dit, un peuple qui veille en armes auprès de ses foyers, un peuple qui veille en larmes auprès de ses autels, ne saurait point périr
. Des hommes venus de Gien apprirent aux Orléanais qu’une jeune fille de Lorraine avait passé par leur ville, se rendant à Chinon, 82pleine de promesses célestes. À quelque temps de là, Chabannes, Villars et Jamet de Tillay, revenus de Chinon, disaient au peuple assemblé qu’ils avaient vu cette Pucelle promettre au gentil prince de lui rendre Orléans et de le mener à Reims. Enfin, ceux de Blois firent savoir qu’elle venait de quitter leurs murs pour secourir les murs d’Orléans.
— Menez-moi à Orléans, répétait-elle aux docteurs, et je vous ferai voir le signe pour quoi je suis envoyée.
[Déjà,] la ville se sent réconfortée et comme désassiégée par la vertu divine que chacun disait être en cette simple Pucelle.
C’était aux premiers jours de mai ; tout était radieux de vie, de lumière et d’espérance. On était au temps de Pâques, l’Église chantait les hymnes de la résurrection, tout disait l’Alleluia sur la terre et dans le ciel. La cathédrale célébrait la fête de la Croix et celle de cette Dédicace où l’on avait vu se lever une main bénissante sur le temple et sur le peuple.
Le présage ne fut pas trompeur.
II
L’armée française arrive à Orléans sous la conduite de Jeanne
Tout en laissant par un côté ouvert un passage praticable aux convois venant de France, les Anglais, obligés à cette concession par la nécessité de se ravitailler eux-mêmes, avaient eu soin de construire secrètement, au milieu de la forêt d’Orléans, une puissante bastille, d’où, observant les routes qui traversaient la forêt, et s’avançant à couvert jusqu’à elles, ils devaient opérer sûrement et facilement sur toutes les expéditions assez téméraires pour essayer de porter secours aux assiégés.
Le 27 avril, au matin, comme nous l’avons dit, l’armée française se mit en marche. En tête, réunis sous l’étendard 83que Jeanne leur avait donné, marchaient les prêtres, chantant des antiennes et la belle hymne du Veni Creator.
Jeanne avait son plan, divinement révélé. Les chefs qui l’accompagnaient, obéissant aux craintes de la prudence humaine, firent prendre à l’armée la direction de la rive gauche, au lieu de la droite que la Pucelle avait donné ordre de suivre.
Première entrevue avec Dunois
La nuit était venue, et Jeanne dormit tout armée sous sa tente. Mais, peu accoutumée à porter son armure, ses membres demeurèrent meurtris et blessés de ce dur repos. Au matin, grande fut sa désolation, quand, parvenue en vue d’Orléans, elle vit qu’on l’avait trompée et que la Loire l’en séparait. Elle vit bientôt venir à elle le gouverneur militaire de la ville, Dunois.
— Est-ce vous, lui dit-elle, qui êtes le Bâtard d’Orléans ?
— Oui, et je me réjouis de votre arrivée.
— Est-ce vous qui avez dit que je vienne de ce côté, et que je n’aille pas directement là où se trouvent Talbot et les Anglais ?
— Oui, et de plus sages que moi sont du même avis, pensant ainsi faire mieux et plus sûrement.
— En nom Dieu, répliqua Jeanne, le conseil de mon Seigneur est plus sage et plus sûr que le vôtre. Vous avez cru me décevoir, et vous vous êtes déçu vous-même. Je vous amène, sachez-le bien, le meilleur secours qui vînt jamais à chevalier ou à cité, puisque c’est le secours du roi des cieux. Ce n’est pas par amour pour moi que Dieu vous l’envoie ; mais, à la requête de saint Louis et de saint Charlemagne, il a eu pitié de la ville d’Orléans, et n’a pas voulu souffrir que les ennemis eussent à la fois le corps de votre duc67 et sa ville.
84Dunois fut saisi par le ton inspiré de la Pucelle. Mais une vive inquiétude le dominait. Un violent vent de l’Est empêcherait les bateaux de remonter le fleuve et de porter dans Orléans le convoi de vivres apporté par l’armée.
— Soyez sans crainte, lui dit Jeanne, le vent va changer, et tout se passera bien.
Au même instant, le vent changea et les eaux s’enflèrent.
Le convoi des vivres passa sans encombre, Orléans était ravitaillé.
Restait une autre difficulté, la plus grosse, celle de faire pénétrer l’armée de secours dans la ville assiégée.
C’est à ce moment que les chefs durent avouer que leur sagesse tout humaine ne valait pas les voix de Jeanne. Il leur fallut rebrousser chemin et revenir à leur point de départ, à Blois, la Loire n’ayant pas de pont avant cette ville, et prendre le chemin que la Pucelle leur avait d’abord ordonné.
Jeanne fut très perplexe. D’une part, Dunois insistait, pour qu’elle cédât aux impatients souhaits d’Orléans qui voulait la voir, la posséder dans ses murs, la fêter comme sa meilleure défense, son dernier espoir. D’un autre côté, elle ne voulait pas laisser ses hommes d’armes.
— J’ai là, disait-elle, ces braves gens sous la main, bien confessés, pleins de confiance en Dieu, qui désirent combattre.
Jean Paquerel comprit son angoisse. Il s’offrit à demeurer avec l’armée et promit de revenir bientôt avec elle par la rive gauche. Les prêtres aussi restèrent avec les soldats et l’étendard de Jésus crucifié. Quelque chose d’elle demeurait donc avec les siens. Elle se décida à satisfaire aux vœux des Orléanais.
85III
Noël ! Noël !
Noël ! Noël ! Béni soit celle qui vient au nom du Seigneur.
Ainsi chantaient et saluaient les habitants d’Orléans, à l’entrée de la Pucelle. C’était le vendredi 29 avril, à 8 heures du soir.
Voici venir le Grand Secours
Armée de toutes pièces, montée sur un cheval blanc, l’apparition de la libératrice fut acclamée par une immense clameur de joie. On eût dit qu’ils voyaient Dieu descendre parmi eux
. Dunois, richement armé, et son escorte auraient voulu tenir tout ce peuple à distance respectueuse. Mais le peuple, à Orléans, comme à Chinon, comme à Reims, comme partout, comprit toujours le mieux la virginale enfant, qu’il appelait le Grand Secours
. En une sainte ivresse, sans ce soucier des murmures jaloux des grands, il se précipitait au-devant de Jeanne. On en vit qui baisaient les demi-lunes qu’avaient laissées dans le sable les sabots de son cheval.
— Voici venir le Grand Secours !
Et descendues du ciel, racontent les chroniques, des formes blanches, qui ressemblaient aux flammes de la Pentecôte, volaient au-dessus des remparts, enguirlandaient les flèches et les tours des églises. C’était l’âme de la libératrice qui s’emparait de tout ce bon peuple, hommes, femmes, enfants, porteurs de torches ardentes, qui tous voulaient la voir de près, la toucher, toucher au moins son cheval. Dans leur empressement, ils faillirent brûler avec leurs torches l’étendard qu’elle portait, avec tant de grâce modeste, inspirée et rayonnante, mais rapportant à Dieu toute sa gloire, car l’orgueil n’effleura jamais cette âme virginale et candide. Ils la conduisirent, en grand chère et grand honneur
à l’église principale, où elle voulut aller prier.
Cette venue change la face des choses
86Sa venue changea la face des choses. D’assiégés, les Orléanais se firent aussitôt assiégeants. Les courages abattus se relevèrent. Hier, raconte Dunois, deux cents Anglais auraient suffi pour mettre en déroute huit cents soldats. Aujourd’hui, quelques centaines d’hommes se levaient pour affronter l’armée anglaise toute entière.
Ung de nous en vaut mieux que cent
Soubs l’estandard de la Pucelle68.
Rendez-vous !
Toujours fidèle à son amour de la justice et de la paix, Jeanne voulut faire une nouvelle sommation aux Anglais, qui, plus insolents que jamais, lui répondirent de s’en retourner garder les vaches
.
Injures des Anglais en réponse à cette sommation
Elle voulut tenter un dernier effort. S’en allant donc sur le boulevard de la Belle-Croix, position avancée sur le pont, résolument, sans crainte du danger, elle interpella Glacidas et les soldats qui occupaient les Tourelles.
— De par Dieu, rendez-vous, vous aurez la vie sauve !
— Vachère, ribaude, répondirent les. Anglais, nous te ferons ardoir (brûler).
— Vous vous en irez bientôt, et toi, Glacidas, tu ne le verras point.
Sa prédiction se réalisa.
Le dimanche 1er mai, elle employa son temps à entrer en communion plus intime encore avec ce bon peuple d’Orléans, qui ne se pouvait saouler de la voir
. Elle s’efforçait de renvoyer le cœur de ce peuple à Dieu.
— Messire, répétait-elle sans cesse, m’a envoyée pour secourir la bonne ville d’Orléans.
Tandis qu’elle chevauchait dans les rues de la ville, elle vint à passer près de la Croix Morin et en profita pour sommer les Anglais de la bastille voisine de se rendre. Comme aux Tourelles, on lui répondit par les mêmes injures et le Bâtard de Granville s’écriait, hors de lui, en fureur :
— 87Voulez-vous donc que nous nous rendions à une femme ?
Le sang de nos gens coule par terre
Cependant, l’armée française tardait de revenir. C’est que quelques chefs avaient opiné pour ne pas tenir la parole donnée à Jeanne. Dunois l’emporta et, le mercredi 4 mai, Jeanne sortit d’Orléans avec La Hire, pour venir à la rencontre de ses soldats, qui amenaient de nouvelles munitions. Glacés de terreur, les Anglais laissèrent passer cette troupe, qui prit un peu de repos dans les murs de la ville.
Vers midi, le Bâtard d’Orléans arriva chez Jeanne, et lui annonça que Falstoff arrivait, amenant aux Anglais des hommes et des vivres, et qu’il était déjà à Janville.
— Bâtard, Bâtard, lui répondit-elle en riant, je te commande, aussitôt que tu sauras la venue dudit Falstoff, que tu me le fasses connaître, car, s’il passe sans que je le sache, je te ferai ôter la tête.
Dunois, sans se formaliser, lui répondit, en riant aussi, qu’il ne manquerait pas de l’avertir. La vérité était que, regardant la Pucelle comme une bonne fille, brave et dévouée au roi, envoyée de Dieu, mais sans croire encore que sa mission lui donnât le droit de tout diriger, Dunois lui avait caché la résolution prise d’attaquer les assiégeants sur l’heure.
Or, Jeanne, brisée de fatigue et d’émotion, s’était jetée tout habillée sur son lit et endormie. Tout à coup, ses voix l’éveillent. Les Français se battent, et elle n’y est pas, et, parce qu’elle n’y est pas, ils ont faibli.
— Le sang de nos gens coule par terre, s’écrie-t-elle. Mes armes, mon cheval !…
Puis, s’adressant à son fidèle écuyer d’Aulon :
— Mon Conseil m’a dit que j’aille contre les Anglais ; mais, je ne sais si je dois aller contre leur bastille, ou contre Falstoff qui les doit ravitailler.
Ah ! sanglant garçon, tu ne me le disais pas
Pendant qu’elle disait cela, frère Paquerel et d’autres prêtres, entrant en son logis, l’entendirent qui s’écriait :
— Où sont ceux qui me doivent armer ? Le sang de nos 88gens coule par terre ! En nom Dieu, c’est mal fait. Pourquoi ne m’a-t-on pas éveillée plus tôt ? Nos soldats ont bien à besogner devant une bastille, et il y en a de blessés. Mes armes ? Apportez-moi mes armes et amenez-moi mon cheval !
Les assistants ne savaient que penser, car tout était aux alentours calme et silencieux. Jeanne cependant courait à la porte, où elle rencontra son page, Louis de Contes :
— Ah ! sanglant garçon, lui cria-t-elle, tu ne me disais pas que le sang de France fût répandu !
Elle l’envoya quérir son cheval, et remonta prendre son armure. D’Aulon finissait de la lui ajuster, quand on entendit du bruit dans la rue. Elle se précipite et, une fois dehors, s’aperçoit qu’elle a oublié sa bannière. Elle crie au page de la lui passer par la fenêtre de sa chambre, la saisit au passage, et se dirige au triple galop vers la porte de Bourgogne. Le sabot de son cheval faisait jaillir des étincelles. Elle allait droit, par le chemin le plus court, là où jamais elle n’était allée.
Le premier sang que Jeanne ait vu couler
L’écuyer et le page eurent beau monter à cheval, ils ne purent la rejoindre qu’à la porte de la ville, où la déroute des assiégés la retint un moment. C’est là qu’elle vit, pour la première fois, des blessés français :
— Jamais, dit-elle plus tard, je n’ai vu couler le sang français sans sentir mes cheveux se dresser sur la tête.
Ce sang, il faut le venger et rétablir, en vengeant l’honneur français, le sort de la bataille, Jeanne s’empare du commandement, elle fait défendre par un héraut de piller l’église de Saint-Loup qu’on va reprendre sous sa conduite, puis, tranquille, sereine, mais illuminée d’un rayon d’en haut, elle donne le signal. Talbot est accouru au secours de la bastille menacée, ce n’est pas trop du chef anglais et de ses meilleures troupes pour soutenir le choc de l’héroïne. Les troupes françaises les arrêtent et l’assaut continue.
Déguisement des Anglais
Trois heures durant, les Anglais opposent une résistance acharnée, Jeanne les chasse de la bastille 89de Saint-Loup. Ils fuient ou se réfugient dans l’église, et quelques-uns revêtent, pour se sauver, les habits et les ornements sacerdotaux.
— Respectez ces hommes, à cause de leurs habits, commanda Jeanne à ce spectacle de lâche terreur, je les fais mes prisonniers, gardez-les près de moi, et tout à l’heure, avec moi, vous les reconduirez dans mon logis.
C’est qu’elle venait d’apprendre le massacre de deux cents prisonniers, que des Orléanais exaspérés avaient tués loin de ses yeux. Elle se prit à pleurer, gémissant, dans sa foi de chrétienne, sur le sort de tant d’âmes surprises par la mort au combat. Elle voulut même que tous les siens recourussent sur-le-champ au sacrement de pénitence, pour expier les fautes commises dans l’enivrement de la victoire, et elle-même se confessa à frère Paquerel.
Allons rendre grâces à Dieu
Puis, se relevant :
— Et maintenant, s’écria-t-elle, en route pour Orléans, mes amis ; allons de suite aux églises rendre gloire à Dieu de la victoire qu’il nous a donnée. Si nous étions ingrats, il ne serait plus avec nous et ne nous donnerait plus la victoire.
Toutes les cloches sonnaient dans les tours des églises, et le Te Deum chantait déjà sur toutes les voies de la ville.
IV
Comment Dieu punit les péchés des gens de guerre
Le lendemain, fête de l’Ascension, les troupes se reposèrent. Jeanne, qui savait l’heure venue, aurait voulu, malgré la sainteté du jour, livrer bataille. Les chefs, prétextant la fête, s’y refusèrent, et elle céda.
Ce répit forcé, elle l’employa à préparer ses gens de guerre, comme elle l’entendait dans son incomparable esprit de foi. Une ordonnance d’elle, publiée à son de trompe, invita tous les hommes à se confesser, avant de combattre le lendemain. Ordre exprès de chasser de l’armée les femmes de mauvaise 90vie, qui ne cessaient d’infester son armée malgré toute sa vigilance.
— Pour punir les péchés des hommes, disait la sainte héroïne, Dieu permet la perte des batailles.
Troisième lettre aux Anglais
Puis, obéissant une dernière fois au besoin de son car, dans l’espoir que l’expérience de la veille leur aurait donné à réfléchir, Jeanne voulut essayer une troisième tentative pour empêcher l’effusion du sang. La guerre, qui la couvrait de gloire, lui paraissait une nécessité, mais sa grande foi la portait à gémir sur cette dure et inéluctable nécessité. Qu’importait la gloire, au regard d’une âme, partie de ce monde sans confession !
Elle dicte donc à frère Paquerel, son chapelain, le billet suivant :
Vous, hommes d’Angleterre, qui n’avez aucun droit sur le royaume de France, le roi du ciel vous mande par moi que laissiez vos bastilles et vous en alliez dans votre pays ; ou sinon je vous infligerai une telle défaite qu’il en sera perpétuelle mémoire. Voilà ce que je vous écris pour la troisième et dernière fois, et je ne vous écrirai pas davantage.
Elle signa :
† Jhesus Maria, Jeanne la Pucelle.
Ce sont des nouvelles
Puis, résolue à adopter une poste d’un nouveau genre, elle ajouta :
Je vous aurais envoyé ma lettre plus honorablement, mais vous me retenez mes hérauts. Vous m’avez retenu mon héraut Guyenne. Renvoyez-le-moi, et je vous renverrai quelques-uns de vos gens pris à la bastille Saint-Loup, car ils ne sont pas tous morts.
Elle s’avança en effet aux avant-postes, attacha son billet à une flèche et la fit lancer aux Anglais avec ce cri :
— Lisez ; ce sont nouvelles.
Les Anglais lurent et répondirent par une grossière injure :
— Oui, ce sont des nouvelles de la prostituée des Armagnacs.
91La chaste héroïne frémit, elle se tourna vers Dieu et pleura, mais Dieu la consola par ses voix.
Jeanne découvre les secrets que les chefs de l’armée voulaient lui cacher
Pendant ce temps, le Conseil des chefs, tenu sans elle, décidait d’adopter un autre plan que le sien. Elle le sut par ses voix et accueillit froidement les délibérants, quand ils vinrent lui révéler une partie seulement de ce qu’ils avaient comploté.
— Dites-moi tout ce que vous avez conclu et arrêté, interrompit la sage guerrière, car, de mon côté, je puis celer des choses bien plus importantes.
Et elle allait et venait par la salle, marchant à grands pas. Dunois comprit qu’on avait maladroitement agi, il essaya de réparer le mal :
— Jeanne, dit-il, ne vous courroucez pas, on ne peut pas tout dire en une fois. Ce que le chancelier vous a dit a été résolu (attaquer la grande bastille de la Beauce) ; mais si ceux de l’autre côté se déportent pour venir aider la grande bastille de par deçà, nous avons résolu de passer la rivière, pour y besogner ce que nous pourrons. Et nous semble que cette conclusion est bonne et profitable.
Jeanne s’apaisa, mais sa tristesse se fit jour à travers sa réponse, car, après s’être déclarée satisfaite, elle ajouta :
— Pourvu toutefois qu’on exécute le plan, tel que vous venez de l’expliquer.
Ses prévisions n’étaient que trop fondées. Le lendemain, ils ne firent rien de ce qu’ils avaient résolu.
Panique dans l’armée française
Le lendemain, vendredi 6 mai, Jeanne et ses gens entendirent de grand matin la messe de Jean Paquerel. Puis, vers neuf heures, la Pucelle sortit d’Orléans, entourée des plus braves chevaliers et suivie de quatre mille hommes environ69.
Le poste extrême des Anglais sur la rive gauche était la bastille de Saint-Jean-le-Blanc. Mieux fortifiée que les 92autres, elle avait surtout pour objet de surveiller le passage du fleuve ; car, devant Saint-Jean-le-Blanc, il y avait dans la Loire une île appelée alors de Saint-Aignan, séparée seulement de la rive par un étroit canal. Cette île se prêtait donc merveilleusement à une attaque contre les Anglais ; aussi fut-ce dans l’île de Saint-Aignan que les Français, amenés par de nombreuses embarcations, vinrent prendre leur rang de bataille ; puis, avec deux bateaux, ils firent un pont sur le canal pour atteindre la terre ferme.
À ce moment, on vit flamber la bastille de Saint-Jean-le-Blanc. Les Anglais, ne s’y trouvant pas en sûreté contre de pareilles forces, abandonnaient ce poste en le brûlant, et se retiraient dans la formidable bastille des Augustins, construite un peu avant du fort des Tourelles, et défendant comme lui l’entrée du pont.
Voyant ce mouvement des Anglais, les chefs français hésitent à continuer leur mouvement en avant. Mais, Jeanne, entraînant avec elle une partie de l’infanterie, prend les devants et va établir ses positions dans le faubourg du Portereau, construit autour des deux bastilles anglaises, et, s’avançant sous le feu et les traits des ennemis, elle plante son étendard sur le rebord du rempart qui entoure la bastille des Augustins.
Mais, tout à coup, un frémissement de terreur parcourt l’armée française. Le bruit s’est répandu que les Anglais arrivent en nombre de la rive droite au secours de leurs postes attaqués ; la panique court de rang en rang. Toutes les compagnies tournent le dos l’une après l’autre, se hâtent de battre en retraite, et vont précipitamment reprendre leur poste d’attente dans l’île Saint-Aignan. Quelques braves seulement entourent encore Jeanne d’Arc, et l’entraînent. D’ailleurs, il faut bien qu’elle recule. Les Anglais, voyant la retraite des Français, sortent en foule de leurs bastilles et menacent d’un grand carnage les derniers des fuyards. Il faut les tenir en échec, pour permettre au mouvement de recul de s’accomplir sans désastre.
L’héroïne ramène les fuyards à l’assaut
93Jeanne est donc là, suivant les siens, empêchant leur massacre et tenant tête aux Anglais. Mais, en même temps, elle entend les injures dont ils l’accablent, et les huées qu’ils poussent sur les Français en fuite. Enfin, tous nos soldats sont en sûreté dans l’île Saint-Aignan. Jeanne n’a plus à les préserver, et c’en est trop pour son ardeur guerrière, pour son noble cœur, de fuir si longtemps devant les ennemis. Elle va les faire fuir à leur tour. Ses voix ne lui ont-elles pas prédit la victoire ?
— En avant, donc, sus aux Anglais !
Et Jeanne, ayant La Hire à ses côtés, derrière elle quelques braves chevaliers, la lance en avant, fond sur les Anglais et les charge avec une incroyable vigueur. L’ennemi ne comprend rien à cette volte-face subite. Il se voit disséminé par la poursuite sur un chemin découvert, loin de ces retranchements. À son tour, il fuit, et lestement encore, car l’armée française ralliée dans l’île a repris son sang-froid ; elle a reconnu son erreur, et, voyant l’Anglais s’éloigner à grands pas, elle marche de nouveau sur lui avec une mâle énergie. En avant, se portent ses braves chefs, des chevaliers honteux de leur premier échec et brûlants de le réparer. À leur tête entre autres, d’Aulon, l’écuyer de Jeanne, et un autre brave, qui se défient à qui le premier entrera dans la bastille des Augustins, sur le rempart de laquelle la Pucelle vient, pour la seconde fois, de planter sa bannière. D’Aulon et son compagnon arrivent en effet les premiers à la porte de l’un des retranchements ; ils s’efforcent d’y pénétrer, quand un Anglais, d’une stature colossale et d’une force herculéenne, les arrête, défendant à lui seul victorieusement tout le passage. D’Aulon, obligé un instant de reculer, signale le géant à Jean le Lorrain, le canonnier célèbre, qui d’un seul coup de sa couleuvrine l’abat sur le sol. Aussitôt, les deux braves pénètrent dans la bastille où les suivent en foule d’autres français. La bastille des Augustins était prise.
94À ce moment, les églises d’Orléans sonnaient l’office des vêpres.
Jeanne, durant le combat, se distinguait par sa bravoure et sa tactique merveilleuse. Craignant de voir ses hommes s’amuser au pillage, elle fit brûler tout le butin, puis, investir la forteresse des Tourelles, où les survivants des Anglais, entre autres Glansdale, s’étaient réfugiés.
Blessée au pied dans une chausse-trappe, elle dut céder aux supplications des chefs et rentrer à Orléans, où, trop fatiguée pour observer son habitude de jeûner tous les vendredis, elle prit un peu de nourriture et se prépara pour la rude journée du lendemain.
Vous avez été en votre conseil, et j’ai été au mien
Sur le soir, un membre du Conseil vint lui dire que, la ville étant bien pourvue, on avait décidé d’attendre.
— Vous avez été en votre Conseil, répliqua l’inspirée, et moi, j’ai été au mien. Or, sachez que le Conseil de mon Seigneur s’accomplira et tiendra ferme, et que cet autre Conseil périra.
Puis, se tournant vers son chapelain :
— Levez-vous demain de grand matin, dit-elle, et vous ferez plus qu’aujourd’hui. Tenez-vous toujours auprès de moi ; car demain j’aurai beaucoup à faire, et plus que je n’ai jamais eu ; oui, demain, je serai blessée, et le sang sortira de mon corps, à la poitrine.
V
Comment elle fit ouvrir la porte de Bourgogne
Le samedi 7 mai, avant l’aube, frère Paquerel dit la messe, et Jeanne partit pour l’assaut. Son hôtesse voulait la retenir, pour qu’elle mangeât d’une alose qu’un pêcheur, qui l’avait prise pendant la nuit, apportait au logis de la vaillante Pucelle.
— Gardez-la jusqu’au soir, répondit-elle en riant, car je vous amènerai un Godon
(sobriquet populaire des 95Anglais goddamn) qui en mangera sa part, et je repasserai le pont, après avoir pris les Tourelles.
De nombreux témoins entendirent la prédiction, s’émerveillant de l’entendre, car le pont dont elle parlait avait plusieurs de ses arches détruites.
Or, la porte de Bourgogne se trouva fermée, parce que le Conseil l’avait ainsi décidé, pour empêcher l’assaut résolu par Jeanne. Elle accourt, et, imposant silence au peuple qui murmurait, elle dit à Raoul de Gaucourt, le gouverneur de la ville qui veillait à l’exécution de la consigne des prudents :
— Vous êtes un méchant homme, mais, que vous le vouliez ou non, les soldats passeront, et ils gagneront aujourd’hui comme ils ont gagné hier.
La porte s’ouvrit, et Jeanne alla rejoindre les siens qu’elle avait laissés la veille devant les Tourelles. Les chefs, l’apprenant, accoururent et se joignirent à elle.
Bravoure des soldats de Jeanne
L’action s’engagea dès six heures du matin. Enthousiasmés par l’exemple et les exhortations de la Pucelle, les nôtres accomplissaient des prodiges de valeur. Ils se jetaient dans les fossés sous les traits de l’ennemi, ils se hissaient, invulnérables, jusqu’au sommet des remparts, mais là, à coups de maillet, de hache, de lance, l’assiégé les faisait rouler de nouveau dans le fossé.
La place est vôtre !
— Ne craignez pas, leur criait Jeanne, la place est vôtre !
Une flèche la transperce au pied des remparts
Vers une heure de l’après-midi, voulant en finir, elle appliqua une échelle contre le rempart. Les Anglais la reconnurent. Une grêle de flèches s’abattit sur la vaillante enfant et l’une de ces flèches, comme elle l’avait prédit, la transperça à la poitrine, entre l’épaule et le cou. Elle roula dans le fossé, aux applaudissements haineux de l’Anglais.
On l’emporta au loin, et on la déposa sur l’herbe. La flèche sortait d’un demi-pied de l’autre côté de la poitrine. Se voyant si grièvement blessée, elle éprouva une défaillance de la nature et se prit à pleurer. Mais, les saintes lui apparurent et elle se rasséréna.
— 96Je suis bien consolée ! fit-elle, après les avoir vues.
Quelqu’un lui proposa de charmer
la blessure. Elle se récria vivement.
— J’aimerais mieux mourir que de commettre un péché. La volonté de Dieu soit faite. Si l’on sait à mon mal quelque remède permis, qu’on l’emploie.
Puis, énergiquement, elle arrache elle-même la flèche de sa blessure, on y applique une simple compresse d’huile d’olive, et elle demande à se confesser.
Les chefs vinrent lui dire qu’ils allaient sonner la retraite.
— En nom Dieu, vous entrerez bientôt, n’en doutez pas.
Elle se retire à l’écart, fait sa prière, et revient reprendre son étendard.
— Quand vous verrez mon étendard flotter vers la bastille, dit-elle sur un ton inspiré, reprenez vos armes, elle sera vôtre.
Fascinés par la lumière surnaturelle qui sortait d’elle, les chefs obéissent. Pour elle, oubliant sa blessure, elle saute en selle, et se dirige vers le rempart, priant, en attendant qu’on l’avertît du signe donné par ses voix.
Tout à coup, le chevalier, mis par elle en observation, lui cria :
— Jeanne, la queue de l’étendard touche au rempart.
— En avant, en avant ! s’écria-t-elle, tout est vôtre !
Et elle s’élança contre la Bastille. Les siens la suivent.
Mort de Glansdale
Ils montent le long de la forteresse, tout comme par un escalier, à la stupéfaction des Anglais, qui, voyant reparaître celle qu’ils croyaient avoir tuée, reculent, se réfugient à la courtine et veulent entrer dans l’intérieur même du fort, dont un pont de bois les sépare. Leur chef, Glansdale, protège cette retraite.
— Ah ! Glansdale, Glansdale, lui cria la Pucelle, rends-toi au roi du ciel. Tu m’as appelée prostituée ; mais, j’ai grand-pitié de vos âmes, rends-toi, rends-toi.
L’orgueilleux obstiné s’engage à ce moment sur le pont, 97qui, miné par le feu d’un brûlot amarré sous lui, s’effondre entraînant chef et soldats dans sa ruine. Ainsi s’accomplit la prédiction qu’elle lui avait faite quelques jours auparavant :
— Les Anglais se retireront de devant Orléans, mais tu ne verras pas leur retraite.
Or, voilà qu’une autre prédiction de Jeanne se réalise.
Elle avait annoncé qu’elle rentrerait à Orléans par un pont, démoli au moment où elle faisait cette annonce. Tout à coup, pour pouvoir établir un passage vers les Tourelles, ses soldats, au moyen d’échelles et de madriers, étayent ce pont, en rétablissent les arches et passent dans la bastille, par le côté opposé à celui où Jeanne vient d’entrer et de planter au sommet son étendard victorieux.
Le soir était venu. Les Anglais ne bougeaient plus. Elle entre par le pont si inopinément rétabli, dans la ville, où les cloches chantaient partout le Te Deum.
Apparitions merveilleuses
Les soldats disaient qu’ils avaient vu, pendant l’assaut, des colombes voltiger sur les épaules de la noble Pucelle.
Quant aux prisonniers ils assuraient avoir vu les assaillants en nombre bien plus considérable et d’une stature bien plus élevée que la réalité. Ils parlaient aussi de l’apparition de deux prélats en habits pontificaux qui parcouraient les remparts, et le bon peuple reconnaissait à ces traits la protection de monseigneur saint Aignan et de monseigneur saint Euverte, évêques et protecteurs de la ville d’Orléans.
VI
Le 8 mai 1429
Enfin se leva le soleil qui allait éclairer la date à jamais mémorable, celle qui, chaque année, ramène la France aux pieds des autels, dans cette cathédrale orléanaise, où fut célébrée, avec tant d’allégresse, pour la première fois, la fête de la délivrance, la fête de l’accomplissement du signe 98que Jeanne avait promis de donner à son roi et à la France quand elle disait, à Vaucouleurs, à Chinon et à Poitiers :
— Je ferai lever le siège d’Orléans.
Le dimanche 8 mai 1429, les Anglais sortirent de leurs bastilles et se rangèrent en ordre de bataille. On vint le dire à Jeanne :
— C’est le plaisir et la volonté de Dieu, répondit-elle, qu’on leur permette de partir, s’ils le veulent ; mais s’ils font mine d’attaquer, défendez-vous hardiment et n’ayez crainte, car vous serez les maîtres.
Les Anglais lèvent le siège d’Orléans
Puis, la messe commença, célébrée en plein air, devant l’armée française. Jeanne l’entendit, abîmée dans l’adoration et l’amour de son Dieu. Elle en entendit une autre, en actions de grâces, et, comme elle finissait, elle demanda de quel côté les visages des Anglais étaient tournés. Comme la veille, à l’assaut des Tourelles, elle venait de recevoir révélation du signe de la victoire ; on lui dit que les Anglais regardaient vers la ville de Meung.
— En nom Dieu, s’écria-t-elle, ils s’en vont, laissez-les partir. Il ne plaît pas à Messire qu’on les combatte aujourd’hui ; vous les aurez une autre fois.
Le siège d’Orléans avait duré sept mois. Jeanne avait délivré la ville en neuf jours.

99Chapitre sixième La campagne de la Loire
I
L’enthousiasme du roi
Charles VII était d’un caractère faible, l’influence qu’exerçait sur lui La Trémouille désolait ses vrais amis. Il eut cependant un moment de chevaleresque enthousiasme.
Il embrasse l’héroïque libératrice et lui octroie un blason royal
Jeanne, se dérobant aux ovations, était arrivée à Blois, puis à Tours. Le roi y vint de Chinon au-devant d’elle. Quand la Pucelle parut à ses yeux, son étendard victorieux à la main, la voyant qui s’inclinait respectueusement devant lui, Charles n’y tint plus de la joie qu’il avait
, dit la 100chronique.
Il ôta son chaperon et l’embrassa en la saluant.
Une charte royale octroya à Jeanne les armoiries, qui font encore le juste et patriotique orgueil de la famille d’Arc. La couronne et l’épée qu’elle avait tirée pour conquérir le royaume y accompagnent les lis de France.
Je ne durerai guère plus d’un an
D’autres pensées plus graves assiégeaient l’âme de l’héroïque Pucelle.
— Je ne durerai guère plus d’un an, répétait-elle angoissée des délais que lui opposaient les politiciens de l’entourage royal, songez à bien besogner cette année, car j’ai beaucoup à faire.
Elle voulait conduire Charles à Reims sûrement et sans empêchement
.
— Après le sacre, assurait-elle, il me reste à chasser les Anglais et à délivrer le duc d’Orléans.
Forcés de se rendre à l’évidence et de reconnaître la divinité de sa mission, les conseillers du roi ergotaient sur tel ou tel détail, disant que ce n’était pas assez clairement l’ordre de Dieu.
Jeanne force l’entrée du conseil du roi
Un jour qu’ils délibéraient en secret, dans un appartement retiré, en présence du roi, au château de Loches, on entendit heurter à la porte de la chambre. C’était Jeanne, qui, pressée par ses voix, venait se jeter aux pieds de Charles et, embrassant ses genoux, s’écriait d’un ton pressant :
— Gentil Dauphin, ne tenez plus tant et de si longs conseils, mais venez au plus tôt à Reims pour recevoir votre digne couronne.
Comment ses voix lui dictaient sa conduite
Le roi hésitait, comme interdit, la regardant et ne sachant que lui répondre. Un des conseillers, Christophe d’Harcourt, vint à son aide et posa, peut-être un peu au hasard, la question de savoir si les voix lui avaient dicté cette démarche.
— Oui, répondit-elle, et je suis fort aiguillonnée touchant cette chose.
— 101Ne voudriez-vous pas, ajouta d’Harcourt, nous dire ici, devant le roi, comment font vos voix, quand elles vous parlent ?
L’humble inspirée rougit, elle n’aimait pas à dire ainsi tout haut les faveurs singulières dont elle était privilégiée. Mais il le fallait.
— Je comprends bien, fit-elle, ce que vous voulez savoir, et je vous le dirai volontiers.
Récit qu’elle en fait devant Charles VII à Loches
Le combat cependant était visible entre son humilité et son devoir. Le roi s’en aperçut et lui demanda :
— Vous plaît-il, Jeanne, de vous expliquer devant les personnes ici présentes ?
La Pucelle fit signe qu’elle le voulait bien et répondit :
— Quand je suis affligée de ce qu’on n’ajoute pas foi facilement aux choses que je dis de la part de Dieu, je me retire à l’écart et je prie ce souverain Maître, me plaignant à Lui, et lui demandant pourquoi on ne croit pas à mes paroles. Ma prière faite, j’entends une voix qui me dit : Fille de Dieu, va ! va ! va ! Je serai ton aide, va ! Et, quand j’entends cette voix, j’éprouve une grande joie, et je voudrais toujours être en cet état.
Dunois, présent à l’audience, rapporte que, en parlant ainsi, Jeanne rayonnait d’une joie céleste et levait les yeux au ciel. L’humble paysanne disparaissait, pour faire place à la glorieuse inspirée.
Toute hésitation cessa, et, sur le plan de Jeanne, pendant qu’on allait convoquer les seigneurs dont la présence était nécessaire au sacre et l’armée qui devait accompagner le Dauphin à Reims, elle délogeait les Anglais des positions qu’ils occupaient encore sur la Loire, pour ne pas laisser le Midi en leur pouvoir, pendant qu’on marcherait vers le Nord.
À quatre siècles et demi de là : Ah ! si Jeanne eût été à Patay en 1871 !
La campagne de la Loire est demeurée célèbre dans l’histoire de la Pucelle. Pendant nos récents désastres, que de fois le souvenir s’en est réveillé au cœur de la France catholique et guerrière ! Ah ! si Jeanne avait été là, avec sa 102bannière ! Un corps d’élite s’inspira de son patriotisme surnaturel et, là où elle avait vaincu les Anglais quatre siècles et demi auparavant, nos annales inscrivirent une des rares dates à demi-victorieuses de la nouvelle guerre, celle de la bataille livrée à Patay par les zouaves du Sacré-Cœur !
Revenons au récit de la campagne de Jeanne.
II
Les trois fortes positions des Anglais sur la Loire
Les Anglais tenaient, sur la Loire, entre Blois et Orléans, trois grosses forteresses, Beaugency, Meung et Jargeau. Ils s’y étaient solidement retranchés. Jeanne entreprit de les en chasser.
Le roi avait donné le commandement de l’expédition au jeune duc d’Alençon, mais avec recommandation expresse de suivre en tout les conseils de la Pucelle.
Un crayon de Guy de Laval
Guy de Laval a raconté, d’un vif crayon, dans une lettre à sa mère et à son aïeule, l’impression qu’il eut de sa première rencontre avec Jeanne.
Le lundi (6 juin 1429), dit-il, je quittai le roi pour venir à Selles-en-Berry, à quatre lieues de Saint-Aignan. Le roi fit venir la Pucelle au devant de lui, et aucuns disaient que c’était en ma faveur, pour que je la visse. Ladite Pucelle me fit très bon visage, à mon frère et à moi. Elle était armée de toutes pièces, sauf la tête, et tenait sa lance en main. Et, après que nous fûmes arrivés à Selles, j’allai à son logis pour la revoir. Elle fit venir du vin, et me dit qu’elle m’en ferait bientôt boire à Paris. Ce semble chose toute divine de son fait, de la voir et de l’ouïr.
Sus à l’Anglais
Suffolk s’était retiré à Jargeau. Sur les instances de Jeanne et malgré l’hésitation des tacticiens à sagesse humaine qui semblaient avoir pour mission de faire ressortir par le contraste l’inspiration surnaturelle de la Pucelle, on se décida à ouvrir le siège.
— 103Ne craignez pas, dit Jeanne à ceux qui voulaient retarder cet assaut, donnez hardiment l’assaut aux Anglais ; Dieu nous conduit.
Et, comme elle vit de l’hésitation à l’en croire :
— Ah ! s’écria-t-elle, si Dieu n’était mon guide, comme j’en suis assurée, n’aimerais-je pas mieux garder les brebis que de m’exposer à tant de périls ?
On finit par l’entendre et on fondit sur les faubourgs.
Les Anglais firent une sortie vigoureuse, et nos troupes faiblissaient, quand l’héroïque bergère, qui venait de faire ce retour mélancolique sur sa vie calme et modeste aux champs de Domremy, saisit son étendard et courut sus à l’Anglais. Elle décida de la victoire. On coucha sur les positions conquises.
Mais, disait plus tard le duc d’Alençon, il faut bien croire que Dieu était avec nous ; car, cette nuit-là, nos gens firent si mauvaise garde, que si les Anglais étaient sortis de la ville, l’armée du roi eût couru un grand danger.
Victoire de Jargeau
Le matin, dès l’aurore, la canonnade commença. Jeanne veillait sur le duc d’Alençon, qu’elle avait promis de ramener sain et sauf.
— Beau duc, lui dit-elle tout à coup, ôtez-vous de cet endroit, ou sinon, voici une machine qui vous tuera.
Alençon obéit et la couleuvrine, que Jeanne désignait du doigt, abattit un gentilhomme qui avait pris la place du duc.
On allait enfin donner l’assaut, quand on vint dire que La Hire parlementait avec Suffolk, sans mission. On le rappelle en hâte, et les hérauts crièrent :
— À l’assaut ! à l’assaut !
Jeanne, s’adressant à d’Alençon, criait aussi :
— Avant, gentil duc, à l’assaut !
Le duc hésita. Il trouvait que c’était aller un peu vite en besogne.
— Ah ! gentil duc, reprit la Pucelle, as-tu peur ? Ne 104sais-tu pas que j’ai promis à ta femme de te ramener à elle sain et sauf ?
Les échelles étaient posés, l’assaut commença. Une pierre, lancée du rempart, vint tomber sur le casque de Jeanne et la coucha par terre. Elle se releva.
— Amis, amis, sus ! sus ! criait-elle. Notre Seigneur a condamné les Anglais. À cette heure, ils sont nôtres. Ayez bon courage.
Les Français, enlevés par ces excitations guerrières, arrivent au sommet du rempart et l’ennemi s’enfuit.
Suffolk est fait prisonnier
Suffolk lui-même, entraîné par les siens, se retira sur le pont, où un gentilhomme, Guillaume Renault, le serra de si près qu’il fut contraint de se rendre.
— Es-tu chevalier ? demanda le comte anglais à son vainqueur.
— Non, répondit le gentilhomme.
— Eh bien ! je te fais chevalier, et je me rends à toi.
III
Arrivée du connétable de France
Le mercredi qui suivit la prise de Jargeau, Jeanne, après un court séjour à Orléans,
de laquelle voir [les habitants] ne se pouvaient saoûler,
repartit pour Meung, où l’on commença à bombarder le château et le pont, dans la soirée du 16 juin. Mais une nouvelle inattendue tomba tout à coup au milieu des assiégeants et faillit débander l’armée.
Le connétable de France, comte de Richemont, arrivait, à la tête d’un corps de troupes considérable et demandait à combattre dans nos rangs. Or, le roi, que La Trémouille avait brouillé avec Richemont, avait donné au duc d’Alençon la consigne expresse de ne pas accepter les services du connétable, s’il avait l’audace de les offrir.
— Si vous l’accueillez, dit-il aux autres chefs de l’armée, je me retire.
Comment Jeanne aplanit cette difficulté
105Avec sa sagesse et sa charité, la Pucelle arrangea cet incident, où tant de difficultés se heurtaient l’une contre l’autre. On avait annoncé au camp l’arrivée d’une nouvelle armée anglaise. Elle en profita pour montrer le doigt de la Providence dans l’arrivée du connétable, se porta garant du consentement de Charles VII, fit jurer à Richemont serment de fidélité au roi, et le disgracié fut admis à l’honneur de combattre à côté d’elle.
Les Anglais reçoivent du renfort
Falstoff cependant arrivait, avec l’armée de renfort destinée à fortifier les garnisons de Jargeau, Meung et Beaugency. Or, Jargeau était occupé, le pont de Meung aussi. Falstoff opina sagement pour une honorable temporisation.
— Nos soldats, dit-il dans le Conseil des envahisseurs du sol français, sont découragés par ces échecs. Il vaut bien mieux gagner du temps. Dispersons nos hommes dans les diverses places fortes des environs qui appartiennent encore au roi d’Angleterre et nous attendrons ainsi les renforts que le régent nous prépare. Pendant ce temps, les Français s’épuiseront à faire des sièges. Puis, quand notre armée sera au complet, nous aurons bien plus facilement raison de leurs troupes lassées.
Les conseils de temporisation repoussés par Talbot
Talbot, humilié de ses défaites et brûlant de se venger, refusa de se ranger à cet avis prudent. La bataille fut décidée.
Les Anglais s’avancèrent, les Français aussi. Ils se rencontrèrent à une lieu près de Meung et assez près de Beaugency
. Or, pendant que les Anglais canonnaient le pont occupé par les Français, pour se frayer un chemin commode et uni vers la forteresse de Beaugency, les Anglais, qui occupaient cette place, effrayés et aux abois, capitulaient, avec promesse de ne point reprendre les armes avant dix jours. Lors donc que les troupes de Talbot se présentèrent, ils se trouvèrent en présence d’une victoire et ne purent plus que songer à la retraite.
Jeanne veut qu’on poursuive les fuyards
L’Anglais fuyait, pourquoi le poursuivre ? Le sol qu’on 106foulait réveillait de douloureux souvenirs. Crécy, Poitiers, Azincourt, les chefs de l’armée française baissaient la tête, à ces noms, mémoriaux de désastres. Les voix furent d’un avis contraire. Jeanne, qui les entendit, revint au camp.
— Qu’on aille hardiment contre les Anglais, s’écria-t-elle avec cet accent d’autorité surnaturelle qui en faisait la messagère du ciel, ils seront certainement vaincus. Ils fuient, dites-vous. Eh bien, quand même ils seraient pendus aux nuages, nous les aurions, car Dieu nous a envoyés pour les punir. Oh ! de par Dieu, n’hésitez pas. Le gentil dauphin de France aura aujourd’hui la plus grande victoire qu’il ait encore vue. Mon Conseil m’a dit que les Anglais sont tous nôtres.
Le cerf
On partit en avant, sans savoir par où les fuyards s’étaient dérobés à la poursuite des nôtres. La Hire, Beaumanoir, Thibault de Termes, couraient en avant, en éclaireurs. Ils firent lever un cerf, qui alla donner dans le gros des troupes anglaises, dissimulées à la vue des éclaireurs par un pli de terrain. Le cerf fut accueilli avec de grands cris, et l’avant-garde reconnut que c’étaient des cris d’Anglais.
Avez-vous de bons éperons ?
On le vint dire à d’Alençon, qui consulta Jeanne.
— Avez-vous de bons éperons ? répondit-elle.
— Eh quoi ! firent-ils d’une voix troublée, nous tournerons donc le dos ?
— Nenni, en nom Dieu, répliqua joyeusement la Pucelle, ce seront les Anglais ; ils seront déconfits, et vous aurez besoin des éperons pour les suivre.
Puis, apercevant Richemont, elle ajouta, toujours joyeuse :
— Ah ! brave connétable, vous n’êtes pas venu de par moi, mais, puisque vous êtes venu, vous serez bien venu.
Bataille de Patay
Elle voulait être à l’avant-garde, — dit M. Wallon qui a très bien peint cette journée. — On la retint malgré elle, et on y mit La Hire, mais avec l’ordre d’attaquer les Anglais assez vivement pour leur faire tourner le visage, point assez pour qu’ils tournassent le dos. On voulait, en les 107retenant à cette escarmouche, donner au gros de l’armée française le temps d’arriver, sans leur laisser à eux celui de gagner la position où ils comptaient se réunir. Mais l’impétuosité de La Hire, et sans doute aussi la terreur que Jeanne, même de loin, inspirait, déjouèrent ce calcul. Les Français tombèrent sur l’arrière-garde, des Anglais et la dispersèrent. Talbot pourtant demeurait ferme à son défilé, et Falstoff, fidèle au plan que l’on avait arrêté, faisait diligence pour aller rejoindre l’avant-garde dans ses positions, sur les derrières. Mais l’avant-garde, le voyant venir à elle, crut qu’il se retirait, et, pour ne pas perdre son avance, elle prit la fuite. Falstoff voulut se retourner alors et marcher à l’ennemi : il était trop tard. Déjà Talbot se voyait enveloppé, la panique était générale, et les Français, maîtres du champ de bataille, tuaient ou prenaient ceux qui leur tombaient sous la main. Falstoff céda enfin aux instances de ceux qui l’entouraient et s’enfuit avec peu de monde. Dans son escorte, était Wavrin, qui a fait un récit de la bataille. Il dit que les Anglais perdirent deux mille morts et deux cents prisonniers. Dunois, sans distinguer, évalue leur perte à quatre mille hommes70.
C’est la fortune de la guerre !
Talbot était parmi les prisonniers. Quand on le présenta au duc d’Alençon, le jeune chef français ne put se contenir de lui dire :
— Vous ne pensiez pas, le matin, que cela vous arriverait.
L’Anglais répondit froidement :
— C’est la fortune de la guerre.
Charité de Jeanne sur le champ de bataille
Tandis que les capitaines français se félicitaient de cette victoire, Jeanne visitait le champ de bataille, jonché de morts et de blessés. L’affreux spectacle l’émut jusqu’aux larmes. Elle fit donner des secours à tous les blessés71 et protégeait les blessés ennemis.
108IV
Conséquences de la victoire de Patay
La victoire de Patay, qui acheva la défaite des Anglais sur la Loire, était la première que les Français eussent, depuis de longues années, remportée en plaine.
Elle termine la campagne de la Loire
Elle terminait la campagne de la Loire, car le pays tout entier, qui détestait les Anglais, se souleva en masse contre eux.
Janville, où ils avaient laissé leur trésor de guerre, refusa de leur ouvrir ses portes, et les garnisons anglaises de Mont-Pipeau, de Saint-Simon et autres forteresses voisines, se hâtèrent de les évacuer, après y avoir mis le feu.
Le doigt de Dieu est là !
En huit jours, Jeanne avait pris trois villes et battu en rase campagne ces solides troupes anglaises qui, depuis longtemps, ne se connaissaient plus de rivales. Elle avait déconcerté par la sûreté de son coup d’œil des capitaines tels que Suffolk, Talbot, Falstoff. Et elle avait dix-huit ans.
Le doigt de Dieu était là. Ce n’est plus seulement le peuple qui le crie, avec ses hosannas enthousiastes, ce sont des tacticiens consommés qui s’avouent vaincus par la force surnaturelle qui est en cette fille de Dieu.
109Chapitre septième À Reims
I
Un martyre du cœur
À ce moment, commença pour Jeanne un martyre du cœur, que Dieu permettait pour garder en cette âme droite la précieuse vertu d’humilité, base de toute sainteté.
Au lieu des acclamations et des récompenses, le roi, de plus en plus subjugué par l’influence jalouse du favori, mécontent des succès de cette Pucelle inconnue, refusa d’abord de ratifier le pardon qu’elle avait accordé, en son nom, au connétable. Bien plus, sur un ton de bonté un peu 110dédaigneuse, il osa dire à l’héroïque vainqueur de Patay :
— J’ai pitié de vous. Vous vous donnez beaucoup trop de mal. Reposez-vous, je vous y engage.
Pourquoi doutez-vous ?
Moins humble, moins respectueuse de l’autorité royale, moins confiante en ses voix, Jeanne se fût révoltée. Elle endura l’injure et pleura sur l’incurable légèreté du roi.
— Pourquoi doutez-vous ? lui dit-elle en pleurant. Vous aurez votre royaume, et vous serez bientôt couronné.
Il faut aller à Reims, c’est la volonté de Dieu
De leur côté, les conseillers royaux, soit prudence humaine, soit par envie plus ou moins consciente, amoncelaient les objections72.
C’était, disait-on, s’exposer à un échec presque inévitable, que de s’engager ainsi sans précautions en plein pays ennemi, où l’on rencontrerait des villes de guerre, des châteaux-forts munis de bonnes garnisons. Était-il prudent de laisser derrière soi des places comme Bonny, Marchenoir, Cosne et La Charité ? Ne valait-il pas mieux jouir tranquillement des victoires récentes, et les compléter en chassant ce qui pouvait rester encore d’ennemis dans la vallée de la Loire ? Le roi d’ailleurs c’était la grande et sempiternelle objection n’avait pas d’argent pour payer ses troupes, et, sans argent, il ne fallait pas compter retenir beaucoup de soldats sous les drapeaux.
Jeanne laissait dire, se bornant à répondre :
— Il faut aller à Reims, c’est la volonté de Dieu !
Son jeune duc d’Alençon lui-même se tournait contre elle.
— Auparavant d’aller à Reims, disait-il, il convient d’envahir la Normandie et de marcher sur Rouen.
Dieu fit ce que les hommes refusaient de faire.
Une lettre aux habitants de Tournai
De toute part, accouraient des chevaliers et gens de guerre, équipés à leurs frais, et Jeanne, obéissant aux ordres de ses voix, conduisait d’Orléans ses troupes à Gien, où le roi lui assignait rendez-vous. Là, tandis que 111les politiques s’agitaient en de nouvelles intrigues pour entraver sa mission73, la Pucelle écrivait aux habitants de Tournai, demeurés en pleine invasion fidèles au roi, cette lettre où respire l’accent d’une inébranlable foi en sa mission et d’un patriotisme surnaturel :
✝ Jhesus ✝ Maria.
Gentils loyaux Français de la ville de Tournai, la Pucelle vous fait savoir des nouvelles de par deçà. En huit jours, elle a chassé les Anglais de toutes les places qu’ils tenaient sur la rivière de Loire, par assaut ou autrement. Il y en a eu beaucoup de tués et de pris, et elle les a déconfits en bataille (en rase campagne). Et croyez que le comte de Suffort (Suffolk), Lapoule (Pole) son frère, le sire de Tallebord (Talbot), le sire de Scallez (Scales), et messire Jean Falscof (Falstoff)74, et plusieurs chevaliers et capitaines ont été pris, et le frère du comte de Suffort et Glasdas (Glansdale) sont morts. Maintenez-vous bien, loyaux Français, je vous en prie. Je vous prie aussi et vous requiers que vous soyez tous prêts à venir au sacre du gentil roi Charles à Reims, où nous serons bientôt, et venez au devant de nous, quand vous saurez que nous approchons. À Dieu je vous recommande. Que Dieu vous garde et vous donne sa grâce, afin que vous puissiez maintenir la bonne cause du royaume de France.
Écrit à Gien, le vingt-cinquième jour du mois de juin.
112L’adresse portait :
Aux loyaux Français de la ville de Tournai.
Deux jours après, Jeanne sortait de Gien, dans la direction de Montargis. Le roi se décida enfin à la suivre, mais, hélas ! il traînait aussi après lui son Conseil.
On n’ose croire au récit des historiens, mais on est bien obligé de confesser que, par les obstacles qu’il suscita sans cesse à la mission de Jeanne, La Trémouille a rendu l’accusation possible. Il reçut, dit-on, deux mille écus d’or des habitants d’Auxerre, qui furent autorisés à tenir leurs portes fermées au passage de Charles VII. Jeanne en gémit tout haut, car, disait-elle,
on aurait eu bien aisément la ville par assaut.
Du moins, on allait en avant !
II
Autre lettre à ceux de Troyes
Charles s’était même décidé à faire plus. Il avait écrit à ceux de Reims, pour leur annoncer sa prochaine arrivée et ordonner qu’on se tînt prêt pour le sacre.
C’était le 3 juillet. Le lendemain, Jeanne écrivait de son côté aux habitants de Troyes. Ce n’était plus la menace, comme quand elle écrivit aux Anglais devant Orléans.
Le ton de cette dernière
Dans la lettre aux Anglais, — remarque le P. Ayroles, — Jésus-Christ, par le chétif instrument qu’il s’est choisi, parle en roi guerrier, résolu de chasser l’envahisseur étranger et de rétablir le vassal injustement dépossédé. C’est la menace. Le ton est tout différent dans la lettre aux habitants de Troyes et au duc de Bourgogne. Les Anglo-Bourguignons sont des sujets égarés qu’il faut ramener. Jeanne fait entendre la voix du roi pacificateur qui veut rétablir l’ordre troublé dans ses États. La menace disparaît, couverte qu’elle est par les paroles d’affection, les promesses de pardon, de victoire et de paix.
✝ Jhesus ✝ Maria.
Très chers et bons amis, s’il ne tient à vous (si cela vous agrée) : seigneurs, bourgeois et habitants de la ville de Troyes. Jeanne la Pucelle vous mande et vous fait savoir, de par le roi du ciel, son droiturier et souverain seigneur, duquel elle est un chacun jour en son service royal, que vous fassiez vraie obéissance et reconnaissance au gentil roi de France, qui sera bientôt à Reims et à Paris, qui que vienne contre, et en ses bonnes villes du saint royaume, à l’aide du roi Jésus. — Loyaux Français, venez au-devant du roi Charles, et qu’il n’y ait point de faute ; et ne vous doubtez de (ne craignez rien pour) vos corps, ni de (pour) vos biens, si ainsi le faites. — Et si ainsi ne le faites, je vous promets et certifie sur vos vies, que nous entrerons, à l’aide de Dieu, en toutes les bonnes villes qui doivent être du saint royaume, et y ferons bonne paix ferme, qui que vienne contre. Ce Dieu vous commande (recommande) : Dieu soit garde de vous. Répondez au plus tôt.
Jehanne.
Les bourgeois orgueilleux, qui tenaient la ville de Troyes au profit de l’invasion anglaise, parlant de cette lettre, écrivirent à ceux de Reims :
Cette coquarde (hâbleuse) nous a écrit. C’est une folle. Sa lettre n’a pas le sens commun. Nous en avons bien ri ; puis, nous l’avons jetée au feu, sans y faire aucune réponse.
Au fond, les vantards avaient peur, et ils espéraient, par ce ton railleur, décider le duc de Bedford à leur envoyer du secours. Mais comme, d’autre part, ils gardaient au fond du cœur l’amour de leur pays et de leur roi, ils imaginèrent de prendre un biais, pour couvrir la reddition qu’ils désiraient secrètement.
Frère Richard
Il y avait, à ce moment, dans les murs de la ville, un religieux fort populaire, ancien pèlerin de Terre-Sainte, 114dont l’éloquence familière ravissait le peuple. Frère Richard, c’était son nom, s’offrit à voir un peu par lui-même ce qu’il en était de cette Pucelle. Les bourgeois y consentirent et frère Richard vint au camp des Français.
Je ne m’envolerai pas
Or, le bon homme, qui avait fort peur, parce que, croyait-il, Jeanne pouvait fort bien être quelque suppôt de Satan, s’avançait avec crainte et jetait de l’eau bénite sur la Pucelle.
— Approchez hardiment, lui dit-elle en riant, je ne m’envolerai pas.
Le moine s’approcha et fut si content de son entretien, qu’il revint à Troyes, tout changé et fort partisan de la Pucelle. Mais, il se heurtait à forte partie. La garnison refusait de se rendre, et les jours s’écoulaient. Bien plus, la famine menaçait l’armée des assiégeants. Charles réunit son Conseil.
Un conseil découragé
Regnault de Chartres, ce même archevêque de Reims à qui revenait le droit de faire le sacre, opina le premier.
— Il faut, dit-il, lever le siège et s’en retourner sur la Loire.
Il alléguait la pénurie de vivres et d’argent, la difficulté de réduire une telle forteresse, l’insuffisance des moyens de bombardement, bref, tant et de si solides raisons que le Conseil se rangea à son avis.
L’avis du vieux conseiller
Un vieux conseiller, Robert le Maçon, essaya de faire entendre la voix du bon sens et de la foi.
— Quand le roi a entrepris ce périlleux voyage, dit-il, il ne l’a pas fait par la considération du nombre d’hommes de guerre qu’il pouvait mener avec lui, ni de l’argent qu’il pouvait avoir pour les payer, mais uniquement par l’avis de Jeanne la Pucelle, qui répétait tous les jours qu’il marchât en avant pour se faire sacrer à Reims, et qu’il ne trouverait sur son chemin que bien peu de résistance, car tel était le plaisir et la volonté de Dieu.
Le judicieux chevalier ajouta, en conclusion :
— Du reste, si Jeanne ne conseille rien de mieux que 115ce qui vient d’être dit, je me rallierai à votre avis et j’opinerai pour qu’on lève le siège.
Jeanne survient au milieu de la délibération
La discussion s’anima et on s’échauffait fort de part et d’autre, quand un coup très vif retentit à la porte de la chambre du Conseil.
C’était Jeanne, amenée là, comme toujours, au moment où l’inspiration d’en haut lui enseignait que sa présence était le plus nécessaire.
Dialogue avec l’archevêque de Reims
— Jeanne, dit Regnault de Chartres, le roi et son Conseil sont très indécis sur ce qu’il convient de faire.
Et il commença un large exposé des débats. Jeanne le laissa dire, et, sans lui répondre directement, elle s’adressa au roi :
— Serai-je crue, fit-elle, en ce que je dirai ?
— Oui, répondit le roi, selon ce que vous direz.
— Gentil sire, reprit-elle, si vous voulez cy demeurer devant votre ville de Troyes, elle sera en votre obéissance dedans (avant) deux jours, soit par force ou par amour ; et n’en faites nul doute.
— Jeanne, reprit l’archevêque, qui serait certain de l’avoir dedans six jours, on l’attendrait bien. Mais, dites-vous vrai ?
La modeste inspirée renouvela son affirmation, et l’on décida d’attendre.
La ville de Troyes se soumet au roi Charles
En sortant du Conseil, Jeanne monta à cheval. Un bâton à la main, elle court au camp, donne ses ordres et met tout le monde en mouvement. Chevaliers, écuyers, archers, artisans, menu peuple, tous travaillaient à l’envi, apportant, qui des fagots, qui des poutres, qui des tables, qui des portes descellées, qui des fenêtres, tout ce qui leur tombait sous la main. On dresse une pièce d’artillerie en bonne position. Sous les ordres de l’habile stratégiste, que le ciel dirige visiblement aux yeux de tous ces bons Français, tout se trouve prêt, comme par enchantement, le lendemain matin pour l’attaque.
Jeanne criait déjà : À l’assaut !
quand, tout à coup, 116les portes de la ville s’ouvrent, et on voit sortir l’évêque, avec les principaux d’entre les bourgeois, qui demandent à capituler.
Frère Richard et l’évêque de Troyes, profitant de la terreur que la vue de tous ces préparatifs si bien dirigés avait imprimée dans le peuple, l’emportèrent sur la rage obstinée des Anglais. Ils obtinrent une capitulation des plus honorables et la garnison put sortir, avec armes et bagages. Mais Jeanne, voyant que celle-ci emmenait les prisonniers français, s’écria :
— En nom Dieu, non, ils ne les emmèneront pas !
Charles VII, qui se croyait engagé, par sa parole, de permettre aux assiégés d’emporter leurs biens, racheta les prisonniers français75.
Le roi fit ainsi son entrée dans la ville que, la veille, il désespérait de prendre.
III
Un écho du pays natal à Châlons
Quand elle quitta la maison natale, pour voler sur les champs de bataille, l’angoisse, on s’en souvient, s’était assise à la place de Jeanne au foyer paternel. On l’y pleura d’abord beaucoup. Avoir une fille si parfaite que messire Guillaume Fronte, son curé, disait qu’elle n’avait pas sa pareille dans tout le village
, entendre chacun et les gentilshommes eux-mêmes la leur envier, et la savoir livrée aux hasards d’une guerre sans merci !… Bientôt, néanmoins, le bruit des merveilleuses victoires de leur enfant vint tempérer la désolation du logis. Jeanne avait sauvé Orléans, pris une foule de forteresses, remporté d’éclatants succès en bataille rangée, elle s’en allait à Reims, conduire 117le roi au sacre. Jacques d’Arc n’y tint plus, il avait quitté Domremy et accourait à Reims, assister au triomphe de sa fille.
Elle apprit cette nouvelle, si douce à sa piété filiale, en entrant à Châlons, qui venait de faire sa soumission spontanée au roi Charles. Là, elle rencontra des gens de Domremy, qui lui apportaient les échos du pays natal : Jean Morel, à qui elle donna, en témoignage d’amitié, un habit rouge qu’elle avait porté ; le compère Gérardin d’Épinal, converti sans doute au parti armagnac, puisque Jeanne l’avertit qu’elle ne craignait que les traîtres.
Ce fut un doux rayon de printemps dans la mêlée ardente. Ses voix la pressaient et on partit pour Reims.
Rage des Anglais
Les Anglais frémissaient de rage. Bedford dégradait Falstoff dans sa colère, impuissante à entraver la marche triomphante d’une jeune fille sans lettres, sans éducation militaire, sans ressources que son indomptable vouloir.
C’est le diable !
Oh ! tout cela ne s’expliquait point humainement, et, tandis que nos modernes rationalistes se tueront à trouver une explication naturelle à cette série de miracles surhumains, l’Anglais ne s’y méprend point, lui. Seulement, quand les soldats découragés qui se débandent proclament que le doigt de Dieu est là, Bedford, préludant aux calomnies des futurs bourreaux de la Pucelle qui prirent le mot d’ordre auprès de lui, leur répond qu’il faut rapporter les prodiges à l’intervention du démon. C’est ce qu’il essayait de persuader aux gens de Reims, afin d’empêcher la ville du sacre de couronner le roi victorieux. Ceux-ci, craignant qu’on leur imposât des garnisons nouvelles et secrètement acquis à la cause de Charles, usèrent de ruse, et réussirent à endormir la crainte du régent d’Henri VI.
En vain, Pierre Cauchon — c’est la première fois que l’on entend retentir le nom si justement honni du prélat traître à sa patrie et aveuglé par une ambition brutale — en vain ce triste évêque de Beauvais vient en ambassade, au nom des Anglais, encourager les Rémois à repousser le dauphin 118et seconder les efforts de ses bons amis les envahisseurs du sol français, assurant, quant au fait de la Pucelle,
que c’était la plus simple chose qu’il vît oncques ; et qu’en son fait n’avait ni rime ni raison, non plus qu’en le plus sot qu’il vît oncques76.
Entrée solennelle à Reims
Les habitants de Reims recevaient en même temps un autre message, celui-là émané de leur pasteur légitime, l’archevêque Regnault, annonçant la bonne nouvelle.
Le roi Charles était arrivé à Septsaulx, à peine distant de quatre lieues de la ville. Aussitôt, les notables partirent en députation. Charles VII les reçut avec cette affabilité royale qui lui gagnait les cœurs, il promit amnistie et, le jour même, 16 juillet 1429, il fit son entrée à Reims.
L’archevêque, qui l’y avait précédé, vint à sa rencontre, à la tête des bourgeois et des corps de métiers. Le peuple criait : Noël ! Noël. Les prédictions de Jeanne s’accomplissaient toutes, l’une après l’autre77.
IV
Préparatifs hâtés
Le temps pressait. On voulait accomplir l’auguste cérémonie du sacre royal dès le lendemain 17, qui était un dimanche. Il ne restait donc pas une minute à perdre. Le reste de la journée et la nuit furent employés aux préparatifs.
Tout manquait. Ainsi, les vêtements royaux, en dépôt à Saint-Denis, durent être remplacés en hâte par d’autres ornements que les dames rémoises confectionnaient avec un patriotique enthousiasme. Chacun rivalisait de zèle, si 119bien, disent les chroniques contemporaines, que la cérémonie fut aussi magnifique que si l’on avait mis une année entière à la préparer.
Un nouveau maréchal de France
Il n’y avait qu’un maréchal de France, Boussac, le roi en créa un second, de Rais. Avec Graville, le chef des arbalétriers, et l’amiral de France, Culan, les deux maréchaux se dirigèrent vers l’abbaye de Saint-Remi.
La Sainte Ampoule à l’abbaye de Saint-Remi
C’est là que reposait, sous la garde de l’abbé et de ses religieux, l’Ampoule mystérieuse, qui recelait l’huile sainte avec laquelle on consacrait les rois. Les grands dignitaires — ainsi le voulait le cérémonial traditionnel — jurèrent d’escorter et de ramener l’auguste dépôt à l’abbaye.
On la transporte processionnellement à Notre-Dame
L’abbé prit alors la Sainte-Ampoule entre ses mains et la porta sous le dais jusque sous le porche de l’église Saint-Remi, où l’archevêque de Reims, revêtu de tous ses ornements pontificaux, crosse en main et mitre en tête, accompagné de tous ses chanoines, l’attendait, pour la porter processionnellement à Notre-Dame de Reims, suivi des seigneurs de l’escorte. Ceux-ci, fidèles au serment juré, et conformément à la tradition, pénétrèrent à sa suite, sans descendre de cheval, bannières en mains, jusqu’au chœur, où se terminait leur première mission d’accompagnateur.
Les douze pairs du royaume
Il aurait fallu, d’après l’antique règle, les douze pairs du royaume. Mais, on ne pouvait ni les réunir tous, ni les attendre. Les principaux seigneurs présents et les évêques de l’escorte royale suppléèrent aux absents, en cet ordre :
Pairs laïques : le duc d’Alençon (qui fit le roi chevalier), remplaçant le duc de Bourgogne passé au parti des Anglais ; les comtes de Clermont et de Vendôme ; les sires de Laval, de La Trémouille et de Beaumanoir.
Pairs ecclésiastiques : l’archevêque de Reims, l’évêque de Laon et l’évêque de Châlons, tous trois en vertu de leur titre ; les évêques de Séez, d’Orléans et un sixième dont le nom s’est perdu, au nom des autres titulaires.
L’archevêque de Reims devait officier et le sire d’Albret tiendrait l’épée devant le roi.
La place de Jeanne au sacre
120Et Jeanne, où sera sa place ? Le peuple s’en enquérait, car
tous les regards étaient pour la Pucelle.
Il fut réglé que, durant toute la cérémonie, elle se tiendrait auprès du roi, son étendard à la main.
L’étendard à l’honneur
Les bourreaux le lui reprocheront un jour, attribuant à orgueil le déploiement de cette bannière.
— Elle avait été à la peine, répondra simplement l’héroïque libératrice de la France, c’était bien raison qu’elle fût à l’honneur.
Parole sublime dans sa simplicité, qui retentit encore comme un clairon de victoire et de patriotisme dans toute âme française.
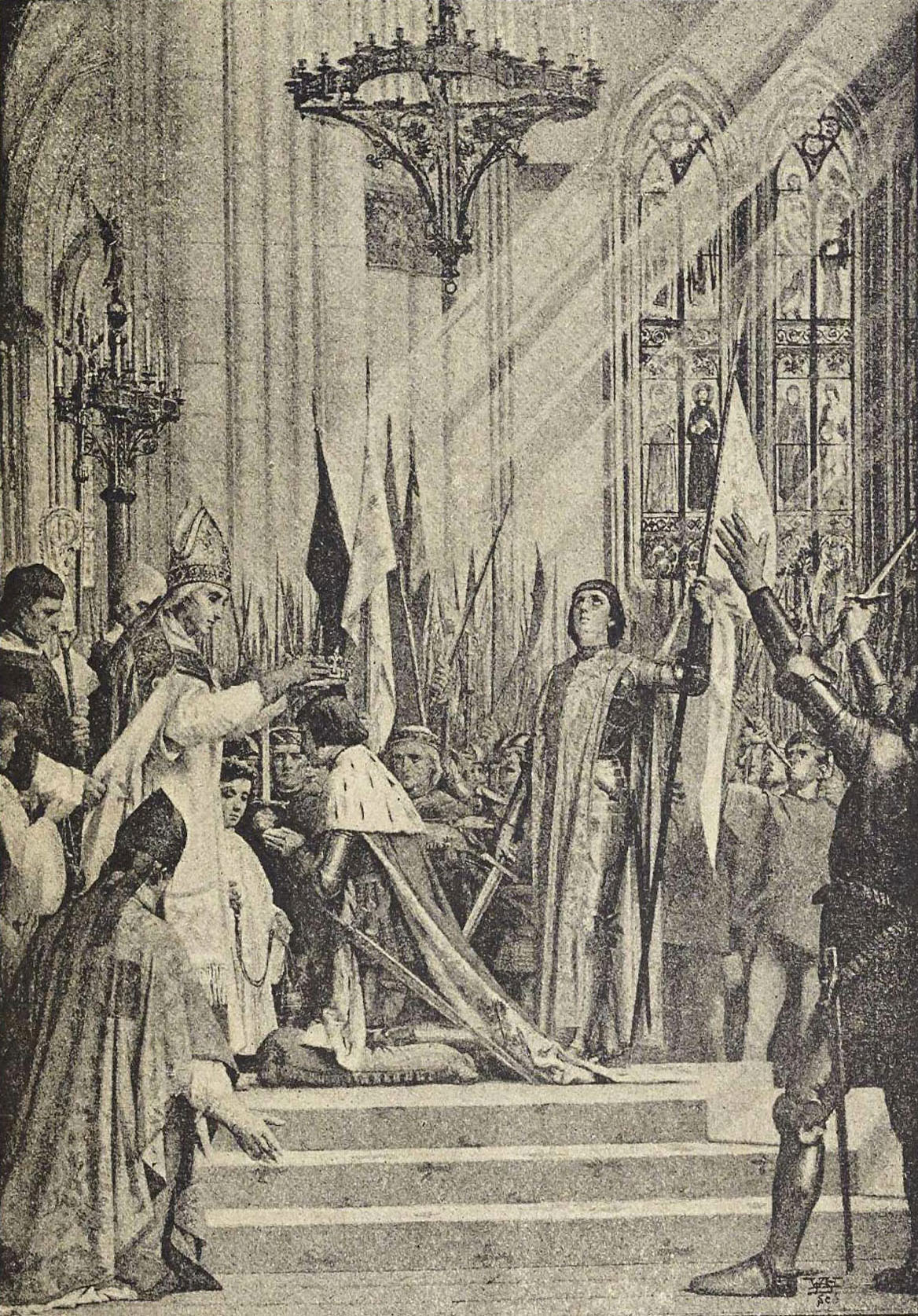
V
Le serment du roi
Lorsque Jeanne, son étendard à la main, tous les yeux tournés vers elle, fut placée près de l’autel, Charles entra, précédé de ses grands officiers, et se mit à genoux devant cet autel. L’archevêque s’approcha à la tête de son clergé et dit :
Nous te requérons de nous octroyer que, à nous et aux églises à nous commises, conserves le privilège canonique, loy et justice due ; nous gardes et deffendes comme roy est tenu en son royaulme à chascun évesque et à l’Église à lui commise.
Charles VII répond :
Je, par la Grâce de Dieu, prouchain d’être ordonné roy de France, promets au jour de mon sacre, devant Dieu et ses saincts, que je conserveray le privilège canonique, loy et justice à chacun de vous, prélats, et vous deffendray tant que je pourray, Dieu aydant, comme ung roy doibt par droit deffendre en son royaulme chascun évesque, et l’Église à luy commise. Je promets, au nom de Jhésus-Xhrist, au peuple Xhrestpien à moy subject, ces choses : 121premièrement que tout le peuple Xhrestpien, je garderay à l’Église, et tous temps la vraye paix, par vostre advis. Item, que je le deffendray de toutes rapines et iniquités de tous degrés. Item, que en tous jugemens je commanderay équité et miséricorde, affin que Dieu clément et miséricordieux m’octroye et à vous sa miséricorde. Item que de bonne foy je travailleray de mon pouvoir męctre, hors de ma terre et juridiction à moy commise, tous les hérectiques déclarés par l’Église. Toutes choses dessus dictes je confirme par serment.
Le consentement du peuple
Dès que ce serment fut prononcé, des pairs, tenant la couronne, se tournèrent, selon l’usage, vers le peuple, pour demander son consentement. Il fut donné par acclamation, au milieu de l’émotion de tous.
Cet épisode du cérémonial avait une haute signification. C’est l’élection à l’origine et ensuite la naissance qui faisaient nos rois. Voilà ce que rappelait l’incident toujours saisissant du sacre. Mais, le roi proclamé, Jésus-Christ, par le sacre, venait à lui, le couvrait de son ombre, lui conférait une particulière majesté. Le droit de l’élection avait fait le souverain, et l’Église le consacrait.
Une page de Lacordaire
Or, a dit, dans son magnifique langage, le P. Lacordaire,
la conséquence de l’onction de l’Église, c’est que le prince, aux yeux des peuples, devenait le mandataire de Jésus-Christ ; on n’obéissait plus seulement à l’homme, mais à Jésus-Christ lui-même, présent et vivant dans celui que l’huile sainte avait touché… La vénération se joignait à l’obéissance ; le respect et l’amour allaient le chercher naturellement. Le peuple pardonnait des fautes au prince, comme l’enfant pardonne des faiblesses à son père. Le souverain avait foi dans son peuple, et le peuple avait foi dans son souverain. Ils croyaient l’un à l’autre ; ils s’étaient donné la main, non pour un jour, mais devant Dieu et pour tous les siècles, au nom des morts et des vivants, au nom des ancêtres et de la postérité. Le prince descendait tranquille dans la tombe, laissant ses enfants à la garde de 122son peuple, et le peuple, les voyant petits et sans force, les gardait en attendant d’être gardé par eux78.
Noël ! Noël !
Le peuple de Reims savait ces choses, comme Jeanne les savait et d’une science éclairée chez elle par une lumière divine qui lui montrait le salut de la France dans l’onction sainte du dauphin.
Aussi, lorsque, après cette onction, la couronne fut placée sur la tête désormais consacrée de Charles, une émotion puissante courut tout le long de la basilique, et un grand cri s’éleva de toute part, dans l’église :
— Noël ! Noël !…
C’était le vieux cri de l’allégresse française, le cri de l’amour, le cri de la foi.
En même temps, les trompettes sonnèrent, avec une telle puissance, que l’on put croire, dit un historien, que les hautes voûtes de la basilique allaient se fendre.
Commencée à neuf heures du matin, la cérémonie se terminait à deux heures d’après-midi. Elle avait duré cinq heures.
Depuis le sacre de Clovis
Depuis le sacre de Clovis, aucun n’a laissé dans l’histoire un tel ressentiment. Il y a eu, à Reims, des sacres plus somptueux, il n’y en eut jamais de plus émouvant.
Conclusion émouvante de la cérémonie
Mais l’émotion fut à son comble, quand Jeanne, jusque là debout à côté de son roi, la bannière en mains, confia son étendard à un seigneur, et, s’avançant devant le roi couronné, se jette à ses pieds, les baise avec un indicible transport, embrasse ses genoux, et, pleurant à chaudes larmes, s’écrie, à travers ses pleurs triomphants, cessant de l’appeler dauphin, pour lui donner maintenant un titre royal :
— Gentil roi, ores est exécuté le plaisir de Dieu, qui 123voulait que vinssiez à Reims recevoir votre digne sacre, en montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume doit appartenir.
Elle pleurait en disant ces choses, la noble et sainte Pucelle, et tous les seigneurs qui étaient là pleuraient comme elle.
Le père de Jeanne d’Arc
Dans un angle de la basilique, un homme pleurait aussi qui s’en allait bientôt retourner au village lointain, emportant des récits qui consoleront la veillée pendant de longs mois. C’était Jacques d’Arc, le père de Jeanne.
Il eût bien voulu ramener sa fille à Domremy. Dieu en avait ordonné autrement.
124Chapitre huitième Devant Paris
I
Si la mission de Jeanne finit à Reims
Une légende, étayée sur un passage mal compris des dépositions de Dunois, et qui a longtemps prévalu dans l’enseignement officiel de l’histoire en France, veut que Jeanne ait déclaré sa mission finie à Reims, et qu’elle ne se soit décidée à continuer la guerre contre les Anglais que sur les instances de Charles VII et en manquant ainsi aux ordres reçus d’en haut.
Paroles mélancoliques de Jeanne à l’archevêque de Reims
Or, Dunois a raconté qu’un jour, peu après le sacre, 125Jeanne chevauchait, à la suite du roi, entre lui et l’archevêque de Reims. En entendant les joyeux : Noël ! Noël ! du peuple, elle dit à l’archevêque :
— Voilà un bon peuple, et je n’ai jamais vu peuple qui se réjouît tant de l’arrivée d’un si noble prince. Ah ! que je voudrais être assez heureuse pour finir mes jours et être ensevelie en cette terre !
— Oh ! reprit le prélat frappé du ton de tristesse qui accompagnait l’expression de ce vœu, Jeanne, en quel lieu croyez-vous mourir ?
— Où il plaira à Dieu, répondit la pieuse héroïne, car je ne suis assurée, ni du temps, ni du lieu, plus que vous-même. Mais, je voudrais qu’il plût à Dieu, mon créateur, que je m’en retournasse maintenant, quittant les armes, et que je revinsse servir mon père et ma mère à garder leurs troupeaux avec ma sœur et mes frères, qui seraient bien aises de me voir !
Les considérants du P. Ayroles
Là-dessus, on a bâti une légende, qui doit disparaître des grandes et des petites histoires79.
126Non, il n’est pas vrai que la mission de Jeanne ait pris fin à Reims. Ses lettres, ses réponses à Rouen protestent contre une donnée qui ne doit plus trouver place dans son histoire. La France pensait comme la Pucelle, nous l’allons constater à chaque pas dans la suite de ce récit.
127II
En faveur du village natal
Jacques d’Arc était reparti pour Domremy, après avoir embrassé une dernière fois cette fille tant aimée et si grande, qu’il ne devait plus revoir. Il rapportait aux gens du pays la bonne nouvelle d’une requête octroyée par le roi à Jeanne, après le sacre.
— Sire, avait dit la libératrice du royaume, j’ai une grâce à vous demander. C’est que vous usiez de votre prérogative, pour exempter d’impôts le village où je suis née.
Et le roi l’avait gracieusement accordé.
Culte de la Pucelle parmi les contemporains et réponse qu’y fait son humilité
À Domremy, comme partout, le nom de Jeanne fut acclamé. Partout, on demandait son image, on plaçait sa statue dans les églises, on portait des médailles à son effigie, on la nommait au saint sacrifice de la messe. L’humble fille de Dieu souffrait de tous ces honneurs, elle craignait de perdre l’humilité.
— En vérité, disait-elle dans son aimable candeur, je ne m’en saurais garder, si Dieu ne m’en gardait lui-même.
De toute part, on consultait
la très honorée et très dévote Pucelle Jeanne, envoyée du roi des cieux pour la réparation et extirpation des Anglais tyrannisant la France.
La poétesse française, sur le seuil de la tombe, Christine de Pisan, le 31 juillet 1429, retrouvait la verve de sa jeunesse poétique pour chanter l’héroïne, guide d’Israël comme Josué ; sauveur du peuple de Dieu comme Gédéon ; libératrice de son peuple comme Esther ; la vaillante, qui se leva comme Débora ; la sainte, qui sortit au devant de l’ennemi et le mit à mort comme Judith.
Jeanne, au milieu de ces hosanna, demeurait humble et douce. Entrevoyait-elle déjà, au milieu des splendeurs de Reims, le bûcher de Rouen ? Nous le croyons. En tout cas, elle demeurait de plus en plus certaine qu’elle ne durerait guère et qu’il fallait se hâter.
128Pour cela, il faut entrer bientôt dans Paris !
Elle écrit au duc de Bourgogne
Elle songea d’abord, comme toujours, à épuiser les moyens de persuasion.
Dans ce but, elle voulut essayer de gagner le duc de Bourgogne à la cause royale, en réconciliant Philippe le Bon avec Charles VII. C’était le jour même du sacre, le 17 juillet. Elle dicta la touchante lettre qu’on va lire :
✝ Jésus, + Marie,
Haut et redouté prince, duc de Bourgogne, Jeanne la Pucelle vous requiert de par le roi du ciel, mon droiturier et souverain seigneur, que le roi de France et vous, vous fassiez bonne paix ferme, qui dure longtemps. Pardonnez-vous l’un à l’autre, de bon cœur entièrement, ainsi que doivent faire loyaux chrétiens ; et, s’il vous plaît de guerroyer, allez contre les Sarrasins. Prince de Bourgogne, je vous prie, supplie et requiers aussi humblement que requérir vous puis, que vous ne guerroyiez plus au saint royaume de France. Faites retirer promptement et sans tarder vos gens qui occupent plusieurs places et forteresses de ce saint royaume. Pour ce qui est du gentil roi de France, il est prêt à conclure la paix avec vous, sauf son honneur, et il ne tient qu’à vous de la faire. Et je vous fais savoir, de par le roi du ciel, mon droiturier et souverain seigneur, pour votre bien, pour votre honneur et sur votre vie, que vous ne gagnerez point bataille contre les loyaux Français, et que tous ceux qui guerroient contre le saint royaume de France guerroient contre le roi Jésus, roi du ciel et de tout le monde, mon droiturier et souverain seigneur. Et je vous prie et requiers à mains jointes que vous ne fassiez aucune bataille et ne guerroyiez contre nous, vous, ni vos gens, ou vos sujets, et croyez sûrement que, quelque nombre de gens que vous armeriez contre nous, ils n’y gagneront pas, et il y aura grande pitié de la grande bataille et du sang qui y sera répandu de ceux qui viendront 129contre nous. Il y a trois semaines je vous avais écrit et envoyé bonnes lettres par un héraut, pour vous prier de vous trouver au sacre du roi, qui, aujourd’hui dimanche, dix-septième jour de ce présent mois de juillet se fait en la cité de Reims ; mais je n’en ai pas eu de réponse, et n’ai même plus eu des nouvelles du héraut. Je vous recommande à Dieu, qu’il vous garde, s’il lui plaît. Je prie Dieu qu’il mette bonne paix entre vous et le roi de France. — Écrit au dit lieu de Reims, le dix-septième jour de juillet.
Quelle noble et sainte fierté en cette humble fille, qui parle ès nom de son droiturier Seigneur, Jésus-Christ ; vrai roi de France ! quel amour pour le roi consacré de par la volonté du Seigneur ! Et, en même temps, quelle charité pour le vassal qu’elle cherche à ramener au devoir, envers son suzerain !
Comme la lettre à Philippe le Bon diffère pour le ton et l’accent des lettres qu’elle avait écrites aux Anglais avant de les combattre ! Les Anglais sont des ennemis : elle les somme de partir, sans autre alternative que d’être mis dehors : car c’est pour cela qu’elle est envoyée. Le duc de Bourgogne est de sang royal ; c’est un fils égaré de la France ; elle le supplie, elle le conjure
à mains jointesde faire la paix, ne craignant pas de se faire trop humble ; car une chose la relève dans cet abaissement et donne une singulière autorité à ses prières : c’est qu’elle sait, c’est qu’elle affirme que, s’il refuse, il ne peut être que vaincu. Elle le prie donc, non par aucun intérêt de parti, mais parce que sera grande pitié de la grande bataille et du sang qui y sera répandu ; car c’est le sang de la France. [Henri Wallon, Jeanne d’Arc, 1860, t. I, p. 150.]
Comment elle déplore la trêve que Charles VII conclut avec lui
Mais, encore, faut-il que cette paix soit franche, bonne loyale, et non feinte comme celle dont elle démêla les mensonges à l’encontre des politiciens, qui se servaient des prétendues avances de Philippe le Bon pour arrêter la marche du roi sur Paris. Une trêve fut même conclue, 130trêve dont Jeanne écrivit aux bons et loyaux Français habitant en la ville de Reims.
Sa lettre aux habitants de Reims
Mes chers et bons amis, les bons loyaux Français de la cité de Reims, Jeanne la Pucelle vous fait savoir de ses nouvelles, et vous prie et vous requiert que vous ne fassiez nul doute en la bonne querelle (cause) qu’elle mène pour le sang royal, et je vous promets et certifie que je ne vous abandonnerai point tant que je vivrai. Il est vrai que le roi a conclu avec le duc de Bourgogne une trêve de quinze jours, au bout de laquelle le duc doit rendre Paris au roi sans coup férir. Ne vous étonnez donc pas si je n’y entre pas plus tôt. De cette trêve qui a été faite, je ne suis pas contente et je ne sais pas si je la tiendrai. Si je la tiens, ce sera seulement pour l’honneur du roi. Mais, certainement, ils n’abuseront le sang royal, car je tiendrai et maintiendrai ensemble l’armée du roi pour être toute prête à l’expiration de ces quinze jours, s’ils ne font la paix. Pour ce, mes très chers et parfaits amis, je vous prie que vous ne vous tourmentiez pas, tant que je vivrai, mais je vous requiers que vous fassiez bon guet et gardiez bien la bonne cité du roi. Faites-moi savoir s’il y a aucuns traiteurs qui vous veuillent grever et, au plus bref délai que je pourrai, je les en ôterai ; et me faites savoir de vos nouvelles. — Je vous recommande à Dieu, qu’il vous garde. — Écrit ce vendredi cinquième jour d’août, en un logis aux champs, sur le chemin de Paris.
III
Nous voici au point le plus délicat de cette histoire
Nous abordons l’épisode peut-être le plus délicat de la vie de Jeanne.
C’est le point sur lequel la libre pensée a le plus insisté, 131prétendant y trouver un argument péremptoire contre le caractère surnaturel de la mission de la Pucelle.
Si Jeanne a mal prophétisé sur Paris et la sortie des Anglais du royaume
Elle a fait, disent nos adversaires, des prophéties qui ne se sont pas réalisées : par exemple, qu’elle mènerait le roi à Paris, qu’elle bouterait les Anglais hors de toute France.
Gerson a répondu d’avance par son traité de Puella, daté du 14 mai 1429, six jours après la délivrance d’Orléans. On ne peut pas supposer que le célèbre théologien ait été influencé par les événements, puisque, quand il est mort, Jeanne touchait à l’apogée de son triomphe.
Gerson prévoit cependant que l’ingratitude et les iniquités du parti national peuvent arrêter le cours des promesses divines ; il enseigne que cela ne prouvera rien contre le caractère surnaturel des faveurs déjà accordées ; et il supplie instamment ses concitoyens de ne pas être cause que le bon vouloir divin soit frustré de la plénitude de son effet. C’est la conclusion, presque l’idée dominante, de son écrit.
Jeanne savait et annonçait que sa mission pouvait être entravée ; et dans cette hypothèse elle prophétisait encore.
C’est le grave Thomassin qui nous l’apprend. La Pucelle certifiait que, si elle devait
mourir avant que ce pourquoi Dieu l’avait envoyée fût accompli, après sa mort elle nuirait plus aux Anglais qu’elle n’aurait fait en sa vie, et que, nonobstant sa mort, tout ce pourquoi elle était venue s’accomplirait ; ainsi que a été fait par grâce de Dieu, comme clairement et évidemment il est appert (manifeste), et est chose notoire de notre temps.
Ce que la libre pensée donne comme une objection péremptoire devient une preuve nouvelle. Non seulement la Pucelle annonçait ce qui arriverait, si elle trouvait dans la nation la coopération matérielle et morale, qui est la loi ordinaire des interventions les plus surnaturelles ; elle prophétisait encore ce qui arriverait, au cas où cette coopération lui serait prêtée d’une manière insuffisante.
132Le P. Ayroles80, à qui nous empruntons cette défense de la sainte Pucelle, insiste sur le point de l’échec momentané qu’il plaira à Dieu de faire rencontrer à Jeanne sous les murs de Paris. Cet échec, comme nous l’allons voir, est uniquement le fait de l’intrigue humaine, se mettant en travers de la mission divine de la libératrice, que les conseillers du roi payèrent ainsi des services rendus à la cause royale. Mais, si elle connut cet échec, elle n’en persista pas moins dans le fond d’une prophétie et dont elle connaissait la pleine étendue. Elle la répéta avec le courage des anciens prophètes, devant ceux qu’elle faisait trembler, c’est la totale expulsion des Anglais, et avant sept ans un grand échec pour leur cause, c’est-à-dire la perte de Paris.
Le 1er mars, on venait de lui lire la menaçante lettre par laquelle, deux ans auparavant, elle avait signifié aux envahisseurs d’avoir à lever le siège d’Orléans, et d’évacuer toute France. Voici, d’après le procès-verbal, le dialogue qui s’engagea :
— Reconnaissez-vous cette lettre ?
— Oui, elle est de moi.
— N’est-ce pas un seigneur de votre parti qui l’a dictée ?
— C’est moi qui l’ai dictée et non pas un seigneur de mon parti.
Et sur-le-champ elle complète sa missive par ces foudroyantes explications :
— Avant qu’il soit sept ans, les Anglais subiront un échec autrement grand que celui d’Orléans ; ils finiront par tout perdre en France. Ils éprouveront en France des défaites qu’ils n’y ont pas encore éprouvées. Dieu donnera grande victoire aux Français.
— Comment le savez-vous ?
— Par la révélation qui m’en a été faite : ce sera avant sept ans ; je serais bien peinée que ce fût différé jusqu’à sept ans : mais je suis aussi certaine que cela arrivera que je le suis que vous êtes devant moi.
— Quand cela arrivera-t-il ?
— J’ignore le jour et l’heure.
Elle y revenait encore d’elle-même dans l’interrogatoire du 17 mars. On lui avait demandé si Dieu hait les Anglais, 133elle répond :
— De l’amour ou de la haine que Dieu porte aux Anglais, de ce qu’il fait de leurs âmes, je n’en sais rien ; mais ce que je sais bien, c’est qu’ils seront boutés hors de toute France, excepté ceux qui y mourront. Dieu enverra contre eux victoire aux Français.
Moins de six ans après, le 14 avril 1436, l’échec plus grand que celui d’Orléans était subi. Paris, anglais pendant seize ans, redevenait français. En 1453, à l’exception de Calais, les Anglais avaient tout perdu en France, même Bordeaux et la Guyenne, où leur domination était établie et acceptée depuis trois siècles.
Mais reprenons notre récit.
IV
Les villes se soumettent sur le passage du roi
En attendant que le duc de Bourgogne voulût bien tenir sa promesse de rendre Paris au roi Charles, l’armée française s’en retournait vers la Loire.
Bedford, à qui cette reculade rendait du courage, venait de recevoir du renfort d’Angleterre. Les nouveaux arrivants déployaient une bannière insolente, où l’on voyait sur fond blanc une quenouille, avec cette devise : Qu’elle vienne la belle ! signifiant qu’on lui donnerait du fil à retordre.
Forfanteries de Bedford
En même temps, Bedford écrivait
à Charles, qui se disait dauphin et qui maintenant ose se dire roi, [lui reprochant d’entreprendre] tortionnairement [contre les droits du roi Henri] naturel et droiturier roi de France et d’Angleterre, [et de s’aider, pour cela], d’une femme désordonnée et diffamée, étant en habits d’homme et de gouvernement dissolu, abominable à Dieu.
Toutes ces forfanteries n’aboutirent, pour le moment, qu’à un refus obstiné, de la part des Anglais, à accepter la bataille en plaine que Jeanne leur alla offrir, le 15 août, 134sans pouvoir les décider à quitter le camp où ils demeurèrent prudemment retranchés, auprès de Senlis.
Les villes cependant revenaient toutes à Charles VII, sans que rien pût empêcher ce mouvement de retour au roi légitime. Compiègne accueillait ses hérauts avec enthousiasme.
Soumission de Beauvais malgré son comte-évêque
Beauvais, apercevant le maître d’armes du roi, poussa un immense vivat, courut à la cathédrale chanter le Te Deum malgré son comte-évêque, ce triste Pierre Cauchon, vendu aux Anglais, qui frémissait de rage. On lui répondit, avec une générosité bien française, que tous ceux qui ne voudraient pas se soumettre au roi pouvaient s’en aller et emporter leurs biens. Cauchon profita de la permission, mais, il ne pouvait emporter sa seigneurie ni son évêché. Il emporta du moins sa haine. Nous la retrouverons plus tard.
Nouvelle trêve
Pendant ce temps, les quinze jours de la trêve, dont Jeanne s’était déclarée si mal contente étaient expirés, et le duc de Bourgogne ne voulait ou ne pouvait pas rendre Paris. Il fut question de conclure une seconde trêve, celle-là se prolongeant jusqu’à Noël.
Initiative qu’elle inspire à la Pucelle
Jeanne, obéissant à sa patriotique indignation, s’en vint trouver Alençon.
— Mon beau duc, lui dit-elle, faites appareiller vos gens, et ceux des autres capitaines ; je veux aller voir Paris de plus près que je ne l’ai vu.
Résistance de Charles VII
Le 23 août, elle partait, entraînant, malgré lui, le roi qui, cependant, s’arrêtait à Senlis, sourd à tous les appels.
Alençon vint, à deux reprises, l’y relancer, et ne parvint à l’emmener à Saint-Denis que le mercredi 7 septembre,
et semblait, dit l’historien du duc, qu’il (le roi) fût conseillé au contraire du vouloir de la Pucelle, du duc d’Alençon et de ceux de leur compagnie.
Menées au sein de la capitale
Les partisans des Anglais profitèrent de tous ces délais, pour répandre dans Paris des bruits capables de terroriser les habitants de la capitale. On y disait que
le prétendu roi avait promis d’abandonner à ses gens Paris tout entier, 135hommes et femmes, grands et petits, et que son intention était de passer la charrue sur la ville.
Malgré ses manœuvres, on pouvait compter sur de secrètes intelligences dans la place, où chacun restait bien persuadé que Jeanne
mettrait le roi dans Paris, si à lui ne tient !
Hélas ! à lui ne devait tenir d’y entrer.
L’attaque de Paris
Ce fut le jour de la Nativité, 8 septembre 1429, la première date qui sonna comme un prélude de glas funèbre dans l’histoire de Jeanne. Elle vint avec Alençon, Clermont, Vendôme, Laval, Rais, Boussac. Elle approuvait leur décision ; elle trouvait, ce sont ses propres paroles, que
les gentilshommes de France faisaient leur devoir, en marchant contre leurs adversaires.
Mais, cette attaque, c’est encore elle qui l’a dit, ne lui était pas commandée par ses voix
. Elle y allait de tout son cœur, avec une pleine conviction, qui prenait sa source dans son patriotisme et dans son génie militaire ; mais, encore une fois, elle n’y allait pas par l’ordre d’en haut. Ses conseils
qui, comme on peut l’induire du langage mélancolique tenu par elle à Crépy, préparaient son âme au tourment et au martyre, en la laissant parfois dans le doute, en l’abandonnant davantage à sa propre inspiration, en la livrant, en un mot, à la contrariété et à la malice des hommes et des choses, ne lui avaient promis pour ce jour-là aucune victoire. Dieu, dans ses desseins éternels, que les historiens et les philosophes ne sauront jamais comprendre ni expliquer à fond, avait décidé qu’il laissait Jeanne faire en ce jour le premier pas dans la voie de mort, qu’elle subirait son premier revers81.
Le fossé plein d’eau
Le premier corps s’avança avec impétuosité vers la porte Saint-Honoré, il força la première barrière, enleva le boulevard qui protégeait la porte. À ce moment, la Pucelle, l’étendard à la main, se jeta avec les plus braves dans les fossés, malgré le feu nourri des assiégés qui les criblaient de traits et de projectiles.
136Le premier fossé fut bientôt franchi, et déjà l’on s’élançait sur le dos d’âne qui le séparait du second, quand un obstacle inattendu arrêta net l’élan de Jeanne. Ce second fossé profond était rempli d’eau. Bien des chefs de l’armée française connaissaient ce détail. Par un sentiment de basse jalousie ou tout autre motif peu avouable, ils s’étaient gardés de le révéler, avant l’attaque de Paris.
Jeanne est blessée sous les murs de Paris
Cependant Jeanne courait le long de ce second fossé, le sondant avec la hampe de son étendard, pour trouver un gué. Le jour baissait. À ce moment, un trait d’arbalète vint blesser Jeanne à la jambe. Sa blessure ne l’arrêta point, elle continuait de faire combler le fossé par ses hommes et se disposait à escalader les murs, quand le duc d’Alençon vint la prendre de force et la mit à cheval pour la ramener au camp.
La vaillante héroïne protestait, assurant que, si l’on eût persévéré, la place était prise, et, de fait, on apprit le lendemain qu’une effroyable panique aurait livré, presque sans coup férir, Paris, à l’armée du roi, si un assaut fût venu donner courage aux partisans de Charles dans sa capitale terrorisée.
Le roi ordonne la retraite
Le lendemain, c’était trop tard. En vain, Jeanne, à peine reposée par une nuit d’insomnie et mal remise de sa blessure, se levait et entraînait les siens à recommencer l’attaque. Un ordre formel du roi vint l’arrêter et la ramena à Saint-Denis. On voulut recommencer l’attaque par un point, et le duc d’Alençon venait même pour cela de faire jeter un pont sur la Seine, à Saint-Denis. Pendant la nuit, le roi fit détruire le pont.
Douleurs de Jeanne
Jeanne, désolée, vint pleurer et prier dans l’église abbatiale.
Son offrande à Saint-Denis
Elle y déposa ses armes aux pieds de Marie et de la châsse du saint patron de France, en hommage à celui qu’on invoquait dans les batailles, pour ce que c’est le cry de France, disait-elle82. Puis, muette, la mort dans 137l’âme, tandis que ses voix lui commandaient jusqu’alors, comme elle le déclare, de demeurer à Saint-Denis, elle en reçut tout à coup licence de partir et de suivre le roi dans sa triste retraite. L’armée royale fut de retour à Gien, le 21 septembre.
Il fallait une martyre
On a beaucoup discuté sur cet échec et sur cette retraite. Nous venons d’en expliquer le vrai caractère, rien qu’en racontant les événements tels qu’ils s’accomplirent, avec leurs responsabilités et leurs tristesses.
Il reste quelque chose à dire cependant, que le procès de canonisation de Jeanne mettra dans tout son jour, et qui n’a point été dit encore.
La souffrance est le sceau des œuvres de Dieu. Rien de grand, rien de divin ne s’est accompli ici-bas sans l’holocauste. Or, Dieu voulait le salut de la France, et la France avait failli devant lui. Autrefois, lorsque l’humanité entière demeurait criminelle en présence du juge suprême, il fallut qu’un Dieu lui-même souffrît et mourût pour la racheter. Maintenant, la France va recouvrer son auguste mission dans le monde, mais, il faut un sang virginal pour laver ses crimes et la rendre capable d’accomplir de nouveau les gestes de Dieu par les Francs
dans l’Église. Voilà pourquoi, ô Jeanne, tu as dû connaître l’épreuve, l’humiliation et la tristesse qu’on ne console pas. Il fallait une martyre pour ton pays, c’est toi que Messire a choisie !…
138Chapitre neuvième Derniers combats
I
Un trophée sacrilège
Furieux de leurs longues humiliations, les envahisseurs se précipitèrent, comme à une curée inattendue, sur les trésors que le roi Charles, obéissant aux conseils timides de son favori La Trémouille dont la politique était toujours hostile à Jeanne, abandonnait à ses ennemis.
Nous disons les trésors, nul peut-être ne s’en souciait dans le cortège royal — c’était si peu de chose, en vérité ! — mais les Anglais ne s’y trompèrent point. On les vit courir à Saint-Denis, dès qu’ils furent assurés par leurs espions que l’héroïque Pucelle avait suivi son roi dans la retraite royale. Pénétrant aussitôt dans la basilique, sans souci du sacrilège, avec des cris de haine triomphante, ils enlevèrent les armes que la pieuse enfant avait suspendues aux murs de Saint-Denis, c’était leur trophée. Ils l’emportèrent dans Paris, dans ce 139Paris qu’ils avaient failli perdre et que le roi de France semblait délaisser entre leurs mains.
Le duc d’Alençon éloigné de la Pucelle
Le Conseil du roi, La Trémouille, Gaucourt et aussi, hélas ! le chancelier de France Regnault de Chartres, archevêque de Reims — plus chancelier qu’archevêque —
gouvernait le corps du roi et le fait de sa guerre.
Alençon exprima le désir de rejoindre la Pucelle et d’entrer avec elle en Normandie, pour guerroyer au nom du roi. Les conseillers n’y voulurent consentir à aucun prix. En même temps, la direction de l’armée échappant à la sainte libératrice, l’indiscipline gagnait chaque jour. C’était presque à faire regretter de s’être soumis au roi légitime, tant les villes et les campagnes revenues au roi Charles étaient maltraitées par une bande de pillards, d’incendiaires, de brigands armés.
Ces pays étaient riches, bien peuplés et bien labourés ; mais bientôt les laboureurs furent massacrés, et plusieurs villes, oppressées et appauvries. Plusieurs cantons demeurèrent déserts et sans culture.
Les généraux les plus utiles, Vendôme, Charles de Bourbon, le duc d’Alençon, découragés, se retiraient ou boudaient sous leur tente.
Et tout cela pour complaire au duc de Bourgogne ! Les conseillers du roi avaient mis en ce prince félon et double leur confiance. Ils conclurent avec Philippe une nouvelle trêve, qui devait durer jusqu’à Pâques 1430. Le duc, ravi du succès de sa politique cauteleuse, et certain d’avoir paralysé celle de Charles VII, partit de Paris et s’en alla convoler en troisièmes noces avec une princesse portugaise.
Comment on décida d’utiliser le prestige de Jeanne
On s’avisa, dans l’entourage royal, qu’il serait peut-être bon d’utiliser le prestige de Jeanne sur les troupes désœuvrées, en l’envoyant faire le siège de La Charité, d’où l’Anglais, fortement établi, menaçait encore les résidences royales. L’admirable Pucelle, oubliant les dédains et les injures, courut où on l’envoyait. Elle commença par assiéger Saint-Pierre-le-Moûtier. La grande auréole de la guerrière s’y montra de nouveau.
140La garnison était très forte et composée de vaillants hommes de guerre. Un premier assaut fut repoussé83. Jean d’Aulon, écuyer de la Pucelle, blessé au talon, s’était retiré du combat, quand soudain il s’aperçut que, loin de suivre la retraite, Jeanne était demeurée presque seule sous les murs de la place. Aussitôt, craignant pour l’héroïque jeune fille, que le roi avait spécialement confiée à sa garde, il oublie sa blessure, monte à cheval, court vers elle, et lui demande ce qu’elle fait là, et pourquoi elle ne se retire pas comme les autres. La Pucelle, qui semblait animée d’une ardeur extraordinaire, lui répond, en ôtant son casque de dessus sa tête :
— Je ne suis pas seule : j’ai encore en ma compagnie cinquante mille de mes gens ; je ne partirai point d’ici que la ville ne soit prise.
Elle n’avait pourtant avec elle, j’en suis bien sûr, rapporte Jean d’Aulon, que quatre ou cinq hommes.
Le bon écuyer renouvelle ses instances. Pour toute réponse, Jeanne lui commande de faire apporter des fagots et des claies, pour faire sur les fossés de la ville un pont où les assaillants puissent passer. Elle-même crie d’une voix forte :
— Aux fagots, aux claies, tout le monde, afin de faire le pont !
Les Français l’entendent, ils reprennent courage, ils accourent en foule. Le pont est aussitôt établi ; on arrive aux pieds des murs, on escalade. La résistance cesse comme par enchantement, et voici que la ville est prise. Les vainqueurs se livrent au pillage ; leur cupidité ne recule même pas devant le sacrilège : ils pénètrent dans les églises et veulent enlever les vases sacrés. Mais Jeanne ne le peut souffrir : elle les réprimande avec une vigueur 141singulière, et, reprenant sur ces hommes farouches tout l’ascendant qu’elle exerçait sur eux naguère, elle préserve la maison de Dieu. Sa gaieté est toujours la même, aussi bien que son héroïsme. Mais, si ses aptitudes militaires lui demeurent, son inspiration n’a plus la netteté surnaturelle d’autrefois.
On l’envoie faire le siège de La Charité
Après ce brillant fait d’armes, le Conseil, poursuivant l’exécution de son plan, résolut d’envoyer Jeanne devant La-Charité-sur-Loire. Mais tel n’était pas l’avis de la Pucelle, car ses
voixdemeuraient muettes, et pour elle, c’était enFrance, c’est-à-dire dans l’Île-de-France et la Picardie, qu’elle voulait aller, dans ces bonnes villes qui l’avaient si bien reçue avant et après le sacre, près de ce Paris qui lui tenait toujours au cœur. Mais, comme on fit appel à son dévouement, elle se soumit.Il n’en fut pas de même de Catherine de la Rochelle, qu’on voulait envoyer avec Jeanne au siège de La Charité. Cette aventurière répondit qu’il faisait trop froid. Au surplus, cette indigne rivale de la Pucelle s’attribuait depuis quelque temps des attributions différentes de celles d’un chef de guerre. Elle demandait qu’on mît à l’essai son talent diplomatique, et offrit d’aller trouver le duc de Bourgogne pour faire la paix. C’est alors que Jeanne prononça cette belle parole, plusieurs fois citée, et qui ne fait pas moins honneur à son bon sens qu’à son patriotisme :
— Il me semble qu’on ne trouvera point de paix, si ce n’est par le bout de la lance.
II
Une aventurière démasquée
L’aventurière que nous venons de nommer fournit aux amis de Jeanne l’occasion de constater une fois de plus le rare sens droit, qui écarte chez elle jusqu’au plus petit soupçon de tendance à l’illuminisme ou à une exaltation mentale quelconque.
142Catherine, se disant inspirée, était venue de La Rochelle trouver le roi.
— Je suis, lui dit-elle, envoyée par Dieu, pour vous procurer des trésors. Une dame blanche, vêtue de drap d’or, m’apparaît et me commande d’aller par les bonnes villes et de faire crier par les hérauts du roi que tous ceux qui possèdent de l’or ou de l’argent caché l’apportent sans retard. S’il en est qui refusent de le faire, je saurai bien les reconnaître et les désigner.
Dans la pénurie où se trouvaient les armées royales, l’offre était tentante. Toutefois, Charles VII eut le bon esprit de s’en remettre à la Pucelle pour prononcer sur le cas de cette femme. Jeanne commença par interroger avec soin la visionnaire. Puis, quand elle eut bien pesé les réponses de Catherine, elle lui dit :
— Retournez vers votre mari, faire votre ménage et nourrir vos enfants.
L’aventurière dépitée insista.
— Quand donc, lui demanda Jeanne, vient cette dame dont vous parlez ?
— Chaque nuit.
— Et elle n’y manque jamais ?
— Non, jamais.
— Eh bien ! ce soir, venez en mon logis, vous partagerez mon lit.
Ainsi fut fait. Jusqu’à minuit, Jeanne resta éveillée, et bien entendu ne vit rien. Vaincue par la fatigue, elle s’endormit jusqu’au matin. À son réveil, elle interrogea Catherine :
— Eh bien ! la dame est-elle venue ?
— Mais oui, répondit l’autre ; seulement vous dormiez si fort que j’ai craint de vous réveiller.
— Bien, reprit la Pucelle, dans ce cas, revenez ce soir.
Toute la journée, Jeanne dormit, afin d’être sûre de veiller la nuit suivante tout entière. En effet, ayant 143Catherine auprès d’elle, elle ne ferma pas l’œil jusqu’au jour, interrogeant souvent sa compagne :
— Votre dame viendra-t-elle bientôt ?
— Oui, tantôt, répondait piteusement l’autre.
Inutile d’ajouter que l’attente demeura absolument vaine.
Cependant, ne s’en fiant pas à ses propres lumières, la prudente jeune fille consulta ses voix. Il lui fut répondu que, dans le fait de cette Catherine de La Rochelle, tout n’était que folie et mensonge. Elle en écrivit au roi, au grand mécontentement de l’aventurière et de frère Richard, qui ajoutait foi à ses révélations.
Catherine néanmoins ne quitta point la cour pour cela, elle eut même l’audace de se proposer pour négociatrice auprès de Philippe le Bon. Plus tard, elle passa au parti anglais, et, dans sa haine jalouse, nous la retrouverons déposant au procès de Rouen contre la sage Pucelle, qui l’avait démasquée.
III
Les voix prédisent à Jeanne sa captivité prochaine
On était dans la semaine de Pâques, vers le 15 avril. Jeanne, sans prendre congé du roi, s’était comme enfuie du château de La Trémouille, où le favori tenait jalousement sous sa main le roi et la libératrice du royaume. Obéissant à son patriotique attrait, la Pucelle se rendait sur le théâtre de la guerre. Elle se trouvait à Melun, ville qui venait de chasser les Anglais pour se donner au roi, quand ses voix lui firent une douloureuse révélation.
— À la Saint-Jean prochaine, disaient les saintes, elle serait prise. Il fallait, ajoutaient-elles, qu’il en fût ainsi.
Mais, en même temps, elles l’exhortaient à ne point s’étonner, à prendre tout en gré et que Dieu lui viendrait en aide.
Un dialogue de pénétrante tristesse
Un dialogue douloureux s’établit entre la jeune martyre 144et ses saintes protectrices. On dirait la scène de Gethsémani, la lutte entre le cœur du Sauveur des hommes épouvanté à la vue subite du calice de sa Passion et l’ange qui réconforte le roi des martyrs.
— Quand donc sera-ce, demandait Jeanne, que je serai réduite en captivité ?
Les voix se turent. Ce n’est point à l’homme de connaître l’heure exacte de son trépas. Il faut que l’heure demeure indécise, pour que les desseins de Dieu sur son âme puissent librement s’accomplir.
— Du moins, conjurait la sainte adolescente, que ma prison soit abrégée. Obtenez-moi qu’ils me fassent mourir, sans les tortures d’une longue captivité.
Les saintes répondaient évasivement :
— Il faut, répétaient-elles, que la prédiction s’accomplisse et que tu prennes tout en gré.
Tout !… c’est-à-dire les longueurs de l’emprisonnement, la cage de fer, les interrogatoires du traître, les tourments d’une longue agonie.
Dès lors, Jeanne comprit que son œuvre était sur le point de finir. D’autres recueilleront les honneurs de la victoire, à elle plus d’autre palme que celle du martyre.
La face des choses en effet allait changer.
Nous voici arrivés au sommet des événements de cette histoire.
C’est Compiègne.
IV
Je veux aller voir mes bons amis de Compiègne
Jeanne venait d’apprendre que Compiègne allait être assiégé.
— Nous sommes assez, dit-elle à la petite troupe qui l’entourait, je veux aller voir mes bons amis de Compiègne.
On lui objectait le petit nombre de ses soldats. Elle ne 145voulut point écouter les conseils pusillanimes de cette prudence trop humaine. Et cependant, ses voix ne lui commandaient point de se lancer dans ce péril, elles ne le lui défendaient point non plus.
— Si j’avais su que je dusse être prise, dira-t-elle plus tard, je n’y serais point allée, à moins que mes voix ne me l’eussent formellement commandé, auquel cas j’y serais allée, quoi qu’il m’en dût advenir.
La ville de Compiègne, placée sur la rive gauche de l’Oise, domine la rivière et la vallée, qui s’étend de l’autre côté en une prairie basse et humide, large d’un quart de lieue, avant d’atteindre l’escarpement du bord de Picardie. La ville y communique par un pont et une chaussée qui se prolonge au-dessus de la prairie jusqu’au versant de la colline. [Henri Wallon, Jeanne d’Arc, 1860, t. I, p. 187.]
L’investissement n’était pas complet, les habitants pouvaient donc se ravitailler ; puis, ils avaient confiance en la Pucelle.
L’enfant ressuscité par les prières de Jeanne
Le bruit d’un récent prodige, opéré sur sa demande en faveur d’un enfant mort sans baptême à Lagny, augmentait la vénération du bon peuple pour la sainte libératrice.
Les jeunes filles de Lagny, touchées de la douleur extrême d’une mère dont l’enfant venait de mourir sans baptême, priaient depuis trois jours à l’autel de Marie devant le petit cadavre. Jeanne allait renouveler pour lui le miracle raconté dans la vie de Geneviève de Paris.
À la nouvelle de son arrivée, les jeunes filles accoururent la supplier de vouloir bien venir prier avec elles sur le corps de l’enfant, demandant à Dieu de le rappeler à la vie à dessein de le baptiser.
— Vos prières sont aussi bonnes que les miennes, ô mes amies ! répondit l’humble guerrière, allez donc et continuez.
Mais, sur leurs instances, elle finit par céder et se rendre à leurs désirs.
À peine se fut elle mise en prières que l’enfant remue, s’agite, semble se réveiller et reprend ses couleurs. Le 146prêtre mandé en hâte le baptise, et l’enfant, après avoir bâillé trois fois, mourut de nouveau pour toujours84.
Au sortir de la prière
Or, Jeanne se trouvait un jour à prier et à entendre la messe dans l’église Saint-Jacques, de Compiègne. Elle y communia, puis se retira près d’un pilier pour continuer son oraison. Quand elle releva la tête, elle se vit entourée de plusieurs gens de la ville et d’une centaine d’enfants qui la contemplaient avec une curiosité tout empreinte de respect et d’affection. Elle lut dans leurs yeux l’expression de leur sincère amitié pour elle, et ne put retenir devant eux le cri de son âme accablée d’angoisses.
Je suis trahie
— Mes enfants et mes chers amis, leur dit-elle, sachez que l’on m’a vendue et trahie. Bientôt je serai livrée à la mort. Aussi je vous supplie que vous priiez Dieu pour moi, car plus jamais je n’aurai la puissance de servir le roi ni le royaume de France.
Ces paroles, qui ne paraissent pas cependant d’une authenticité indiscutable, faisaient allusion, si elles ont été dites, non point à un personnage en particulier, mais à tous ceux qui, pour une part quelconque, avaient empêché la France et son roi de profiter du secours surnaturel et divin qu’elle portait avec elle85.
147V
Le plan de la Pucelle
La Pucelle avait formé un plan hardi contre les assiégeants : suivre la chaussée avec ses troupes, culbuter les Bourguignons de Margny, les poursuivre et les battre à Clairoix, tandis que Guillaume de Flavy, gouverneur de Compiègne, avec les troupes restées dans la ville, surveillerait les Anglais et les arrêterait à la chaussée, s’ils tentaient une attaque sur les derrières du corps commandé par Jeanne d’Arc.
Comment il manqua
Le plan s’exécuta d’abord, comme elle l’avait conçu.
Jeanne sortit, le 24 mai, vers cinq heures du soir, avec cinq ou six cents hommes, de Compiègne, où elle laissait Flavy. Les Anglais essayèrent aussitôt de cerner la troupe française, mais Flavy fit tirer sur eux un feu nourri d’artillerie et de flèches. Par malheur, à ce moment, une panique se produisit dans les derniers rangs des Français. S’imaginant qu’ils allaient avoir la retraite coupée, ils se mirent à rentrer dans la ville en débandade par le chemin de la chaussée.
Flavy se trouva obligé de faire cesser le feu, de peur de tirer sur ses propres troupes. Et les assaillants en profitèrent pour escalader la chaussée.
Jeanne se trouvait cernée. On le lui fit remarquer.
— Taisez-vous, s’écria-elle, il ne tient qu’à vous qu’ils soient tous défaits, ne pensez qu’à frapper sur eux.
Et elle s’élançait de nouveau dans la mêlée, disant :
— En avant ! Ils sont tous vôtres !…
Mais, on ne l’écoutait plus, chacun battait en retraite et elle se trouva entraînée dans le mouvement. Elle marchait à reculons, en brave, tenant tête à l’ennemi, la dernière, comme le capitaine sur le navire naufragé.
Le pont-levis fermé
À la porte de la ville, une confusion extrême régnait, 148qui fit perdre au gouverneur le sentiment de son devoir, car il serait trop odieux de penser qu’un homme, en qui Jeanne avait mis sa confiance puisqu’elle l’avait associé à son plan de sortie, qu’elle était venue avec une telle magnanimité secourir dans sa forteresse assiégée, ait pu donner un ordre pareil, dans l’intention de la livrer aux Anglais. Nous aimons mieux croire et dire que Guillaume de Flavy craignait une surprise, quand il fit lever le pont et baisser la herse.
Ainsi, la porte fut fermée à l’infortunée Pucelle.
J’ai baillé ma foi à un autre
En vain, ramassant toutes ses forces, essaya-t-elle de se frayer un passage à travers les ennemis. Elle et les fidèles chevaliers de son escorte se trouvèrent bientôt accablés par le nombre.
Les ennemis lui criaient :
— Rendez-vous, et baillez-nous votre foi.
— Ma foi, répondit l’héroïque enfant, je l’ai jurée et baillée à un autre que vous, et je lui en tiendrai mon serment.
En ce moment, un archer la tira violemment par la robe de drap d’or qui couvrait son armure et la fit tomber de cheval.
Jeanne prisonnière
Ils la firent prisonnière. Avec elle, son frère Pierre, d’Aulon, son écuyer, et le fidèle Xaintrailles furent aussi faits prisonniers.
Jeanne venait de finir sa carrière militaire.
Suprême injure
Les Anglais et les Bourguignons ne se possédaient plus de joie. Nous voudrions pouvoir ajouter qu’à la cour du roi Charles, on était dans la consternation. Hélas ! il s’y trouva un ministre du roi, le chancelier de France, qui osa donner sèchement avis de cette nouvelle, presque d’un ton banal, aux habitants de Reims, ajoutant cette réflexion où transparaît la secrète pensée de son âme :
Elle ne voulait croire conseil, mais faisait tout à son plaisir !…

Notes
- [1]
Abbé Bourgaut, Guide du pèlerin à Domremy, 1878, p. 15
- [2]
Pendant que ce brave homme (Gérardin) abandonne à son pays la chaumière de l’illustre vierge, et qu’il en emploie la chétive indemnité (2.500 fr.) à se procurer un autre abri pour sa nombreuse famille, arrive un lord anglais. Il ne doute pas d’enlever, au poids des guinées, la vente de la maison, comme autrefois ses maîtres ont acheté Jeanne elle-même. Il était trop tard ! et on le vit, dans son désespoir, s’arracher littéralement les cheveux. Au fond, pourtant, ne devait-il pas se féliciter du fait accompli ? Son or, impuissant sur le patriotisme de Gérardin, eût allumé son indignation au premier mot d’une offre aussi flétrissante. En 1828, il mourut, à Domremy, entouré de l’estime universelle. Ses enfants gardent précieusement comme un bien de famille les hommages rendus aux vertus de leur père. (Bourgaut, op. cit., p. 35.)
- [3]
D’où le nom du Lys (deux lys) adopté par les descendants de la famille d’Arc.
- [4]
Avons-nous besoin de dire que, en attribuant à Jeanne les qualifications de bienheureuse ou de sainte, nous n’avons aucunement la prétention de prévenir le jugement de l’Église. À elle seule aussi appartient le droit de déterminer le caractère surnaturel et divin des prodiges qu’accomplit la vierge de Domremy, et que nous aurons à raconter le long de ces pages. Mais, en nous conformant ainsi aux sages prescriptions du pape Urbain VIII, nous sera-t-il interdit d’émettre le vœu que bientôt ce jugement infaillible ratifie les pieuses croyances de tant de grandes âmes et de nobles esprits !
- [5]
Les détails descriptifs qu’on vient de lire sont empruntés, pour la plupart, à l’excellent Guide du pèlerin à Domremy, de M. l’abbé Bourgaut, curé de Domremy.
- [6]
Lunas (sans doute une sorte de petits gâteaux). D’autres lisent lanas, de la laine.
- [7]
À quelques pas de la vieille église, s’élèvera bientôt la basilique nationale rêvée par Mgr de Briey, édifiée par les soins et grâce au zèle de Mgr Sonnois et de Mgr Foucault. Déjà l’édifice sort de terre ; le 15 mai 1891, le R. P. Létendard, supérieur des missionnaires de Jeanne d’Arc, put célébrer dans la crypte, terminée à cette date, de la basilique en construction, la première messe officielle de l’Œuvre des prières pour l’armée dont Mgr Sonnois a eu la belle idée de fixer le siège à Domremy.
Nous publions, d’après le projet de son éminent architecte, M. Paul Sédille, une vue de cette basilique appelée à abriter l’autel de Jeanne, espoir et consolation des patriotes fidèles à la foi dont elle fut l’héroïque confesseur. Le magnifique groupe de Saint-Michel, que nous donnons également, est l’œuvre de M. Allar ; il est destiné à décorer l’entrée de la basilique. M. de Sédille a fait une large place, tant au dehors qu’au dedans du monument, aux sujets et aux ornements décoratifs le fronton et les frises porteront, gravés sur le marbre ou peint sur mosaïque, les écussons des familles dont les ancêtres furent les compagnons de Jeanne, comme de celles dont les membres ont, à l’exemple de l’héroïne, inscrit le culte de la patrie dans leur devise.
L’œuvre de Domremy est bien une œuvre nationale : son succès n’honore pas seulement, en même temps qu’il les récompense, ceux qui l’ont créée et fait aboutir, il honore aussi la France par l’éclatante affirmation de son patriotisme et de sa fidélité au culte de celle qui paya du martyre la gloire de l’avoir délivrée de l’oppression anglaise.
- [8]
L’histoire a conservé le nom de cinq marraines avec quatre parrains portant presque tous le nom de Jean ou de Jeanne, qu’ils imposèrent à l’enfant, et qu’elle devait immortaliser. C’étaient Jean Morel, de Greux ; Jean Barrey, Jean de Longard et Jean Rainguesson, de Neufchâteau ; puis : Jeannette, femme d’Étienne Thévenin, charpentier ; Béatrice, veuve Estellin, de Domremy toutes deux ; Jeannette, veuve Thiesselin, de Vittel, habitant alors Neufchâteau ; Édille, veuve de Jean Barre, de Fubécourt ; et Agnès, que sa filleule, dans une réponse à ses juges, ne désigne pas plus clairement. Garants, en janvier 1412, de la fidélité future de leur fille spirituelle aux serments de son baptême, la plupart de ses premiers témoins se retrouvèrent en 1455, au procès de réhabilitation, pour garantir sa fidélité passée ; et après l’avoir relevée des fonts sacrés aux premiers jours de son existence, ils relevèrent, après sa mort, par l’unanimité de leurs dépositions, sa réputation et son honneur, un instant obscurcis par la haine de ses ennemis jurés. (Bourgaut, op. cit., p. 56.)
- [9]
Après la réhabilitation de Jeanne, sa statue, décorée de riches peintures, y fut placée en face de l’image de la Vierge, aux pieds de laquelle on l’avait si souvent vue prosternée. Les membres de sa famille y élurent leur dernière demeure et décorèrent la chapelle de divers ornements.
- [10]
Au retour du printemps, les habitants de Domremy, leurs seigneurs, qui étaient de la maison de Bourlemont, leurs dames et leurs familles, recommençaient les promenades et les réunions habituelles sous l’arbre des Fées appelé aussi pour cela arbre des Dames et beau may. Le dimanche Lætare, qui est le IVe de Carême, on l’inaugurait en quelque sorte avec la belle saison. De son côté, l’Église avait à cœur de sanctifier ces amusements. Aux Rogations, le curé de la paroisse dirigeait une procession vers ce but, bénissait les fontaines, s’arrêtait sous le hêtre, y récitait l’évangile de saint Jean et d’autres prières. Ainsi le dimanche des Fontaines, et, en été, les jours de fête, la jeunesse de Domremy, venait, sous l’arbre fameux, faire ses fontaines, tandis que ceux de Greux allait les faire à Notre-Dame de Bermont. Munis de petits pains préparés par leurs mères, les enfants se rendaient en chantant vers le vieil arbre, y faisaient des rondes, cueillaient des fleurs aux alentours, en formaient des guirlandes qu’ils suspendaient à ses rameaux, prenaient à son ombre leur goûter frugal, puis allaient, en jasant et en riant, se désaltérer à la fontaine des Groseilliers, et enfin ils rentraient gaiement au foyer domestique. Plus de deux cents ans après la mort de Jeanne, E. Richer, un de ses historiens, trouva encore ces mêmes usages vivants à Domremy. (Bourgaut, op. cit., p. 71 et suiv.)
- [11]
Mgr Perraud, Panégyrique de Jeanne d’Arc, le 8 mai 1872.
- [12]
L’Éternelle consolation. Édit. Jannet, p. 128 et 130.
- [13]
Dès ses plus jeunes années, elle se confessait fréquemment, d’abord au moins tous les mois, puis en Carême tous les quinze jours ; à Neufchâteau, tous les huit jours ; et plus tard, à l’armée, quand elle fut jetée dans le tumulte des camps, c’était deux fois par semaine. (Mgr Dupanloup, second Panégyrique de Jeanne d’Arc, le 8 mai 1869.)
- [14]
Ibid.
- [15]
Dans sa lettre au duc de Milan, Boulainvilliers nous a conservé un touchant détail de cette naissance.
C’est la nuit de l’Épiphanie, jour de joie pour tous les chrétiens, que la jeune fille a vu la lumière, et, chose merveilleuse, tous les habitants de Domremy se sentent inondés d’une ineffable joie. Ignorant le mystère de cette naissance, ils sortent de leurs maisons et se demandent les uns aux autres ce qui est arrivé de nouveau. Plusieurs sentent leur joie redoubler. Que vous dire encore ? Les coqs, comme autant de hérauts d’un si heureux événement, font, à une heure inaccoutumée, entendre des concerts qu’on ne leur connaissait, battent des ailes, et presque durant deux heures paraissent annoncer la signification de la nouvelle naissance. (Quicherat, Procès, V, 116.)
- [16]
L’évêque d’Avranches, Bochard, dans son mémoire pour Jeanne d’Arc, rappelle, à ce sujet, des particularités négligées par d’autres :
Saint Michel, — dit-il, — fut autrefois le guide du peuple de Dieu. Il transmettait à ce peuple les révélations du ciel, ainsi que l’enseigne la glose au vie chapitre des Juges et au Xe de Daniel. Maintenant que l’ancien peuple est dispersé, que l’Église est fondée, la foi établie, il ne saurait être douteux que le bienheureux archange ne préside à la conduite de l’Église et de toute la chrétienté. Mais, parmi tous les royaumes de la chrétienté, il doit, plus que tout autre, veiller sur ce royaume de France, auquel un éclat particulier dans le culte divin, le flambeau de la foi toujours conservé dans sa pureté et sans obscurcissement, ont fait donner, comme témoignage d’une spéciale et particulière prérogative, même par les autres nations, le nom de très chrétien. On peut l’induire encore d’un fait singulier. Dans mon diocèse d’Avranches, l’archange se choisit autrefois une roche au milieu des flots de la mer, pour y être particulièrement honoré. C’est le récit de nos vieilles histoires. Le Bienheureux Aubert, alors évêque d’Avranches y fit bâtir en l’honneur et sur l’ordre même de l’archange une église fameuse appelée depuis église de Saint-Michel-sur-Tombe. Or, c’est le seul lieu de la Normandie qui n’ait pas été subjugué par les Anglais. Tout le duché était conquis. Les lieux circonvoisins, pendant la durée des guerres, étaient ennemis du Mont Saint-Michel. Blocus très vigoureux et prolongés, machines merveilleuses, embuscades, trahisons, engins de tout genre, tout a été mis en œuvre, sans que les Anglais soient parvenus à s’en rendre maîtres. Le bienheureux archange en personne a couvert ce lieu d’une particulière et souveraine protection, aussi le roi très chrétien peut-il s’approprier les paroles de Daniel, et dire avec ce prophète : Voilà que Michel, le premier parmi les princes premiers est venu à mon aide.
- [17]
On la voyait bien quelquefois quitter ses compagnes, se recueillir comme si elle était devant Dieu. Mais nul ne sut ce qui se passait en elle, pas même celui qui l’entendait en confession. Elle garda la chose secrète, non qu’elle se crût obligée de la taire, mais pour se mieux assurer du succès quand le temps viendrait de l’accomplir, car elle craignait les pièges des Bourguignons, elle craignait les résistances de son père. (H. Wallon, Jeanne d’Arc, t. I, p. 89.)
- [18]
Chronique espagnole de la Pucelle, trad. par le comte de Puymaigre.
- [19]
Elle dit avoir connu que c’était saint Michel qui la visite, aux bons conseils, réconfort et bons enseignements qu’elle en a reçus, et aussi parce que saint Michel s’est nommé à elle. Ainsi en est-il de sainte Catherine et de sainte Marguerite qui lui ont déclaré leurs noms et qui la saluent. (Les XII articles de Nicolas Midi, lus en Sorbonne.)
- [20]
La question du surnaturel dans la mission de Jeanne d’Arc et de la réalité des Révélations dont elle fut favorisée est capitale dans l’histoire de la Vénérable Pucelle. Nous espérons qu’elle ressortira, aux yeux des lecteurs de ce livre, du récit même, scrupuleusement emprunté aux sources authentiques et les moins suspectes de partialité. Mais, elle ne saurait faire ici le sujet d’une thèse spéciale, étrangère au but que nous poursuivons et au plan que nous nous sommes proposé. Les personnes qui seraient curieuses d’approfondir une question si digne de fixer l’attention des philosophes comme des historiens, trouveront ample moisson à leurs études dans le volume du P. Ayroles, intitulé la Pucelle devant l’Église de son temps. Cet énorme volume in-4° (Paris, Gaume) est rempli de documents de premier ordre et complète savamment l’autre ouvrage du même auteur, Jeanne d’Arc sur les autels, duquel Mgr de Cabrières a pu écrire au savant défenseur de l’inspiration surnaturelle :
Vous avez peint d’une façon saisissante le côté surnaturel de cette pure existence qui se meut dans une atmosphère toute céleste, au milieu des plus chers patrons de la France…
L’objection tirée du point de vue médical a fait l’objet de plusieurs travaux scientifiques du plus haut intérêt. Nous signalerons, comme un des plus complets et des plus concluants, la belle étude de M. le comte de Bourbon-Lignières, dont la deuxième édition vient de paraître à la librairie Lamulle et Poisson, à Paris. Elle est intitulée : Étude sur Jeanne d’Arc et les principaux systèmes qui contestent son inspiration surnaturelle et son orthodoxie.
Pendant que nous écrivons cette note, on annonce un nouveau travail de l’infatigable P. Ayroles, où le docte jésuite étudiera plus spécialement en Jeanne d’Arc la Voyante.
- [21]
Faisant allusion à la statue de Jeanne que venait de donner au public artistique la princesse Marie d’Orléans, l’orateur ajoutait délicatement :
Elle a prouvé, elle aussi, qu’elle savait comprendre la sainte et noble figure de Jeanne.
- [22]
H. Wallon, op. cit., t. I, p. 90.
- [23]
M. Sepet, Jeanne d’Arc, édit. grand in-8°, p. 61.
- [24]
L’habitation de Durand Lascart à Burey-le-Petit, ou Burey-la-Côte, existe encore ; elle est connue par une tradition constante et familière à tout le monde. En 1869, Mgr Dupanloup l’honora de sa visite. C’est une maison évidemment très ancienne, n’ayant qu’un rez-de-chaussée et quelques ornements de style ogival du XVe siècle. (Bourgaut, op. cit., p. 13.)
- [25]
Pour Jeanne, Charles VII fut toujours le dauphin, tant qu’elle ne l’eut pas conduit à Reims et elle ne le traita de roi qu’après son sacre.
- [26]
Cette parole fournit au P. Ayroles l’occasion de réflexions qu’on lira avec profit :
Jésus-Christ, — dit-il (Jeanne d’Arc sur les autels, p. 302), — Jésus-Christ est la source de la souveraineté. Les droits de Charles proviennent d’un acte positif de la volonté du roi des nations… Charles n’est qu’un roi lieutenant, locum tenens, du vrai roi Jésus-Christ.
D’après la Pucelle, le roi lieutenant n’entre pas en possession par le sang ou même par la mort de son père ; mais bien par le sacre. Là, il s’engage envers Jésus-Christ à gouverner le fief d’après la divine constitution apportée par l’Homme-Dieu aux royaumes non moins qu’aux individus. Il promet d’être, au nom du suzerain, le protecteur de tout ce qui est faible contre l’oppression de la force, d’être l’invincible tenant de la justice. Jésus-Christ, par l’intermédiaire de ses ministres, accepte l’engagement, et couvre le vassal des rayons de sa majesté.
Les pontifes, en installant le roi sur son trône, lui disent :
Occupez, gardez désormais la place où Dieu vous délègue en vertu de son autorité toute-puissante, et par la présente intronisation, faite par le mutuel accord de tous les évêques et de tous les autres serviteurs de Dieu.
Puis, s’adressant à Dieu, le pontife consécrateur lui demande, entre autres faveurs, d’être
le bouclier, la cuirasse, la sagesse du nouveau monarque ; que les peuples lui gardent la fidélité ; que les grands ne troublent pas la paix ; que la nation croisse et multiplie sous le nouveau règne, fondue dans l’unité par les éternelles bénédictions.
- [27]
M. Sepet, op. cit., p. 62.
- [28]
Elle avait tenu sur les fonts de l’église de Domremy, un enfant de ce Gérardin, qu’elle interpellait ainsi joyeusement, témoignant par ce ton que la haine n’était point dans son cœur et que l’esprit de parti ne la rendait point indifférente aux pieuses affections de l’affinité spirituelle.
- [29]
Dans une ville royale.
- [30]
Allusion au projet dès lors mis en avant de marier Marguerite d’Écosse au fils du roi, encore enfant. (Quicherat, Procès, II, 436, cité par H. Wallon op. cit., I, 96.)
- [31]
Celui qui se confesse sincèrement, dit saint Ambroise, n’a rien à redouter des accusations de Satan. Le maudit a perdu sur lui tout pouvoir parce que, comme l’enseigne saint Augustin, la confession est le salut de l’âme, la destruction des vices. Elle restaure les vertus, et met les démons en fuite. Jeanne, se confessant souvent, tenait le démon sous ses pieds, loin d’en être l’esclave. Loin de l’imiter, elle faisait le contraire de ses œuvres, et de ce à quoi tendent ses pompes. (Bourdeilles, Dissertation sur la Source des Révélations de la Pucelle.)
- [32]
M. Sepet, op. cit., p. 65.
- [33]
Au nom de Dieu. C’est la formule d’affirmation de Jeanne, depuis sa mission.
- [34]
Vous tardez.
- [35]
Noble, d’où est resté l’expression de gentilhomme (homme noble).
- [36]
Il est en péril.
- [37]
La Marne, l’Aube, la Seine, l’Yonne, à l’époque de l’année où leurs lits sont remplis par les crues d’hiver.
- [38]
Pierre de Versailles, mort évêque de Meaux, a raconté ce prodige, comme le tenant des hommes d’armes eux-mêmes. (Déposition de Seguin au procès de réhabilitation.)
- [39]
Le Conseil du roi se composait de quatre influences dominantes : Georges de La Trémouille, baron de Sully, hostile à la Pucelle ; Regnault de Chartres, archevêque de Reims et chancelier de France, dévoué au premier et dès lors peu favorable à Jeanne, que cependant il finit par subir ; Robert le Maçon, seigneur de Trêves en Anjou, point hostile, mais faible, et dès lors tiède et chancelant dans son attitude vis-à-vis de la Pucelle ; Raoul de Gaucourt, bailli d’Orléans, point hostile à ce moment, mais le devint plus tard par jalousie.
Jeanne était soutenue par la reine de Sicile, Yolande d’Aragon, belle-mère de Charles VII ; et par le confesseur du roi, maître Gérard Machet, plus tard évêque de Castres, pieux et savant docteur, qui insista pour admettre la Pucelle à l’audience du roi.
- [40]
D’après la Chronique de la Pucelle attribuée à Cousinot de Montreuil, l’épisode se passa quelques jours après la première audience et eut plusieurs témoins.
Elle fut contente, dit le chroniqueur, que quelques-uns des gens du roi y fussent, et, en la présence du duc d’Alençon, du seigneur de Trêves, de Christophe d’Harcourt et de maître Gérard Machet, confesseur du roi, aux-quels il fit jurer, à la requête de ladite Jeanne, qu’ils n’en révéleraient ni diraient rien, elle dit au roi une chose de grande conséquence qu’il avait faite, bien secrète, dont il fut fort ébahi, car il n’y avait personne qui pût le savoir, que Dieu et lui.
D’autres récits suppriment les témoins, ou du moins les tiennent à distance, d’accord sur le fait et la joie qu’en éprouva Charles VII.
Ce qu’elle lui a dit, nul ne le sait, écrit Alain Chartier en juillet 1429, mais il est bien manifeste qu’il en a été tout rayonnant de joie, comme à une révélation de l’Esprit-Saint.
Ce secret fut révélé plus tard par le roi lui-même à Guillaume Gouffier, seigneur de Boisy, son chambellan, qui le raconta à son ami Pierre Sales, lequel l’a mentionné dans son livre des Hardiesses.
- [41]
Jeanne, dans son interrogatoire de Rouen, confirme l’opinion qui veut que le secret ait été révélé au roi sans témoins, quand elle dit
qu’elle ne pense pas que personne ait été alors avec le roi, quoiqu’il y eut bien des gens assez proche.
- [42]
Le duc d’Alençon, dans sa déposition au Procès (III, 91), raconte que Jeanne
demanda au roi de donner son royaume au roi des cieux, et que le roi des cieux, après cette donation, ferait pour lui comme pour ses prédécesseurs, et le rétablirait dans son ancien état.
- [43]
M. Quicherat a soulevé diverses objections contre la prophétie de Merlin, en ce qu’elle se rapporterait à Jeanne. Il n’en est pas moins acquis que, au sentiment populaire général, plus d’une des prédictions ayant cours se sont réalisées dans la venue de la Pucelle de Domremy.
- [44]
Le grand Gerson, sur le point de mourir, écrivait, dans son dernier travail, Opuscule sur le fait de la Pucelle, à la date du 14 mai 1429 :
Que la grâce divine, manifestée en cette Pucelle, ne tourne point, par notre faute, en vanités, en haines, en séditions, en vengeances d’injures passées ; mais que, excitant tout le peuple à la prière, cette grâce nous procure enfin la douce, paix, afin que, délivrés avec l’aide de Dieu, des mains de nos ennemis, nous adorions le Seigneur, dans la sainteté et la justice, tous les jours de notre vie. Ainsi soit-il. Cela a été fait par Dieu.
- [45]
Certes, — écrivait Bouillé, — lors du procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc, si l’on considère la mission divine, vraisemblablement intimée à Jeanne par ses révélations ; le service guerrier à accomplir par commandement divin au milieu des hommes d’armes, on trouvera qu’elle avait un motif raisonnable de prendre le vêtement viril, au milieu de tous ces guerriers.
Il n’y a rien d’ailleurs de déraisonnable dans l’assertion d’après laquelle elle a affirmé que ses voix lui avaient commandé, de la part de Dieu, de prendre le costume masculin et militaire ; et elle ne devait pas, pour obéir à l’homme, transgresser un ordre de Dieu dont elle était certaine. Ceux qui sont conduits par une loi particulière sont conduits par l’esprit de Dieu, et (sous ce rapport) ne sont pas assujettis à la loi commune : Là où est l’esprit de Dieu, là est la liberté. (Gal. II.)
Il y avait en outre une cause raisonnable, dès que l’on part de ce fondement qu’elle avait mission pour faire la guerre. Ce n’était pas par esprit de libertinage, de superstition idolâtrique, ni pour aucun des motifs qui inspiraient aux païens semblable travestissement, et qui avaient porté Dieu, d’après saint Thomas d’Aquin, à le prohiber dans la loi.
Des causes raisonnables ont fait que des saintes ont ainsi changé les habits de leurs sexes. Elles sont nombreuses celles qui, par raison de pudeur ou de piété, ont porté des vêtements d’homme jusqu’à la fin de leur vie ; sainte Nathalie, sainte Maxime, sainte Eugénie, sainte Euphrasie, etc.
- [46]
Remarquablement vigoureuse, elle reçoit un carreau (flèche à pointe carrée), à la prise des Tournelles. Le carreau, tiré du haut en bas, pendant qu’elle tentait l’escalade, pénètre près de la clavicule elle se retire du combat, est sur le point de s’évanouir ; vingt minutes après, elle reprend la bataille et, par ses cris, par ses efforts, par son exemple, elle entraîne de nouveau les Français et pénètre la première dans une citadelle, que gardaient le géant Glacidas, et la fleur de la chevalerie d’Angleterre ! À Jargeau, on lui lance, du haut du rempart, un rocher qui se brise sur son heaume :
elle fut forcée de se seoir…
dit la chronique. Quelques minutes après, elle se battait de plus belle. À la porte Saint-Honoré, sa blessure fut plus grave : un vireton, sorte de flèche tournante, lui traversa les deux cuisses ; par le même archer, sans doute, son porte-étendard avait été tué. Elle avait franchi le premier fossé ; l’attaque n’ayant pas réussi, elle était restée là, par terre, abandonnée. Vers dix heures, à la nuit, d’Alençon vint la prendre, et, deux semaines plus tard, elle était rétablie, à cheval, hardiment, demandant à recommencer. - [47]
Elle montait vigoureusement à cheval, et affectionnait les chevaux noirs. La selle d’alors facilitait singulièrement cet exercice parce qu’elle emboîtait presque exactement le cavalier, formant en arrière une petite dossière, de façon que le chevalier pouvait tenir bon au coup de lance. La selle arabe est encore ainsi faite les cavaliers montaient avec la jambe droite, le pied à fond dans l’étrier, la pointe en bas. Jeanne combattait avec l’épée et la lance.
La manière de combattre du XVe siècle est exactement conservée de nos jours par les toreros. L’unité de combat vers 1430 se composait de six à dix hommes. Un chevalier avait un bon cheval, une bonne armure, et des aides. Le chevalier, un professionnel habile, comme furent Poton, Xaintrailles, La Hire, se chargeait, dans la mêlée, d’attaquer quelque personnage à sa taille : les domestiques, suivants ou pages, à pied ou à cheval, occupaient la troupe diverse aidant de leur mieux leur chef d’attaque. Le prisonnier fait payait rançon ; on tuait peu, cela ne rapportait rien, et il fallait vivre de la guerre, c’est-à-dire des prisonniers. Jeanne était devenue en peu de temps un cavalier émérite.
- [48]
M. Siméon Luce a donné de cette coupe de cheveux une raison qui ne manque pas de vraisemblance. Jeanne d’Arc fréquenta, dès sa jeunesse, les religieux des ordres mendiants, et spécialement les franciscains, à qui elle se confessa souvent et qui, de leur côté, l’exaltèrent en toute occasion ; or, il y a tout lieu de croire que Jeanne fut de bonne heure affiliée par les frères mineurs au tiers-ordre de Saint-François ; et précisément un des signes extérieurs auxquels se reconnaissaient les adeptes laïques du tiers-ordre franciscain était, pour les femmes, l’obligation de porter les cheveux coupés en rond jusqu’à la hauteur des tempes. (Siméon Luce, Jeanne d’Arc à Domremy, p. 322.)
- [49]
En dehors des affaires de la guerre, Jeanne demeurait
moult simple, et peu parlant
. Accueillant toujours avec bonté les curieux qui venaient la voir, surtout les femmes, elle leur parlait si doucement et si gracieusement, dit la chronique, qu’elle les faisait pleurer. - [50]
Prince du sang royal et gendre du duc d’Orléans, Alençon eut le titre de généralissime dans la campagne de la Loire, mais il laissa à Jeanne le commandement de l’armée. Les intrigues de cour les séparèrent, au retour de la campagne de l’Île-de-France. Le duc d’Alençon, deux ans après sa déposition, ternit la gloire de ces souvenirs, en s’alliant secrètement avec l’Anglais. Il fut traduit devant la Cour des pairs et condamné à mort, sentence qui fut commuée en une sentence de prison perpétuelle. Il fut appelé à déposer au procès de Jeanne, pour qui il professa toujours une profonde admiration. Elle datait du lendemain de leur première rencontre au château de Chinon. Jeanne, étant montée à cheval dans la plaine de Chinon, courut la lance à la main, comme le meilleur chevalier. Le duc d’Alençon fut ravi de cette vaillance, et lui fit cadeau d’un cheval.
Il l’accompagna depuis assidûment dans les combats, dit M. Sepet, et, quoique le chroniqueur Perceval de Cagny ait sans doute beaucoup exagéré, pour faire valoir son maître, la confiance réelle que Jeanne accordait au prince, on ne peut nier qu’elle n’ait eu pour ce dévoué compagnon de ses fatigues une amitié chaste el sincère. On peut trouver un témoignage des dispositions de Jeanne à l’égard du duc d’Alençon, dans la visite qu’elle fit, peu de temps avant d’entrer en campagne, à la mère et à la femme de ce prince, qui résidaient à l’abbaye de Saint-Florent-lès-Sauveur. Elle y fut fêtée plusieurs jours par ces nobles dames, et leur promit qu’elle leur ramènerait sain et sauf, à l’une son fils, à l’autre son mari.
- [51]
D’après une tradition mentionnée dans un Dictionnaire de Géographie du siècle dernier, cette épée aurait appartenu à Charlemagne. M. l’abbé Chevalier en mentionne une autre, qui veut qu’elle ait primitivement servi à Charles-Martel. Les deux traditions peuvent très bien s’accorder.
- [52]
Jeanne avait encore une autre épée, et celle-là, elle l’avait achetée à la vente des chevaux, harnais et armes de l’évêque de Sens. Dans le prétoire sinistre de Rouen, où des juges haineux cherchaient à lui arracher des réponses pour motiver leur assassinat, on lui posa cette question :
— Puisque les voix avaient mis dans votre main l’épée de sainte Catherine, pourquoi n’avez-vous pas craint d’en prendre une autre, celle d’un évêque ?
Et alors, abandonnée comme elle l’était de tout et de tous, il lui vint un grand rayon du beau soleil de Patay ; le souvenir de la victoire, de la grande honte anglaise : toute cette réminiscence de gloire transfigura sa physionomie et, pleine d’amour pour la patrie, son gai caractère lui fit oublier qu’elle se trouvait en présence non de juges, mais de bourreaux, et elle dit à ces Anglais :
— Ah ! mais c’est qu’avec celle-là je donnais de meilleures bouffes et de meilleurs torchons !
(Nous rencontrerons ces expressions naïves, empruntées au langage militaire du temps, et qui signifient
d’estoc et de taille
.) - [53]
Quicherat, Procès, t. IV ; Jean Chartier, p. 53 ; Perceval de Cagny, p. 3 : Chronique de la Pucelle, p. 288.
- [54]
Greffier de la Rochelle, p. 23. Cf. Quicherat, Procès, t. III, déposition du duc d’Alençon, p. 92.
- [55]
Quicherat, Procès, V, 133 : Ascendens equum, quod nusquam antea.
- [56]
Je sais, disait-elle à ses juges de Rouen, je sais par révélation que Dieu aime mieux le roi que moi, pour l’aise de son corps, » c’est-à-dire pour les biens temporels et pour le trône de France, tandis que Jeanne était l’élue du ciel pour le martyre du patriotisme et la gloire d’une royauté céleste. Peu lui importaient donc les défauts de Charles VII. Jusque sur le bûcher de Rouen, elle professe pour lui un grand respect. Et cependant, si elle se fût placée au regard des défauts personnels de son roi, combien peu elle eût professé d’estime pour lui, s’il faut en croire les historiens.
Charles VII, dit Henri Martin, était alors âgé de vingt-six ans, il avait presque tous les défauts et aucune des qualités de la jeunesse à la fois mobile et obstiné, léger et songeur, soupçonneux envers les bons et crédule aux méchants, amolli dès l’adolescence par ce précoce abus de voluptés qui avait coûté la raison à son père et la vie à son frère, il ne montrait en rien l’activité d’esprit et de corps, ni les passions énergiques de son âge. Il n’était pas lâche : quand il fut obligé de payer de sa personne, il le fit honorablement ; mais il craignait les fatigues et le tumulte des camps,
ne s’armoit point volontiers et n’avoit point cher la guerre
; il n’était ni cruel ni absolument insensible ;il étoit beau parleur à toutes personnes et piteux envers les pauvres gens
; mais sa sensibilité toute physique, pour ainsi dire, était sans profondeur et sans durée ; sa vie morale était toute dans la sensation présente, il n’aimait pour ainsi dire que par les yeux. - [57]
Ensuite cette jeune fille, qui n’avait pas l’usage du bouclier et du casque, on la vit, à l’étonnement de tous, monter un cheval de guerre ; tenant d’une main l’épée, de l’autre un étendard qui portait l’image du Rédempteur, elle se livra aux périls et aux travaux des combats et se précipita hardiment au milieu des ennemis. C’est chose incroyable combien elle a osé, combien elle a supporté patiemment d’insultes et de moqueries de la part des adversaires, combien de prières accompagnées de larmes et de jeûnes elle a répandues devant Dieu, afin que les vainqueurs fussent chassés d’Orléans, et qu’ayant ensuite enrichi la France de nouveaux triomphes, rétabli et et assuré le droit du royaume, elle pût, même pour l’avenir, écarter, avec l’aide de Dieu, le péril menaçant de faire perdre la prospérité et la paix et de porter atteinte à la religion des aïeux. (Décret d’introduction de la cause de la Vénérable Jeanne d’Arc.)
- [58]
M. Sepet, op. cit., p. 96.
- [59]
Quicherat, Procès, III, 219.
- [60]
On voyait Jeanne, qui avait toujours à côté d’elle son confesseur, prendre tous les moyens pour préserver les soldats de ce qui pouvait corrompre les mœurs, proscrivant diverses excitations au mal et procurant l’assistance de saints prêtres pour favoriser la piété. Plus puissant encore était l’exemple de la Pucelle, qui offrait quelque chose d’angélique par l’exercice de toutes les vertus, principalement de la plus ardente charité envers Dieu et envers le prochain. (Décret d’introduction de la cause de la Vénérable Jeanne d’Arc.)
- [61]
C’est ce même La Hire qui, avec une soixantaine de lances et trois ou quatre mille hommes de pied commandés par Kennedy, un capitaine écossais, et l’abbé de Serquenceaux, s’en vient devant Montargis que les Anglais assiégeaient et qu’il s’agissait de ravitailler. En approchant, il se dit qu’il fera mieux et qu’il enlèvera la ville assiégée.
C’était chose très difficile. Aussi songea-t-il à quelques gros péchés que
d’aventure
il pouvait avoir sur la conscience. Il n’y avait, d’ailleurs, pas de temps à perdre. Il trouva un chapelain, auquel il dit qu’il lui donnât hâtivement l’absolution. Le chapelain lui dit qu’il voulait bien, et qu’il confessât ses péchés. La Hire répondit qu’il n’aurait pas le temps, car il fallait frapper promptement sur l’ennemi, et que le chapelain savait bien ce que les gens de guerre ont l’habitude de faire et que c’était là sa confession. Sur quoi le chapelain lui bailla l’absolution telle quelle. Alors La Hire fit sa prière à Dieu, en lui disant, en son gascon, les mains jointes :Dieu, je te prie que tu fasses aujourd’hui pour La Hire autant que tu voudrais que La Hire fit pour toi, s’il était Dieu et que tu fusses La Hire.
Et il pensait très bien dire et prier. (Chronique de la Pucelle.) - [62]
Sa charité brilla à tel point à l’égard même des ennemis, que non seulement jamais Jeanne ne blessa aucun d’eux de l’épée ou de la hache, mais que ceux qu’elle voyait gisant à terre blessés, elle les faisait relever sur-le-champ, secourir et soigner, à la grande admiration de tous. (Décret d’introduction de la cause de la Vénérable Jeanne d’Arc.)
- [63]
Dieu qui, selon la parole de l’Apôtre, appelle ce qui n’est pas, comme ce qui est, de même que jadis il avait choisi, dans ses desseins, Débora et Judith pour confondre les puissants, suscita, au commencement du XVe siècle, Jeanne d’Arc pour relever les destinées de sa patrie presque abattue par la guerre acharnée entre les Français et les Anglais et, en même temps, pour revendiquer la liberté et la gloire de la religion dont les intérêts étaient menacés. (Décret d’introduction de la cause de la vénérable servante de Dieu Jeanne d’Arc.)
- [64]
Mgr Baunard, Panégyrique de Jeanne d’Arc, p. 23.
- [65]
Ce paragraphe est emprunté, pour le fonds du récit et, souvent dans les termes, au début du second point du Panégyrique de Jeanne d’Arc, déjà cité, que Mgr Baunard prononça, à Orléans, devant Mgr Dupanloup, le 8 mai 1868.
- [66]
Le 19 août 1568, les Orléanais dressèrent et signèrent en leur hôtel de ville un acte solennel,
s’engageant à défendre la sainte religion catholique, apostolique et romaine, et à s’entre-soutenir les uns les autres jusqu’au dernier soupir de leur vie et à la dernière goutte de leur sang.
C’est la véritable et première origine de la Ligue. Celle qui fut formée à Péronne par la noblesse de Picardie ne fut signée que huit ans après, en 1576.
- [67]
Le duc Charles d’Orléans était depuis treize ans, captif en Angleterre, où il tuait le temps à faire des ballades, regardant vers le pays de France, maudissant l’ennemi, puis, faisant de belles chasses, le faucon sur poing, en compagnie de ceux qu’il venait de maudire.
- [68]
Mystère du siège d’Orléans, v. 12. 332.
- [69]
Tout le récit de cette journée, un peu confus dans les historiens, a été fort clairement élucidé par M. l’abbé Henri Debout, dont nous suivons les données exactes et précises.
- [70]
H. Wallon, op. cit., t. I, p. 204.
- [71]
Elle en aperçut un, du parti des Anglais, qui venait d’être frappé violemment à la tête. Elle descendit aussitôt de cheval et le prit dans ses bras. Puis, s’apercevant que la blessure était mortelle, elle l’exhorta, les yeux pleins de larmes, le consola affectueusement et lui soutint la tête, tandis qu’un prêtre, appelé par elle, s’inclinait vers lui et le réconciliait avec Dieu.
- [72]
M. Sepet, op. cit., p. 131.
- [73]
Et par le moyen d’icelle Jeanne la Pucelle venaient tant de gens de toutes parts devers le roi pour le servir à leurs dépens, qu’on disait qu’icelui de la Trimolle et autres du Conseil étaient bien courroucés que tant y en venait, pour le doubte (la considération) de leurs personnes. Et disaient plusieurs que si ledit sire de la Trimolle et autres du Conseil du roi eussent voulu recueillir tous ceux qui venaient au service du roi, ils eussent pu légèrement recouvrer tout ce que les Anglais tenaient du royaume de France. (Alain Chartier, cité par M. Wallon.)
- [74]
D’après M. Quicherat, l’erreur provient de ce qu’un des prisonniers anglais a dû se faire passer pour Falstoff, afin de dérouter les poursuites.
- [75]
Le roi d’Angleterre fut moins chevaleresque. Par décret du 31 août, il punit l’évêque de Troyes, avec plusieurs autres, de leur défection, par la confiscation de leurs biens.
- [76]
Lettre de Jean de Châtillon du 13 juillet 1429.
- [77]
Jeanne avait prédit à Charles VII qu’il entrerait à Reims sans résistance, et que les bourgeois viendraient au-devant de lui. La prédiction s’accomplit à la lettre.
- [78]
La grande affaire, — ajoute Lacordaire, — n’est pas la naissance du pouvoir, c’est surtout son sacre.
Cette belle et profonde parole semble n’être que le commentaire du mot prononcé par l’archevêque de Reims, Adalbéron, lors de la consécration d’Hugues Capet :
Le couronnement d’un roi de France est un intérêt public, non une affaire particulière.
- [79]
Le R. P. Ayroles l’a bien démontré à la page 654 de la Pucelle et l’Église de son temps.
Dans un chef d’œuvre, dit-il, en 1844, un jeune prêtre, qui devait devenir le cardinal Pie, félicitait hautement un historien de Jeanne, M. Lebrun des Charmettes, d’avoir rompu avec la tradition qui fait finir la mission à Reims. Le sens si profond et si juste du jeune panégyriste était heurté de voir la céleste enfant s’aventurer ainsi sans mission dans un milieu, où elle eût été si déplacée, si elle ne s’y fût pas trouvée sur l’ordre du ciel. Il y a de la continuation de la mission d’autres raisons que celles que donnait l’abbé Pie ; à défaut des documents qui lui faisaient défaut, son génie lui suggérait des raisons dont la valeur serait contestable. Mais, en présence de ceux que nous possédons aujourd’hui, il n’est plus permis de maintenir une assertion qui obscurcit si grandement la sainte jeune fille. Non ; elle ne s’est pas aventurée à poursuivre son œuvre après le sacre, sur un conseil ou un ordre humain quel qu’il fût ; est-ce que quelqu’un, fût-ce le roi, aurait-eu le droit de lui faire pareil commandement ? Aurait-elle dû s’y conformer ?
Rien ne prouve que les voix ont cessé de lui parler ? Jeanne affirme expressément qu’elles l’ont conseillée après l’assaut de Paris, sur les fossés de Melun, à Saint-Pierre-le-Moûtier. Jamais leurs conseils n’ont été aussi fréquents qu’à Rouen, elle les recevait plusieurs fois par jour. C’est une invention sans fondement et étrange de dire qu’elles lui ont donné le choix, entre continuer sa carrière ou rentrer dans ses foyers ? Comment l’auraient-elles pu la laisser à elle-même dans une élection de pareille importance ? Jeanne les eût importunées, pour en obtenir lumière. Les conquêtes faites après le sacre, celles qui pouvaient être faites si Jeanne eût obtenu le concours qu’elle demandait, prouvent qu’elle était toujours assistée. Les oraisons composées pour sa délivrance, non moins que d’autres documents, établissent que la conviction de son parti était que la céleste envoyée était loin d’avoir fourni toute sa carrière, au moment où elle tomba entre les mains des Anglais.
Les auteurs des mémoires n’ont pas eu recours à cette hypothèse pour expliquer ce que les prophéties de Jeanne peuvent présenter d’obscur. Avant la catastrophe, Gerson et le clerc de Spire avaient donné la solution que fournit l’enseignement théologique sur la prophétie. À l’exception de Bréhal, aucun des apologistes de la Pucelle ne dit le moindre mot de la prétendue fin de la mission à Reims ; ils ignoraient cette conception malsaine. Bréhal la signale à trois reprises ; mais c’est pour dire qu’elle est en opposition avec les réponses de la victime à Rouen. Jeanne parle en effet par maints endroits comme n’ayant pas encore entièrement accompli ce pourquoi le ciel l’avait suscitée.
Est-ce à dire qu’elle ne sut pas que sa mission pouvait être entravée ? Interrogée pourquoi elle n’avait pas délivré le duc d’Orléans de sa prison*, ainsi qu’elle l’avait annoncé, elle ne répond pas en niant la prophétie ; elle la confirme en disant qu’elle l’aurait fait, soit par échange de prisonnier, soit par une
descente en Angleterre
, si elle n’en avait pas étéempêchée
. Il serait puéril et indigne d’elle de supposer qu’elle parlait d’un empêchement venu du parti anglais.Le sentiment que la mission finissait à Reims n’a d’autre fondement que quelques paroles de Dunois, qui, au fond, n’exprime qu’une manière de voir du grand capitaine. Il avoue que Jeanne parlait souvent dans un sens contraire ; mais, dit-il, c’était pour animer les soldats. Ce n’était pas la raison qui le lui faisait répéter à Rouen ; ce n’était pas la raison qui le lui avait fait consigner dans ses lettres les plus solennelles, dans ses entretiens particuliers. En réalité, pareille manière d’expliquer la double période de la vie guerrière de de Jeanne est en opposition avec tous les monuments historiques. L’esprit en est offusqué d’instinct ; le reste de la carrière en demeure voilé, et la sainte fille, si constante avec elle-même, devient, une énigme.
* Au procès de la réhabilitation, un témoin, non moins intime dans la compagnie de la Pucelle que Dunois, le duc d’Alençon, l’a dit expressément :
Elle disait, dépose-t-il, qu’elle avait quatre charges mettre en fuite les Anglais, faire consacrer et couronner le roi, délivrer le duc d’Orléans et faire lever le siège mis par les Anglais devant Orléans.
- [80]
Jeanne d’Arc sur les autels, chap. III.
- [81]
M. Sepet, op. cit., p. 161.
- [82]
Quand ses juges lui demandèrent pourquoi elle avait fait cette offrande, elle répondit :
Ce fut par dévotion ; c’est la coutume des gens d’armes quand ils sont blessés ; j’avais été blessée devant Paris ; j’offris mes armes à saint Denis, parce que c’est le cri de France (Montjoie Saint-Denis).
- [83]
Ces détails résultent des dépositions du procès habilement mises en œuvre par M. Sepet (op. cit., p. 120 et 121), qui nous paraît cependant un peu trop concéder à l’opinion de ceux qui regardent l’inspiration de Jeanne comme terminée au sacre de Reims.
- [84]
Le fait figure au procès de Rouen en ces termes :
L’Assesseur. — Quel âge avait l’enfant que vous avez ressuscité à Lagny ?
Jeanne. — C’était un enfant de trois jours On l’apporta devant l’image de la sainte Vierge à Lagny ; on me dit que les jeunes filles de Lagny étaient devant cette image et que j’y voulusse bien aller prier Dieu et la sainte Vierge, de rendre la vie à l’enfant. J’y allai avec les autres et priai ; finalement, la vie apparut en l’enfant. Il bâilla trois fois, et puis fut baptisé. Aussitôt après il mourut et fut inhumé en terre sainte. Il y avait trois jours, disait-on, que la vie n’était apparue en l’enfant, et il était noir comme ma cotte. Mais quand il bâilla, la couleur commença à lui revenir. Pour moi ‘ étais avec les autres jeunes filles, à genoux devant Notre-Dame.
L’Assesseur. — Ne dit-on point, dans la ville, que c’était vous, qui, par vos prières, aviez fait faire cette résurrection ?
Jeanne. — Je ne m’en occupai point. (Interrogatoire du 3 mars.)
- [85]
Debout, op. cit., t. II., p. 2 et suivantes.