Autres éditions
Autres éditions notables de Jeanne d’Arc
Sommaire
- Émile Bourgeois (1888) Avec Introduction et Répertoire alphabétique des sources historiques utilisées par Michelet.
- Gustave Rudler (1925-1926) L’édition de référence en 4 volumes.
- Hatier (1932) Introduction de Charles-Marc Des Granges.
- Hachette (1935) Introduction de Louis-Fernand Flutre.
- Larousse (1941) Introduction de Henri Chabot, avec une chronologique de la vie de Michelet, une notice historique et littéraire de l’œuvre, et une sélection d’opinions d’écrivains.
Émile Bourgeois (1888)
Nous reproduisons ici l’Introduction fort intéressante d’Émile Bourgeois, ainsi que son Répertoire alphabétique qui recense de manière exhaustive et détaille les références historiques employées par Michelet.
- Introduction
- Biographie de Jules Michelet
- Jeanne d’Arc et Michelet
(Nota : les sous-titres ont été ajoutés à la présente édition) - Liste chronologique des œuvres de Michelet citées dans cette notice
- Principaux travaux relatifs à l’histoire de Jeanne d’Arc
- Carte indiquant l’itinéraire de Jeanne d’Arc
- Répertoire alphabétique
(Les articles suivants sont particulièrement dignes d’intérêt)- Buchon
- Notices des manuscrits (L’Averdy)
- Procès de condamnation (manuscrit)
- Procès de révision (manuscrit)
- Quicherat
Introduction
I. Michelet
Jules Michelet est né à Paris, le 21 août 17981. Les premières années de sa vie, rudes et misérables, développèrent en lui les qualités maîtresses dont était formé son génie, une singulière puissance d’amour et de sympathie, une puissance au moins égale de travail et de volonté. Je suis resté peuple
, a-t-il dit lui-même : il attribuait à ses origines plébéiennes la chaleur, la tendresse de cœur et l’impression d’une vie âpre et laborieuse
qu’il garda toute sa vie.
Ses parents, des plébéiens en effet : son grand-père, ancien maître de musique à Laon, son père imprimeur, marié à une jeune fille très simple, vinrent à Paris, en 1793, pour y installer une imprimerie et furent ruinés en 1800 par un arrêté du premier consul qui supprimait les journaux. Depuis lors jusqu’en 1815, la famille de Michelet vécut au jour le jour, dans des logis tristes et humides, jeûnant quand il ne venait point d’ouvrage ; l’enfant souffrit de la faim, du froid. Et pourtant il ne garda de ces temps de misère et de souffrances aucun souvenir amer. À défaut de bien-être, il trouvait au foyer paternel des ressources de tendresse inépuisables. Sa mère, aux heures de détresse, l’attirait près d’elle, et le consolait en lui disant : Ne crains rien, tu es sous mon aile.
Il vivait de sa vie ; c’est d’elle qu’il apprit à lire, avec elle qu’il lut ses premiers livres, les Reines et régentes de France, qui éveillèrent en lui le goût de l’histoire. Son père, qui supportait les épreuves avec une patience digne d’Épictète
, et avec la certitude vraiment touchante que son fils serait le consolateur et l’honneur de la famille
, s’imposa tous les sacrifices pour le mettre en 1812 au lycée Charlemagne. Une chose saine et forte, disait Michelet plus tard, m’est restée de ces années de malheur. C’est cette fanatique espérance placée dans un enfant. Mon père est en réalité l’auteur et le créateur de ma destinée. Grâce à lui, à sa bonté, à ses privations, j’eus ce qui est le moyen, le premier élément de tout, j’eus de la liberté, du temps, je pus penser.
À cette école de misère et de dévouement, Michelet, que sa sensibilité exquise préparait à comprendre la valeur de pareils sacrifices, apprit de bonne heure la puissance de la bonté et de la sympathie humaine : Être bon, dit Michelet, et rester tel entre les injustices des hommes et les sévérités de la Providence, ce n’est pas seulement le don d’une heureuse nature, c’est de la force et de l’héroïsme, cela est divin.
Il eut alors aussi, sous les yeux, constamment l’exemple du travail et il en prit l’habitude : au moment où l’imprimerie de son père fut ruinée par les décrets du premier consul, où il fallut renvoyer les ouvriers et transporter les presses dans une cave de la rue de Bondy, humide et obscure, toute la famille se mit à l’ouvrage. Le grand-père imprimait de ses mains tremblantes ; la mère, déjà malade, se fit brocheuse, coupa, plia
; Michelet, à peine âgé de douze ans, composait, s’apprenant tout seul à assembler les lettres. Il fréquentait dans la journée l’école d’un vieux maître de pension jacobin, où il prit aisément la première place, il retournait le soir à l’atelier, et là, courbé sur sa casse, il sut avant l’heure ce que c’était que souffrir et vouloir, vouloir, non le vain désir, mais la volonté réalisée par le travail obstiné !
Quand il entra à Charlemagne, ne sachant ni traduire un mot de grec, ni construire un vers latin, effarouché comme un hibou en plein jour
, il fit tout ce qui était humainement possible pour réussir : Sans feu (la neige couvrait tout), ne sachant pas si le pain viendrait le soir, j’eus un pur sentiment stoïcien de courage et de mâle énergie. Je frappai de ma main crevée par le froid sur ma table de chêne et je sentis une joie virile de jeunesse et d’avenir.
Il réussit : au sortir du collège, dont il avait été l’un des plus brillants élèves, il renonça pour aider ses parents pauvres qui l’avaient aidé dans les mauvaises années
à l’École normale, et accepta pour vivre et faire vivre les siens la rude tâche de répétiteur dans une pension du Marais (1816). Il traversait Paris à cinq heures du matin, lisant en route, pendant l’été, ses auteurs grecs et latins ; il revenait, après une longue journée, se remettre le soir au travail. Il apprenait pour être en état d’enseigner aux autres et pour s’instruire lui-même
.
En 1819 il prit le grade de docteur, fut reçu agrégé en 1821 ; il entra au collège Sainte-Barbe-Rollin comme professeur d’histoire. La vie matérielle était assurée : il avait un vrai métier
; au moment où, après avoir aidé ses parents, il assumait une nouvelle tâche : il épousa une pauvre fille que sa mère, mariée à un noble, puis remariée à un acteur, reniait presque et maltraitait. Le souvenir de cette première époque de sa vie, de cette lutte précoce contre la misère ne s’est jamais effacé de l’esprit de Michelet. Il semble même qu’il ait aimé ces années de privations pour l’exemple et l’amour du travail qu’elles lui avaient donnés, pour l’énergie morale et les qualités de conscience et de dignité qu’elles développèrent en lui.
Dès lors l’unité de sa vie est faite, comme aussi celle de son œuvre : chef de famille, professeur d’histoire, historien, il donna aux siens, à ses élèves, à la science, tout ce qu’il avait en lui d’amour et d’ardeur au travail.
Jusqu’en 1827 il vécut modestement dans un cercle étroit entre le Marais, le Jardin des Plantes, Bicêtre, le Père-Lachaise ; au fort de l’hiver il montait vers Sainte-Barbe par la rue Saint-Jacques, sans paletot pour se couvrir ; il publiait trois livres, dont le dernier seul eut du succès, les Tableaux chronologiques et synchroniques d’histoire moderne (1825-1826), une traduction abrégée de la Scienza nuova de Vico, et enfin un admirable Précis d’histoire moderne. Dans cette seconde période de son existence individuelle, comme il dira plus tard, où le public ne le connaissait point, et où il ne connaissait le monde que par ses élèves, Michelet était déjà tout entier. Fidèle à la mémoire de ceux qui l’avaient aimé, aux pieux souvenirs de son enfance, il mettait en pratique à son foyer les leçons qu’il donnera plus tard dans l’Amour, dans la Femme. L’enseignement n’était pas pour lui seulement un métier, mais une noble tâche, la plus haute de toutes et la plus féconde ; il communiquait à ceux qui l’écoutaient l’ardente flamme intérieure
qui l’animait, et il se faisait en son cœur, au contact de ces jeunes gens aimables et confiants qui croyaient en lui, après les années de misère, un grand apaisement.
De bonne heure il avait eu du goût pour l’histoire : sa jeune imagination s’était émue un jour d’une visite au musée des Monuments français. Il y avait senti les morts à travers les marbres. Mais ce fut surtout en enseignant qu’il devint historien : il reconnut que l’étude des dates, des faits politiques, plus aride que celle des institutions
, des religions et des mœurs, que la critique des faits par les documents contemporains, le sévère jugement de ceux qui furent
étaient la condition première de tout enseignement, de toute recherche historique. Il chercha le vrai, pour éclairer le jeune public qui lui était confié, avec une ardente curiosité et un sentiment de la précision qui sont la source et le fondement même de la science.
Mais il ne pensait pas que le dernier objet de la science fût de fournir une satisfaction égoïste à celui qui la pratique : avant tout, l’érudition historique devait être un moyen de retrouver et de révéler aux générations de notre temps la raison secrète du progrès de l’humanité. Ces raisons, il crut les trouver dans Vico, et il proclama avec lui que l’humanité est son œuvre à elle-même, qu’elle n’est ni l’esclave des climats et des milieux, ni l’instrument servile des grands hommes et des dieux : fatalisme de races, fatalisme légendaire des grands hommes providentiels, deux écueils à éviter
. C’était pour apprendre à ses contemporains à vivre que Michelet voulut savoir comment leurs ancêtres avaient vécu, et pour le savoir, il se résolut à vivre avec eux, se replaça dans leurs milieux, entra dans toutes leurs doctrines, se passionna pour toutes leurs affections
. Ainsi, par la magie de son imagination et la toute-puissance de son cœur, il établissait comme un grand courant sympathique entre les hommes de son siècle et tous les hommes des siècles passés. L’histoire devenait une résurrection. Le véritable historien, c’était, pour Michelet, celui qui, à force d’amour et de science, de labeur et de sympathie, pouvait rendre la vie aux morts pour l’apprendre aux vivants. Et Michelet était bien en 1827 cet historien, un maître, dans toute l’acception du mot : Si j’avais comme historien, disait-il, un mérite spécial qui me soutînt à côté de mes illustres prédécesseurs, je le devrais à l’enseignement, qui pour moi fut l’amitié. Ces grands historiens ont été brillants, judicieux, profonds. Moi, j’ai aimé davantage.
C’est ainsi que fut conçue et exécutée sa première grande œuvre historique, l’Histoire de la République romaine, commencée en 1828, publiée en 1831. Au temps où elle parut, l’histoire romaine n’était connue en France que par des abrégés secs, sans intérêt et sans critique ; personne ne lisait plus ni les travaux de Beaufort sur les origines de Rome, ni ceux de Lenain de Tillemont sur sa décadence. Seuls les Allemands avaient repris avec Niebuhr, en 1811, l’étude des antiquités romaines : il avait fallu un Barbare pour renouveler l’histoire de Rome !
Michelet s’inspira des travaux de Niebuhr, en les critiquant, entra en relation avec ses successeurs, Bunsen, Gerhard, étudia les textes anciens, visita Rome et, au lieu de dissertations, il fit une histoire qui fut à la fois une résurrection de Rome et du romanisme en France. Et nous Français, ne réclamons-nous pas notre part dans cette Rome qui fut à nous ? La longue et large épée germanique pèse sans doute, et celle de la France n’est-elle pas plus acérée ?
Michelet ne se proposait pas seulement d’enlever aux Allemands le privilège de l’érudition : une pensée plus haute encore l’avait soutenu dans ce prodigieux labeur, un grand sentiment lui avait inspiré ses plus belles pages. S’il ressuscitait Rome, c’était pour qu’elle parlât aux Français, ses héritiers, des destinées et de la mission de la France. Peu de temps avant, il avait publié son Introduction à l’histoire universelle, où il disait son dessein d’éclairer l’histoire de France par l’histoire romaine, et l’avenir du monde moderne par l’histoire de la France, ce pilote du vaisseau de l’humanité
. Cette conception avait un objet moral : cette étude devait être un enseignement pour tous les enfants du siècle atteints, selon le mot de Musset, d’une abominable maladie morale, qui n’est point encore aujourd’hui guérie. Michelet voulait la guérir, tandis que Musset, après Goethe et Byron, se contentait de la décrire. Il invoquait le témoignage des anciens pour rendre courage à ses contemporains ; comme la France, Rome n’avait-elle pas eu ses époques de grandeur, de doutes aussi et d’angoisse mortelle ? Ses victoires, comme ses souffrances, avaient fait l’unité matérielle et morale du monde ancien. La maladie du dix-neuvième siècle était peut-être le prix de l’unité morale du monde moderne.
En 1827 Michelet fut appelé comme professeur d’histoire à l’École normale. L’homme qui, pour son modeste auditoire de Sainte-Barbe, s’était fait savant, sans cesser d’être professeur, était bien désigné pour être le maître des maîtres. En 1831 le gouvernement de Louis-Philippe le nomma chef de la division historique aux Archives nationales. C’était lui confier à la fois toute l’éducation historique de la jeunesse française et tous les trésors de notre histoire nationale, une grande mission et de pleins pouvoirs pour la remplir. Michelet n’y faillit point : ses élèves de l’École normale ont gardé de son enseignement un souvenir ineffaçable. Aux Archives il exhumait avec l’ardeur d’un bénédictin des documents que personne avant lui n’avait connus ; il les classait avec un soin religieux. Les découvertes qu’il y faisait lui fournissaient chaque jour pour ses élèves la matière de leçons nouvelles, incessamment renouvelées. Et ces leçons à leur tour, les questions et les doutes qu’elles soulevaient, l’obligeaient à examiner de plus près tous les témoignages, à en rechercher de nouveaux, le ramenaient sans cesse aux Archives, acharné à la poursuite de la vérité. Il allait ainsi de ces jeunes gens qui étaient l’avenir à ces parchemins usés et noircis qui étaient comme les témoins du passé. Aux uns il parlait un langage vivant et cependant précis ; il écoutait les témoignages des autres avec recueillement, interprète ému et fidèle entre la France d’autrefois et celle d’aujourd’hui.
Le moment lui parut alors venu d’écrire ce qu’il enseignait, de fixer cette vaste révélation de la France
, pour que d’autres pussent enseigner à leur tour et que tous pussent apprendre la France
. En 1833 il publia le premier volume de son Histoire de France, dont l’Histoire romaine et l’Introduction à l’histoire universelle n’étaient que la préface, qu’il n’abandonna plus, et qui demeure son ouvre capitale. Il n’avait pas pris le temps d’achever la préface. L’histoire des empereurs romains, qu’il avait annoncée, était sacrifiée. Michelet ne fut jamais un de ces savants qui, désintéressés de tout, hormis de leur œuvre, la poursuivent froidement, méthodiquement. Toujours professeur, travaillant à faire des hommes et des Français, il avait hâte d’écrire dès qu’il avait l’occasion et les moyens d’enseigner. Il écrivit alors l’Histoire de France, parce qu’il en trouva l’occasion à l’École normale, et les moyens aux Archives. Les six premiers volumes parurent de 1833 à 1844 : dans l’ensemble de l’œuvre, ils forment une première série, presque indépendante, la plus belle et la plus durable. Le premier volume fut encore une sorte de préface, l’histoire des origines, celtiques, mérovingiennes, carolingiennes. Les autres renfermaient ce que les Français connaissaient le moins alors, et ce qu’ils auraient dû surtout connaître, l’histoire de la formation de la patrie française. Michelet la présenta comme un drame, dont l’héroïne était la France, dont les acteurs étaient les hommes même du passé ressuscitant. Il montra la France au début, aux temps féodaux, réunion de provinces, vaste chaos de fiefs, grand pays d’idée vague
; il la montra ensuite moins France que chrétienté, obscure et comme perdue dans cette grande ombre
. Il la vit enfin devenir avec Jeanne d’Arc et Louis XI comme une âme, une personne. L’exposition du drame, c’était cet admirable tableau des provinces qui ouvre le second volume, le dénouement, l’histoire de Jeanne d’Arc, la patrie française, naissant du cœur d’une femme, de sa tendresse, de ses larmes, de son sang
.
Quand il conçut cette œuvre puissante, qu’il lui donna cette forme dramatique, Michelet fut un poète dans le sens rigoureux du mot, un créateur, tout en restant un érudit. Le public ne s’y trompa point : il considéra justement cette histoire comme l’un des monuments de la pensée française. La jeunesse y trouva le remède qu’elle cherchait, et vit un guide dans cet homme qui, de son patriotisme, tirait une grande leçon morale ; elle applaudit avec lui au triomphe de l’homme sur la nature, de l’esprit sur la matière. Les historiens eurent un maître qui leur enseigna à travailler directement sur les pièces inédites, à construire solidement une œuvre historique sur une base énorme d’actes, de manuscrits, de pièces rares, patiemment accumulés, habilement fondus. L’ardente sympathie de Michelet lui gagna les cours ; son énergie morale put former des volontés ; sa conscience fut un exemple.
En 1838 il quitta l’École normale pour entrer au Collège de France et à l’Institut, sous le patronage de Burnouf. Autour de sa chaire il trouva un auditoire plus vaste que celui de l’École normale, non plus seulement les maîtres de la jeunesse française, mais l’Europe ou ce qu’il croyait être l’Europe. Les cours du Collège de France étaient alors fréquentés par un assez grand nombre de jeunes étrangers qui fuyaient le despotisme de la Sainte-Alliance, applaudissaient aux leçons de Mickiewicz et d’Edgar Quinet. La France parut un moment l’asile de la liberté : Ma patrie seule peut sauver le monde
, s’écriait Michelet. Il résolut de le prouver.
Cette chaire d’histoire et de morale qu’on lui confiait n’avait été jusque-là occupée que par des érudits, Crevier, Daunou, Letronne : il en fit une vraie chaire, d’où il prêcha en enseignant. Certes il n’entendait pas trahir la science, ni conclure sans étudier. Mais il voulait conclure, et de la science tirer un principe d’action
. Il avait un désir passionné d’accorder la science et l’âme humaine. Le grand titre de sa chaire l’y autorisait fortement.
L’occasion s’offrait de formuler les conclusions qu’il avait annoncées dans ses premiers livres, de s’élever de l’idée de la patrie à celle de la patrie universelle, de dire comment la Révolution française avait préparé le salut des nations. Et, comme l’écrivain en lui se subordonnait toujours au professeur, il interrompit son histoire de France pour aborder l’histoire de la Révolution, afin de coordonner ses études et son enseignement.
Mes cours posèrent le droit du peuple, dit-il : de là le livre de ce nom, de là ma Révolution.
Le Peuple parut en 1846 : ce n’était plus une œuvre historique, mais une autobiographie, un manuel du patriote et du citoyen, l’Évangile de la Révolution, de la religion qu’il prêchait.
C’était de l’histoire encore que son Histoire de la Révolution, publiée de 1847 à 1853 : fidèle à ses habitudes de conscience et de travail, Michelet l’avait encore préparée par de longues et heureuses recherches dans les Archives, archives centrales, archives de la commune de Paris, archives de Nantes. Il s’était procuré des documents innombrables, curieux, qui ont été perdus depuis et que d’autres historiens n’ont point connus. Peut-être n’avait-il plus toute l’indépendance d’esprit nécessaire pour en faire la critique ? Il est assez délicat de concilier le désintéressement du savant avec l’enthousiasme de l’apôtre. Michelet se croyait appelé avec Quinet et Mickiewicz à un apostolat social. Il s’était donné une mission, une mission de combat. Il luttait au Collège de France, dans la presse, dans ses livres : Des Jésuites (1843), Du prêtre, de la femme, de la famille (1845), pour une religion, contre une autre religion. C’est alors qu’il fixa dans son Histoire de la Révolution la légende sacrée et les souvenirs héroïques de cette grande époque. Il en fit sentir l’enthousiasme : s’il ne la jugea pas dans le détail avec impartialité, il en marqua mieux que personne le caractère religieux et désintéressé. En ce sens, il fit œuvre d’historien, œuvre durable.
Michelet put croire, en voyant éclater la révolution de 1848, que son œuvre de propagande et de foi ne serait pas stérile : n’était-ce point enfin cet affranchissement qu’il avait rêvé de la France par la Révolution, de l’Europe par la France ? Les événements de 1850-1851, la réaction, le coup d’État, le désabusèrent cruellement. Il fit cette triste expérience que l’humanité n’écoute guère ceux qui l’aiment et travaillent à son progrès qu’après les avoir maltraités : ce qui ne doit pas empêcher d’ailleurs de se dévouer à elle, et de l’aimer.
En 1851 Michelet fut destitué de sa chaire au Collège de France ; en juin 1852 il refusa de prêter serment comme garde des Archives et quitta les Archives. Enfin son Précis de l’Histoire moderne fut rayé de la liste des ouvrages autorisés dans les collèges. Tout lui manquait à la fois, les ressources matérielles, le métier dont il vivait, les ressources de travail dont il disposait depuis vingt ans, son auditoire, ses élèves, son enseignement, ses affections domestiques, sa femme morte en 1839, son père mort en 1846, ses enfants établis au loin, ses espérances les plus chères brisées.
C’est alors qu’il épousa en secondes noces celle qui devait être la compagne de ses vingt-cinq dernières années ; et par elle il retrouva tout ce qui, depuis sa jeunesse, avait fait l’unité de sa vie et de son œuvre. Michelet de nouveau eut une affection intime qui le consola des deuils du passé, des misères du présent. Comme aux temps de son enfance contre la pauvreté, il trouva dans sa famille un concours précieux, la collaboration de l’intelligence et du cœur. À la campagne, près de Nantes, en Italie, au bord de la Méditerranée, au pied de l’Apennin où ils étaient allés chercher le repos et la solitude, Michelet et sa femme se mirent courageusement à l’œuvre. Les matériaux de l’œuvre seuls furent nouveaux : ce n’étaient plus les livres ni les documents du passé, mais la nature, observée, regardée de près, qui éveilla dans cette âme de poète des voix inconnues. L’Oiseau (1856), l’Insecte (1857), la Mer (1861), la Montagne (1868) apportèrent au public, qui leur fit un accueil enthousiaste, les fruits de cette inspiration nouvelle et féconde.
Michelet ne pouvait pourtant pas se passer de l’enseignement : l’Empire, en le séparant de ses élèves, l’avait frappé cruellement. Son mariage le consola de cette injustice. Il retrouva un auditoire, moins vaste, un seul élève, mais un élève qu’il s’attacha à former, digne de lui, sa femme encore. Il l’associa à ses travaux d’historien, et continua devant elle son Histoire de France, qui fut achevée de 1855 à 1867. Si cette seconde partie est inférieure à la première pour le nombre et la valeur des documents employés, ce n’est pas à l’historien qu’il faut le reprocher, mais à ceux qui lui retirèrent les moyens de faire autrement. S’il a abusé, dans ses derniers volumes, de l’histoire naturelle, c’est que la nature lui fut plus clémente alors que les hommes.
Et pourtant, tandis que les hommes l’exilaient, animé toujours pour eux de la même sympathie et du même zèle, il tirait de sa vie intime, qui valut mieux que celle de ses contemporains, des leçons nobles et salutaires : il enseignait encore à la jeunesse, en dépit des gouvernements, dans l’Amour (1858), la Femme (1859), la Bible de l’humanité (1864), Nos fils (1869), la religion du foyer : la pierre qui porte les cités
. Michelet a prouvé, par l’exemple de toute sa vie, la valeur de ces préceptes. Depuis sa jeunesse jusqu’à ses derniers jours il a puisé dans la famille l’amour du travail, l’amour de la patrie et de l’humanité qui firent de lui un professeur incomparable, un grand Français et un grand homme.
Il ne pouvait pas survivre aux malheurs de la France. En 1870 les fautes de ses concitoyens, la défaite du droit en Europe le frappèrent mortellement. Pendant l’Empire il avait adressé des appels éloquents à ses concitoyens, à l’étranger. Il publiait, en 1853, de nouveau, séparément, comme des leçons de patriotisme, sa Jeanne d’Arc, son Louis XI. Pour plaider devant l’Europe la cause des vaincus, martyrs de la liberté et du droit
, il publiait, en 1851, Pologne et Russie, en 1863, la Pologne martyre. Ce lui fut un coup terrible, quand, exilé de France par la guerre et la maladie, Paris investi, il vit la France abandonnée de tous, livrée à la force du vainqueur. Il parla du moins, s’il ne put agir. Il publia une brochure dont le titre était la France devant l’Europe, et l’épigraphe : Les juges seront jugés. Frappé d’apoplexie à la nouvelle de la capitulation de Paris, il trouva encore la force de publier les trois premiers volumes d’une histoire du XIXe siècle, qu’il conduisit jusqu’à Waterloo afin de ramener la justice dans cette histoire obscurcie
. La mort ne lui permit pas d’achever : elle le prit à Hyères, le 9 février 1874, à midi.
Michelet a jugé avec sérénité sa vie et son œuvre dans son testament, qui a été publié en 1874 : Dieu me donne de revoir les miens et ceux que j’ai aimés. Qu’il reçoive mon âme reconnaissante de tant de bien, de tant d’années laborieuses, de tant d’œuvres, de tant d’amitiés.
La postérité n’aura pas d’autre jugement. La vie de Michelet demeurera comme un exemple de désintéressement, de patriotisme et de labeur.
II. Jeanne d’Arc et Michelet
Michelet avait une préférence, qu’il avouait, pour son histoire de Jeanne d’Arc. Il disait ma Jeanne d’Arc
avec attendrissement ; et il ajoutait avec un orgueil naïf que d’autres après lui raconteraient encore la vie de cette sainte, mais que personne ne ferait plus pour elle ce qu’il avait fait. La critique et l’expérience de ces trente dernières années ont montré que Michelet ne se trompait point. Sainte-Beuve, qui n’aimait point sa manière historique, reconnut pourtant, en 1856, que sa Jeanne d’Arc
était plus vraie qu’aucune des précédentes. Depuis cette époque, Quicherat a consacré à l’héroïne d’Orléans un volume d’Aperçus nouveaux, M. Wallon une étude consciencieuse en deux volumes, M. Boucher de Molandon une série de recherches curieuses, M. Siméon Luce un volume rempli de vues ingénieuses et de documents nouveaux ; MM. Sepet et Fabre ont célébré dans des pages émues le miracle de foi ou de patriotisme qui arracha la France aux Anglais. De tous ces historiens, aucun n’a été à la fois curieux et ingénieux, renseigné et inspiré comme Michelet. Les uns ont expliqué de leur mieux, les autres admiré l’œuvre de Jeanne d’Arc. Michelet reste encore le seul qui ait du même coup fait sentir à ce point la grandeur presque surnaturelle et comprendre la réalité historique de cette œuvre.
1. Abrégé de l’histoire de Jeanne d’Arc
L’épopée de Jeanne d’Arc, qui tient du prodige, est pourtant une histoire vraie : histoire dont les résultats furent très positifs, dont les détails n’ont rien de légendaire. On sait exactement où Jeanne d’Arc est née, quand, et de quelle famille, ce qu’était la France quand elle la sauva, et comment elle la sauva ; on connaît tous les détails de son procès, la date et la douloureuse réalité de son martyre.
Jeanne d’Arc est née le 6 janvier 1412, à Domrémy, près de Vaucouleurs. Son père, Jacques, était originaire de Champagne, de Ceffonds près de Montier-en-Der ; sa mère, du duché de Bar, du village de Vouthon qui est limitrophe de Domrémy. C’étaient des paysans qui avaient quelque bien, sans être riches, vivaient estimés de leur seigneur et de leurs voisins, servaient Dieu et secouraient les pauvres. Jeannette était la cadette des cinq enfants qu’ils avaient eus.
Jusqu’au milieu de l’année 1425, Jeanne vécut de la vie de ses parents, vaquant aux soins du ménage, prenant sa part des travaux des champs, gardant les moutons, qui sont la principale richesse de ce pays. Elle était d’une piété ardente mystique et dévote à la fois, très charitable d’ailleurs et très douce.
Entre la Champagne, qui appartenait aux Anglais, et la Lorraine, dont le duc était soumis aux Bourguignons, la châtellenie de Vaucouleurs était à peu près le seul coin de terre que Charles VII possédât encore dans l’est, grâce à la fidélité et à la vaillance du capitaine Robert de Baudricourt : Vaucouleurs à l’est, à l’ouest le Mont-Saint-Michel, le sanctuaire de l’archange qui semblait protéger la royauté légitime, étaient les dernières forteresses qui tinssent encore contre les Anglais, au nord de la Loire.
La situation morale du dauphin n’était pas moins compromise que sa situation matérielle. Il n’avait pas été sacré : était-il l’héritier de Clovis, de saint Charlemagne
et de saint Louis, qui avaient tenu le royaume de France de Dieu ? La trahison d’Isabeau de Bavière pouvait entraîner dans le parti de Henri VI, que Bedford s’apprêtait à faire sacrer à Reims, les sujets du roi légitime, et justifier toutes les défections. L’oriflamme de Saint-Denis, le patron séculaire du royaume de France, était aux mains des Anglais. L’archange Saint-Michel, qui avait rendu la raison quelque temps à Charles VI, sauvé le dauphin à la Rochelle d’une mort presque certaine et protégé ses derniers partisans de Normandie, la Vierge Marie adorée à la cathédrale du Puy-en-Velay, dont Charles VII était chanoine, feraient peut-être des miracles pour cette royauté française, abandonnée de la plupart de ses sujets, ébranlée dans ses traditions les plus anciennes. C’était le dernier espoir de ceux qui persistaient à croire en elle et à l’aimer.
C’est alors que Jeanne d’Arc, âgée de 13 ans (1425), après une attaque des ennemis, qui avaient pillé Domrémy, mais s’étaient vus forcés de restituer leur prise, touchée de tant de maux et d’un retour de fortune si inattendu, eut une première vision. Elle avait appris d’ailleurs dans son village, situé à la fois sur la route d’Allemagne et sur celle des bords de la Meuse, la croix des routes
, la défaite des Anglais devant le Mont-Saint-Michel, qu’ils assiégeaient depuis dix mois. Saint-Michel protégeait la France : Jeanne l’entendit qui lui disait la pitié du royaume de France
, et lui intimait l’ordre de secourir le roi légitime. Elle l’entendit plusieurs fois ; elle le vit. Elle hésita trois ans : enfin, le 13 mai 1428 elle s’en alla trouver le capitaine Robert de Baudricourt, qui la renvoya à ses parents. Mais, la même année, une nouvelle attaque des Bourguignons contre Domrémy força la famille d’Arc à se réfugier à Neufchâteau ; Jeanne, au retour, voyant son village saccagé, convaincue peut-être par des franciscains que l’année 1429, où l’annonciation de la Vierge tomberait le Vendredi Saint, était réservée à un grand miracle et qu’elle devait se hâter, s’enfuit une seconde fois à Vaucouleurs. Baudricourt l’accueillit mieux (janvier 1429) : les affaires du roi allaient de plus en plus mal ; Orléans était assiégé par les Anglais, et, le 17 février, le combat dit des Harengs semblait avoir décidé en faveur de l’ennemi du sort de la place. Jeanne, équipée par les habitants de Vaucouleurs, encouragée par le duc de Lorraine, auquel elle s’était présentée à la fin de janvier 1429, partit pour la cour de France, le 23 février, avec une escorte de six hommes, Jean Colet, messager du roi, Jean de Metz, Bertrand de Poulangy, hommes d’armes de Vaucouleurs, et trois servants.
Elle n’arriva pas sans difficultés jusqu’au roi, à Chinon. Elle fut attaquée aux portes de la ville par des hommes d’armes, qui avaient été peut-être apostés là par les conseillers eux-mêmes. On voulut l’empêcher de voir le dauphin Charles, et, quand on l’admit en sa présence, on fit en sorte qu’elle n’eût aucun moyen de le reconnaître. Elle le reconnut pourtant, lui promit de faire lever le siège d’Orléans, de le mener à Reims, de lui reconquérir son royaume. Elle lui rendit confiance en lui-même, dans la légitimité de sa naissance et de ses droits : ce fut là proprement son œuvre et sa mission. Charles VII, après avoir fait examiner Jeanne à Poitiers par une assemblée de théologiens, eut à son tour confiance en elle, et, dès qu’il crut en elle, il crut en lui même et reprit courage.
Pour convaincre et réconforter ses partisans, il fallait des actes. Le premier, glorieux, fut la délivrance d’Orléans, la défaite des Anglais, attaqués le 4 mai, mis en déroute le 8 mai. Ils avaient vu Saint-Michel guider contre leurs bastilles les défenseurs d’Orléans. Le second acte de la mission de Jeanne, plus fécond encore que la victoire d’Orléans, ce fut le sacre de Reims : le dauphin quitta la Loire, dont Jeanne d’Arc aidée du duc d’Alençon avait chassé les Anglais pendant le mois de juin. Le 11 juillet il prenait Troyes, le 15, Châlons ; le 17, un dimanche, il était sacré à Reims. Il n’était plus le dauphin, mais le roi de France, le seul, l’héritier vrai
qui tenait sa terre du roi du Ciel, fils de sainte Marie
. Désormais c’était la France qui était rendue à elle-même : l’abîme qui avait paru se creuser entre son passé et son avenir était comblé ; et, comme dit Michelet, la France, touchée d’être tant aimée, se mit à s’aimer elle-même
.
Il restait à délivrer le territoire des Anglais, à les bouter hors de France
. Cela ne se pouvait faire que par le même élan d’enthousiasme qui leur avait enlevé en quelques jours Orléans et Reims. Autrement, c’était affaire de temps, de politique, de stratégie. L’effet qu’avait produit le sacre de Reims fut immense : Soissons, Laon, Château-Thierry, Provins, toutes les villes de la Brie et de la Champagne s’ouvrirent au roi légitime. Mais l’enthousiasme peu à peu s’affaiblissait. Pour le ranimer, Jeanne d’Arc pressa le roi d’aller à Saint-Denis, de reprendre possession de ce sanctuaire de la royauté française, profané par l’étranger. Le roi hésitant, elle l’y devança ; elle y arriva le 26 août 1429, et quand, après l’attaque inutile du 8 septembre contre Paris, le conseil décida de revenir sur la Loire, Jeanne d’Arc se refusa d’abord à quitter Saint-Denis. Blessée, elle dut se soumettre et, le 21 septembre, suivre le roi vers Chinon, contre sa volonté. Les politiques, les seigneurs, jaloux d’elle peut-être, avaient enfin raison de la pauvre fille du peuple, qui leur semblait folle plutôt qu’inspirée.
Ils eurent tort : l’entreprise conseillée par Jeanne d’Arc était une véritable croisade, croisade pour la foi et la patrie, vers les sanctuaires de la royauté, gardienne de l’unité française. L’interrompre, abandonner les lieux saints, Reims, Saint-Denis, le Mont-Saint-Michel, c’était transformer la croisade en une guerre de sièges, la sainte en un simple capitaine. Jeanne, à partir de ce moment, douta d’elle-même, de sa puissance morale, qu’elle croyait divine, de son œuvre : elle n’entendit plus ses voix. Elle lutta encore à la requête des hommes d’armes, non plus par révélation
. Elle ne guida plus les hommes de guerre, elle les suivit, à la fin d’octobre, au siège de Saint-Pierre-le-Moûtier, près de Nevers, puis à celui de la Charité où elle échoua. Dès lors, elle eut révélation qu’elle serait prise
, et elle fut prise en effet, le 27 mai 1430, dans une sortie qu’elle fit pour délivrer Compiègne, assiégée par le sire de Luxembourg, vassal du duc de Bourgogne.
On l’enferma à Beaulieu, près de Noyon, puis, après une tentative d’évasion qui faillit réussir, à Beaurevoir en Vermandois. Le grand inquisiteur, l’Université de Paris la réclamèrent comme hérétique au duc de Bourgogne et à son vassal Luxembourg ; les Anglais l’achetèrent à ce seigneur luxueux, besogneux et cupide, comme tous les seigneurs du temps, pour 10.000 livres. Ils la transférèrent d’abord au Crotoy, puis au château de Rouen, pour la juger (juin-décembre 1430). Compiègne fut délivrée le 1er décembre, et le duc de Bourgogne défait à Germigny ; mais Jeanne resta entre les mains des Anglais. C’était une victoire qui compensait largement la perte de quelques villes.
Le procès de Jeanne d’Arc commença le 21 février 1431, dans la chapelle du château de Rouen : elle comparut, après enquête, à raison de faits concernant la foi, devant un tribunal ecclésiastique de quarante à soixante membres, chanoines, prieurs d’abbayes, docteurs de l’Université de Paris, dont le président était Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, dévoué aux Anglais, qui lui laissaient espérer l’archevêché de Rouen. Les interrogatoires commencèrent : il y en eut six publics, du 21 février au 3 mars, puis neuf secrets dans la prison même, du 10 mars au 17. Les juges ne pouvaient pas être impartiaux : la sentence leur était imposée d’avance. Les Anglais exigeaient que Jeanne d’Arc fût condamnée, et sa mission avec elle, et toute son œuvre. Les ministres de Henri VI comprenaient ce que les seigneurs français auraient dû com prendre : l’héroïne avait légitimé Charles VII et ranimé parmi les populations françaises, par l’intervention de Saint Michel et la cérémonie du sacre, la religion de la royauté et de la patrie. Prouver que sa mission était pure sorcellerie, qu’elle était inspirée non de Dieu ou des saints protecteurs de la France, mais du diable, c’était démontrer à ces mêmes populations qu’elles avaient été trompées. La force morale qui avait fait en quelques mois de Charles un roi, de la France une nation, était brisée : les armées anglaises achèveraient aisément ce qu’auraient commencé les juges.
Jeanne ne pouvait pas leur échapper, placée en face d’un dilemme terrible que nul ne pouvait résoudre. Ou elle douterait elle-même de sa mission, par crainte du supplice et par respect pour l’Église : elle renierait son œuvre, son roi et la France ; ou elle affirmerait la réalité de ses révélations, et l’Église, qui n’admet point cette communication directe des fidèles avec les saints, trouverait dans ses réponses plus d’une raison de la déclarer hérétique. De toutes manières, les Anglais auraient ce qu’ils désiraient. Le silence même ne pouvait pas la sauver : pendant tout l’interrogatoire ce fut pourtant le moyen de défense qu’elle adopta. Elle refusa de s’expliquer sur le caractère et les signes de sa mission, sans en douter jamais d’ailleurs, pour qu’on ne pût abuser de ses réponses.
On en abusa pourtant : le 5 avril, les juges soumirent une liste de douze assertions tirées des dires de l’accusée à l’Université de Paris, qui la déclara schismatique, apostate et devineresse
. Le 19 mai, les juges décidèrent qu’ils se rangeraient à l’avis des docteurs de Paris, et communiquèrent à Jeanne cette décision le 23 mai ; elle tint ferme d’abord, puis le lendemain, par crainte du supplice, elle eut une défaillance et signa l’acte d’abjuration qu’on lui présentait. Mais de nouveau, le 29 mai, elle reprit son aveu, qu’elle n’avait fait que par peur du feu, et le lendemain même, 30 mai 1431, elle fut exécutée sur la place du Vieux Marché, à Rouen. Elle mourut en nommant encore ses saints et ses saintes, confessant sa foi dans le roi et dans ses voix.
La fermeté de sa mort acheva l’œuvre de sa vie. Ce n’était plus un supplice, cela, c’était un martyre. Les Anglais avaient cru condamner une sorcière, il se trouva qu’ils avaient brûlé une sainte
.
2. Les deux procès et les sources contemporaines
Longtemps les Anglais ont maintenu leur jugement haineux et injuste sur l’héroïne : on en trouve encore la preuve dans Shakespeare. Les Bourguignons, moins acharnés contre elle, l’ont considérée comme un personnage ou un instrument politique. Et les Français en général, malgré le procès de réhabilitation que Charles VII fit poursuivre de 1450 à 1456 en l’honneur de Jeanne d’Arc, ont jusqu’au dix-huitième siècle méconnu, travesti et même profané la mémoire de la Pucelle.
Aujourd’hui cette grande figure est fixée par l’histoire, avec un degré de réalité qui n’est pas toujours atteint. Par un rare bonheur, nous avons conservé sur l’œuvre de Jeanne d’Arc, si lointaine déjà et si courte, ce qui est peut-être unique, les explications de l’héroïne elle-même, le témoignage de ses amis et celui de ses ennemis.
Jeanne d’Arc s’est expliquée à Rouen, devant ses juges, sinon sur sa mission, du moins sur sa vie, sur ses sentiments envers la France, le Roi et l’Église. Les greffiers recueillirent chaque fois en français ses réponses, à la suite des questions qui lui furent posées par ses ennemis. Après le supplice ils firent avec ces minutes et toutes les pièces officielles, l’acte d’abjuration, la sentence de condamnation, un instrument authentique, traduit en latin, contresigné et paraphé par l’un des juges et par eux-mêmes. Puis ils le copièrent à cinq exemplaires : et de ces cinq exemplaires, trois nous sont intégralement parvenus2.
En outre, lorsqu’en 1450 Charles VII ordonna à ses juges de réviser l’injuste procès de Rouen, il fit ouvrir une enquête à Domrémy, à Orléans, à Paris, à Rouen. Tous ceux qui avaient connu Jeanne dans son enfance, ses amies, ses voisins de Lorraine, ceux qui l’avaient fréquentée pendant le siège d’Orléans, ceux qui l’avaient connue ou suivie à la cour ou à l’armée, les bourgeois de Rouen et les moines qui avaient admiré sa fermeté devant les juges et devant la mort, furent appelés au tribunal de réhabilitation. Les greffiers recueillirent chaque jour leurs dépositions, et firent, après la sentence du 7 juillet 1456, qui cassait le premier jugement, un instrument authentique. Ils le paraphèrent, comme avaient fait les notaires de Rouen, en firent plusieurs exemplaires, qui nous sont parvenus, et nous gardèrent ainsi les témoignages précieux des contemporains, des humbles et des grands seigneurs, des gens d’Église et des gens du roi.
La plupart des chroniqueurs qui au quinzième siècle ont raconté l’histoire de Jeanne d’Arc, se sont inspirés de ces témoignages : Anglais ou Bourguignons, ils ont reproduit les conclusions et les détails du procès de Rouen. Le Bourgeois de Paris, ou plutôt un clerc de l’Université, développa et accentua la réponse des docteurs de Paris aux juges de Rouen. Monstrelet, un Bourguignon, intercalait dans son texte les explications que les Anglais donnèrent, après le supplice de Jeanne, de leur conduite. Les chroniqueurs français, au contraire, l’auteur de la Chronique de la Pucelle, Thomas Basin, évêque de Lisieux, qui fut chargé par Charles VII de composer un mémoire sur les irrégularités du procès de Rouen, le rédacteur du Journal du siège d’Orléans, citèrent des passages entiers du procès de réhabilitation, les dépositions de Dunois, du duc d’Alençon. Seuls Jean Chartier et Perceval de Cagny, serviteur du duc d’Alençon, ont fait exception et déposé dans leurs chroniques, avant le procès de révision, en faveur de l’héroïne d’Orléans. En sorte que les pièces des deux procès demeurent pour les historiens de notre temps, comme pour les chroniqueurs du quinzième siècle, la source première d’une histoire vraie de Jeanne d’Arc.
3. Le travail de Michelet
C’est l’un des mérites de Michelet que de l’avoir compris : quelle qu’ait été l’émotion de l’historien en écrivant cet Évangile, la vie de Jeanne d’Arc, il s’est attaché, a-t-il dit, au réel, sans jamais céder à la tentation d’embellir
. Michelet n’avait pas à sa disposition l’édition définitive que Quicherat a donnée, de 1841 à 1850, des pièces originales des deux procès, conservées à la Bibliothèque nationale : il prit l’analyse et les extraits qu’un académicien du dix-huitième siècle, L’Averdy3, avait publiés en 1790, dans les Notices des manuscrits de la Bibliothèque royale ; et l’on peut voir au bas des pages, par de nombreux renvois, combien il s’en est servi ; il se servit aussi de l’édition très incomplète que Buchon avait insérée dans sa Collection, d’après une compilation manuscrite de la bibliothèque d’Orléans. Mais sa conscience était si grande qu’il ne se contenta ni des extraits de L’Averdy ni de la compilation de Buchon : il voulut voir les pièces elles-mêmes, il consulta les manuscrits de la Bibliothèque nationale, et par des citations nombreuses il engagea ses lecteurs à les consulter eux-mêmes. La belle publication de Quicherat leur épargnera désormais cette peine, que Michelet n’avait pas hésité à s’imposer.
S’il n’a pas étudié ni cité des chroniqueurs que Quicherat a pour ainsi dire révélés depuis, comme Perceval de Cagny ou Thomas Basin, il n’a pas, en revanche, négligé le témoignage des historiens contemporains qu’il pouvait connaître. Après les pièces originales du procès, c’est eux qu’il invoque d’abord comme autorités, Jean Chartier, Jacques Gélu, archevêque d’Embrun, les auteurs anonymes de l’Histoire du siège d’Orléans et de la Chronique de la Pucelle, les amis de Jeanne d’Arc, et ses ennemis aussi, Monstrelet et le Bourgeois de Paris. C’est la règle essentielle de la méthode historique que de préférer à tous les témoignages ceux des hommes qui ont vu et vécu ce qu’ils racontent. Michelet s’en était fait une loi invariable. Il pratiquait aussi les travaux des historiens qui l’avaient précédé, Le Brun de Charmettes, Lenglet du Fresnoy, Berriat-Saint-Prix, pour l’histoire même de Jeanne d’Arc ; pour l’histoire d’Angleterre, Lingard et Turner ; pour l’histoire de Flandre, Reiffemberg, Gachard, Quetelet, les plus célèbres des érudits belges.
Mais ce qu’il préférait encore aux histoires les mieux faites, c’étaient les recueils de documents originaux. Il n’y a pas un des grands travaux de l’érudition française qu’il n’ait connu, consulté, cité : les Ordonnances des rois de France et les décrets des conciles de Labbe, l’Art de vérifier les dates, la Gallia christiana, les Actes de l’ordre de Saint-Benoît, l’Histoire de Lorraine, l’Histoire de l’Université de Paris, les Actes des Bollandistes, les Archives administratives de Reims. Il consultait les hommes qui ont été les bénédictins de notre temps, Quicherat et M. Chéruel ; il étudiait, dans les Archives, des chroniques encore inédites. Il semble, en un mot, qu’à quatre siècles d’intervalle il ait entrepris, au nom de la science, une nouvelle révision du procès de Jeanne d’Arc, provoqué les dépositions des témoins, afin de peser leurs témoignages et d’établir avec impartialité les responsabilités de chacun.
C’est pour cette raison même, qu’en faisant une histoire vraie, il a fait de Jeanne d’Arc une histoire si vivante. Il est devenu, pour ainsi dire, un homme du quinzième siècle, à force d’entendre le langage des gens de ce siècle, et puis il s’est fait leur interprète auprès de nous. D’un mot il nous a expliqué, résumé leurs opinions, leurs sentiments, sans nous embarrasser de leurs longs discours. C’est dans une courte note qu’il nous a dit pourquoi les gens de Domrémy, ancien fief de l’abbaye de Saint-Rémi-de-Reims, le sanctuaire de la royauté française, étaient si attachés à leur roi. Dans une phrase, il nous a montré qu’à l’extrémité du royaume, ce petit village, sur la route de l’Allemagne et de la Meuse à la fois, croix des routes
, ressentait aussitôt le contre-coup des événements qui pouvaient relever ou abattre les cours fidèles au roi et à la patrie. Voilà, en quelques traits, le milieu où est née Jeanne d’Arc : d’autres historiens depuis, M. Siméon Luce, l’ont décrit plus longuement. Ils avouent eux-mêmes qu’après de curieuses recherches ils ne l’ont ni mieux ni autrement vu. D’où venait à Michelet cette intuition profonde
? Le mot est de M. Siméon Luce. Il avait vécu à Domrémy, connaissant les sentiments, partageant les émotions et les espérances des partisans du dauphin.
Nul n’était mieux préparé que Michelet à sympathiser avec eux : toute sa vie a été faite d’angoisses, d’espérances, de pensées patriotiques. Son enseignement était une école de patriotisme ; ses livres, ouvrages d’histoire ou de morale, des moyens d’éducation nationale. Cela lui venait de son exquise bonté. Le sauveur de la France devait être une femme : la France était femme elle-même.
En parlant ainsi de la France et du miracle d’amour qui la sauva au quinzième siècle, Michelet prouvait qu’il était, comme il l’a dit, profondément le fils de la femme
. Il eut, en étudiant Jeanne d’Arc, cette intuition que l’amour seul peut donner, et qui fait le génie.
Émile Bourgeois,
Lyon, 2 novembre 1887.
III. Liste chronologique des œuvres de Michelet citées dans cette notice
- Thèses de Michelet : Examen des Vies des hommes illustres de Plutarque. — La philosophie de Locke. Paris, 1819.
- Tableau chronologique de l’histoire moderne. Paris, 1825.
- Tableaux synchroniques de l’histoire moderne. Paris, 1826.
- Précis de l’histoire moderne. Paris, 1827-1829 (9 éditions).
- Principes de philosophie de l’histoire, traduits de la Scienza nuova de Vico. Paris, 1827.
- Introduction à l’histoire universelle. Paris, Hachette, 1831 (3 éditions).
- Histoire romaine, 1re partie : République, 2 vol. Paris, Hachette, 1831 (4 éditions).
- Histoire de France jusqu’au seizième siècle, 6 vol. Paris, Hachette, 1833-1844 (4 éditions).
- Des jésuites, en collaboration avec Quinet. Paris, Hachette, 1843 (7 éditions).
- Du prêtre, de la femme, de la famille. Paris, Hachette, 1845 (7 éditions).
- Le Peuple. Paris, Hachette, 1846 (4 éditions).
- Histoire de la Révolution française, 7 vol. in-8. Paris, 1847-1853 (3 éditions).
- Histoire de France depuis le seizième siècle jusqu’à la Révolution, 10 vol. in-8. Paris, 1855-1867.
- Pologne et Russie. Paris, 1851.
- Jeanne d’Arc. Paris, Hachette, 1853 (Bibliothèque des chemins de fer (3 éditions).
- Louis XI et Charles le Téméraire. Paris, Hachette, 1853 (ibid.) (3 éditions).
- L’Oiseau. Paris, Hachette, 1856 (11 éditions).
- L’Insecte. Paris, Hachette, 1857 (6 éditions).
- L’Amour. Paris, Hachette, 1858 (8 éditions).
- La Femme. Paris, Hachette, 1859 (6 éditions).
- La Mer. Paris, Hachette, 1861 (3 éditions).
- La Pologne martyre. Paris, 1863.
- La Bible de l’humanité. Paris, 1864.
- La Montagne. Paris, 1868.
- Nos Fils. Paris, 1869.
- La France devant l’Europe. Florence, 1871.
- Histoire du dix-neuvième siècle, 3 vol. Paris, 1872.
- Testament olographe de Jules Michelet. Paris, 1874.
IV. Principaux travaux relatifs à l’histoire de Jeanne d’Arc4
- L’Averdy, Notice du procès de Jeanne d’Arc, tirée des différents manuscrits de la Bibliothèque du roi (Académie des inscriptions, Notices des manuscrits, t. III), 1790.
- Le Brun de Charmettes, l’Histoire de Jeanne d’Arc, 1817.
- Berriat-Saint-Prix, Jeanne d’Arc.
- Jules Quicherat, Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc (5 vol., Société de l’Histoire de France), 1841-1849.
- Henri Wallon, Histoire de Jeanne d’Arc, 1860.
- Henri Martin, Jeanne d’Arc (Histoire de France, t. VI).
- Marius Sépet, Jeanne d’Arc, 1865.
- Joseph Fabre, Jeanne d’Arc, libératrice de la France, 1883.
- Siméon Luce, Jeanne d’Arc à Domrémy ; recherches critiques sur les origines de la mission de la Pucelle, 1886.
V. Carte indiquant l’itinéraire de Jeanne d’Arc
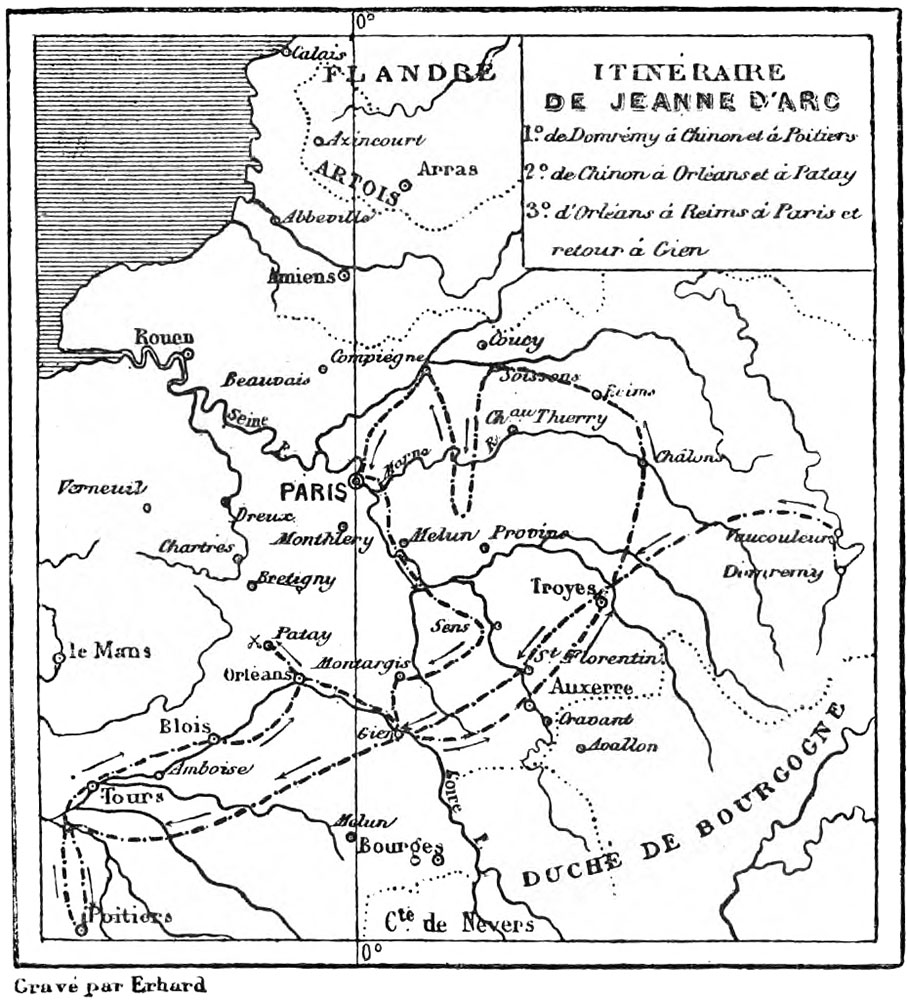
Répertoire alphabétique des recueils, manuscrits, historiens anciens et moderne, personnages cités par Michelet dans les notes de Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
Nota. — Il suffit, pour se servir de ce répertoire, de chercher, à la place qu’il occupe dans l’ordre alphabétique, le premier mot de chacune des notes de Michelet.
Acta SS. ord. S. Bened.
Lisez : Acta sanctorum ordinis Sancti Benedicti, Actes des saints de l’ordre de Saint-Benoît.
Outre les Vies des Saints dont Bolland avait entrepris la publication (voyez Actes des Bollandistes), dom Mabillon, le plus grand peut-être des érudits bénédictins, eut l’idée de publier une collection analogue, mais plus restreinte, qui ne comprendrait que les vies des saints ayant appartenu à l’ordre de Saint-Benoît. Il réalisa cette idée avec le concours de plusieurs de ses confrères, érudits comme lui et également célèbres, dom Luc d’Achery, Germain et Ruinart. Le recueil forme 9 volumes in-f°. Il parut de 1688 à 1701.
Actes des Bollandistes 20 juillet
Le véritable titre de cet ouvrage est : Actes de tous les saints qui sont vénérés dans tout le monde (Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur). C’est un recueil des Vies des Saints, qui fut entrepris au dix-septième siècle par le jésuite Jean Bolland, continué par les jésuites d’Anvers ou Bollandistes : il comptait en tout, en 1867, 60 volumes in-folio. La vie de chaque saint est placée à la date de sa fête. Le premier volume part donc du 1er janvier, le dernier aboutit au 25 octobre. Cet immense recueil est précieux pour l’histoire du moyen âge, dont les Vies des Saints sont une source importante. Rédigées pour la plupart par des contemporains, amis ou élèves des saints eux-mêmes, elles permettent de connaître de très près le caractère, l’esprit du temps, les coutumes locales, les légendes populaires. Les Annales du moyen âge ne font guère connaître que l’histoire politique ; les Vies des Saints nous renseignent sur l’histoire des meurs, des idées, des croyances.
Alençon (duc d’), sa déposition
Jean d’Alençon, né en 1409, mort en 1476, fut un des compagnons les plus fidèles de Jeanne d’Arc. Fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Verneuil (1425), il vit son duché occupé par le duc de Bedford. Il devint connétable de France en 1429, et prit à ce titre le commandement des armées françaises, qui avait appartenu jusque-là au connétable de Richemont. Avec la Pucelle, il s’empara de Beaugency, Jargeau, et fut vainqueur à Patay. Jeanne d’Arc aimait le gentil duc
parce qu’il était le gendre du duc d’Orléans, prisonnier des Anglais, et parce qu’il avait aidé les défenseurs du Mont-Saint-Michel à maintenir l’intégrité de ce sanctuaire. Elle aurait, après le sacre de Reims, voulut le suivre en Normandie : la jalousie de la Trémoille les sépara. Après la mort de Jeanne d’Arc, le duc d’Alençon reprit Alençon (1449) et contribua à chasser les Anglais de Normandie (1450). Mais il conspira avec les Anglais contre Charles VII (1456), puis contre Louis XI avec les seigneurs : deux fois il fut condamné à mort (1458, 1471) et deux fois gracié. Lorsque en 1450 Charles VII fit réviser le procès de Jeanne d’Arc, le gentil duc pour qui elle avait fait ce qu’elle n’aurait fait pour nul autre
fut appelé comme témoin. Son témoignage avait donc une valeur toute particulière. Voyez Procès de révision.
Apud Concil. Labbe
Lisez : dans Labbe, Collection des conciles. Labbe, jésuite érudit, né à Bourges le 10 juillet 1607, mort à Paris le 25 mars 1667, a publié un certain nombre de recueils de documents très précieux pour l’histoire du moyen âge. L’un des plus importants est la Collection des décrets des conciles, qui ne comprend pas moins de 18 volumes in-folio (1671). On se sert, lorsqu’on a besoin de consulter un de ces décrets, tantôt du recueil de Labbe, tantôt de celui du père Hardouin qui parut, en 1715, en 12 volumes in-folio.
Archives nationales
Elles ont été organisées d’abord en juillet 1789 par l’Assemblée Constituante qui les confia à l’archiviste Camus, puis par la Convention qui en fit un dépôt central pour toute la République et les ouvrit au public. Elles s’enrichirent, sous Napoléon, d’archives enlevées aux pays conquis, mais restituées après 1815. Les Archives nationales occupent actuellement l’ancien hôtel de Soubise à Paris. Les documents y sont répartis en séries désignées par des lettres : lettres doubles ou simples, J ou JJ par exemple. Tous les documents qui proviennent du Parlement sont compris dans une série unique désignée par la lettre X. Les registres du Parlement civil, c’est-à-dire les cahiers sur les quels on transcrivait les minutes des arrêts de la cour jugeant au civil, qui existent avec des interruptions, depuis 1254 jusqu’en 1779, forment une subdivision X1a. Les registres du Parlement criminel, une autre X2a. La série K renferme les monuments historiques : documents de la maison du roi, titres des familles royales, ou de dignités et offices, archives de négociations, copies de chartes. Le trésor des chartes, c’est-à-dire les anciennes archives de la monarchie, constituées au treizième siècle, abandonnées au milieu du seizième siècle, forme deux séries, J les layettes, JJ les registres.
Archives, registre du Parlement
Voyez : Archives.
Archives, trésor des chartes
Voyez : Archives.
Archives du Royaume
Voyez : Archives.
Art de vérifier les dates Hollande, Clèves, Comtes de Saint-Pol.
On appelle ainsi un grand répertoire chronologique qu’un Bénédictin, D. Maurice d’Antine, entreprit pour préciser exactement les dates des faits historiques
. D. Clément, son confrère, le publia après sa mort, en un volume in-4° (1750). De 1783 à 1792 l’ouvrage refondu parut en trois volumes in-folio. C’est un recueil unique qui contient, sous forme chronologique, l’histoire de tous les temps et de tous les pays du monde. Au dix-neuvième siècle, M. de Saint-Allais en a donné, en 18 volumes in-8 °, une troisième édition augmentée à l’aide de notes que la Révolution n’avait pas permis à dom Clément de mettre en œuvre. Malgré cela, la deuxième édition reste la plus estimée, sinon la plus complète.
Barante (de)
Historien et homme politique, né à Riom le 10 janvier 1782, mort le 22 novembre 1866. Pair de France, membre de l’Académie française, ambassadeur en Sardaigne et en Russie, il a publié un certain nombre d’œuvres qui ont eu un grand succès : Des communes et de l’aristocratie, 1821 ; Mélanges historiques, 1835 ; Histoire de la Convention nationale, 6 vol., 1853 ; Histoire du Directoire, 3 vol., 1855. Son œuvre la plus considérable et la plus connue, à laquelle Michelet fait des emprunts lorsqu’il cite simplement : Barante, est : l’Histoire des ducs de Bourgogne, parue en 12 volumes, de 1824 à 1826.
La méthode de l’historien est tout entière résumée dans l’épigraphe qu’il a mise en tête de cette histoire : Scribitur ad narrandum, non ad probandum : l’histoire est affaire de récit, non d’argumentation. Aussi ne cite-t-il pas, comme Michelet par exemple, ses preuves, quoiqu’il en ait pu fournir. C’est ce qui a donné à un savant belge, M. de Reiffemberg (voyez ce nom), l’idée de publier à Bruxelles, en 1835, une sixième édition de l’Histoire des ducs de Bourgogne, avec des remarques et des notes. Michelet, avec son souci ordinaire de la vérité, s’est servi de l’édition belge de préférence. Un autre savant belge, M. Gachard (voyez ce nom), a repris la même idée en 1838. Michelet ne paraît pas avoir eu cette édition à sa disposition.
Barante, d’après les Chroniques de Bretagne
Voyez : Barante et Chroniques de Bretagne.
Béatrix, sa déposition
Béatrix, marraine de Jeanne d’Arc, fut appelée à déposer au procès de révision que Charles VII fit entreprendre en 1450. Son témoignage porta particulièrement sur les premières années de la vie de l’héroïne.
Beaupère (Jean), sa déposition
Jean Beaupère, maître en théologie, était au quinzième siècle un des grands personnages de l’Université de Paris, recteur en 1413, député de Normandie au concile de Bâle. Il fut l’un des auxiliaires les plus ardents de Pierre Cauchon dans le procès de Jeanne d’Arc. C’est peut-être en raison de ses services qu’il devint chanoine de Rouen.
Bergame (Philippus), De claris mulieribus
Frère Jacques Philippe de Bergame, moine augustin, né en 1433, a consacré un article à la Pucelle d’Orléans, dans son livre intitulé : De claris electisque mulieribus (Des femmes illustres), imprimé en 1497. Cet article est plein d’erreurs ; il tient plus du roman que de l’histoire. L’auteur place Orléans sur le Rhône, et fait réhabiliter la mémoire de Jeanne par Louis XI. Son œuvre n’a quelque importance que parce qu’il prétend tenir certains renseignements d’un témoin oculaire, chevalier lombard, attaché à la cour de Charles VII.
Berriat-Saint-Prix
Jurisconsulte, littérateur, érudit, membre de l’Institut, né à Grenoble le 23 septembre 1769, mort à Paris le 4 octobre 1845. Il a publié surtout des ouvrages relatifs à l’histoire du droit. Cependant sa Jeanne d’Arc, ou Coup d’œil sur les révolutions de France au temps de Charles VI et Charles VII (1817), se recommande à l’attention des historiens. Il est le premier qui ait eu l’idée de dresser, d’après les documents, un tableau chronologique des marches exécutées par la Pucelle. Ce travail est publié en appendice à la suite de son ouvrage. M. Quicherat l’a jugé si important qu’il l’a réimprimé dans le tome V de ses pièces consacrées à l’histoire de Jeanne d’Arc (p. 377).
Bibliothèque nationale
Voyez Bibliothèque royale.
Bibliothèque royale
La Bibliothèque royale, aujourd’hui Bibliothèque nationale, a été constituée, pour la première fois avec les livres que Charles V fit réunir dans la tour du Louvre. Elle s’est formée ensuite par des dons, des acquisitions, des legs ; ses principales richesses datent de l’époque de Louis XIV, où, sous la direction intelligente de Colbert, de très nombreuses acquisitions furent faites, par les soins des bibliothécaires, de Baluze notamment. Au dix-huitième siècle, les collections de manuscrits et de livres qu’avaient eux-mêmes formées Colbert et Baluze entrèrent à la Bibliothèque royale. Pendant la Révolution, la Bibliothèque royale reçut les collections qui se trouvaient dans un certain nombre d’abbayes, celle de Saint-Victor, par exemple, celle de Saint Germain des Prés. Les manuscrits très rares et très précieux qu’elle contient sont classés d’après le lieu de provenance des collections. Le fonds Gaignières a été vendu au roi en 1711 par son propriétaire, François de Gaignières, gouverneur de la principauté de Joinville. Il contenait une admirable collection de dessins. Le fonds Baluze provient de la collection de l’érudit de ce nom, qui la vendit également au roi. Le fonds Saint-Victor provient de l’abbaye de Saint-Victor, etc.
Bibliothèque royale, msc., fonds Saint-Victor
Voyez : Bibliothèque royale.
Bibliothèque royale, coll. Gaignières
Voyez : Bibliothèque royale.
Buchon
Érudit et littérateur, né le 21 mai 1791 dans le Cher, mort à Paris le 29 août 1846. Ses travaux historiques ont été consacrés plus particulièrement à l’étude des établissements que formèrent les Français dans l’empire gréco-latin de Constantinople, après la quatrième croisade : Recherches et matériaux pour servir à l’histoire de la domination française dans les provinces démembrées de l’empire grec, 1840. — Nouvelles recherches…, 1843-44, etc. Mais son nom demeure surtout attaché à la publication de deux grandes collections précieuses pour l’histoire de France, sinon par la valeur de l’édition, du moins par son format et par l’intérêt des chroniques et des documents que le public n’avait pas à sa disposition. Ce sont :
- Collection des chroniques nationales écrites en langue vulgaire, du treizième au quatorzième siècle, Paris, 1824-1829, 47 tomes en 26 vol.
- Choix de chroniques et mémoires, dont les sept premiers volumes parurent sous ce titre, dont les dix autres furent publiés par la Société du Panthéon littéraire.
La première de ces collections renferme : (t. XXVI à XXXII), la Chronique de Monstrelet ; (t. XXXIV), une chronique de Jeanne d’Arc, dite Chronique de la Pucelle, une minute incomplète, il est vrai, du procès de Jeanne, un abrégé du procès de réhabilitation que le public ne pouvait se procurer qu’avec peine, des pièces originales de Charles VII, etc., une dissertation de l’abbé Dubois, théologal de l’église d’Orléans, qui s’est occupé particulièrement de l’histoire de Jeanne d’Arc. Ce volume parut en 1827 et a été consulté fréquemment par Michelet, qui y renvoie le lecteur de différentes manières : Procès, éd. Buchon, ou encore Procès, éd. 1827. La même édition contient, au tome IV, le Journal d’un bourgeois de Paris, qui n’avait encore été publié que par les bénédictins, et qui est très important pour l’histoire de France au quinzième siècle.
Bulæus, Hist. Univ. Paris.
Voyez : Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis.
Chartier (Alain), Chroniques du roi Charles VII
Alain Chartier, né à Bayeux à la fin du quatorzième siècle, attaché au dauphin (Charles VII), et surtout connu comme poète, a composé en latin un certain nombre d’opuscules historiques, par exemple : Sur la sortie de Paris du dauphin (1418), Harangue aux Hussites (1419), une Lettre à un prince d’Allemagne sur la Pucelle (juillet 1429) ; mais c’est à tort qu’on lui attribue, et que l’érudit Duchesne a inséré dans le recueil de ses œuvres publié en 1617 ces Chroniques du roi Charles VII. Michelet les lui attribue à son tour : il est aujourd’hui démontré qu’elles sont l’œuvre de Gilles le Bouvier dit Berry, premier héraut d’armes de France. Ces chroniques, que l’auteur eut l’idée de composer au jour le jour dès 1402, sont certainement, en ce qui concerne Jeanne d’Arc, antérieures au procès de réhabilitation. Elles ont une grande valeur, l’autorité d’un témoin qui a vu, pour toute la partie de la vie de la Pucelle qui s’étend du sacre à la malheureuse sortie de Compiègne.
Chartier (Jean), éd. Godefroy
Jean Chartier, frère d’Alain Chartier, né à Bayeux, mort en 1462, chantre de l’abbaye de Saint-Denis, avait, en 1449, le titre et les fonctions de chroniqueur de France. Son récit, très détaillé, sur Jeanne d’Arc, a une grande importance : composé antérieurement au procès de révision, il n’a pu être modifié, favorablement à la Pucelle, par les dépositions des témoins pour ainsi dire à décharge, et cependant il nous donne de l’héroïne la même impression que la lecture des pièces du procès. C’est une preuve, entre autres, de la valeur historique de ces pièces.
L’édition de Godefroy, dont s’est servi Michelet, contient de nombreuses inexactitudes. Michelet n’a pas eu à sa disposition l’édition meilleure, mais postérieure à sa Jeanne d’Arc, qu’en a donnée M. Vallet de Viriville, 3 vol. in-18.
Chéruel
Historien français, dont les travaux sur l’histoire du dix-septième siècle : l’Administration de Louis XIV (1661-1672), Histoire de Fouquet, Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV et sous le ministère du cardinal Mazarin (1879-1882) sont justement estimés. Il se fit d’abord connaître, au temps où Michelet étudiait l’histoire de Jeanne d’Arc, par des recherches remarquables sur l’histoire de Normandie. Il a publié, à l’âge de trente-et-un ans, un premier volume intitulé : Histoire de Rouen sous la domination anglaise (1840). En 1844, il en publia un second : Histoire de la commune de Rouen (2 vol. in-8°). Michelet, qui s’était mis en relation avec lui et le consultait fréquemment sur l’histoire de la Normandie, renvoie au premier de ces deux ouvrages quand il cite : Chéruel.
Chroniques de Bretagne
Elles ont été composées dans la première moitié du seizième siècle par un certain Alain Bouchart, maître des requêtes au parlement de Bretagne sous le duc François II, et imprimées trois ou quatre fois de 1514 à 1541. Les exemplaires en sont tellement rares que Michelet ne semble pas les avoir eues à sa disposition. Il les cite d’après Barante.
Chronique de la Pucelle
Cette chronique, qui a été publiée plusieurs fois, par Denis Godefroy dans son Histoire de Charles VII, puis par Buchon (t. XXVII), par Petitot, par Quicherat, au tome IV de son Procès de condamnation et réhabilitation de Jeanne d’Arc, par Vallet de Viriville enfin, va de l’année 1422 au mois d’octobre 1429. Ce n’est donc pas une histoire complète de Jeanne d’Arc. De plus, comme elle paraît postérieure à l’année 1467, qu’il y a entre plusieurs de ses parties et les dépositions des témoins du procès de révision, des ressemblances considérables, elle ne peut avoir une grande valeur pour l’historien qui a entre les mains aujourd’hui les pièces originales du procès. M. Vallet de Viriville cependant, qui l’attribue à G. Cousinot, chancelier du duc d’Orléans, présent à Orléans pendant le siège, pense qu’il faut la consulter pour l’étude des détails de ce siège. Michelet, dans sa Jeanne d’Arc, parue isolément après le beau travail de Quicherat, s’est servi tantôt de l’édition Petitot, tantôt de l’édition Quicherat. Voyez Collection Petitot et Quicherat.
Chronique de la Pucelle, éd. Quicherat
Chronique de la Pucelle, collection Petitot
Chronique de Lorraine
Chronique de Lorraine, ap. (abréviation pour apud, en français dans) D. Calmet, Preuves, t. II.
La Chronique de Lorraine, composée sous Charles VIII, est un récit légendaire, sans valeur historique, que dom Calmet a publiée dans ses Preuves de l’histoire de Lorraine. Dom Calmet, né près de Commercy, mort à Senones en 1757, est un de ces grands Bénédictins qui, au dix-huitième siècle, publièrent des recueils de documents précieux pour l’histoire politique et religieuse, générale et provinciale de la France au moyen âge. Il s’est attaché plus spécialement à l’histoire de Lorraine. Son principal ouvrage, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, parue en 1728 en 4 vol. in-f°, qui s’accrut, de 1745 à 1757, de 3 autres volumes, accompagnée de nombreuses Preuves, est une œuvre considérable, devenue justement classique. Il a publié, en outre, une Suite des médailles des ducs de Lorraine (Vienne, 1736), une Bibliothèque lorraine (in-f°, 1751) et de très nombreux ouvrages de théologie.
Collection Petitot
En 1819, Claude-Bernard Petitot eut, presque en même temps que Buchon (voyez ce nom), l’idée de publier une collection de tous les mémoires relatifs à l’histoire de France. Il commença par Villehardouin et résolut d’abord de ne pas dépasser le règne de Henri IV. Mais on le pressa de poursuivre : il entreprit, à partir de 1820, une deuxième série. La première fut achevée en 1827, en 52 volumes ; la seconde, en 1829, comprit 79 volumes. L’ensemble de la collection porte le titre de : Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu’à la paix de Paris conclue en 1763, par MM. Petitot et Monmerqué. Le défaut de ce recueil, qu’on cite d’ordinaire, comme fait Michelet, Collection Petitot, c’est la longueur et l’inutilité des dissertations mises en tête de chaque volume et la rareté des notes ; mais chacune des séries contient une table alphabétique et méthodique, excellente.
Le tome VIII contient des mémoires concernant la Pucelle d’Orléans (1425-1429), un supplément à ces mémoires, le Panégyrique de Richemont, par Guillaume Gruel ; les tomes VI et VII, le Livre des faicts du maréchal Boucicault.
Compaing, chanoine d’Orléans, sa déposition
Ce personnage, qui fut appelé comme témoin au procès de révision, était à Orléans au moment du siège. Il y a donc vu Jeanne d’Arc, ce qui donne, pour l’historien, une grande autorité à son témoignage.
Contes (Louis de), sa déposition
De Contes, surnommé Mugot, rencontra Jeanne d’Arc au château de Coudray, en Touraine, à une lieue de Chinon, pendant que le roi la soumettait à certaines épreuves, avant de la laisser partir pour Orléans. Il devint alors son page, et ne la quitta plus jusqu’au siège de Paris. Il témoigna au procès de révision.
Cusquel (Pierre), sa déposition
C’était un bourgeois de Rouen qui vit Jeanne au château de Rouen, l’avertit qu’elle était en danger de mort et, pris de compassion, n’eut pas ensuite la force d’assister à son supplice. Il déposa en 1452, au procès de révision, et fut cité au tribunal de la réhabilitation.
Didron, Iconographie chrétienne
C’est Didron qu’il faut lire.
Lorsque M. Guizot, en 1833, forma le projet d’une publication de tous les documents relatifs à l’histoire de France, le plan qu’on adopta comprenait une série réservée à l’histoire des sciences, des arts, des lettres. M. Albert Lenoir publia une Statistique monumentale de Paris, une Architecture monastique (3 vol. in-4°). M. Didron publia une Iconographie chrétienne, c’est-à-dire une Histoire des images chrétiennes au moyen âge. Le premier volume seul a paru en 1843 : il est consacré à l’histoire des diverses représentations de Dieu. Il est intitulé, à cause de cela, Histoire de Dieu. C’est à ce volume unique que Michelet renvoie.
Dubois (l’abbé), Dissertation, éd. Buchon
L’abbé Dubois, théologal de l’église d’Orléans, légua, par son testament du 1er février 1824, à la Bibliothèque publique d’Orléans, des remarques manuscrites qu’il avait faites sur le manuscrit 411 de cette bibliothèque et une copie d’une partie de ce manuscrit. Ce manuscrit contient la Chronique de la Pucelle, les préliminaires du procès de Jeanne, la minute en français de ce procès jusqu’à la sentence de condamnation, un abrégé du procès de révision.
L’abbé Dubois s’efforça dans ses remarques de prouver que cette minute du procès conservé à Orléans était bien authentique. Buchon, qui n’a fait autre chose qu’imprimer dans son tome XXVII ce manuscrit d’Orléans, a publié à la suite (p. 191 à 220) la dissertation de l’abbé Dubois. Quicherat a démontré depuis que le manuscrit d’Orléans n’était pas une copie exacte des pièces du procès, mais simplement une compilation abrégée. Il ne l’a pas admis comme un manuscrit original, digne de servir de base à une édition savante. Voyez Buchon.
Du Boulay, Historia univ. Parisiensis
Du Boulay (Egasse), né dans la Mayenne, mort le 16 octobre 1678, fut professeur d’humanités, recteur, puis historiographe de l’Université de Paris. C’est ainsi qu’il fut amené à entreprendre l’histoire de l’Université de Paris (Historia universitatis Parisiensis) en 6 volumes in-folio (1665-1673), continuée pour le dix-septième et le dix-huitième siècle par M. Jourdain, de l’Institut (1862-1864). Le livre de Du Boulay, écrit en latin, est, par l’importance et le nombre des documents qu’il contient sur l’histoire de l’Université de Paris au moyen âge, un livre classique qui honore l’érudition française. Du Boulay a publié d’autre part un certain nombre d’ouvrages de détails sur le même sujet : Recueil des privilèges de l’Université, 1674, in-4°.
Dunois, sa déposition
Jean de Dunois, comte de Longueville, le Bâtard d’Orléans. Vainqueur des Anglais au Mont-Saint-Michel (1425), à Montargis (1427), il contribua puissamment avec Jeanne d’Arc (1425) à la défense et à la délivrance d’Orléans. Il l’accompagna à Reims et resta auprès d’elle lors de l’assaut donné à Paris. Il fut, dès le début, de ceux qui conseillèrent à Charles VII de se servir de Jeanne d’Arc, et celui qui semble l’avoir le mieux comprise. On le vit par exemple, après la délivrance d’Orléans, établir dans cette ville la procession du 8 mai destinée à perpétuer dans les imaginations populaires le souvenir de l’intervention miraculeuse de la Pucelle. Dunois fut un des principaux témoins du procès de révision.
Gachard, Documents inédits
Gachard (Louis-Prosper), né à Paris le 12 mars 1800, mort à Bruxelles le 24 décembre 1885 à quatre-vingt-cinq ans, était un Français qui vint, comme ouvrier typographe, s’établir en Belgique. Il y organisa les Archives du royaume, lorsque le royaume se sépara, avec Léopold Ier, de la Hollande, de telle manière que les documents communaux, provinciaux furent tous inventoriés et classés. Puis il entreprit de grands recueils d’histoire belge, avec un personnel nombreux qu’il dirigeait très activement, par exemple, une Collection de chroniques belges (1836), et toutes les publications de la commission royale d’histoire de Belgique. Il parcourut les Archives de toute l’Europe, pour y puiser des documents intéressant l’histoire de la Belgique ; c’est ainsi qu’à Simancas, en Espagne, il eut le bonheur de retrouver, et publia la correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas (5 vol., 1848-1879). Le livre de Gachard, auquel Michelet renvoie ici, est un recueil de documents pris dans les Archives de Belgique et intitulé : Documents inédits, 3 vol. in-8°, 1845.
Gallia christiana
Le titre complet de ce grand recueil de notices et de documents sur l’histoire ecclésiastique de la France est, nous le traduisons immédiatement en français : la Gaule chrétienne divisée en provinces ecclésiastiques, où l’on trouve, depuis l’origine des Églises chrétiennes jusqu’à notre temps, la série et l’histoire des archevêques, des évêques et des abbés de France et des pays voisins, avec des preuves à l’appui, empruntées aux documents authentiques, par dom Denys Sainte-Marthe, prêtre bénédictin de la congrégation de Sainte-Marthe.
Cette entreprise considérable avait été précédée au dix-septième siècle de quelques essais analogues, mais imparfaits. L’assemblée du clergé en 1710 en chargea Denys de Sainte-Marthe, neveu du janséniste de Sainte-Marthe, d’une famille d’érudits célèbres au dix-septième siècle, et lui vota une somme de 4.000 livres, à la condition que sa publication serait continuée, s’il mourait, par les Bénédictins. Il fit paraître, de 1715 à 1725, trois volumes in-f°. Sa mort n’interrompit pas l’entreprise : les Bénédictins tinrent leurs engagements ; de 1725 à 1789, ils publièrent dix volumes in-f°. Dans ce siècle, M. Hauréau, aujourd’hui membre de l’Institut, donna, en trois volumes, l’histoire des quatre archevêchés que les Bénédictins n’avaient pas achevée (1856, 1860, 1865).
L’ensemble (16 volumes) offre à ceux qui s’occupent de l’histoire de la France au moyen âge des ressources de travail incomparables. Comme c’est une œuvre collective, on cite simplement Galla christiana, sans nom d’auteur.
Gaucourt (de), sa déposition
Ce personnage, gouverneur d’Orléans, était certainement un des hommes de guerre les moins favorables à Jeanne d’Arc, ou du moins les plus jaloux d’elle : car il reconnaissait sa science militaire. Il s’opposa plusieurs fois à ses projets, par exemple à la première sortie qu’elle voulut faire à Orléans, aux combats qu’elle voulut livrer à Paris. Ce fut lui qui contribua à séparer Jeanne du duc d’Alençon, pour empêcher l’expédition commune qu’ils projetaient contre la Normandie anglaise. Appelé au procès de révision, il y apportait le témoignage d’un homme qui n’avait jamais accepté qu’à regret l’autorité de la Pucelle.
Gorckeim (Henri de), Propos. libr. duo, in Sibylla Fran cica, éd. Goldast, 1606
Voici la traduction de ce titre : (Propositionum libri duo) deux livres de propositions, (de Puella militari) sur la Pucelle guerrière, par Henri de Gorckeim (aujourd’hui écrit Gorkum). Cet opuscule, composé au moment où Jeanne était à l’apogée de sa gloire, est curieux parce qu’il nous donne l’opinion des Allemands sur la Pucelle. C’est l’intérêt que présente également la Sibylla francica (la Sibylle française), dissertation où l’auteur s’efforce de prouver que Jeanne était une sibylle agréée de Dieu, comme ses devancières de l’antiquité.
L’érudit Goldast a donné une édition de la Sibylla francica en 1606, in-4°, dans laquelle il a inséré l’opuscule d’Henri de Gorckeim. C’est ce qu’indique la seconde partie de la note de Michelet : consultez les deux livres d’Henri de Gorckeim dans le recueil de Goldast, la Sibylla francica.
Goldast (Melchior), publiciste et historien suisse, né le 6 janvier 1576, près de Bischofszell, mort à Giessen (Hesse), 1693. De famille noble, mais besogneux, il mena une vie d’aventures, correcteur d’imprimerie, tantôt au service des princes, tantôt au service de l’empereur, soutenant des démêlés très vifs avec les savants de son temps. Travailleur infatigable, il accumula des matériaux considérables pour l’étude de l’histoire et du droit public allemands, éditions de vieilles chroniques allemandes, recueil de décrets impériaux, une collection de lois barbares et de capitulaires carolingiens ; il a entrepris d’une manière incomplète, mais seul, ce que les Allemands ont exécuté plus complètement, plus savamment, au début de ce siècle, dans leur collection des Monumenta Germaniæ historica (Monuments de l’histoire d’Allemagne).
Histoire au vrai du siège
Le titre complet est : Histoire et discours au vray du siège qui fut devant la ville d’Orléans par les Anglais, etc., prise de mot à mot, sans aucun changement de langage, d’un vieil exemplaire escript à la main en parchemin et trouvé en la maison de ville d’Orléans. Ce journal de siège, imprimé pour la première fois en 1576 et composé vers 1467 à Orléans, est en partie composé avec d’autres chroniques antérieures, en partie avec les pièces du procès de révision. Il n’aurait pas d’intérêt, si l’on n’y voyait d’une manière évidente qu’il contient des renseignements pris à un registre tenu à Orléans pendant le siège même.
Hordal (Jean), Joannæ Darc historia (Histoire de Jeanne d’Arc)
Ce n’est pas tout à fait le titre exact ; le voici : Heroina nobilissimæ Joanna Darc Lothringæ, vulgo Aurelianensis puellæ, historia (Histoire de la très noble héroïne Jeanne d’Arc de Lorraine, vulgairement appelée la Pucelle d’Orléans). Cette histoire, parue en 1612, à Pont-à-Mousson, a quelque valeur, parce que l’auteur, descendant de Jeanne d’Arc, consulta les pièces originales du procès conservées dans le Trésor des Chartes, à la Bibliothèque du roi.
Isambart, sa déposition
Isambart de la Pierre, religieux dominicain, acolyte du vice-inquisiteur Lemaître dans l’enquête, puis assesseur au tribunal, fut un de ceux qui montrèrent le plus de pitié pour Jeanne d’Arc, pendant le procès. C’est pour cela qu’on l’appela au procès de réhabilitation, quoiqu’il eût pris part au premier procès de condamnation.
Journal d’un Bourgeois de Paris
Ce journal n’est pas d’un bourgeois de Paris. C’est le premier éditeur Godefroy qui lui a donné ce titre, et depuis l’usage s’en est pris. Le style de l’ouvrage, trivial, coloré décèle l’habitude des assemblées populaires. L’auteur a pris le parti des Cabochiens, et ne s’est pas consolé de leur défaite : aussi n’aime-t-il ni les Anglais, ni les Armagnacs, encore moins les derniers que les premiers. C’est le témoignage le plus hostile que nous ayons sur Jeanne d’Arc ; il est fait en grande partie avec les douze articles rédigés par Cauchon, sur lesquels l’Université fut appelée à donner son avis. Voyez Buchon.
Labbe, Alliance chronologique
Voyez Ap. Concil. Labbe, les renseignements que nous donnons sur l’érudit Labbe. Le titre complet de l’ouvrage auquel Michelet renvoie ici est, en latin, Concordia chronologica, technica et historica, 1670, 5 vol. in-f°. Ce sont des tableaux synchroniques de faits et de dates, pour l’histoire sacrée et profane. Labbe avait laissé inachevé ce travail, que son confrère Briet reprit et poussa jusqu’à la date de 1600. L’édition de 1670, en 5 volumes, contient la continuation du père Briet.
L’Averdy
Plus exactement Clément-Charles-François de L’Averdy, conseiller au parlement de Paris, décembre 1763, puis contrôleur général des finances et ministre d’État (1765). Il joua alors un certain rôle en combattant les Jésuites, en essayant de réparer et de supprimer à l’avenir les dilapidations des fermiers généraux, mais il fut obligé d’accepter le désordre qu’il avait eu la prétention de combattre. Membre honoraire de l’Académie des inscriptions, il consacra à la science les loisirs que lui avaient faits ses échecs dans la vie publique. Il dressa en 1791 une table méthodique des travaux considérables de l’Académie des inscriptions et belles lettres et il publia vers la même époque, en un volume in-4°, dans les Notices des manuscrits de l’Académie, la plus grande partie des pièces du procès de Jeanne d’Arc. C’est à ce volume que Michelet renvoie quand il cite simplement : L’Averdy. Pour plus de détails, voyez Notices des manuscrits, t. III.
Le Brun de Charmettes
Le Brun ou Le Brun de Charmettes (Alexandre), littérateur, né à Bordeaux, en 1785, mort en 1850 [en 1880 ! mais il s’était retirée de la vie publique], n’est guère connu que par son Histoire de Jeanne d’Arc, parue en 1817 (4 vol. in-8 °). Le titre complet de l’ouvrage en indique la valeur et la portée : Histoire de Jeanne d’Arc, tirée de ses propres déclarations, de cent quarante-quatre dépositions de témoins oculaires et de manuscrits de la Bibliothèque du roi et de la Tour de Londres.
Lenglet du Fresnoy
D’après le manuscrit de Jacques Gelu, De Puella aurelianensi, manuscrits lat. Bibl. regiæ (manuscrit latin de la Bibliothèque du roi, aujourd’hui nationale, n° 6199).
Lenglet du Fresnoy (l’abbé Nicolas) est un des érudits qui ont le plus contribué au dix-huitième siècle à l’étude méthodique de notre histoire nationale. Il était né à Beauvais, le 5 octobre 1674. D’abord secrétaire de l’électeur de Cologne, il eut une vie très mouvementée, fut mis dix fois à la Bastille et mourut le 15 janvier 1755. Dans son livre : l’Histoire justifiée contre les romans, 1735, il posait les principes de la méthode historique. Il publiait en 1712 sa Méthode pour étudier l’histoire, qui fut reprise et complétée en 1772, répertoire pratique des sources de l’histoire de France. Il fit encore un plan de l’Histoire générale de la monarchie française, 1755. Quand Michelet cite : Lenglet-Dufresnoy, il renvoie à son Histoire de Jeanne d’Arc, 1755 (3 vol. in-8°), composée d’après des ouvrages inédits, entre autres celui de Jacques Gelu, la première qui ait fait connaître au public l’existence des pièces originales du procès de la Pucelle. Jacques Gelu, archevêque d’Embrun, écrivit, après la levée du siège d’Orléans, un opuscule, pour affermir le roi dans l’opinion favorable que les théologiens lui avaient donnée de la Pucelle. Le texte, écrit en latin, a été analysé par Lenglet du Fresnoy. Mais il était resté manuscrit à la Bibliothèque royale, jusqu’au jour où Quicherat l’a édité dans son Procès de Jeanne d’Arc (t. III, p. 395-407).
Lenozoles (frère Jean de), sa déposition
Plus exactement Jean de Lenozoliis, religieux célestin, était attaché à la personne d’Érart, assesseur au procès de Jeanne d’Arc. Docteur en théologie, il a pu suivre à Rouen les détails du procès et connaître la conduite de Jeanne d’Arc. On l’appela pour cette raison à témoigner au procès de réhabilitation.
Lingard (Jean)
Né à Winchester (Angleterre) en 1771, mort le 13 juillet 1851. Il avait fait ses études en France, à Douai : la Révolution l’en chassa ; il alla recevoir les ordres à Rome. Il vécut très simplement, consacrant sa vie à l’étude et à la piété, refusant les dignités ecclésiastiques qu’on lui offrait. Aussi ses travaux historiques sont-ils considérables, par le nombre, l’étendue et la valeur. Il publia, en 1810, deux volumes sur les Antiquités de l’Église anglo-saxonne ; il en donna, cinq ans après, une nouvelle édition en huit volumes. Puis, en 1819, il entreprit une Histoire d’Angleterre depuis la première invasion romaine jusqu’à l’avènement de Guillaume III et de Marie, qu’il acheva en 1830 (8 vol. in-4°). Cette histoire qui fit connaître Lingard, non seulement en Angleterre, mais dans toute l’Europe, est l’œuvre d’un catholique, et d’un prêtre catholique qui ne pouvait guère juger l’histoire d’Angleterre avec impartialité, étant à la fois polémiste et historien. C’est à cette œuvre que Michelet renvoie quand il cite : Lingard.
Livre des faits du maréchal Boucicault
, collection Petitot, t. VI
Le maréchal Jean le Meingre, dit Boucicault, né à Tours en 1364, mort en Angleterre en 1421, est le type du chevalier du quatorzième siècle. Formé à douze ans à l’école de Du Guesclin, il se distingua à Roosebeke en 1382 contre les Flamands. Il alla ensuite combattre avec les chevaliers Teutoniques contre les païens de Lituanie. Il revint en France soutenir un fameux pas d’armes à Saint-Inglevert contre les Anglais, fut alors créé maréchal de France (1391), puis partit à la suite de Jean sans Peur pour la croisade de Nicopolis (1392), où il fut fait prisonnier par les Turcs. Délivré, il retourna en Orient, en 1400, pour défendre l’empereur Manuel contre les Turcs ; à son retour il gouverna, de 1401 à 1409, Gênes qui s’était donnée à la France. À Azincourt, il fut fait prisonnier par les Anglais et mourut entre leurs mains. Il avait fondé l’ordre de chevalerie de la Dame Blanche.
Sa vie a été racontée par un contemporain : c’est le Livre des faicts du maréchal Boucicault. L’érudit Godefroy l’a publié pour la première fois en 1620. Michelet s’est servi de l’édition qui a paru dans la collection Petitot (t. VI).
Mémoires concernant la Pucelle
, collection Petitot, t. III
Voyez Collection Petitot.
Monition, troisième
Voyez Procès latin, ms.
Monstrelet
Monstrelet (Enguerrand de), chroniqueur né vers 1390, mort le 20 juillet 1453. Il était de famille picarde ou flamande, entra au service du duc de Bourgogne, ce qui lui valut les fonctions de prévôt de Cambrai et bailli de Walincourt. Originaire du même pays que Froissart et comme lui au service des seigneurs du Nord, témoin de leurs faits d’armes et de leur vie luxueuse, il eut l’idée de continuer à partir de 1400, date à laquelle s’arrête l’œuvre de Froissart, cette chronique célèbre. Il poussa la sienne jusqu’en 1453.
La meilleure édition de son ouvrage a été publiée par M. Douët d’Arcq, de 1857 à 1862, pour la Société de l’Histoire de France. Michelet n’a pu par conséquent s’en servir pour sa Jeanne d’Arc. Il a employé et cité l’édition que Buchon a donnée dans sa collection des Chroniques de France (t. XXVI à XXXVII). Voyez Buchon.
Nicolas Clemengis, Epistolæ (Lettres)
Nicolas Clemengis [de Clamanges], théologien, né à Clamanges (Marne) vers 1360, mort entre 1435 et 1440. Recteur de l’Université de Paris en 1393, il fut, à l’époque du grand schisme, l’un des docteurs célèbres, austères, qui, avec Gerson et D’Ailly, travaillèrent à ramener l’unité dans l’Église, la morale dans le corps ecclésiastique, et demandèrent la réforme par le concile.
Ses œuvres, et en particulier ses lettres, ont été publiées à Leyde en 1613, in-4°.
Monition, troisième
Voyez Notices des mss, t. III.
Notices des mss, t. III
Le titre complet de l’ouvrage auquel renvoie Michelet par cette indication, ou par l’indication plus sommaire encore, Notices, est : Notices et Extraits des manuscrits du Cabinet du Roi, publiés par l’Académie des inscriptions et belles lettres. En 1787, l’Académie des inscriptions, qui depuis 1717 avait entrepris un recueil de dissertations et mémoires d’érudition, résolut de faire connaître par des extraits rai sonnés et des notices exactes les manuscrits de la Bibliothèque du roi, de découvrir à la France les trésors qu’elle possède et de lui en faciliter l’usage
; à cet effet, elle nomma, avec le titre de Comité des manuscrits de la Bibliothèque du roi, un comité de savants qui se répartirent le travail, les uns publiant des notices ou des extraits des manuscrits orientaux, les autres des manuscrits grecs et latins, les autres des manuscrits en toutes langues, concernant l’histoire de France et les antiquités du moyen âge.
Les deux premiers volumes (1787, 1789) furent consacrés à la fois à des manuscrits des trois genres. Le troisième (1790) fut presque entièrement employé à l’impression des extraits raisonnés que L’Averdy communiqua à l’Académie de tout ce que les manuscrits de la Bibliothèque du roi contenaient relativement au procès de Jeanne d’Arc
(604 pages in-4 °).
L’érudit Lenglet du Fresnoy avait déjà en 1712 compris et signalé l’importance que présentaient, pour l’histoire de Jeanne d’Arc, les pièces originales de son procès. Il eut l’intention d’imprimer, dans une seconde édition de sa Jeanne d’Arc, ces pièces comme appendices : la mort ne le lui permit pas ; les pièces restèrent manuscrites, jusqu’à ce que L’Averdy en donnât dans les Notices et extraits une analyse excellente, très détaillée, avec de nombreux passages reproduits intégralement.
Ce travail consciencieux était et devait être désormais, pour un siècle entier, le fondement de toute l’histoire de Jeanne d’Arc, l’édition postérieure qu’a donnée Buchon des pièces du procès en 1827 n’étant que la reproduction d’un abrégé du procès fait sans méthode et sans esprit scientifique. Michelet l’a admirablement compris, comme le prouvent les renvois très fréquents qu’il fait aux Notices des mss., t. III, c’est à-dire au travail de L’Averdy.
L’analyse de L’Averdy demeura pourtant incomplète : il ne connut pas tous les manuscrits des deux procès. Pour le procès de condamnation, il n’a pas employé le manuscrit dit de l’Assemblée nationale, qui appartenait avant la Révolution à la collection particulière de M. de Cotte, ni les manuscrits de Harlay, de Christine de Suède, conservés à la Bibliothèque du Vatican à Rome, ni celui de Genève. Pour le procès de réhabilitation, L’Averdy n’a connu ni le manuscrit du fonds Saint-Victor n° 285, ni celui du supplément latin 252, ni celui de Genève. En outre des extraits ne valent jamais, si bien qu’ils soient faits, une reproduction intégrale du reste ; ce qui l’indique, c’est que Michelet, tout en se servant du travail de L’Averdy, eut recours aux manuscrits eux-mêmes, qu’il cite sous cette rubrique : Procès latin, procès ms. Et cela prouve en même temps le scrupule et le zèle que notre grand historien national apportait à ses recherches préparatoires.
En 1841, Quicherat entreprit de donner une édition complète des pièces authentiques des deux procès, collationnées sur tous les manuscrits actuellement connus. Cette édition, qui est un chef-d’œuvre de soin et de science, rend désormais inutile le travail de L’Averdy, le tome III des Notices des mss., dont Michelet a tiré un si grand parti (voyez dans notre répertoire, Lenglet du Fresnoy, L’Averdy, Quicherat, Procès ms. de révision, Procès lat. ms., Procès ms., etc.
Ordonnances
Le titre complet de l’ouvrage auquel Michelet renvoie par cette indication est : Ordonnances des roys de France de la troisième race (Capétiens) recueillies par ordre chronologique. Paris, 1723, 22 vol. in-f°. Cette collection considérable, dont Louis XIV avait confié l’entreprise à son chancelier Pontchartrain assisté de trois avocats au Parlement, Berroyer, Eusèbe de Laurière et Loger, ne commença à paraître qu’en 1723 par les soins de Laurière. Laurière mourut en 1728 : un autre avocat, Secousse, fut chargé par d’Aguesseau de continuer l’œuvre : il fit paraître 7 volumes et laissa le tome IX de la collection entièrement achevé en 1774. Un membre des plus célèbres de l’Académie des inscriptions et belles-lettres remplaça Secousse après sa mort, Bréquigny, qui publia du tome X au tome XIV. Le reste fut repris et achevé, à partir de 1811, par deux membres de l’Institut Pastoret et Pardessus ; la collection se termina par les ordonnances du règne de Louis XII.
L’ensemble de ce recueil, qui comprend, outre les documents législatifs eux-mêmes, des tables chronologiques et méthodiques, des dissertations d’une grande valeur et des notes, est un des monuments les plus remarquables de l’érudition française. On le cite, comme fait Michelet, sous le titre : Ordonnances, Ordonnances des rois de France.
Panégyrique de Richmond, par Guillaume Gruel, collection Petitot
Voyez Collection Petitot.
Richmond (Arthur III, duc de Bretagne et Touraine, comte de), pair et connétable de France, né le 22 août 1393, mort à Nantes le 26 décembre 1456 ; l’un des grands seigneurs du parti d’Orléans au quinzième siècle. Il débuta au service de ce parti, fut fait prisonnier à Azincourt (1415), et revint d’Angleterre pour se mettre à la disposition du dauphin (Charles VII) ; connétable de France, il fut, pendant quelques années (1424-1439), le ministre principal de Charles VII. Disgracié en 1429, il vit le pouvoir passer aux mains du duc d’Alençon, mais il retrouva, en 1432, la faveur royale, prit part aux négociations d’Arras (1435) et à la conquête de la Normandie (1448).
Son écuyer, Guillaume Gruel, écrivit, après sa mort (1458), le récit ou plutôt l’apologie de sa vie, qui fut imprimé en 1520, pour la première fois, sous le titre : Histoire du vaillant chevalier Arthur, réimprimé ensuite en 1622 par l’érudit Denis Godefroy. Michelet emploie et cite l’édition plus récente qu’a donnée Petitot dans sa collection complète des Mémoires relatifs à l’histoire de France, au tome VIII.
Pasquerel (frère), sa déposition
Ce personnage, religieux augustin, chapelain de la Pucelle, fut appelé à déposer au procès de réhabilitation et donna très nettement son avis sur Jeanne d’Arc, en même temps que sur ses juges.
Procès, éd. Buchon.
Voyez Buchon.
Procès, éd. 1827.
Voyez Buchon.
Procès lat. ms.
(Procès latin manuscrit.) Michelet avait compris que la préparation nécessaire d’une histoire de Jeanne d’Arc, c’était l’étude des pièces originales du procès. Il connaissait l’histoire de Lenglet du Fresnoy, qui en avait signalé l’importance, le travail de L’Averdy, qui, dans les Notices et extraits des manuscrits, t. III en avait publié l’analyse et des extraits, il avait enfin entre les mains l’édition de Buchon parue en 1827. Mais tous ces travaux antérieurs étaient incomplets : les indications de Lenglet du Fresnoy ne pouvaient satisfaire la curiosité qu’elles éveillaient ; l’édition Buchon n’était qu’une reproduction pure et simple d’un abrégé très incomplet de l’instrument original du procès ; enfin de L’Averdy, très souvent, ne fournissait à Michelet que des extraits.
L’instrument original du procès de condamnation était à la Bibliothèque nationale, dans des manuscrits latins. En effet, quelque temps après le supplice de Jeanne d’Arc, l’un des juges du procès, Thomas de Courcelles, assisté du greffier Manchon, fit traduire en latin les interrogatoires de Jeanne d’Arc, d’après les minutes authentiques qui, au cours du procès, avaient été écrites en français, les procès-verbaux complétés. L’ensemble fut rédigé en un instrument authentique latin dont cinq copies furent faites immédiatement. Les cinq copies reçurent l’attestation des greffiers, Boisguillaume, Manchon, Taquel et le sceau des juges. De ces cinq copies, deux furent détruites, trois sont actuellement conservées à Paris, où elles sont arrivées après des vicissitudes diverses ; l’une est à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, les deux autres sont à la Bibliothèque nationale où elles portent les numéros 5968 et 5966 latins.
C’est de l’un de ces deux exemplaires que s’est servi Michelet ; c’est à l’un ou à l’autre qu’il renvoie, quand il cite : Procès latin ou Procès ms. Les textes des deux manuscrits sont d’ailleurs identiques.
Ces manuscrits latins, d’une valeur inappréciable, que Michelet a eu le mérite de vouloir connaître, contiennent :
- L’enquête préliminaire du procès, l’instruction, les conclusions du juge d’instruction, qu’on appelait alors le promoteur ;
- Les interrogatoires de Jeanne d’Arc, les propres réponses de l’héroïne, conservées et attestées par ses juges et rangées par ordre chronologique ;
- Les monitions ou exhortations adressées à Jeanne d’Arc, après l’interrogatoire, par ses juges, pour la décider à faire des aveux, à abjurer, depuis le 18 avril jusqu’au 24 mai ;
- L’acte d’abjuration du 24 mai, que Jeanne d’Arc rétracta presque immédiatement après ;
- Enfin, la procédure de la deuxième partie du procès (secundum judicium), où l’on accusa Jeanne d’être relapse, c’est-à-dire retombée dans le crime d’hérésie dont l’acte d’abjuration l’avait lavée.
Ainsi, quand Michelet cite : Procès lat. ms. ou Procès ms., c’est toujours duProcès de condamnation qu’il parle, d’après l’instrument authentique conservé à la Bibliothèque nationale.
Procès ms., 17 februarii 1431 (17 février 1431)
Voyez l’article précédent.
Procès ms. de révision
En février 1450, lorsque Rouen fut redevenue ville française, Charles VII, se souvenant, après la victoire, de l’héroïne qui l’avait préparée, ordonna de réviser le procès de la Pucelle, que les Anglais avaient mise à mort iniquement. L’enquête fut ouverte à Domrémy, à Orléans, à Paris, à Rouen, et l’on consulta tous ceux qui avaient connu Jeanne d’Arc pendant son enfance, son séjour à Orléans et à l’armée, pendant son procès. Le pape n’autorisa que le 11 juin 1455 cette révision, et son autorisation était nécessaire, puisque Jeanne d’Arc avait été condamnée comme hérétique et relapse par un tribunal ecclésiastique. Ce second procès de révision aboutit, le 7 juillet 1456, à une sentence de réhabilitation qui déclara ladite Jeanne et ses ayants cause et parents n’avoir encouru, en cette occasion, aucune tache d’infamie, et être exempte et purgée de tout effet des procès et sen tences prononcés à Rouen
. La sentence des juges de Rouen fut déclarée dol, calomnie, iniquité
.
À la suite de ce second procès, dit de révision, les greffiers Lecomte et François Ferrebouc, qui avaient, au cours du procès, dressé à mesure les minutes, les réunirent avec les actes pour en former l’acte définitif. Ils s’y reprirent à deux fois : leur premier travail ne reçut pas d’attestation, ne fut pas déclaré authentique. Nous l’avons conservé à la Bibliothèque nationale, où il est connu sous le nom de manuscrit de d’Urfé. Leur second travail, dont ils firent trois copies, nous est parvenu dans deux manuscrits qui sont pour nous la preuve légale, authentique de la réhabilitation.
Ces deux manuscrits sont en latin, à la Bibliothèque nationale (n° 5970 fonds latin, fonds Notre-Dame, n° 138), où Michelet les a consultés. Ils sont munis des attestations des deux greffiers qui en garantissent l’authenticité.
Michelet cite ces manuscrits de la manière ci-dessus indiquée : Procès ms. de révision.
Quicherat
Jules Quicherat, un des plus grands érudits de notre temps, né à Paris le 13 octobre 1814, mort le 8 avril 1882, se consacra dès sa jeunesse à la fois à l’histoire et aux arts. Il entra à l’atelier du peintre Charlet et à l’École des chartes en 1835. Il devint en 1847 professeur chargé du cours d’archéologie, puis directeur de cette école. Il avait été l’un des principaux fondateurs et fut l’un des plus savants collaborateurs du recueil qui marqua, aux yeux du public et au profit de la science, l’activité de cette école d’érudition : la Bibliothèque de l’École des Chartes. Ses œuvres principalement consacrées, mais non exclusivement, au moyen âge, se composent d’études d’archéologie, d’art proprement dit, d’histoire.
Il a écrit ou publié sur l’histoire de Jeanne d’Arc et sur le quinzième siècle, un certain nombre d’ouvrages qui font aujourd’hui autorité.
Le plus important, le premier, est l’édition qu’il donna, de 1841 à 1850, pour la Société de l’histoire de France, des pièces originales du Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, dite la Pucelle. L’Averdy n’en avait publié que des extraits ou des analyses. L’édition de Quicherat fut complète et, pour ainsi dire, définitive. Aux trois volumes qui contenaient les pièces, Quicherat en ajouta un quatrième où se trouvent par séries les témoignages des historiens français, bourguignons, anglais sur Jeanne d’Arc, puis un cinquième consacré à reproduire des lettres, actes officiels, pièces détachées, relatifs à la Pucelle, qui avaient été mal publiés, ou ne l’avaient pas encore été.
À la fin du dernier volume, il inséra des notices sur les procès et les manuscrits des deux procès de Jeanne d’Arc, qui sont de véritables chefs-d’œuvre de discussion et de science.
Lorsque parut, pour la première fois, dans l’Histoire de France de Michelet, sa Jeanne d’Arc, le travail de Quicherat n’était pas publié, ou plutôt le premier volume de ce travail et le cinquième volume de l’histoire de Michelet (Jeanne d’Arc), parurent la même année. Mais les deux savants, l’érudit et l’historien, se connaissaient : ils étaient l’un et l’autre attachés à nos deux plus grands dépôts d’archives : Michelet garde des Archives, Quicherat attaché à la Bibliothèque nationale. Michelet indiqua dans ses notes que certains documents lui avaient été communiqués par Quicherat. Ils avaient tous les deux la même ardeur au travail, et en particulier le même culte pour Jeanne d’Arc.
Dans l’édition séparée qu’il publia de sa Jeanne d’Arc en 1853, et qui forme le présent volume, Michelet tint compte des travaux de Quicherat et cita l’introduction parue en 1849 à la fin du cinquième volume : Quicherat, Introduction. Quicherat de son côté poursuivit ses études sur Jeanne d’Arc jusqu’aux derniers jours de sa vie.
En 1850, il donna un volume d’Aperçus nouveaux sur l’histoire de Jeanne d’Arc (Renouard, 107 p.) : c’était son introduction tirée à part.
En 1854, dans la même collection où avait paru la Jeanne d’Arc de Michelet, dans la Bibliothèque des chemins de fer, chez Hachette, il réimprima l’Histoire du siège d’Orléans.
En 1855-59, il publia pour la Société de l’histoire de France, l’Histoire des règnes de Charles VII et Louis XI par Thomas Basin, que Michelet n’avait pu connaître et qui est une des sources importantes de l’histoire de Jeanne d’Arc (4 vol. in-8 °).
En 1879, il réimprima, avec de nombreuses additions, l’un de ses premiers travaux, l’histoire de Rodrigue de Villandrando, l’un des défenseurs de la France au quinzième siècle et, la même année, il édita dans la Revue historique, une relation manuscrite sur Jeanne d’Arc, tirée des Archives de La Rochelle.
Enfin, dans les derniers mois de sa vie, il donnait encore à la même Revue un Supplément aux témoignages contemporains de Jeanne d’Arc (1882), la réimpression, avec des développements, d’un texte qui avait paru dans la Revue de Normandie.
Ainsi, tandis que Michelet caractérisait d’une manière durable et sûre la figure et l’œuvre de Jeanne d’Arc, Quicherat, animé d’une même ardeur patriotique, fournissait les moyens de contrôler et de vérifier l’exactitude de notre grand historien. L’ensemble de leurs travaux constitue aujourd’hui un monument historique, solide et harmonieux tout à la fois, digne de l’héroïne dont ils ont voulu honorer la mémoire.
Quicherat, Introd.
Voyez Quicherat.
Reiffenberg
[Le baron Frédéric de Reiffenberg], historien, critique, bibliographe, né à Mons le 14 novembre 1795, mort à Bruxelles le 18 avril 1850. D’abord militaire, il fut en 1818 nommé professeur de littérature à Louvain, en 1835 à Liège, puis appelé à la direction de la Bibliothèque royale de Bruxelles, lorsqu’on la reconstitua.
Il publia un certain nombre d’ouvrages très importants sur l’histoire de la Belgique : Histoire du commerce et de l’industrie des Pays-Bas aux quinzième et seizième siècles (1822) ; Histoire du comté de Hainaut, qui fut complétée par une autre publication : Documents pour servir à l’histoire des provinces de Namur, Hainaut, Luxembourg (1844-1848), une Histoire de l’ordre de la Toison d’or.
Il édita un certain nombre de chroniques belges, par exemple les Mémoires de Du Clercq (1822), et contribua à la fondation et au succès de la grande collection des Chroniques belges inédites, publiées par ordre du gouverne ment belge et par les soins de la Commission royale d’histoire (1836, Bruxelles).
Il a eu l’heureuse idée de publier une édition annotée de l’Histoire des ducs de Bourgogne de Barante, avec des textes empruntés aux documents belges.
Michelet cite fréquemment ce dernier ouvrage de Reiffenberg de manières différentes : Reiffenberg, Notes sur Barante ; Reiffenberg, Notes sur l’édition belge de Barante. Il cite aussi son Histoire de la Toison d’or.
Reiffenberg, Histoire de la Toison d’or
Voyez Reiffenberg.
Reiffenberg, Notes sur Barante
Voyez Reiffenberg.
Reiffenberg, Notes sur l’édition belge (6e édition) de Barante
Voyez Reiffenberg.
Le religieux de Saint-Denis, ms. Baluze, Bibliothèque royale
Le titre complet est : Chronique du religieux de Saint Denis, contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422. Cette chronique était en grande partie manuscrite lorsque Michelet composa et publia sa Jeanne d’Arc. Elle fut éditée pour la première fois par M. Bellaguet, en 1839, pour la Collection des documents inédits de l’histoire de France, entreprise par M. Guizot. Comme l’édition complète comprend 6 volumes in-4°, on s’explique que Michelet n’ait pas pu s’en servir. Il n’a pas hésité à recourir au manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale. L’œuvre du Religieux, rédigée au monastère de Saint-Denis, à mesure que les événements se produisaient, et peut-être même par un témoin oculaire, est favorable au roi de France, à l’Université, à la haute bourgeoisie, et défavorable aux abus qui provoquent les révoltes populaires.
Rymer, 3e édition
Thomas Rymer, né dans le comté de York en 1638, mort en 1714, historiographe du roi à partir de 1692. Il avait fait d’abord des ouvrages de critique que Pope considérait comme très importants. Mais son ouvre principale est un grand recueil de tous les actes législatifs relatifs à l’histoire d’Angleterre. Le titre de ce recueil, qui parut de 1704 à 1735 en 20 volumes, est : Fœdera, conventiones, literæ et cujuscumque generis acta publica inter reges Anglia et alios quosvis Imperatores, reges, pontifices, Principes, vel communitates ab ineunte sæculo Duodecimo (1101) ad nostra usque tempora (1654) habita (Traités, conventions, lettres et actes publics de tout genre conclus entre les rois d’Angleterre et les Empereurs, les rois, les princes laïcs ou ecclésiastiques, les villes depuis 1101 jusqu’en 1654). Rymer, de 1704 jusqu’à sa mort, en fit paraître 15 volumes avec l’aide de Robert Sanderson. Sanderson fit paraître seul les cinq derniers.
Le recueil de Rymer est indispensable pour quiconque s’occupe d’histoire d’Angleterre. On le cite, comme a fait Michelet, ou Rymer simplement, ou Rymer, Fœdera.
Séguin (frère), sa déposition
Séguin, docteur en théologie, dominicain, doyen de la Faculté de théologie de Poitiers, fut chargé par le roi d’examiner Jeanne d’Arc à Poitiers, avant son départ pour Orléans. C’est à ce titre qu’ayant, avant l’expédition de Jeanne, témoigné de son humilité, virginité, honnêteté et dévotion, il fut appelé au procès de révision, pour en témoigner encore, malgré la sentence rendue contre elle par les docteurs et les juges de Rouen. Sa déposition est un récit très détaillé de tout ce qui se passa à Poitiers entre l’héroïne et les juges chargés de l’examiner.
Simon (Charles), sa déposition
Maître des requêtes du roi en 1429, puis président de la Chambre des comptes, il eut l’occasion de voir Jeanne d’Arc, lors de son arrivée à Chinon, et fut pour ce motif appelé en témoignage au procès de révision.
Premier et quinzième témoin de l’enquête de Rouen, leur déposition
Lors du procès de révision, en 1450, le roi Charles VII ordonna qu’une enquête fût ouverte à Domrémy, Orléans, Paris, Rouen et qu’on citât tous les gens qui dans ces quatre lieux avaient eu l’occasion de voir Jeanne d’Arc. Ce sont deux de ces personnes de Rouen, dont Michelet invoque le témoignage. Voyez Procès ms. de révision.
La Touroulde (Marguerite), sa déposition
Femme de Bouligny, fut l’hôtesse de Jeanne d’Arc à Bourges, lorsqu’elle revint du sacre. Veuve d’un conseiller du roi, ayant par conséquent une certaine autorité, elle vint témoigner en faveur de Jeanne d’Arc au procès de réhabilitation.
Toutmouillé (Jean), sa déposition
Jean Toutmouillé, dominicain, a vu Jeanne d’Arc dans ses derniers moments, la visita le matin de sa mort, et l’assista jusqu’au supplice. Il avait refusé de siéger parmi les assesseurs du procès. C’était un double motif pour qu’on l’appelât à témoigner au procès de réhabilitation.
Turner
Né à Londres le 24 septembre 1768, mort à Londres le 13 février 1847, historien anglais. Il a composé une grande Histoire d’Angleterre, dont le premier volume parut en 1799 et le dernier en 1826. Elle s’étend depuis les origines jusqu’à la mort d’Élisabeth. Tous les critiques anglais sont d’accord pour reconnaître la conscience avec laquelle fut fait ce long travail de vingt-sept années.
Varin, Archives administratives de Reims
Varin (Pierre Joseph), érudit, né à Brabant-le-Roi (Meuse), mort à Paris le 12 juin 1849, secrétaire du comité des Chartes, puis doyen de la Faculté des lettres de Rennes. Il entreprit, sur les conseils d’Augustin Thierry et de Guizot, un recueil considérable de documents pour servir à l’histoire de Reims, qui devait prendre sa place dans la grande collection de Documents inédits, publiés à partir de 1836 par les soins du gouverne à ment de Louis-Philippe. Son ouvrage parut en 7 volumes à partir de 1839, en 2 séries : Archives administratives de la ville de Reims, Archives législatives. Dans sa préface, Varin s’excusait avec modestie de n’avoir été qu’un compilateur. Mais ce recueil, qui lui coûta huit années de travail, la santé et presque la vue
, n’est pas une compilation. C’est une collection précieuse, indispensable à qui veut connaître l’histoire municipale de Reims et celle des villes au moyen âge, l’un des plus beaux travaux et des plus utiles qu’aient provoqués l’initiative et l’exemple féconds d’Augustin Thierry.
Varin a imprimé dans ses Archives législatives une relation de l’entrée de Charles VII et de Jeanne d’Arc à Reims, faite au dix-septième siècle par Jean Rogier d’après des lettres de Charles VII, de la Pucelle, des commandants militaires du pays, des corps municipaux de Troyes et Châlons, pièces précieuses, aujourd’hui perdues. Michelet n’a pas eu cette relation à sa disposition.
Notes
- [1]
Consultez surtout : Ma Jeunesse et le Peuple, de Michelet lui-même ; Jules Michelet, par Gabriel Monod ; Jules Michelet, sa vie et ses œuvres, par Joseph Othenin d’Haussonville (Revue des Deux Mondes, mai-juin 1876) ; Jules Michelet (1876), par Eugène Spuller ; Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t. II, Nouveaux lundis, t. II.
- [2]
Pour toutes ces indications sur les manuscrits du procès, sur les chroniqueurs du quinzième siècle, les historiens de Jeanne d’Arc, consultez le Répertoire alphabétique.
- [3]
Voir pour ce nom et ceux qui vont suivre le Répertoire alphabétique.
- [4]
Nous n’indiquons que les travaux les plus importants. Pour de plus amples détails sur ces livres mêmes, consultez notre Répertoire alphabétique.
Gustave Rudler (1925)
L’édition de référence.
Gustave Rudler (1872-1957), homme de lettres, élève à Louis-le-Grand puis à l’École Normale Supérieure, enseigna à la Sorbonne avant d’être recruté par le Bedford College de Londres pour y enseigner la littérature française.
Entre 1925 et 1926, il publia coup sur coup, quatre volumes sur la Jeanne d’Arc de Michelet : une édition critique du texte (Hachette), une analyse de l’auteur (Presses universitaires de France).
- Michelet historien de Jeanne d’Arc, t. I : la méthode (1925) ;
- Jeanne d’Arc, de Jules Michelet, t. I et II, édition critique (1925) ;
- Michelet historien de Jeanne d’Arc, t. II : la pensée, l’art (1926) ;
Pour écrire le premier tome de Michelet historien consacré à la valeur historique de l’ouvrage de Michelet, Rudler s’est astreint à une double étude des sources : celles relatives à l’histoire de la Pucelle, mais aussi le manuscrit original du texte de Michelet.
Et malgré toute l’estime qu’il porte à Michelet l’écrivain, ses conclusions sont sévères envers l’historien.
Qu’en reste-t-il ? tout et rien. Rien, c’est un peu trop dire ; mais vraiment, il en reste bien peu de chose si on le prend pour une œuvre d’histoire et de critique… Tout, si on y cherche un beau poème, une légende tendre et terrible, une âme, un talent… L’essentiel est de le bien prendre et de ne pas lui demander ce qu’il n’a pas. On n’y trouve guère Jeanne d’Arc, au moins la vraie ; mais on y trouve, à chaque ligne, Michelet. Il révèle clairement sa forme d’esprit. C’est un esprit habituellement sans précision, ni application, pétulant, généreux, immédiat dans ses réactions, emporté par l’imagination et la sensibilité, plus soucieux de se trouver dans les choses que de les trouver, prompt à s’envoler dans le royaume de la poésie ; mais là, merveilleusement à l’aise, chez lui, riche de vues fines et tendres, prodigue de coups d’aile, et si humain.
Compte rendu de Daniel Mornet (1926)
Article paru dans la Revue d’Histoire littéraire de la France, 33e année, n° 2 (1926), pp. 303-305.
Les conclusions ne sont pas une condamnation des méthodes de Michelet. […] Au nom peut-être d’une vérité supérieure — on pourra toujours en discuter — il a fait bon marché de la vérité de certains détails. […] Michelet est un peu un historien original et beaucoup un compilateur de génie.
Gustave Rudler, agrégé des lettres, docteur es lettres, professeur de littérature française à l’Université d’Oxford : Michelet historien de Jeanne d’Arc, tome I : La Méthode
, Paris, Presses Universitaires, 1925. Un vol. in-8° de 228 pages.
C’est un ouvrage remarquable et qui nous invite à réviser une partie des jugements traditionnels sur Michelet historien. M. Rudler s’est proposé de rechercher quelle était la valeur non pas littéraire, dramatique, pathétique ou nationale de la Jeanne d’Arc de Michelet, mais sa valeur proprement historique. Dans quelle mesure nous apprend-elle sur Jeanne d’Arc la vérité ; ou plutôt, puisqu’on pourra toujours chicaner cette vérité, quelles précautions Michelet a-t-il prises pour l’atteindre ? A-t-il eu tous les scrupules nécessaires, ceux de nos historiens modernes ou, du moins, ceux de son temps ?
La tâche était singulièrement malaisée. Elle demandait un labeur considérable. Pour juger la méthode de Jeanne d’Arc il fallait, en quelque mesure, refaire soi-même son histoire. Pour s’assurer de la valeur des documents de Michelet il fallait étudier les documents ; et l’on sait qu’ils sont considérables. M. Rudler n’a pas reculé devant ce travail de bénédictin. Il nous apporte aujourd’hui la première partie de son enquête. Des volumes qui suivront étudieront la pensée et l’art de Michelet et nous donneront une édition critique de l’histoire de Jeanne d’Arc.
Les conclusions ne sont pas une condamnation des méthodes de Michelet. Michelet ne pouvait pas employer des méthodes scientifiques. Je ne crois pas qu’aucun historien d’aujourd’hui, avec le secours des innombrables histoires partielles très solides qui ont été écrites depuis quatre-vingts ans, pourrait entreprendre d’écrire une histoire de France complète
. Michelet l’a tenté. La tentative devait être très imparfaite. L’histoire de Jeanne d’Arc n’était qu’un chapitre de cet ensemble ; elle devait avoir les défauts inévitables de l’ensemble. Il aurait fallu des années pour qu’elle fût scrupuleusement informée. Michelet pouvait lui consacrer non des années mais des mois. Pour lui en faire grief il faudrait démontrer qu’il a eu tort d’écrire son histoire. Et M. Rudler n’y songe pas.
Ce qui est un peu plus fâcheux c’est que Michelet a essayé de faire illusion. En fait il a écrit tout son livre en suivant de très près ou d’assez près les meilleurs historiens de Jeanne d’Arc, L’Averdy (1790), Le Brun [orthographié Lebrun] de Charmettes (1817) et quelques autres. Il n’a eu recours aux pièces originales que par occasions, superficiellement. Mais s’il n’avait pas le temps ni la patience d’écrire l’histoire d’après les seuls documents originaux, il savait le prix de ces documents. Il avait le goût de la science ; il était capable de scrupules critiques. Or il a essayé, non pas de tromper ses lecteurs, ce serait un bien gros mot, mais de masquer la hâte de l’information. Il a quelque peu laissé croire qu’il avait constamment sous les yeux non pas L’Averdy ou Le Brun, mais les pièces authentiques. Enfin, s’il était capable de critique et s’il avait le sens des méthodes historiques, il était surtout un homme d’enthousiasme et d’imagination, un narrateur qui veut ressusciter
. Dans la fièvre de la composition, dans l’exaltation de sa vision il a pris avec les textes et même avec ses informateurs de seconde main des libertés qui servaient sans doute le pittoresque et le pathétique de son récit, mais qui trahissaient la vérité. Au nom peut-être d’une vérité supérieure — on pourra toujours en discuter — il a fait bon marché de la vérité de certains détails.
Telles sont les conclusions générales de M. Rudler. Elles sont fort intéressantes. Ce qui l’est plus encore, c’est la méthode que suit M. Rudler pour y parvenir. Ayant à juger l’exactitude historique de Michelet, il a eu la conscience de ne reculer devant aucune des exigences d’un examen critique rigoureux. Il a suivi le récit de Michelet phrase par phrase. Détail par détail, avec une patience et une pénétration admirables, il a cherché d’où lui venait son information. Détail par détail il a mis de côté tout ce qu’il trouvait dans L’Averdy, dans Le Brun et dans quelques autres, et tout ce qui pouvait venir de la lecture des documents. Il n’a pas craint d’en faire un tableau rigoureux et comme une statistique. Pour chaque cas particulier, il a exposé les éléments du problème et cherché la solution. Il n’a pas escamoté les difficultés, passé sous silence les cas contradictoires ; il a reconnu que Michelet, dans sa hâte, avait des scrupules, qu’il lui arrivait de vérifier, de s’appuyer directement sur le document. Mais, dans l’ensemble, chacune des démonstrations de détail de M. Rudler, aussi ingénieuse que solide, mène à des conclusions générales dont la solidité est faite de la solidité des parties. Avec toutes les excuses ou même tous les droits que l’on voudra, Michelet n’a pas eu rigoureusement la conscience d’un historien : aveuglé par ses puissances intérieures de sympathie ou d’antipathie, de vision et de poésie, il a manqué de beaucoup des méthodes que nous jugeons indispensables à l’historien.
Ce premier volume ne donne d’ailleurs que des résumés et des exemples topiques. C’est seulement dans l’édition critique que nous pourrons suivre le détail minutieux de l’examen. Mais M. Rudler nous en dit assez pour que nous soyons tout à fait rassurés ; on pourra peut-être chicaner certains détails ; ils n’ébranleront pas la cohésion, la solidité de l’ensemble ; la vérité est établie pour cette histoire de Jeanne d’Arc. Michelet est un peu un historien original et beaucoup un compilateur de génie.
Il faut louer hautement M. Rudler d’avoir poursuivi cette vérité avec une pareille énergie et une pareille pénétration. Le tome II, qui étudiera la pensée et l’art de Michelet, lui fera peut-être pardonner les constatations de son tome premier. Ce n’est pas sûr. Il est périlleux de toucher aux idées reçues ; il est même dangereux de n’exposer des idées sur l’histoire des hommes qu’après les longs et obscurs labeurs d’une recherche méthodique. Il y aura toujours des gens pour croire que cette longueur de temps et ce labeur sont une insulte aux intuitions de leur talent et aux éclairs soudains de leur génie. Chaque mois, et parfois chaque semaine, nous voyons naître de ces résurrections
de nos grands hommes, de nos grands écrivains, des événements de notre histoire où ceux qui ne sont pas des Michelets pillent sans le dire des L’Averdys ou des Lebruns d’aujourd’hui, sans les excuses de Michelet et sans les scrupules qu’il gardait. Ils en sont d’ailleurs fort souvent récompensés par de l’argent et même de la réputation. Ils ne se contentent pas toujours d’en jouir ; et il leur arrive de démontrer que nos Lebruns et nos L’Averdys, sans qui ils n’auraient rien pu écrire, ne sont que des sots. Pourtant, pardessus ces vaines querelles, il faut que s’élève un idéal : l’amour de la vérité, le désir impérieux de l’atteindre ou d’en approcher le plus près possible, quel que soit le labeur qu’elle impose, sans autre récompense que de la posséder ou de l’approcher. Le livre de M. Rudler est un bel exemple de cet amour. Il vaut par ses résultats. Il vaut également par les leçons qu’il donne. C’est un des meilleurs modèles de méthode critique pour l’étude des sources, où les problèmes très complexes sont posés avec le plus de pénétration et résolus avec le plus de sagacité et de précision. M. Rudler est un des représentants de la pensée française en Angleterre. Nous savons quelle haute autorité il y a
conquise et le respect qui l’y entoure. Son nouveau livre témoigne avec éclat qu’il les mérite.
Compte rendu de Henri Laurent (1926)
Article paru dans la Revue belge de Philologie et d’Histoire, année 1926, tome 5, fasc. 2-3, pp. 639-644.
Le livre de Rudler paraît une charge contre la méthode de Michelet et un hommage aux deux sources qu’il aurait effrontément pillées : L’Averdy et Le Brun de Charmettes.
Ce n’est qu’après la rédaction achevée, et souvent sur les épreuves, que Michelet a repris [ses notes de bas de page] pour substituer à des références à Le Brun, des citations du procès. Son appareil de notes est donc absolument trompeur et postiche.
L’histoire de Jeanne d’Arc de Michelet formait primitivement les chapitres 3 et 4 du livre X, au tome V de la première édition de l’Histoire de France (1841) ; et elle fut reproduite dans toutes les réimpressions. Ce n’est qu’en 1853 que l’épisode parut séparément, en un volume de 150 pages qui est demeuré l’ouvrage le plus populaire du grand historien, et comme un microcosme de cet univers de lyrisme qu’est l’œuvre de Michelet.
M. Rudler, professeur d’histoire de la littérature française à l’Université d’Oxford, qui a publié récemment un ouvrage remarquable sur les techniques de l’histoire et de la critique littéraires en littérature française moderne couronné par l’Académie française (Oxford, The Clarendon Press, 1923), a préparé pour la Société des textes françaises modernes (Hachette) une édition critique de la Jeanne d’Arc, qui supprime toutes les précédentes défectueuses. Dans le présent volume, il nous livre le détail de son travail d’éditeur du texte se proposant d’établir avec le maximum de précision où Michelet a pris les matériaux de son livre et selon quels principes critiques il les a traités. En réalité, cette étude dépasse largement le but que se propose son titre : elle nous renseigne sur les procédés intimes de travail d’un grand historien, répondant ainsi à un vœu intelligent formulé autrefois par M. Charles-Victor Langlois (Introduction aux études historiques, 1898, p. 83, note 1) ; mais du même coup elle constitue un exposé de la conception que l’on se faisait d’une œuvre historique en France environ le milieu du siècle dernier. La conclusion de l’examen rigoureux auquel M. R. s’est livré, est décisive et sévère : du point de vue strict, disons tout de suite pour être, croyons nous, en conformité d’idées avec M. Rudler, du point de vue spécial, mais indispensable, de la critique historique telle qu’on la pratique depuis un demi siècle dans les écoles, la méthode de Michelet est condamnable en tous points. Nous verrons tout-à-l’heure à porter sur elle un jugement plus ample en admettant l’excuse de la date ; pour le moment gardons avec M. Rudler le point de vue actuel.
Par malheur, Michelet avait une idée très haute de sa méthode. Or, s’il la fondait, comme la plupart de ses contemporains, influencés par l’enseignement de la jeune École des Chartes, sur l’étude directe du document, marquant en cela un grand progrès sur Barante et Vitet qui avaient ramené l’histoire à la peinture de genre, à l’étude, au croquis
comme disait Vitet lui-même, en revanche Michelet se contentait de ce principe essentiel, n’en dépassait guère le sens littéral. Cet amoureux des textes se servait des premiers venus à sa portée, il ignorait comment on établit un meilleur texte par l’étude comparée, la recherche de la provenance, des copies d’un original, bref par tout ce travail de la critique d’érudition grâce auquel l’historien s’achemine vers une approximation de la vérité.
M. Rudler, examinant quelles sources Michelet a employées, est obligé de commencer (et ceci est significatif) par les sources de seconde main, par les imprimés
tant est grande la dette de Michelet envers eux. Le sujet n’était déjà plus neuf en 1840 Parmi les ouvrages précédents, Michelet en a retenu deux, dont M. R. nous donne une analyse extrêmement amusante et pénétrante à la fois. Ce sont :
1. L’Histoire de Jeanne d’Arc de Le Brun de Charmettes [orthographié Lebrun des Charmettes] (Paris 1817, 4 vol in-4° de 1818 pages au total). Le Brun a réuni tous les matériaux de l’histoire de Jeanne d’Arc à quelques rares exceptions près. Or non seulement, son ouvrage a servi à Michelet comme index renvoyant aux textes de Monstrelet, du Bourgeois de Paris, etc. ; comme répertoire de fragments de textes publiés qu’il a utilisés sans les vérifier ; mais Michelet lui a encore emprunté l’ordre de son récit, en n’y pratiquant guère rien de plus qu’un nouveau groupement des faits par séries ; mais il lui doit encore sa critique et — chose inattendue — une quantité innombrables d’idées, de jugements et même de passages tout entiers, de traits ailés et lyriques qu’on croirait être spécifiquement du Michelet ! M. Rudler le démontre indiscutablement, et par son étude des notes du manuscrit de Michelet, et par une comparaison des procédés d’exposition, de l’arrangement composite de certains passages. En outre, Michelet jugeant sans doute qu’il avait fait œuvre originale en recréant la compilation de Le Brun, ne reconnaît pas la dette énorme qu’il lui doit, par la brève déclaration générale à laquelle on s’attendrait.
2. Pour le procès, Michelet s’est inspire des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. III (Paris, 1790) de L’Averdy. Le plan de ce volume est déplorable, ou plutôt il n’y en a guère : c’est un fatras de notices et d’extraits (par hasard, le titre dit vrai) Mais si difficilement maniable qu’il soit, il est une date dans l’histoire de Jeanne. Ce L’Averdy, vrai fils du XVIIIe siècle, homme sensible
épris de justice, d’équité et d’humanité, discute pied à pied la légalité du procès comme Voltaire celui de Calas ; et au lieu d’éclairer les agissements de Cauchon comme le fit Quicherat, par une connaissance des règles et de la procédure canoniques en matière d’inquisition, il n’y voit qu’un tissu de raffinements, de scélératesse, comme on aimait en trouver alors dans les romans gothiques
. Ici également, M. R. établit par une patiente et minutieuse et concluante analyse mot par mot, dans le détail de laquelle il nous est impossible d’entrer, mais dont on admirera l’ingéniosité et l’intelligence, que la dette de Michelet est énorme, non seulement pour la documentation, mais pour la pensée.
Tout ce qui s’y décèle en fin de compte de personnel, c’est la promptitude de coup d’œil qui a capté ça et là tel ou tel rayon, c’est l’agile pensée intérieure qui a rapproché, fondu, unifié, ces matériaux disparates en un récit ailé, c’est l’écrivain, c’est l’homme, Michelet (p. 26).
Qu’il ait largement puisé sa documentation et sa pensée dans L’Averdy et dans Le Brun, le reproche se réduit considérablement si l’on veut bien considérer que les ouvrages de ces deux auteurs sont, en gros, probes et sains. Le paragraphe suivant, relatif aux sources de première main, au procès manuscrit, aboutit à une conclusion impitoyable. On sait que l’histoire de la Pucelle nous est connue en ordre principal par la minute du procès de sa condamnation copiée à cinq exemplaires dont il nous reste trois : les mss. lat. 5965-66 de la Nationale que L’Averdy dans son classement plaçait très justement en tête de liste, et que Quicherat a pris pour base de son édition (5 vol. 1841-49) ; et un ms. de la Bibliothèque du Palais-Bourbon, ignoré de L’Averdy et de Quicherat, qui est probablement l’exemplaire de Pierre Cauchon, et d’après lequel M. Champion nous a donné récemment une édition monumentale et définitive (2 vol. 1920-21). On imaginerait que Michelet se basant sur le bon classement établi par L’Averdy, a utilisé le lat. 5964 de la Nationale. Point du tout ! Il ne l’a pas connu, non plus que l’exemplaire de la Bibliothèque de la Chambre des Députés, non plus encore que les nombreuses copies du XVe ou du XVIe siècle reposant à la Nationale et qui se placent en seconde ligne. M. R. qui estimait trop haut la méthode de Michelet, avoue qu’il aurait dû ne pas négliger le fait important que Michelet, alors chef de section aux Archives Nationales, avait sous la main dans son dépôt des copies du procès. Il a découvert sur le manuscrit de Michelet — qu’il n’a pu consulter qu’en 1923 — que les références se reportent aux copies du procès cotées à l’Hôtel Soubise U 820-21. Or ces copies sont tardives et sans valeur ! De plus, M. Rudler en une analyse poussée jusqu’aux extrêmes limites de la minutie et qui exige trois ou quatre lectures (pp. 35-65) dissèque l’appareil de notes et de références de la Jeanne d’Arc, et à travers ce rideau, compare l’appareil érudit destiné au lecteur avec la sorte de catalogue des passages que Michelet avait dressé en lisant ces copies, dans l’intention de les utiliser comme références (cette table des matières est aujourd’hui au Musée Carnavalet. M. Rudler la publie en appendice, pp. 190-204.). Mais le livre de Michelet n’est pas né de la réaction spontanée de son esprit sur les documents ;… il reflète étroitement presque tout entier des ouvrages de seconde main
(p. 8). En effet, après ce dépouillement hâtif des tardives copies. Michelet effrayé par l’immensité du labeur d’érudition auquel il allait devoir se livrer, s’est rabattu sur les ouvrages de L’Averdy et de Le Brun ; il s’en est servi pour établir la charpente de son récit, et même un peu la substance, comme nous l’avons vu. Et ce n’est qu’après la rédaction achevée, et souvent sur les épreuves, qu’il a repris sa sorte de table dressée d’après la copie du procès, pour substituer à des références à Le Brun, des citations du procès. Son appareil de notes est donc absolument trompeur et postiche.
Les autres chapitres du livre de M. Rudler sur lesquels nous ne pouvons nous étendre, nous montrent le même Michelet négligent dont l’exactitude chronologique est parfois inférieure à celle de L’Averdy ou de Le Brun (chap. II). Ses principes critiques sont simplistes et insuffisants. Il part de l’axiome qu’en cas de contradiction, il faut accorder la préférence au témoignage de Jeanne ; se laisse guider souvent par son instinct ou par le hasard (pp. 100-01) ; esquive des difficultés, se dérobe devant tous les obstacles (p. 109) ; cite des fragments isolés de leur contexte (p. 137) ; se décide plus loin pour une cote mal taillée entre un texte de chroniqueur suspect et l’appréciation d’un érudit du XIXe siècle. En somme, il n’a pas compris les ressorts profonds du procès, ne s’est jamais inspiré de la règle élémentaire qui était de voir le procès du point de vue des juges, lesquels en furent si fiers qu’ils assurèrent la conservation des copies. (M. Rudler a résumé en quelques pages (81-89) bourrées d’idées les grands principes critiques qui doivent guider les historiens qui étudient le procès.)
La lecture du livre de M. Rudler appelle quelques conclusions. La plus générale, c’est que l’identité de la méthode de la critique littéraire et de la critique historique est démontrée une fois de plus, si besoin en est encore, par ce modèle concret de l’analyse minutieuse et détaillée qui, loin d’être une entrave à l’ampleur des vues, en est la condition même. Une autre réflexion nous est encore indirectement suggérée par le livre de M. Rudler ; c’est que nous nous sentons plus près d’un L’Averdy ou d’un Le Brun que d’un Michelet. Voici deux noms à ajouter à la liste déjà longue des érudits de la fin du XVIIIe siècle qui ont vu la carrière de leurs livres arrêtée par la tourmente révolutionnaire. On ne sait pas assez qu’à ce moment la jonction si longtemps retardée de l’histoire érudite et de l’histoire philosophique, le contact entre le pôle Mabillon et le pôle Montesquieu était près d’être réalisé, l’était même déjà chez nombre de jurisconsultes et d’historiens des institutions comme Mably, Moreau, Buat-Nancey, etc. Le livre de M. Rudler nous apprend à connaître un Le Brun qui a vu toutes les sources de l’histoire de Jeanne d’Arc ; un L’Averdy qui, lorsqu’on a dépouillé son ouvrage de l’ingénuité de l’homme sensible
, n’en reste pas moins le premier qui ait vu avec clarté tous les problèmes de critique spéciale que posait le procès de Rouen.
Nous ne pensons pas pouvoir mieux exprimer notre admiration sans réserves pour le très beau livre de M. Rudler, qu’en lui disant que nous attendons avec impatience son t. II consacré à la pensée et à l’art de Michelet historien de Jeanne d’Arc. Nul doute que les conclusions de ce t. II compenseront largement celles si lamentables du présent volume consacré à l’examen de la méthode ; nous avons omis en effet de signaler chemin faisant que M. Rudler semble parfois fort ennuyé de devoir établir un bilan aussi fâcheux pour la mémoire de Michelet et qu’il anticipe sur son volume suivant pour nous dire toute son admiration pour l’intuitif le lyrique, l’animateur incomparable qui appelait l’Histoire une résurrection
(voir entre autres pp. 2-3 ; 66 ; 171).
Le style de M. Rudler très heureusement personnel, alerte, nuancé, riche, dénote une maîtrise constante de la matière. Sagacité de l’analyse et souci de la synthèse, ne sont-ce pas là les deux plus belles qualités de l’historien ?
Compte rendu de Charles-Hippolyte Pouthas (1926)
Article paru dans la Revue d’histoire moderne, tome 1, n° 6, 1926, pp. 473-474.
J’ai dit naguère, dans le Bulletin de la Société d’Histoire Moderne, lors de la publication du tome Ier, l’estime et, pour exprimer toute ma pensée, le respect, qu’inspirent une méthode aussi impeccable et un travail aussi minutieux. On apprécie mieux encore ici, dégagée des comparaisons techniques, l’aisance souveraine de M. Rudler ; on a, de plus, l’avantage de pouvoir, à chaque citation ou référence, se reporter au texte de son édition critique publiée entre temps (Jules Michelet, Jeanne d’Arc, édition critique par Gustave Rudler, 2 vol. in-16, Société des Anciens Textes Français, Paris, Hachette, 1925.)
Je laisse à regret la 3e partie sur l’art de Michelet, où l’étude du style et des procédés littéraires est fouillée jusqu’à l’analyse du mécanisme mental et de la psychologie de l’écrivain ; et, puisque nous sommes sur le terrain historique, je renonce même à résumer l’exposé des théories religieuses, politiques et historiques de la Jeanne d’Arc, pour indiquer seulement en quoi la pensée de Michelet l’amène à fausser, consciemment ou non, ses documents, les documents plutôt de Le Brun, L’Averdy et Barante.
M. Rudler nous montre combien cette pensée reste indécise et fuyante, prise entre un rationalisme instinctif et pourtant timide, et un parti-pris d’idéalisation spiritualiste. La volonté de construire la légende de Jeanne lui suggère des interprétations mystiques étranges (les prénoms prédestinés par exemple), déforme le milieu provincial et familial, l’enfance et jusqu’au portrait physique, ou bien l’arrête au milieu de vues plus perspicaces (l’évolution du caractère de Jeanne devant le succès), émousse l’acuité de son analyse psychologique.
L’histoire de Jeanne devient chez Michelet l’épisode capital d’une double théorie très vaste : l’absorption de l’âme religieuse du moyen âge dans la dévotion virginale, la libération progressive de la conscience humaine. Prise en elle-même, on y retrouve soit des imaginations historiques hasardées (comme le plan lorrain, ou les combinaisons d’ambitions personnelles autour de la prise de Jeanne), soit des transpositions d’expériences intimes (la révélation de la patrie par la pitié), soit des exaltations de sentiments personnels (l’acrimonie contre les Anglais qui fausse tout le détail des tribulations de Jeanne après sa prise à Compiègne et tout le procès), soit des ignorances dues à une préparation par trop rapide (le rôle de l’Université de Paris).
Au total, de ce livre d’une conscience qui fait avec la méthode de Michelet un tel contraste qu’il se dégage de ce rapprochement toute une philosophie du travail historique et tout un enseignement, il ressort un Michelet terriblement superficiel, acceptant sans critique les conclusions de ses devanciers, n’allant point aux documents, se contentant d’utiliser, sauf à les orner, des sources immédiates.
Qu’en reste-t-il ? tout et rien. Rien, c’est un peu trop dire ; mais vraiment, il en reste bien peu de chose si on le prend pour une œuvre d’histoire et de critique… Tout, si on y cherche un beau poème, une légende tendre et terrible, une âme, un talent… L’essentiel est de le bien prendre et de ne pas lui demander ce qu’il n’a pas. On n’y trouve guère Jeanne d’Arc, au moins la vraie ; mais on y trouve, à chaque ligne, Michelet. Il révèle clairement sa forme d’esprit. C’est un esprit habituellement sans précision, ni application, pétulant, généreux, immédiat dans ses réactions, emporté par l’imagination et la sensibilité, plus soucieux de se trouver dans les choses que de les trouver, prompt à s’envoler dans le royaume de la poésie ; mais là, merveilleusement à l’aise, chez lui, riche de vues fines et tendres, prodigue de coups d’aile, et si humain. (p. 218).
Édition Hatier (1932)
Collection : Les Classiques pour tous de la librairie Hatier, avec une brève notice sur Michelet signée Charles-Marc Des Granges, professeur au lycée Charlemagne.
Le texte est celui de l’édition séparée de 1853, mais sans les notes de bas de page.
Notice sur Michelet
I.
Michelet a raconté lui-même, dans son ouvrage intitulé Ma Jeunesse, sa vie laborieuse et tourmentée. Il naquit à Paris, le 21 août 1708, d’une famille très humble, mais où le travail était en honneur, et où il reçut des exemples de dévouement et de persévérance. Son père, modeste imprimeur, fut à peu près ruiné en 1800 par l’arrêté du Premier Consul qui supprimait tous les journaux issus de la Révolution. Le petit Michelet eut ainsi une enfance pénible, et dut, dans l’intervalle de ses heures d’étude, se faire ouvrier imprimeur pour contribuer aux travaux précaires qui suffisaient à peine à la subsistance de la famille. Cependant sa mère lui donnait le goût de l’histoire, en lui faisant des lectures.
En 1812, l’enfant put entrer au Lycée Charlemagne, où il fit de brillantes études. Une volonté touchante animait cet écolier qui souffrit bien des fois du froid ou de la faim. Pour aider ses parents pauvres qui l’avaient aidé dans les mauvaises années
, il renonça à passer par l’École normale supérieure et se fit répétiteur dans une de ces institutions du Marais dont les élèves suivaient les classes de Charlemagne. Ces ingrates fonctions ne l’empêchèrent pas de devenir licencié, puis docteur ès lettres (1819). Deux ans après, il passait avec succès le concours d’agrégation. Nommé professeur d’histoire au Collège Sainte-Barbe, il peut alors concilier ses goûts et ses devoirs.
En 1825, il publie son premier ouvrage : les Tableaux chronologiques et synchroniques d’histoire moderne. L’année suivante, il donne une traduction de la Scienza nueva de Vico et son Précis d’histoire moderne. — En 1828, c’est l’Histoire romaine, la première de ses œuvres où il apparaît avec ses qualités brillantes et aussi avec ses défauts. Son ardente imagination prêtait la vie aux documents patiemment amassés ; mais parfois aussi elle l’entraînait à des accès de romantisme et de sensibilité dont ne saurait s’accommoder la véritable science de l’histoire.
Du Collège Sainte-Barbe, Michelet passa, en 1827, à l’École normale supérieure. Il devenait ainsi, par une superbe revanche, professeur dans cette école où son dévouement familial ne lui avait pas permis d’entrer comme élève. En 1831, il est nommé chef de la division historique des Archives ; et, en 1838, professeur au Collège de France.
II.
Il avait entrepris, dès 1828, une Histoire de France, dont il publia les six premiers volumes de 1833 à 1844. Il y traitait des origines de la France dans le tome I ; — au tome II, il faisait le Tableau de la France ; — dans les tomes III à VI, c’était l’histoire de la féodalité et des temps modernes jusqu’à l’avènement de François Ier.
Là, il s’arrêta. Pour bien comprendre le développement de la monarchie absolue, il voulut d’abord étudier la Révolution, qui en était l’aboutissement De 1847 à 1853, il écrivit donc son Histoire de la Révolution, où il s’efforçait d’être impartial, mais où son lyrisme romantique prenait trop souvent le dessus sur la critique.
Quand il se remit à l’étude de la Renaissance et de la monarchie pour continuer et achever sa grande œuvre, de graves événements s’étaient passés, qui avaient eu leur répercussion sur l’âme ardente et sensible de Michelet. La Révolution de 1848 l’avait enthousiasmé, puis profondément déçu ; car elle aboutissait à la dictature, au coup d’État de 1851, au rétablissement de l’Empire. Michelet refusant de prêter serment à la nouvelle constitution, avait dû abandonner sa place aux Archives et sa chaire du Collège de France. Désormais, il ne vivra plus au milieu des documents dont le seul maniement refrénait ses écarts d’imagination ; et il ne pourra plus trouver dans l’enseignement public une heureuse et éloquente échappatoire à ses poussées de lyrisme. Il se remet donc au travail dans des conditions moins favorables, et les derniers volumes de son Histoire, abondants en tableaux magnifiques, très intéressants pour l’étude de sa personnalité, ont moins de valeur que les précédents.
Il y ajoute, travailleur infatigable et poète magistral, des ouvrages où se mêlent de la façon parfois la plus surprenante la science et l’imagination : l’Oiseau, l’Insecte, la Mer, la Montagne.
Les désastres de 1870-1871 le frappèrent au cœur. Il mourut à Hyères, le 9 février 1874, laissant inachevée une Histoire du XIXe siècle.
Édition Hachette (1935)
Collection : Classiques illustrés Vaubourdolles de la librairie Hachette, avec quelques illustrations et une notice de Louis-Fernand Flutre.
Le texte est celui de l’édition séparée de 1853, sans les notes de bas de page de Michelet, mais avec de nouvelles notes explicatives pour public jeune : l’explication de mots (par exemple pharisien), de notions (docteur en théologie), d’éléments historiques (le Journal du Bourgeois de Paris), etc.
Vie de Michelet 1798-1874
Jules Michelet naquit à Paris le 21 août 1798. C’était le fils d’un imprimeur, petit patron que les lois de 1800 sur la presse ruinèrent à moitié. Son enfance fut pénible. Dès l’âge de douze ans, il dut aider son père comme apprenti et travailler à lever la lettre
dans une cave du boulevard Saint-Martin. Mais comme il se faisait remarquer à l’école primaire pour son intelligence et son application, ses parents s’imposèrent des privations pour le faire instruire. En 1872, il entra au lycée Charlemagne où il fut un élève brillant. Après avoir remporté en 1816 plusieurs prix au concours général, il entra comme répétiteur dans une institution du Marais, fut reçu docteur ès lettres en 1819, agrégé d’histoire en 1821. Pendant cinq ans, jusqu’en 1826, il enseigna l’histoire successivement au collège Sainte-Barbe, au lycée Charlemagne, au collège Rollin. C’est alors qu’il traduisit les Principes de la philosophie de l’histoire de l’Italien Vico, composa ses Tableaux chronologiques de l’histoire moderne et son Précis d’histoire moderne. En 1827, il fut nommé maître de conférences de philosophie à l’École Normale Supérieure. En 1831, il publia son Histoire romaine et fut appelé aux Archives Nationales comme chef de la division historique.
Ce fut la plus belle époque de sa vie. Marié depuis 1823, père de deux enfants, il était arrivé, à force de travail, à une situation brillante et stable. C’est alors qu’il conçut l’idée de chercher, dans les documents dont il avait la garde, l’histoire du passé de sa patrie. Il commença la grande Histoire de France à laquelle il devait travailler près de quarante ans. Le premier volume parut en 1833, le dernier en 1867.
En 1838, il fut nommé professeur d’histoire et de morale au Collège de France. Il avait comme auditeurs, non plus des élèves, mais un public nombreux sans cesse renouvelé. Lui et ses deux amis, Quinet et Mickiewicz, entreprirent de faire de leur cours une sorte de prédication à la jeunesse. C’était le moment où l’opposition contre le gouvernement de Guizot devenait vive dans toute la France. Démocrate d’origine et d’instinct, Michelet se fit le défenseur de l’ouvrier et du paysan, et publia en 1846 son livre : Le Peuple. Interrompant son Histoire de France après le sixième volume, il commença à composer son Histoire de la Révolution (1347-1853). Quand Louis-Philippe fut renversé par la révolution de 1848, Michelet crut un instant réalisés ses rêves de libéralisme. Mais la République ne dura pas ; le coup d’État de 1851 le chassa de sa chaire du Collège de France et de sa place aux Archives. Il continua néanmoins ses travaux historiques, acheva l’Histoire de la Révolution, reprit la suite de l’Histoire de France. Entre temps, pendant ses vacances et différents séjours à Nantes, Étretat, Montreux, Fontainebleau, il écrivit une série d’ouvrages d’un genre différent : L’Oiseau, L’Insecte, La Mer, La Montagne, sortes de poèmes en prose mêlés de considérations philosophiques où Michelet exprime les émotions que lui a inspirées le spectacle de la nature.
La guerre de 1870 le trouva à Paris, malade, épuisé. Ses amis l’emmenèrent en Italie où il souffrit cruellement de toutes les nouvelles qu’il recevait de France. La capitulation de Paris lui donna une attaque d’apoplexie. Il se remit cependant et commença une Histoire du XIXe siècle. Il n’eut pas le temps de l’achever ; il mourut à Hyères le 9 février 1874.
Notice sur Jeanne d’Arc
Une édition critique de la Jeanne d’Arc de Michelet a été publiée en 1925 par M. Gustave Rudler (2 vol. dans la collection des Textes français modernes), qui l’a fait suivre de deux volumes où il étudie la méthode de Michelet, historien de Jeanne d’Arc. Ce sont là des ouvrages de premier ordre, auxquels doit recourir quiconque veut étudier de près le texte que nous réimprimons ; et nous ne pouvons mieux faire, dans cette courte notice, que d’en résumer les principales données.
Jeanne d’Arc a d’abord paru en 1841, dans le tome V de l’Histoire de France entreprise par Michelet en 1833 ; elle remplissait alors les chapitres III et IV de ce volume, et se trouve naturellement reproduite dans toutes les réimpressions de l’Histoire. Mais, en 1853, Michelet avait fait paraître séparément l’épisode de Jeanne d’Arc, découpé cette fois en six chapitres, avec une introduction nouvelle. C’est le texte de l’édition de 1853 qu’on trouvera dans la présente brochure.
Comment Michelet a-t-il composé sa Jeanne d’Arc ? Chose surprenante, ce magnifique écrivain, si fier d’avoir donné le document
pour base à la science de l’histoire qui alors se constituait, n’a pas fondé son incomparable récit sur la lecture de pièces originales ; il n’a utilisé que des documents de seconde main.
Pour bien faire comprendre la façon dont a procédé Michelet, nous allons d’abord rappeler par quels documents authentiques nous est parvenue la fabuleuse et pourtant véridique histoire de la Pucelle. Tandis que s’instruisait son procès à Rouen, les juges de Jeanne, préoccupés de donner à la procédure une forme juridiquement inattaquable, avaient requis trois notaires rouennais, nommés Manchon, Boisguillaume et Taquel, qui, chaque après-midi, rédigeaient le procès-verbal des séances du matin où l’accusée avait été interrogée. Cette minute, écrite en français, fut, quelque temps après le martyre de Jeanne, traduite en latin par un des juges du tribunal de l’Inquisition, Thomas de Courcelles. Revêtue des signatures des trois notaires et scellée au sceau des juges, cette version latine fut copiée à cinq exemplaires dûment paraphés et authentiqués. Une de ces copies devait être donnée au roi d’Angleterre, une autre envoyée à Rome, une troisième remise à l’évêque de Beauvais, Pierre Cauchon. Ce document officiel constitue ce qu’on nomme le Procès de condamnation. Un des cinq exemplaires précités fut lacéré par sentence du tribunal qui fit la revision du procès ; trois autres exemplaires nous sont parvenus. L’un, celui très probablement qui a appartenu à Cauchon, se trouve à la bibliothèque de la Chambre des députés ; les deux autres sont conservés à la Bibliothèque Nationale. Pour le Procès de revision, instruit sut l’ordre de Charles VII, en 1455, nous possédons également trois manuscrits, qui sont à la Bibliothèque Nationale. Les documents des deux procès ont été publiés in extenso pour la première fois par Quicherat, de 1841 à 1849 ; plus récemment, en 1920, M. Pierre Champion à donné une édition définitive du Procès de condamnation, d’après le manuscrit de la Chambre des députés, auquel il à ajouté, en notes, les variantes des deux autres manuscrits originaux.
Lorsque Michelet résolut d’écrire sa Jeanne d’Arc, il semble naturel qu’il ait eu le souci de se reporter aux pièces du procès. Or, quand M. Rudler a voulu savoir à quel manuscrit s’était référé l’historien, et plus encore dans quelle mesure il l’avait pu utiliser, il s’aperçut, avec quelle stupeur, on le devine, que Michelet n’avait lu ni le manuscrit du Palais-Bourbon, ni les deux manuscrits originaux de la Nationale ; et il y a lieu de remarquer qu’il ne les a pas davantage connus par la publication de Quicherat, postérieure à la rédaction de Jeanne d’Arc. M. Rudler à établi ce fait que Michelet, alors chef de division aux Archives Nationales, s’est contenté des manuscrits du procès conservés dans ce dépôt, et qui ne sont que des copies tardives et sans valeur
. Bien mieux, que Michelet, ayant tiré de ces copies un résumé, qui se trouve au Musée Carnavalet, ne s’est servi de ce résumé que pour piquer des citations et des références à sa version achevée de Jeanne d’Arc, et généralement sur les épreuves, c’est-à-dire au dernier moment. Autrement dit, il n’a pas rédigé son manuscrit en ayant une des copies authentiques du procès latin sous les yeux. Il ne s’est servi, pour guides et conducteurs généraux de sa composition personnelle, que de deux ouvrages de seconde main : les Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, publiés en 1790 par L’Averdy ; et l’Histoire de Jeanne d’Arc surnommée la Pucelle d’Orléans, tirée de ses propres déclarations, de cent quarante-quatre dépositions de témoins oculaires, et des manuscrits de la Bibliothèque du Roi et de la Tour de Londres, publiée en 1817 par Le Brun de Charmettes, sous-préfet de Saint-Calais. Il s’est trouvé que ces deux ouvrages étaient fort bien faits, honnêtes, fidèles et sains
, comme dit M. G. Rudler qui a relevé ligne par ligne et presque mot par mot tous les emprunts faits par Michelet à ses deux devanciers. Les citations et les références ajoutées après coup ne sont donc qu’une érudition en trompe-l’œil
. Mais hâtons-nous d’ajouter que si, du point de vue de la critique historique moderne, le procédé est condamnable, notre admiration doit rester entière pour le génial écrivain que fut Michelet, sa faculté de reconstitution visionnaire, son art pathétique, ses dons de styliste et son émotion communicative.
Bibliographie
1° Histoire.
Outre les ouvrages mentionnés dans la Notice précédente, on pourra consulter :
- Henri Wallon, Histoire de Jeanne d’Arc, 1860.
- Marius Sépet, Jeanne d’Arc, 1865.
- Joseph Fabre, Jeanne d’Arc, libératrice de la France, 1883.
- Siméon Luce, Jeanne d’Arc à Domremy, recherches critiques sur les origines de la mission de la Pucelle, 1886.
- Anatole France, Vie de Jeanne d’Arc, 1908.
- Gabriel Hanotaux, Jeanne d’Arc, 1911.
2° Littérature.
De bonne heure, Jeanne d’Arc a été célébrée par la littérature : dès le début de sa mission, par Christine de Pizan ; un peu après, dans un mystère représenté à Orléans en 1435 ; puis par le Bourguignon Martin le Franc ; à la fin du XVe siècle, par Martial d’Auvergne, dans les Vigiles du roi Charles VII (1484), et par Villon, dans la célèbre Ballade des Dames du temps jadis. Du XVIIe siècle, nous avons la Pucelle de Chapelain ; du XVIIIe, celle de Voltaire. Au XIXe siècle, Casimir Delavigne consacre à Jeanne d’Arc deux de ses Messéniennes (1820), et Soumet une de ses Épopées (1845). Plus près de nous, Émile Moreau fait représenter le Procès de Jeanne d’Arc (1909), et Péguy écrit Jeanne d’Arc, drame en trois pièces : Domremy, les Batailles, Rouen (1897), et le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910).
En Angleterre, si Shakespeare, dans son premier Charles VI, invective l’héroïne française, Robert Southey écrit en 1795 un poème à sa gloire, et tout récemment Bernard Shaw a donné, dans sa Sainte Jeanne (1925), une image curieuse de la vie de Jeanne d’Arc.
En Allemagne enfin, Schiller l’a célébrée dans son drame la Pucelle d’Orléans (1801).
Édition Larousse (1941)
Collection : Classiques Larousse de la librairie Hachette, avec quelques illustrations et une notice historique et littéraire de Henri Chabot, professeur au Lycée Charlemagne. Cette notice riche et passionnante inclut une chronologie de la vie de Michelet, un panorama de l’état du monde lors de la parution de Jeanne d’Arc en 1841, ainsi qu’une recension de jugements d’hommes de lettres sur l’œuvre.
Le texte est celui de l’édition séparée de 1853, dans sa version éditée par Rudler en 1925, sans les notes de Michelet mais avec de nouvelles notes explicatives (à l’instar de l’édition Hachette 1935).
Résumé chronologique de la vie de Jules Michelet (1798-1874)
- 21 août 1798. — Naissance à Paris de Jules Michelet, fils d’un imprimeur.
- 1810-1812. — Michelet travaille à l’imprimerie de son père, qui est supprimée en 1812, par un décret impérial. Il entre alors au collège Charlemagne.
- 1815. — Mort de la mère de Michelet.
- 1816. — Michelet reçoit le baptême. Il obtient au Concours général le premier prix de discours français et de version latine, le deuxième prix de discours latin.
- 1817. — Il est reçu bachelier ès lettres.
- 1818. — Son père ouvre une maison de famille rue de la Roquette. Michelet est reçu licencié ès lettres.
- 1819. — Il conquiert le titre de docteur ès lettres.
- 1821. — Il est reçu troisième à l’agrégation des lettres et nommé suppléant au collège Charlemagne.
- 1822. — Michelet professeur d’histoire à Sainte-Barbe.
- 1824. — Il épouse Pauline Rousseau. Naissance de sa fille Adèle. Il fait la connaissance de Victor Cousin.
- 1825. — Début de son amitié avec Edgar Quinet. Il publie son Tableau chronologique de l’Histoire moderne.
- 1826. — Tableaux Synchroniques de l’Histoire moderne.
- 1827. — Michelet professeur d’histoire et de philosophie à l’École normale supérieure. Traduction de la Science nouvelle de Vico.
- 1828. — Édition complète du Précis d’Histoire moderne. Premier voyage en Allemagne.
- 1829. — Michelet professeur d’histoire ancienne et d’archéologie à l’École normale. Naissance de son fils Charles.
- 1830. — Voyage en Italie (mars-avril).
- 1831. — Michelet professeur d’histoire moderne à l’École normale et chef de la section historique aux Archives. Introduction à l’Histoire universelle. Histoire romaine.
- 1833. — Précis de l’Histoire de France. Tomes I et II de l’Histoire de France.
- 1833-1834. — Michelet supplée Guizot à la Sorbonne.
- 1835. — Mémoires de Luther.
- 1837. — Origines du droit français. Tome III de l’Histoire de France.
- 1838. — Michelet est élu à l’Académie des sciences morales et politiques, et nommé à la chaire d’Histoire et Morale au Collège de France.
- 1840. — Tome IV de l’Histoire de France. Pièces du Procès des Templiers.
- 1841-1846. — Tome V de l’Histoire de France. Les Jésuites (1843). Tome VI de l’Histoire de France (1844). Du prêtre, de la femme, de la famille (1845). Le Peuple (1846).
- 1847. — Tomes I et II de l’Histoire de la Révolution française.
- 1848. — Le cours de Michelet est suspendu (2 janvier), puis rétabli (6 mars). Michelet épouse en secondes noces Athénaïs Mialaret.
- 1850. — Naissance d’un fils Yves-Jean-Lazare, qui meurt après quelques semaines.
- 1852. — Michelet, destitué de sa chaire au Collège de France et de ses fonctions aux Archives, va s’installer à Nantes.
- 1853. — Michelet publie les deux derniers volumes de l’Histoire de la Révolution, puis part pour l’Italie, où il reste plus d’un an.
- 1854. — Retour à Paris. Légendes démocratiques du Nord. — Les Femmes de la Révolution.
- 1855. — Tomes VII et VIII de l’Histoire de France. Les volumes suivants paraîtront régulièrement jusqu’au dix-septième (1867).
- 1856-1869. — L’Oiseau (1856). L’Insecte (1857). L’Amour (1858). La Femme (1859). La Mer (1861). La Sorcière (1862). La Bible de l’Humanité (1864). La Montagne (1868). Nos Fils (1860).
- 1871. — À Florence, Michelet écrit la France devant l’Europe. Il est frappé d’une première, puis d’une seconde attaque. Premier volume de l’Histoire du XIXe siècle.
- 1874. — Michelet meurt à Hyères, le 9 février, après avoir écrit le troisième volume de son Histoire du XIXe siècle.
Michelet avait onze ans de moins que Guizot, huit ans de moins que Lamartine, trois ans de moins qu’A. Thierry, deux ans de moins que Mignet, un an de moins que Thiers et Vigny. Il avait un an de plus que Balzac, quatre ans de plus que Victor Hugo, cinq ans de plus que Quinet, six ans de plus que Sainte-Beuve, douze ans de plus que Musset.
Notice
1. Ce qui se passait en 1841
En politique
France :
- Ministère Guizot.
- La France rentre dans le Concert Européen.
- Convention des Détroits.
- Loi sur les fortifications de Paris, sur le travail des enfants dans les manufactures.
- Ouverture du chemin de fer de Strasbourg à Bâle.
- Naissance de Clemenceau, du comte de Mun.
- Mort de Bertin l’aîné, fondateur du Journal des Débats.
Étranger :
- Amérique centrale. — La Confédération des États de l’Amérique centrale est dissoute.
- Angleterre. — Formation d’un nouveau ministère Robert Peel, dont font partie Wellington et Gladstone. Fin des premières hostilités entre l’Angleterre et la Chine ; capitulation de Canton (mai). Seconde campagne (août). Désastres de l’armée anglaise dans L’Afghanistan.
- Espagne. — Insurrection de O’Donnell à Pampelune, de Diego Léon et de Concha à Madrid. Victoires du régent Espartero.
- États-Unis d’Amérique. — Mort du général Harrison, président de la République. Le vice-président, Tyler, lui succède.
- Orient. — Soulèvement des populations chrétiennes opprimées en Bulgarie, en Crète, en Macédoine, en Syrie. Troubles au Liban.
- Russie. — Difficultés de la Russie avec le Saint-Siège.
- Suisse. — Révolution démocratique à Genève.
Dans les lettres
France :
- Balzac publie Une ténébreuse affaire, la Rabouilleuse, Ursule Mirouet ; [Auguste ] Barbier, les Chants civils et religieux ; Brizeux, la Fleur d’or ; Cousin, le premier volume de son Cours d’histoire de la philosophie moderne ; Dumas père commence la publication de Monte-Cristo et donne au théâtre Un mariage sous Louis XV ; Lamartine fait paraître la Marseillaise de la Paix ; Lamennais, le premier volume de son Esquisse d’une philosophie ; de Laprade, Psyché ; Mérimée, l’Essai sur la guerre sociale ; Musset, le Rhin allemand, Souvenir, Sur la paresse ; Quinet, le Génie des religions ; Sandeau, le Docteur Herbeau ; Scribe fait représenter Une chaîne ; Frédéric Soulié publie les Mémoires du diable ; Eugène Sue, Mathilde ; Vigny, De Mademoiselle Sedaine et de la propriété littéraire.
- Élection de Victor Hugo à l’Académie française, où il est reçu le 3 juin.
Étranger :
- Amérique. — Emerson commence la publication de ses Essais.
- Angleterre. — Robert Browning donne Cloches et Grenades ; Carlyle, les Héros.
- Danemark. — Paludan-Müller, publie Adam Homo.
- Espagne. — Zorrilla fait paraître les Chants du troubadour.
- Russie. — Mort du poète Lermontov.
- Suède. — Naissance du poète Snoïlsky.
- Suisse. — Jeremias Gotthelf fait paraître Uli valet.
Dans les arts et les sciences
France :
- Delacroix expose Une noce juive dans le Maroc.
- Naissance de l’historien d’art Courajod.
- Les directeurs des établissements du Creusot prennent un brevet pour la construction du marteau-pilon.
2. La publication
Michelet n’a pas écrit sur Jeanne d’Arc un livre spécial. Quand il a rencontré l’héroïne au cours de son récit, il lui a consacré dans le tome cinquième de son Histoire de France, publié en 1841, deux chapitres du livre X, les chapitres III et IV, qui ont pour titres, le premier la Pucelle d’Orléans, 1429 ; le second le Cardinal de Winchester, Procès et mort de la Pucelle, 1429-1431. C’est en 1853 seulement qu’il détacha de son Histoire ces deux chapitres pour en donner un tirage à part sous le titre Jeanne d’Arc (1412-1431).
Cette édition offre trois nouveautés. D’abord, elle contient une Introduction qui n’est pas dans l’Histoire de France. Ensuite, la distribution du texte en deux chapitres a été remplacée par une division en six parties. Enfin, la conclusion, qui, dans l’Histoire, s’ajoute au récit de la mort de Jeanne, a été supprimée. On la trouvera dans la présente édition, dont le texte est celui du tirage à part de 1853, tel que M. Rudler l’a publié en 1925.
De 1856 à 1890 Jeanne d’Arc a été rééditée sept fois.
3. Les sources
Elles sont de deux sortes : les sources originales et les ouvrages de seconde main.
Les sources originales sont les manuscrits des deux procès : le procès de condamnation et le procès de révision ou de réhabilitation — ce dernier entrepris par ordre de Charles VII, qui, après avoir reconquis la Normandie, fit faire à Rouen une enquête sur le jugement moyennant lequel, par grande haine, les Anglais avaient fait mourir la Pucelle d’Orléans iniquement et contre raison très cruellement
.
Les sources de seconde main sont les Notices des manuscrits du procès de Jeanne d’Arc, de L’Averdy (1790), et l’Histoire de Jeanne d’Arc de Le Brun de Charmettes (1817). Le premier de ces deux ouvrages est un recueil de documents sur le procès ; le second, une longue histoire, suivie et complète, de l’héroïne. Ajoutons-y, pour ne rien omettre, l’Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois de Prosper de Barante (1824), et, si faible que soit la dette de Michelet envers son auteur, le livre de Berriat-Saint-Prix, intitulé Jeanne d’Arc, ou Coup d’œil sur les révolutions de France au temps de Charles VI et de Charles VII, et surtout de la Pucelle d’Orléans (1817).
4. L’héroïne
Il n’y a pas dans l’Histoire de France de personnage que Michelet ait plus aimé ni mieux peint. Une critique sévère [celle de Gustave Rudler en 1925], et manifestement injuste en sa conclusion, lui a reproché, il est vrai, d’avoir manqué aux règles de la méthode historique. Mais il n’est pas douteux que la méthode la plus rigoureuse l’aurait moins heureusement servi que son intuition. Pour faire revivre une grande figure, une figure comme celle de Jeanne d’Arc surtout, ce que Renan appelle la petite certitude des minuties
ne suffit pas. Il faut la faculté divinatrice, un sens aigu de la vie intérieure et, pour parler comme Michelet lui-même, la seconde vue
que donne l’émotion. Si cette imagination du cœur qui fut sa plus grande puissance a parfois égaré l’historien, elle lui a permis d’atteindre, quand il a peint Jeanne d’Arc, un degré de vérité où personne encore ne s’était élevé et qu’on n’a pas dépassé dans la suite. C’est qu’il y avait entre Jeanne et lui une harmonie de nature dont on trouverait difficilement un autre exemple. Sa sensibilité d’une infinie tendresse et presque féminine, son amour du peuple et son humanité, l’ardeur de sa foi patriotique le rendaient merveilleusement propre à comprendre la jeune fille au grand cœur qui s’émut et prit les armes, quand elle sut la pitié qu’il y avait au royaume de France
, l’humble paysanne qui fut la plus pure incarnation de l’âme populaire et la vivante image de la Patrie, ou, pour mieux dire : la Patrie personnifiée. Celle dont on a dit qu’elle était tout piété et patriotisme
(Hanotaux), l’héroïne qui, par excellence, représente le génie de notre race dans ce qu’il a d’essentiel et de permanent, revit dans les pages que Michelet lui a consacrées, avec ce bon sens et cette finesse aussi qu’elle conserva dans son enthousiasme et son exaltation : figure à la fois idéale et vraie, telle qu’elle s’est à jamais fixée dans la mémoire des hommes, et telle qu’on la retrouve dans les ouvrages plus récents, qui ont profité des progrès de la méthode et des travaux de l’érudition.
5. Le récit
La narration de Michelet tient à la fois du drame et de l’épopée.
Pour donner à son œuvre un caractère dramatique, l’historien n’a eu besoin d’aucun artifice : le drame est inscrit dans l’existence de l’héroïne. Il a suffi à Michelet de dégager et d’ordonner les péripéties de l’action glorieuse et douloureuse qui va de la naissance à la mort, du village de Domremy, près des forêts des Vosges, jusqu’au bûcher de Rouen.
C’est d’abord la vocation, la mission révélée par les visions, et la longue hésitation de l’enfant, incertaine du parti qu’elle doit prendre : désobéir à son père ? désobéir à ses voix ? Elle se décide enfin, elle part. Elle s’engage dans l’action ; et traversant mille dangers, affrontant mille épreuves, elle va trouver Charles VII à Chinon, puis délivrer Orléans. Reims et le sacre, c’est l’honneur. Éphémère triomphe où elle eut, semble-t-il, le pressentiment qu’elle avait accompli son œuvre, que sa fin, était proche. Bientôt, en effet, la tribulation va venir, et la trahison. Entourée d’intrigues et de rivalités, mal voulue, mal soutenue
, elle connaît ses premiers revers. Après avoir échoué à Paris et devant La Charité, elle se jette dans Compiègne assiégée : c’est là qu’elle est prise au cours d’une sortie. On la vend à Jean de Ligny ; celui-ci la remet au duc de Bourgogne, qui la livre aux Anglais.
Alors se déroulent les scènes de la passion, avec l’insidieux procès, la sentence inique et l’horrible supplice du feu. Ces étapes, indiquées dans une note de l’Histoire de France, Michelet les parcourt d’un pas rapide, et le rythme de sa narration n’est pas autre chose que le mouvement même de son âme, surexcitée par une émotion qui se communique au lecteur le plus rebelle à l’émotion.
Ce drame pathétique contient aussi l’élément essentiel d’une épopée. Bien que Michelet se soit défendu de faire une légende de l’histoire de Jeanne d’Arc, il n’a pu ni voulu en éliminer le merveilleux. Il le conserve, au contraire, mais il le ramène discrètement à la mesure de l’humanité. On le voit d’abord, lorsqu’il explique comment Jeanne a conçu l’idée de sauver la France en péril de mort. C’est en elle-même qu’elle trouve l’inspiration. C’est dans son cœur que parlent les voix. Ses visions, ce sont ses idées, ses sentiments qu’elle réalise, leur prêtant du trésor de sa vie virginale une splendide et toute puissante existence, à faire pâlir les misérables réalités de ce monde
. Et quand l’historien la suit dans l’exécution de son grand dessein, il sent, comme l’ont senti les hommes du XVe siècle ; le miracle qui s’accomplit ; mais dans cet ascendant surnaturel qui s’impose aux plus sceptiques, enlève les foules et suscite partout l’énergie sur le passage de la jeune fille, il voit, comme un homme d’aujourd’hui, le rayonnement de son âme à la fois ardente et lucide, de son courage sans égal et de sa piété, de sa sainteté. Le miracle expliqué en est-il moins touchant ? Et, pour rester tout humaine, l’histoire en est-elle moins sublime ?
6. Intérêt de l’œuvre
Le nom de Michelet demeure inséparable de celui de Jeanne d’Arc. L’historien dont la plume ailée a retracé la vie héroïque de la vierge lorraine a mis dans ces pages inspirées tout son cœur avec tout son art. Nulle trace ici des passions qui divisent. Il n’y a de place que pour les sentiments les plus tendres et les plus généreux. Tout est pitié, amour, admiration. Ce sont les sentiments qui unissent aujourd’hui toutes les âmes françaises dans le culte de la sainte, sainte selon la Religion, selon la Patrie
(Michelet). En nous donnant sa Jeanne d’Arc, Michelet nous a donné notre Bible nationale. Rien ne lui fait plus d’honneur que de l’avoir écrite.
Jugements sur Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
André Cochut Revue des Deux Mondes (15 janvier 1842)
Est-ce une fiction que nous venons d’analyser ? Ces détails touchants qui font concourir toute une population à l’effet d’un drame sont-ils des combinaisons de romancier ? Non, c’est là de l’histoire dont chaque trait est justifié en note par des témoignages valables. Notre but, en résumant quelques-unes des pages consacrées à Jeanne d’Arc, a été de montrer avec quel bonheur M. Michelet sait découvrir dans le bavardage diffus d’une chronique, dans un acte juridique, dans l’écrit le plus insignifiant en apparence, le mot qui enferme le sentiment sympathique, l’incident qui fait tableau. Il y a dans chaque talent une nuance aimée du public ; si l’on veut apprécier celle qui a fait le succès de M. Michelet, il faut lire en entier ce bel épisode de la Pucelle, qui compose la moitié du cinquième volume.
Sainte-Beuve Causeries du lundi, t. II, Procès de Jeanne d’Arc
(19 août 1850)
Procès de Jeanne d’Arc(19 août 1850)
Après avoir parlé sans bienveillance de l’ouvrage de Michelet, Sainte-Beuve écrit les lignes suivantes :
Quand on a posé toutes ces réserves, on doit, pour être juste, reconnaître que M. Michelet a bien saisi la pensée même du personnage, qu’il a rendu avec vie, avec entrain et verve, le mouvement de l’ensemble, l’ivresse de la population, ce cri public d’enthousiasme qui, plus vrai que toute réflexion et toute doctrine, plus fort que toute puissance régulière, s’éleva alors en l’honneur de la noble enfant, et qui, nonobstant Chapelain ou Voltaire, n’a pas cessé de l’environner depuis. La Jeanne d’Arc de M. Michelet est plus vraie qu’aucune des précédentes.
[Lire un extrait plus long de l’article original paru dans le Constitutionnel du 19 août 1850.]
François Corréard Michelet, sa vie, son œuvre historique (1887)
Jeanne d’Arc n’a jamais trouvé un historien plus ému, plus éloquent, et en même temps plus clairvoyant que Michelet. Le récit de l’enfance de Jeanne a le charme poétique d’une légende, mais d’une légende réelle et véridique.
Émile Faguet Dix-neuvième siècle : études littéraires (1887)
S’il se trouve en présence d’une âme de femme, émue de la
grand-pitié qui est au royaume de France, sensible et héroïque, bonne et pure, et en même temps ayant en elle l’esprit, le tempérament populaire, on peut compter alors que, tout entier touché, il se donnera tout entier, sera un grand historien, un grand artiste, un grand écrivain (Jeanne d’Arc). Remarquez même qu’alors, en un sujet qui prêtait aux effusions mystiques, pour être à la hauteur du héros, il sentira le besoin d’être simple, très lucide, n’insistera point sur les parties d’illuminée qui sont en la bonne Lorraine, démêlera au contraire (admirablement) ce qu’elle a de bon sens français, de netteté, d’esprit avisé et juste, tracera enfin un portrait sobre, vigoureux et grand, le plus beau qui soit parti de sa main.
Félix Hémon Cours de littérature, à l’usage des divers examens, vol. 25 (1889)
L’histoire de Jeanne d’Arc, telle que Michelet veut l’écrire, c’est une histoire plus légendaire qu’historique et qui se transformerait vite en épopée merveilleuse si l’historien ne s’appliquait à en maintenir, à en affermir le fond réel. Le merveilleux, il ne le supprime pas, Dieu merci, mais il ne le révèle pas dans les phénomènes extérieurs ; il le localise pour ainsi dire dans une âme. Il le respecte, et l’explique sans le déflorer… Chez Michelet, histoire et poésie se pénètrent. Le lecteur comprend a à merveille comment l’épopée de Jeanne d’Arc a été possible, et cette épopée n’en reste pas moins pour lui, si l’on peut ainsi parler, très humainement surhumaine.
Jules Simon Mignet, Michelet, Henri Martin (1890)
Tout à coup, quand Michelet a montré la France désolée, ruinée, perdue ; sans argent, sans soldats, sans foi, sans unité, sans honneur ; quand il s’est effrayé lui-même de la tragédie qu’il raconte, ou quand il commence à se dire qu’il va trop loin, que de pareils récits sont trop accablants, que l’âme humaine ne peut les supporter, le génie de la France lui amène Jeanne d’Arc, une héroïne faite pour lui : car elle est à la fois histoire et légende ; elle est le peuple dans sa faiblesse et dans sa force, dans sa foi et dans sa clairvoyance ; elle part des derniers rangs, elle triomphe au nom de Dieu et de la France, et elle disparaît dans un bûcher entre le ciel et la terre, éternel objet d’admiration, de pitié et d’amour. On a pris ce livre, on l’a séparé de la grande histoire, on l’a répandu à profusion dans les écoles, on ne y répandra jamais assez. C’est la rédemption de la France, c’est à cette source qu’il faut s’abreuver d’héroïsme et de patriotisme. Avoir écrit ce livre, avoir été digne de l’écrire, c’est une grande époque dans la vie d’un homme.
Gustave Lanson Histoire de la littérature française (1894)
Michelet assiste, avec une pitié immense, à la naissance du sentiment de la patrie dans l’âme obscure des masses populaires ; pendant l’horrible guerre de Cent ans ; il voit éclore ce sentiment dans la dévotion chrétienne et monarchique, il le voit s’incarner dans la douce voyante qui sauve la France, dans Jeanne d’Arc ; et jamais la pieuse fille n’a été mieux comprise que par ce féroce anticlérical. Les pages qu’il lui consacre, où il analyse les causes de tout ordre qui ont produit et fait réussir la mission de Jeanne d’Arc, peuvent être étudiées comme contenant tout le génie de Michelet.
Camille Jullian Extraits des historiens français du XIXe siècle (1897)
Le récit de Michelet est le morceau le plus vivant, le plus complet, le plus populaire de son Histoire de France.
Anatole France Vie de Jeanne d’Arc (1908), Préface
De 1841 à 1549, jules Quicherat, en publiant les deux procès et les témoignages, ouvrit dignement une époque incomparable de recherches et de découvertes. Au même moment, Michelet écrivit dans le cinquième volume de son Histoire de France des pages rapides et colorées, qui resteront sans doute comme la plus belle expression de l’art romantique appliqué à la Pucelle.
Gabriel Hanotaux Jeanne d’Arc (1911)
La Jeanne d’Arc de Michelet est un des plus beaux chapitres de son Histoire de France. La sincérité de l’émotion, la noblesse de l’inspiration, la promptitude ailée du style donnent à ces pages un charme pénétrant ; on y retrouve comme un écho de la légende populaire. Le grand écrivain touche, dans ce morceau incomparable, au comble de son génie.
Gustave Rudler Michelet historien de Jeanne d’Arc, t. II (1925)
Il faut comparer Michelet à ses sources pour mesurer sa grandeur… L’Averdy, cherchant, mais ne trouvant guère, le vrai des choses, va de discussion en dissertation et s’embarrasse souvent dans sa dialectique. Le Brun, moins juriste et moins logicien, mais narrateur diffus et inégal au poids de ses documents, amortit l’intérêt dans les méandres des citations, les lenteurs de sa pensée et les pompes de son style. Michelet a taillé hardiment dans leur texte, oublié ou intériorisé (sauf deux exceptions) leurs scrupules de droit et de critique, visé surtout à écrire une belle histoire pathétique. Il y a merveilleusement réussi. De cette mort pareille à tant de morts par sa cruauté, il a fait jaillir le sublime, il a dégagé une leçon haute et éternelle, en y montrant jusqu’au dernier soupir de Jeanne, dans l’oubli de soi le plus doux et la plus méritoire des confiances en Dieu, le triomphe de l’Esprit. C’est le sens final de son livre.
Matériel scolaire et pédagogique
Questions
Introduction :
- Quelle sorte d’émotion l’histoire de Jeanne d’Arc fait-elle naître ?
- Comment Michelet explique-t-il l’idée que Jeanne a conçue de sauver la France ?
- Avec quel art résume-t-il dans les lignes qui précèdent la vie de l’héroïne ?
- Comment interprète-t-il son sacrifice ?
- Qu’est-ce qui donne tout son prix à ce sacrifice ?
- Quel est le sentiment qui a inspiré Jeanne d’Arc ?
- L’état de la France à la fin du XIVe siècle et au commencement du XVe.
- Comment la France est-elle devenue une patrie ?
I. Enfance et vocation de Jeanne :
- Ce qui fait l’originalité de Jeanne d’Arc.
- Les visions au moyen âge.
- Le caractère lorrain. Comment Michelet l’explique-t-il ?
- La pieuse enfance de Jeanne. Comment elle apprit sa religion.
- Quelle fut sur son âme l’influence des légendes parmi lesquelles elle est née, des émotions de la guerre au milieu desquelles elle a grandi, des prophéties qui annonçaient que la France serait sauvée par une femme ?
- Ses visions. Quel changement apportent-elles dans sa vie ?
- Comment Michelet dépeint-il le combat que Jeanne eut à soutenir en elle-même et contre les siens ?
- Comment elle quitte Domremy.
- Jeanne à Vaucouleurs. Comment Baudricourt la juge-t-il ? Quels sentiments inspire-t-elle au peuple ?
- Le voyage de Jeanne d’Arc. Ses difficultés ; ses dangers.
- Jeanne à Chinon. Comment se présente-t-elle ? Comment est-elle reçue ?
- On la fait examiner à Poitiers. Comment subit-elle l’examen ? Comment son caractère se révèle-t-il ? Quelle impression produit-elle sur le peuple et sur ses juges eux-mêmes ?
- La situation des Anglais à Orléans au moment où Jeanne y est envoyée.
- Quelle a été l’influence de Jeanne d’Arc ? Quel ascendant a-t-elle pris sur les hommes d’armes ?
II. Jeanne délivre Orléans et fait sacrer le roi à Reims :
- Étudier l’art de Michelet dans le récit du siège d’Orléans.
- Quel fut l’effet produit par la délivrance de la ville ?
- La marche sur Reims. Quelles en sont les principales étapes ?
- Le sacre de Charles VII. Quelles sont les qualités de la narration ? Quelle est l’émotion qui s’en dégage et d’où vient-elle ?
III. Jeanne est trahie et livrée :
- Quel fut l’effet du sacre dans la France du Nord ?
- Quelle était à ce moment la situation des Anglais en France ?
- Comment l’intervention du cardinal de Winchester se produit-elle ?
- Pourquoi Jeanne d’Arc désapprouve-t-elle la marche sur Paris ? A-t-elle raison ? Pourquoi ?
- L’échec devant Paris. Quelles en sont pour Jeanne les conséquences ?
- Jeanne d’Arc est prise devant Compiègne. Quelles réflexions cet événement inspire-t-il à Michelet ?
- La peinture des mœurs du temps. Quel rapport y a-t-il entre le tableau que trace Michelet et le sujet de son récit ?
- Comment dans les pages qui précèdent Michelet représente-t-il les efforts des Anglais pour se faire livrer Jeanne d’Arc ?
- Pourquoi Jeanne n’a-t-elle pas été défendue ?
IV. Le procès. Jeanne refuse de se soumettre à l’Église :
- Jeanne prisonnière. Le duc de Bourgogne la livre aux Anglais. Pourquoi ?
- Comment Michelet expose-t-il les préliminaires du procès ?
- Les premiers interrogatoires. Comment ils sont conduits. Comment le caractère de Jeanne se révèle dans ses réponses.
- Où Michelet pense-t-il que soit dans le procès le vrai débat ?
- Ce qui se passe dans l’intervalle des interrogatoires. Quelles difficultés Cauchon rencontre-t-il ?
- Les combats intérieurs de Jeanne d’Arc.
- Jeanne tombe malade dans la semaine sainte. Elle comparaît devant ses juges. Ses réponses. Comment Michelet peint-il ce qui se passe en elle ?
V. La tentation :
- Qu’est-ce que Michelet appelle la Tentation ? Montrer comment il analyse les sentiments de Jeanne. Dire quelle sorte d’intérêt on trouve ici.
- Quelles tentatives fait-on pour vaincre les dernières résistances de la jeune fille ? Faire voir l’intérêt dramatique de cette partie du récit.
- Comment on obtient de Jeanne une sorte de rétractation. Comment on la trompe.
- Acharnement des Anglais à réclamer la mort de Jeanne d’Arc.
VI. La mort :
- Fin du procès. Comment les événements se précipitent.
- Martin L’Advenu est envoyé à Jeanne d’Arc pour lui annoncer sa mort. Comment la scène est-elle retracée ?
- Jeanne part pour le supplice. Ses pensées.
- La mort de Jeanne d’Arc :
- Le lieu du supplice. Le bûcher : pourquoi est-il si élevé ?
- Les différentes parties de la scène ;
- L’attitude de Jeanne : sa douceur ; la sainteté de sa mort ;
- Effet produit par sa mort sur les assistants.
Conclusion :
- Analyser les réflexions qui, dans l’Histoire de France, servent de conclusion au récit de Michelet. Quelles qualités du génie de l’écrivain retrouve-t-on dans ces pages ?
Sujets de devoirs
Narrations :
Jacques Gérardin, paysan de Domremy, habite la maison qui a été celle de Jeanne d’Arc. Un étranger offre de la lui acheter, Jacques refuse en donnant les motifs de son refus.
— Faire ressortir, en racontant l’histoire de Jeanne d’Arc, la justesse de ces paroles de Michelet :
La sainte fille eut un signe à part : bonté, charité, douceur d’âme. Elle eut la douceur des anciens martyrs, mais avec une différence. Les premiers chrétiens ne restaient doux et purs qu’en fuyant l’action, en s’épargnant la lutte et l’épreuve du monde. Celle-ci fut douce dans la plus âpre lutte, bonne parmi les mauvais, pacifique dans la guerre même ; la guerre, ce triomphe du diable, elle y porta l’esprit de Dieu.
Rêve de Jeanne d’Arc. Jeanne, dans sa prison, s’est endormie pour la dernière fois. Son sommeil est calme comme celui de l’innocence. Elle rêve, non de la guerre, mais de son pays natal. Elle se voit revenant au milieu des siens pour ne plus les quitter jamais. Pendant qu’elle goûte ces douces chimères, les Anglais dressent son bûcher.
Lettre :
Lorsque Michelet visita pour la première fois la ville de Rouen, on raconte qu’il fondit en larmes à la vue des rues et des monuments que Jeanne d’Arc avait eus sous les yeux au moment de sa mort. Vous supposerez que, rentré chez lui après cette promenade émouvante, le grand historien écrit à l’un de ses amis pour lui faire part de ses impressions et lui parler du supplice de l’héroïne que la place du Vieux-Marché vient de lui rappeler si cruellement.
Dissertations :
Quelles ont été vos impressions en lisant dans Michelet le récit de la vie et de la mort de Jeanne d’Arc ? En quoi ce récit vous paraît-il admirable et digne du sujet ?
- Étudier l’art de la narration dans la Jeanne d’Arc de Michelet.
- Le merveilleux dans le livre de Jeanne d’Arc. Comment se concilie-t-il avec l’histoire ?
- Montrer comment Michelet, en incarnant dans une humble fille du peuple l’âme de la France, a donné à cette figure héroïque plus de vérité que ne saurait lui en donner l’histoire la plus précise.
- Brunetière dit de Michelet qu’il y a en lui
la faculté de se mettre tout entier dans ce qu’il dit et dans ce qu’il écrit
. Trouvez-vous Michelet tout entier dans sa Jeanne d’Arc ? - Voyez-vous, en lisant Michelet, quelle est l’origine et quelles sont les raisons du culte de Jeanne d’Arc ?
- Comment Michelet a-t-il pu dire que Jeanne d’Arc avait fondé sur l’échafaud
le droit de la conscience, l’autorité de la voix intérieure
? - En quoi la lecture de la Jeanne d’Arc de Michelet est-elle bienfaisante ?
- En examinant, indépendamment de l’héroïne, les autres figures qui apparaissent dans le récit (Winchester, Philippe le Bon, Cauchon), étudiez l’art du portrait chez Michelet.
Édition Livre-club du libraire (1962)
125e ouvrage de la collection, avec une préface de Régine Pernoud (reproduite ci-dessous).
Le texte est celui de l’édition séparée de 1853 (probablement le texte établi par Rudler puisque certaines erreurs ont été corrigées) avec les notes de Michelet, et agrémenté de huit miniatures (quatre en couleurs, quatre en noir et blanc) extraites des Vigiles du roi Charles VII.
Jeanne d’Arc et Michelet par Régine Pernoud
On a beaucoup écrit sur Jeanne d’Arc : un monceau d’œuvres qui se veulent édifiantes, un petit nombre d’ouvrages d’histoire ; à l’étranger comme en France, théâtre et cinéma l’ont adoptée. Mais, à travers les temps, à travers les œuvres, celle de Michelet a gardé de nos jours tout son pouvoir ; on y retrouve tout ce qui peut satisfaire l’historien et émouvoir le lecteur. Chapitre réellement magistral qui fait l’effet d’une cathédrale dans la ville : s’imposant avec autant de grandeur aujourd’hui qu’en son siècle.
C’est en 1841 qu’il fut publié. Michelet est alors, à quarante-trois ans, en pleine activité, dans tout l’éclat de sa renommée d’historien, exerçant aussi, depuis une dizaine d’années, ses fonctions d’archiviste. Entré aux Archives Nationales en 1830, il préside, en effet, aux inventaires et au classement de la Section Historique ; on le voit préciser la manière dont les notices doivent être rédigées pour donner du document une idée exacte et complète, indiquer les cadres de classement des catalogues, préparer l’inventaire des registres du Trésor des Chartes, qui forment l’un des plus précieux ensembles du Moyen Âge parvenus jusqu’à nous ; il projette un inventaire général des documents composant sa section, établit le programme de travail de l’atelier de reliure et de restauration ouvert en cette même année 1841, prend soin de la conservation des documents les plus fragiles, comme les papyrus mérovingiens, qu’il fait mettre sous verre ; en un mot, accomplit avec conscience une tâche obscure et minutieuse. Mais surtout, il a été, dès ses débuts d’archiviste, saisi de l’intérêt profond que cette tâche peut présenter lorsque, comme on doit s’y attendre, l’archiviste est aussi un historien, capable d’apprécier et de mettre en œuvre l’incomparable réserve de matériaux dont il dispose. Cela, il nous l’a fait sentir en une page inoubliable :
Je ne tardai pas à m’apercevoir, dans le silence apparent de ces galeries, qu’il y avait un mouvement, un murmure qui n’était pas de la mort. Ces papiers, ces parchemins laissés là depuis longtemps, ne demandaient pas mieux que de revenir au jour. Ces papiers ne sont pas des papiers, mais des vies d’hommes, de provinces, de peuples. Tous vivaient et parlaient… et à mesure que je soufflais sur leur poussière, je les voyais se soulever.
— (Histoire de France, t. II, 1833, Éclaircissements, p. 701-702.)
Ainsi, pour lui, cette fréquentation quotidienne, ce contact direct avec le texte, le document d’origine, tout ce travail, aride souvent dans le détail, aura été incomparablement fécond. Michelet n’avait pas bénéficié de la formation de l’École des Chartes créée vingt ans plus tôt, qui dispense aux médiévistes l’initiation nécessaire ; c’est son séjour aux Archives qui lui en a tenu lieu. Quant à son œuvre historique, elle est déjà importante au moment où il va publier, dans le tome V de son Histoire de France, les chapitres consacrés à Jeanne d’Arc. Le premier tome de cette Histoire, paru en 1833, avait été lui-même précédé d’un Tableau Chronologique, purs d’un Précis de l’Histoire moderne et d’une Histoire romaine, dans lesquels Michelet, alors professeur au collège Sainte-Barbe, puis à l’École Normale, avait fait ses débuts d’historien ; surtout, son Introduction à l’Histoire Universelle a consacré sa renommée dans cette voie de l’Histoire qui sera pour lui une voie triomphale. C’est donc en pleine possession de ses moyens qu’il compose les chapitres consacrés à Jeanne d’ Arc, souvent réédités à part et qui le méritaient, car ils forment par eux-mêmes un tout dans lequel s’est puissamment affirmée la conception même de l’Histoire selon Michelet : une résurrection.
Or, 1841 est aussi l’année où parait le premier volume d’une publication destinée à compter dans l’Histoire de France : celle du Procès de condamnation de Jeanne d’Arc. Car le document capital sur la plus grande héroïne de notre passé n’était encore connu que de ceux qui avaient eu assez de curiosité et de connaissances paléographiques pour le lire sur manuscrit (J’en puis parler plus hardiment
, déclarait, au XVIe siècle, Étienne Pasquier, faisant remarquer qu’à la différence de plusieurs autres biographes de Jeanne, il avait, lui, consulté les pièces du procès). La seule publication avait été, en 1790, celle d’un érudit, Clément L’Averdy, qui avait édité une Notice du procès criminel de condamnation de Jeanne d’Arc tirée des différents manuscrits de la bibliothèque du roi. Jules Quicherat, frais émoulu de l’École des Chartes, cherchait sa voie quand Michelet lui indiqua un travail digne de l’érudit alors simple étudiant, destiné à réaliser, dans ce domaine de l’érudition, une œuvre magistrale et à être, plus tard, directeur de l’École qui l’avait formé. Et c’est ainsi que, sous l’égide de la Société de l’Histoire de France, alors jeune (elle avait été fondée en 1834), allaient paraître les cinq volumes qui sont le plus admirable monument élevé à la mémoire de Jeanne et la base de tout ce que nous pouvons, sur elle, connaître d’exact : un volume du Procès de condamnation, deux du Procès de réhabilitation, deux de chroniques et écrits divers du XVe siècle la concernant. Le véritable historien de Jeanne d’Arc, c’est Quicherat
, dira plus tard Michelet.
Assez curieusement, l’année 1961 aura vu un hommage simultané à Michelet et à Quicherat lui-même, puisque c’est celle qui voit paraître la réédition des Procès entreprise par la même Société de l’Histoire de France, et aussi celle qui voit rendre le premier hommage public à Michelet archiviste, avec une exposition consacrée à sa vie et à son œuvre et organisée aux Archives Nationales par leur directeur André Chamson.
Aucun sarcasme n’aura été épargné aux Romantiques. On a vu en eux de simples excentriques cherchant à tout prix l’originalité, des révoltés, des rêveurs, et pour tout dire, des poètes, terme qui, dans la France bourgeoise du XIXe siècle, équivalait à une injure. Il a fallu que Gustave Lanson s’appliquât laborieusement à démontrer que les Romantiques n’étaient pas si romantiques que cela, qu’ils étaient aussi des classiques à leur manière, pour qu’ils fussent admis à la Sorbonne et au lycée. Or, jamais dans les lettres, souffle plus puissant ne balaya les vieilles routines, jamais l’esprit d’invention et de renouveau ne fut plus ardent qu’en cette génération qui s’affirme impétueusement pendant la première moitié du XIXe siècle. Pour bien mesurer tout ce qu’on leur doit, il faut jeter un coup d’œil en arrière, rappeler quel désert aride et sans espoir représente, dans le domaine poétique, le XVIIIe siècle, de quel froid intellectualisme procède alors tout le domaine artistique ; et ce ne sont certes pas l’idéologie révolutionnaire et le Serment des trois Horaces qui pouvaient contribuer à rendre vie aux arts. Le souffle nouveau qu’on pouvait pressentir avec les premières œuvres d’un Chateaubriand et qui, une fois écroulé l’Empire autoritaire et oppresseur, se manifeste avec tant de violence chez un Lamartine, un Victor Hugo, un Delacroix, un Michelet, quelle reconnaissance ne lui devons-nous pas ! que de découvertes ou, si l’on préfère, de redécouvertes dans leurs œuvres ! Retrouver la passion, la couleur, le sens de l’enfance, le lyrisme, la poésie enfin, qui est création comme son nom l’indique : quelles voies fécondes frayées désormais à tous, artistes et poètes, mais aussi philosophes, historiens et chercheurs. Et l’on comprend, en revanche, l’inquiétude, l’agacement, le mépris indigné du bourgeois qui siffle Hernani et fera un succès à la Lucrèce de Ponsard : tout son monde de valeurs dûment étiquetées, reconnues, jaugées à la mesure sacro-sainte de l’Antiquité romane, de l’école classique et de la règle des trois unités, s’écroulait sous ce souffle de jeunesse.
Aux Romantiques, entre autres redécouvertes, on doit celle de notre Moyen Âge. Après une période où l’on avait tant détruit — et c’est beaucoup moins aux fureurs révolutionnaires
que nous pensons ici qu’à ces destructions beaucoup plus sauvages, beaucoup plus systématiques et totales, celles des XVIIe et XVIIIe siècles pendant lesquels on démolissait méthodiquement les édifices gothiques
pour leur substituer des œuvres de grand goût
, c’est-à-dire conçues dans le style dorique, ionique ou corinthien, ou encore à celles opérées par les marchands de biens qui, sous l’Empire, faisaient sauter, par exemple, la grande abbatiale de Cluny pour en vendre les pierres — après ces destructions, combien l’on apprécie, par contraste, les patients efforts d’un Viollet-le-Duc ou d’un Alexandre Lenoir pour rassembler et sauver ce qui pouvait être sauvé, et éclairer leurs contemporains sur la valeur et l’intérêt de ce qui survivait de notre passé !
L’œuvre de Michelet touchant Jeanne d’Arc se situe dans la ligne de ces efforts. Que connaît-on de Jeanne à son époque ? Quelques biographies dues à des curieux, plus amateurs que savants véritables, l’œuvre bouffonne de Chapelain, celle, non moins ridicule, de Voltaire. Jeanne disparaît littéralement sous le chapeau empanaché dont on la trouve affublée sur les estampes datant du Grand Siècle. Michelet va lui rendre un visage, un corps et une âme. Au fond, son œuvre ressemble étonnamment à celle qui nous a restitué Notre-Dame de Paris. La cathédrale dont, au XVIIIe siècle, on projetait de détruire la façade pour la reconstruire dans le goût de celle du Panthéon, si elle se dresse aujourd’hui au cœur de la Cité, c’est parce que Viollet-le-Duc en a ramassé les pierres éparses, qu’il a su reconnaître leur beauté, et qu’il en a imposé la restauration à ses contemporains. Sans doute lui manquait-il, pour bien comprendre l’édifice, cette connaissance plus approfondie qu’un siècle de recherches et d’expériences ont value à notre temps. Mais comme il serait mesquin de reprocher des restaurations excessives à celui qui fut l’auteur d’une si émouvante résurrection ; qu’il ait ajouté des chimères et créé une galerie des rois qui n’existait pas dans l’ancienne église, la faute, si faute il y a, est fort bénigne à côté de l’œuvre réalisée. De même pour la Jeanne d’Arc de Michelet. On butte de temps à autre, dans son texte, sur une idée fausse, une notation inexacte. L’obsession de la chimère diabolique qui caractérise le Moyen Âge
tel qu’on l’imagine au XIXe siècle n’est pas absente ; à preuve cette méprise — que beaucoup d’autres historiens ont, du reste, partagée avec lui — sur le véritable sens de la virginité ; il attribue l’importance qu’on donne, en ce qui concerne Jeanne, à l’examen de virginité auquel elle fut deux fois soumise, à cette croyance d’un commerce que le diable aurait avec les sorcières : ignorant qu’au Moyen Âge, comme en tous les temps de civilisation chrétienne depuis l’Évangile, la virginité est la marque de l’être consacré, voué à Dieu sans partage, et anticipant sur cette vie future où ils seront comme des anges dans le ciel
.
Qu’il y ait comme cela bien des erreurs de détails, provenant pour la plupart d’un manque de connaissances générales de l’époque, rien d’étonnant : on commençait seulement (l’École des Chartes, rappelons-le, a été fondée en 1820) à se préoccuper de l’histoire de notre passé ; jusqu’alors seule celle des Grecs et des Romains avait paru mériter l’intérêt des savants ; c’est à peine si quelques bénédictins s’étaient penchés, pendant les trois siècles précédents, sur certains aspects de ce passé ténébreux
. Et l’on doit plutôt, semble-t-il, s’étonner de l’intuition fulgurante qui aura permis à Michelet d’atteindre d’emblée, non pas l’exactitude des détails qui, après tout, est chose secondaire, mais la vérité de l’ensemble. Car la personne de Jeanne a été, par lui, merveilleusement sentie :
Elle fut douce dans la plus âpre lutte, bonne parmi les mauvais, pacifique à la guerre même ; la guerre, ce triomphe du diable, elle y porta l’esprit de Dieu.
— (Histoire de France, t. V, 1841, derniers paragraphes de Jeanne d’Arc, supprimés dans l’édition séparée de 1853.)
Non moins admirablement a-t-il dégagé son rôle, son action sur les événements :
La Vierge secourable des batailles que les chevaliers appelaient, attendaient d’en haut, elle fut ici-bas. En qui ? c’est la merveille. Dans ce qu’on méprisait, dans ce qui semblait le plus humble, dans une enfant, dans la simple fille des campagnes, du pauvre peuple de France. Car il y eut un peuple, il y eut une France. Cette dernière figure du passé fut aussi la première du temps qui commençait. En elle apparurent à la fois la Vierge… et déjà la patrie. Telle est la poésie de ce grand fait, telle en est la philosophie, la haute vérité. Mais la réalité historique n’en est pas moins certaine ; elle ne fut que trop positive et trop cruellement constatée…
— (Ibid.)
Et cette réalité historique du personnage de Jeanne est demeurée pour Michelet comme un phare éclairant sa route. Il s’en explique :
Quelle qu’ait été l’émotion de l’historien en écrivant cet évangile, dit-il de lui-même à propos de son chapitre sur Jeanne, il s’est attaché au réel sans jamais céder à la tentation de l’idéaliser !
— (Ibid., note.)
Et c’est bien, en effet, ce qu’il y a de plus frappant dans ces pages frémissantes, c’est que pas un instant le souci et le respect de la vérité de l’histoire n’ont été oubliés. Sur d’autres sujets, Michelet se laissera quelque peu envahir et égarer par des préjugés personnels : en ce qui concerne Jeanne, le reproche ne peut lui être fait. Les pages magnifiques dans lesquelles il l’évoque ne sont pas seulement de la haute Littérature (nous prenons le terme en son sens le plus noble), mais bien de l’Histoire.
N’est-ce pas ici l’occasion d’admirer, une fois de plus, ce qu’il y a d’unique, d’extraordinaire, d’incomparable dans la mission de Jeanne après sa mort comme pendant sa vie ? Celle qui fut la fille la plus sainte après la Sainte Vierge
, il aura fallu que sa grandeur soit découverte en même temps par l’historien Michelet et par l’érudit Quicherat, l’un et l’autre anticléricaux ; et c’est encore un anticlérical qui dressera pour elle le plus beau monument poétique puisque, on le sait, Charles Péguy n’était pas encore converti lorsqu’il écrivit le Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc. On pourrait s’en étonner si, emporté par des préjugés d’un autre temps, on hésitait à reconnaître en ces trois écrivains la qualité d’âme exceptionnelle qui les rendit sensibles à la grandeur partout ou elle se trouvait. C’était là l’essentiel en ce qui concerne Jeanne : ne se sont mépris sur le personnage que les âmes par elles-mêmes incapables de sentir la grandeur : ainsi en son temps les juges de Rouen et un Charles VII lui-même ; au nôtre, tant d’écrivains-amateurs, de journalistes, de dramaturges qu’il serait cruel d’énumérer. Et c’est un titre de gloire pour le peuple, le petit peuple de France, de ne s’y être, lui, jamais trompé et d’avoir, d’emblée, canonisé Jeanne dès son entrée à Orléans.
Peut-être est-ce à ces redécouvertes qui transcendent tous les sectarismes que l’on doit de pouvoir, aujourd’hui, saluer en Jeanne d’ Arc le seul personnage sur lequel s’opère toute réconciliation — celle des protestants et des catholiques, de l’Église et de l’État — et, selon l’expression d’André Malraux, la seule figure de notre Histoire sur laquelle se soit faite l’unanimité du respect
.
Régine Pernoud.