Livre II : La Vierge Guerrière
47Livre II La Vierge Guerrière
37Chapitre premier Jeanne se prépare à entrer en campagne
§1. La maison militaire
De Chinon, où elle ne fit que passer, Jeanne fut dirigée sur Tours. Afin de la faire conduire honnêtement à Orléans, selon le vœu exprimé par les docteurs de Poitiers, le roi lui fit donner une maison militaire.
Il lui fut baillé, — dit la chronique, — pour la conduire et être à sa suite, un bien vaillant et notable écuyer, Jean d’Aulon, prudent et sage ; et, pour page, lui fut assigné un bien gentil homme, Louis de Coutes, avec d’autres valets et serviteurs.
Au reste, le nombre de ses familiers fut bientôt doublé par l’arrivée de deux de ses frères, Jean et Pierre, et de ses guides de Vaucouleurs.
Une fois leur mission accomplie, Jean de Metz et Bertrand de Poulengy s’étaient rendus au pèlerinage de Notre-Dame du Puy. Là, ils avaient rencontré Isabelle Romée, à laquelle ils purent donner des nouvelles favorables de sa fille. Un religieux augustin, Jean Pasquerel, les accompagna au retour. Ils le présentèrent 48à la Pucelle, en disant : Jeanne, nous vous avons amené ce bon père ; quand vous le connaîtrez, vous lui serez bien affectionnée.
Elle répondit gracieusement qu’elle avait déjà entendu parler de lui, que sa venue lui faisait grand plaisir et qu’il serait son confesseur. À partir de ce moment, jusqu’au jour où elle fut prise, Pasquerel ne la quitta plus ; il l’entendait en confession et lui chantait la messe.
§2. L’épée de Fierbois
Jean de Metz, promu trésorier de la Pucelle, lui fit faire une armure complète, telle qu’en portaient les chevaliers, sauf qu’elle était à blanc, c’est-à-dire sans armoiries. Elle-même prit soin d’indiquer l’épée qu’elle voulait porter. Voici comment elle a raconté la chose :
— Pendant que j’étais à Tours, j’envoyai chercher une épée, qui était dans l’église de Sainte-Catherine-de-Fierbois. Je sus par mes Voix qu’elle était là. C’est un armurier de Tours qui l’alla chercher ; je n’avais jamais vu cet homme. J’écrivis aux prêtres de cette église de vouloir bien m’en faire cadeau. Elle était derrière l’autel, sous terre, pas beaucoup, à ce qu’il me semble. On l’y trouva couverte de rouille ; elle portait cinq croix. Aussitôt qu’on l’eut trouvée, les prêtres la frottèrent et la rouille tomba sans effort. Les clercs de l’endroit me donnèrent un fourreau ; les gens de Tours m’en firent aussi faire un ; l’un était de velours vermeil, l’autre de drap d’or. J’en fis faire un autre de cuir très fort. Lorsque je fus prise, je n’avais plus cette épée. Je n’ai cessé de la porter jusqu’à mon départ de Saint-Denis, après l’assaut de Paris. J’aimais beaucoup cette épée parce qu’elle avait été trouvée dans l’église de Sainte-Catherine, que j’aime beaucoup.
La découverte de l’épée de Fierbois contribua à accroître le renom de la Pucelle ; le peuple y vit un signe manifeste de l’intervention de Dieu, qui accréditait ainsi son envoyée, et la confiance s’en augmenta d’autant. Dans les combats, Jeanne laissait le plus souvent son épée au fourreau, pour éviter de répandre le sang ; elle préférait avoir en main son étendard.
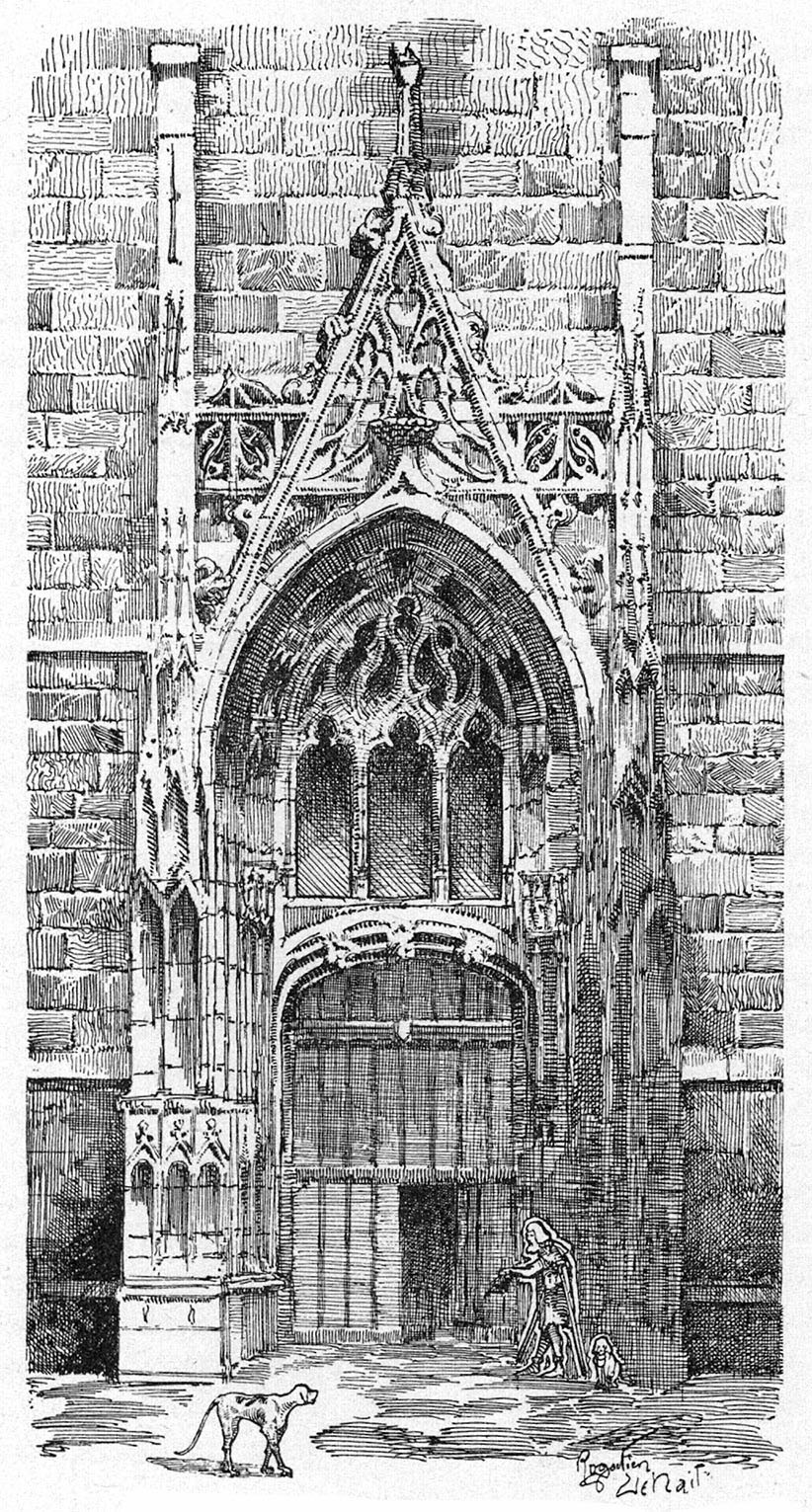
§3. L’étendard
Cet étendard portait l’image de Notre-Seigneur, peinte sur une étoffe blanche. Le Sauveur du monde y était représenté 49dans l’attitude d’un juge, les pieds posés sur une nuée, tenant, dans sa main gauche, le globe terrestre, et bénissant, de sa main droite, des lis que lui présentaient deux anges, saint Michel et saint Gabriel, agenouillés, l’un à droite, l’autre à gauche. On y lisait, inscrits en gros caractères, les deux noms les plus chers à la piété chrétienne, Jhesus Maria.
— J’avais, — dit-elle, — un étendard, dont le champ était semé de fleurs de lis ; il était de couleur blanche, en toile de boucassin, avec des franges de soie. On y lisait les deux noms, Jhésus, Maria, inscrits sur le côté. Notre-Seigneur y était représenté tenant le monde. J’y fis peindre deux anges, tels qu’ils se voient ès églises ; ils étaient là seulement pour l’honneur de Notre-Seigneur. Tout l’étendard était commandé de par Notre-Seigneur, par les Voix de sainte Catherine et de sainte Marguerite, qui me dirent :
Prends l’étendard de par le roi du Ciel et porte-le hardiment ; Dieu t’aidera.J’aimais quarante fois Plus mon étendard que mon épée. Dans les combats, je portais cet étendard, pour éviter de tuer quelqu’un. Je n’ai jamais tué personne.
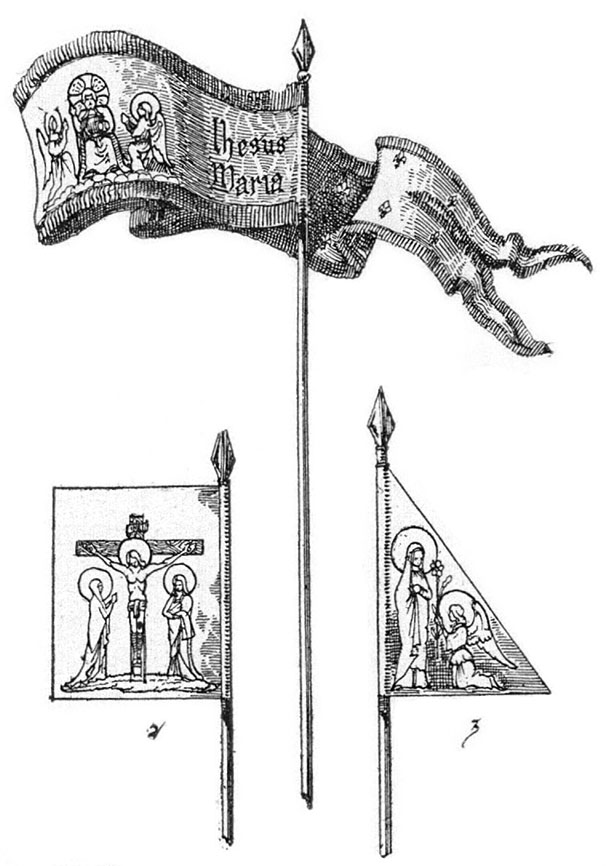
§4. Jeanne à Blois
Cependant les Orléanais, assiégés depuis sept mois, commençaient à perdre courage. Toutes leurs tentatives pour déloger les Anglais avaient misérablement échoué et la famine allait bientôt les forcer à se rendre. Ce leur fut donc un grand réconfort d’apprendre que le roi se disposait enfin à leur envoyer la Pucelle, avec une armée de secours.
Cette armée se formait, en effet, à Blois, sous la direction de l’amiral de Culant et d’Ambroise de Loré, auxquels vinrent bientôt se joindre le chancelier, Regnault de Chartres, le sire de Gaucourt, gouverneur d’Orléans, le maréchal de Boussac, le sire de Retz, le brave La Hire. On organisait en même temps un grand convoi de vivres, destiné à ravitailler la place. Pour payer ces dépenses, la belle-mère du roi avait engagé son argenterie et ses bijoux.
Les préparatifs étaient en bon train, lorsque Jeanne arriva à Blois (21 avril). Les hommes d’armes, ramas de mercenaires pillards et licencieux, lui témoignèrent d’abord une hostilité 50dédaigneuse. Que venait faire parmi eux cette jouvencelle ? Quel rôle prétendait-elle jouer ? Ils ne l’ignorèrent pas longtemps ; elle-même se hâta de les en instruire. Elle leur déclara qu’ils devaient reprendre courage, qu’elle était envoyée de Dieu au secours de la France, qu’avec eux elle délivrerait Orléans et conduirait le roi à Reims ; mais elle avait soin d’ajouter qu’ils devaient eux-mêmes se montrer dignes de la faveur céleste et, pour cela, renoncer à leurs mauvaises habitudes, se convertir sincèrement et se mettre en état de grâce par une bonne confession.
Il n’y avait guère d’incrédules, à cette époque, et les hommes auxquels la Pucelle adressait ces exhortations avaient conservé intacte la foi de leur baptême, au milieu des désordres d’une vie dévergondée. Sa parole réveilla la conscience endormie de ces natures, plutôt grossières que foncièrement perverses. Non seulement ils crurent à sa mission — ce qui ne contribua pas peu à exalter leur courage, par la pensée que Dieu combattait avec eux, dans la personne de son envoyée, — mais un grand nombre se convertirent sincèrement, au grand profit de la discipline. Pour les maintenir dans leurs bonnes dispositions, elle les réunissait deux fois par jour, avec les prêtres qui leur servaient d’aumôniers ; les rangeait devant une bannière, sur laquelle Notre-Seigneur était représenté en croix, et chantait avec eux des hymnes et de pieux cantiques en l’honneur de la Sainte Vierge. Mais elle n’accordait la faveur de prendre part à ces exercices qu’à ceux qui s’étaient confessés.
§5. Sommation aux Anglais
Pendant que la Pucelle était à Poitiers, elle avait dicté à un clerc les termes de la sommation qu’elle se proposait d’adresser aux Anglais7. À la veille d’entrer en campagne, elle jugea que 51le moment était venu de la leur envoyer et dépêcha à Orléans deux hérauts d’armes, chargés de la remettre aux chefs de l’armée assiégeante.
C’était un ultimatum en règle, formulé en termes rustiques, mais d’une précision et d’une énergie qui contrastent singulièrement avec l’âge, le sexe et la condition sociale de son auteur. Il est adressé au roi d’Angleterre d’abord, puis aux troupes d’invasion et à leurs chefs, enfin au duc de Bedford, soi-disant régent de France pour le roi d’Angleterre. Elle s’y présente comme une alliée qui vient au secours du roi Charles, vrai héritier du royaume. Mais elle a soin de déclarer que ce n’est pas de lui qu’elle tient son mandat : elle vient de par le roi du Ciel, le fils de Sainte Marie, avec mission de bouter hors de France les Anglais ; et le roi du Ciel lui enverra plus de forces qu’ils ne sauront en mener contre elle et ses bonnes gens d’armes.
52Elle est toute prête à faire la paix, s’ils veulent rendre les clefs des bonnes villes qu’ils ont forcées, payer une juste indemnité et s’en aller dans leur pays. S’ils ne veulent obéir, elle les y forcera ; car le roi du Ciel le veut. Au contraire, s’ils veulent lui faire raison, ils pourront venir en sa compagnie, là où les Français feront le plus beau fait, qui jamais fut fait pour la chrétienté.
Quelle merveilleuse assurance chez cette jeune fille de dix-sept ans ! Avait-elle donc quelque espoir que sa déclaration allait faire reculer les Anglais ? Non, sans doute ; mais, en la faisant, elle se conformait aux lois de la guerre : un nouveau belligérant, Dieu lui-même, allait se mettre en campagne contre eux ; et elle, sa mandataire, est chargée de les en avertir, afin qu’ils ne s’exposent pas aux châtiments qui les attendent, s’ils refusent de se soumettre à la volonté divine.
Aussi, lorsqu’on l’accusera, à Rouen, d’avoir dicté cette lettre par esprit de témérité et d’orgueil, elle répondra simplement :
— 55Non, je ne l’ai pas fait par orgueil ou présomption, mais par le commandement de Notre-Seigneur. Si les Anglais avaient ajouté foi à cette lettre, ils n’auraient fait que sage. Avant qu’il soit sept ans, ils s’apercevront bien de ce que je leur écrivais.
§6. Départ de Blois et arrivée devant Orléans
Le 27 avril, eut lieu le départ du convoi, destiné à ravitailler Orléans. Pour gagner cette ville, on avait le choix entre deux routes : l’une par la Beauce, sur la rive droite de la Loire ; l’autre par la Sologne, sur la rive gauche. La Pucelle avait demandé qu’on prît la première ; mais les grands chefs ne tinrent pas compte de son désir et se décidèrent pour la seconde, sans même l’en informer. Jeanne, à cheval et revêtue de son armure, attirait tous les regards.
Elle portait son harnois, — dit un chroniqueur, — aussi gentiment que si elle n’eût fait que cela tout le temps de sa vie.
Pour affirmer d’une manière sensible le caractère religieux qu’elle voulait imprimer à l’expédition, elle plaça sa bannière en tête de la colonne, devant son bataillon d’aumôniers auxquels elle fit entonner le Veni creator, lorsqu’on se mit en marche ; on aurait dit un départ de croisés.
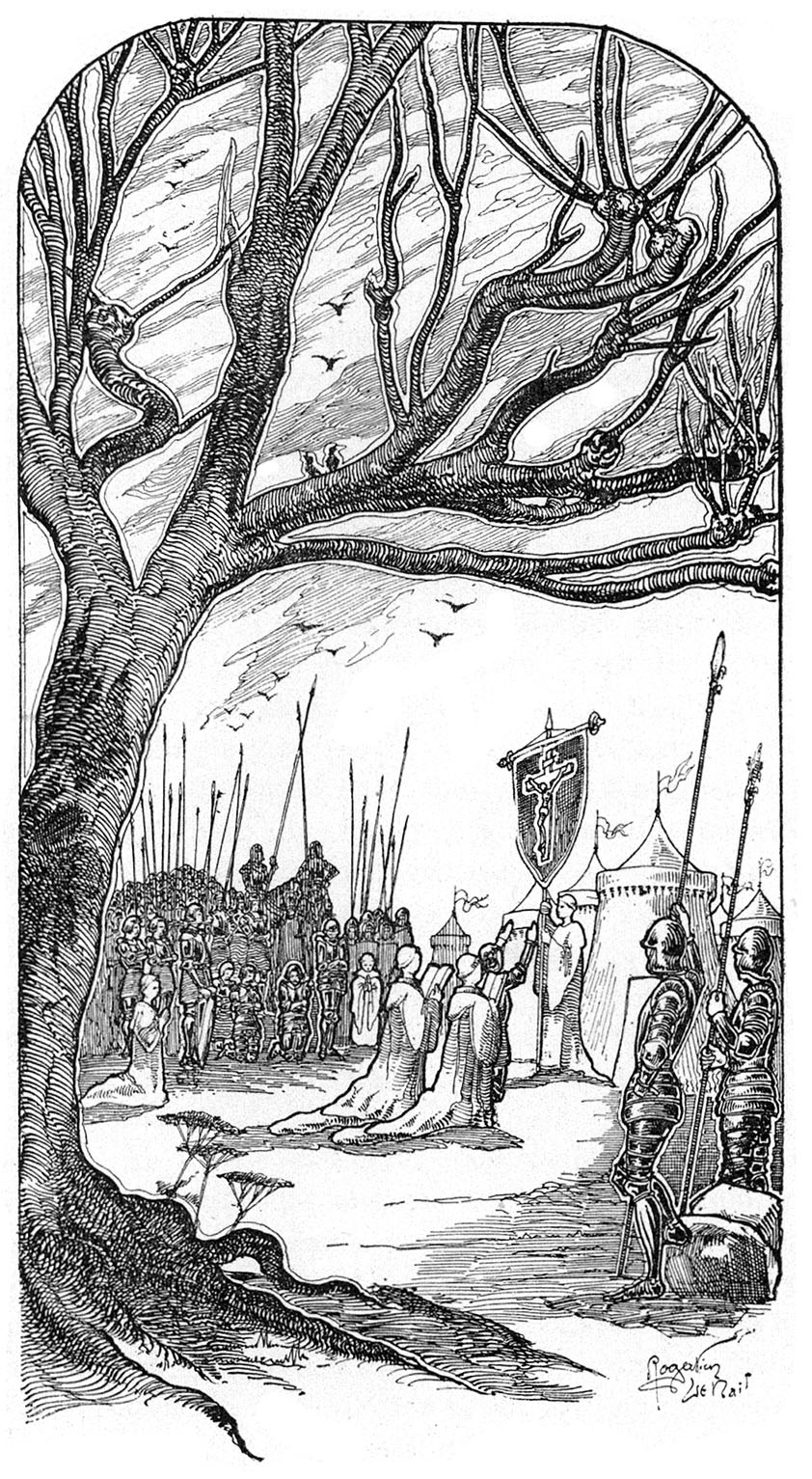
Arrivée devant Orléans après deux jours de marche, l’armée se rangea en bataille, juste en face de la bastille Saint-Loup, où se trouvait un nombreux corps d’Anglais. Il s’agissait maintenant de faire entrer le convoi dans la ville ; la chose paraissait difficile et périlleuse ; en premier lieu, les capitaines ne se croyaient pas en état de tenir tête à l’ennemi, avec les forces dont ils disposaient ; puis, il fallait traverser la Loire, en remontant assez loin pour être à l’abri des assiégeants, et on n’avait pas de bateaux en nombre suffisant ; enfin, pour comble de malheur, le vent était contraire. Or, toutes ces difficultés auraient été évitées, si l’on avait pris la route de la Beauce, comme le voulait la Pucelle. Aussi laissa-t-elle éclater son mécontentement, lorsque Dunois, qui s’appelait alors le bâtard d’Orléans, vint à sa rencontre :
— Est-ce vous, lui dit-elle, qui êtes le bâtard d’Orléans ?
— Oui, répondit-il, et je me réjouis de votre venue.
— 56Est-ce vous, qui avez donné le conseil de me conduire par cette rive, au lieu de me faire aller droit là où sont Talbot et ses Anglais ?
— Nous avons donné ce conseil, moi et d’autres plus sages que moi, pensant que c’était le meilleur et le plus sûr.
— En nom Dieu, le conseil de Notre-Seigneur est plus sûr et plus sage que le vôtre. Vous avez cru me tromper et vous vous êtes trompés vous-mêmes. Car je vous apporte le meilleur secours qui jamais vint à chevalier ou à cité quelconque, puisque c’est le secours du roi du Ciel. Dieu ne vous le donne pas par amour pour moi ; mais, à la requête de saint Louis et de saint Charlemagne, il a eu pitié de la ville d’Orléans et n’a pas voulu que les ennemis, avec le corps du duc d’Orléans, possédassent aussi sa ville.
Aussitôt, — déclare Dunois, — et comme instantanément, le vent qui était contraire et présentait un très grand obstacle à la montée des bateaux, changea de direction et devint favorable. Les voiles furent tendues et les bateaux passèrent au delà de Saint-Loup, malgré les Anglais. Dès lors, je conçus bon espoir de Jeanne, plus que je n’en avais eu jusque-là.
Une fois les vivres introduits, l’armée avait ordre de retourner à Blois, pour en ramener un autre convoi. Jeanne se disposait à la suivre, lorsque Dunois vint la prier de passer la Loire et d’aller à Orléans, où elle était vivement désirée. Elle s’y refusa d’abord énergiquement : à aucun prix, elle ne voulait se séparer de ses compagnons d’armes ; ils étaient bien confessés, animés des meilleurs sentiments ; elle craignait que, abandonnés à eux-mêmes, ils retombassent dans le péché. Elle finit pourtant par céder à de nouvelles instances, qui lui furent faites par les chefs de l’armée ; mais elle exigea que son chapelain et les autres prêtres accompagnassent les hommes d’armes ; puis, elle insista pour que le retour se fit cette fois par la Beauce, assurant que les Anglais n’y mettraient pas obstacle.
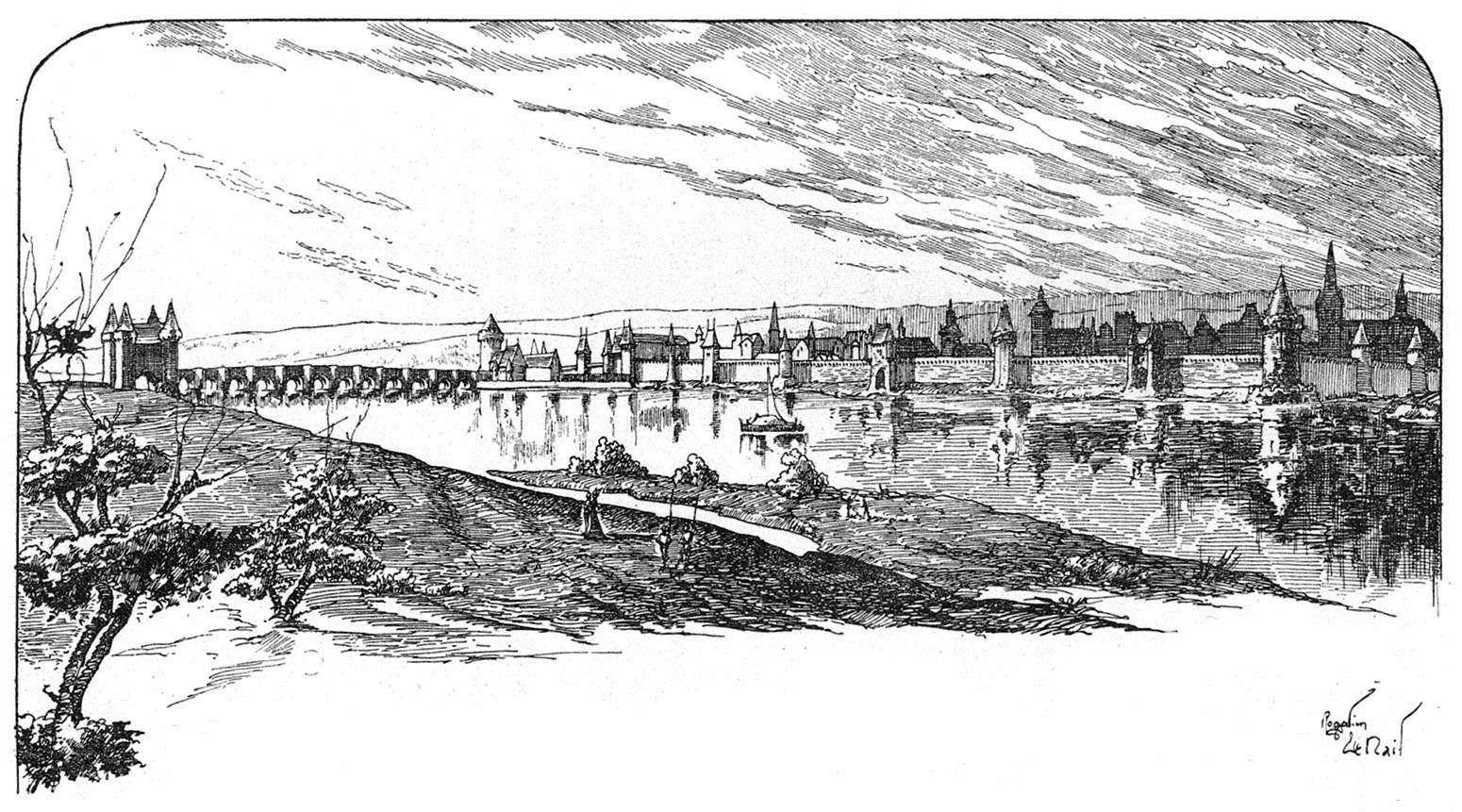
§7. Entrée de Jeanne à Orléans
De Chécy, où elle débarqua, la Pucelle gagna le château de Reuilly. Elle y resta jusqu’au soir, parce que le gouverneur avait 57arrêté que,
pour éviter le tumulte du peuple, elle n’entrerait à Orléans qu’à la nuit. Sur les huit heures, la Pucelle entra à Orléans, armée de toutes pièces, montée sur un cheval blanc. Elle faisait porter devant elle, son étendard. Elle avait, à sa gauche, le bâtard d’Orléans, armé et monté richement. Après venaient plusieurs autres nobles et vaillants seigneurs, sans compter quelques-uns de la garnison et aussi des bourgeois d’Orléans, qui lui étaient allés au devant.
D’autre part, vinrent la recevoir les autres gens de guerre, bourgeois et bourgeoises, portant grand nombre de torches et faisant autres signes de joie, comme s’ils avaient vu Dieu descendre parmi eux. Ils se sentaient déjà tout réconfortés et comme désassiégés par la vertu divine qu’on leur avait dit être en cette simple Pucelle, qu’ils regardaient moult affectueusement, tant hommes et femmes que petits enfants. Et il y avait très merveilleuse presse à toucher au cheval sur lequel elle était, tellement que l’un de ceux qui portaient des torches s’approcha tant de son étendard que le feu y prît. Mais elle frappa son cheval des éperons et le tourna jusqu’à l’étendard dont elle éteignit le feu aussi gentiment que si elle eût longtemps suivi les guerres. Ce que les gens d’armes tinrent à grande merveille et les bourgeois d’Orléans aussi.
Ils l’accompagnèrent au long de leur ville, montrant très grande allégresse et tous la conduisirent avec très grand honneur, jusque auprès de la porte Renard, en l’hôtel de Jacques Boucher, pour lors trésorier du duc d’Orléans, où elle fut reçue avec très grande joie, avec ses deux frères et les gentilshommes de sa maison. (Journal du Siège d’Orléans.)
Le chroniqueur, à qui nous devons cette relation si vivante, a pourtant omis un détail, qui ne laisse pas d’avoir son importance.
Avant tout, — rapporte un témoin de cette entrée triomphante, — elle voulut se rendre à l’église cathédrale, offrir ses adorations à Dieu, son créateur.
Jacques Boucher lui avait fait préparer un souper copieux ; 58elle n’y toucha pas et se contenta de quelques bouchées de pain, trempées dans du vin, étendu d’eau. Cette nuit-là et toutes celles qu’elle passa à Orléans, elle partagea son lit avec la fille de son hôte, enfant de sept à huit ans.
§8. La Pucelle, terreur des Anglais et réconfort des Français
Le lendemain (samedi 30 avril), l’un des hérauts d’armes de la Pucelle, vint lui rendre compte du résultat de sa mission : après avoir pris connaissance de la lettre qu’il lui avait remise, Talbot était entré dans une violente colère et avait vomi contre la sainte enfant les injures les plus grossières, l’appelant vachère, ribaude, sorcière, et il menaçait de la faire brûler vive, si elle tombait entre ses mains. De plus, il avait retenu prisonnier l’autre héraut et déclarait qu’il allait le faire périr dans les flammes. Il n’osa pourtant pas exécuter sa menace, par crainte de justes représailles.
Le même jour, Jeanne se rendit au boulevard Belle-Croix, qui était au milieu du pont, à une faible distance des Tourelles, occupées par les Anglais ; de là, elle leur cria d’avoir à s’en aller en paix, sinon qu’ils auraient terriblement à s’en repentir. Ils ne répondirent que par des outrages et des menaces. Le lendemain, elle recommença à faire la même sommation sur un autre point ; le résultat fut pareil.
Mais, sous ce dédain affecté des soldats anglais se cachait un autre sentiment, qu’ils n’auraient pas osé avouer. En réalité, la venue de cette mystérieuse Pucelle, dont la renommée était arrivée jusqu’à eux, les avait jetés dans une vague inquiétude. Puisque les Français la vénéraient comme l’envoyée de Dieu, elle ne pouvait être pour eux qu’un suppôt du diable, une redoutable sorcière, capable de les détruire par ses enchantements. De là, une crainte superstitieuse, qui ira toujours croissant, et qui déjà paralyse leurs cœurs. Dunois le constate et son témoignage est confirmé par plusieurs autres :
Tandis que précédemment, — dit-il, — deux cents Anglais mettaient en fuite huit cents ou mille Français, à partir de cette heure, il suffit de quatre ou cinq cents combattants français pour tenir tête quasi 59à toute la puissance anglaise. Les assiégeants n’osaient plus sortir de leurs refuges et de leurs bastilles.
On est quelque peu étonné de voir le sage Bedford lui-même partager les idées superstitieuses de ses soldats ; mais son témoignage n’en a que plus de valeur. Voici comment il s’exprime dans un rapport, qu’il adressait à son roi, cinq ans plus tard :
Notre peuple se trouvait fort nombreux à Orléans et, selon moi, ses malheurs eurent pour cause ses propres fautes et ses erreurs. On eut le tort de croire à un suppôt de l’enfer, nommé la Pucelle, et d’en avoir peur. Elle usait d’enchantements et de sorcellerie. Par l’effet de ces procédés, le nombre de vos partisans diminua ; le courage de ceux qui restaient disparut, en même temps que s’augmentait le nombre et la vaillance de vos ennemis.
Le jugement porté sur la Pucelle par le noble duc a beau être le contre-pied de la vérité, il n’en reste pas moins établi, de son propre aveu, que les défaites des Anglais eurent pour cause déterminante l’intervention de la jeune inspirée.
En même temps qu’elle jetait la terreur parmi les ennemis, Jeanne relevait le courage des Orléanais, en faisant passer dans leurs âmes la foi dont elle était animée. Elle les exhortait à prier et leur prédisait la délivrance prochaine. Ces pauvres gens, exténués de misère et presque désespérés, buvaient ses paroles avec délices :
Ils ne pouvaient se saouler de la voir, — dit un chroniqueur.
Le dimanche, 30 avril, ils se portèrent en foule devant l’hôtel où elle logeait, la réclamant à grands cris. Elle se rendit volontiers à leur désir, monta à cheval et fit une longue promenade à travers la ville, au milieu d’acclamations enthousiastes. L’affluence était telle que les chevaliers de son escorte avaient peine à se frayer un passage. Tout le monde admirait la bonne grâce et l’aisance de ses manières. Elle prenait ainsi, tout doucement et jour par jour, un prestige devant lequel les grands chefs devront s’incliner, de gré ou de force ; car le peuple, témoin et victime de leur impuissance durant ces six mois de siège, ne connaîtra plus d’autre chef que la Pucelle.
60Le lundi, elle monta à cheval, pour protéger la sortie de Dunois qui s’en allait à Blois presser le retour des troupes. Quand on eut dépassé les bastilles anglaises, elle s’arrêta quelque temps, avec sa suite ; puis, voyant que l’ennemi ne bougeait pas, elle rentra en ville et se rendit à la cathédrale, où elle assista aux vêpres. Le lendemain, elle prit part à une procession solennelle, que l’on faisait pour demander à Dieu la levée du siège. Enfin, le mercredi, 4 mai, elle se porta, de grand matin, au devant du convoi de Blois, avec une nombreuse compagnie de gens d’armes. Il ne tarda pas à arriver et franchit les portes de la ville sous les yeux des Anglais, qui n’avaient pas osé se montrer.
À partir de ce moment, les événements vont se précipiter avec une rapidité prodigieuse. Le soir de ce même jour, Jeanne annonçait à son chapelain qu’avant cinq jours le siège serait levé et qu’il ne resterait pas un Anglais devant la ville.
61Chapitre II Délivrance d’Orléans (4-8 mai)
§1. Prise de la bastille de Saint-Loup
Après avoir assisté à l’entrée du convoi, la Pucelle avait regagné son hôtel. Dunois vint l’y trouver et lui apprit qu’on attendait l’arrivée prochaine d’une troupe anglaise, envoyée de Paris, sous la conduite de Fastolf, pour renforcer l’armée de siège. Loin de l’alarmer, cette nouvelle parut la réjouir :
— Bâtard, bâtard, — dit-elle gaiement au jeune capitaine, — en nom Dieu, je te commande qu’aussitôt que tu sauras la venue de Fastolf, tu me le lasses savoir ; car, s’il passe sans que je le sache, je te ferai ôter la tête.
Il lui dit de ne pas s’inquiéter, qu’il la ferait avertir.
Lorsqu’il l’eut quittée, elle se jeta sur un lit pour prendre un peu de repos. À peine avait-elle fermé les yeux qu’elle se réveille soudain et se lève d’un bond, en s’écriant :
— En nom Dieu, nos gens ont beaucoup à besogner ; mon Conseil m’a dit d’aller contre les Anglais, mais je ne sais pas si c’est contre ceux des bastilles ou contre Fastolf, qui vient les ravitailler.
Son incertitude ne fut pas longue ; car, tandis qu’elle se faisait armer à la hâte, la rumeur de la rue lui apprit qu’on se battait à la bastille de Saint-Loup et que les Français y étaient bien malmenés. Elle descend précipitamment et, rencontrant son page, lui crie :
— Ha ! sanglant garçon, tu ne me disais pas que le sang de France était répandu !
Puis elle saute à cheval, saisit son étendard, qu’on lui fait passer par la fenêtre et s’élance au grand galop vers le lieu du combat. 62Elle s’arrêta pourtant à la vue d’un blessé qu’on emportait, et dit, d’une voix émue :
— Jamais je n’ai vu couler sang de Français, sans que mes cheveux se dressassent sur ma tête.
Voici ce qui s’était passé en son absence : certains capitaines, désireux de se signaler, avaient rassemblé à la hâte un nombre assez considérable d’archers et de gens de la milice urbaine ; avec cette troupe improvisée, ils étaient allés donner l’assaut à la bastille de Saint-Loup. Cette imprudence allait leur coûter cher. La bastille, bien fortifiée, était défendue par une garnison nombreuse, largement pourvue de munitions. Repoussés avec perte, ils étaient en fort mauvaise posture, lorsque l’arrivée de la Pucelle vint ranimer le courage des combattants et les décida à tenter un nouvel effort. Elle s’élança avec eux à l’assaut et, malgré la vaillance de ses défenseurs, le fort fut pris et la garnison passée au fil de l’épée, sauf une quarantaine de prisonniers. Tant de sang répandu assombrit la joie que ce premier triomphe causait à la Pucelle ; elle se lamentait sur le sort de ces pauvres gens qui avaient eu le malheur de mourir sans confession. Car toujours battit en elle, même au milieu du carnage, le cœur compatissant de la femme et de la sainte.
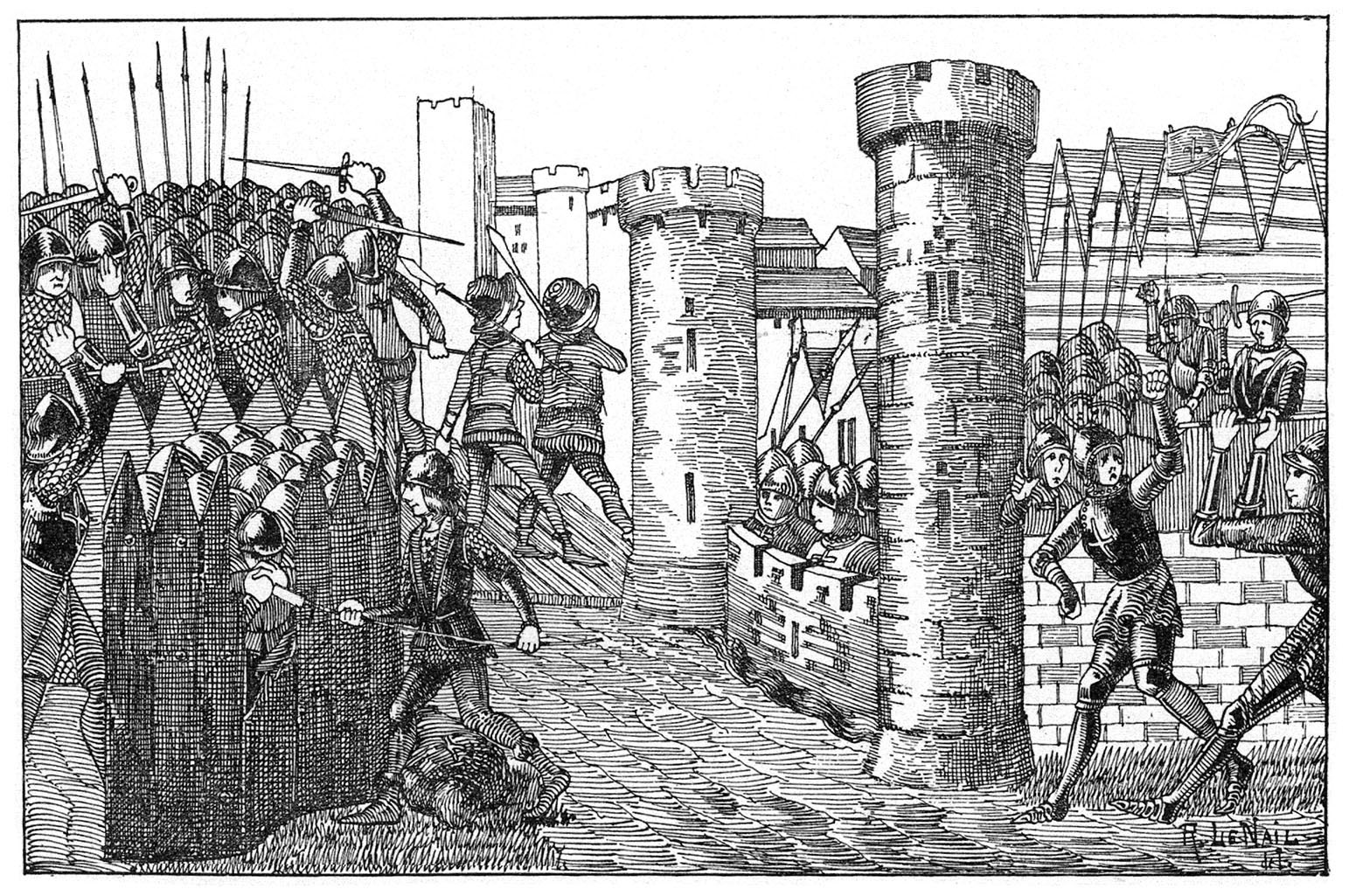
§2. Conseil de guerre
Le lendemain (jeudi, 5 mai, fête de l’Ascension), le gouverneur Gaucourt réunit les principaux chefs de l’armée en conseil de guerre, dans l’hôtel du chancelier d’Orléans. La Pucelle n’y avait pas été convoquée. Ce fut seulement quand tout fut terminé qu’on la fit venir, soi-disant pour l’informer des résolutions prises ; mais le chancelier, qui craignait quelque indiscrétion de sa part, en dissimula les plus importantes. Elle s’en aperçut et riposta sèchement :
— Dites ce que vous avez conclu ; je cèlerai bien plus grand secret que celui-là,
et elle allait et venait dans la salle. Pour apaiser ce juste ressentiment, le bâtard d’Orléans se hâta d’intervenir : Jeanne, dit-il, ne vous courroucez pas, on ne peut tout dire à la fois. Ce que vous a dit le chancelier est vrai ; mais il y a autre chose
; et il lui fit part des décisions prises.
63Elle avait aussi formé un projet, qu’elle leur communiqua : attaquer ce jour-là une autre bastille, afin de mettre à profit l’enthousiasme que le succès de la veille avait inspiré aux assiégés et la stupeur qu’il avait causée aux ennemis. Les généraux s’y refusèrent, sous prétexte qu’il ne convenait pas à des chrétiens de se battre en une fête si solennelle ; mais, en réalité, pour des motifs bien moins élevés ; il leur répugnait surtout de paraître céder à un caprice de jeune fille sans expérience. Elle n’insista pas et les choses en restèrent là.
La solennité de l’Ascension ne lui était certes pas indifférente. Elle s’était confessée et avait communié le matin. Dans le courant du jour, elle fit publier à nouveau que personne n’eût la témérité d’aller au combat sans avoir purifié sa conscience par une bonne confession, parce que le péché ferait perdre la bataille ; elle-même refuserait de marcher avec des pécheurs endurcis.
§3. Dernière sommation aux Anglais
L’après-midi, elle voulut tenter une dernière démarche pacifique auprès des Anglais qui occupaient le fort des Tourelles. Elle se rendit donc au boulevard Belle-Croix, à portée de la voix du poste ennemi, où elle fit lancer une flèche, l’archer criant en même temps :
— Lisez, il y a des nouvelles.
En effet, la flèche portait une lettre ainsi conçue :
Vous, hommes d’Angleterre, qui n’avez nul droit dans ce royaume de France, le roi des cieux vous a ordonné et vous mande par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos forts et rentriez dans vos parages ; faute de quoi je vous ferai un tel hahay qu’il en sera perpétuelle mémoire. C’est pour la troisième et dernière fois que je vous écris ; je ne vous écrirai plus. — Jhésus, Maria.
Jeanne la Pucelle.
En post-scriptum :
Je vous aurais envoyé cette lettre plus honnêtement, mais vous retenez mes hérauts. Vous avez retenu mon héraut Guyenne. Veuillez me le renvoyer et je vous renverrai quelques-uns de vos gens, pris au fort Saint-Loup ; car tous ne sont pas morts.
Les soldats anglais répondirent par des injures immondes, qui firent rougir la pudique enfant et lui arrachèrent des larmes. Dans ce moment de pénible désarroi, elle eut recours à la prière, 64son refuge habituel, et ne tarda pas à montrer un visage rasséréné, parce qu’elle avait eu, disait-elle, des nouvelles de son Seigneur.
§4. Prise du fort des Augustins
Le jour suivant (vendredi, 6 mai), Jeanne se leva de grand matin, se confessa et assista à la messe, puis rejoignit le gros de l’armée. Après avoir traversé la Loire, on se dirigea vers le fort de Saint-Jean-le-Blanc, dans l’intention de le prendre d’assaut ; il était vide ; ses défenseurs l’avaient abandonné et étaient allés renforcer les garnisons des autres bastilles.
On se porta alors vers le fort des Augustins. La Pucelle marchait en tête, avec une poignée d’hommes. Elle venait de planter son étendard sur le boulevard, lorsque, se retournant, elle s’aperçut qu’elle était seule ; ses gens avaient lâché pied, effrayés par les formidables hourras que poussaient les Anglais, sortis de leurs repaires. Après s’être quelque peu éloignée pour rallier les fuyards,
tout soudain, — dit un chroniqueur, — elle se tourna vers les ennemis et, quoique ayant peu de gens avec elle, elle leur fit visage, marcha à leur rencontre à grands pas, son étendard déployé. Les Anglais en furent, par la volonté de Dieu, si épouvantés qu’ils prirent laide et honteuse fuite. Les Français se retournèrent alors et se mirent à leur donner la chasse, les poursuivant jusques à leurs bastilles, où ils se retirèrent à grande hâte. À cette vue, la Pucelle fixa son étendard devant la bastille des Augustins, sur les fossés du boulevard, où le sire de Rais vint incontinent la joindre. Le nombre des Français alla toujours croissant, en sorte qu’ils prirent d’assaut la bastille des dits Augustins, où, en très grande multitude se trouvaient des Anglais, qui furent tous tués. Il y avait aussi foison de vivres et de richesses. Parce que les Français se montraient trop avides de pillage, la Pucelle y mit le feu et tout fut brûlé.
Quand la nuit fut venue, ses gens la ramenèrent à son hôtel, harassée de fatigue, blessée au pied par une chausse-trape et néanmoins bien résolue à donner l’assaut, le lendemain, au fort des Tourelles.
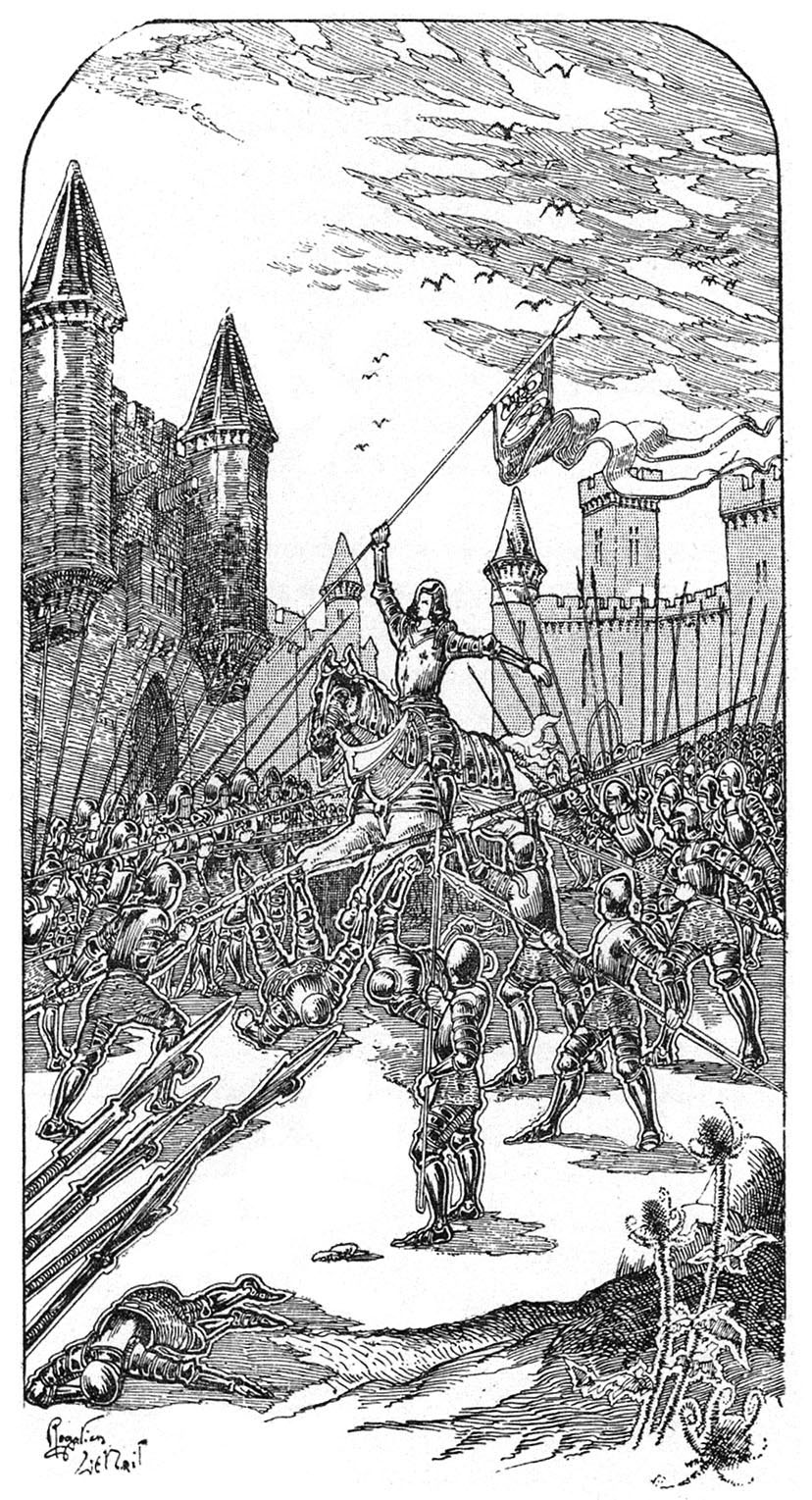
§5. Jeanne résiste aux chefs de l’armée
67Jeanne venait de souper, lorsqu’elle reçut la visite d’un envoyé des grands chefs de l’armée, chargé de lui communiquer les décisions qu’ils avaient prises en conseil : satisfaits, pour le moment, des succès obtenus, et ne disposant, disaient-ils, que d’un nombre insuffisant de troupes, ils avaient résolu, avant d’entreprendre autre chose, d’attendre de nouveaux secours du roi, et, en tout cas, de ne pas faire de sortie le lendemain. À cette nouvelle, Jeanne bondit d’indignation.
— Vous avez été à votre conseil, — dit-elle au messager, — et j’ai été au mien. Croyez que le conseil de mon Seigneur s’exécutera et tiendra et que le conseil des hommes s’évanouira.
Puis, se tournant vers son chapelain :
— Demain, levez-vous au premier jour, plus matin encore qu’aujourd’hui et faites du mieux que vous pourrez. Tenez-vous toujours près de moi ; car demain, j’aurai beaucoup à faire, beaucoup plus que je n’eus jamais de ma vie. Demain, le sang jaillira de mon corps, au-dessus du sein8.
Les chefs de l’armée, dûment avertis de ses projets, résolurent de s’opposer par la force à toute sortie et le gouverneur lui-même, Gaucourt, se chargea de garder la porte et de faire respecter la consigne. Ainsi, le conflit est inévitable : la Pucelle s’est engagée à exécuter les ordres de son Seigneur et elle les exécutera, coûte que coûte.
Désormais sa volonté va s’imposer à tous, pour le plus grand bien de la France. Un contemporain, Jean Chartier, historiographe de Charles VII, le constate en ces termes :
Bien souvent, le Bâtard et les autres seigneurs s’abouchaient pour aviser à ce qu’il y avait à faire et, quelque conclusion qu’ils prissent, quand Jeanne la Pucelle arrivait, elle concluait tout à l’opposite, quasi contre toutes les opinions des chefs de guerre ; de 68quoi toujours lui en prenait bien. Il ne se fit pas chose, dont il faille parler, que ce ne fût sur l’entreprise de Jeanne. Elle allait toujours armée de toutes pièces, quoique ce fût contre la volonté des mêmes gens de guerre. Elle montait sur son coursier tout armée, aussi prestement que chevalier qui fut en cour de roi ; ce dont les gens de guerre étaient ébahis et courroucés.
Il est bien évident qu’elle leur portait ombrage.
Le samedi, 7 mai, Jeanne se confessa et communia à une messe matinale. Rentrée à son hôtel, elle y reçut une députation des bourgeois d’Orléans ; eux aussi avaient tenu conseil et pris des résolutions. Craignant sans doute que la Pucelle eût renoncé à la sortie projetée, à cause de la défense des chefs de guerre, ils venaient la sommer d’accomplir sans délai la charge qu’elle avait de par Dieu et de par le roi. La requête de ces bons bourgeois répondait si bien à ses plus chers désirs qu’elle en fut toute réjouie :
— En nom Dieu, je le ferai, — leur dit-elle, — et qui m’aime me suive.
Comme elle se disposait à sortir, on lui apporta une belle alose :
— Gardez-la pour ce soir, — dit-elle aux gens de la maison ; — je vous amènerai un godon9 qui en mangera sa part.
Elle ajouta :
— Je repasserai par dessus le pont.
La chose paraissait impossible ; car il avait été coupé par les Anglais, sur une assez grande longueur.
Le gros de la troupe, que conduisait la Pucelle, appartenait à la milice communale ; ils amenaient des canons, des couleuvrines, des échelles et autres engins de guerre ; tous étaient pleins d’ardeur et de confiance. Arrivés devant la porte de Bourgogne, ils la trouvent fermée et gardée par des hommes d’armes ; le gouverneur est là, qui refuse de l’ouvrir. La Pucelle s’approchant alors lui crie :
— Méchant homme ! que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, les hommes d’armes passeront et ils seront victorieux, comme ils l’ont déjà été.
Ils passèrent en 69effet et le sire de Gaucourt, bousculé par cette avalanche humaine, fut trop heureux de s’en tirer sain et sauf ; il avait craint pour sa vie.
§6. Prise des Tourelles
Le fort des Tourelles, vers lequel la Pucelle se dirigeait, était un solide bâtiment, assis sur le pont, non loin de l’extrémité qui touchait à la Sologne. Les Anglais ne s’en étaient emparés, au début du siège, qu’au prix de grandes pertes ; deux cent quarante des leurs avaient été tués dans une première attaque, qui avait été repoussée. Quand ils s’y furent une fois installés, ils n’avaient rien négligé pour le mettre dans le meilleur état de défense : une large coupure, pratiquée dans le pont, l’isolait de la ville ; d’autre part, ils avaient puissamment fortifié le boulevard, élevé sur la rive solognote, qui en défendait les approches.
Ce boulevard était environné d’un fossé de quatre-vingts pieds de large et communiquait avec le fort par un pont-levis. La garnison, forte de cinq à six cents hommes d’élite, était commandée par de vaillants officiers, lord Moleyns, lord Poynings, Glasdale, etc. Elle était abondamment pourvue d’armes et de munitions. Telle était la formidable position qu’il s’agissait d’enlever.
L’attaque du boulevard commença au lever du soleil et fut poussée avec une vigueur et une ténacité extraordinaires. Il fallut d’abord combler le fossé, en y jetant des fascines, sous les traits de l’ennemi ; la matinée fut employée à ce travail ingrat. Vers midi, au moment où la Pucelle dressait la première échelle, elle fut atteinte d’un trait, qui la traversa de part en part, entre l’épaule et le cou. La douleur lui fit d’abord verser des larmes ; mais bientôt elle arracha elle-même le trait. Des hommes d’armes lui ayant proposé de la guérir par un charme superstitieux, elle refusa, en disant :
— J’aimerais mieux mourir que de faire ce que je saurais être un péché.
Elle se retira un peu à l’écart, s’entretint quelques instants avec son chapelain ; puis, après un pansement sommaire, se hâta de rejoindre les combattants.
Cependant, les chefs de l’armée, voyant que l’affaire était 70sérieusement engagée, avaient eu honte de leur inaction et s’étaient décidés à y prendre part. Encouragés par leur présence et animés par les exhortations de la Pucelle, les assaillants se précipitaient à l’assaut avec furie ; toujours repoussés, ils revenaient toujours avec une nouvelle ardeur. Les Anglais déployaient un courage égal : ils avaient, en outre, l’avantage de leur position et d’une discipline que ne connaissaient guère les masses désordonnées de la milice orléanaise. Aussi, le combat se prolongeait, sans autre résultat qu’une extrême fatigue et de nombreuses blessures.
Comme le jour était sur son déclin, Dunois, convaincu qu’on n’avait aucune chance de s’emparer du boulevard, donnait le signal de la retraite, lorsque Jeanne survint et s’y opposa énergiquement :
— Ne vous retirez pas, dit-elle aux hommes d’armes ; en nom Dieu vous entrerez bientôt dedans ; n’ayez doute. Reposez-vous un peu ; buvez et mangez ; les Anglais n’auront plus de force sur vous.
Et, quand ils se furent reposés et restaurés :
— Maintenant, de par Dieu, retournez à l’assaut ; car, sans faute, les Anglais n’auront plus la force de se défendre, et seront prises leurs Tourelles et le boulevard.
Cela dit, elle se retira à l’écart, pour prier, durant sept à huit minutes, puis revint bien vite.
Comme elle approchait du fossé, elle vit, aux mains d’un inconnu, son étendard, qu’elle avait confié à son majordome, d’Aulon ; et, craignant qu’il ne fût en mauvaises mains, elle en saisit l’extrémité, en s’écriant :
— Ha ! mon étendard ! mon étendard !
Elle le secouait en même temps d’étrange façon, de sorte que les gens d’armes crurent que c’était un appel au secours et accoururent aussitôt ; mais elle se rassura, en voyant le porteur se diriger vers d’Aulon, qui se tenait au pied du mur. S’adressant alors à un gentilhomme, qui était en meilleure situation pour voir ce qui se passait :
— Prenez garde, lui dit-elle, quand la queue de mon étendard touchera contre le boulevard.
— Jeanne, il y touche.
Elle, de s’écrier joyeusement :
— Tout est vôtre et y entrez.
71Quand les Anglais avaient vu la Pucelle, qu’ils croyaient blessée mortellement, agiter son drapeau sur le bord du fossé, ils avaient été, dit Dunois,
saisis de frayeur ; ils frissonnaient. Les gens du roi, animés d’un nouveau courage, escaladèrent le boulevard sans rencontrer aucune résistance.
Personne n’avait insulté Jeanne en termes plus outrageants que Glasdale. Néanmoins, quand elle le vit sur le point de périr, elle lui cria :
— Glacidas, Glacidas, rends-toi, rends-toi au roi des Cieux. Tu m’as appelée prostituée, et moi j’ai grand pitié de ton âme et de l’âme des tiens.
Mais Glasdale et les siens s’enfuyaient du côté des Tourelles, où ils espéraient trouver un sûr abri. Ils ne purent y parvenir. Le pont-levis, qui y donnait accès, à demi rongé par les flammes d’un brûlot que les Orléanais avaient allumé en dessous, s’écroula sous leur pas ; ils tombèrent dans le fleuve et s’y noyèrent. Du reste, les Tourelles n’étaient déjà plus au pouvoir des Anglais. La garnison du boulevard Belle-Croix, profitant de ce que l’attention des ennemis était attirée de l’autre côté, avait réussi à joindre ensemble, au moyen d’une vieille gouttière, les deux piles de l’arche détruite ; des hommes courageux s’étaient risqués un à un sur ce pont improvisé et avaient surpris les soldats restés dans la forteresse. Tous ses défenseurs périrent, tués ou noyés, à l’exception d’un petit nombre, qui furent faits prisonniers.
La vue de ce carnage arracha à Jeanne des larmes de compassion. Ses compagnons d’armes déploraient aussi très sincèrement la mort de tant de grands personnages, mais pour un motif moins noble. ils regrettaient surtout la rançon qu’ils en auraient tirée. Le Journal du siège le constate sans vergogne :
Grand dommage pour les vaillants Français qui, par leur rançon, eussent pu avoir grand-finance.
La Pucelle rentra en ville par le pont, comme elle l’avait prédit le matin. Elle y fut reçue au milieu des acclamations d’un peuple transporté de joie ; la foule la suivit à la cathédrale, où l’on rendit à Dieu de ferventes actions de grâces. Rentrée 72à la maison de Boucher, elle fit panser sa blessure et prit ensuite une réfection bien légère,
quatre ou cinq tranches de pain, — dit Dunois, — dans du vin mêlé de beaucoup d’eau. Ce fut là tout son manger et tout son boire pour la journée entière.
Ainsi, cinq jours après son premier combat, cette jeune paysanne venait, suivant la remarque d’un de ses plus récents historiens, Andrew Lang, de gagner
une des quinze batailles, où se sont décidées les destinées du monde.
Elle fut interrogée, à Rouen, sur le rôle qu’elle avait joué dans cette mémorable journée ; invitée à donner certains détails, elle le fit en toute simplicité et candeur.
— Je savais, dit-elle, que je ferais lever le siège d’Orléans ; car cela m’avait été révélé, et je l’avais dit à mon roi, avant de venir dans la ville. Je savais bien aussi que je serais blessée et que je ne laisserais pas cependant de besogner et je le dis à mon roi. — À l’assaut de la bastille du pont, je fus blessée par un vireton. Je venais la première de hisser une échelle contre la bastille, quand je fus blessée. Je fus grandement réconfortée par sainte Catherine et cette blessure ne m’empêcha ni de chevaucher ni de besogner ; dans une quinzaine, je fus guérie. — Je ne disais pas à mes gens qu’ils ne seraient pas atteints — il y eut cent blessés et plus parmi eux — je leur disais de ne pas faire doute que le siège serait levé.
Pendant que les défenseurs des Tourelles faisaient vaillamment leur devoir, en résistant toute une journée à de furieux assauts, les Anglais, qui occupaient les autres bastilles, étaient demeurés spectateurs inertes d’un combat, où se jouait la fortune de leur pays ; transis de peur, au fond de leur taudis, ils n’avaient rien tenté pour aller au secours de leurs camarades.
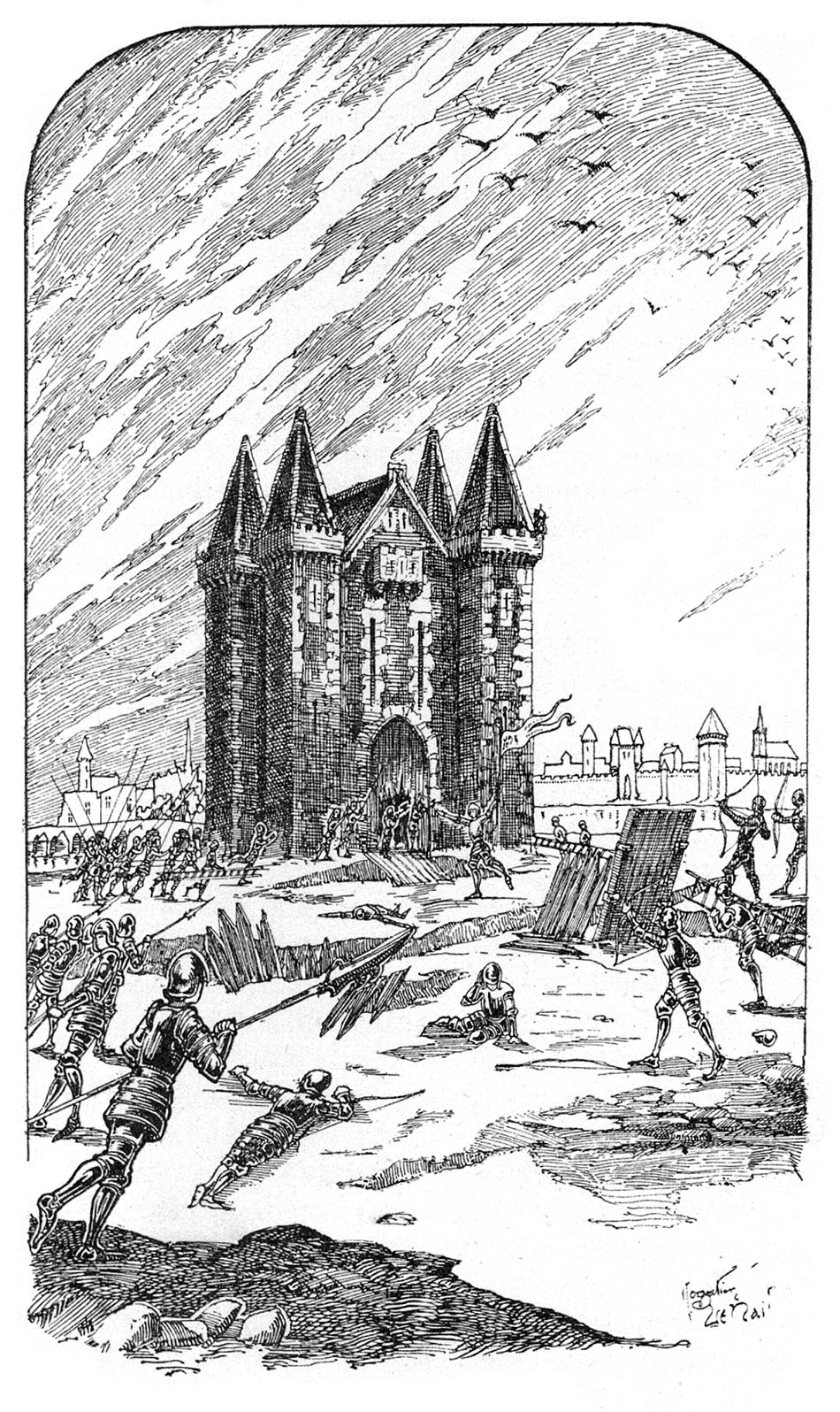
§7. Levée du siège
La nuit venue, Suffolk tint un conseil de guerre, où il fut décidé qu’on allait lever le siège. Avec des troupes aussi profondément démoralisées, c’était évidemment le parti le plus sage. Ils sortirent donc de leurs retranchements, au point du jour, avec leurs prisonniers et tout ce qu’ils pouvaient emporter, abandonnant leurs blessés, leurs vivres, leurs engins de guerre, 75canons, bombardes, poudre, etc. À une faible distance, ils se rangèrent en ordre de bataille, enseignes déployées, comme pour provoquer les Français à se mesurer avec eux en rase campagne. Ceux-ci étaient aussi sortis de la ville et leur faisaient face, conduits par la Pucelle et par les chefs de l’armée royale. Plusieurs de ces derniers auraient voulu engager le combat, mais Jeanne s’y opposa.
Ce jour était un dimanche, et ni elle ni les siens n’avaient assisté à la messe. Sa piété y pourvut sur-le-champ ; on apporta, par son ordre, près de sa bannière, une table et une pierre sacrée et deux messes furent célébrées en plein air devant les troupes. Ce pieux devoir accompli, elle dit en montrant l’armée anglaise :
— Regardez s’ils ont le visage ou le dos tourné vers nous.
Puis, quand on lui eut rapporté qu’ils tournaient le dos :
— Laissez-les aller ; il ne plaît pas à Messire qu’on les combatte aujourd’hui ; vous les aurez une autre fois.
Un incident burlesque vint bientôt jeter une note comique au milieu de l’allégresse générale. Le comte de Talbot avait un prisonnier de marque, le capitaine Le Bourg de Bar, dont il espérait tirer une honnête rançon. En partant, il en avait confié la garde à un religieux, son confesseur. Le prisonnier, les jambes entravées par une forte chaîne, ne marchait qu’à petits pas et n’avançait guère ; il avait d’ailleurs ses raisons pour ne pas se presser. Quand il vit la colonne suffisamment éloignée, il sauta brusquement sur le dos de son gardien et le força de le porter ainsi jusqu’à la ville, où leur arrivée ne manqua pas de faire sensation.
Le soir, la population se porta en foule dans les églises, pour remercier Dieu et les saints patrons de la ville, saint Aignan et saint Euverte, de cette miraculeuse délivrance. Une procession solennelle défila dans les rues et la journée se termina par un sermon de circonstance. Tel fut le début de la grande fête du 8 mai, qui se célèbre encore maintenant chaque année à Orléans.
Après cela, l’armée dut se disloquer, parce que l’argent et les 76vivres manquaient. Avant de laisser s’éloigner leur libératrice, les Orléanais eurent à cœur de lui donner à nouveau les marques les plus touchantes de leur reconnaissance. Pressés autour d’elle, les yeux baignés de larmes, ils lui protestaient de leur absolu dévouement, mettant à sa disposition leurs biens et leurs personnes. Tels étaient les sentiments dans lesquels elle les laissa, en partant, le mardi 10 mai, pour aller rejoindre le roi à Tours.
Elle avait certes le droit de se présenter devant lui avec une légitime fierté : ce siège, qui durait depuis sept mois et avait réduit la ville à la dernière extrémité, elle l’avait fait lever en cinq jours. La première partie de sa tâche était accomplie. Elle avait donné le signe que réclamaient les docteurs de Poitiers, et réalisé ses promesses. Personne, désormais, ne pourra plus se croire raisonnablement autorisé à mettre en doute sa mission divine.
La délivrance d’Orléans est bien son œuvre personnelle, et les foules, qui lui en attribuent la gloire, ne font que lui rendre justice ; car, sans elle, la ville aurait certainement succombé. Seule, rien que par sa présence, elle avait ramené la confiance aux cœurs des Français et jeté l’épouvante parmi ses ennemis. L’attaque des Tourelles, dont le succès fut décisif, elle l’avait entreprise, non seulement sans les chefs de l’armée, mais contre leur défense formelle. Leur intervention faillit même faire tout échouer, puisque Dunois faisait sonner la retraite, lorsque l’indomptable ténacité de la Pucelle exigea un sursis, dont elle profita pour donner l’assaut victorieux. Elle vérifiait ainsi d’avance cette parole de Napoléon : À la guerre, les hommes ne sont rien, un seul homme est tout. Mais ici, prodige absolument inouï ! le chef, qui fut tout, était une jeune paysanne de dix-sept ans !
77Chapitre III Après Orléans
§1. Accueil royal
Jeanne s’arrêta deux ou trois jours à Blois, puis se rendit à Tours, où le roi ne tarda pas à la rejoindre. Elle sortit à sa rencontre, à cheval, son étendard déployé. En l’abordant, tête découverte, elle lui fit une très profonde révérence. Le monarque ôta son chaperon pour lui rendre son salut ; puis, s’approchant, la serra dans ses bras en la soulevant un peu.
Il semblait à plusieurs, — ajoute un chroniqueur, — qu’il l’eût volontiers baisée, tant il avait de joie.
En effet, sa reconnaissance était vive, et sincère son admiration. Deux jours après la levée du siège, il avait expédié des lettres aux bonnes villes de son royaume pour les informer de l’heureux événement. Après y avoir relaté la prise des Tourelles par grande prouesse et vaillance d’armes, il ajoutait :
Le héraut, qui a été présent à tout, nous a rapporté, et d’autres aussi, les vertueux faits et les choses merveilleuses de la Pucelle, laquelle a toujours été en personne à l’exécution de toutes ces choses.
Peu de temps après, en juin, à la recommandation de sa bien aimée Jeanne, il délivrait des lettres de noblesse à Guy de Cailly,
qui l’avait reçue dans son château de Reuilly, quand elle approchait d’Orléans, [et s’était distingué par son] empressement à la seconder en combattant à ses côtés. [Il a soin d’y faire enregistrer que] la levée du siège d’Orléans a été 78opérée principalement par l’arrivée et sous la conduite de l’illustre Pucelle, Jeanne de Domrémy ; que les services, rendus par elle, sont infinis et qu’aucune récompense n’en saurait égaler la grandeur ; [car, dans le temps où ses] affaires allaient toujours en déclinant, [elle lui a donné] le présage et le gage qu’il pourrait facilement recouvrer ses autres villes et cités.
§2. Mémoire de Gerson
Le cœur de tous les bons Français battait à l’unisson de celui du roi. Le nom de la Pucelle volait de bouche en bouche. Un si glorieux début n’autorisait-il pas tous les espoirs ? Elle s’était engagée à bouter hors de France les Anglais détestés ; elle allait donc le faire et à bref délai. Ainsi raisonnait l’enthousiasme populaire. Ceux qui étaient au courant de ce qui se passait dans les régions gouvernementales, se montraient moins rassurés. Sans mettre en doute la mission surnaturelle de l’héroïne, ils se demandaient avec inquiétude si l’incurable veulerie du roi et l’égoïsme de ses ministres n’allaient pas entraver son action et faire échouer ses entreprises. Ce double sentiment de confiance et de crainte se manifeste dans un mémoire, que le savant et pieux Gerson rédigea à cette époque.
Dans ce mémoire, que le docte vieillard composa, quelques semaines seulement avant sa mort, il déclare tout d’abord que
c’est chose pieuse, salutaire et de bonne dévotion de se prononcer pour la Pucelle ; car elle poursuit une œuvre très juste et sa conduite n’a rien de blâmable, rien qui sente la superstition, la fraude, la trahison ; pas de vues intéressées ; elle prouve sa mission en s’exposant aux plus grands périls. Le conseil dû roi et les hommes d’armes ont fini par croire à la parole de cette fillette. Le peuple tressaille d’une sainte allégresse ; il croit, il suit. Les ennemis eux-mêmes et leurs chefs sont confondus ; ils se cachent derrière leurs murailles, en proie à la peur. Des signes indubitables montrent que Dieu l’a choisie pour écraser les ennemis de la justice et relever les défenseurs du droit. Par la main d’une enfant, d’une vierge, il veut confondre les puissantes armes de l’iniquité.
79Ainsi, d’après Gerson, c’est Dieu qui a pris en main la cause du roi de France ; Jeanne est sa mandataire et elle réalisera sûrement ce qu’elle a promis, pourvu toutefois que les intéressés n’y mettent pas eux-mêmes obstacle. Car, ajoute le mémoire,
un premier miracle n’amène pas toujours tout ce que les hommes en attendent… Notre ingratitude, nos blasphèmes, d’autres causes encore pourraient faire que, par un secret mais juste jugement de Dieu, nous ne vissions pas l’accomplissement de tout ce que nous attendons. Avis donc au parti qui a la justice de son côté. Que, par ses infidélités, ses ingratitudes ou par d’autres prévarications, il n’arrête pas le cours des bienfaits divins, dont il a reçu déjà des effets si manifestement merveilleux.
Le mémoire continue en signalant quatre avertissements d’ordre politique et religieux, apportés par la Pucelle, sur la teneur desquels on ne trouve nulle part d’indications plus précises que celles qu’on y lit :
Le premier regarde le roi et les princes du sang ; le second, la milice du roi et des communes ; le troisième, les ecclésiastiques et le peuple ; le quatrième, la Pucelle elle-même. Tous n’ont qu’une seule et même fin : nous amener à bien vivre, dans la piété envers Dieu, dans la justice envers le prochain, dans la sobriété et la tempérance envers nous-mêmes.
À ceux qui pouvaient être tentés de se scandaliser, à propos du costume viril, que Jeanne avait adopté pour d’excellentes raisons, le vieux chancelier répond :
Il est défendu à l’homme et à la femme de porter des vêtements indécents… Cette règle nous oblige à faire attention à toutes les circonstances, pour voir ce que demandent le temps, le but, la manière et autres semblables accidents, dont juge le sage.
Voici maintenant sa conclusion :
Aucune loi n’interdit le costume viril et guerrier à notre vierge, qui est guerrière et fait œuvre d’homme. Trêve donc et silence aux langues d’iniquité ; car, lorsque la puissance divine opère, elle harmonise les moyens à la fin, et il n’est pas 80permis de pousser la témérité jusqu’à incriminer l’ordre que Dieu établit dans ses œuvres.
§3. Traité de l’archevêque Jacques Gélu
La voix de l’un des premiers dignitaires de l’église de France, Jacques Gélu, archevêque d’Embrun et ami personnel de Charles VII, vint bientôt se joindre à celle de l’illustre Gerson, pour célébrer la mission de la Pucelle. Son témoignage a d’autant plus de poids qu’il avait, tout d’abord, montré une grande défiance à son égard. Mais, la merveilleuse délivrance d’Orléans ayant dissipé toutes ses craintes, il envoya au roi un long traité, dans lequel nous lisons :
Les merveilles, qui viennent de s’opérer pour l’éternelle gloire de Votre Altesse et de la Maison de France, retentissent à toutes les oreilles. Une toute jeune fille en est l’instrument. Les doctes se partagent ; les uns y voient l’effet d’une providence spéciale sur votre personne et votre race ; les autres regardent la Pucelle comme le jouet de l’esprit du mal.
La première opinion était celle de tous les vrais. Français ; mais l’Université de Paris tenait pour la seconde.
Après avoir signalé les causes des malheurs qui désolaient la France avant l’arrivée de Jeanne d’Arc, Gélu expose l’extrême détresse où le roi était réduit :
Il n’y avait presque plus personne qui fît cas de ses ordres. Princes et seigneurs se retiraient de son autorité, faisaient hommage aux Anglais ou se déclaraient indépendants dans leurs domaines. On en était venu à regarder comme licite que chacun pouvait s’approprier, aux dépens du royaume, ce dont il pouvait s’emparer. Le roi était réduit à une telle détresse qu’il manquait souvent du nécessaire, non seulement pour sa maison, mais aussi pour sa personne et pour celle de la reine. Rien n’autorisait à penser qu’un bras d’homme pût le remettre en possession de ses États. Le nombre de ses ennemis et de ceux qui se retiraient de son obéissance croissait tous les jours, et ceux qui se disaient de son parti ne lui donnaient qu’une assistance chaque jour plus faible. Ainsi dénué de tout secours humain, dépouillé par la cupidité des siens, il montrait grande patience et très ferme espérance en Dieu.
83C’est alors, quand tout semblait humainement désespéré, que
le roi des rois et le Seigneur des seigneurs est venu en aide au roi par une toute jeune fille, que rien n’avait préparée à cette mission.
Après ce préambule, Gélu établit, dans une longue dissertation, que l’œuvre confiée à la Pucelle,
œuvre merveilleuse en elle-même, [n’a cependant rien que de conforme à la sagesse divine], qui choisit souvent ce qui est faible, pour confondre ce qui est fort.
Le traité se termine par des conseils pratiques d’une importance capitale :
Il ne faut nullement s’opposer à la volonté de la messagère divine, mais lui obéir entièrement… Si le roi, cherchant son appui dans la prudence humaine, n’écoute pas la Pucelle, il doit craindre, même alors qu’il croirait bien faire, d’être abandonné de Dieu et de voir ses désirs frustrés… Les préparatifs des expéditions, machines de guerre, ponts, échelles, approvisionnements en vivres et en argent et choses semblables, en un mot, tout ce qui regarde le côté matériel de l’entreprise, il faut y pourvoir par voie de prudence humaine. Mais, pour tout ce qui concerne les points essentiels du mandat confié à celle que la piété nous porte à considérer comme l’ange du Dieu des armées, c’est l’avis de la Pucelle qui doit être demandé, recherché en premier lieu, de préférence à tout autre.
Ces conseils étaient dictés par la sagesse même. Le roi s’y conforma d’abord, autant du moins que le comportait son pauvre caractère. Mais, après le Sacre, nous le verrons mettre Jeanne à l’écart, au grand détriment du pays.
§4. Jeanne presse le roi d’agir
Après le grand coup, frappé à Orléans, le plus vulgaire bon sens demandait qu’on mît à profit, sans délai, l’enthousiasme des Français, et qu’on ne laissât pas aux Anglais démoralisés le temps de se remettre de leur panique. C’était bien l’avis de la Pucelle, qui pressait le roi de reprendre aussitôt la lutte, pour se frayer le chemin de Reims :
— Gentil dauphin, — lui disait-elle, — venez prendre votre digne Sacre à Reims, je suis fort aiguillonnée que vous y alliez et ne fais nul doute que vous l’y receviez.
À Loches, 84où elle l’avait suivi avec les chefs de l’armée, elle renouvelle ses instances.
Le roi, — dit Dunois, — était dans sa chambre de retrait avec le seigneur Christophe de Harcourt, Machet son confesseur, et Robert le Maçon, seigneur de Trèves. La Pucelle frappa à la porte ; aussitôt entrée, elle se jeta à deux genoux-devant le roi et, lui tenant les jambes embrassées, lui parla en ces termes :
Noble dauphin, ne tenez plus tant et de si longs conseils ; mais venez au plus tôt à Reims pour y recevoir votre digne Sacre.Christophe de Harcourt lui demanda si c’était de la part de son Conseil qu’elle tenait ce langage. Elle répondit que oui et qu’elle était fort aiguillonnée à ce sujet. —
Jeanne, reprit le comte d’Harcourt, voudriez-vous dire ici, en présence du roi, la manière dont vous parle votre Conseil.—Je conçois fort bien, repartit-elle, ce que vous voulez savoir et je vous le dirai volontiers. Lorsque j’ai déplaisir, parce qu’on lait difficulté d’ajouter foi à ce que je dis, de la part de Dieu, je me retire à l’écart pour prier ; je me plains de la peine que j’ai à me faire croire de ceux auxquels je m’adresse. Ma prière finie, j’entends une voix qui me dit : Fille de Dieu, va, va, va, je serai à ton aide, va. Et quand-j’entends cette Voix je suis inondée de joie et je désirerais être toujours en cet état.Elle éprouvait un merveilleux transport, en prononçant ces paroles, les yeux levés vers le ciel.
Ses instances finirent par triompher de l’inertie du roi ; la marche sur Reims fut décidée. Mais, pour assurer les derrières de l’armée, on voulut auparavant chasser les Anglais des places qu’ils occupaient sur la Loire, en amont et en aval d’Orléans. La direction de l’affaire fut confiée au duc d’Alençon, qui venait de dégager sa parole, en payant aux Anglais le reliquat de la somme fixée pour sa rançon. Aucun choix ne pouvait être plus agréable à la Pucelle ; dès leur première entrevue, il s’était montré sympathique et généreux à son égard ; de plus, il était le gendre du duc d’Orléans, prisonnier en Angleterre, dont la délivrance faisait partie de sa mission. Pendant son séjour à Chinon, elle était allée rendre visite à la duchesse d’Alençon en 85l’abbaye de Saint-Florent, près de Saumur, où cette dame résidait.
Dieu sait, — dit Perceval de Cagny, — le joyeux accueil que lui firent la mère du duc, le duc et sa femme, durant les trois ou quatre jours qu’elle passa au dit lieu. Et après cela, et toujours depuis, elle se tint plus près et plus familière du duc d’Alençon que d’aucun autre ; et toujours, en parlant de lui, elle l’appelait Mon beau duc et pas autrement.
Elle était présente, lorsqu’il prit congé de sa femme, au moment de se mettre en campagne. La jeune duchesse, qui venait de passer par de cruelles angoisses durant la captivité de son mari, n’était pas sans inquiétude en le voyant sur le point d’affronter de nouveaux périls. Jeanne la rassurait de son mieux :
— Soyez sans crainte, Madame, — lui dit-elle en la quittant ; — je vous le ramènerai bien portant.
Le roi, qui n’avait pas encore eu le temps d’oublier les sages conseils de Gélu, donna au duc d’Alençon l’ordre formel
de se conduire et de faire entièrement d’après le conseil de la Pucelle. Et il le fit, étant celui qui prenait grand plaisir à la voir en sa compagnie, et aussi le faisaient les gens d’armes et encore les hommes du peuple, tous la tenant et la réputant envoyée par Notre-Seigneur, et ainsi était-elle. (Journal du siège.)
§5. Lettre des seigneurs de Laval
Pendant que l’expédition s’organisait, la Pucelle prit les devants pour se rapprocher du théâtre des prochaines opérations, et le roi vint la rejoindre à Selles-en-Berry. Il était accompagné de deux jeunes seigneurs, Guy et André de Laval, qui lui avaient amené, sans en être requis, une compagnie de gens d’armes, levée à leurs frais. L’un des deux frères écrivit, le 8 juin, à leurs mère et grand-mère, une longue lettre, qui constitue un précieux document historique. Après avoir témoigné de sa joie pour le gracieux accueil dont le roi les avait honorés, il en vient à raconter son entrevue avec la Pucelle ; rien de plus frais et de plus vivant que son récit.
Le roi, — dit-il, — fit venir au devant de lui la Pucelle. Quelques-uns disaient que c’était en ma faveur, afin que je la visse. La dite Pucelle fit très bonne chère 86à mon frère et à moi. Elle était armée de toutes pièces et tenait la lance en main.
Après que nous fûmes descendus à Selles, j’allai la voir à son logis ; elle fit venir le vin et me dit qu’elle m’en ferait bientôt boire à Paris. Cela me semble chose toute divine, de son fait, de la voir et de l’ouïr. Elle est partie de Selles lundi, aux vêpres, pour aller à Romorantin, le maréchal de Boussac et grand nombre de gens armés et des communes avec elle. Je la vis monter à cheval, armée tout à blanc, sauf la tête, une petite hache en main, sur un grand coursier, qui se démenait très fort à la porte de son logis et ne souffrait pas qu’elle montât. Et alors, elle dit :
Menez-le à la croix, qui était devant l’église ; et lors elle monta sans qu’il remuât, comme s’il eût été lié. Et lors elle se tourna vers la porte de l’église et dit de sa voix de femme :Vous, prêtres et gens d’église, faites processions et prières à Dieu.Et alors, elle retourna à son chemin, en disant :Tirez avant, tirez avant.Un gracieux page portait son étendard ployé et elle avait sa petite hache en la main.
Guy de Laval donnait ensuite, à ses très redoutées dames et mères, des nouvelles du duc d’Alençon, auquel il a
gagné une convenance, à la paume, et de divers autres seigneurs, qui viennent de toutes parts. [Il constate avec joie que] jamais gens n’allèrent de meilleure volonté en besogne qu’ils ne vont à celle-ci. [Malheureusement la cour n’a pas d’argent ; il] n’en espère aucun secours ni soutien [et il ne reste aux deux frères que] trois cents écus. [C’est pourquoi il ajoute, avec l’accent d’un noble désintéressement :] Vous, Madame ma Mère, qui avez mon sceau, n’épargnez point ma terre par vente, ni par engagement, ou avisez plus convenable affaire, pour un cas où il faut sauver l’honneur de nos personnes, qui, par défaut, serait abaissé ou même en voie de périr ; car, si nous ne faisions ainsi, vu qu’il n’y a point de solde, nous demeurerions seuls.
La renommée de la Pucelle allait susciter, en grand nombre, de semblables dévouements dans toutes les classes de la société.
87Chapitre IV Campagne de la Loire (12-18 juin)
§1. Prise de Jargeau
De Romorantin, le duc d’Alençon et la Pucelle se rendirent à Orléans. L’armée, qui s’y trouvait réunie, était forte de sept à huit mille hommes, appartenant en majeure partie aux milices communales. De là, grande variété dans l’armement : à côté des chevaliers, bardés de fer, armés de la lance, et des fantassins, munis d’arbalètes réglementaires, on voyait les gens des communes portant, qui une guisarme, qui une hache, qui une massue. La municipalité d’Orléans se montra généreuse ; non seulement elle mit à la disposition de l’armée ses pièces de canon avec leurs servants et sa grosse bombarde, attelée de vingt-deux chevaux, mais elle vota, en outre, un subside de trois mille livres pour les besoins de l’expédition.
Les capitaines tinrent conseil pour décider sur quel point il convenait de porter les premiers coups ; mais ils n’arrivaient pas à s’entendre ; les uns étaient d’avis qu’il fallait d’abord attaquer Jargeau, ville située sur la Loire, en amont d’Orléans, défendue par sept à huit cents Anglais, sous les ordres de Suffolk ; d’autres estimaient la place trop puissamment fortifiée et ses défenseurs trop nombreux pour qu’on eût chance de l’emporter de vive force. Dunois l’avait tenté un mois auparavant et il avait été repoussé. La Pucelle intervint alors :
— Ne vous laissez pas effrayer, — dit-elle, — par le nombre et ne faites pas difficulté d’assaillir les Anglais, parce que Dieu conduit notre entreprise. Si je n’étais pas certaine que Dieu conduit cette entreprise, je préférerais bien garder les brebis que de m’exposer à de si grands périls.
Son avis prévalut et la marche sur Jargeau fut décidée.
88Le samedi 12 juin, l’armée arriva, d’assez bonne heure, sous les murs de la place. Les Anglais firent une sortie et repoussèrent l’avant-garde ; mais ils furent, à leur tour, repoussés. Les nôtres occupèrent les faubourgs et s’y logèrent.
Il faut bien croire, — dit le duc d’Alençon, — que Dieu était avec nous ; car cette nuit-là, nos gens firent si mauvaise garde, que, si les Anglais fussent sortis de la ville, l’armée du roi eût couru un grand danger.
Le lendemain, de grand matin, pendant qu’on mettait en place les canons et les bombardes, Jeanne s’approcha des murs et cria à leurs défenseurs :
— Rendez la place au roi du Ciel et au gentil roi Charles et vous en allez ; autrement il vous arrivera malheur.
L’action ne tarda pas à s’engager ; les canons français bombardaient les murs et l’artillerie anglaise répondait vigoureusement. À un certain moment, Jeanne, qui avait l’œil à tout, vit une pièce ennemie pointée dans la direction du duc d’Alençon :
— Retirez-vous de cet endroit, — lui dit-elle vivement ; — sans quoi ; cette machine vous ôtera la vie.
Il s’écarta aussitôt et bien lui en prit ; car, peu de temps après, la machine tuait un gentilhomme, qui avait eu l’imprudence de se mettre à la même place. Quand le signal de l’assaut eut été donné, elle dit au jeune prince :
— En avant, gentil duc, à l’assaut.
Comme il montrait quelque hésitation, l’assaut ne lui paraissant pas suffisamment préparé :
— N’hésitez pas, — lui dit-elle ; — l’heure est propice, quand il plaît à Dieu ; agissez et Dieu agira.
Puis, elle ajouta gaiement :
— Ah ! gentil duc, as-tu peur ? Ne sais-tu pas que j’ai promis à ta femme de te ramener sain et saut ?
L’assaut dura quatre heures, avec un acharnement égal des deux côtés. À la fin, la Pucelle, son étendard à la main, se porta à l’endroit où le combat était le plus rude. Elle était en train d’escalader le mur, lorsqu’elle reçut sur la tête une grosse pierre qui la fit rouler par terre dans le fossé. Le coup aurait dû la tuer ; elle ne fut pas même blessée : la pierre, bien que très dure, s’était émiettée sur sa capeline. Elle se releva aussitôt, en criant de 89toutes ses forces :
— Amis, sus, sus, montez hardiment et entrez. Notre Sire a condamné les Anglais ; dès cette heure, ils sont à nous ; vous ne trouverez plus aucune résistance.
En effet, les Anglais lâchaient pied partout et s’enfuyaient vers le pont, poursuivis par les Français, qui en firent un grand carnage ; trois ou quatre cents furent tués et le reste pris. Suffolk, serré de près, fit tout à coup volte-face et dit au Français qui le pourchassait :
— Es-tu gentilhomme.
— Oui.
— Es-tu chevalier ?
— Non.
Alors, le comte le fit chevalier ; après quoi il se rendit à lui. Un de ses frères avait perdu la vie dans le combat et un autre était prisonnier.
Un chroniqueur du temps, le greffier de La Rochelle, raconte autrement la reddition de Suffolk. Celui-ci aurait déclaré qu’il préférerait mourir que de se rendre au duc d’Alençon ou à d’autres seigneurs ; puis, il aurait crié à haute voix :
— Je me rends à la Pucelle, qui est la plus vaillante femme du monde, qui doit nous subjuguer tous et nous mettre à confusion.
Et, de fait, il se serait rendu à elle. Cette version n’est ni vraie, ni vraisemblable. Le noble comte aurait sûrement préféré la mort à la honte de se rendre à une fille, qu’il avait traitée de ribaude et de vachère. Nous n’avons pourtant pas voulu la passer sous silence, parce que, toute fausse qu’elle est, elle montre en quelle estime l’opinion publique tenait notre héroïne.
Nul homme de guerre, à côté d’elle, — remarque le bourguignon Monstrelet, — ne faisait grand bruit, ni n’avait grande renommée.
Le soir même, le duc d’Alençon et la Pucelle reprirent le chemin d’Orléans, emmenant avec eux Suffolk et quelques prisonniers de marque. Le gros de l’armée ne quitta Jargeau que le lendemain matin. Le long de la route, une violente dispute s’éleva entre les soldats et les miliciens, à propos du partage des prisonniers. Les chefs n’étant pas là, la querelle ne tarda pas à dégénérer en une effroyable bagarre, au cours de laquelle la plupart des prisonniers furent massacrés ; des sept cents hommes, qui avaient composé la garnison de Jargeau, il n’en restait 90plus qu’une cinquantaine. La prise de la ville n’avait coûté aux Français qu’une vingtaine d’hommes tués.
§2. Prise de Beaugency
L’armée séjourna à peine deux jours à Orléans, pendant lesquels la compagnie de la Pucelle se grossit de nombreuses milices communales. Dans la soirée du mardi, elle fit appeler son beau duc et lui dit :
— Je veux demain aller voir ceux de Meung. Faites que la compagnie soit prête à partir à cette heure-ci.
La place de Meung, située sur la Loire, était au pouvoir des Anglais. Comme il était déjà tard quand les nôtres y arrivèrent, ils se contentèrent d’occuper le pont.
Ils repartirent le lendemain matin et arrivèrent à Beaugency vers midi. Talbot s’était retiré dans cette place, avec une partie des troupes qu’il commandait à Orléans. Le siège commença aussitôt. Les Anglais essayèrent en vain de disputer la ville aux Français ; ils en furent délogés et réduits à se renfermer dans le château.
Sur ces entrefaites, l’arrivée inopinée du connétable de Richemont, à la tête d’une troupe nombreuse, vint mettre les chefs de l’armée dans un cruel embarras. Assurément, le renfort qu’il amenait — quatre cents lances et huit cents archers — n’était pas à dédaigner. Mais Richemont était en état de révolte ouverte et le roi avait fait défense expresse à ses capitaines de le recevoir. En conséquence, le duc d’Alençon, voyant un certain nombre de seigneurs disposés à l’accueillir, déclara qu’il quitterait plutôt l’armée. La Pucelle intervint alors et réussit à l’apaiser.
De son côté, le connétable protestait de ses bonnes intentions et de la loyauté de ses sentiments ; comme il n’ignorait pas le grand crédit dont Jeanne jouissait auprès de Charles VII il la conjura de s’entremettre pour faire sa paix avec lui. Elle y consentit, à condition qu’il allait jurer, devant les seigneurs présents, de servir fidèlement le souverain et de ne rien dire ni faire qui pût lui déplaire. Elle exigea, en outre, que le duc d’Alençon et les autres seigneurs se portassent garants de sa fidélité, par un acte écrit et signé ; ce qui fut fait.
93Cependant les capitaines anglais, retirés dans le château, étaient en proie à une grande perplexité. Talbot, leur chef, les avait quittés, pour aller au devant de l’armée de secours, que Fastolf leur amenait. Ce renfort arriverait-il à temps ? En cas d’assaut, n’étaient-ils pas exposés à subir le même sort que leurs camarades, qui avaient succombé aux Tourelles et à Jargeau ? Éventualité d’autant plus à redouter que leurs soldats, démoralisés par la terreur que leur inspirait la Pucelle, n’aspiraient qu’à quitter les rives de la Loire, pour chercher un refuge en Normandie. Ces réflexions les amenèrent à négocier la reddition ne la place. Les pourparlers aboutirent à un accord, qui fut signé à minuit : les Anglais prenaient l’engagement de quitter le château et de ne pas reprendre les armes avant dix jours ; moyennant quoi, ils avaient la liberté de s’en aller, avec leurs chevaux et une partie de leurs biens. Ils se mirent en route, de grand matin, dans la direction de Paris.
§3. Victoire de Patay
Fastolf n’était pas loin ; on avait appris, la veille au soir, son arrivée à Meung. Cette nouvelle fit bondir de joie le cœur de Jeanne.
— Ah ! beau connétable, — dit-elle à Richemont, — vous n’êtes pas venu de par moi ; mais, puisque vous êtes venu, soyez le bienvenu.
C’est qu’elle se rendait compte de l’opportunité du renfort, qu’il avait amené. En effet, si l’armée française avait la supériorité du nombre, elle comptait beaucoup moins de soldats exercés et bien armés que la troupe de Fastolf, forte de quatre à cinq mille hommes de guerre. Le duc d’Alençon ayant demandé à Jeanne ce qu’il y avait à faire :
— En nom Dieu, répondit-elle, il les faut combattre ; s’ils étaient pendus aux nues, nous les aurons, parce que Dieu nous les envoie pour leur châtiment. Le gentil roi aura aujourd’hui la plus belle victoire qu’il ait jamais eue.
Elle ajouta d’une voix perçante :
— Ayez de bons, éperons.
À ces mots, les assistants se récrient : Que dites-vous, Jeanne ; c’est donc nous qui tournerons le dos ?
— Non, reprit-elle, ce seront les Anglais, qui ne se défendront pas et se débanderont. Les éperons vous seront nécessaires pour les poursuivre.
94Les capitaines français, persuadés qu’ils allaient être attaqués, prirent leurs dispositions en conséquence ; mais l’ennemi ne parut pas. En apprenant la reddition de Beaugency, Fastolf avait repris le chemin de Paris. Il était déjà près de Patay, lorsque des éclaireurs, envoyés à sa recherche, firent lever un cerf, qui, étant allé se jeter dans la colonne anglaise, y provoqua une grande clameur. Ces cris dénoncèrent la présence de l’ennemi, que des bois dérobaient à la vue. Les Français accourent aussitôt. Les Anglais, surpris par cette brusque attaque et n’ayant pas le temps de prendre leurs dispositions habituelles de combat, n’opposent presque aucune résistance et s’enfuient en désordre. On en fit un affreux carnage : deux mille tués, deux cents prisonniers, parmi lesquels Talbot, tel fut le chiffre de leurs pertes.
Fastolf aurait sans doute éprouvé le même sort, s’il n’avait cherché son salut dans une fuite précipitée. Les fuyards se portèrent en masse vers Janville, où ils avaient un grand dépôt d’armes, de vivres et d’approvisionnements de toute sorte. Mais les habitants avaient fermé les portes et ils durent passer outre. Fastolf ne s’arrêta qu’à Corbeil. Chose à peine croyable ! Cette insigne victoire ne coûta la vie qu’à un seul Français !
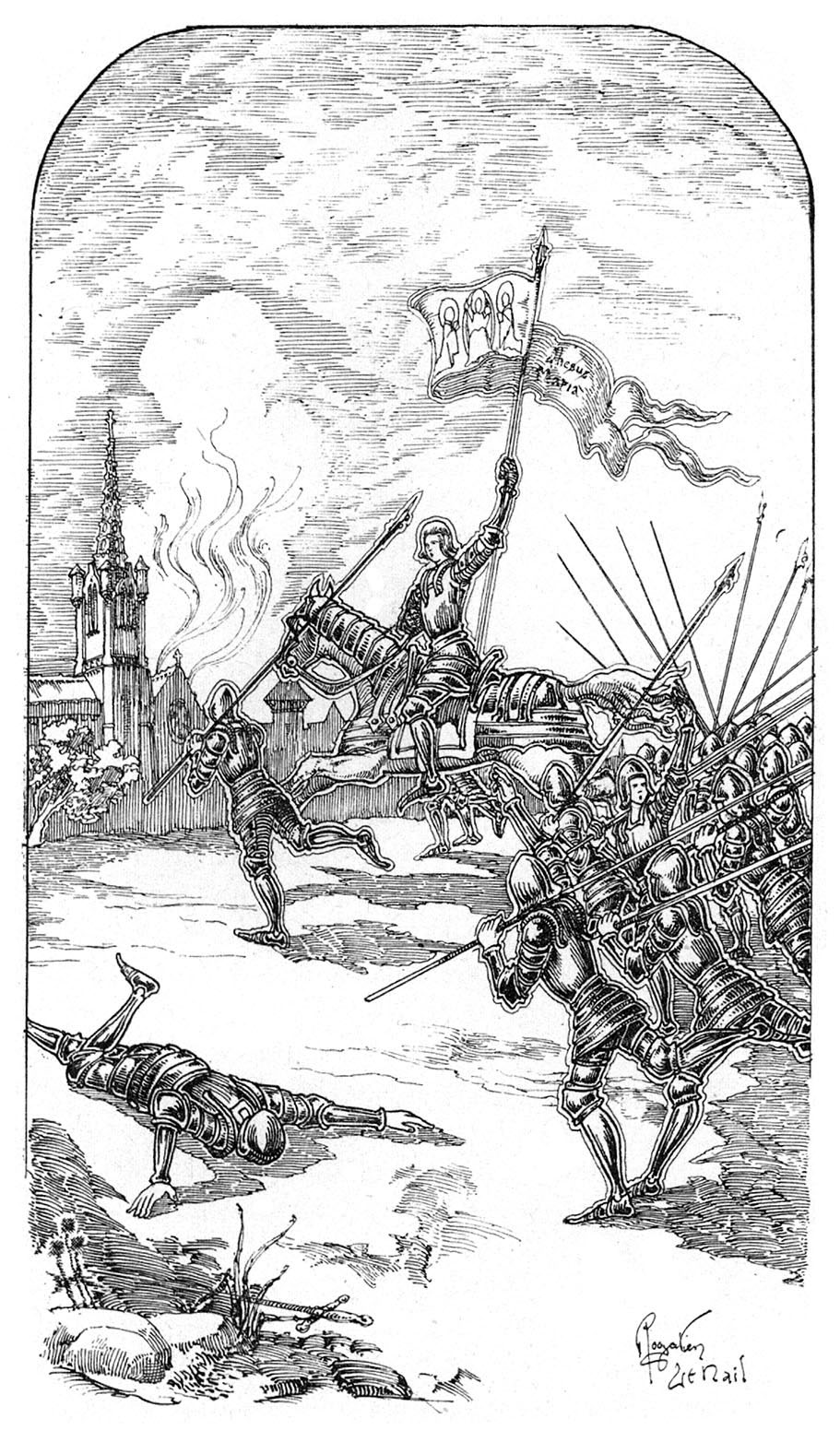
En résumé, quatre places de guerre, Jargeau, Beaugency, Meung et Janville, reconquises et l’armée ennemie anéantie, en une campagne de sept jours.
Voilà, — dirons-nous après l’illustre général Dragomirov, — qui n’eût-pas déparé la gloire de Napoléon lui-même.
Cette semaine de victoires acheva de consacrer la renommée de la Pucelle : amis et ennemis, tous s’accordent à lui en attribuer le principal mérite.
Ma persuasion, — dit Dunois, — est que ces succès furent obtenus grâce à la Pucelle.
Sans elle, — ajoute Perceval de Cagny, — jamais si grandes merveilles n’auraient été accomplies.
C’était bien aussi le sentiment des Anglo-Bourguignons.
Jeanne la Pucelle, — dit Monstrelet, — acquit en ces besognes si grande louange et si grande renommée qu’il semblait à toutes gens que les ennemis du roi n’eussent plus puissance de lui résister.
Wavrin de Forestel, 95attaché à la personne de Fastolf, qu’il avait accompagné dans sa fuite, tient le même langage. Il constate que,
par la renommée de Jeanne la Pucelle, les courages anglais étaient fort altérés et défaillis.
Elle rentra à Orléans le dimanche, 19 juin, et y fut reçue avec de grandes démonstrations de joie. La foule la suivit à l’église, où
de solennelles actions de grâces furent rendues à Dieu, à la Vierge Marie et à tous les benoîts saints et saintes du paradis.
Les Orléanais, croyant que le roi allait venir prendre dans leur ville ses dernières dispositions pour la campagne du Sacre, se mirent en frais pour décorer et pavoiser les rues et les places. Mais il ne jugea pas à propos de se déranger ; ce dont ils furent fort mécontents.
Le lendemain les chefs de l’armée se rendirent à Sully, où il résidait. Son accueil fut naturellement des plus chaleureux.
Jeanne, s’autorisant des bonnes dispositions du prince, lui demanda la grâce du connétable de Richemont. Après les éclatants services qu’elle venait de lui rendre, il ne pouvait guère rejeter sa requête, appuyée d’ailleurs par les seigneurs, qui se portaient caution de la fidélité du connétable. Il consentit donc, à contre-cœur, à lui pardonner ses torts passés, mais déclara qu’il ne voulait pas l’avoir avec lui dans la campagne qu’on allait entreprendre. Cette exclusion brutale mécontenta vivement la Pucelle et les capitaines ; mais personne n’osa rien dire, parce qu’on y voyait la main du tout-puissant favori, La Trémoille. La demande que Jeanne venait de faire, en faveur d’un adversaire détesté, l’avait blessé au vif. Déjà fort mal disposé à l’égard de la jeune fille, il n’oubliera pas ce nouveau grief et travaillera à s’en venger. Elle venait, sans s’en douter, de se faire un ennemi irréconciliable dans la personne de cet homme, qui disposait de la volonté du roi.
Jeanne rentra à Orléans, et c’est vraisemblablement alors qu’elle reçut un message du duc de Bretagne. Ce prince, qui avait gardé jusque-là une neutralité cauteleuse, lui envoyait son 96confesseur pour s’assurer si elle venait de Dieu.
— Votre maître, — lui dit-elle, — n’aurait pas dû attendre si longtemps, pour envoyer ses gens au service du roi, son droiturier seigneur.
L’envoyé répondit que le duc ne pouvait venir lui-même, à cause de ses infirmités, mais qu’il enverrait son fils, avec de grandes forces. Belles promesses, qui ne furent pas tenues. Jeanne reçut pourtant, de sa part, une dague et des chevaux.
97Chapitre V Campagne du Sacre
§1. La Pucelle à Gien
Le vendredi 24 juin, de grand matin, la Pucelle dit au duc d’Alençon :
— Faites sonner les trompilles et montez à cheval. Il est temps d’aller vers le gentil roi Charles, pour le mettre au chemin de son Sacre à Reims.
Ainsi fut fait ; les troupes quittèrent Orléans et prirent la route de Gien, où elles arrivèrent le même jour.
Le lendemain, Jeanne adressa une lettre aux gentils loyaux Français de la ville de Tournay10. Ils méritaient cette attention ; 98car ils montraient une fidélité inébranlable à la cause royale, quoiqu’ils fussent séparés de la France par cent lieues de pays ennemi. Elle leur fait part d’abord des succès qu’elle vient de remporter :
En VIII jours, elle a chassé les Anglais de toutes les places qu’ils tenaient sur la rivière de Loire, par assaut ou autrement et elle les a déconfits en bataille.
Ce début appelle une observation : car il peut paraître étrange que l’humble vierge s’attribue, et attribue à elle seule, les succès obtenus. En dictant cette phrase, aurait-elle cédé inconsciemment à un accès de vaine gloire ? Non, certes. Son langage n’est ici que le reflet de la foi absolue qu’elle avait en sa mission. À ses yeux, Dieu avait tout fait et il avait tout fait par elle, son envoyée. Avant même de quitter Vaucouleurs, n’avait-elle pas proféré cette affirmation, plus étrange encore : Il n’y a de secours à espérer que de moi ?
Parmi les noms de plusieurs prisonniers de marque, cités dans la lettre, figure à tort celui de Fastolf. Cette erreur, qui provenait de rapports qu’on n’avait pas suffisamment contrôlés, se retrouve dans des lettres du roi et de Perceval de Boulainvilliers, son chambellan, écrites à la même date.
La lettre continue par des exhortations patriotiques :
Maintenez-vous bien loyaux Français… soyez tout prêts de venir au Sacre, à Reims, où nous serons brièvement… Que Dieu vous donne grâce pour que vous puissiez maintenir la bonne querelle du royaume de France.
Cette bonne querelle prenait d’ailleurs une allure nettement favorable. Les recrues affluaient à Gien ; il en arrivait de toutes parts, non seulement de France, mais encore des pays étrangers. Attirés par la renommée de la Pucelle, impatients de faire campagne sous ses ordres, ils se déclaraient prêts à la suivre partout où elle voudrait les mener. Les gentilshommes avaient répondu à l’appel du roi ; plusieurs d’entre eux, trop pauvres pour s’équiper d’une manière conforme à leur rang, étaient venus, montés sur de maigres bidets et armés seulement d’arcs et de courtes 101épées. Mais la masse des volontaires se composait surtout de menu peuple, artisans des villes, manants des campagnes, tous justement fiers de seconder l’héroïne qui jetait tant de gloire sur leur humble condition.
Au lieu de se réjouir de cet élan, présage de nouvelles victoires, le tout-puissant ministre La Trémoille en prit ombrage. Se sachant haï et méprisé, il se demandait avec inquiétude ce que pèserait désormais son autorité, en face de Jeanne devenue l’idole de l’armée ; il manifestait même des craintes pour sa sûreté personnelle. D’ailleurs, il n’entrait pas dans ses plans de conquérir le royaume de vive force, parce qu’il trouvait plutôt son intérêt à négocier qu’à combattre.
On disait, — rapporte Jean Chartier, historiographe de Charles VII, — que s’il avait voulu recevoir tous ceux qui se présentaient au service du roi, on eût pu facilement recouvrer tout ce que les Anglais occupaient au royaume de France. Mais personne n’osait se déclarer contre le tout-puissant ministre, quoique tout le monde vît clairement que de lui venait la faute.
Le fait suivant, relevé par un témoin oculaire, laisserait supposer que l’astucieux ministre avait réussi à mettre le roi en défiance contre la Pucelle. Dans le temps où elle le pressait de hâter l’expédition, Charles VII, s’apitoyant sur les fatigues qu’elle avait endurées, l’engageait à prendre un peu de repos. L’intérêt, qu’il lui témoignait sous cette forme, en un pareil moment, la blessa au vif et lui arracha des larmes ; d’une voix entrecoupée de sanglots, elle lui rappela qu’elle avait mission de lui faire recouvrer son royaume et qu’il serait bientôt couronné, s’il le voulait.
Cependant, les esprits étaient partagés dans le conseil royal ; les uns opinaient pour qu’on allât relancer l’ennemi en Normandie ; d’autres auraient voulu qu’on le chassât d’abord des quelques places qu’il avait encore sur la Loire. Jeanne, au contraire, insistait énergiquement pour qu’on marchât tout de suite sur Reims, parce que, disait-elle,
une fois le roi couronné et sacré, 102la force de ses ennemis ira toujours en baissant, et finalement ils seront réduits à l’impuissance.
À ceux qui lui objectaient que tout le pays compris entre Gien et Reims était au pouvoir de l’ennemi, que les villes, les châteaux et les ponts, par où il faudrait passer, étaient gardés par des garnisons anglaises ou bourguignonnes, elle répondait qu’elle n’en avait cure et répétait avec assurance :
— Je mènerai sûrement le roi et sa compagnie et il sera couronné à Reims.
À la fin, mécontente de voir qu’on perdait un temps précieux en délibérations stériles, elle quitta Gien et s’en alla camper aux champs, avec ses gens. Le roi la rejoignit deux jours après (29 juin).
L’armée, qui conduisait le roi à Reims, était forte d’environ douze mille hommes ; elle comptait nombre de grands seigneurs, les ducs d’Alençon et de Bourbon, le comte de Vendôme, les sires d’Albret, de Laval, de Retz, sans parler de l’indispensable La Trémoille, flanqué du chancelier ; d’illustres capitaines, Dunois, La Hire, Xaintrailles, etc., en faisaient aussi partie. Tous, chefs et soldats, rivalisaient d’entrain, quoique la paie de ces derniers fût bien maigre ; chaque homme avait reçu, avant le départ, la modique somme de trois francs, pour subvenir, en cours de route, à tous ses besoins, y compris la nourriture.
§2. L’armée devant Auxerre
Le 1er juillet, on arriva devant Auxerre, dont les portes étaient fermées. La Pucelle et les capitaines voulaient donner l’assaut. La Trémoille s’y opposa, jugeant préférable d’engager des négociations avec les bourgeois. Elles réussirent, à son gré et au leur : moyennant deux mille écus, versés secrètement entre ses mains, il avait pris l’engagement de ne pas laisser l’armée entrer dans la ville. Les soldats eurent moins de chance ; car ils durent payer fort cher les vivres que les habitants leur fournirent, durant les trois jours qu’ils passèrent devant la place.
La Pucelle et les autres chefs ignoraient l’infâme marché ; mais ils n’en étaient pas moins indignés de laisser derrière eux, 103sans coup férir, une ville rebelle et leur patriotisme s’alarmait, à bon droit, des conséquences que pouvait entraîner cet acte de lâcheté ; le succès de l’expédition ne risquait-il pas d’en être compromis ? Les autres villes de la Champagne, y compris Reims, n’allaient-elles pas s’autoriser de cet exemple pour fermer aussi leurs portes ? Chefs et soldats étaient fort mécontents d’un pareil début.
§3. Jeanne devant Troyes
Le 4 juillet, l’armée prit le chemin de Troyes. Le roi s’y fit précéder par une lettre : il sommait les habitants de le recevoir comme leur légitime souverain, promettant d’oublier leurs torts passés, s’ils se comportaient envers lui comme ils le devaient. Jeanne leur en envoya une autre11. Elle leur
mande et fait savoir, de par le roi du Ciel, au service royal duquel elle est un chacun jour, qu’ils fassent vraie obéissance et reconnaissance au gentil roi de France, qui sera bientôt à Reims et en ses bonnes 104villes du saint royaume, avec l’aide du roi Jésus, et y fera bonne paix ferme, quels que soient les opposants.
Ni la prose onctueuse de la chancellerie royale, ni le style un peu fruste mais nerveux de la Pucelle ne réussirent à faire rentrer les Troyens dans le devoir. Ils expédièrent le jour même aux habitants de Reims une copie des deux lettres, les informant en même temps qu’ils étaient bien décidés à se maintenir, eux et leur ville, dans l’obéissance du roi d’Angleterre et du duc de Bourgogne et cela jusqu’à la mort ; qu’ils l’avaient tous juré sur le précieux corps de Notre-Seigneur. En conséquence, ils les priaient, comme frères et loyaux amis, d’avoir pitié d’eux et de leur procurer des secours. Ils affichaient, dans leur lettre, le plus profond mépris pour la Pucelle,
une coquarde [Fauquembergues], une folle pleine du diable ; sa lettre n’a ni rime ni raison, et n’est que moquerie [Jean Rogier].
Ils ne lui feront pas l’honneur d’une réponse. Celle qu’ils adressèrent à Charles VII était un refus d’obéissance, poli mais absolu, fondé sur deux motifs : leur serment d’abord, qu’ils ne veulent pas violer ; puis, l’impuissance où ils seraient de lui donner satisfaction, quand même ils le voudraient, la garnison étant plus forte que les habitants.
Cette fois, on n’avait d’autre alternative que de réduire la ville rebelle ou d’abandonner la marche vers Reims et de se retirer sur la Loire. La situation était donc extrêmement critique : d’une part, le siège menaçait d’être long et risquait même d’échouer ; car la ville était abondamment approvisionnée, ses fossés profonds, ses murailles solides, et on manquait de grosse artillerie pour y pratiquer des brèches ; d’autre part, la famine se faisait déjà sentir dans le camp français ; nombre de soldats n’avaient pas eu de pain à manger depuis plusieurs jours ; la plupart en étaient réduits à se nourrir de grains de blé, à moitié mûrs, et de fèves qu’ils allaient ramasser dans les champs.
Dieu réservait à la Pucelle l’honneur de tirer l’armée de cette situation embarrassante.
105Il y avait alors à Troyes un religieux cordelier, Frère Richard, dont les prédications avaient eu naguère un immense succès à Paris ; sa parole enflammée, ses airs de prophète attiraient de grandes foules au pied de sa chaire. En revanche, les autorités, tant civiles que religieuses, voyaient d’un très mauvais œil les hardiesses et les excentricités de ses discours. Obligé de s’enfuir de Paris, il était venu chercher un refuge en Champagne. Ce personnage, d’allure suspecte, âme ardente et tête folle, avait des doutes sur le compte de la Pucelle ; elle passait à Paris pour être l’agent du démon, et il n’était pas éloigné de le croire. Pour savoir à quoi s’en tenir, il se hasarda à lui faire visite, non sans prendre ses précautions. Il s’était muni d’eau bénite et, quand il fut à distance convenable, il se mit à l’en asperger. Jeanne lui dit en riant :
— Approchez, je ne m’envolerai pas.
Après avoir conversé quelque temps avec elle, il s’en retourna, convaincu qu’elle était vraiment envoyée de Dieu, et il ne manqua pas de propager cette nouvelle.
Cependant, le siège durait depuis plusieurs jours, sans résultat appréciable. Alors, les chefs de l’armée, réunis en conseil de guerre, sous la présidence du roi, se disposaient à décider la retraite, lorsque Robert le Maçon, seigneur de Trèves, homme sage et prudent, fit observer
qu’il serait bon, avant de prendre une décision si grave, d’avoir l’avis de la Pucelle, d’autant plus que le roi avait entrepris cette campagne sur ses instances, après l’assurance, donnée par elle, qu’il ne rencontrerait que peu de résistance et que d’ailleurs telle était la volonté de Dieu.
On délibérait sur cette motion, lorsque Jeanne entra dans la salle, sans être appelée. Quand elle eut fait sa révérence au roi, l’archevêque de Reims lui exposa l’embarras où l’on se trouvait, lui rendit compte des opinions émises et lui demanda la sienne :
— Me croirez-vous, dit-elle en se tournant vers le roi.
— Oui, selon ce que vous direz.
— Gentil roi de France, cette cité est vôtre ; si vous voulez demeurer devant ses murs deux ou trois jours, elle sera en votre obéissance, par amour ou par force, et la 106fausse Bourgogne n’en sera pas peu stupéfaite ; n’en faites aucun doute.
L’archevêque-chancelier répliqua qu’on attendrait bien si l’on était sûr de l’avoir en quatre ou cinq jours. Jeanne réitéra son affirmation ; sur quoi, il fut résolu qu’on attendrait.
Elle, sans perdre une minute, aussitôt sortie du conseil, monte à cheval, un bâton à la main, met en mouvement chevaliers, écuyers, archers, manœuvres de tous métiers, fait apporter fagots pour combler les fossés, portes, tables, fenêtres, chevrons, pour construire des abris, met en position une petite bombarde et quelques canons.
Elle fit, — dit Dunois, — de si merveilleuses diligences que deux et trois hommes d’armes des plus expérimentés et des plus fameux n’auraient pas pu les égaler.
Ces préparatifs d’un assaut prochain, qui se poursuivirent toute la nuit, donnèrent à réfléchir aux bons bourgeois. D’ailleurs, Frère Richard, qui avait de l’influence, ne leur avait pas laissé ignorer qu’il croyait la Pucelle réellement envoyée de Dieu ; d’un autre côté la rumeur publique leur avait appris ses merveilleux exploits à Orléans, à Jargeau, à Patay. Si la ville était prise de force, n’avaient-ils pas tout à craindre pour leurs biens, peut-être même pour leurs vies ? Ces réflexions les amenèrent à oublier leur fameux serment. D’accord avec la garnison anglo-bourguignonne, ils se résolurent à traiter.
Le lendemain, l’évêque Jean Laiguisé et les principaux bourgeois, tremblants et frissonnants, vinrent rendre obéissance au roi.
On constata dans la suite, — déclare Dunois, — que, dès le moment où la Pucelle donnait au roi le conseil de ne pas s’éloigner, les habitants avaient perdu tout courage et n’avaient plus songé qu’à chercher un refuge dans les églises.
Le traité fut rapidement conclu ; le roi accordait une amnistie générale aux habitants et les Anglo-Bourguignons étaient autorisés à se retirer librement, avec ce qu’ils possédaient.
Au moment où ils sortaient de la ville, la Pucelle, qui se tenait à la porte, fut saisie d’une généreuse indignation, en les 107voyant emmener avec eux leurs prisonniers français ; elle voulut s’y opposer. Mais, comme ils étaient dans leur droit, aux termes du traité, le roi termina le différend en payant les rançons ; de cette façon tout le monde fut content.
Aucun obstacle n’allait plus désormais retarder la marche vers Reims. Le roi était encore à Troyes, lorsque des députés vinrent lui présenter les clefs de la ville de Châlons, avec promesse d’humble obéissance. À Châlons, il reçut une députation de la ville de Reims, où l’on se préparait à l’accueillir comme le Seigneur légitime de la cité. De Châlons, il alla coucher à Sept-Saulx, dans un château appartenant à l’archevêché, et le lendemain, dans la soirée, il faisait son entrée dans la ville, ayant la Pucelle à ses côtés.
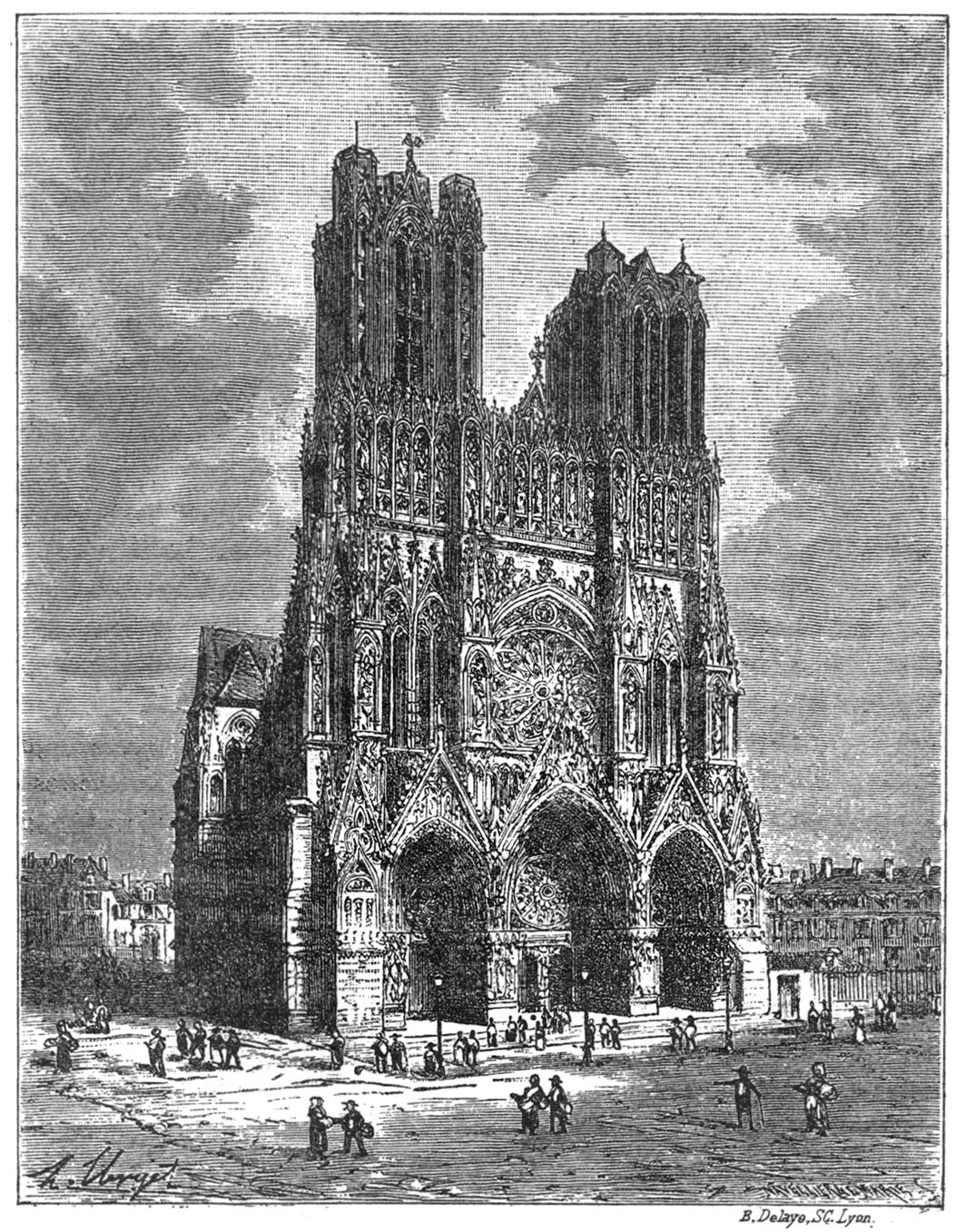
§4. À Reims, le sacre
La cérémonie du Sacre eut lieu le jour suivant (dimanche, 17 juillet). Elle se fit avec grand apparat, malgré l’absence de la plupart des pairs qui auraient dû y figurer ; des six pairs ecclésiastiques, les seuls présents étaient l’archevêque de Reims et l’évêque de Châlons ; les évêques de Séez, d’Orléans, de Laon et de Troyes remplacèrent les absents. Le duc d’Alençon, les comtes de Clermont et de Vendôme, les deux seigneurs de Laval et le sire de La Trémoille remplirent les fonctions de pairs laïques. Tous étaient vêtus d’habits somptueux.
Dès trois heures du matin, le roi vint à la basilique, y resta longtemps en prière, puis se fit armer chevalier par le duc d’Alençon. Un peu après, quatre gentilshommes, armés de pied en cap et portant chacun sa bannière, se rendirent à l’abbaye de Saint-Remi, pour en escorter l’abbé, auquel revenait l’honneur d’apporter la sainte ampoule. Ils entrèrent, avec lui, à cheval, dans la basilique, et le cortège s’avança ainsi jusqu’à la grille du chœur.

À neuf heures, les portes de l’église s’ouvrirent ; le peuple s’y précipita et les immenses nefs se remplirent aussitôt d’une foule joyeuse. La cérémonie se déroula avec une majestueuse lenteur jusqu’à trois heures du soir, au milieu d’un enthousiasme 108indescriptible. Au moment où l’archevêque posait la couronne sur la tête du roi, les cris, de Noël, Noël, éclatèrent avec tant de force qu’il semblait que les voûtes de l’édifice allaient s’effondrer.
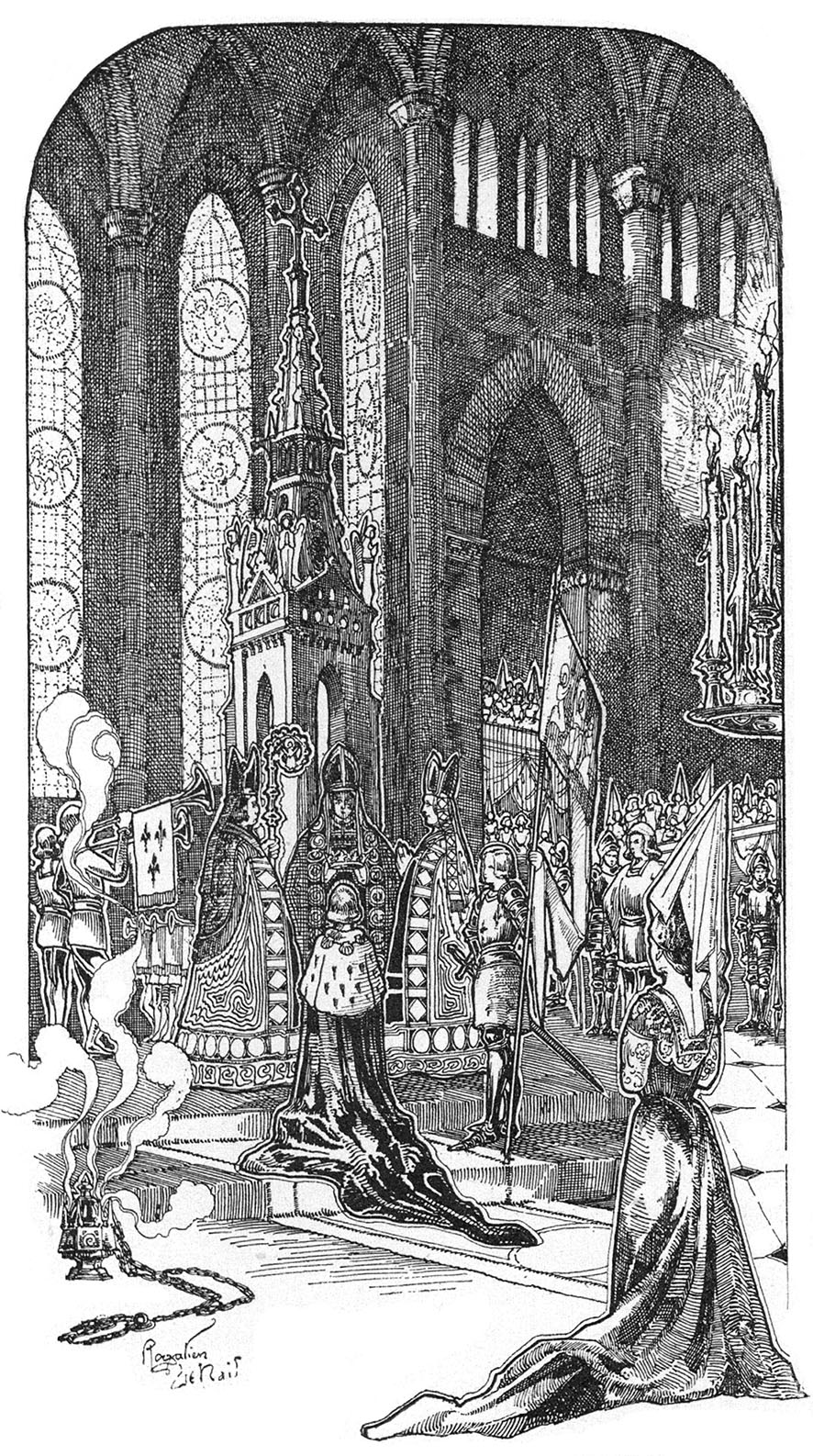
Durant toute la cérémonie, la Pucelle se tint près du roi, son étendard à la main. Quand tout fut terminé, elle se jeta à genoux devant le monarque, qu’elle venait de faire couronner, lui baisa humblement les pieds, puis, embrassant ses jambes, lui dit en versant de grosses larmes :
— Gentil roi, maintenant est exécuté le Plaisir de Dieu, qui voulait que vinssiez à Reims recevoir votre digne Sacre, en montrant que vous êtes le vrai roi et celui auquel le royaume doit appartenir.
En voyant ainsi heureusement accomplie cette importante partie de sa mission, son cœur déborde de joie, au souvenir des bontés de Dieu, qui l’a conduite, comme par la main, jusqu’à ce grand jour, à travers tant de contradictions, et son émotion s’épanche en larmes de bonheur.

Elle eut aussi, ce jour-là, la joie de revoir et d’embrasser son père. Il était venu assister au Sacre, en compagnie de l’oncle Laxart, et fut témoin des honneurs rendus à sa fille. Lorsqu’il la vit aux côtés du roi, vêtue d’habits éclatants, traitée avec distinction par les plus grands seigneurs, admirée de tout le peuple, se rappelait-il que, quelques mois auparavant, il aurait voulu la noyer, pour l’empêcher d’aller avec les hommes d’armes ? Quoi qu’il en soit, il ne paraît pas s’être ennuyé à Reims ; car il y prolongea son séjour durant plus de six semaines. Quand il partit, la ville paya vingt-quatre livres parisis pour ses dépenses à l’hôtel de l’Âne rayé et lui fit cadeau d’un cheval. Le roi lui avait fait remettre soixante livres tournois par les mains de sa fille.
Jeanne n’a jamais rien demandé, ni pour elle, ni pour les siens ; mais son bon cœur la porta à intercéder en faveur de ses compatriotes de Domrémy et de Greux, comme en témoigne l’extrait suivant des lettres patentes, envoyées par le roi (31 juillet) au bailli de Chaumont :
Savoir vous faisons que, en faveur et à la 109requête de notre bien-aimée Jehanne la Pucelle et pour les grands, notables et profitables services, qu’elle nous a faits et fait chaque jour au recouvrement de notre seigneurie, Nous avons octroyé et octroyons, de grâce spéciale, par ces présentes, aux manants et habitants de Greux et de Domrémy, dont la dite Jehanne est native, qu’ils soient dorénavant quittes et exempts de toutes tailles, aides, subsides et subventions, mises et à mettre au dit bailliage.
§5. La Pucelle glorifiée
Le couronnement de Charles VII marque une des dates principales de la vie de Jeanne d’Arc ; elle est alors à l’apogée, de sa gloire. Trois mois se sont à peine écoulés depuis qu’elle est entrée en campagne et ce court espace de temps lui a suffi pour délivrer Orléans, chasser les Anglais des bords de la Loire et conduire le roi à Reims, à travers un pays hostile. Elle a constamment marché de succès en succès, sans éprouver le plus léger revers. Aussi, son nom est dans toutes les bouches, son amour dans tous les cœurs vraiment français. Sa renommée a franchi les frontières du royaume ; on exalte ses exploits en Italie, en Allemagne, dans les Pays-Bas.
Le secrétaire de Charles VII, Alain Chartier, n’était que l’interprète du sentiment public, quand, au lendemain du Sacre, il écrivait à un prince italien :
Elle ne semble pas venir de la terre, mais être descendue du ciel, pour soutenir, de la tête et des épaules, la France croulante. C’est elle qui a ramené au port et au rivage le roi perdu dans un immense océan, ballotté par les vents et les tempêtes. En abattant l’insolence anglaise, elle a rendu sa hardiesse au courage français, arrêté la ruine de la France, éteint l’incendie, qui dévorait le royaume. Ô Vierge sans pareille, digne de toute gloire et de toute louange, digne des honneurs divins ! Vous êtes la splendeur du royaume, l’éclat du lis, la lumière et la gloire, non pas seulement de la France, mais de la chrétienté entière.
La célèbre Christine de Pisan, qu’on appelait la sœur des Muses, sortant de la retraite où l’avaient confinée les malheurs 110de la France, composa un long poème en l’honneur de la Pucelle, lorsque
L’an mil quatre cent vingt-neuf,
Le soleil se reprit à luire.
Après avoir chanté le miracle du relèvement de la France et de l’état royal, elle adresse ses félicitations au roi :
Et toi, Charles, vois ton renom
Haut élevé par la Pucelle,
Qui a soumis sous ton pennon
Tes ennemis. Chose est nouvelle !
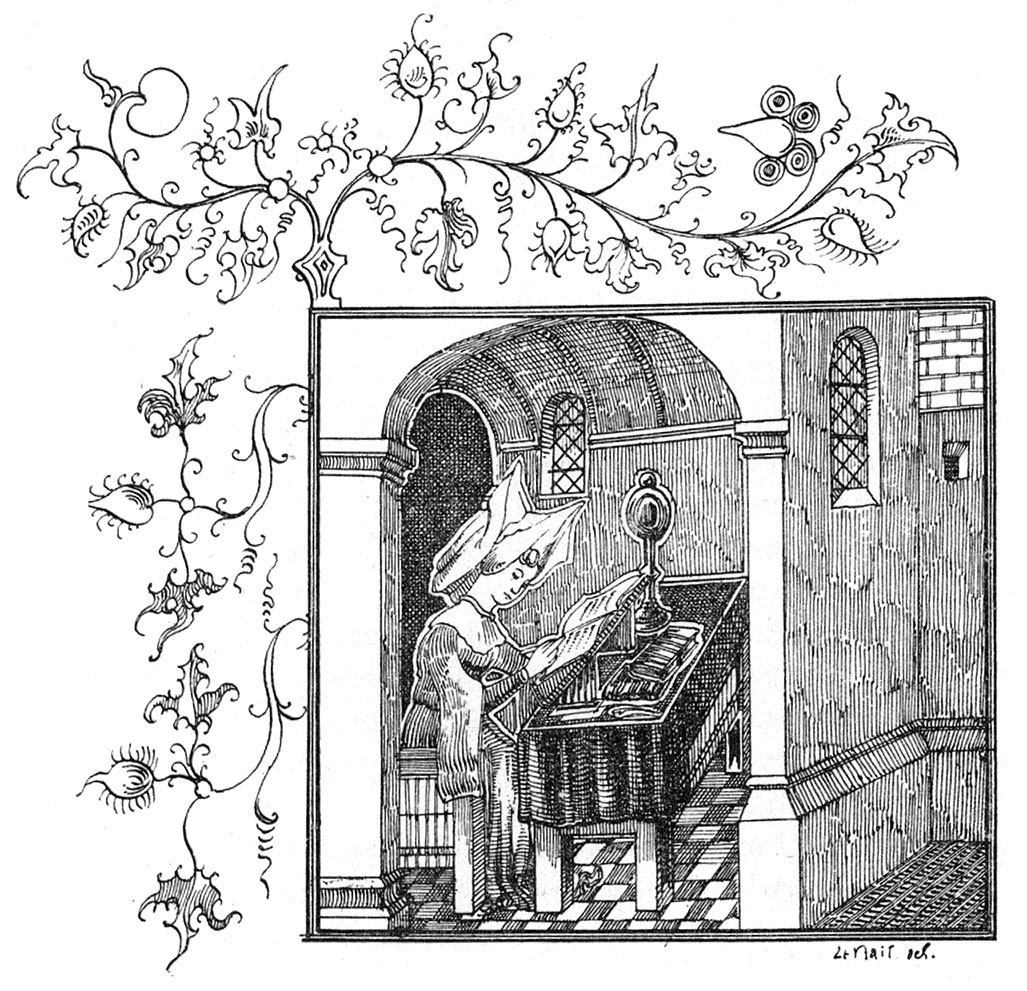
À la même époque, un noble vénitien écrivait de Bruges :
Qu’une fillette ait conquis tant de pays en quelques mois, c’est un signe que Dieu agit.
Et, dans une autre lettre :
On attribue toutes ces conquêtes à la Pucelle, ainsi que mille autres merveilles. Voilà, de nos jours, de grands prodiges.
Grands prodiges ! en effet, et on était fondé à en espérer d’autres encore. Car la mission de Jeanne n’était pas terminée. Dès sa première entrevue avec le roi, la jeune paysanne lui avait déclaré qu’elle était envoyée, non seulement pour délivrer Orléans et conduire le dauphin à Reims, mais aussi pour chasser les Anglais du royaume et rendre la liberté au duc d’Orléans. Sous les murs de Troyes, elle répétait au prince indolent que, s’il voulait aller virilement de l’avant, elle lui ferait recouvrer tout son royaume. Enfin, à Reims, après le Sacre, elle lui promettait à nouveau de le faire entrer dans Paris. Après avoir mené à bien la première partie de sa tâche, elle ne demandait donc qu’à remplir la seconde et elle y aurait sûrement réussi si le roi et ses ministres, au lieu de seconder ses entreprises, n’avaient pas travaillé, sous main, à les faire échouer.
§6. La Pucelle en disgrâce
À partir de la délivrance d’Orléans, jusqu’au Sacre, Jeanne a toujours fini par avoir raison des oppositions et elle a fait prévaloir sa volonté dans le conseil royal. Mais, cette dernière 111campagne, qui vient de se terminer avec tant d’éclat, ferme la série de ses, grands triomphes. Si Dieu lui ménage encore quelques menus succès, elle n’en verra pas moins ses desseins entravés et elle-même mise peu à peu de côté. Les services qu’elle a rendus, la gloire qu’elle s’est acquise, offusquent trop l’orgueil de certains personnages haut placés ; ils ne lui pardonneront jamais de les avoir relégués au second plan.
Elle avait, — remarque un contemporain, — l’honneur de tout ce qui se faisait ; ce dont 112quelques seigneurs et capitaines conçurent grande haine et envie contre elle.
Parmi ces seigneurs haineux, il faut mettre, en première ligne, les deux plus puissants personnages du royaume, le sire de La Trémoille et son bras droit, l’archevêque-chancelier, Regnault de Chartres. Nous avons vu précédemment qu’ils ne s’étaient résignés à mettre Jeanne à l’essai que parce qu’ils voyaient la situation désespérée. Mais, une fois le roi couronné et l’état consolidé par ses victoires, ils jugèrent le moment venu de la tenir à l’écart ; sans rien brusquer toutefois, pour ne pas trop mécontenter le peuple et l’armée, dont elle était l’idole. Désormais, tout en la traitant extérieurement avec les mêmes égards on ne tiendra pas compte de sa volonté, on lui cachera les résolutions prises en conseil, on s’arrangera même de façon à lui ménager des échecs, en vue de nuire à sa réputation.
Tel paraît bien avoir été le complot machiné contre elle par La Trémoille et Regnault de Chartres, avec la connivence, avouée ou secrète, de certains capitaines, jaloux de sa gloire. Pendant qu’elle combattra vaillamment, ces politiques dénués de scrupules se livreront à de louches négociations et concluront avec l’ennemi des trêves désastreuses, dont le résultat le plus clair sera de la réduire à l’impuissance.
Voilà pourquoi la Pucelle, malgré son héroïque dévouement, ne put mener à bien la dernière partie de sa tâche. Pour expliquer les échecs, qui vont marquer la fin de sa carrière, quelques-uns ont prétendu que sa mission se bornait à délivrer Orléans et à faire sacrer le roi. Cette opinion ne peut se soutenir ; elle est démentie et par les déclarations précédentes et par la conduite subséquente de Jeanne. Après le Sacre, comme avant, elle fera campagne pour bouter les Anglais hors de France, et, plus tard, elle dira à ses juges :
— Je n’ai rien fait que par ordre de Dieu.
Elle regardait si peu sa mission comme terminée, que, prisonnière, elle conservera, jusqu’à la fin, l’espérance d’être délivrée et de reprendre son service auprès du roi.
113L’opinion contraire s’appuie sur cette déclaration de Dunois :
Quand elle (Jeanne) parlait sérieusement de son fait, de sa mission, elle affirmait seulement ceci : Qu’elle était envoyée pour faire lever le siège d’Orléans, secourir le malheureux peuple de cette ville et des pays circonvoisins, et conduire le roi à Reims pour y être sacré.
Le vaillant capitaine, qui rendit d’ailleurs pleine justice à l’héroïne, laisse donc supposer que sa mission se terminait à Reims. Ainsi le voulait sans doute l’esprit qui dominait à la cour, lors du procès de réhabilitation. Évidemment ceux dont les intrigues avaient paralysé l’action de la Pucelle, ne pouvaient pas avouer qu’ils s’étaient opposés à l’envoyée de Dieu ; ils avaient donc tout intérêt à faire croire que, sa mission divine ayant produit tout ce qu’on était en droit d’en attendre, son autorité avait dû cesser par le fait même.
§7. Sa lettre au duc de Bourgogne
Le jour même du Sacre, Jeanne adressa au duc de Bourgogne une lettre12, dans laquelle, sous l’écorce rugueuse d’un style 114un peu fruste, on sent palpiter un grand cœur, tout plein d’un amour religieux pour le saint royaume de France et d’une confiance inébranlable dans le succès final : quel que soit le nombre des ennemis,
ils n’y gagneront rien, [parce que] tous ceux qui font la guerre au dit saint royaume, font la guerre au roi Jhésus. [Elle] requiert, de par le roi du Ciel, le haut et redouté prince, [de faire] bonne paix ferme ; le gentil roi de France est prêt [à la faire], sauf son honneur. [Que les deux princes se pardonnent] de bon cœur l’un à l’autre, ainsi que doivent faire loyaux chrétiens.
Rien, dans cette lettre, ne rappelle le ton impérieux, qu’elle avait pris vis-à-vis des Anglais, lorsqu’elle les sommait de s’en retourner dans leur pays. Au contraire, elle s’y fait aussi humble que possible :
[elle] prie, supplie, requiert, les mains jointes, et aussi humblement qu’elle peut, au nom de Dieu, son Seigneur.
C’est qu’il y avait une grande différence entre les envahisseurs, qui devaient être boutés dehors, et un prince français, qu’il s’agissait seulement d’amener à une réconciliation avec le roi.
Est-il besoin d’ajouter que cette touchante supplique resta sans réponse ? La haine et l’ambition parlaient trop haut au cœur du duc de Bourgogne pour qu’il pût entendre ce langage. Il était alors à Paris, auprès du duc de Bedford, son beau-frère, et s’employait de son mieux à raviver les vieilles rancunes des 115Parisiens contre le parti français. Cela ne l’avait pourtant pas empêché d’envoyer des ambassadeurs à Reims, sous prétexte de négocier, mais, en réalité, pour détourner l’attention de la cour par de vaines démonstrations et donner ainsi à une armée, qui venait de débarquer à Calais, le temps d’arriver à Paris. Cette armée forte de quatre à cinq mille hommes, avait été levée en Angleterre, aux frais du Pape, pour une croisade contre les Hussites, qui ravageaient alors la Bohême. Bedford n’hésita pas à l’arrêter au passage et à s’en servir contre le roi de France. Le Pape protesta contre cet acte malhonnête, mais le régent anglais n’en tint aucun compte.
117Chapitre VI Campagne de l’Île-de-France (21 juillet-13 septembre)
§1. Heureux débuts
Après avoir perdu trois jours à Reims en vaines négociations avec les ambassadeurs bourguignons, Charles VII eût volontiers regagné les bords de la Loire, pour s’y musser dans ses châteaux, remettant à plus tard la conquête de l’Île-de-France. Il céda pourtant aux instances des capitaines et l’armée se mit en marche le 21 juillet. Paris est l’objectif de cette nouvelle campagne. Les pays qu’on aura à traverser, avant d’arriver sous ses murs, sont tous au pouvoir des ennemis. Les débuts furent marqués par une suite ininterrompue de succès. Partout, sur le passage du roi, les villes s’empressaient de lui ouvrir leurs portes. Laon, Soissons, Provins, Coulommiers, Crécy, Château-Thierry, Montmirail, se rendirent de bonne grâce, lui jurèrent obéissance et reçurent des gouverneurs de son choix.
Comme il était à Provins, le 2 août, il apprit que le duc de Bedford s’avançait à sa rencontre, avec une puissante armée. Cette nouvelle fut accueillie avec une grande joie par les troupes françaises, qui ne demandaient qu’à se mesurer avec l’adversaire ; elles allèrent se ranger, en ordre de bataille, près du château de la Motte-Nangis. La Pucelle était là, aux premiers rangs, animant les soldats de la voix et du geste,
et c’était gentille chose de voir son maintien et les diligences qu’elle faisait.
Ce fut d’ailleurs en pure perte : Bedford ne jugea pas à propos d’engager le combat et s’en retourna à Paris, sans coup férir.
118Cette retraite honteuse eût dû encourager le roi à poursuivre avec vigueur le cours de ses conquêtes. Il avait avec lui une armée nombreuse, que la présence de la Pucelle enthousiasmait. D’un autre côté, les villes de l’Île-de-France et de la Picardie étaient fatiguées de la domination anglaise et l’auraient reçu avec bonheur.
En vérité, — dit l’historien bourguignon Monstrelet, — si, avec son armée, il fût venu devant Saint-Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville, etc., la plupart de leurs habitants étaient tout prêts à le recevoir comme leur Seigneur et ne désiraient autre chose au monde13.
§2. Sottes négociations
Au lieu de profiter de ces excellentes dispositions pour achever la conquête de la Picardie et de l’Île-de-France, le conseil royal, désireux d’avoir un prétexte pour abandonner la campagne, se mit à écouter les propositions fallacieuses du duc de Bourgogne. Philippe le Bon, alarmé des progrès de l’armée française, demandait une trêve, en prenant l’engagement de faire la paix et de 121rendre Paris au roi dans un mois. Le conseil crut ou feignit de croire à la parole du maître fourbe, et la trêve fut conclue. C’était vraiment pousser bien loin la naïveté.
En conséquence, la retraite fut décidée, à la grande satisfaction du roi et de son entourage civil ; l’armée, qui était alors à Provins, devait aller passer la Seine à Bray, où il avait un pont ; les habitants avaient promis le passage. Mais un événement imprévu vint déranger ce plan. Lorsque l’avant-garde se présenta le matin, elle fut repoussée par une troupe anglaise, qui avait occupé la ville pendant la nuit. On renonça à forcer le passage et on reprit le chemin de Paris, à la grande joie de la Pucelle et de toute l’armée.
§3. Lettre de Jeanne aux Rémois
Cependant la nouvelle de la trêve, conclue avec le duc de Bourgogne, avait jeté l’alarme à Reims. Les habitants, effrayés des conséquences fâcheuses, qui ne manqueraient pas d’en résulter pour eux, envoyaient message sur message au roi, au chancelier et à Jeanne.
Celle-ci, dans sa réponse14, rassure de son mieux, ses
chers 122et bons amis, les bons et loyaux Français de la cité de Reims, leur promettant de ne pas les abandonner, tant qu’elle vivra, mais leur recommandant aussi de bien garder la bonne cité du roi. Elle leur confirme l’existence de la trêve, qui a été conclue quinze jours auparavant et qui doit se terminer quinze jours après, par la reddition de Paris ; mais qu’ils ne s’étonnent pas trop si elle n’y entre pas si tôt. Elle déclare n’être pas contente de cette trêve et ne sait pas si elle l’observera ; mais, si elle l’observe ce sera uniquement pour sauvegarder l’honneur du roi. Afin d’empêcher qu’on n’abuse, une fois encore, de la bonne foi de ce prince, elle maintiendra l’armée rassemblée, de manière à ce qu’elle soit prête, si les Bourguignons ne font pas la paix au terme fixé.
En attendant, comme, les Anglais n’étaient pas compris dans la trêve, elle fit grande diligence pour leur reprendre les places qu’ils occupaient dans la Brie et l’Île-de-France ; Château-Thierry, la Ferté-Milon, Crépy, Lagny, etc., se rendirent de bonne grâce. Les populations accouraient en foule au devant du roi, avec de grandes démonstrations de joie, chantant des Te Deum et faisant retentir les airs de Noël, Noël, mille fois répétés.
— Que voilà un bon peuple ! — dit Jeanne, qui chevauchait entre l’archevêque de Reims et le bâtard d’Orléans. — Je n’en ai pas vu de pareil à témoigner tant de joie pour la venue d’un si noble roi. Plût à Dieu, quand je finirai mes jours, que f eusse le bonheur d’être inhumée dans cette terre !
— Jeanne, répliqua l’archevêque, en quel lieu avez-vous espérance de mourir ?
— Je n’en sais rien ; car, pour ce qui est du temps et du lieu, je n’en sais pas 123plus que vous n’en savez vous-même. Combien je désirerais que ce fût le bon Plaisir de Dieu, mon créateur, de me permettre de me retirer et de quitter les armes ! J’irais servir mon père et ma mère, en gardant leurs brebis, avec mes frères et ma sœur, qui auraient grande joie de me voir.
§4. Français et Anglais à Montépilloy
Cependant le duc de Bedford ne restait pas inactif. Après avoir renforcé frauduleusement son armée, avec les troupes levées par le Pape pour faire la guerre aux Hussites, il se mit en campagne à la tête de dix mille combattants. Avant de quitter Paris, il avait adressé un insultant défi à Charles VII. Il l’accusait d’usurper le titre de roi, de faire aux Anglais une guerre injuste et surtout de séduire le peuple par des moyens abominables, en
se faisant aider par une femme désordonnée, qui porte vêtement d’homme, et de conduite dissolue.
Puis, après avoir rappelé, en termes violents, le meurtre du duc de Bourgogne, il prenait Dieu et les hommes à témoins de son bon droit, et finissait en proposant de régler la querelle, soit à l’amiable,
soit par journée de bataille, puisque autrement ne se peut faire entre puissants princes.
Cette journée de bataille, que le régent anglais semblait appeler de ses vœux, il n’allait tenir qu’à lui de l’avoir. En effet, le 11 août, son armée prit contact avec celle du roi, dans le voisinage de Senlis. Les Anglais avaient assis leur camp, à Montépilloy, dans une position très avantageuse ; leurs derrières étaient protégés par une rivière et leurs flancs par de fortes haies d’épines. Des Français étant venus le soir reconnaître la position, quelques Anglais s’avancèrent à leur rencontre et il y eut des tués et des blessés dans cette escarmouche ; qui prit fin à la nuit.
Tout le monde s’attendait à une bataille pour le lendemain, et chacun prit soin de mettre ordre aux affaires de sa conscience. Le matin, la Pucelle entendit la messe et communia, en compagnie des ducs d’Alençon et de Clermont ; puis on monta à cheval et on se dirigea vers l’ennemi. Son front découvert avait été sérieusement fortifié pendant la nuit ; des fossés 124profonds, des barricades, construites avec de lourds chariots, des pieux aiguisés, solidement fichés en terre devant la ligne des archers, autant d’obstacles contre lesquels les Anglais comptaient que viendrait se briser la fougue des Français, comme l’année précédente, à la fameuse journée des harengs.
Mais, les chefs, instruits par une cruelle expérience, surent contenir leur ardeur ; ils se contentèrent de faire quelques escarmouches, sans jamais s’engager à fond. Ces escarmouches ou vaillantises n’étaient pourtant pas de simples parades, mais des sortes de duels, souvent meurtriers ; deux ou trois cents combattants y perdirent la vie ; des deux côtés, l’animosité était si grande qu’on ne faisait aucun quartier.
Donner l’assaut, dans des conditions si désavantageuses, eût été aller au devant d’un échec certain ; on résolut donc sagement de s’abstenir. Le duc d’Alençon n’en désirait pas moins combattre, mais à chances égales. C’est pourquoi il fit dire aux Anglais que, s’ils voulaient sortir de leur parc, ses gens se reculeraient et les laisseraient se mettre en ordre de bataille. Sur leur refus, les Français regagnèrent leur camp et l’armée ennemie, au lieu d’aller les y attaquer, reprit pendant la nuit le chemin de Paris.
Beauvais ouvrit alors ses portes aux gens du roi, malgré son évêque, Pierre Cauchon, qui s’enfuit chez les Anglais, la rage dans le cœur.
Quelques jours après la vaine démonstration de Bedford, les bourgeois de Compiègne envoyèrent au roi les clefs de la ville et ceux de Senlis lui ouvrirent les portes de la leur.
§5. La Pucelle à Saint-Denis
Cependant la trêve était expirée et le duc de Bourgogne ne parlait ni de rendre Paris, ni de faire la paix. La Cour n’en continuait pas moins, quoique toujours en pure perte, à négocier avec le vassal rebelle ; une ambassade vint le relancer à Arras. L’archevêque-chancelier eut beau humilier devant lui la majesté royale, en lui offrant des réparations, qui blessaient gravement l’honneur du souverain ; tout fut inutile. Le duc reçut ses avances 125avec une hauteur dédaigneuse et congédia les ambassadeurs, en leur faisant dire qu’il enverrait plus tard sa réponse. Sur ce, ils rejoignirent Charles VII à Compiègne, dont la population lui avait fait un chaleureux accueil.
Il s’y trouvait si bien qu’il ne demandait qu’à y prolonger son séjour, au grand déplaisir de la Pucelle et des capitaines :
Il semblait, à sa manière, — dit Perceval de Cagny, — qu’à cette heure il fût content de la grâce que Dieu lui avait faite, sans vouloir entreprendre autre chose.
Au bout de huit jours d’inaction, la Pucelle se décida à prendre les devants, espérant, cette fois encore, l’entraîner à sa suite, comme elle l’avait fait à Gien. Elle appela le duc d’Alençon et lui dit :
— Mon beau duc, faites apprêter vos gens et ceux des autres capitaines ; je veux aller voir Paris de plus près que je ne l’ai vu.
Partis de Compiègne le 23 août, ils arrivèrent à Saint-Denis le 26.
Quand le roi sut qu’ils étaient logés à Saint-Denis, il vint, à son grand regret, dans la ville de Senlis.
Il semblait, — ajoute Perceval de Cagny, — qu’il fût conseillé dans le sens contraire au vouloir de la Pucelle, du duc d’Alençon et de ceux de leur compagnie.
Il en était ainsi, en effet ; cette opposition allait même beaucoup plus loin qu’on ne pouvait l’imaginer et les bons Français, qui soutenaient avec tant d’ardeur la cause royale, auraient été justement indignés, s’ils avaient eu connaissance de ce qui se tramait dans le cabinet des ministres.
§6. Nouvelle trêves
Ceux-ci après avoir été cent fois bernés par le duc de Bourgogne, avaient renoué avec lui des négociations qui aboutirent (28 août) à une nouvelle trêve ; elle devait durer jusqu’à Noël et fut plus tard prorogée jusqu’au 21 mars de l’année suivante. Les conditions, acceptées par le conseil royal, étaient telles que les clauses du traité durent rester secrètes, sous peine de provoquer l’indignation générale. En voici une :
Durant le temps de cette présente trêve, aucune des parties ne pourra prendre, acquérir, conquérir l’une sur l’autre aucune des villes, places ou forteresses, qui y sont comprises ; on n’admettra 126l’obéissance d’aucune, au cas où ces villes, places ou forteresses voudraient se rendre à l’obéissance d’une des parties.
Une autre, concernant spécialement Paris, était ainsi libellée, au nom du roi de France :
Si bon lui semble, notre dit cousin de Bourgogne pourra, durant la dite trêve, s’employer, lui et ses gens, à la défense de la ville de Paris et résister à ceux qui voudraient faire la guerre ou porter dommage à cette ville.
Ce traité n’était pas uniquement l’œuvre de La Trémoille et du chancelier ; il est même assez déconcertant d’y voir coopérer le duc de Bar, les comtes de Clermont et de Vendôme, le bâtard d’Orléans, les sires d’Albret et de Trèves, etc. Quels qu’aient été les motifs qui ont fait agir de la sorte tant d’illustres personnages, il est clair que le traité mettait fin officiellement à la glorieuse chevauchée, qui avait conduit le roi de Gien à Reims et de Reims à Compiègne, à travers des provinces reconquises sans coup férir. Charles VII va jusqu’à prendre l’engagement de ne pas recevoir la soumission des villes bourguignonnes, qui, de leur plein gré, voudraient se donner à lui ! Mieux encore ; il permet au duc de Bourgogne de défendre Paris, au moment même où ses troupes se préparent à attaquer cette ville !
Aussi, ne se hâtait-il pas de les rejoindre ; la Pucelle avait beau lui envoyer message sur message pour le presser de venir, il n’en faisait rien. Le duc d’Alençon alla lui-même le relancer à Senlis et finit par lui arracher la promesse qu’il partirait le lendemain ; mais on l’attendit vainement. Ce fut seulement le 5 septembre que, sur une nouvelle et plus pressante démarche du duc, il se décida à se mettre en route. Il fit son entrée à Saint-Denis le surlendemain, à la grande joie de l’armée, que ces retards commençaient à énerver. On allait donc enfin pouvoir, sous la conduite de la Pucelle, livrer à Paris un assaut victorieux. Car,
il n’y avait personne, — dit Perceval de Cagny, — de quelque état qu’il fût, qui ne dît : Elle mettra le roi dans Paris, si à lui ne tient.
§7. Échec sous les murs de Paris
Le duc d’Alençon, de concert avec la Pucelle, avait tout préparé 127pour l’assaut ; il disposait d’une nombreuse artillerie et avait, toutes prêtes, une quantité considérable de voitures, remplies de gros fagots, destinés à combler les fossés, de claies pour les recouvrir, sept cents échelles pour l’escalade. De plus, un pont, jeté par ses ordres, sur la Seine, en amont de la ville, permettait de porter des troupes sur la rive gauche.
Bedford avait quitté Paris quelques jours avant l’arrivée des Français, emmenant avec lui, en Normandie, la majeure partie de ses forces. La garnison, composée de Bourguignons et d’une poignée d’Anglais, n’était pas bien nombreuse ; mais elle avait un solide point d’appui dans la population, qui détestait les Armagnacs. Il y avait bien, dans la ville, un fort parti de bons Français, fidèles au roi ; mais ils n’osaient se montrer. Quelques-uns entretenaient pourtant des intelligences avec les chefs de l’armée royale et l’on comptait un peu sur eux pour exciter une émeute, au moment de l’assaut.
L’attaque eut lieu (8 septembre) le lendemain de l’arrivée du roi. Elle commença fort tard et fut dirigée sur un seul point, entre les portes Saint-Honoré et Saint-Denis. Avant d’arriver arc pied des murailles, les assaillants avaient à traverser deux fossés, séparés par un dos d’âne ; le premier était à sec, mais le second, qui avait une grande profondeur, était plein d’eau. Arrivée au dos d’âne, la Pucelle cria aux soldats qui gardaient le mur :
— Rendez la ville au roi de France.
En même temps, elle faisait jeter des fagots dans le second fossé et animait de la voix et du geste, les gens du duc d’Alençon, qui étaient à ses côtés. Pas n’est besoin de dire qu’elle avait la volonté bien arrêtée de prendre la ville et qu’elle s’y employa de toutes ses forces. Malheureusement les chefs, qui venaient de signer la dernière trêve, étaient dans de tout autres dispositions. Au lieu d’une attaque à fond, ils étaient décidés à faire une simple démonstration, pour donner un semblant de satisfaction à l’ardeur belliqueuse des troupes. C’est pourquoi l’attaque commença tard, fut poussée mollement et ne consista guère qu’en 128un duel d’artillerie :
— Les gentilshommes, — dira plus tard la Pucelle, — désiraient faire une escarmouche ou vaillance ; mais j’étais bien décidée à aller plus outre et à passer le fossé.
§8. Récit d’un témoin
Le récit suivant, dû à la plume d’un témoin oculaire, Clément de Fauquembergues, clerc du Parlement de Paris, montre bien quel fut le caractère véritable de cette vaine tentative :
Le jeudi, 8 septembre, les gens d’armes de Messire Charles de Valois, assemblés en grand nombre, près les murs de Paris, à la porte Saint-Honoré, espérant grever et endommager la ville et les habitants de Paris, par commotion du peuple, plus que par puissance ou force d’armes, environ deux heures après midi, commencèrent de faire semblant de vouloir assaillir la dite ville. Et, hâtivement, plusieurs d’entre eux étant sur la Place aux Pourceaux, près de la dite porte, portant de longues bourrées et fagots, descendirent et se boutèrent ès premiers fossés, èsquels point n’avait d’eau, et jetèrent les dites bourrées et fagots dans l’autre fossé, proche des murs, èsquel avait grande eau.
Et, à cette heure, y eut, dedans Paris, gens effrayés ou corrompus, qui élevèrent une voix en toutes les parties de la ville, criant que tout était perdu et que les ennemis étaient entrés dedans Paris, et que chacun fît diligence de se sauver. Là dessus se départirent des églises toutes les gens étant lors ès sermons, et furent moult épouvantés et se retirèrent en leurs maisons et fermèrent leurs portes. Mais il n’y eut aucune autre agitation.
Et demeurèrent à la garde des portes et des murs de la ville ceux qui y étaient députés et à leur aide survinrent plusieurs autres habitants, qui firent très bonne et forte résistance aux hommes de Charles de Valois, qui se tinrent dedans le dit premier fossé, jusqu’à dix ou onze heures de nuit qu’ils se départirent à leur dommage. Et d’eux il y en eut plusieurs morts ou blessés, de traits et de canons. Et entre autres fut blessée, d’un trait à la jambe, une femme, que l’on appelait la Pucelle.
129Jeanne fut, en effet, blessée à la cuisse, pendant qu’elle sondait le fossé du bout de sa lance ; mais, elle n’en continuait pas moins d’encourager les hommes d’armes et de faire jeter des fascines. Depuis longtemps, la retraite était sonnée et la nuit venue ; elle s’obstinait toujours à garder son posté de combat. Il fallut qu’on vînt l’en arracher ; le sire de Gaucourt la mit à cheval, malgré sa résistance, et l’entraîna à la Chapelle. Durant le trajet, on l’entendait répéter :
— La Place aurait été prise, la place aurait été prise.
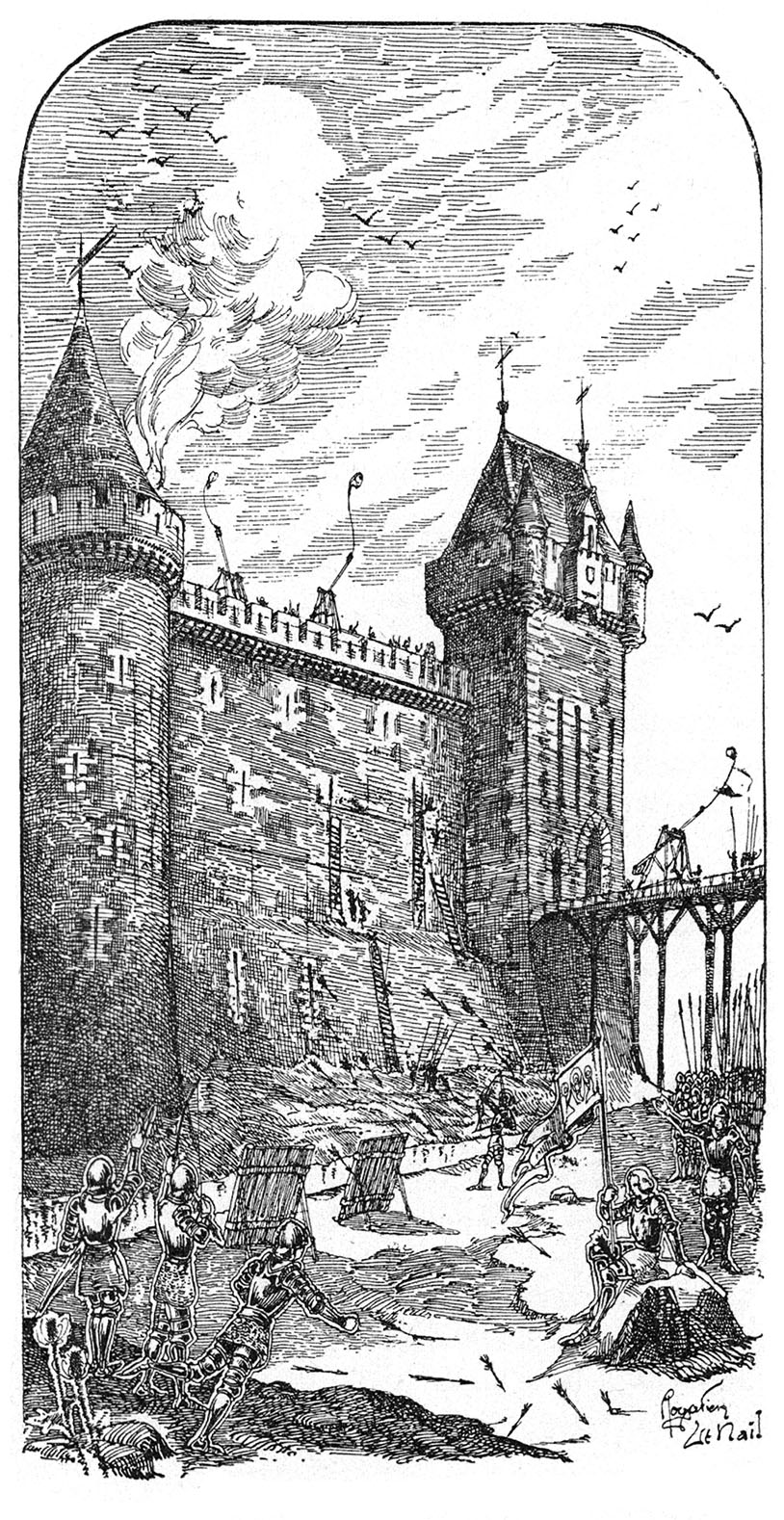
§9. Étrange conduite du roi
Certes, il ne tint pas à elle qu’elle le fût en effet. Aussi, ce n’était pas elle, mais le roi, que l’armée rendait responsable de cet échec.
L’on disait que par lâcheté de courage, il n’avait jamais voulu prendre Paris d’assaut.
Que ce fût lâcheté ou raison politique, il ressort clairement de la manière dont l’affaire fut conduite, qu’il n’entrait pas dans ses plans de forcer la ville. Autrement, l’attaque aurait commencé dès le matin ; elle n’aurait pas été portée sur un seul point ; et au lieu de laisser, comme on le fit, le gros de l’armée dans l’inaction, on en aurait jeté une partie sur la rive gauche pour opérer une diversion. Du reste, la conduite de Charles VII, les jours suivants, montre assez quelles étaient ses intentions.
Le lendemain, la Pucelle, malgré sa blessure, se leva de grand matin et demanda au duc l’Alençon de donner le signal pour retourner devant Paris. Il l’eût fait volontiers, mais certains capitaines refusaient de marcher. Pendant ces pourparlers, on vit arriver le baron de Montmorency, qui avait été jusque-là du parti opposé au roi ; il venait de Paris, avec une soixantaine de gentilshommes, se mettre sous les ordres de la Pucelle. Elle se disposait donc à partir, lorsqu’un ordre formel du roi la rappela à Saint-Denis, elle et le duc d’Alençon. Le jour suivant, comme ils manifestaient l’intention de se porter sur la rive gauche, on leur apprit que le pont n’existait plus ; le roi l’avait fait démolir pendant la nuit. Il avait hâte de rentrer dans ses châteaux d’au delà de la Loire.
§10. Retraite et dislocation de l’armée
130La retraite ayant donc été décidée, au grand regret de la Pucelle ; elle voulut, avant de partir, aller déposer son armure dans l’église, en hommage à Notre-Dame et à saint Denis ; tel était l’usage des chevaliers, quand ils avaient été blessés.
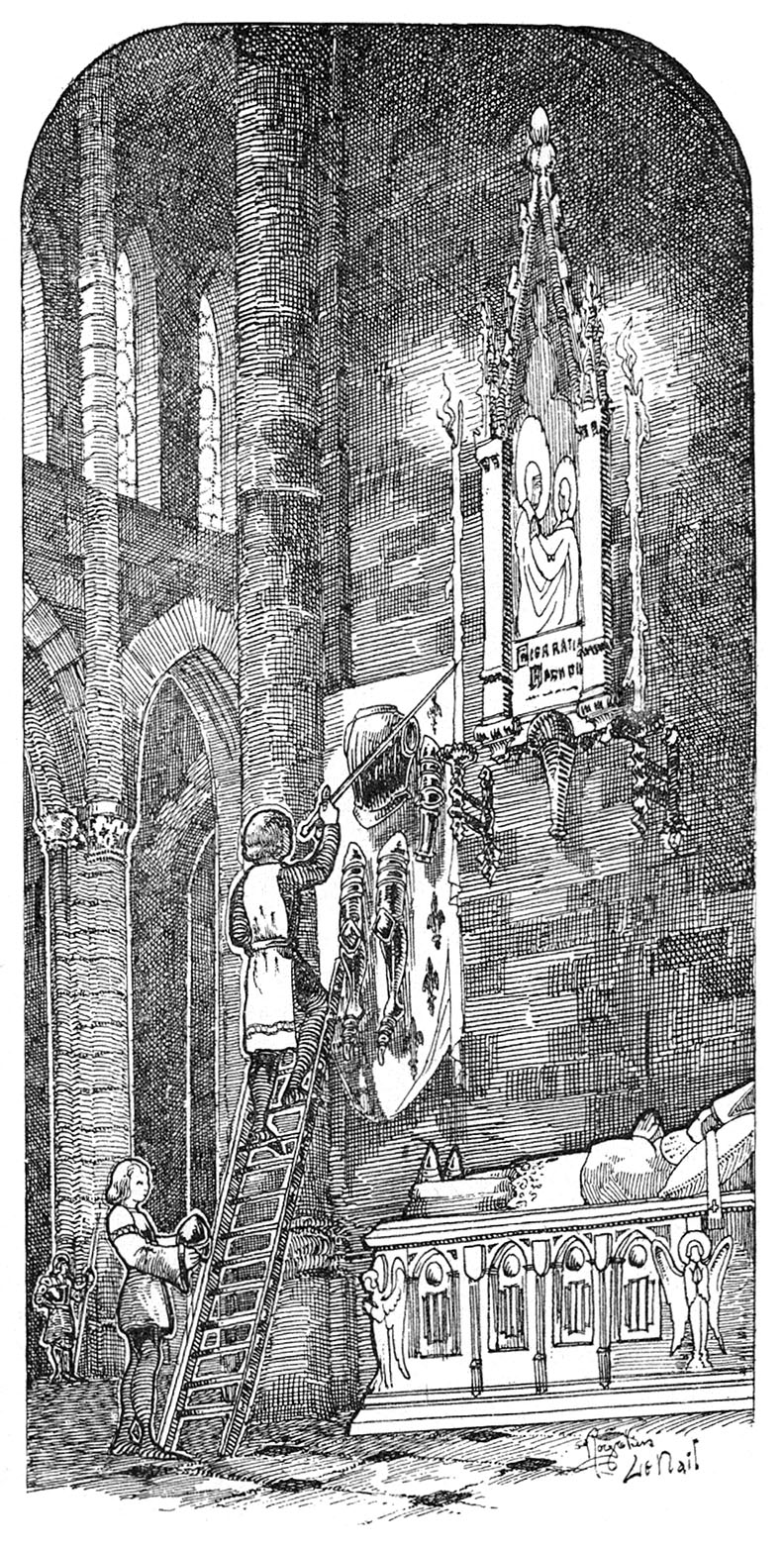
Ainsi, — dit Perceval de Cagny, — fut rompu le vouloir de la Pucelle et fut aussi rompue l’armée du roi.
Le 13 septembre, les troupes françaises quittèrent la ville de Saint-Denis, qui retomba quelques jours après aux mains des Anglo-Bourguignons et en fut fort maltraitée. La retraite s’effectua en grande hâte et souvent en désordre. L’armée fut licenciée à Gien.
Le départ du duc d’Alençon causa beaucoup de peine à la Pucelle ; depuis leur première entrevue à Chinon, elle l’avait toujours eu en grande affection et
faisait pour lui, — dit Perceval de Cagny, — ce qu’elle n’eût fait pour nul autre.
De son côté, le jeune prince lui était tout dévoué, l’avait toujours secondée de son mieux et appréciait hautement ses services. Aussi, peu de temps après leur séparation, comme il était en train de lever une armée pour reconquérir son duché, il pria le roi de la lui envoyer, parce que, disait-il
sa présence seule lui amènerait des gens, qui ne bougeraient pas, si elle ne se mettait elle-même en campagne.
La Trémoille et de Gaucourt, qui gouvernaient alors la personne du roi, répondirent par un refus. Elle ne devait plus revoir son beau duc.
131Chapitre VII Dernières campagnes
§1. Prise de Saint-Pierre-le-Moûtier
Une fois l’armée disloquée, le roi, libre enfin de suivre ses goûts, reprit aussitôt ses anciennes habitudes de nonchalance et de désœuvrement, promenant son incurable ennui de châteaux en châteaux. Gien, Sully, Amboise, Selles en Berry, Meung, le virent passer tour à tour, avant qu’il se rendît à Bourges, auprès de la reine. Jeanne le suivait dans ces déplacements, toujours traitée par lui avec de grands égards, mais aussi toujours en butte à l’hostilité sourde des ministres.
Après six semaines de ce repos mouvementé, elle se remit en campagne, à la requête du conseil royal. Le sire d’Albret, frère de La Trémoille, avait le commandement de l’expédition contre Saint-Pierre-le-Moûtier. La place avait une garnison nombreuse, qui se défendit vaillamment. La première tentative d’assaut n’ayant pas réussi, les assaillants découragés lâchèrent pied, de sorte que la Pucelle restait presque seule au pied des remparts, avec quelques hommes seulement de sa maison. Son majordome lui-même, d’Aulon, ayant été blessé, s’était éloigné. Mais bientôt, s’apercevant du danger auquel elle s’exposait, en pure perte, croyait-il, il monta à cheval, courut la rejoindre et lui demanda pourquoi elle ne s’était pas retirée 132comme les autres et ce qu’elle prétendait faire toute seule. Elle répondit qu’elle n’était pas seule, qu’elle avait avec elle cinquante mille de ses gens et qu’elle ne partirait pas avant d’avoir pris la ville.
D’Aulon, qui ne voyait, à ses côtés, que quatre ou cinq hommes, insistait pour la faire partir ; mais, elle, sans s’émouvoir :
— Faites plutôt, — lui dit-elle, — apporter des fagots et des claies pour faire un pont sur les fossés.
Puis, elle cria de toutes ses forces :
— Tout le monde aux fagots et aux claies.
Son appel fut entendu ; les fuyards revinrent, animés d’un nouveau courage, et la ville fut prise ; ce dont le bon d’Aulon déclare avoir été tout émerveillé. Les vainqueurs voulaient s’emparer des objets que les habitants avaient déposés dans l’église. Jeanne s’y opposa, par respect pour la maison de Dieu, et rien ne fut enlevé.
Après cette expédition, elle se rendit à Moulins, d’où elle adressa une demande de secours aux habitants de Riom et de Clermont15.
§2. Catherine de La Rochelle
135Avant de suivre la Pucelle au siège de La Charité, nous devons mentionner un incident, auquel elle avait été mêlée et qu’elle a elle-même raconté avec de plaisants détails. Une aventurière, nommée Catherine de La Rochelle, prétendait avoir des visions et son directeur, le trop fameux frère Richard, que nous avons déjà rencontré à Troyes, la patronnait à la Cour. Jeanne avait eu l’occasion de la voir à Montfaucon en Berry et ses confidences l’avaient intriguée ; elle flairait une grossière supercherie et résolut de la démasquer. Elle va nous dire elle-même comment elle s’y prit :
— Elle me disait que venait à elle une dame blanche, qui lui disait d’aller par les bonnes villes, de se faire donner par le roi des hérauts et des trompettes pour faire crier que quiconque avait or, argent ou trésor caché, eût à les apporter tout de suite, qu’elle (Catherine) connaîtrait bien ceux qui ne le feraient pas et qui tiendraient leurs trésors cachés, qu’elle saurait bien trouver ces trésors, et qu’ils serviraient à payer mes hommes d’armes. Je lui répondis de retourner a son mari, faire son ménage et élever ses enfants.
Pour avoir la certitude de son fait, j’en parlai à sainte Catherine et à sainte Marguerite ; elles me dirent que le fait de cette Catherine n’était que folie et néant. J’écrivis à mon roi que je lui dirais ce qu’il devait faire et, quand je fus près de lui, je lui dis que tout était folie et néant chez cette femme. Cependant frère Richard voulait qu’on la mît à l’œuvre et tous les deux, frère Richard et Catherine, furent très mécontents.
La dite Catherine ne me conseillait pas d’aller à La Charité ; il faisait trop froid et elle n’y irait pas. Elle voulait aller vers le duc de Bourgogne pour faire la paix. Je lui dis qu’il me semblait qu’on n’y trouverait point la paix, si ce n’est au bout de la lance.
Je demandai à cette Catherine si la dame blanche venait toutes les nuits et lui dis que je coucherais avec elle. J’y couchai ; je veillai jusqu’à minuit et ne vis rien ; je m’endormis ensuite. Le matin arrivé, je demandai si la dame était venue. Elle me 136répondit qu’elle était venue, que je dormais lors de sa visite et qu’elle n’avait pu m’éveiller. Je lui demandai alors, si elle ne viendrait pas le lendemain et la dite Catherine me répondit que oui. Cela fut cause que je dormis de jour, afin de pouvoir veiller la nuit. Je couchai donc la nuit suivante avec la dite Catherine et je veillai toute la nuit ; mais je ne vis rien, encore que souvent je lui demandasse :
Ne viendra-t-elle point, et que la dite Catherine me répondit :Oui, bientôt.
Jeanne se peint, dans ce naïf récit, avec son bon sens impeccable et sa finesse.
§3. Siège de La Charité
Le siège de La Charité, auquel la Pucelle se disposait à prendre part, avait été décidé en dehors d’elle.
— J’allai devant La Charité, — dit-elle, — à la requête de mon roi et ce ne fut ni contre ni par le commandement de mes Voix.
On touchait à la fin de novembre, saison peu favorable pour commencer un siège ; d’un autre côté, l’armée, d’ailleurs mal pourvue du matériel nécessaire, se composait surtout de mercenaires étrangers et l’argent manquait pour les payer. Le résultat fut ce qu’il devait être dans de pareilles conditions. Les chroniques du temps se contentent d’enregistrer l’échec final, sans donner de détails sur la conduite des opérations. Après trois ou quatre semaines de dures souffrances et d’efforts infructueux, les assiégeants se retirèrent, laissant leur artillerie aux mains de l’ennemi. Pour la seconde fois, le dévouement de la Pucelle avait été inutile.
§4. Le roi anoblit Jeanne et sa famille
Ce fut quelques jours seulement après cet échec, et sans doute en vue d’adoucir un peu la peine qu’elle en ressentait, que le roi donna à Jeanne un témoignage solennel de sa reconnaissance et de son affection. En décembre 1429, il délivrait des lettres de noblesse, pour elle et pour sa famille. Elles débutent ainsi :
Afin d’exalter l’effusion des grâces si éclatantes, que la divine Majesté nous a départies par le ministère de notre chère et bien aimée Jeanne Darc…, et celles que nous en attendons encore, nous croyons convenable et opportun que ce ne soit pas seulement la Pucelle, mais toute sa parenté… qui soit élevée et 137exaltée par de dignes marques d’honneur de notre Royale Majesté… Attendu donc ce qui vient d’être exposé, et en considération des louables, gracieux et utiles services, rendus à nous et à notre royaume, de bien des manières, par Jeanne la Pucelle, et de ceux que nous en espérons à l’avenir,… nous avons anobli la sus-dite Pucelle, et, en son honneur et considération, son père, sa mère, ses frères et toute sa parenté, née et à naître en légitime mariage,… nonobstant que peut-être ils soient de condition autre que la condition libre.
En outre, il était stipulé que la noblesse se transmettrait dans la famille, non seulement par les hommes mais aussi par les femmes.
Jeanne ne se prévalut point de cet anoblissement ; mais ses frères, devenus gentilshommes, prirent un nouveau nom, du Lys, en rapport avec leur blason :
— Mon roi, — dit-elle, — donna des armes à mes frères, à savoir : un écu d’azur, avec deux fleurs de lis d’or et une épée dans le milieu. Le tout fut donné par mon roi à mes frères, pour leur faire plaisir et sans requête de ma part.
§5. Repos forcé
Après l’expédition avortée de La Charité, les hostilités furent suspendues, tant à cause de la rigueur de la saison que par l’effet des trêves, qui devaient durer jusqu’à Pâques ; de sorte que la Pucelle passa l’hiver dans un repos forcé (Noël 1429-Pâques 1430).
On aimerait à savoir ce qu’elle fit durant ces trois mois ; mais, faute de documents, on ne peut que risquer des conjectures ou formuler des hypothèses. M. le comte de Maleyssie, qui se fait gloire de descendre de la famille du Lys, en a tout récemment émis une, qui ne doit pas être passée sous silence, puisqu’elle a obtenu l’adhésion de publicistes éminents et que l’Académie française a couronné l’ouvrage, où elle est exposée avec un talent incontestable. L’auteur s’est efforcé de démontrer que la Pucelle a mis à profit ses loisirs d’hiver pour apprendre à lire et à écrire. (Voir à la fin du volume, l’Appendice N° 2.)
§6. Lettre aux Hussites
Vers la fin de mars, elle chargea son chapelain, Pasquerel, 138de rédiger et d’adresser, en son nom, une lettre aux Hussites, qui ravageaient alors la Bohême. Les bandes forcenées de ces hérétiques y promenaient partout le fer et le feu, pillaient et brûlaient les églises et les couvents, massacraient les prêtres, les religieux et les fidèles qui refusaient d’embrasser leur hérésie.
Pasquerel rédigea donc une lettre à leur intention. Après avoir insisté longuement sur leurs méfaits, il les apostrophait en termes véhéments et finissait par des menaces : s’ils ne s’amendent pas, la Pucelle ira elle-même les visiter, avec d’immenses forces divines et humaines et leur fera subir le sort, qu’ils ont fait subir aux autres. Évidemment ce chef-d’œuvre de fausse rhétorique ne dut pas produire sur ses destinataires, l’effet qu’en attendait son auteur.
§7. Lettres au Rémois
Deux lettres, que la Pucelle adressa, à la même époque, aux habitants de Reims, et qu’elle avait elle-même dictées, ont une allure bien autrement française. La première16 a pour but de les rassurer, à propos de la crainte, qu’ils lui manifestaient, d’être assiégés par les Bourguignons, à l’expiration de la trêve : qu’ils soient toujours bons et loyaux, qu’ils ferment bien leurs portes ; si les ennemis se présentent, elle accourra aussitôt et leur fera
chausser les éperons si en hâte qu’ils ne sauront par où les prendre.
139Reims renfermait des traîtres, qui complotèrent d’introduire les Bourguignons dans la ville ; ils furent découverts et punis. Mais des rapports, venus à la Cour, avaient singulièrement grossi le nombre de ces mauvais Français. La municipalité écrivit au roi, pour rétablir les faits et protester à nouveau de sa fidélité. Elle envoya aussi une lettre à la Pucelle, sur le même sujet. Celle-ci, dans sa réponse17, laisse entendre que les faux rapports ont fait une fâcheuse impression ; mais maintenant le roi, mieux informé, est très content de ses fidèles Rémois, ils sont bien en sa grâce ; et, si les traîtres Bourguignons vont les assiéger, il les
en délivrera le plus tôt que faire se pourra.
Elle termine par une bonne nouvelle.
Le duc de Bretagne va envoyer trois mille combattants, payés pour deux mois.
§8. Compiègne reste française malgré la Cour
Les négociations, engagées avec le duc de Bourgogne pour l’amener à faire la paix, s’étaient poursuivies tout l’hiver, sans donner aucun résultat, quoique les indignes ministres de Charles VII 140eussent consenti à ses demandes les plus exorbitantes, sacrifiant au vassal révolté, non seulement l’honneur de leur maître, mais les intérêts de ses plus fidèles sujets. La place de Compiègne, principal boulevard de la France du Nord, dressait ses remparts entre les États du duc de Bourgogne et l’Île-de-France, occupée par ses bons alliés, les Anglais. Philippe le Bon désirait naturellement faire disparaître cette fâcheuse barrière et il eut l’impudence de demander qu’on lui confiât la garde de la ville jusqu’à la paix. Chose à peine croyable ! les négociateurs y consentirent, au nom du roi. Heureusement les habitants de Compiègne comprirent mieux leur devoir ; ils déclarèrent fièrement qu’ils voulaient rester Français, coûte que coûte, et qu’ils n’ouvriraient point les portes de la ville au nouveau maître, qu’on prétendait leur imposer contre leur gré. C’est pourquoi celui-ci se disposa à les assiéger.
§9. La Pucelle à Lagny : enfant mort-né revenu à la vie
Cependant la Pucelle fatiguée de sa longue inaction et d’ailleurs fort malcontente de pareilles négociations, quitta brusquement la Cour, sans prendre congé du roi. Sortie sans bruit, comme pour aller à la promenade, elle se dirigea du côté. de Lagny, parce que ceux de la place faisaient bonne guerre aux Anglais de Paris et d’ailleurs. Son passage dans cette ville fut signalé par deux événements notables.
Le premier, que les habitants crurent miraculeux, fut le retour à la vie d’un enfant qui paraissait mort-né. Elle y contribua par ses prières et le peuple ne manqua pas de lui en attribuer la gloire. Entendons-la raconter elle-même ce fait extraordinaire :
— Il y avait trois jours, ainsi qu’on le disait, qu’il n’avait pas apparu de vie dans l’enfant. Il fut apporté à Notre-Dame. L’on me dit que les pucelles de la ville étaient devant Notre-Dame et que je voulusse y aller pour prier Dieu et Notre-Dame de vouloir bien lui donner la vie. J’y allai et je priai avec les autres. L’enfant était noir comme ma cotte. Finalement, la vie apparut en lui ; il bailla trois fois, et, quand il eut baillé, la couleur commença à lui revenir. Il fut baptisé, ne tarda pas à mourir et fut inhumé 141en terre sainte. J’étais à genoux devant Notre-Dame, avec les autres, à faire ma prière.
À cette question, qui lui fut posée au procès de Rouen : Ne fut-il pas dit, par la ville, que c’était vous qui aviez fait cette résurrection ? elle répond simplement :
— Je ne m’en enquérai point.
Elle a fait comme les autres, elle a prié avec les autres. Rien de plus, et, si l’on dit que c’est elle qui a fait cette résurrection, elle n’en sait rien et n’en veut rien savoir. Voilà bien le langage de l’humilité.
§10. Franquet d’Arras
Pendant que Jeanne était à Lagny, un aventurier au service des Bourguignons, Franquet d’Arras, dont la scélératesse égalait la bravoure, vint ravager les environs de la ville, avec une bande de trois à quatre cents Anglais. Elle se porta à sa rencontre, avec un nombre à peu près égal de Français. Le choc fut rude et la victoire longtemps indécise ; les Français furent deux fois repoussés ; ils finirent cependant par l’emporter et tous les ennemis furent tués ou faits prisonniers. Parmi ces derniers se trouvait Franquet d’Arras. La Pucelle se le fit remettre, dans l’intention de l’échanger contre un bourgeois de Paris, propriétaire de l’hôtel de l’Ours, qui s’était trouvé compromis dans un complot et avait été jeté en prison. Mais, ayant appris que le seigneur de l’Ours avait été mis à mort, elle livra son prisonnier au bailli de Senlis, qui le réclamait et le condamna à mort pour ses crimes.
On lui fit, à Rouen, un gros grief de l’exécution de ce brigand ; elle n’eut pas de peine à s’en justifier.
— Prendre un homme à rançon et le faire mourir, n’est-ce pas un péché mortel ?
— Aussi ne l’ai-je pas fait.
— Et Franquet d’Arras, que l’on fit mourir à Lagny ?
— Pour ce qui regarde Franquet d’Arras, je consentis à ce qu’on le fît mourir, s’il l’avait mérité. Je voulus avoir ce Franquet d’Arras pour un homme de Paris, seigneur de l’Ours. Quand je sus que ce seigneur était mort et que le bailli m’eut dit que je faisais grand tort à la justice, en délivrant ce Franquet, je dis au bailli :
Puisque mon homme, celui que je voulais avoir, est mort, faites de celui-ci ce que vous en devez faire, 142par justice.Son procès dura quinze jours, il confessa être larron, meurtrier et traître. Le juge fut le bailli de Senlis et les hommes de justice de Lagny.
§11. Sinistres avertissements
La victoire de Lagny clôt la série des succès militaires de la Pucelle. Les mêmes Voix, qui lui avaient prédit ses triomphes, lui donnèrent peu après de lugubres avertissements, pour la préparer aux douloureuses épreuves qu’elle aura bientôt à subir. Ainsi avertie, elle se résigna à la volonté de Dieu, malgré les répugnances de la nature, mais — on le conçoit sans peine — moins joyeusement que lorsqu’il s’était agi d’aller au secours de son roi. Elle s’en est expliquée en ces termes :
— En la semaine de Pâques, comme j’étais sur les fossés de Melun, il me fut dit par mes Voix, à savoir, par sainte Catherine et sainte Marguerite, que je serais prise avant la Saint-Jean, qu’il fallait que ce fût ainsi ; de ne pas m’ébahir et prendre tout en gré et que Dieu m’aiderait. Depuis, cela m’a été dit par plusieurs fois et quasi tous les jours. Je requérais de mes Voix que, quand je serais prise, je mourusse promptement, sans long tourment de prison. Elles me répondaient de prendre tout en gré, qu’ainsi il fallait faire. Mais elles ne me dirent pas l’heure, et, si je l’eusse sue, je n’y fusse point allée. Toutefois, à la fin, j’eusse fait leur commandement, quelque chose qui dût en advenir. Depuis que j’eus révélation que je serais prise, je m’en rapportai le plus souvent à la volonté des capitaines pour le fait de la guerre, mais sans leur dire que j’avais révélation que je serais prise.
Cet acquiescement douloureux aux décrets divins, malgré les répugnances de la nature, ne rappelle-t-il pas celui du divin Maître : Que ce calice s’éloigne de moi, s’il se peut ; mais que votre volonté soit faite, non la mienne.
§12. Derniers services
Le 24 avril, Jeanne se présenta aux portes de Senlis, avec un millier de chevaux ; la ville, mal pourvue de fourrage et de grain, refusa de recevoir une troupe si nombreuse. Elle arriva à Compiègne, deux semaines plus tard et y reçut un chaleureux accueil. De là, elle se rendit à Pont-l’Évêque, avec deux mille combattants, 143pour en déloger les Anglais. Il y eut de rudes escarmouches ; mais la place ne fut pas prise.
À peine rentrée à Compiègne, la Pucelle repartait aussitôt pour Soissons. Le gouverneur, à qui le roi en avait confié la garde, était un traître. Il avait vendu la ville aux Bourguignons et était à la veille de la leur livrer. C’est pourquoi il ameuta la population et fit refuser l’entrée. Les troupes, obligées d’aller coucher aux champs, se dispersèrent, pour se procurer des vivres.
Cependant le duc de Bourgogne se disposait à mettre le siège devant Compiègne ; or la ville n’avait qu’un nombre insuffisant de défenseurs. À la demande du gouverneur, Guillaume de Flavy, Jeanne se chargea volontiers d’aller en recruter ; car elle avait beaucoup d’affection pour les habitants de cette ville, dont les sentiments patriotiques répondaient si bien aux siens. Elle se rendit aussitôt dans le pays voisin et réussit à enrôler trois ou quatre cents combattants. Avant de quitter Crépy-en-Valois, elle apprit que l’armée bourguignonne campait déjà devant Compiègne ; comme on lui représentait qu’il serait téméraire de tenter de passer à travers les ennemis, avec sa faible troupe :
— Nous sommes assez, — dit-elle ; — je veux aller voir mes bons amis de Compiègne.
Une marche de nuit l’amena, sans coup férir, aux portes de la ville, où elle entra, de grand matin, avec ses recrues. Ce fut sa dernière joie ; le soir, elle était prisonnière (23 mai 1430).
L’année précédente, au moment d’entrer en campagne, Jeanne avait dit à Charles VII : Je durerai un an, guère plus. Or, l’année était révolue depuis quelques semaines. La guerrière disparaît donc, au temps précis, qu’elle avait fixé, d’après ses révélations. Si elle n’a pas réalisé tout son programme, si l’Anglais n’est pas encore bouté hors de France, on sait 144que ce ne fut pas sa faute. Elle n’en a pas moins sauvé la France d’une ruine imminente, malgré les obstacles, semés sous ses pas par ceux-là mêmes qui avaient le plus d’intérêt à la seconder. Son rôle actif et personnel est désormais fini ; mais l’impulsion qu’elle a donnée, continuera de s’exercer et amènera dans un avenir prochain, la libération complète du pays : elle laisse le moral des adversaires en présence radicalement changé : chez les Français, la pusillanimité d’autrefois a fait place à une généreuse ardeur, tandis qu’un profond découragement ne cessera plus de paralyser les Anglais, naguère si présomptueux. Tel fut l’effet durable des victoires de la Pucelle.
145Chapitre VIII Qualités militaires et vertus chrétiennes
§1. La personne physique de la Pucelle
Avant de suivre la Pucelle sur la voie douloureuse, qui la conduira au bûcher de Rouen, arrêtons-nous un instant pour embrasser, d’un regard d’ensemble, les qualités guerrières et les vertus chrétiennes, par lesquelles elle s’est distinguée durant l’année qu’elle a passée au milieu des hommes d’armes.
Il n’existe aucun portrait authentique de Jeanne d’Arc ; de sorte que nous en sommes à regretter la perte d’une ébauche, bien grossière sans doute, qu’elle a elle-même signalée :
— À Arras, je vis, en la main d’un Écossais, une peinture à ma ressemblance. J’étais peinte tout armée, un genou en terre, présentant une lettre à mon roi. Jamais je ne vis d’autre image à ma ressemblance ni n’en fis faire.
Si, pour concevoir quelque idée de ce qu’elle était physiquement, on fait appel au témoignage de ceux qui l’ont le mieux connue, on se heurte à un laconisme désespérant ; il semble que l’éclat des brillantes qualités de son âme les ait empêchés de voir les traits marquants de sa physionomie, tant ils sont réservés à cet égard. L’un d’eux, de Boulainvilliers, se contente de dire qu’
elle avait la beauté qui convenait, quelque chose de viril dans son allure, avec un timbre de voix bien féminin.
Un autre, d’Aulon, qui a toujours vécu en sa compagnie, du commencement à la fin de sa vie guerrière, constate qu’
elle 146était belle et bien conformée.
Même note chez Cousinot :
Elle était bien compassée de membres et forte.
Le duc d’Alençon déclare qu’
elle était bien faite et de visage agréable.
Nous savons, par ailleurs, qu’elle portait le même costume que ses compagnons d’armes,
tunique courte, braies et chaussures, avec foison, d’aiguillettes, cheveux coupés en rond, tombant du sommet de la tête aux oreilles.
Voilà, à peu près tout ce que nous apprennent les contemporains sur l’extérieur de la jeune héroïne.
§2. Courage et génie militaire de la guerrière
En revanche, tous célèbrent à l’envi sa prodigieuse force d’endurance. On la voyait, dans les marches, chevaucher des journées entières, couverte, des pieds à la tête, de la pesante armure, que portaient les chevaliers. Souvent, du milieu de la colonne, où elle se tenait habituellement en compagnie du roi, elle se portait tantôt à l’avant, tantôt à l’arrière, pour encourager les hommes d’armes. Arrivée à l’étape, elle se contentait de la plus légère réfection ; il lui est arrivé souvent, après des chevauchées fatigantes, de prendre seulement quelques bouchées de pain, trempées dans du vin mêlé d’eau. Aux champs, elle couchait à la paillade, tout habillée et parfois même sans quitter son armure. Ses compagnons d’armes, étonnés de voir tant de vigueur chez une fille si jeune, lui firent, sous ce rapport, une réputation qui dépasse les limites de la vraisemblance. Ainsi, Perceval de Boulainvilliers, chambellan de Charles VII, écrivait au duc de Milan, avant la campagne du Sacre :
Jamais on ne vit pareille force à supporter la fatigue. Elle peut rester six jours et six nuits, sous le poids des armes, sans détacher une seule pièce de son armure.
Dans les nombreux combats auxquels elle prit part, la Pucelle fit preuve d’un courage héroïque : à Orléans, à Jargeau, sous les murs de Paris, à Saint-Pierre-le-Moutier, son intrépidité provoquait l’admiration. À la voir ainsi se porter aux endroits les plus périlleux, sans aucun souci du danger, certains se demandaient si elle n’avait pas reçu de ses Voix l’assurance 147qu’elle n’y trouverait pas la mort. La question lui ayant été un jour directement posée, elle répondit :
— Je n’en ai pas plus d’assurance que tout autre combattant.
Au courage du soldat, elle joignait l’activité, le coup d’œil, le savoir-faire du chef le plus habile. Ses compagnons d’armes les plus qualifiés sont unanimes à vanter ses talents militaires. Pour éviter des répétitions fastidieuses, nous n’en citerons que deux :
S’agissait-il, — dit de Thermes, — de conduire et de disposer l’armée, de préparer les batailles, d’animer le soldat, elle se conduisait comme le plus sagace capitaine, qui aurait passé toute sa vie au métier des armes.
Le duc d’Alençon est encore plus explicite :
En dehors du métier des armes, — dit-il, — Jeanne était une jeune fille bien simple ; mais, au fait de la guerre, elle se montrait très experte ; aussi habile à manier la lance qu’à ranger l’armée, à préparer la bataille, et surtout à disposer l’artillerie, en quoi elle excellait et causait l’admiration de tous. Un général, qui se serait exercé, durant vingt ou trente ans, au métier des armes, n’aurait pas mieux fait.
Dunois tient le même langage.
Il y a eu, de nos jours, des généraux, Français et étrangers, qui ont étudié les campagnes de Jeanne d’Arc, en hommes du métier. Chose remarquable, leurs appréciations, basées sur une science plus éclairée, enchérissent, s’il est possible, sur l’admiration de ses contemporains. Ils reconnaissent, dans sa stratégie, l’application des principes qui ont toujours dirigé les grands capitaines dans leurs opérations militaires : se concentrer rapidement, frapper vite, frapper fort, frapper aux points vitaux ; enfin, ne pas perdre son temps et dépenser ses efforts en vaines escarmouches, mais combattre sans relâche, avec une indomptable ténacité, jusqu’au succès final.
Ces qualités de la guerrière, force extraordinaire d’endurance, courage intrépide, génie militaire surtout, dépassent évidemment les capacités naturelles d’une jeune paysanne ; elles ne pouvaient donc venir que d’une assistance spéciale 148de Dieu, qui se plaît à opérer de grandes choses par les plus faibles instruments.
À une nature, déjà riche de son propre fonds, il avait surajouté des dons gratuits, en rapport avec la mission qu’il confiait à la fille de Jacques d’Arc. Aussi la regardait-on comme chose toute divine. L’un de ceux qui ont vécu le plus longtemps dans son intimité, Perceval de Cagny, déclare que
ses paroles et ses faits semblaient miraculeux à ceux de sa compagnie.
Elle-même n’en jugeait pas autrement, quand elle disait :
— Sans la grâce de Dieu, je ne saurais rien faire ; mon fait est un ministère, c’est-à-dire une charge imposée, avec garanties à l’appui.
Elle n’avait accepté ce ministère qu’avec une grande répugnance ; mais, une fois entrée dans la carrière, forte de sa confiance dans le secours promis, qui d’ailleurs ne lui fit jamais défaut, elle ne vit plus que le but à atteindre et s’y dépensa sans compter. Dieu fit le reste, en suppléant à ce qui lui manquait.
Amis et ennemis s’accordent à dire que la Pucelle était regardée comme une sainte par les Français :
Elle était pleine de toutes les vertus, — déclare son chapelain, Pasquerel.
Le chroniqueur Chastelain, bourguignon fanatique, constate avec dépit qu’
il y avait toutes sortes de gens du parti français, qui étaient persuadés que cette femme était une sainte créature, une chose divine et miraculeuse, envoyée pour le relèvement du roi de France.
§3. Vertus de la sainte
L’Église catholique a, de nos jours, confirmé ce jugement, en accordant à Jeanne d’Arc les honneurs de la canonisation, après avoir reconnu qu’elle a pratiqué les vertus chrétiennes, dans un degré héroïque. Parmi ces vertus, celles qui brillent en elle d’un plus vif éclat, sont l’obéissance, le dévouement désintéressé, la chasteté, l’humilité, la piété et la charité. Nous allons les passer brièvement en revue.
§4. Obéissance
L’Écriture nous dit que l’homme obéissant aura des victoires à raconter. Jamais, peut-être, cette parole ne s’est mieux vérifiée qu’en la personne de notre jeune sainte. Elle a certes remporté des victoires éclatantes ; mais aussi, quel acte 151héroïque d’obéissance elle eut à faire, pour entrer dans la carrière, où Dieu l’appelait ! Qu’on se figure quel dut être l’effroi de cette villageoise de dix-sept ans, élevée dans une famille pauvre, sans autres relations que d’humbles paysans, lorsqu’elle reçut l’ordre de quitter son pays, ses compagnes, ses parents, d’aller trouver le roi bien loin, pour guerroyer, seule parmi les hommes d’armes ! Elle hésita d’abord ; mais, lorsqu’elle eut bien compris que telle était la volonté de Dieu, elle imposa silence à ses répugnances, accepta, de tout son cœur, la lourde mission que le ciel lui confiait et fit preuve d’un joyeux entrain, qui ne la quittera plus.
— Je ne pouvais plus, — a-t-elle déclaré, — m’endurer où j’étais… Puisque Dieu commandait, quand j’aurais eu cent pères et cent mères, quand j’eusse été fille de roi, je serais partie.
Désormais elle ne s’appartiendra plus et sera tout entière, corps et âme, à sa mission. Elle l’a acceptée par obéissance ; l’obéissance la lui fera continuer jusqu’au bout, sans récriminations et sans un seul moment de défaillance, malgré tous les obstacles. La première et la plus grande difficulté, dont elle eut tout d’abord à triompher, fut de faire partager aux autres la foi qu’elle avait en cette mission. Nous avons vu avec quel zèle, quelle éloquence et quel succès elle s’y employa. À Vaucouleurs, à Chinon, à Poitiers, à Orléans, partout elle va répétant : Je suis envoyée de Dieu. À Rouen, devant ses juges, elle reproduira la même affirmation et, quand ils lui demanderont si ceux de son parti croient qu’elle est envoyée de Dieu, elle répondra modestement :
— Je n’en sais rien ; je m’en rapporte à leur cœur ; s’ils ne le croient pas, je n’en suis pas moins envoyée de par Dieu ; et, s’ils le croient, ils ne sont pas abusés en cela.
§5. Désintéressement
Il serait inutile, après ce qui a déjà été dit, d’insister sur le dévouement, que la Pucelle a montré dans l’accomplissement de sa mission ; mais il n’est pas hors de propos d’attirer l’attention sur son absolu désintéressement.
— J’ai demandé, — a-t-elle dit, — trois choses à mes Voix : la première, le succès de mon entreprise ; 152la seconde, que Dieu vienne en aide aux Français et qu’il garde les villes de leur obédience ; la troisième, le salut de mon âme.
Ainsi, rien pour elle, sinon le salut de son âme, dont elle ne pouvait se désintéresser sans péché.
Même désintéressement dans les requêtes qu’elle adresse au roi :
— Je ne demandais rien à mon roi, si ce n’est de bonnes armes, de bons chevaux et de l’argent pour payer les gens de mon hôtel.
L’anoblissement que Charles VII lui conféra, sans aucune démarche de sa part, semble l’avoir laissée fort indifférente. Les hochets de la vanité n’avaient pas prise sur une âme qui vivait dans la familiarité des saints du ciel.
§6. Chasteté
Au XVe siècle, on appelait communément pucelles les jeunes filles qui avaient conservé la fleur de leur intégrité virginale. Notre jeune sainte s’appropria ce nom, dès le début de son entreprise, sans doute par un sentiment d’humilité, mais sûrement aussi pour en faire un rempart à son innocence. Tantôt elle l’ajoutait, tantôt elle le substituait à son nom de baptême :
— J’ai nom Jehanne la Pucelle,
disait-elle en se présentant au roi, dans sa première entrevue. On lit, dans sa lettre aux Anglais :
Rendez à la Pucelle ;… attendez des nouvelles de la Pucelle ;… la Pucelle vous prie, etc.
Ce nom était, dès lors, si bien devenu le sien que les registres de la ville d’Orléans renferment des mentions de ce genre :
Donné à Jehan du Lys, frère de la Pucelle ;
Et même :
à Jehan de la Pucelle.
Cette fleur de candeur virginale, dont elle aimait à se parer, elle l’a jalousement gardée jusqu’à la fin. Quand ses juges lui demanderont si elle est vierge, elle leur répondra avec une tranquille assurance :
— Je puis affirmer que je suis telle.
Le matin même du jour où elle sera livrée au bourreau, on l’entendra répéter que son
corps, net en entier, ne fut jamais corrompu.
Notre Pucelle n’ignorait pas que la chasteté est une vertu délicate ; aussi ne négligeait-elle aucune précaution pour la mettre à l’abri. Afin de ne pas attirer les regards, elle avait 153adopté le costume des hommes d’armes et rien ne l’en distinguait extérieurement. La nuit, elle couchait toujours avec une jeune fille, quand elle se trouvait dans des lieux habités ; aux champs, elle prenait son repos toute vêtue, parfois même tout armée. D’ailleurs, sa réserve pudique, jointe au prestige que lui donnait sa mission inspirait le respect à tous ceux qui l’approchaient :
J’affirme, — dit Dunois, — que, ni moi, ni aucun autre, n’avons eu de désirs impurs en sa compagnie ; ce qui, à mon avis, est chose quasi divine.
On comprend après cela, que ceux qui l’ont connue l’aient vénérée comme une sainte.
§7. Humilité
Si la pureté de Jeanne n’a jamais été effleurée par le plus léger soupçon, au moins dans le parti français, il n’en fut pas de même de son humilité ; plusieurs la taxèrent d’orgueil, à tort assurément, mais d’après certaines apparences, qui expliquent, sans le justifier, ce jugement injuste. En effet, les devoirs et les droits qui découlaient, pour elle, de sa mission divine, ne pouvaient manquer de la mettre plus d’une fois, surtout au début, en opposition avec les conseillers du roi et les chefs de l’armée qui prétendaient bien ne rien céder de leur autorité. Ils lui reprochaient donc de ne pas tenir compte de leurs avis, d’aller contre leurs ordres et d’imposer sa volonté. Ils s’obstinaient à ne pas voir qu’en agissant de la sorte elle accomplissait simplement son devoir, puisqu’elle obéissait à Dieu, qui lui dictait sa conduite, par le ministère de ses Voix. Leur orgueil s’en trouvait donc froissé. De là, à l’accuser d’être elle-même orgueilleuse, il n’y avait qu’un pas, qui fut vite franchi.
Plusieurs, sans doute, modifièrent cette première impression, quand ils eurent vu sa mission confirmée par des succès prodigieux ; mais d’autres ne lui pardonnèrent pas de les avoir humiliés. De ce nombre fut l’archevêque-chancelier, Regnault de Chartres. La lettre qu’il écrivit aux habitants de Reims, pour leur annoncer la prise de la Pucelle, en fournit une preuve sans réplique. Loin de s’apitoyer sur le sort de l’héroïne, il semble plutôt se féliciter d’être enfin débarrassé de sa personne.
Elle 154avait, — disait-il, — mérité ce malheur, parce qu’elle avait une confiance excessive en ses forces et en son propre sens, qu’elle ne voulait croire conseil, mais faisait tout à son plaisir.
Elle est d’ailleurs déjà remplacée par un pastour du Gévaudan, qui vient d’arriver à la Cour. Ce berger dit qu’il fera
ni plus ni moins ce qu’avait fait Jehanne la Pucelle ; qu’il a commandement de Dieu d’aller avec les gens du roi, et que, sans faute, les Anglais et les Bourguignons seront déconfits18. Il dit aussi que Dieu avait souffert que Jeanne fût prise parce qu’elle s’était constituée en orgueil et pour les riches habits qu’elle avait pris, et qu’elle n’avait pas fait, ce que Dieu lui avait commandé, mais avait fait sa volonté.
L’accusation est grave ; nous allons l’examiner en détail.
D’abord, que la Pucelle n’ait pas voulu prendre conseil de La Trémoille et de son agent, le chancelier, qu’elle ait plus d’une fois contrarié leurs projets, le fait est certain et nous n’avons pas à l’en justifier ; en ce faisant, elle obéissait à ses Voix et remplissait sa mission.
Quant au second grief, savoir : qu’elle n’a pas fait ce que Dieu lui commandait, l’accusation du berger, contresignée par l’archevêque, est purement gratuite, puisqu’elle était seule à connaître les ordres que Dieu lui donnait. De plus, elle est absolument fausse ; Jeanne l’a déclaré elle-même en termes formels, sous la foi du serment :
— Tout ce que j’ai fait, c’est sur l’ordre de Dieu ; et tout ce que j’ai fait sur le commandement de Dieu, ie pense l’avoir bien fait.
Reste un troisième grief : elle avait pris de riches habits. Le fait est vrai : après la délivrance d’Orléans, le trésorier du duc, en reconnaissance de ce service signalé, lui fit cadeau de vêtements somptueux, aux couleurs de la maison ducale, savoir : une robe en drap cramoisi superfin de Bruxelles et une huque 155 — sorte de casaque, sans manches, qui se portait sur l’armure — en drap vert sombre, doublées l’une et l’autre de fines étoffes. Ce cadeau, venant d’un prince prisonnier des Anglais et pour lequel elle avait toujours montré une vive sympathie, ne pouvait que lui être très agréable. Elle se para donc de ces riches habits, non pour se constituer en orgueil, mais parce qu’ils convenaient à la grandeur de son rôle et étaient de nature à lui faciliter sa tâche.
Si elle n’eût pas été habillée somptueusement, — remarque Quicherat, — on ne l’eût pas réputée chef de guerre et elle n’aurait pas pris l’ascendant qu’elle exerça sur les troupes.
Vraiment, un prélat, qui portait des chapes en drap d’or et des mitres précieuses, ornées de pierreries, n’aurait pas dû s’offusquer de voir la messagère de Dieu revêtue d’un costume en rapport avec sa dignité. Le scandale est ici purement pharisaïque.
La vérité est que Jeanne est restée humble de cœur, dans une situation, qui n’eut jamais sa pareille ; les merveilles, dont elle fut l’instrument, ne lui firent jamais oublier son propre néant :
— Sans la grâce de Dieu, — disait-elle, — je ne saurais rien faire.
Elle garda toujours, au milieu de ses triomphes, une simplicité d’enfant. L’admiration, dont elle était l’objet, et les hommages qu’on lui rendait, la faisaient souffrir et elle s’en défendait de son mieux. Elle-même s’en est expliquée en ces termes :
— Si quelques personnes ont baisé mes mains ou mes vêtements, ce n’est pas par ma volonté ; je m’en faisais garder et le l’empêchais de tout mon pouvoir.
Elle était la première à se moquer de la crédulité superstitieuse de certaines gens, qui attribuaient à son contact une sorte de vertu surnaturelle ; témoin la scène plaisante, racontée par la femme du trésorier général, chez qui elle résidait à Bourges : des femmes venaient présenter à Jeanne des objets de piété en la priant de les toucher. Elle riait de leur naïveté et, se tournant vers son hôtesse :
— Touchez-les, vous, — disait-elle ; — ils seront aussi bons de votre toucher que du mien.
156Mais s’agissait-il de ce qui était du ressort de sa mission, alors sa parole devenait grave, imposante et parfois impérieuse. Dans ses lettres aux Anglais, au duc de Bourgogne, aux habitants de Troyes, elle exhorte, commande, menace, d’un ton autoritaire, qui surprend de la part d’une jeune fille de sa condition ; tout d’abord, on serait tenté d’y voir de l’arrogance. Il n’en est rien pourtant ; car, dans ce cas, nous n’avons pas affaire avec la fille de Jacques d’Arc, mais avec la mandataire de Dieu, qui parle et agit comme telle, en vertu de l’autorité que lui donne son mandat. Elle avait d’ailleurs pleine conscience et de la grandeur de sa mission et de son insuffisance personnelle. Ce double sentiment se fait jour dans sa réponse aux juges, qui lui demandaient pourquoi Dieu l’avait choisie plutôt qu’un autre :
— Il a plu à Dieu ainsi faire, par une simple pucelle, pour rebouter les ennemis du roi.
Ainsi, à ses yeux, c’est Dieu et Dieu seul, qui a tout fait ; elle n’a été que son instrument. Voilà bien le langage de l’humilité vraie.
§8. Piété
La vie des camps n’a jamais passé pour être favorable à la piété. Elle l’était peut-être moins encore, qu’en d’autres temps, dans la période troublée où vécut la Pucelle. Les grossiers soudards, parmi lesquels elle se trouve brusquement transplantée, au sortir de son village, ne ressemblaient guère aux bons habitants de Domrémy. C’était un ramas d’aventuriers de tout pays et de tout acabit, gens de sac et de corde, pour la plupart sans foi ni loi. La vue de leur misère morale donna un nouvel élan à sa piété, en lui faisant éprouver le besoin de se tenir en communication plus intime avec Dieu ; sa prière en devint plus fervente et sa pratique des sacrements plus fréquente.
Elle se confessait souvent, avec de grands sentiments de componction, assistait tous les jours au saint sacrifice de la messe et y communiait deux ou trois fois par semaine. On voyait souvent de grosses larmes rouler sur ses joues, lorsque le prêtre lui présentait le corps de Notre-Seigneur. Son bonheur était 157de le recevoir, en compagnie des petits enfants, qu’on élevait dans les monastères, et elle avait soin de s’informer du jour où ils devaient communier.
En campagne, elle réunissait devant sa bannière, matin et soir, les hommes d’armes qui s’étaient confessés, et chantait avec eux des antiennes et des hymnes à la Sainte Vierge. Lorsqu’elle arrivait dans une ville ou une bourgade, son premier soin était d’aller à l’église adorer le Saint Sacrement. La nuit, elle interrompait souvent son sommeil, se mettait à genoux et adressait à Dieu de ferventes prières. Cette piété était, chez elle, le fruit de la crainte et surtout de l’amour de Dieu :
— J’aimerais mieux mourir, — disait-elle, — que de faire ce que je saurais être un péché, en opposition avec le commandement de Dieu. Je l’aime de tout mon cœur.
§9. Charité
La vraie piété n’est pas égoïste ; elle aime à rayonner, à s’épanouir en œuvres de miséricorde, pour subvenir aux besoins spirituels ou corporels du prochain. Telle fut la piété de la Pucelle. Jean de Metz, son trésorier, déclare qu’elle aimait à faire l’aumône, qu’elle lui demandait souvent des pièces de monnaie, pour les distribuer aux pauvres. Les miséreux trouvaient facilement accès près d’elle :
— Ils venaient volontiers vers moi, — dit-elle, — parce que je ne leur faisais pas de déplaisir et que je les aidais selon mon pouvoir.
Du reste, elle se montrait bonne et accueillante à tout le monde, même aux ennemis. Un jour, apercevant un prisonnier anglais, qui venait d’être dangereusement blessé, elle s’arrête, descend de cheval, lui pose la tête sur ses genoux et ne le quitte qu’après l’avoir confié aux bons soins d’un prêtre. En divers endroits, pour faire plaisir aux parents, elle accepta d’être marraine de leurs enfants :
— Volontiers, — dit-elle, — je donnais aux garçons le nom de Charles, en l’honneur de mon roi, et aux filles, celui de Jeanne ; quelquefois aussi, je donnais le nom qui agréait aux mères.
C’étaient pourtant les besoins spirituels du prochain, qui étaient le principal objet de son zèle, et elle eut bien souvent 158l’occasion d’exercer sa charité à cet égard. En effet, nous l’avons déjà dit, ses compagnons d’armes étaient loin d’être des saints : la luxure, le blasphème et le vol étaient passés, chez la plupart d’entre eux, à l’état d’habitudes invétérées. Faire disparaître ces vices était humainement impossible. Elle l’entreprit cependant dès son entrée en campagne, et, avec l’aide de Dieu, elle y réussit dans une large mesure, tant était grand l’ascendant qu’elle exerçait autour d’elle.
Avant son arrivée, le libertinage le plus effronté s’étalait au grand jour dans l’armée. Son premier soin fut de le réprimer impitoyablement. Elle obligea les hommes d’armes à renvoyer les femmes, qu’ils menaient avec eux, ou à les épouser. Jamais elle ne se relâcha, ni dans sa vigilance à guetter les désordres de ce genre, ni dans son énergie à les réprimer ; quand les exhortations, les ordres et les menaces ne suffisaient pas, elle n’hésitait pas à employer la violence :
Je l’ai vue à Saint-Denis, — dit le duc d’Alençon, — poursuivre une fille, surprise dans l’armée, et la frapper avec tant de vigueur qu’elle en brisa son épée.
Les blasphèmes, que proféraient continuellement les hommes d’armes et leurs chefs, lui inspiraient une sainte horreur. Elle les réprimait sur-le-champ, quel que fût le rang de celui qui s’en rendait coupable. Le duc d’Alençon lui-même n’était pas épargné. Il tenait d’ailleurs grand compte des reproches, qu’elle ne lui ménageait pas plus qu’aux autres.
Sa vue seule, — déclare-t-il, — suffisait pour me réfréner et faire expirer les jurements sur mes lèvres.
Un jour, à Orléans, sur une place publique, entendant un grand seigneur proférer un horrible juron — jarnidié, je renie Dieu — elle s’approche, indignée, et, mettant la main au collet du blasphémateur :
— Osez-vous bien, — s’écrie-t-elle, — renier Notre-Seigneur et notre maître ? En nom Dieu, vous vous en dédirez avant que je parte d’ici.
Le coupable exprima publiquement son repentir et promit de se corriger. Le vaillant capitaine La Hire avait souvent le même juron sur les lèvres et prétendait, comme beaucoup d’autres, n’y pas voir de mal, 159parce qu’il le proférait sans mauvaise intention :
— Eh bien ! disait la Pucelle, au lieu de renier Dieu, dites jarni bâton.
Non contente d’avoir ramené la décence dans le camp en réprimant par voie d’autorité le libertinage, le blasphème, et aussi, comme il a été dit, la maraude, au moins dans les limites du possible, elle se fit apôtre auprès des hommes d’armes, s’appliquant avec une sainte obstination à réveiller leurs consciences endormies et à les détacher du péché. À Orléans, avant l’assaut des Tourelles, elle fit publier qu’elle ne voulait avoir avec elle que ceux qui auraient purifié leur conscience par une bonne confession, parce que le péché fait perdre les batailles. Spectacle merveilleux ! soldats et capitaines, subjugués par l’ascendant que lui donnaient l’éclat de ses vertus et l’auréole de sa mission divine, obéissaient comme des enfants à cette jouvencelle de dix-sept ans. Ces conversions, fruit de son apostolat parmi ses compagnons d’armes, sont-elles moins admirables que ses victoires sur les Anglais ?
Notes
- [7]
En voici le texte légèrement rajeuni :
Jhesus-Maria
Roi d’Angleterre, et vous duc de Bedfort, qui vous dites régent du royaume de France ; vous, Guillaume de la Poule, comte de Sufford ; Jehan, sire de Talbot ; Thomas, sire d’Escales, qui vous dites lieutenants du dit duc de Bedfort, faites raison au roi du Ciel ; rendez à la Pucelle, qui est ici envoyée de par Dieu, le roi du Ciel, les clefs de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est venue de par Dieu pour réclamer le sang royal. Elle est toute prête à faire la paix, si vous lui voulez faire raison, par ainsi que vous laissiez la France et payiez pour ce que vous l’avez tenue.
Et vous, archers, compagnons de guerre, gentilshommes et autres, qui êtes devant là ville d’Orléans, allez-vous-en en votre pays, de par Dieu ; et si ainsi ne le faites, attendez les nouvelles de la Pucelle, qui vous ira bientôt voir, à votre bien grand dommage.
Roi d’Angleterre, si ainsi ne le faites, je suis chef de guerre, et, en quelque lieu que j’atteindrai vos gens en France, je les ferai s’en aller, qu’ils le veuillent ou non, et s’ils ne veulent obéir, je les ferai tous occire. Je suis envoyée de par Dieu, le roi du Ciel, corps pour corps, pour vous bouter hors de toute la France. S’ils veulent obéir, je les prendrai à merci.
N’ayez point en votre opinion que vous tiendrez le royaume de France, qui est à Dieu, le roi du Ciel, fils de Sainte Marie. Mais le tiendra le roi Charles, vrai héritier : car Dieu, le roi du Ciel, le veut et il le lui a révélé par la Pucelle. Il entrera à Paris en bonne compagnie.
Si vous ne voulez croire les nouvelles de par Dieu et la Pucelle, en quelque lieu que nous vous trouverons, nous vous frapperons du fer et ferons un si grand hahay, que, depuis mille ans, il n’y en eut pas un si grand en France, si vous ne faites raison.
Et croyez fermement que le roi du Ciel enverra à la Pucelle plus de forces que vous n’en sauriez amener contre elle et ses bonnes gens d’armes. Aux horions on verra qui aura meilleur droit de Dieu du ciel.
Vous, duc de Bedfort, la Pucelle vous prie et vous requiert que vous ne vous fassiez pas occire.
Si vous lui faites raison, vous pourrez encore venir en sa compagnie, où que les Français feront le plus beau fait qui oncques fut fait pour la Chrétienté.
Et faites réponse si vous voulez faire paix en la cité d’Orléans : et, si vous ne le faites, de vos bien grands dommages qu’il vous souvienne bientôt.
Écrit ce mardi de la Semaine sainte.
Cette lettre se trouve reproduite avec de légères variantes, dans les Chroniques du XVe siècle. Le texte ci-dessus est celui qui fut lu à la Pucelle, au cours de son procès (séance du 22 février). Elle en reconnut l’exactitude, sauf trois expressions : au lieu de : rendez à la Pucelle, il faudrait lire : rendez au roi ; puis supprimer chef de guerre et corps pour corps, qui n’étaient pas dans l’original.
- [8]
Elle avait déjà, étant encore à Chinon, annoncé au roi qu’elle serait blessée de la sorte et qu’elle n’en continuerait pas moins de besogner. Cette prédiction est relatée dans une lettre écrite le 22 avril, c’est-à-dire quinze jours avant l’événement.
- [9]
Sobriquet populaire des Anglais.
- [10]
Voici le texte de cette lettre :
✝ Jhesus ✝ Maria
Gentils loyaux Français de la ville de Tournay, la Pucelle vous fait sçavoir des nouvelles de par deça. En VIII jours, elle a chassé les Anglais hors de toutes les places qu’ils tenaient sur la rivière de Loire, par assaut ou autrement. Il y en a eu maints morts et maints prisonniers, et elle les a déconfits en bataille. Et croyez que le comte de Sufford, la Poule, son frère, le sire de Talbot, le sire de Scalles et messire Jean Fascolf et plusieurs chevaliers et capitaines ont été pris, et le frère du comte de Sufford et Glasdas, morts.
Maintenez-vous bien loyaux Français, je vous en prie. Et vous prie et vous requiers que vous soyez tout prêts de venir au Sacre à Reims, où nous serons brièvement. Venez au devant de nous, quand vous saurez que nous approchons.
À Dieu vous recommande ; que Dieu soit garde de vous et vous donne grâce pour que vous puissiez maintenir la bonne querelle du royaume de France.
Écrit à Gien, le XXVe jour de juin.
- [11]
Cette lettre était rédigée en ces termes :
✝ Jhesus ✝ Maria
Très Chers et bons amis, s’il ne tient qu’à vous, seigneurs, bourgeois et habitants de la ville de Troyes, la Pucelle vous mande et vous fait sçavoir de par le roi du Ciel, son droiturier et souverain Seigneur, au service royal duquel elle est un chascun jour, que vous fassiez vraie obéissance et reconnaissance au gentil roi de France, qui sera bien brief à Reims et à Paris, qui que vienne contre, et en ses bonnes villes du Saint Royaulme, à l’aide du roi Jhésus.
Loyaux Français, venez au devant du roy Charles et qu’il n’y ait point de faute, et n’ayez pas d’inquiétude pour vos corps et vos biens, si ainsi le faites. Et si ainsi ne le faites, je vous promets et certifie, sur vos vies, que nous entrerons, à l’aide de Dieu, en toutes les villes qui doivent être du Saint Royaulme, et y ferons bonne paix ferme, qui que vienne contre.
À Dieu vous recommande ; Dieu soit garde de vous, s’il lui plaist. Réponse brief devant la cité de Troyes. — Écrit à Saint-Fales, le mardi, quatriesme jour de Juillet.
(Saint-Phal est à 20 kilomètres de Troyes.)
- [12]
Voici le texte de cette lettre :
✝ Jhesus Maria
Haut et redouté prince, duc de Bourgogne, Jehanne la Pucelle vous requiert, de par le roi du Ciel, son droiturier et souverain Seigneur, que le roi de France et vous fassiez bonne paix ferme, qui dure longuement. Pardonnez de bon cœur l’un à l’autre entièrement, ainsi que doivent faire loyaux chrétiens, et s’il vous plaît guerroyer, allez contre les Sarrazins.
Prince de Bourgogne, je vous prie, supplie et requiers, tant humblement que requérir vous puis, que vous ne guerroyiez plus au saint royaume de France, et faites retirer incontinent vos gens qui sont en aucunes places et forteresses du dit saint royaume. De la part du gentil roi de France, il est tout prêt de faire la paix avec vous, sauf son honneur ; cela ne tient qu’à vous.
Et je vous fais savoir, de par le roi du Ciel, mon droiturier et souverain Seigneur, pour votre bien et pour votre honneur et sur vos vies, que vous ne gagnerez point bataille à l’encontre des loyaux Français et que tous ceux qui font la guerre au dit saint royaume de France, font la guerre au roi Jhésus, roi du Ciel et de tout le monde, mon droiturier et souverain Seigneur. Et je vous prie et vous requiers, à jointes mains, que vous ne fassiez nulle bataille, ni ne guerroyiez contre nous, vous, vos gens ou sujets, et croyez sûrement que, quelque nombre de gens que vous ameniez contre nous, ils n’y gagneront rien, et ce sera gran pitié de la gran bataille et du sang, qui y sera répandu, de ceux qui viendront contre nous.
Et il y a trois semaines que je vous avais écrit et envoyé bonnes lettres par un héraut que vous fussiez au Sacre du roi, qui, aujourd hui dimanche, XVIIe jour de ce présent mois de Juillet, se fait en la cité de Reims, dont je n’ai point eu de réponse, ni ouï oncques depuis nouvelles du dit héraut.
À Dieu vous recommande et qu’il soit garde de vous, s’il lui plaît, et prie Dieu qu’il y mette bonne paix.
Écrit au dit lieu de Reims, le dit XVIIe jour de juillet.
- [13]
Le fait suivant, dûment authentiqué par un acte officiel de l’administration anglaise, est une preuve, sans réplique, des sentiments dont ils étaient animés : Un jour, à Abbeville, dans un groupe formé sur la place publique, on s’entretenait des hauts faits de la Pucelle. Deux individus, Petit et Colin, crurent devoir protester et se permirent de dire :
Bren, bren, quelque chose qu’ait dit et fait cette femme, ce n’est qu’abusion ; on ne doit pas y ajouter foi et ceux qui ont créance en elle sont fols et sentent la persinée ; et il y en a plusieurs dans cette ville qui sentent la persinée,
voulant dire par là qu’ils mériteraient d’être mis à mort, le persil étant une plante funéraire. Malheureusement pour eux, le maire et les échevins eurent connaissance de ces propos et, comme ils étaient de ces fous qui avaient créance en la Pucelle, ils firent saisir ses deux blasphémateurs et les tinrent
longuement en dures et étroites prisons, [d’abord] à Abbeville, où ils furent un certain espace de temps en grande rigueur par le fait des dits maire et échevins,
puis à Amiens, où ils étaient encore incarcérés un an après. Non seulement cela se passait en des villes soumises à la domination anglaise, mais, chose non moins étrange ! tous les détails, qu’on vient de lire, sont consignés dans, les lettres de rémission, qui furent délivrées au nom du roi d’Angleterre.
- [14]
Voici la teneur de la lettre :
Mes chers et bons amis, les bons et loyaux Français de la cité de Reims, Jehanne la Pucelle vous fait savoir de ses nouvelles et vous prie et vous requiert que vous ne faites nul doute en la bonne querelle qu’elle mène pour le sang royal, et je vous promets et certifie que je ne vous abandonnerai pas, tant que je vivrai.
Et est vrai que le roi a fait trêves au duc de Bourgogne, quinze jours par devant, par ainsi qu’il doit lui rendre la ville de Paris au chef de quinze jours. Cependant ne vous donnez nulle merveille si je n’y entre si brièvement. Combien que des trêves, qui ainsi sont faites, je ne sois point contente et ne sais si je les tiendrai. Mais, si je les tiens ce sera seulement pour garder l’honneur royal. Combien aussi que ils ne rabuseront point le sang royal ; car je tiendrai et maintiendrai ensemble l’armée du roi, pour être toute prête au dit chef des dits quinze jours, s’ils ne font la paix.
Pour ce, mes très chers et parfaits amis, je vous prie que vous ne vous en donniez pas malaise, comme je vivrai, mais vous requiers, que vous faites bon guet et gardez la bonne ville du roi et me faites savoir s’il y a aucuns triteurs qui vous veuille grever, et, au plus brief que je pourrai je les en ôterai et me faites savoir de vos nouvelles.
À Dieu vous recommande pour qu’il soit garde de vous.
Écrit ce vendredi, cinquième jour d’août, près d’un logis aux champs, sur le chemin de Paris.
- [15]
Voici le texte de la lettre envoyée à Riom :
Chers et bons amis, vous savez bien comme la ville de Saint-Pierre-le-Moustier a été prise d’assaut, et, à l’aide de Dieu, ai intention de faire vider les autres places, qui sont contraires au roi ; mais, pour ce que grant dépenses de poudres, traits et autres habillements de guerre a été faite devant la dite ville, et que petitement les Seigneurs, qui sont en cette ville, et moi, en sommes pourvus pour aller mettre le siège devant la Charité, où nous allons présentement, je vous prie, sur tant que vous aimez le bien et l’honneur du roi et aussi de tous les autres de par ça, que veuillez incontinent envoyer et aider de poudres, salpêtre, soufre, arbalestres fortes et d’autres habillements de guerre. Et, en ce, faites tant, que, par faute des dites poudres et autres habillements de guerre, la chose ne soit longue et que on ne vous puisse dire en ce être négligents et refusants.
Chers et bons amis, Notre Sire soit garde de vous. Écrit à Molins, le neuvième jour de Novembre.
Jehanne.
L’original de cette lettre est conservé à la mairie de Riom ; elle est la première en date qui soit signée.
- [16]
Très chers et bien aimés et bien désirés à voir, Jehanne la Pucelle, ai reçu vos lettres faisant mention que vous vous doutiez d’avoir le siège. Veuillez savoir que vous ne l’aurez point, si je puis les rencontrer. Et si ainsi était que je ne les rencontrasse, et qu’ils vinssent devers vous, fermez bien vos portes ; car je serai bien brief vers vous, et si eux y sont, je leur ferai chausser les éperons si en hâte qu’ils ne sauront par où les prendre.
Autre chose ne vous écris pour le présent, mais que vous soyez toujours bons et loyaux. Je prie Dieu qu’il vous ait en sa garde.
Écrit à Sully, le XVIe jour de mars.
Je vous manderais encore quelques nouvelles, dont vous seriez bien contents, mais je craindrais que les lettres ne fussent prises en chemin et que l’on ne vît les dites nouvelles.
Jehanne.
- [17]
Très chers et bons amis, plaise vous savoir que j’ai reçu vos lettres, lesquelles font mention comment on a rapporté au roi que, dedans la bonne cité de Reims, il en avait moult de mauvais. Ainsi, veuillez savoir que c’est bien vrai qu’on lui a rapporté vraiment qu’il y en avait beaucoup qui devaient trahir la ville et mettre les Bourguignons dedans.
Et depuis le roi a bien su le contraire, parce que vous lui en avez envoyé la certaineté, dont il est très content de vous ; et croyez que vous êtes bien en sa grâce ; et, si vous aviez à besogner au regard du siège, il vous secourrait, et connaît bien que vous avez moult à souffrir pour la dureté que vous font ces traîtres Bourguignons adversaires : aussi, vous en délivrera au plaisir Dieu, bien brief, c’est-à-dire à savoir le plus tôt que faire se pourra. Si, vous prie et vous requiers, très chers amis, que vous gardiez bien la dite bonne cité pour le roi et que vous fassiez bon guet.
Vous ouïrez bientôt de mes nouvelles plus à plein. Autre chose, à présent ne vous écris fors que toute Bretagne est française et doit le duc envoyer au roi III mille combattants, payés pour deux mois.
À Dieu vous recommande, qui soit garde de vous. Écrit à Sully le XXVIIIe jour de Mars.
Jehanne.
- [18]
Le pastour tomba bientôt aux mains des Anglais ; après l’avoir traîné ignominieusement à Paris, ils le noyèrent dans la Seine ; enfermé dans un sac.