Livre III : La Martyre
161Livre III La Martyre
Chapitre premier Jeanne prisonnière
§1. Prise de la Pucelle
Nous avons vu précédemment que la Pucelle était entrée de grand matin à Compiègne, avec des renforts qu’elle amenait de Crépy. Elle n’eut rien de plus pressé que de se rendre à l’église pour y faire ses dévotions ; elle se confessa, entendit la messe et communia.
Le soir de ce même jour (23 mai 1430), elle voulut, malgré la fatigue de sa chevauchée nocturne, aller déloger les Bourguignons, qui occupaient Margny, gros bourg situé en face de Compiègne, sur la rive opposée de l’Oise. Vers quatre ou cinq heures, elle sortit donc de la ville, montée sur un superbe cheval gris pommelé et portant, sur son armure, une riche huque en drap d’or vermeil. Cinq à six cents hommes l’accompagnaient, 162les uns à cheval, les autres à pied. Les Bourguignons, qui ne s’attendaient pas à être attaqués, avaient presque tous quitté leurs armures ; ils se mirent cependant en défense et la mêlée commenta par de grands cris, de part et d’autre.
Des seigneurs bourguignons, qui venaient rendre visite au commandant de Margny, ayant entendu cette clameur, se hâtèrent de rebrousser chemin et d’aller informer de ce qui se passait les postes voisins et le duc de Bourgogne, qui se trouvait à une lieue de là. L’ennemi reçut bientôt des renforts considérables et les Français, qui s’étaient d’abord flattés de remporter un succès facile, se virent obligés de reculer.
La Pucelle, plus vaillante que jamais, continuait de faire face à l’ennemi et de protéger la retraite des siens avec une poignée de braves ; de sorte qu’à la fin, elle se trouva presque seule, en compagnie de son majordome. Un archer la saisit de côté par sa huque et la fit tomber de cheval,
plus heureux, — dit un chroniqueur bourguignon, — que s’il eût eu un roi entre les mains.
Sommée de se rendre, elle répondit fièrement :
— J’ai baillé ma foi à un autre que vous et je lui tiendrai mon serment.
Avec elle fut pris d’Aulon et quelques autres, en très petit nombre.
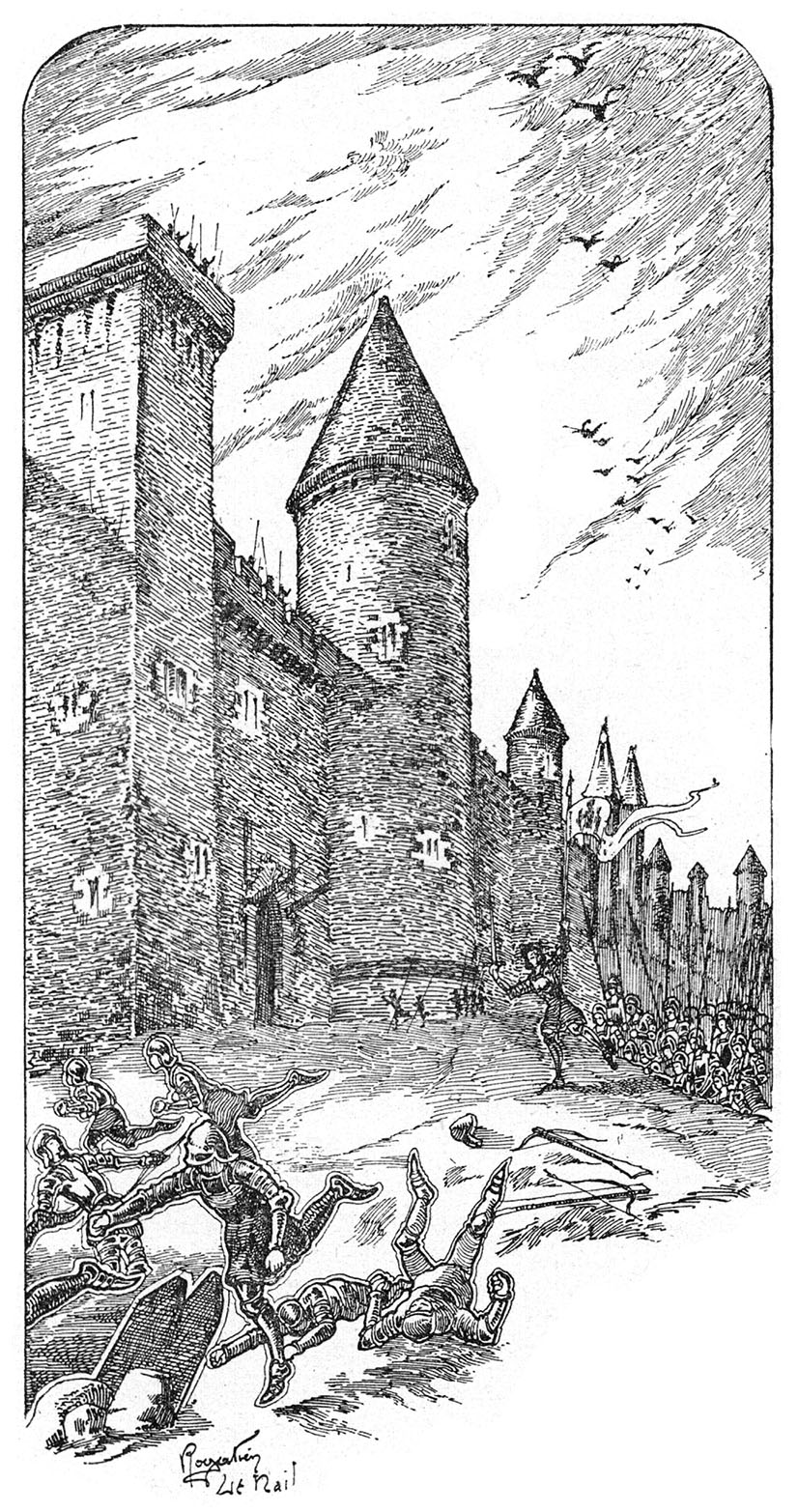
Le gouverneur de Compiègne, Guillaume de Flavy, avait fait fermer la porte de la ville après la rentrée des fuyards, pendant que Jeanne luttait encore courageusement. C’est pourquoi il fut soupçonné d’avoir joué, en cette affaire, le rôle d’un traître. On disait qu’il avait reçu plusieurs lingots d’or, pour fermer la porte, afin de faire tomber la Pucelle aux mains des Bourguignons. Il n’était d’ailleurs pas homme à reculer devant un crime, lorsque son intérêt était en jeu : débauché, voleur, meurtrier, parricide — il fit mourir ses beaux-parents pour s’emparer de leurs biens — sa vie fut celle d’un des monstres féodaux les plus complets de cette époque, où il y en eut tant. Mais, pour charger sa mémoire de ce nouveau forfait, il faudrait des preuves et on n’en a pas.
165En effet, du récit que la Pucelle a fait de cette funeste sortie, il semble bien ressortir qu’elle fut victime, non de la trahison, mais de son propre courage, qui l’avait entraînée trop loin des siens.
— J’allai, — dit-elle, — avec la compagnie des gens de mon parti sur les gens de Monseigneur de Luxembourg et, par deux fois, je les repoussai jusqu’aux logis des Bourguignons, et, à la troisième fois, jusqu’à mi-chemin. Alors, les Anglais, qui étaient là, coupèrent, à moi et à mes gens, le chemin de la retraite ; et moi, en me retirant par les champs, devers la Picardie, je fus prise près du boulevard ; il n’y avait entre le lieu où je fus prise et Compiègne que la rivière, le boulevard et le fossé du dit boulevard.
Le duc de Bourgogne, — dit Monstrelet, — alla la voir au lieu où elle était et lui adressa quelques paroles, dont je n’ai pas souvenance.
Ce manque de mémoire, chez le chroniqueur attitré du parti bourguignon, paraît bien extraordinaire ; car l’entrevue ne dut pas être banale ; mais peut-être ne tourna-t-elle pas à l’avantage du prince ; car nous savons que Jeanne parlait fort bien et qu’elle ne craignait pas de dire de dures vérités aux grands. C’est sans doute pour cela que Monstrelet aura jugé à propos de ne pas s’en souvenir, quand il écrivit sa chronique : le courtisan aura imposé silence à l’historien.
Jeanne étant tombée aux mains du comte Jean de Luxembourg, elle devenait la prisonnière de ce seigneur. D’Aulon partagea sa captivité, au château de Beaulieu d’abord, puis à celui de Beaurevoir.
§2. Anglo-bourguignons triomphants ; Français consternés
La prise de Jeanne causa des transports de joie parmi les Anglo-Bourguignons.
Ils en furent très joyeux, — dit Monstrelet ; — plus que d’avoir pris cinq cents combattants ; car ils ne craignaient et ne redoutaient aucun capitaine, aucun chef de guerre, autant que, jusqu’à ce jour, ils avaient redouté cette Pucelle.
Le jour même, malgré l’heure avancée, le duc de Bourgogne expédiait des lettres à Saint-Quentin et à Gand, pour annoncer le grand événement :
Notre benoît créateur, — y disait-il, — nous a fait la grâce que… la Pucelle a été prise… De cette prise seront 166grandes nouvelles partout.
Partout, en effet, ce fut un long cri de triomphe, dans le parti anglo-bourguignon.
Mais, nulle part, il n’éclata plus joyeux et en même temps plus haineux qu’à Paris. Le lendemain du jour où l’on y avait appris la grande nouvelle, le greffier de l’Université adressait sommation au duc de Bourgogne de remettre la prisonnière à l’inquisiteur, pour être jugée, selon
bon conseil, faveur et aide des bons docteurs et maîtres de l’Université.
Ces bons docteurs, bourguignons fanatiques, n’oubliaient pas qu’ils avaient là une occasion inespérée de venger une injure personnelle. En soutenant la cause royale, condamnée par eux, cette paysanne ignorante n’avait-elle pas eu l’audace de ne tenir aucun compte des arrêts de leur docte compagnie ? Dès lors, et sans plus ample examen, l’envoyée de Dieu ne pouvait être, à leurs yeux, qu’un suppôt du démon et devait être punie en conséquence. Aussi les verrons-nous poursuivre leur vengeance sans relâche, jusqu’à ce qu’ils aient conduit leur victime au bûcher de Rouen.
Dans le parti français, chose triste à dire ! il y en eut qui virent disparaître la Pucelle, non seulement sans regret, mais avec satisfaction ; tels, La Trémoille, Regnault de Chartres, et aussi, disait-on, certains capitaines jaloux de sa gloire. Mais l’armée et le peuple furent consternés. L’archevêque d’Embrun, Gélu, n’eut pas plutôt appris la fatale nouvelle qu’il écrivit à Charles VII. Après lui avoir rappelé les grâces dont Dieu l’avait comblé par le moyen de la Pucelle et les victoires prodigieuses qu’il devait à son intervention, il lui recommande de ne rien négliger pour la délivrance de la prisonnière, de
n’épargner pour cela ni démarches, ni argent, ni quelque dépense que ce soit, s’il ne veut encourir le blâme ineffaçable d’une très reprochable ingratitude. [Il lui demande, en outre,] de faire ordonner partout des prières pour la délivrance de la captive.
Ces prières furent, en effet, ordonnées ; ce sont, entre autres, trois oraisons, collecte, secrète et postcommunion que les prêtres 167récitaient à la messe19. En beaucoup d’endroits, il y eut, à cette occasion, de grandes démonstrations religieuses. À Tours, on fit une procession générale, à laquelle prirent part, pieds nus, les chanoines et tout le clergé, tant séculier que régulier. Le peuple comprenait la grandeur de la perte que la nation venait de faire et donnait partout des témoignages de sa douleur.
Les ministres, qui dirigeaient alors les affaires de l’État et disposaient de la volonté du roi, étaient loin, nous l’avons vu, de partager ces sentiments. Malgré la recommandation pressante de Gélu, rien ne laisse supposer qu’ils aient tenté quoi que ce soit pour sauver la captive. Le moyen le plus simple, d’usage courant à cette époque, eût été de l’acheter à Jean de 168Luxembourg ; celui-ci, cadet sans grande fortune, n’eût sûrement pas refusé de l’échanger contre une grosse somme, d’autant que sa femme et sa tante étaient très favorables à la Pucelle et à la cause française. Il eût évidemment fallu y mettre le prix, comme firent les Anglais, quelques mois plus tard. Les ministres jugèrent plus à propos de garder l’argent et de laisser ainsi leur maître endosser
le blâme ineffaçable d’une très reprochable ingratitude.
§3. Jeanne à Beaurevoir
De Clairoix, où la Pucelle passa sa première nuit de captivité, Jean de Luxembourg la fit conduire au château de Beaulieu. Là, elle fit une tentative d’évasion, qui ne réussit pas. Au bout d’une douzaine de jours, on la transféra au château de Beaurevoir, où résidaient la femme et la tante de Jean de Luxembourg. Ces dames, attachées toutes les deux, de cœur, au parti français, accueillirent la prisonnière avec une grande bonté et eurent pour elle des attentions, dont elle garda toujours un souvenir reconnaissant ; nous en avons la preuve dans ce témoignage, qu’elle rendit au cours de son procès :
— Mademoiselle de Luxembourg et Madame de Beaurevoir m’offrirent un habit de femme ou du drap pour le faire. Je répondis que je n’en avais pas le congé de Notre-Seigneur, qu’il n’était pas encore temps. Si j’avais dû prendre habit de femme, je l’aurais plutôt fait à la requête de ces deux dames que d’autres dames qui soient en France, ma reine exceptée.
Elle reçut plusieurs fois, à Beaurevoir, la visite d’un jeune seigneur bourguignon, Aymond de Macy, qui fut, plus tard, interrogé au procès de réhabilitation ; sa déposition est toute à l’honneur de la Pucelle. Il raconte qu’une fois, il avait voulu, en badinant, porter la main à sa poitrine et qu’elle l’avait repoussé avec indignation ; ce qui lui avait fait concevoir une haute estime de sa vertu.
§4. Vendue aux Anglais
Cependant l’Université de Paris et le gouvernement anglais multipliaient les démarches pour se faire livrer la prisonnière. Jean de Luxembourg s’y refusa d’abord, parce que son honneur 169de chevalier ne lui permettait pas de livrer un prisonnier, et surtout une femme, à ses ennemis et contre son gré. Le 14 juillet, l’évêque de Beauvais, Cauchon, vint lui remettre, en présence de témoins, des lettres de l’Université, avec une requête, rédigée au nom du roi d’Angleterre et au sien. Le comte était officiellement sommé de livrer sa prisonnière à l’évêque,
afin, — portait la requête, — que son procès lui soit fait, parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis plusieurs crimes, comme sortilèges, idolâtries, invocations des démons.
Pour arriver plus sûrement à ses fins, l’agent de l’Angleterre faisait appel à la cupidité du comte, lui rappelant que si de grands personnages sont pris à la guerre,
fût-ce le roi, le dauphin ou autres princes, le roi les pourrait avoir, s’il le voulait, en baillant au preneur dix mille livres ; c’est le droit, usage et coutume de France. [En conséquence] le dit évêque somme et requiert, au nom du roi, que la dite Pucelle lui soit délivrée, en baillant sûreté de la dite somme de dix mille livres.
L’offre de cette royale rançon fit taire les derniers scrupules de Jean de Luxembourg et l’infâme marché fut conclu. Au mois d’août, les États de Normandie votèrent
dix mille livres tournois, pour le payement de l’achat de Jehanne la Pucelle, [et cette somme fut levée en septembre sur] les aides d’Argentan et d’Exmes.
§5. Tentative d’évasion
L’odieuse négociation n’avait pas été tenue si secrète que le bruit n’en parvînt aux oreilles de Jeanne. Elle en fut vivement affectée ; car elle ne redoutait rien tant que de tomber aux mains des Anglais. Une autre rumeur vint encore redoubler ses angoisses : on lui disait que sa chère ville de Compiègne allait être prise et mise à feu et à sang par les Bourguignons. Elle résolut alors de sauter du haut de la tour, où elle était enfermée, et elle le fit, malgré la défense de ses Voix. Se précipita-t-elle dans le vide, comme ses réponses au procès semblent l’indiquer, ou bien se laissa-t-elle glisser le long d’un support trop fragile, comme l’affirme une chronique de l’époque,
ce par quoi elle 170s’avalait rompit ?
On ne sait. Mais il est certain qu’elle tomba de haut et se blessa grièvement.
Cette tentative d’évasion lui fut imputée à crime par ses juges, qui prétendaient y voir un acte de désespoir, un véritable suicide.
— Non, — leur dit-elle, — je ne voulais pas me tuer ; mais j’espérais, par ce moyen, éviter d’être livrée aux Anglais. Je ne le faisais pas dans une pensée de désespoir, mais dans l’espérance de sauver mon corps et de secourir de bonnes gens, qui étaient en nécessité. J’avais ouï dire que tous ceux de Compiègne, au-dessus de sept ans, seraient mis à feu et à sang. Je disais à sainte Catherine :
Comment ! Dieu laissera mourir ces bonnes gens de Compiègne, qui ont été et sont si loyaux à leur Seigneur !Sainte Catherine me disait, presque tous les jours, de ne pas saillir, que Dieu m’aiderait et à ceux de Compiègne. Je lui disais que, puisque Dieu les aiderait, je voulais y être. Ce fut une des causes qui me firent saillir. L’autre cause, c’est que je sus que j’étais vendue aux Anglais et j’aimais mieux mourir qu’être entre les mains de mes ennemis. Sainte Marguerite me disait :
Il faut que vous preniez tout en gré. Vous ne serez pas délivrée que vous n’ayez vu le roi des Anglais.Je lui répondis :Vraiment, je ne voudrais pas le voir. J’aimerais mieux mourir que d’être mise en la main des Anglais.Quand je sus qu’ils allaient venir, j’en fus moult courroucée. Mes voix me défendirent plusieurs fois de saillir ; mais, à la fin, par crainte des Anglais, n’y pouvant plus tenir, je saillis, en me recommandant à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie.Mes saintes me secoururent de la vie et me gardèrent de me tuer ; mais je fus grièvement blessée ; quelques-uns disaient que j’étais morte. Cette chute m’avait tellement brisée que je fus deux ou trois jours sans pouvoir manger ni boire. Toutefois, je fus réconfortée par sainte Catherine, qui me dit de prendre bon courage, que je guérirais et que, sans faute, ceux de Compiègne auraient secours, avant la Saint-Martin d’hiver. Elle me dit aussi de me confesser et de demander pardon à Dieu, pour avoir sailli. Alors, je me pris à revenir et commençai à manger, et je fus aussitôt guérie.
171À cette demande, qui lui fut laite : Croyez-vous avoir fait un péché mortel, en vous précipitant ? elle répondit humblement :
— Je n’en sais rien, je m’en attends à Notre-Seigneur. Je crois que ce n’était pas bien de faire ce saut ; ce fut mal fait. Je sais, par la révélation de sainte Catherine, que j’en ai eu le pardon, après que je m’en fus confessée.
— Avez-vous eu pour cela grande pénitence ?
— La plus grande partie fut le mal que je me fis en tombant.
§6. De Beaurevoir à Rouen
Dans le courant de septembre, Jeanne fut extraite du donjon de Beaurevoir et conduite à Arras. Comme elle n’avait plus là les bonnes dames de Luxembourg pour subvenir à ses besoins, elle adressa aux fidèles habitants de Tournay une
requête par lettre et message, [demandant que,] en considération du roi et des services qu’elle lui avait rendus, la dite ville voulût lui envoyer vingt à trente écus d’or, pour employer en ses nécessités ; sur quoi fut, par délibération et ordonnance de Messieurs les quatre consaulx, baillé à Jean Naviel, clerc, la somme de vingt-deux couronnes d’or, pour porter à Jehanne la Pucelle, prisonnière à la ville d’Arras.
Au bout d’un mois environ, elle échangeait cette prison pour celle du Crotoy, où Dieu lui ménagea de précieuses consolations. Parmi les détenus se trouvait un prêtre éminent, Nicolas de Queuville, chancelier de la cathédrale d’Amiens ; elle se confessait à lui et communiait à sa messe. Un jour, elle reçut la visite d’un groupe de dames de qualité, de demoiselles et de bourgeoises, venues tout exprès d’Abbeville, pour saluer la merveille de leur sexe. Elles la félicitèrent de se montrer
si constante et si résignée à la volonté de Notre-Seigneur et lui souhaitèrent toutes sortes de faveurs du Ciel. La Pucelle les remercia cordialement de leur charitable visite, se recommanda à leurs prières et, les baisant aimablement, leur dit adieu. Ces vénérables personnes jetaient des larmes de tendresse, en prenant congé d’elle.
Saint Michel vint aussi la visiter, comme nous l’apprend 172cette déclaration qu’elle fit à ses juges :
— La dernière fois que je vis saint Michel, c’était lorsque je quittais Le Crotoy.
Il lui était apparu une première fois sept ans auparavant ; puis, le moment venu, il l’avait décidée à se dévouer au salut de la France, pour obéir aux ordres de Dieu. Maintenant, à la veille des terribles épreuves qui attendent sa protégée, il était venu lui apporter les encouragements et le réconfort dont elle allait avoir tant besoin. Elle arriva à Rouen vers la fin de décembre.
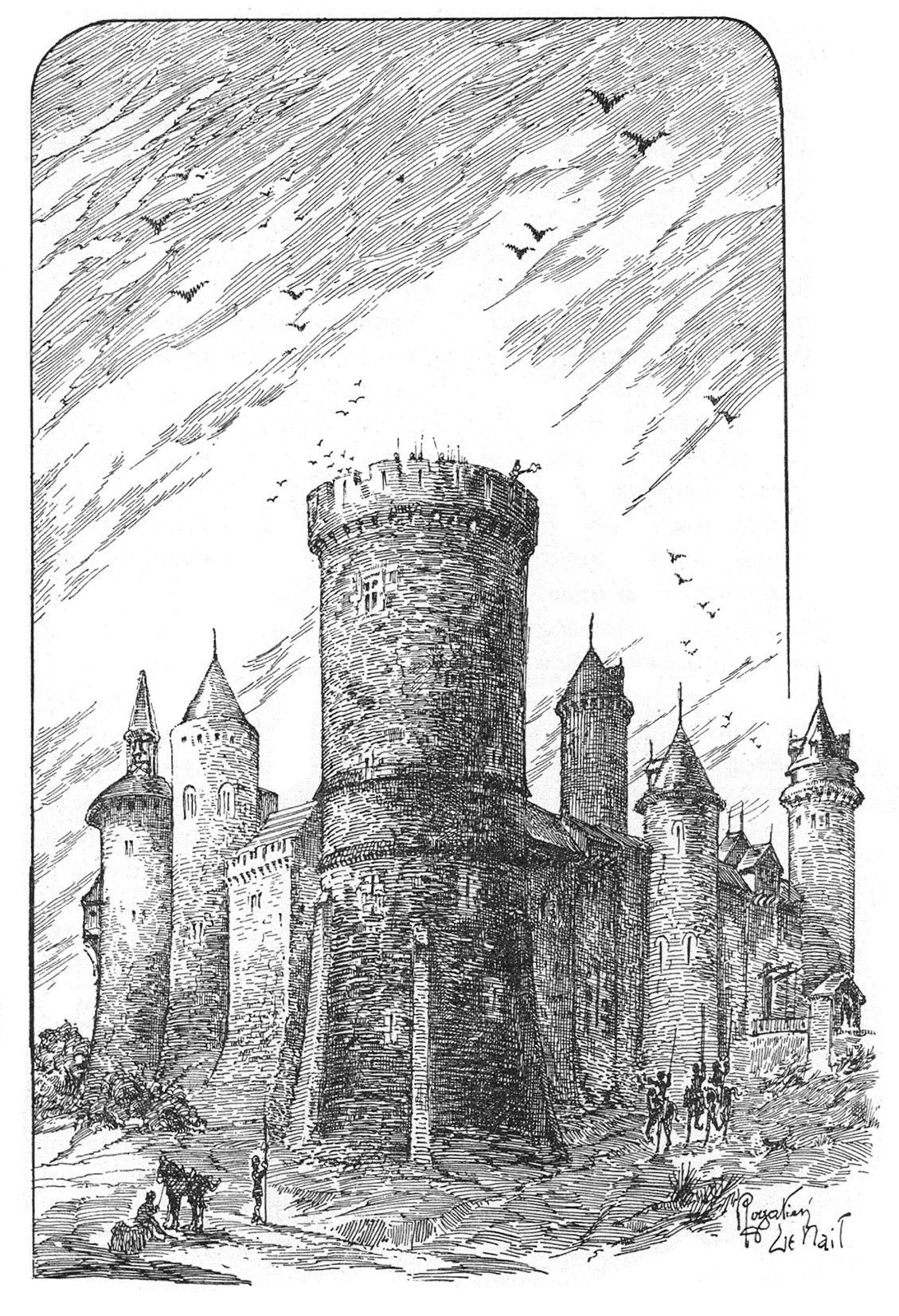
§7. L’Université contre la Pucelle
Cependant, plus de six mois s’étaient écoulés depuis que la Pucelle était aux mains de ses ennemis. Jean de Luxembourg ayant touché, en belles pièces d’or, le prix de son odieux marché, avait livré sa prisonnière aux Anglais, et la question du procès, qu’on était bien résolu à lui faire, restait toujours en suspens. L’Université de Paris s’indignait de ces lenteurs. En attendant mieux, elle avait fait brûler une pauvre Bretonne, qui avait vécu quelque temps avec la Pucelle. Cette brave femme, la Pierronne, soutenait que
dame Jeanne, qui s’armait avec les Armagnacs, était bonne, que ce qu’elle faisait était bien fait et selon Dieu. Elle ne voulut jamais se rétracter et mourut en son dire, [le 3 septembre].
Si le seul fait d’affirmer la mission divine de la Pucelle était, aux yeux des maîtres de l’Université, un crime digne du feu, il est évident que son procès était jugé d’avance.
Réunis en assemblée générale, le 21 novembre, ils envoyèrent à l’évêque de Beauvais, Cauchon, qui était chargé de faire les démarches en vue du procès de la femme vulgairement appelée la Pucelle, une longue lettre, pleine de récriminations peu respectueuses ; ils le sommaient d’avoir à en finir au plus tôt.
Si votre Paternité, — disaient-ils, — eût déployé plus de diligence et d’activité, la femme sus-dite serait en ce moment devant les tribunaux de l’Église… Veuillez vous employer pour qu’elle soit conduite dans cette ville de Paris, où abondent les docteurs et les savants.
Ils envoyèrent une autre lettre, le même jour et pour la même fin, mais d’un ton bien différent, à leur très 175redouté et souverain Seigneur et père, le roi d’Angleterre, bambin de neuf ans, dont l’Université se proclamait la très humble et dévote fille. Le régent céda sans peine à de si vives instances, mais ne consentit pas à ce que le procès eût lieu à Paris ; il décida que le tribunal siégerait à Rouen.
Le 3 janvier 1431, parut l’ordonnance royale, qui en confiait la présidence à Cauchon. Ce choix n’avait pas été fait au hasard. Le régent connaissait bien les sentiments anglophiles du personnage et son animosité contre les Français, qui l’avaient chassé de son diocèse ; de plus, il le savait habile et assez dépourvu de scrupules pour conduire l’affaire à son gré. Néanmoins, pour plus de sûreté, il avait prévu le cas où l’accusée serait acquittée et pris ses précautions en conséquence :
Toutefois, — portait l’ordonnance, — c’est notre intention de ravoir et de reprendre par devers nous icelle Jeanne, si ainsi était qu’elle ne fût convaincue de cas touchant la foi.
De cette façon, s’il arrivait que la Pucelle ne fût pas condamnée par le tribunal ecclésiastique — hypothèse bien improbable, vu la composition de ce tribunal, tout à la dévotion des Anglais — elle n’échapperait pas pour cela au supplice.
À son arrivée à Rouen, la Pucelle avait été enfermée dans une tour du château. On lui avait ménagé un réduit, à l’étage du milieu, non loin des appartements du gouverneur, Warwick, dans une chambre assez vaste, mais obscure et mal aérée. Le château avait alors des hôtes de marque : le roi d’Angleterre, âgé de neuf ans ; son grand oncle, le cardinal de Winchester ; son oncle, le duc de Bedford, avec sa femme. Jeanne fut donc à même de voir le roi d’Angleterre, comme sainte Catherine le lui avait prédit. Car on ne peut guère douter que cet enfant, curieux, comme on l’est à cet âge, n’eut rien de plus pressé que d’aller contempler cette prisonnière fameuse, dont il avait entendu tant parler.
§8. Prisonnière du château de Rouen
Elle inspirait encore une telle crainte qu’on avait pris la précaution de fabriquer une solide cage de fer pour l’enfermer ; 176et un serrurier, Étienne Castille, témoigna en justice qu’il l’y avait vue, debout, avec des liens au cou, aux mains et aux pieds. Toutefois, il n’est guère probable qu’on l’ait maintenue bien longtemps ainsi ; en tout cas, la cage fut enlevée avant l’ouverture du procès. Mais la condition de la prisonnière n’en resta pas moins extrêmement pénible : durant le jour, elle était attachée à une longue chaîne de fer, fixée à une grosse pièce de bois et cadenassée à ses pieds ; la nuit, une autre chaîne, passée sur elle par le travers du lit, la maintenait dans une immobilité forcée.
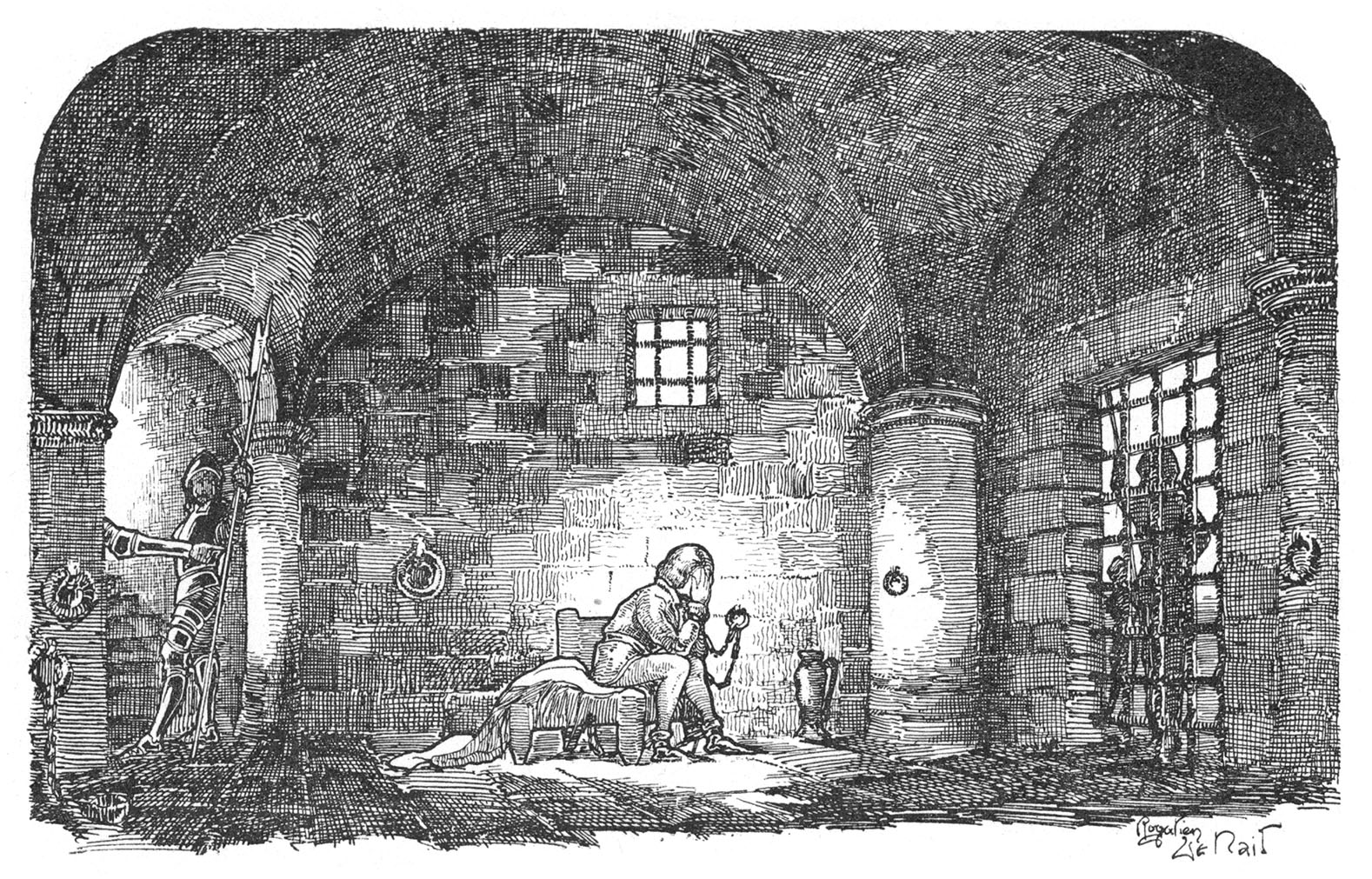
Ces rigueurs s’expliquent, jusqu’à un certain point, par la crainte superstitieuse qu’elle continuait d’inspirer. Ainsi, le bruit courait, à Rouen, que les Anglais n’osaient pas aller assiéger Verneuil, parce que, tant qu’elle serait vivante, ils redoutaient de la voir s’échapper, grâce à ses sortilèges.
Mais, ce que rien ne peut excuser, ce sont les traitements indignes que lui faisaient subir ses geôliers. Deux d’entre eux montaient la garde à l’extérieur de la chambre ; trois autres se tenaient jour et nuit à l’intérieur. Du matin au soir, elle avait les oreilles remplies de leurs éclats de voix, de leurs propos grossiers et souvent orduriers. Ce n’est pas encore tout ; ces misérables prenaient plaisir à la poursuivre de leurs injures, de leurs sarcasmes haineux et à la maltraiter de mille manières. Un jour même, sans l’arrivée soudaine du gouverneur, attiré par ses cris, ils allaient lui faire subir les pires outrages. Ce fut sans doute après cette scène scandaleuse que la duchesse de Bedford, ayant constaté elle-même, avec le concours de quelques dames, son intégrité, virginale, fit donner des ordres pour qu’on eût désormais à respecter au moins sa vertu.
Ces tortures physiques et morales étaient encore singulièrement aggravées par la privation de tout secours religieux : ni messe, ni confession, ni communion, durant les cinq mois qu’elle passa à Rouen avant son martyre. Elle eut beau réclamer, supplier à maintes reprises, Cauchon resta toujours inflexible. Mais le Ciel ne l’abandonnait pas dans sa détresse ; sainte Catherine 177et sainte Marguerite venaient lui rendre visite et remonter son courage.
— Il n’est pas de jour, — dit-elle à ses juges, — que je n’entende les Voix et j’en ai bien besoin. Je serais morte, sans la révélation qui me réconforte.
C’est sûrement à ce secours qu’elle dut de conserver, parmi tant d’angoisses, toutes ses qualités natives, courage indomptable, esprit lucide et fin, enjouement même, que nous aurons plus d’une fois l’occasion d’admirer dans ses réponses aux juges.
La scène suivante, racontée par un témoin oculaire, Aymond de Macy, nous montre que, prisonnière, elle était bien restée telle que nous l’avons connue guerrière. Ce jeune gentilhomme, qui avait déjà eu, comme il a été dit, l’occasion de s’entretenir avec elle à Beaurevoir, vint la visiter dans la prison de Rouen, en compagnie de Jean de Luxembourg, du chancelier d’Angleterre et des comtes de Warwick et de Stafford. — Jeanne, lui dit le comte de Luxembourg, je suis venu ici pour vous mettre à rançon, à condition que vous me promettiez de ne jamais vous armer contre nous.
— En nom Dieu, répliqua-t-elle vivement, vous vous moquez de moi ; car je sais bien que vous n’en avez ni le vouloir ni le pouvoir.
Puis elle ajouta :
— Je sais bien que ces Anglais me feront mourir, parce qu’ils croient qu’après ma mort ils gagneront le royaume de France. Mais, quand ils seraient cent mille godons de plus qu’ils ne sont à présent, ils n’auront pas le royaume.
À ces mots, le comte de Stafford mit la main sur sa dague, pour en percer l’héroïque enfant. Warwick, en arrêtant son bras, lui épargna un crime qui eût désolé Bedford, Cauchon et les maîtres de l’Université. Ils étaient bien résolus à faire mourir la prisonnière ; mais leur haine ne pouvait être assouvie que si elle mourait déshonorée, à la suite d’une condamnation infamante.
179Chapitre II La Pucelle en face de ses juges
§1. Composition du tribunal
Le principal artisan du procès de la Pucelle, Cauchon, évêque de Beauvais, avait des titres particuliers à la confiance du gouvernement anglais. C’était un habile homme, versé dans la théologie et le droit canon, mais ambitieux et vindicatif. Il avait pris part aux négociations du traité de Troyes, qui livrait la France au roi d’Angleterre ; l’évêché de Beauvais avait été la récompense de ce service. Quelques années plus tard, l’Université de Paris se plaçait sous son haut patronage, en le nommant conservateur de ses privilèges. Pour l’attacher davantage à la cause anglaise, Bedford l’avait fait entrer au Grand Conseil et, à l’époque où nous sommes arrivés, il faisait miroiter à ses yeux l’archevêché de Rouen, qui était vacant. Il n’en fallait pas davantage pour faire de lui l’instrument des haines anglaises contre la Pucelle. Mais il avait, en outre, des motifs personnels de la haïr ; car elle était cause que ses diocésains l’avaient chassé et privé des revenus de son évêché. Aussi, dès qu’il avait su qu’elle était prisonnière, s’était-il empressé d’intriguer pour la faire livrer aux Anglais.
Il se considérait si bien comme son juge naturel, parce qu’elle avait été prise dans le diocèse de Beauvais, qu’il n’avait pas attendu l’ordonnance royale pour agir en cette qualité. Mais, comme sa juridiction expirait aux limites de son diocèse, il 180avait demandé au chapitre métropolitain de Rouen l’autorisation de faire le procès dans cette ville.
Le 9 janvier, il présida une réunion de huit gradués de l’Université, parmi lesquels il désigna les officiers nécessaires à la conduite du procès.
Le chanoine Jean d’Estivet, official de Beauvais, fut choisi pour préparer et soutenir l’accusation, en qualité de promoteur. Ce misérable, âme damnée de Cauchon, remplit son rôle en parfait scélérat ; nous aurons plus d’une fois l’occasion de le constater.
Le licencié Jean de la Fontaine, nommé commissaire instructeur, était chargé de diriger les interrogatoires ; il le fit ; mais, mécontent de la manière dont le procès était conduit, il s’esquiva de Rouen, avant la fin, par crainte des Anglais.
Les deux greffiers, Guillaume Manchon et Boisguillaume, étaient d’honnêtes gens, mais de caractère pusillanime ; et la crainte de se compromettre leur fit faire plus d’une lâcheté. Cauchon leur défendit, à plusieurs reprises, d’enregistrer certaines déclarations de l’accusée, trop favorables à sa défense, et ils n’eurent pas le courage de passer outre. Manchon, qui a rédigé le compte rendu détaillé du procès, dira plus tard, pour excuser ces défaillances :
Je n’osais pas contredire de si grands personnages.
La charge d’huissier fut confiée à un jeune prêtre, Jean Massieu. Son rôle consistait à signifier à la prisonnière les ordres de Cauchon, à la conduire à la salle d’audience et à la ramener à la prison.
§2. Préliminaires du procès
Le tribunal ainsi constitué, Cauchon réunit, le 23 janvier, les officiers ci-dessus désignés, pour s’entendre avec eux sur la marche à suivre. On y décida que l’évêque
pouvait et devait procéder à l’information préparatoire sur les actes et les paroles de la femme prisonnière.
Le 13 février, nouvelle séance, à laquelle assistent six délégués de l’Université de Paris.
181Une dernière séance préparatoire eut lieu, le 19 février. À s’en rapporter au procès-verbal, Cauchon y aurait donné lecture des dépositions des témoins, qui avaient été interrogés, par ses ordres, à Domrémy et ailleurs, sur la réputation de Jeanne, et les assesseurs en auraient délibéré longuement et mûrement ; après quoi, il déclara que
ces informations et d’autres motifs étaient une cause suffisante pour citer la dite femme en jugement sur la foi.
Or, chose étrange ! ces informations, sans lesquelles on ne pouvait pas ouvrir la procédure, ne figurent pas au procès-verbal. Mieux encore, plusieurs des assistants, Manchon, Thomas de Courcelles, interrogés dans la suite sur ces informations, sont obligés de déclarer qu’ils ne se rappellent pas en avoir eu connaissance.
§3. Enquête favorable à l’accusée
L’enquête, ordonnée par Cauchon, avait pourtant été faite : le prévôt d’Andelot, Gérard Petit, avait interrogé une quinzaine d’habitants de Domrémy et des environs et il était venu lui-même apporter à Rouen le procès-verbal des dépositions entendues. Cauchon, après en avoir pris connaissance, entra dans une violente colère, accabla de reproches le malheureux prévôt et finalement le congédia sans le payer, parce que son enquête ne pouvait lui servir. En effet, les dépositions avaient été très favorables à la Pucelle ; et le prévôt lui-même déclarait n’avoir trouvé, dans son enquête, rien qu’il n’eût voulu savoir sur sa propre sœur. Le juge prévaricateur, ne pouvant donc faire état de cette pièce, la garda sans rien dire par devers lui et passa outre ; n’avait-il pas d’ailleurs assez d’autres motifs d’engager le procès ?
§4. Refus d’une prison ecclésiastique
Tant qu’il ne fut pas ouvert, la détention de Jeanne, dans la prison du château, pouvait se justifier, parce qu’elle était prisonnière de guerre. Mais le procès entraînait, à son avantage, une situation légale, toute différente. En effet, d’après les lois canoniques, en vigueur au XVe siècle, les prévenus, cités en matière de foi, devaient être renfermés dans des prisons ecclésiastiques et les femmes gardées par des personnes de leur sexe. 182Cauchon, qui avait été professeur de droit canon, n’ignorait pas ces sages dispositions. Les assesseurs durent donc être bien surpris, quand il leur demanda lequel était le plus convenable de garder Jeanne aux prisons séculières ou aux prisons d’Église ; pareille question révélait déjà un parti pris évident. Il avait sans doute compté arracher ainsi à leur complaisance un avis conforme à ses vues et abriter sa forfaiture derrière l’autorité de ces docteurs ; mais son calcul fut déjoué. Les prescriptions du droit étaient trop formelles ; ils n’osèrent pas se prononcer contre, et, après en avoir délibéré, ils déclarèrent qu’il était plus décent de garder la jeune fille aux prisons ecclésiastiques qu’aux autres. Cauchon, déçu dans son attente, répliqua qu’il ne ferait pas cela, de peur de déplaire aux Anglais. C’est pourquoi la Pucelle continua de rester enfermée au château, pendant toute la durée du procès.
§5. L’inquisiteur promu juge malgré lui
Un dernier point restait encore à régler : les évêques n’avaient pas le pouvoir de juger seuls les procès en matière de foi ; il leur fallait le concours de l’Inquisition. Celle-ci était représentée, à Rouen, par le dominicain Jean Lemaître ; Cauchon le requit donc de s’adjoindre à lui pour le procès. Le pauvre homme, effrayé de la responsabilité qu’il allait encourir, commença par se dérober, en alléguant qu’il n’avait pas de pouvoirs pour le diocèse de Beauvais. Mais l’inquisiteur général, sommé par Cauchon de venir siéger lui-même ou de se faire remplacer, envoya à Lemaître les pouvoirs nécessaires, avec ordre d’en user. Il s’y résigna, la mort dans l’âme, et vint prendre place à côté de Cauchon, trois semaines après l’ouverture du procès. Sa présence n’apporta d’ailleurs aucun changement et fut à peine remarquée, tant il prenait soin de s’effacer. La peur des Anglais lui faisait approuver tout ce que voulait son collègue.
Si l’on ne procède pas selon leur volonté, — disait-il à l’huissier Massieu, — c’est la mort qui nous menace.
Décidément, il n’avait point âme de héros.
§6. Vices essentiels de la procédure
Nous entendons faire un beau procès, avait dit Cauchon ; 183ce qui, dans la bouche de l’ancien professeur de droit, voulait dire un procès si bien conduit, d’après toutes les règles de la procédure canonique, qu’il serait impossible au juriste le plus exercé d’y trouver rien à reprendre. Hélas ! ce beau procès était, d’avance, irrémédiablement vicié, pour de multiples raisons, dont voici les principales :
1° En l’entreprenant, on revenait sur une chose déjà jugée. En effet, Jeanne avait été minutieusement examinée, à Poitiers, sur sa foi, ses mœurs et sa mission, et le jugement, porté sur elle, était tout à sa louange. L’évêque de Beauvais n’avait pas le droit de réviser ce jugement, d’autant qu’il avait été confirmé par l’archevêque de Reims, son propre métropolitain.
2° L’enquête préparatoire n’avait rien fourni contre l’accusée ; au contraire, elle lui avait été très favorable ; or, pour introduire une cause en matière de foi, il fallait plus que des soupçons, une réputation notoirement mauvaise.
3° Ni Cauchon, parce qu’il était ennemi déclaré de l’accusée, ni le vice-inquisiteur, qui ne siégeait que contraint et toujours sous l’empire de la terreur, ne pouvaient être ses juges.
4° Les audiences allaient se tenir dans une forteresse, où juges et assesseurs avaient tout à craindre, s’ils ne procédaient pas au gré des Anglais, qui l’occupaient en force.
5° Enfin, Jeanne n’était pas seule en cause : à travers sa personne, c’était surtout le roi de France que Bedford voulait atteindre ; en la faisant condamner comme sorcière, il entendait bien infliger une flétrissure au prince qui avait accepté ses services. Charles VII aurait donc dû être invité à se faire représenter au procès pour y défendre son honneur.
Ces vices essentiels furent d’ailleurs signalés à Cauchon, au cours du procès, par un prêtre normand, Jean Lohier, qui lui déclara que sa procédure était radicalement nulle. Après avoir ainsi déchargé sa conscience, Lohier se hâta de quitter Rouen, où il n’eût plus été en sûreté. Le juge sentait bien la justesse de ces critiques ; il n’en était que plus âpre à les réprimer ; 184un des assesseurs, Nicolas de Houppeville, s’en étant aussi rendu coupable, il lui interdit de paraître à l’audience et, peu après, le fit jeter en prison.
§7. Odieux guet-apens
Tout en prenant les dispositions que nous avons rapportées, Cauchon imagina, de concert avec le gouverneur du château, un stratagème, destiné à obtenir de la prisonnière des aveux compromettants. Les deux fourbes décidèrent d’introduire dans son cachot un traître, qui se présenterait à elle comme un bon Français, prisonnier pour son attachement au roi, et tâcherait de gagner ainsi sa confiance ; on écarterait les geôliers et, pendant qu’elle ferait ses confidences à ce faux ami, des greffiers, postés dans la chambre voisine, près d’une ouverture pratiquée dans la cloison, entendraient la conversation, sans qu’elle se doutât de leur présence.
Ainsi fut fait ; un misérable, le chanoine Loyseleur, consentit à jouer le rôle du traître, se présenta à la Pucelle sous un déguisement et lui dit qu’il était un pauvre cordonnier lorrain, emprisonné par les Anglais ; puis, quand il crut s’être suffisamment insinué dans sa confiance, il se mit à l’interroger discrètement. Les greffiers avaient écouté la conversation ; mais Cauchon ayant voulu leur faire enregistrer ce qu’ils avaient entendu, ils s’y refusèrent, parce que, dirent-ils, il n’était pas honnête de commencer le procès de cette manière.
Loyseleur n’avait point de pareils scrupules. Durant tout le temps du procès, il multiplia ses visites à la prison, de jour et de nuit, sous divers déguisements, et parvint enfin à faire croire à Jeanne qu’il était un prêtre lorrain, prisonnier des Anglais. Il se rendait près d’elle avant les audiences, pour lui suggérer des réponses de nature à la perdre ; il informait ensuite Cauchon des aveux qu’il avait pu lui surprendre. Il sut si bien cacher sa fourberie, sous les dehors d’un sincère intérêt, que la pauvre enfant s’y laissa prendre et accorda toute sa confiance à ce prêtre qui lui témoignait une si affectueuse sympathie. Manchon et de Courcelles rapportent même qu’il l’entendait 187en confession. Quoi qu’il en soit, l’infâme conduite du traître était bien connue des membres du tribunal ; ils s’en indignaient tout bas, sans oser rien dire.
§8. La Pucelle à l’audience
La première audience publique se tint dans la chapelle et les suivantes dans une salle de château. Pour donner plus d’autorité au jugement à intervenir et se mettre lui-même à couvert, Cauchon eut soin de s’entourer d’assesseurs aussi nombreux que distingués, docteurs en théologie et en droit canon, ou pourvus d’autres grades universitaires. Rarement il y en eut moins de trente, habituellement quarante-cinq à cinquante et quelquefois beaucoup plus. Tous étaient Français, un seul excepté ; mais la plupart avaient été entraînés par la passion politique dans le parti bourguignon et les Anglais avaient réussi à se les attacher en les comblant de faveurs ; double raison, qui explique, sans la justifier, la conduite qu’ils tinrent au cours du procès.
Les plus acharnés contre la Pucelle furent naturellement les délégués de l’Université, qui estimaient avoir à venger sur elle une injure personnelle. Cauchon se reposait ordinairement sur eux du soin de surveiller les interrogatoires ; après l’audience, il les réunissait en conseil secret, pour examiner avec eux le parti qu’on pouvait tirer des réponses de l’accusée. À l’audience, leur animosité bien connue, leur grand crédit et, de plus, la présence de l’assesseur anglais, Hayton, suffisaient ordinairement à empêcher toute manifestation de sympathie en sa faveur. La crainte de déplaire aux Anglais paralysa la bonne volonté de quelques rares ecclésiastiques, bien intentionnés mais timides, qui furent mêlés au procès.
Les audiences étaient excessivement fatigantes pour l’accusée ; elles duraient deux, trois et parfois quatre heures ; certains jours, il y en eut deux, l’une le matin, l’autre le soir. Au début du procès, elle demanda en vain qu’on lui donnât quelqu’un pour la conseiller, parce qu’elle était trop ignorante pour répondre convenablement. Elle se trouvait donc seule, en face d’une 188meute de légistes retors, qu’elle savait acharnés à sa perte. Elle essaya de récuser ses juges :
— Pour ce qui est de vous, — dit-elle à Cauchon, — je ne veux pas me soumettre à votre jugement, parce que vous êtes mon ennemi mortel.
Peine perdue ; le juge, ainsi pris à partie, se contenta de répondre :
— Le roi m’a ordonné de faire votre procès, et je le ferai.
On l’accablait de questions ; souvent elle n’avait pas même fini de répondre à un interrogateur qu’un autre commençait déjà à la harceler. Elle s’en plaignit à plusieurs reprises. Un jour, interpellée de plusieurs côtés à la fois, elle s’écria :
— Tout beau ! messeigneurs, faites l’un après l’autre.
En d’autres circonstances, elle rappelait les interrogateurs à la question, en leur disant :
— Cela n’est pas de votre procès.
Ou bien :
— Passez outre.
À la suite de questions oiseuses ou saugrenues, qui n’avaient pour but, semble-t-il, que de l’énerver, on lui en posait d’autres, tellement subtiles et captieuses qu’un savant théologien aurait pu seul s’en tirer à son honneur. Bon nombre d’assesseurs en murmuraient tout bas ; quelques-uns même s’en plaignirent ouvertement ; leur protestation resta sans effet.
Dans ses visites à la prisonnière, Loyseleur lui conseillait fortement de ne pas se soumettre à l’Église ; il dut avoir d’autant moins de peine à la persuader que, de fait, dans le cas présent, l’Église ne pouvait être, à ses yeux, que le tribunal qui instruisait son procès. C’est pourquoi elle refusait de s’y soumettre. Le dominicain Isambart de la Pierre, voyant qu’elle ne comprenait pas le sens et la portée de ce refus, lui suggéra de se soumettre au Concile général, qui se réunissait à Bâle. Comme elle ne savait pas ce que c’était qu’un Concile général, il lui dit que, dans cette assemblée, il y avait autant de Français que d’Anglais :
— Oh bien ! dit-elle, puisqu’il y a des gens de notre parti, je veux bien me soumettre au Concile de Bâle.
Cauchon, se retournant vers le religieux, s’écria, dans un paroxysme de fureur :
— Taisez-vous, de par le diable !
Au greffier qui lui demandait s’il fallait enregistrer la déclaration de l’accusée, 189il répondit sèchement :
— Non, ce n’est pas nécessaire.
Sur quoi, celle-ci lui adressa cette plainte trop justifiée :
— Vous écrivez bien ce qui est contre moi, et vous ne voulez pas écrire ce qui est pour moi.
Une autre fois, s’étant aperçu des marques d’intérêt qu’Isambart lui donnait, l’évêque l’interpella brutalement, la menace à la bouche :
— Pourquoi souffles-tu cette méchante femme, en lui faisant des signes ? Par la morbleu, vilain, si je m’aperçois que tu te mettes en peine de l’aider, je te ferai jeter à la Seine20.
Il poussait l’effronterie jusqu’à commander aux greffiers de dénaturer le sens de certaines réponses qui dérangeaient ses plans. Manchon déclare avoir refusé de se prêter à cette falsification et nous pouvons l’en croire ; mais nous avons vu qu’il eut la faiblesse de supprimer, par ordre, d’autres déclarations trop gênantes. Les procès-verbaux n’étaient pas toujours d’une exactitude parfaite. La Pucelle, à qui on les lisait, remarquait tout de suite les erreurs de la rédaction et les faisait corriger, séance tenante. Elle étonnait tout le monde par la sûreté de sa mémoire. Quand on lui adressait, pour la seconde ou la troisième fois, une question 190qui avait déjà été posée, elle disait :
— J’en ai répondu tel jour et de telle manière.
En se reportant au registre, on trouvait que c’était parfaitement exact. Un jour, le second greffier, Boisguillaume, prétendant qu’elle se trompait :
— Cherchez dans votre livre, — lui dit-elle.
Il le fit et dut reconnaître son erreur.
— Prenez garde, — ajouta-t-elle avec un fin sourire ; — si vous vous trompez encore, je vous tirerai les oreilles.
Ainsi, ni le danger où elle était et dont elle avait pleinement conscience, ni l’appareil imposant de la justice, ni l’hostilité, dont elle se sentait l’objet, rien ne fut capable de l’intimider. Ses Voix lui recommandaient de répondre hardiment ; elle répondait hardiment et savait même plaisanter, au besoin.
Maître Jacques de Touraine lui ayant demandé si elle s’était trouvée en des affaires où des Anglais avaient été tués :
— Oui, certes, — répondit-elle ; — pourquoi ne quittaient-ils pas la France et ne s’en retournaient-ils pas dans leur pays ?
En l’entendant, un lord anglais ne put retenir ce cri d’admiration : La brave fille ! que n’est-elle anglaise !
Par la simplicité, l’à-propos, la finesse et, quelquefois, la profondeur de ses réponses, elle excitait l’admiration de ses ennemis eux-mêmes. Le greffier Manchon lui a rendu ce témoignage :
Elle répondait aussi bien qu’eût pu le faire le meilleur clerc et les assesseurs disaient n’avoir jamais vu femme qui leur eût donné tant d’embarras.
Puis, il ajoute :
Je crois que, dans une cause si difficile, elle était incapable, par elle-même, de se défendre contre de si grands docteurs, si elle n’avait pas été inspirée.
191Chapitre III Procès préparatoire Les six premières séances, en présence d’un nombreux public
§1. Observations préliminaires
1° Les procès en matière criminelle, appelés devant nos Cours d’assises, s’ouvrent par la lecture de l’acte d’accusation, relatant les faits qui motivent la poursuite. Dans le procès de Jeanne d’Arc, au lieu de faits, préalablement certifiés par des témoignages et passés au crible d’une instruction sérieuse, le promoteur, qui remplit près des tribunaux ecclésiastiques à peu près les mêmes fonctions que nos procureurs, n’avait tout au plus à alléguer que des on-dit et de vagues soupçons, puisque l’enquête préalable n’avait rien révélé qui ne fût favorable à l’accusée. Pour qu’il pût dresser l’acte d’accusation, il fallait que celle-ci lui en fournît tous les éléments par ses réponses ; car aucun témoin ne sera entendu. Il s’agissait donc, dans le procès préparatoire, de lui arracher des aveux compromettants. C’est à quoi vont s’employer, de tout leur pouvoir, Cauchon et ses complices, au cours des quinze séances qui eurent lieu du 21 février au 17 mars.
2° L’évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur avaient seuls la qualité de juges ; les assesseurs n’étaient que de simples consulteurs. Aux deux greffiers, précédemment nommés, le vice-inquisiteur en adjoignit un troisième, Nicolas Taquel, lorsqu’il se résigna à siéger. Ces greffiers prenaient séparément leurs notes d’audience et les confrontaient ensuite pour rédiger le procès-verbal. Tous les trois ont prétendu l’avoir fait aussi exact que possible et on peut les en croire, quant à la fidélité 192générale de ce qu’ils ont enregistré. Mais nous savons par le témoignage d’Isambart et par les aveux mêmes de Manchon, qu’ils omirent, par ordre du juge, de reproduire des réponses de grande importance.
3° Le procès-verbal général, que nous suivrons dans notre compte rendu abrégé des audiences, fut rédigé d’abord en français par Manchon ; puis, après la mort de Jeanne, traduit en latin par Thomas de Courcelles. Assurément, ni Cauchon, qui l’a revu soigneusement, ni le traducteur, qui fut un des ennemis les plus acharnés de la Pucelle, ne seront soupçonnés d’avoir cherché à présenter leur victime sous un jour favorable. Néanmoins, tel qu’il est et malgré des lacunes regrettables, la figure de la sainte héroïne s’en dégage, rayonnante d’un éclat surhumain.
§2. Première séance (21 février, 2e mardi de Carême)
Avant d’introduire l’accusée, l’huissier rendit compte au juge de la façon dont elle avait reçu la citation qu’il lui avait faite : elle avait déclaré être prête à comparaître, mais elle demandait deux choses, savoir : que des ecclésiastiques du parti français assistassent au procès, en nombre égal à ceux du parti anglais ; puis, elle suppliait humblement qu’il lui fût permis d’entendre la messe avant l’audience. Les deux demandes furent rejetées.
Cauchon ouvrit la séance en ordonnant à Jeanne de jurer, les mains sur les Évangiles, qu’elle dirait la vérité sur tout ce qu’on lui demanderait. À quoi elle répondit prudemment :
— Je ne sais pas sur quoi vous voulez m’interroger. Vous pourriez me demander telle chose que je ne vous dirai pas. Pour ce qui est de mon père, de ma mère, de ce que j’ai fait, depuis que je me suis mise en chemin pour la France, je prêterai volontiers serment. Mais, pour ce qui est des révélations que je tiens de Dieu, je ne les ai jamais révélées qu’à celui qui est mon roi, au seul Charles. Je ne les révélerai pas, dût-on me couper la tête. Dans huit jours je saurai bien si je dois les révéler.
Cela dit, elle se mit à genoux et prêta serment, les mains posées sur un missel.
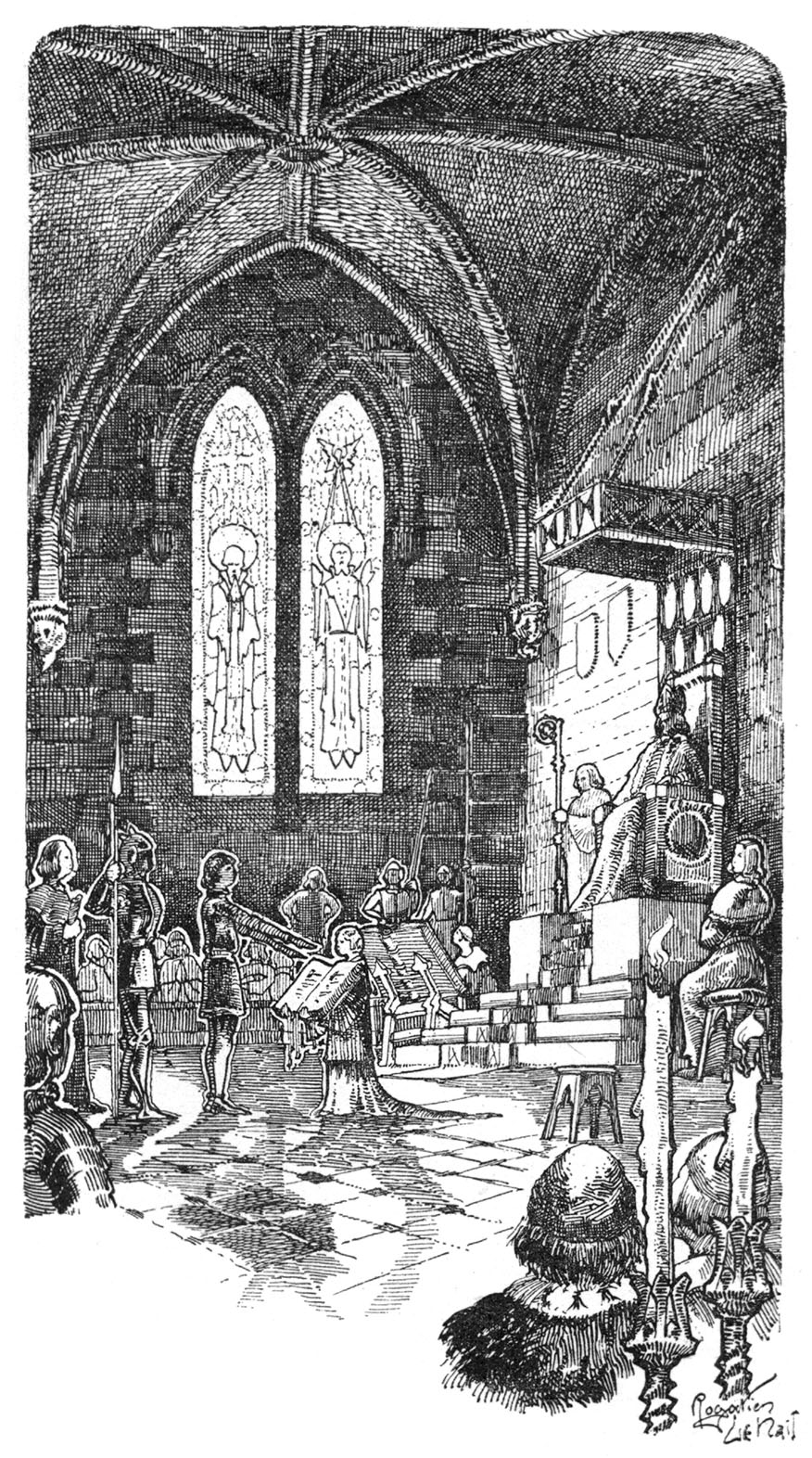
193Après quelques interrogations, de pure forme, touchant son nom, son âge, etc., l’évêque lui dit de réciter le Pater :
— Entendez-moi en confession, — répondit-elle, — et je le dirai volontiers, mais pas autrement.
Avant de lever l’audience, il lui fit défense de chercher à s’évader, sous peine d’être déclarée convaincue d’hérésie.
— Je n’accepte pas cette défense, — répliqua-t-elle ; — si je m’évadais, personne n’aurait le droit de m’accuser d’avoir violé la foi donnée, car je n’engageai jamais ma foi à personne… Combien me font souffrir les chaînes et les liens de fer dont on charge mon corps et mes pieds ! Il est vrai que j’ai voulu autrefois m’évader ; je le voudrais encore, ainsi que tout prisonnier en a le droit.
Sur ce, Cauchon la fit reconduire à la prison, en recommandant aux geôliers de faire bonne garde.
§3. Deuxième séance (22 février)
Le lendemain, à l’ordre qu’on lui donnait de prêter serment, Jeanne répondit :
— J’ai déjà prêté serment ; cela doit suffire ; vous me chargez trop.
Elle obéit pourtant, mais avec les mêmes restrictions que la première fois ; puis elle ajouta :
— Si vous étiez bien informés de ce qui me concerne, vous devriez me vouloir hors de vos mains : car je n’ai rien fait que, par révélation.
L’interrogatoire porta ensuite sur son enfance et sa jeunesse. Les réponses qu’elle fit sont reproduites au livre Ier.
Voici ce qu’elle dit ce jour-là de sa première entrevue avec Charles VII :
— J’allai vers mon roi sans obstacle. Arrivée à Sainte-Catherine-de-Fierbois, j’envoyai, pour la première lois, devers mon roi, au château de Chinon, où il était alors. J’arrivai à Chinon sur le midi, et je descendis dans une hôtellerie… Après le dîner, j’allai au château. Quand j’entrai dans la chambre de mon roi, je le connus au milieu de son entourage, sur l’indication de ma Voix qui me le révéla. Je lui dis que je voulais aller faire la guerre aux Anglais. Avant de me mettre à l’œuvre, il eut plusieurs belles révélations.
— Lesquelles ?
— Je ne vous le dirai pas et vous n’aurez pas encore de réponse sur ce point. Envoyez vers lui et il vous le dira.
194Nous avons vu (livre Ier, chap. III) que ces révélations étaient de telle nature qu’elles ne pouvaient être divulguées sans grand préjudice pour l’honneur du roi. Les juges auront beau revenir, nombre de fois, à la charge, pour lui arracher ce secret, ils n’y réussiront pas.
Vers la fin de l’audience, elle fit cette touchante déclaration :
— Il n’est pas de jour que je n’entende la Voix, et y en ai bien besoin. Je ne lui ai jamais demandé, comme récompense finale, que le salut de mon âme.
§4. Troisième séance (24 février)
Ce jour-là, le juge somma l’accusée, à trois reprises, de prêter serment sans condition ; trois fois elle s’y refusa. Puis, regardant l’évêque en face, elle lui adressa cette superbe déclaration :
— Faites bien attention à ce que vous dites que vous êtes mon juge ; car vous prenez une grande chargé et m’en imposez une trop lourde… Tout le clergé de Paris et de Rouen ne saurait me condamner, s’il n’a pas de droit sur moi. Je dirai volontiers la vérité sur ma venue en France, et encore pas tout : huit jours n’y suffiraient pas ; pour le reste, qu’on ne m’en parle plus. Je suis venue de la part de Dieu ; je n’ai rien à faire ici. Renvoyez-moi à Dieu, de la part de qui le suis venue.
Sur de nouvelles instances de l’évêque, accompagnées de menaces, elle finit par consentir à jurer de dire la vérité, mais seulement sur ce qui touchait au procès.
À certaines questions qui lui sont posées sur ses Voix, elle répond :
— J’ai entendu la Voix hier et aujourd’hui. Hier, je l’ai entendue trois fois, le matin, à l’heure des Vêpres et quand on sonnait l’Ave Maria. Ce matin, je dormais ; la Voix m’a éveillée sans me toucher. Cette voix me dit de répondre hardiment ; que Dieu m’aiderait.
Puis, elle interpelle à nouveau l’évêque :
— Vous dites que vous êtes mon juge faites bien attention à ce que vous faites ; car, en vérité, je suis envoyée de par Dieu et vous vous mettez en grand danger.
On lui pose ensuite de nouvelles questions et elle demande 195un délai pour y répondre ; puis, elle ajoute :
— Je crois fermement que cette Voix vient de Dieu et par son ordre. Je le crois aussi fermement que je crois la loi chrétienne, et que Notre-Seigneur nous a rachetés des peines de l’enfer. J’ai beaucoup plus de crainte de faillir, en disant quelque chose qui déplairait à ces Voix que je n’en ai de vous répondre… J’ai appris cette nuit bien des choses pour le bien de mon roi ; je voudrais bien qu’il les connût et pour cela je consentirais à ne pas boire de vin jusqu’à Pâques. Il en serait plus gai à son dîner.
— Votre conseil vous a-t-il révélé que vous sortiriez de prison ?
— Je n’ai pas à vous le dire.
Puis, elle ajouta :
— Il y a un proverbe que citent les petits enfants : On est quelquefois pendu pour avoir dit la vérité.
— Savez-vous, reprend l’interrogateur, si vous êtes en état de grâce ?
Question perfide, à laquelle elle ne peut répondre ni oui, ni non, sans se condamner elle-même. Un murmure de désapprobation s’élève parmi les assistants et un des assesseurs fait observer qu’elle n’est pas tenue d’y répondre. Mais elle, sans se déconcerter :
— Si je n’y suis pas, que Dieu m’y mette, si j’y suis, qu’il daigne m’y conserver. Il n’est rien au monde dont je fusse plus fâchée que de savoir ne pas être en la grâce de Dieu. Si j’étais dans le péché, je crois que la Voix ne viendrait pas vers moi. Je voudrais que tout le monde le comprît aussi bien que moi.
Interrogée ensuite sur les sentiments qu’elle éprouvait, dans son enfance, à l’égard des Bourguignons, elle répondit franchement, sans souci de froisser le juge et les assesseurs, qui étaient tous de ce parti :
— Je ne connaissais qu’un seul Bourguignon, à Domrémy, et j’eusse bien voulu qu’il eût la tête coupée, si toutefois c’eût été le bon plaisir de Dieu. Depuis que j’ai compris que mes Voix étaient pour le roi de France, je n’ai pas aimé les Bourguignons. Ils auront la guerre, s’ils ne font pas leur devoir. La Voix me l’a dit.
Après lui avoir fait raconter ses occupations à Domrémy et les joyeux ébats de la jeunesse du village sous l’arbre des 196fées, Jean Beaupère lui demanda si elle voulait avoir un habit de femme.
— Donnez-m’en un ; je le prendrai et m’en irai. Je ne le prendrai pas à d’autre condition. Je suis contente de celui que j’ai, puisqu’il plaît à Notre-Seigneur que je le porte.
§5. Quatrième séance (27 février)
Jean Beaupère commence par demander à l’accusée si elle a jeûné pendant le Carême :
— Oui vraiment, — répond-elle, — j’ai jeûné tout le carême.
Elle avait déjà dit à l’audience précédente :
— Depuis hier après midi, je n’ai bu ni mangé.
L’interrogatoire roule ensuite sur la Voix :
— L’avez-vous entendue depuis samedi ?
— Oui vraiment, je l’ai entendue souvent.
— Dans cette salle ?
— Ce n’est pas de votre procès… Oui, je l’ai entendue ; mais je ne la comprenais pas bien avant d’être rentrée dans ma chambre.
— Et quand vous avez été rentrée ?
— Elle m’a dit de vous répondre hardiment. Je vous dirai volontiers ce que Notre-Seigneur m’a permis de dire ; mais pour ce qui est des révélations qui concernent le roi de France, je ne le dirai pas sans permission de ma Voix. Je lui ai demandé conseil sur certaines questions, qui m’étaient posées ; j’ai eu conseil sur quelques points. Si je répondais sans permission, je n’aurais pas mes Voix en garant ; mais, lorsque Notre-Seigneur m’aura donné permission, j’aurai bon garant.
— La Voix était-elle l’a voix d’un ange, d’un saint ou de Dieu ?
— C’était la voix de sainte Catherine et de sainte Marguerite. Elles avaient, sur la tête, de belles couronnes, fort riches et de très grand prix. J’ai la permission de vous le dire. Si vous en doutez, envoyez à Poitiers, où j’ai été précédemment interrogée.
— Comment les distinguez-vous l’une de l’autre ?
— Par la salutation qu’elles me font. Il y a bien sept ans qu’elles sont chargées de me gouverner. Je les connais encore parce qu’elles me disent leurs noms.
On lui fait alors une série de questions sur les vêtements, l’âge, etc., des saintes et sur la figure de saint Michel. Elle refuse de répondre. Mais, quand Beaupère lui demande si elle a vu l’ange et les 199saintes sous une forme corporelle, elle répond sans hésiter :
— Je les ai vus de mes yeux, des yeux de mon corps, aussi bien que le vous vois vous-même. Quand ils s’éloignaient, je pleurais, j’aurais bien voulu qu’ils m’eussent emportée avec eux.
— Que vous dit saint Michel à propos du roi ?
— Vous n’aurez pas encore de réponse aujourd’hui. Mes Voix m’ont ordonné de répondre hardiment. J’ai bien dit une fois à mon roi tout ce qui m’a été révélé, parce que j’allais vers lui pour cela ; mais je n’ai pas la permission de vous révéler ce que m’a dit saint Michel. Combien je voudrais que vous eussiez une copie du livre qui est à Poitiers ! Si toutefois Dieu en était content.
— Puis, à la suite de nouvelles questions sur les saintes :
— Je vous ai assez dit que ce sont sainte Catherine et sainte Marguerite. Croyez-moi si vous voulez. Je ne suis venue en France que sur le commandement de Dieu. J’aurais mieux aimé être tirée à quatre chevaux que de venir en France sans son congé.
— Est-ce Notre-Seigneur qui vous a dit de prendre le vêtement d’homme.
— Le vêtement est peu de chose ; c’est un point de minime importance. Ce n’est sur le conseil d’aucun homme que j ai pris le vêtement d’homme. Je n’ai pris le vêtement, je n’ai fait quoi que ce soit que sur le commandement de Dieu et des anges. S’il m’ordonnait de prendre un autre vêtement, je le prendrais. Tout ce que j’ai fait par le commandement de Dieu, je crois l’avoir bien fait. Voilà pourquoi j’en attends bonne garantie et bon secours.
— Quand vous avez vu votre roi la première fois, y avait-il un ange au-dessus de sa tête ?
— Par la bienheureuse Vierge Marie, s’il y en avait un, je ne l’ai pas vu.
— Sur quoi votre roi ajouta-t-il foi à vos paroles ?
— Il eut de bons signes et les clercs furent d’avis qu’il devait me croire.
— Quelles révélations lui fîtes-vous ?
— Vous ne saurez pas cela de moi cette année. Pendant trois semaines, je fus interrogée par des ecclésiastiques à Chinon et à Poitiers, et mon roi, avant de se décider à me croire, eut de bons renseignements sur mon passé. Les clercs 200de mon parti furent d’avis qu’il n’y avait rien que de bon dans mon fait.
La séance continua par une série de questions concernant son épée, son étendard et la part qu’elle avait prise à la délivrance d’Orléans. Heureuse, sans doute, de se trouver ainsi. amenée sur le terrain de ses premiers exploits, elle ne fit pas difficulté de satisfaire amplement la curiosité du tribunal. Son récit ayant été précédemment reproduit (livre II, ch. Ier), nous nous contenterons d’en détacher ici les deux passages les plus saillants.
— J’aimais beaucoup mon épée, parce qu’elle avait été trouvée dans l’église de sainte Catherine que j’aime beaucoup. Je la portais continuellement jusqu’à l’assaut contre Paris. J’avais cette épée à Lagny ; mais, de Lagny jusqu’à Compiègne, je portai une épée prise sur un Bourguignon, parce que c’était une bonne épée de guerre, bonne pour donner de bonnes bouffes et de bons torchons.
— J’aimais quarante fois plus mon étendard que mon épée. Dans les combats, je portais cet étendard pour éviter de tuer quelqu’un. Je n’ai jamais tué personne.
§6. Cinquième séance (1er mars)
Au début de la séance, Jeanne refusa énergiquement, pour la cinquième fois, de s’engager par serment à dire la vérité sur tout ce qui lui serait demandé.
— Je sais, — dit-elle, — bien des choses qui ne sont pas de ce procès et qu’il n’est pas besoin de dire. Mais tout ce que je saurai touchant le procès, je vous dirai la vérité, comme si j’étais devant le Pape de Rome.
Celui-là était donc à ses yeux le vrai Pape ; car il y en avait alors deux autres. Ce fut l’occasion de l’interroger sur sa lettre au comte d’Armagnac. En effet, ce seigneur, excommunié par Martin V et ne sachant comment se tirer d’embarras, avait écrit à la Pucelle pour lui demander conseil. Elle avait fait une réponse évasive.
Lecture est donnée de la lettre du comte et de la réponse de Jeanne. Celle-ci reconnaît avoir fait cette réponse, en partie seulement ; le reste est le fait du clerc qui l’avait écrite. L’interrogateur 201lui ayant demandé si elle ne savait pas auquel des trois Papes le comte devait obéir, elle répondit :
— Le comte voulait savoir à qui Dieu voulait qu’il obéît et je ne savais pas ce que, sur ce point, je devais lui mander. Mais, pour ce qui est de moi, je crois et je tiens que nous devons obéir au Pape, qui est à Rome. Je n’ai jamais écrit ni fait écrire sur les trois Papes. J’affirme, sous la foi du serment, que je n’ai jamais écrit, ni fait écrire à ce sujet.
On lut ensuite la lettre qu’elle avait adressée aux Anglais, avant d’entrer en campagne, et dans laquelle elle leur annonçait qu’ils seraient boutés hors de France. Elle reconnut l’exactitude de la copie, à trois mots près.
Après quoi, saisie tout à coup de l’esprit prophétique, elle s’écria :
— Avant sept ans, les Anglais perdront un gage plus grand qu’ils n’ont fait à Orléans… Ils perdront tout en France. Ils éprouveront une perte telle qu’ils n’en ont jamais éprouvé de pareille, et ce sera par une grande victoire que Dieu enverra aux Français. Je le sais par la révélation qui m’en a été faite. Je le sais d’une manière aussi certaine que je sais que vous êtes devant moi.
Cinq ans plus tard, Paris, gage plus grand qu’Orléans, ouvrait ses portes à Charles VII ; et, finalement, les Anglais perdaient tout en France, après la bataille de Châtillon, où leur armée fut anéantie. Il ne leur restait que Calais.
L’interrogatoire continue :
— Quel jour avez-vous parlé à vos saintes ?
— Hier et aujourd’hui ; il ne se passe pas de jour que je ne les entende. Je serais morte sans la révélation, qui me réconforte chaque jour. Je les vois toujours sous la même forme ; elles portent des couronnes d’une grande richesse.
On veut lui faire donner des détails sur leur apparence, figure, bras et autres membres ; elle s’y refuse. Mais elle déclare
qu’elles ont un langage excellent, fort beau, et qu’elle les comprend bien… La Voix est douce, modeste et c’est en français qu’elle s’exprime.
— Ainsi, elle ne parle pas anglais ?
— Comment parlerait-elle anglais, puisqu’elle n’est pas du parti anglais ?
Questionnée 202à propos de deux bagues qu’on lui a prises, elle répond :
— Celle que vous avez, Monseigneur, est un cadeau de mon frère. Je vous charge de la donner à l’église.
— Quelles promesses vous ont faites vos saintes ?
— Cela n’est nullement de votre procès… Elles m’ont dit que mon roi recouvrerait son royaume, que ses ennemis le veuillent ou non. Elles m’ont promis de me conduire en paradis ; c’est ce que je leur avais demandé. J’ai une autre promesse, je ne vous la dirai pas ; cela ne touche pas le procès. Avant trois mois, je vous dirai l’autre promesse.
— Vous ont-elles dit que vous seriez délivrée ?
— Cela n’est pas de votre procès. J’ignore quand je serai délivrée, vous m’en parlerez dans trois mois.. Il faudra bien que je sois délivrée un jour. Je veux avoir permission pour vous le dire, je demande un délai… Ce que je sais bien, c’est que mon roi recouvrera le royaume de France. Je le sais aussi certainement que je sais que vous êtes devant moi dans cette salle d’audience.
Elle laissait ainsi clairement entendre que ses Voix lui avaient dit qu’elle serait délivrée avant trois mois. Elle le fut, en effet, par son martyre, qui fut consommé deux jours avant ce terme. Mais, il est évident qu’elle rêvait d’un tout autre genre de délivrance.
— Quelle était la figure de saint Michel ?
— Je ne lui ai pas vu de couronne et je ne sais rien de ses vêtements.
— Était-il nu ?
— Pensez-vous que Dieu n’ait pas de quoi le vêtir ?
— Avait-il des cheveux ?
— Pourquoi les lui aurait-on coupés ? Je ne sais pas s’il a des cheveux. J’ai une grande joie, quand je vois saint Michel ; car, lorsque je le vois, il me semble que je ne suis pas en péché mortel. Je ne sais pas si je fus jamais en péché mortel ; je ne crois pas en avoir lait les œuvres. Plaise à Dieu que le ne fasse jamais, que je n’aie jamais fait rien qui soit un poids pour mon âme.
— Quel signe avez-vous donné à votre roi, que vous veniez de la part de Dieu ?
— Je vous ai toujours dit que vous ne le tireriez pas de ma bouche. Allez le lui demander. De ce qui touche 203à mon roi, je ne vous parlerai pas. Ce que j’ai promis de tenir très secret, je ne vous le dirai pas ; je ne puis le dire sans être parjure. Je l’ai promis à sainte Catherine et à sainte Marguerite, sans en être requise par elles ; c’est de moi-même que je me suis imposé cette obligation, parce que trop de gens m’auraient sollicitée à ce sujet, si je n’avais pas fait cette promesse aux saintes.
§7. Sixième séance (3 mars)
Cette séance débute par de nouvelles questions sur l’apparence extérieure de saint Michel et des saintes ; l’accusée refuse d’y répondre et ajoute :
— Je vous ai dit ce que je sais et je ne vous répondrai pas autre chose. J’ai vu saint Michel lui-même et les saintes, dont vous parlez. Je les ai vus de mes yeux et je crois que ce sont eux aussi fermement que je crois en Dieu.
— Savez-vous, par révélation, si vous échapperez ?
— Cela ne regarde pas votre procès. Voulez-vous que je parle contre moi ? Je m’en rapporte à Notre-Seigneur. Si tout cela vous regardait, je vous le dirais. Par ma foi, je ne sais ni le jour ni l’heure. Mes Voix m’ont dit, en général, que je serai délivrée. Elles m’ont dit aussi de faire hardiment bon visage.
Revient ensuite la question de l’habit viril :
— Le roi, la reine et les docteurs de Poitiers vous ont-ils demandé si c’est par révélation que vous l’avez pris ?
— Je ne me rappelle pas si cela m’a été demandé ; c’est écrit à Poitiers.
— Pensez-vous que vous auriez fait une faute, en prenant un habit de femme ?
— Je lais mieux d’obéir à mon souverain Seigneur, à Dieu.
Puis, c’est une série de questions à propos des panonceaux que les compagnons de la Pucelle avaient faits sur le modèle de son étendard : quelle en était l’étoffe ? Les renouvelait-on souvent ? Les aspergeait-on d’eau bénite ? etc., etc. L’accusée promettait-elle bon succès à ceux qui les portaient ?
— Je leur disais bien quelquefois : Entrez hardiment parmi les Anglais, et j’y entrais moi-même.
On voit ensuite défiler pêle-mêle, dans le procès-verbal, Frère Richard et Catherine de La Rochelle, l’enfant ressuscité 204à Lagny, les bonnes femmes qui faisaient toucher leurs anneaux à celui de la Pucelle, son portrait, les messes qui furent dites à son intention, la haquenée de l’évêque de Senlis, qu’elle avait prise, et autres balivernes, jusqu’à des papillons, qu’on aurait cueillis sur son étendard.
§8. Grave modification, décidée par Cauchon
Après le départ de l’accusée, Cauchon fit part aux assistants d’une modification qu’il jugeait à propos d’apporter à la tenue des audiences.
Le procès, — disait-il, — serait continué sans interruption ; [des docteurs, désignés par lui,] seraient chargés d’extraire des aveux de Jeanne ce qu’il y aurait à en recueillir. Si, après cet extrait, il y avait des points, sur lesquels l’accusée dût être encore interrogée, elle le serait par quelques hommes, députés par lui à cet effet, sans qu’il fût nécessaire de causer du dérangement à tous ceux qui étaient ou avaient été présents. Tout serait rédigé par écrit, pour que, lorsque ce serait opportun, les sus-dits docteurs pussent en délibérer et formuler leur avis.
La résolution, énoncée ici par Cauchon, est, — dirons-nous après le R. P. Ayroles, — de toute importance. L’instruction avait été jusque-là très favorable à l’accusée.
En lisant, ses réponses dans un procès-verbal décoloré et incomplet, on reste frappé d’admiration.
Que serait-ce si nous l’avions entendue, faisant face aux interrogateurs, parfaitement maîtresse d’elle-même, demandant délai pour répondre, écartant, comme un jurisconsulte, les questions étrangères au procès, jetant ses terribles prophéties, rappelant à Cauchon la responsabilité qu’il encourait… Jeanne était victorieuse ; l’opinion était pour elle. C’est ce qui a du déterminer Cauchon à écarter tant de témoins de sa défaite et lui faire chercher les moyens de les tromper.
Des interrogatoires, devant quelques rares témoins de son choix, lui permettraient de peser sur les greffiers, qui ne seraient plus soutenus par le témoignage que rendrait à leur fidélité une assistance nombreuse. L’on pourrait présenter, sous un 205aspect tout autre, les aveux de la sainte fille ; les absents seraient bien tenus de s’en rapporter à ce que l’on dirait avoir été confessé par elle. Système de noire iniquité, que le Caïphe devait poursuivre jusqu’à la fin. Il allège ou fait disparaître la responsabilité de beaucoup de ceux qui, dans la suite, sont intervenus comme consulteurs dans la sentence ; mais il charge d’autant la mémoire du grand prévaricateur. [Ayroles, Vraie Jeanne d’Arc, V, 242.]
Les docteurs qu’il désigna se réunirent chez lui et consacrèrent six jours à éplucher les réponses de la Pucelle.
207Chapitre IV Procès préparatoire (suite) Les neuf dernières séances, en présence de rares témoins choisis par Cauchon
§1. Septième séance (10 mars)
Le 10 mars, Cauchon se présenta à la prison, accompagné seulement de trois docteurs et de deux témoins. L’interrogateur, maître Jean de la Fontaine, ouvrit la séance en demandant à l’accusée des détails sur la sortie de Compiègne, où elle avait été prise. Les réponses ont été reproduites dans notre récit. Puis, après quelques questions futiles sur son étendard, son écurie, son trésor de guerre, il arrive tout de suite à un sujet plus important, le signe qu’elle avait donné au roi, comme preuve de sa mission.
Dès la première séance, elle avait formellement déclaré qu’elle aimerait mieux avoir le cou coupé que de le révéler, et, de fait, dans les séances suivantes, malgré des instances réitérées, on n’avait pu lui arracher un mot sur ce sujet. Ce jour-là, pour donner une apparence de satisfaction à la curiosité des interrogateurs, sans d’ailleurs rien révéler de son secret, peut-être aussi dans l’espérance qu’ils cesseraient de la tourmenter à propos de ce signe, elle imagina de leur raconter une fiction, dans laquelle elle-même joue le rôle d’un ange, venant, de la part de Dieu, apporter au roi une riche couronne. L’archevêque Gélu ne l’avait-il pas appelée l’ange du Dieu des armées ? Elle ne mentait pas, en disant :
— Un ange, de par Dieu et non pas de par un autre, bailla le signe à mon roi. Ce signe était beau, honorable et bien croyable. Les clercs de par delà, quand ils surent 208le dit signe, cessèrent de m’arguer.
Elle ne devait pas tarder à s’apercevoir que l’évêque de Beauvais et les clercs à sa dévotion étaient plus exigeants.
§2. Huitième séance (12 mars)
— L’ange, qui apporta le signe au roi, parla-t-il ?
— Oui, il dit au roi que l’on me mît à l’œuvre et que le pays serait soulagé.
— L’ange vous a fait défaut, quand vous avez été prise ?
— Je crois, puisque cela plaît à notre Seigneur, que c’est le mieux que j’aie été prise.
(Mot sublime de résignation et de parfait acquiescement à la volonté divine !)
— L’ange ne vous a-t-il pas failli aux biens de la grâce ?
— Comment ne faillirait-il, quand il me conforte tous les jours ? J’entends le confort que je reçois par le moyen de sainte Catherine et de sainte Marguerite. Souvent elles viennent sans être appelées. Si elles tardaient à venir, je requerrais Notre-Seigneur. Je n’en eus jamais quelque peu besoin, sans qu’elles soient venues.
Les questions suivantes ont pour objet son vœu de virginité, sa citation à Toul, en cause de mariage, le silence qu’elle a gardé sur ses visions vis-à-vis de ses parents et de son curé, enfin sa fuite de la maison paternelle.
— En partant ainsi, ne pensiez-vous. pas pécher ?
— Puisque Dieu le commandait, il convenait de le faire. Quand j’aurais eu cent pères et cent mères, quand j’aurais été fille de roi, je serais partie.
— Vos Voix vous ont-elles appelée fille de Dieu, la fille au grand cœur ?
— Avant la levée du siège d’Orléans et depuis, tous les jours, quand elles me parlent, elles m’ont appelée plusieurs fois Jeanne la Pucelle, fille de Dieu.
— Puisque vous vous dites fille de Dieu, pourquoi ne dites-vous pas volontiers le Pater ?
— Je le dis volontiers et quand, autrefois, j’ai refusé, c’était dans l’intention que Mgr de Beauvais me confessât.
§3. Neuvième séance (même jour, soir)
Les premières questions portent sur les songes de Jacques d’Arc à propos de sa fille, puis sur l’habit viril :
— En prenant l’habit d’homme, pensiez-vous mal faire ?
— Non, et encore à présent, si j’étais en l’autre parti et en habit d’homme, il me semble que ce serait 209un grand bien pour la France, que je fisse comme je faisais devant ma prise.
— Comment auriez-vous délivré le duc d’Orléans ?
— J’aurais fait de par de ça assez de prises d’Anglais pour le ravoir, et si je n’en avais pas assez pris, j’eusse passé la mer, pour l’aller quérir à puissance, en Angleterre.
— Dans l’espace de trois ans ?
— Oui, et je le dis à mon roi, et lui demandai qu’il me laissât faire des prisonniers. Si j’avais duré trois ans, sans empêchement, je l’eusse délivré. C’était un terme plus bref que trois ans et plus long que le terme d’un an.
— Quel signe avez-vous baillé à votre roi ?
— J’en aurai conseil auprès de sainte Catherine.
§4. Dixième séance (13 mars)
Le sous-inquisiteur Lemaître siégea, pour la première fois, à cette séance. Il avait amené avec lui, comme consulteur, un autre dominicain, Isambart de la Pierre, et un troisième greffier.
La question du signe donné au roi fut reprise.
— Quel était ce signe ?
— Seriez-vous contents que je me parjurasse ? J’ai promis et juré de ne pas le dire. Le signe ce lut ce que l’ange certifiait à mon roi en lui apportant la couronne. Il lui disait qu’il aurait le royaume de France tout entier, à l’aide de Dieu et moyennant mon labeur ; qu’il me mît en besogne, à savoir, qu’il me baillât des gens d’armes, autrement il ne serait, pas couronné de sitôt.
— Depuis hier, avez-vous parlé à sainte Catherine ?
— Oui, je l’ai ouïe, elle m’a dit plusieurs fois de répondre hardiment aux juges, sur ce qu’ils me demanderaient touchant le procès.
Nouvelles questions sur l’ange, qui apporta la couronne, le lieu, le jour, l’heure, où elle fut remise, la matière dont elle était faite. Jeanne répond en continuant toujours son allégorie :
— Elle était d’or fin, si riche que je ne saurais en nombrer la richesse.
— L’ange entra-t-il par la porte ? Marchait-il par terre ?
— Il vint de haut ; j’entends qu’il venait par le commandement de Notre-Seigneur. Il entra par l’huis de la chambre, vint devant le roi et fit la révérence au roi, en s’inclinant devant lui et en prononçant les paroles que j’ai dites du signe. Avec cela, il lui remettait 210en mémoire la belle patience qu’il avait eue dans les tribulations, qui lui étaient survenues… Depuis l’huis, il marchait par terre en venant au roi.
— Est-ce à cause de votre mérite que Dieu envoya son ange ?
— Il venait pour grande chose ; ce fut, en espérance que le roi crût le signe pour que l’on cessât de m’arguer.
— Pourquoi avez-vous été choisie plutôt qu’un autre ?
— Il a plu à Dieu ainsi faire par une simple pucelle, pour rebouter les ennemis du roi.
— Où l’ange avait-il pris cette couronne ?
— Elle a été apportée de par Dieu ; il n’y a orfèvre au monde, qui la sût faire si belle et si riche. Quant au lieu où il l’a prise, je m’en rapporte à Dieu.
— Avait-elle bonne odeur ?
— Je n’ai pas gardé mémoire de cela ; je m’en aviserai… Je me souviens ; elle sent bon et le sentira longtemps ; mais qu’elle soit bien gardée ainsi qu’il appartient. Elle était en manière de couronne, et la couronne signifiait que le roi tiendrait le royaume de France.
— Y avait-il des pierreries ?
— Je vous ai dit ce que j’en sais.
— L’avez-vous maniée, baisée ?
— Non.
La conclusion, qui se dégage de ce minutieux interrogatoire, est que la Pucelle n’avait nullement en vue un objet matériel. Le mot couronne, dont elle se sert, est bien, comme elle l’explique elle-même, un symbole : la couronne signifiait que le roi tiendrait le royaume.
— Avez-vous eu révélation de vos Voix d’aller à Paris, à La Charité, à Pont-l’Évêque ?
— Non, j’y allai à la requête des gens d’armes. Depuis qu’à Melun j’eus révélation que je serais prise, je m’en rapportais le plus souvent aux capitaines pour le fait de la guerre.
§5. Onzième séance (14 mars)
L’audience commence par un interrogatoire sur le saut de Beaurevoir (Livre III, chap. Ier) ; puis Jean de la Fontaine pose cette question :
— Vos Voix demandent-elles délai pour répondre ?
— Sainte Marguerite me répond aussitôt ; mais quelquefois je manque de l’entendre, à cause de la turbation des personnes et des noises des gardes. Quand je 213fais requête aux saintes, elles font requête à Notre-Seigneur ; puis, du commandement de Notre-Seigneur, elles me donnent réponse.
— Quand les saintes viennent, y a-t-il de la lumière ?
— Il n’est pas de jour qu’elles ne viennent en ce château et elles n’y viennent pas sans lumière… Si tant est que je sois menée à Paris, faites que j’aie le double des interrogations et de mes réponses, pour que je le baille à ceux de Paris et que je puisse leur dire :
Voilà comment j’ai été interrogée à Rouen et ce que rai répondu, et que je ne sois Plus travaillée de tant de demandes.— Vous avez dit que Mgr de Beauvais se mettait en danger, en vous mettant en cause, qu’est-ce que cela ?
— Ce que c’était et ce que c’est encore ? C’est que dis à Mgr de Beauvais :
Vous dites que vous êtes mon juge ; je ne sais pas, si vous l’êtes ; mais avisez bien de ne pas mal juger ; vous vous mettriez en grand danger. Je vous en avertis, afin que, si Notre-Seigneur vous châtie, j’aie fait mon devoir de vous le dire.— Quel est ce danger ?
La réponse ne figure pas au procès-verbal ; à la place, on est tout étonné de trouver une révélation, énoncée par la Pucelle en termes singulièrement expressifs :
— Sainte Catherine m’a dit que j’aurais secours. Je ne sais pas si ce sera pour être délivrée de la prison ; ou bien, quand je serai en jugement, s’il surviendra quelque trouble, au moyen duquel je pourrai être délivrée ; je pense que ce sera l’un ou l’autre. Le plus souvent mes Voix me disent que je serai délivrée par grande victoire et ensuite elles me disent :
Prends tout en gré ; ne te chaille, pas de ton martyre ; tu t’en viendras enfin au royaume de Paradis.Et cela, les Voix me le disent simplement et absolument, c’est-à-dire sans faillir. Et j’appelle cela martyre, pour la peine et adversité que je souffre en la prison, et je ne sais pas si plus grand en souffrirai ; mais, je m’en attends à Notre-Seigneur.
On remarquera la distinction si nette, qu’elle établit entre ce qu’elle tient pour certain et ce qu’elle donne comme conjectural. Les saintes lui ont dit qu’elle aurait secours, qu’elle serait délivrée par grande victoire et que finalement, après son martyre 214elle irait en Paradis. De cela, elle est absolument certaine, parce que les Voix le disent simplement, absolument, sans faillir. Mais quelle, sera cette grande victoire ? De quel martyre est-il question ? Comment sera-t-elle délivrée ? Elle l’ignore et l’ignorera jusqu’à la fin. En attendant, elle continuera d’espérer qu’un événement quelconque lui permettra de briser ses chaînes et de reprendre sa mission interrompue. Douce illusion, dans laquelle les saintes la laissèrent. N’en avait-elle.pas besoin pour soutenir son courage jusqu’au bout ?
L’interrogateur lui demandant ensuite si elle se tient pour assurée d’être sauvée, elle répond, sans la moindre hésitation :
— Je crois fermement ce que mes Voix m’ont dit, que je serai sauvée, aussi fermement que si j’étais en Paradis.
— Pareille réponse est d’un grand poids.
— Je la tiens pour un grand trésor.
— Croyez-vous ne pouvoir plus faire de péché mortel ?
— Je n’en sais rien ; mais je m’attends du tout à Notre-Seigneur.
§6. Douzième séance (même jour, soir)
Au début de la séance, Jeanne revient d’elle-même sur ses dernières réponses, pour les expliquer :
— Quant à la certitude de mon salut, il faut ajouter : à condition que je tiendrai la promesse et le serment que j’ai faits à Notre-Seigneur, de garder ma virginité de corps et d’âme.
Puis l’interrogateur reprend :
— Est-il besoin de vous confesser, puisque vous croyez que vous serez sauvée ?
— Je ne sais pas avoir péché mortellement ; si j’étais en état de péché, sainte Catherine et sainte Marguerite me délaisseraient aussitôt. Et, pour répondre à votre interrogation, l’on ne saurait trop nettoyer sa conscience.
— Prendre un homme à rançon et puis le faire mourir, n’est-ce pas péché mortel ?
— Aussi, je ne l’ai pas fait.
— Et Franquet d’Arras ?
— Je consentis qu’on le fît mourir, s’il l’avait mérité ; il confessa être meurtrier, larron et traître… Son procès dura quinze jours ; il fut jugé par le bailli de Senlis.
— L’assaut de Paris, un jour de fête, le vol d’un cheval qui appartenait à l’évêque de Senlis, le saut, du haut de la tour de 215Beaurevoir, le port de l’habit d’homme, ne sont-ce pas péchés mortels ?
— Pour le premier reproche, l’assaut contre Paris, je ne pense pas être pour cela en péché mortel ; c’est à Dieu d’en connaître, et, en confession, à Dieu et au prêtre.
Pour le second, le cheval de Senlis, je crois fermement n’en avoir pas de péché mortel ; il fut estimé deux cents saluts d’or, dont le propriétaire reçut assignation. Toutefois, il fut renvoyé au seigneur de La Trémoille, pour être rendu à Mgr de Senlis. Le dit cheval ne valait rien pour moi. D’un côté, ce n’est pas moi qui l’avais pris à l’évêque ; de l’autre, je n’étais pas contente de le retenir, parce que l’évêque était mécontent qu’on lui eût pris son cheval, et aussi parce qu’il ne valait rien pour hommes d’armes.
Pour le troisième cas, le saut de Beaurevoir, ce fut mal fait. Je m’en confessai, sur le conseil de sainte Catherine, et j’en ai eu pardon de Notre-Seigneur. Je ne sais pas si c’était un péché mortel ; je m’en attends à Notre-Seigneur.
Pour le quatrième cas, le port de l’habit, je réponds : Puisque ie le fais par le commandement de Notre-Seigneur, je n’estime pas mal faire. Quand il lui plaira de le commander, l’habit sera déposé.
Les griefs qui viennent d’être allégués, sont tout ce que les ennemis de Jeanne ont pu trouver de plus délictueux dans sa vie ; elle les a tous mis à néant. D’ailleurs, eussent-ils été bien fondés, aucun n’intéresse la foi et le procès est uniquement en matière de foi. Pour avoir un motif, tant soit peu plausible, de condamnation, il fallait donc trouver autre chose. C’est à quoi vont désormais s’employer Cauchon et ses complices.
§7. Treizième séance (15 mars)
Maître Jean de la Fontaine commence par exhorter la Pucelle à s’en rapporter à l’Église, au-cas où elle aurait fait quelque chose contre la foi.
— Que mes réponses, — dit-elle alors, — soient vues et examinées par les clercs, et puis que l’on me dise s’il y a quelque chose contre la foi chrétienne. Je saurai bien dire, par mon conseil, ce qu’il en sera. S’il y a quelque chose de mal contre la foi chrétienne, que Notre-Seigneur 216a commandée, je ne le voudrais pas soutenir et je serais bien fâchée d’aller contre… Je ne vous en répondrai pas autre chose, pour le présent.
L’interrogateur voulut ensuite lui expliquer la distinction qu’il faut faire, entre l’Église militante et l’Église triomphante. À quoi elle aurait répondu, d’après l’huissier Massieu :
— Vous me parlez de l’Église triomphante et militante ; je ne comprends pas ces mots. Je veux me soumettre à l’Église, comme le doit toute bonne chrétienne.
En réponse à une question sur sa tentative d’évasion, à Beaulieu, elle dit :
— Je ne fus jamais prisonnière quelque part que je ne me fusse volontiers évadée. Mais il ne plaisait pas à Dieu que je m’évadasse de cette fois ; il fallait que je visse le roi d’Angleterre, ainsi que mes Voix me l’avaient dit.
— Avez-vous congé, de Dieu ou de vos Voix, de partir ?
— Je l’ai demandé plusieurs fois, je ne l’ai pas encore.
— À présent, partiriez-vous, si vous croyiez le pouvoir ?
— Si je voyais la porte ouverte, mes gardes, et les autres Anglais impuissants à résister, je m’en irais ; je croirais que c’est le congé. Mais, sans congé, je ne m’en irais pas, à moins que ce ne fût un essai de m’échapper pour savoir si Notre-Seigneur en serait content. Le proverbe dit : Aide-toi, le ciel, t’aidera. Je dis cela pour que, si je m’en allais, on ne dise pas que je me suis en allée sans congé.
On lui propose ensuite de choisir entre deux partis, savoir : ou bien prendre un habit de femme, avec lequel elle pourra assister à la messe ; ou bien rester privée de ce bonheur, si elle ne veut pas quitter son costume.
— Certifiez-moi que je l’ouïrai, si je suis en habit de femme ; et, sur ce, je vous répondrai.
— Je vous le certifie.
— Alors, faites-moi faire une robe longue jusqu’à terre, sans queue ; baillez-la-moi pour aller à la messe ; et puis, au retour, je reprendrai l’habit que j’ai. Je vous le demande en l’honneur de Dieu et de Notre-Dame, que je puisse ouïr la messe en cette bonne ville. Baillez-moi un habit, comme en a une fille de bourgeois, c’est à savoir, une houppelande longue et aussi le chaperon 217de femme et je les prendrai pour aller ouïr la messe. Mais je vous demande, le plus instamment que je puis, de me laisser ouïr la messe, sans quitter l’habit que je porte.
L’interrogateur lui demande à nouveau si elle veut soumettre au jugement de l’Église ce qu’elle a dit et fait. On peut déjà prévoir que c’est sur ce terrain que se livrera la lutte suprême. Elle répond :
— Toutes mes œuvres sont en la main de Dieu ; je m’en attends à lui et vous certifie que je ne voudrais rien faire ou dire contre la foi chrétienne, et, si j’avais rien fait ou dit que les clercs pussent dire que c’est contre la foi chrétienne, je ne le voudrais soutenir, mais le bouterais dehors. Je ne vous en répondrai pas maintenant autre chose. Mais, samedi, envoyez-moi le clerc, si vous n’y voulez venir, et je lui répondrai sur cela, à l’aide de Dieu, et ce sera mis par écrit.
— Révérez-vous vos Voix, comme on fait pour les saints ?
— Oui ; et si quelquefois je ne l’ai pas fait, ie leur en ai ensuite crié merci et pardon. Je ne fais point de différence entre sainte Catherine qui est au ciel et celle qui m’apparaît.
— Croyez-vous que ce soit un péché de leur désobéir ?
— Oui, je le crois ; mais je le sais amender. Le plus que les aie courroucées, à mon avis, ce fut au saut de Beaurevoir ; ce dont je leur ai crié merci.
On lui demande si elle avouerait une faute, pour laquelle on dût la faire mourir. Elle répond carrément :
— Non.
(En effet, nul n’est tenu, en ce cas surtout, de témoigner contre soi.)
§8. Quatorzième séance (17 mars)
L’interrogatoire débute ainsi :
— Donnez-nous réponse sur la forme, la figure, le vêtement de saint Michel, quand il vient vers vous ?
— Il était en la forme d’un très vrai prud’homme. Quant à l’habit et aux autres choses, je n’en dirai plus rien. Pour ce qui est des anges, je les ai vus de mes yeux et vous n’aurez plus autre chose de moi à ce sujet. Je crois les dits et les faits de saint Michel, qui m’est apparu, aussi fermement que je crois que Notre-Seigneur Jésus-Christ souffrit mort et passion pour nous. Ce qui me meut à le croire, c’est le bon conseil, la bonne doctrine et le confort, qu’il m’a faits et donnés.
— 218Voulez-vous vous en rapporter, pour tous vos faits et dits, à la détermination de notre Mère Sainte Église ?
— L’Église, je l’aime et je voudrais la soutenir de tout mon pouvoir, pour notre foi chrétienne ; et ce n’est pas moi que l’on devrait détourner ou empêcher d’aller à l’église et d’entendre la messe. Quant aux bonnes œuvres que j’ai faites et à ma venue, il faut que je m’en rapporte au roi du Ciel, qui m’a envoyée à Charles, fils de Charles, roi de France, qui sera roi de France. Vous verrez que les Français gagneront bientôt une grande besogne, que Dieu enverra aux Français. Presque tout le royaume de France en branlera. Je le dis, afin que, quand cela sera arrivé, on se souvienne que je l’ai dit.
La réconciliation du duc de Bourgogne avec Charles VII eut lieu quatre ans plus tard. Cette grande besogne, si favorable à la France que tout le royaume en branla, privait les Anglais d’un puissant allié, dont la perte compromettait irrémédiablement leur situation.
— Vous en rapportez-vous à la détermination de l’Église ?
— Je m’en rapporte à Notre-Seigneur qui m’a envoyée, à Notre-Dame et à tous les benoîts saints et saintes du paradis. Il m’est avis que c’est tout un, Notre-Seigneur et l’Église, et que l’on n’en peut pas faire, difficulté. Pourquoi en faites-vous difficulté, vous, que ce soit tout un ?
— Voulez-vous vous en rapporter à l’Église militante ?
— Je suis venue au roi de France de par Dieu, de par la Vierge Marie et de par les benoîts saints et saintes du paradis, de par l’Église victorieuse de là-haut. À cette Église-là, je soumets tout ce que j’ai fait et ai à faire. Quant à répondre si je me soumettrai à l’Église militante, je n’en répondrai pas maintenant autre chose.
Par conséquent, ni refus ni acceptation, mais réserve prudente. Les soi-disant représentants de l’Église militante, qui se sont constitués ses juges, sont les partisans acharnés de la faction à laquelle elle a infligé de si rudes défaites. Elle le sait et les a récusés comme ses ennemis mortels. Lui demander de se soumettre 221à leur jugement, elle, l’envoyée de Dieu, dont ils sont les indignes ministres, c’était exiger l’impossible.
L’interrogateur revenant alors à l’habit de femme qu’il lui a offert, elle répond :
— Je ne le prendrai pas encore, tant qu’il plaira à Notre-Seigneur. Et, s’il en est ainsi qu’il faille me mener jusques en jugement et me dévêtir en jugement, je requiers des seigneurs de l’Église, qu’ils me fassent la grâce d’avoir une chemise de femme et un couvre-chef sur ma tête. J’aime mieux mourir que de révoquer ce que Notre-Seigneur m’a fait faire. Je crois fermement que Notre-Seigneur ne permettra pas que je tombe si bas, sans que j’aie bientôt secours de Dieu, et par miracle.
— Pourquoi demandez-vous une chemise de femme ?
— Il me suffit qu’elle soit longue.
— Vous avez dit que vous prendriez l’habit de femme, si l’on vous laissait aller ?
— Si l’on me donnait congé en habit de femme, je me mettrais bientôt en habit d’homme et je ferais ce qui m’est commandé par Notre-Seigneur. C’est ce que j’ai répondu précédemment. Pour rien au monde je ne ferais le serment de ne me point armer et de ne pas me mettre en habit d’homme ; cela, pour faire le plaisir de Notre-Seigneur.
Ces réponses laissent voir qu’elle a le pressentiment du sort qui lui est réservé, puisqu’elle prend d’avance ses précautions pour sauvegarder sa pudeur, au dernier moment ; car tel est le sens de sa demande : si Dieu permet qu’elle tombe si bas, qu’on lui donne au moins une chemise longue. Néanmoins, on sent que l’espérance vit toujours au fond de son cœur, puisqu’elle rêve encore de reprendre les armes.
— Savez-vous, — continue l’interrogateur, — si sainte Catherine et sainte Marguerite haïssent les Anglais ?
— Elles aiment ce que Notre-Seigneur aime et haïssent ce qu’il hait.
— Dieu hait-il les Anglais ?
— De l’amour ou de la haine que Dieu a pour les Anglais, je ne sais rien ; mais je sais bien qu’ils seront boutés hors de France, excepté ceux qui y mourront, et Dieu enverra victoire aux Français contre les Anglais.
— 222Dieu n’était-il pas favorable aux Anglais, quand ils étaient victorieux des Français ?
— Je ne sais si Dieu haïssait les Français ; mais, à mon avis, il voulait permettre qu’ils fussent punis, s’ils l’avaient offensé.
§9. Quinzième séance (même jour, soir)
Interrogée sur son étendard, Jeanne répond qu’elle l’a fait faire sur le commandement de ses Voix.
— Leur avez-vous demandé si vous auriez la victoire en vertu de cet étendard ?
— Elles me dirent de le prendre hardiment et que Dieu m’aiderait.
— Qui aidait le plus à la victoire, de l’étendard ou de vous ?
— La victoire de l’étendard ou de moi, tout était à Notre-Seigneur.
— L’espérance de la victoire était-elle fondée en l’étendard ou en vous ?
— Elle était fondée en Notre-Seigneur et pas ailleurs.
— Si vous perdiez votre virginité, perdriez-vous votre bonheur ?
— Cela ne m’a pas été révélé.
— Si vous étiez mariée, les Voix viendraient-elles à vous ?
— Je n’en sais, rien ; je m’en attends à Notre-Seigneur.
— Pensez-vous que votre roi fit bien de tuer ou de faire tuer Mgr le duc de Bourgogne ?
— Ce fut un grand dommage pour le royaume de France ; mais, quelque chose qu’il y eût entre eux, Dieu m’a envoyée au secours du roi de France.
— Vous avez dit à Mgr de Beauvais que vous lui répondriez comme vous le feriez devant le Pape, et cependant vous n’avez pas voulu répondre à plusieurs questions. Ne vous semble-t-il pas que vous seriez tenue de répondre la vérité au Pape, touchant la foi et le fait de votre conscience ?
— Je requiers d’être menée vers lui ; je répondrai devant lui tout ce que je dois répondre.
Voilà un appel formel au Pape ; ce ne sera pas le seul ; mais Cauchon est bien décidé à n’en tenir aucun compte.
Après diverses questions sur les anneaux de la Pucelle, sur les hommages qu’elle rend à ses saintes, sur le sabbat, dont elle déclare ne rien savoir :
— Pourquoi, — dit l’interrogateur, — votre étendard, en l’église de Reims, au Sacre, fut-il plus porté que ceux 223des autres capitaines ?
— Il avait été à la peine ; c’était bien raison qu’il fût à l’honneur.
Admirable réponse, jaillie spontanément du cœur de la Pucelle et enregistrée par ses ennemis eux-mêmes ! Elle clôt superbement cette longue série d’interrogatoires.
§10. Intermède laborieux (17-27 mars)
Dans les quinze longues séances, consacrées à l’interrogatoire, la Pucelle avait dû étaler devant ses juges sa vie entière, le mobile de ses actes, ses sentiments les plus intimes. Elle l’avait fait de bonne foi, avec une sincérité parfaite, qui n’excluait pourtant pas la prudence. Cauchon n’avait plus maintenant qu’à tirer parti de ses aveux, pour y chercher des motifs plausibles de condamnation.
À cet effet, le lendemain de la dernière audience, dimanche de la Passion, il convoqua chez lui une douzaine d’assesseurs, dont trois seulement avaient suivi l’instruction tout entière. Le procès-verbal de ce conseil intime peut se résumer ainsi : chacun des assesseurs devra étudier le sujet et consulter de bons auteurs, afin d’être en mesure de donner, le jeudi suivant, son sentiment personnel sur un certain nombre d’assertions.
Le 22 mars, le sous-inquisiteur et vingt-deux assesseurs se rendirent à la maison de l’évêque. Là, plusieurs docteurs, qui avaient étudié et approfondi la matière scientifiquement — ce sont les termes mêmes du procès-verbal — en firent un rapport. On décida de résumer les extraits du compte rendu de l’instruction en un certain nombre d’articles, qui seraient remis à chaque docteur.
Remarquons que les extraits, qui avaient servi de base aux rapports des docteurs, avaient été faits sous l’œil de Cauchon ; que les articles sont l’œuvre de son âme damnée, le chanoine d’Estivet ; enfin, que les assesseurs, à l’exception de trois ou quatre des délégués de l’Université, n’avaient pas même assisté à la moitié des audiences et étaient, par conséquent, obligés de s’en rapporter aux pièces qu’on leur communiquait.
Le 24 mars, on tint à la prison une longue séance, dans laquelle 224on lut à l’accusée le procès-verbal de l’instruction, en présence de sept assesseurs seulement, dont cinq maîtres de l’Université. Jeanne prêta serment de tenir pour vrai et avoué ce qu’elle ne contredirait pas. La lecture achevée, elle déclara, affirme le procès verbal,
qu’elle croyait bien avoir dit ce qui était écrit et qu’on venait de lui lire ; elle ne démentit rien de ce qui était contenu dans le registre.
En effet, le greffier Manchon était assez prudent et honnête pour n’y avoir pas mis de faussetés. Mais, il n’en avait pas moins failli à son devoir, en supprimant, sur l’ordre de Cauchon, l’appel de Jeanne au concile et peut-être encore d’autres choses de même gravité.
Le lendemain, dimanche des Rameaux, l’évêque se rendit de nouveau à la prison, en compagnie de quatre assesseurs. Il demanda à Jeanne si, au cas où on lui accorderait d’entendre la messe, comme elle l’avait ardemment requis, à plusieurs reprises et notamment la veille, elle consentirait à prendre un habit de femme, pareil à celui qu’elle portait dans son pays.
Cette proposition était une sorte de guet-apens, dont elle ne pouvait pas sortir indemne. Si elle acceptait ce travestissement, elle devenait la risée de la Cour et de la valetaille du château ; c’eût été, comme le remarque le R. P. Ayroles, une sorte de déchéance et de désaveu de sa mission divine. Si, au contraire, elle refusait, on l’accuserait de n’avoir pas voulu remplir le devoir pascal. C’est, en effet, ce qui arriva et le promoteur se fit donner acte de son refus.
225Chapitre V Procès proprement dit
§1. Trois séances en présence d’un public nombreux Première séance (27 mars)
Le Mardi Saint, l’audience se tint dans une salle du château, en présence de trente-huit assesseurs, y compris trois médecins et deux prêtres anglais. Le promoteur, d’Estivet, déposa l’acte d’accusation, en soixante-dix articles, et prêta serment de non-calomnie, jurant que ni la faveur, ni le ressentiment, ni la crainte, ni la haine, mais le seul zèle de la foi chrétienne lui avait dicté son écrit. Jamais serment ne fut plus faux ; son écrit est, d’un bout à l’autre, un tissu de calomnies, dictées par une haine féroce et, sans doute, aussi par le désir de se ménager la faveur des Anglais.
Il y déclare se proposer de prouver que Jeanne est sorcière, hérétique, schismatique, sacrilège, idolâtre, apostate, blasphématrice, cruellement altérée de sang humain, etc., etc. Où découvrira-t-il la preuve de tant de crimes ? L’enquête préliminaire n’a pas fourni de renseignements défavorables à l’accusée ; aucun témoin n’a été entendu, au cours de l’instruction ; il n’a donc, pour appuyer ses odieuses accusations, que les aveux de la Pucelle. Nous les avons fidèlement reproduits, d’après le procès-verbal, et tout homme de bonne foi y verra la preuve manifeste de la parfaite innocence de l’accusée.
Cauchon adressa ensuite à celle-ci une allocution mielleuse :
— Jeanne, tous ceux que vous voyez devant vous sont des ecclésiastiques d’une haute science, très versés dans le droit divin et 226humain. Leur volonté est de procéder avec vous en toute bénignité et douceur, comme ils l’ont toujours fait, sans esprit de vengeance, sans poursuivre votre punition corporelle, mais pour vous instruire et vous ramener dans la voie de la vérité, si vous avez failli en quelque chose. Comme vous n’êtes ni assez instruite, ni assez habile dans ces difficiles matières, pour connaître ce que vous avez à faire ou à répondre, nous vous offrons de choisir un ou plusieurs des assistants, ou, si vous n’êtes pas en état de faire ce choix, nous nommerons quelques-uns d’entre nous pour vous conseiller. Personnellement vous n’avez qu’à répondre sur les questions de fait et nous vous requérons de jurer que, sur les questions de fait vous direz fidèlement la vérité.
Jeanne répondit :
— Premièrement, de ce que vous m’admonestez de mon bien et de notre foi, je vous en remercie et toute la compagnie aussi. Quant au conseil, que vous m’offrez, aussi je vous en remercie ; mais je n’ai point l’intention de me départir du conseil de Notre-Seigneur. Quant au serment que vous voulez que je fasse, je suis prête à jurer de dire la vérité sur tout ce qui touche à votre procès.
Et elle jura ainsi, les mains sur les Évangiles.
Après ce préambule, commença la lecture des soixante-dix articles, où d’Estivet avait déposé l’amas de calomnies que la haine lui avait inspirées contre la sainte enfant. Cette lecture dut prendre un temps considérable, car le factum est d’une longueur démesurée et, d’autre part, la Pucelle avait à faire ses remarques sur chacun des articles. Très souvent, il est vrai, elle se contente de répondre : Je m’en rapporte à ce que j’ai déjà dit ; ou bien : Je nie l’article, Je nie telle partie de l’article. Mais aussi, d’autres fois, elle explique et précise, toujours avec une lucidité parfaite et une pleine possession d’elle-même, sans se laisser déconcerter par les abominables accusations, dont sa vie si pure est l’objet.
Comme il serait aussi inutile que fastidieux de reproduire, un à un, ces articles, qui seront d’ailleurs, plus tard, réduits 227à douze, nous nous contenterons d’indiquer brièvement le contenu de ceux auxquels l’accusée jugea à propos de répondre d’une manière plus explicite.
Après la lecture du premier article, qui concerne la compétence des juges, elle fait la déclaration suivante :
— Je crois bien que Notre Saint-Père le Pape de Rome, les évêques et autres gens d’Église sont pour garder la foi chrétienne et punir ceux qui défaillent. Mais, quant à moi, de mes faits je ne me soumettrai qu’à l’Église dit Ciel, à savoir, Dieu, la Vierge Marie, les saints et les saintes du paradis. Je crois fermement n’avoir pas défailli en notre foi chrétienne et n’y voudrais défaillir. Je requiers…
La plume du greffier s’est arrêtée sur ce dernier mot. Quelle pouvait bien être cette requête, et pourquoi n’a-t-elle pas été enregistrée ? Ne serait-ce pas alors que ce serait produit l’incident, rapporté précédemment : Jeanne se déclarant, sur le conseil de Frère Isambart, prête à répondre de ses actes devant le concile de Bâle ? D’où accès de fureur de Cauchon et défense faite aux greffiers d’enregistrer sa déclaration. Peut-être aussi demandait-elle, comme elle l’avait déjà fait pendant l’instruction, à être conduite devant le Pape.
Accusée (art. 2) d’avoir fait des sortilèges et de s’être laissée adorer, elle répond :
— Je nie avoir fait des sortilèges, m’être portée à des œuvres de superstition et de divination. Pour ce qui est des hommages à ma personne, si quelques-uns ont baisé mes mains ou mes vêtements, ce n’est pas de ma faute et par ma volonté. Je m’en faisais garder de tout mon pouvoir.
Au sujet de l’habit viril (art. 13-15), elle dit :
— Je ne laisserai point encore mon habit, pour quelque chose que ce soit, ni pour recevoir la communion, ni pour autre chose. Je ne fais pas de différence entre l’habit d’homme et l’habit de femme, et on ne doit pas me refuser de la recevoir à cause de cela. J’aime mieux mourir que de révoquer ce que j’ai fait, du commandement de Notre-Seigneur.
Au grief qu’on lui fait (art. 7) de dédaigner les œuvres de son 228sexe, elle répond :
— Quant aux œuvres de femme il y a assez de femmes pour les faire.
Elle n’ajoute pas : Mais il n’y avait que moi pour faire ce que j’ai fait. Elle en aurait pourtant bien eu le droit.
On lui reproche (art. 17, 18) les promesses qu’elle a faites au roi ; elle les avoue hautement :
— Je confesse que, de par Dieu, je portai à mon roi la nouvelle que Notre-Seigneur lui rendrait son royaume, le ferait couronner à Reims et mettrait hors ses adversaires. En cela, je fus messagère de par Dieu, et je lui dis de me mettre hardiment à l’œuvre et que je lèverais le siège d’Orléans. Je parlais de tout le royaume ; et que, si Mgr de Bourgogne et les autres sujets du royaume ne venaient pas à l’obéissance, le roi les y ferait venir par force. Pour ce qui est du duc de Bourgogne, je l’ai requis, par lettres et par ses ambassadeurs, qu’il y eût paix entre mon roi et le dit duc. Quant à ce qui est des Anglais, la paix qu’il y faut, c’est qu’ils s’en aillent dans leur pays, en Angleterre.
À propos de ses lettres aux Anglais, taxées (art. 21) de témérité et d’orgueil, elle dit :
— Je ne les ai pas faites par orgueil ou présomption, mais par le commandement de Notre-Seigneur. Si les Anglais avaient cru à ces lettres, ils n’auraient été que sages. Avant qu’il soit sept ans, ils s’en apercevront bien.
L’accusation lui reproche (art. 25) de s’être donnée comme envoyée de Dieu, pour des œuvres abominables, faire la guerre et verser le sang. Voici sa réponse :
— Je requérais premièrement que l’on fît la paix et, au cas où l’on ne voudrait pas, j’étais toute prête à combattre.
§2. Deuxième séance (28 mars)
Mêmes assesseurs que la veille, à l’exception de trois. L’un des manquants était Frère Isambart ; le gouverneur l’avait menacé de le faire jeter à la Seine, parce qu’il se montrait favorable à l’accusée. — La lecture des articles continue.
Les révélations et visions de Jeanne, si elles sont réelles, viennent des esprits de malice (art. 32).
— Je nie cet article ; 229j’ai agi par révélation des saintes Catherine et Marguerite ; je le soutiendrai jusqu’à la mort.
C’est présomption à Jeanne de s’être vantée de connaître l’avenir et les choses cachées (art. 33).
— C’est à Notre-Seigneur de faire ses révélations à qui il lui plaît ; c’est par révélation que j’ai connu l’épée et les choses à venir.
L’accusée croit à ses révélations sans donner de preuves, sans avoir consulté (art. 48).
— J’en ai répondu et m’en attends à ce qui est écrit. Quant aux signes, si ceux qui les demandent n’en sont pas dignes, je n’en puis mais. Plusieurs fois, j’ai prié, pour qu’il plût à Dieu de les révéler à quelques-uns de ce parti. Pour ce qui est de croire à mes révélations, je n’en demande point conseil à évêque, curé ou autre. J’ai cru que c’était saint Michel, pour la bonne doctrine qu’il me montrait. Aussi fermement que je crois que Notre-Seigneur est mort pour nous racheter des peines de l’enfer, aussi fermement je crois que ce sont saints Michel et Gabriel, sainte Catherine et sainte Marguerite, que Notre-Seigneur m’envoie pour me conforter et conseiller. Je les invoquerai tant que le vivrai.
— Comment les requérez-vous ?
— Je prie Notre-Seigneur et Notre-Dame pour qu’ils m’envoient conseil et réconfort, et ils me les envoient.
— En quelle manière les requérez-vous ?
— En cette manière :
Très doux Dieu, en l’honneur de votre sainte passion, je vous requiers, si vous m’aimez, que vous me révéliez ce que je dois répondre à ces gens d’Église. Je sais bien, quant à l’habit, comment je l’ai pris par votre commandement, mais je ne sais point de quelle manière je le dois laisser. Pour cela, plaise à vous l’enseigner à moi.Et aussitôt les saintes viennent. J’ai souvent des nouvelles de Mgr de Beauvais.— Que vous disent-elles de moi ?
— Je vous le dirai à part. Elles sont venues aujourd’hui trois fois. Sainte Catherine et sainte Marguerite m’ont dit la manière de répondre de cet habit.
On reprend ensuite la lecture des articles. — L’accusée a eu l’orgueil de se constituer chef d’une armée, dans laquelle on 230voyait des princes et des nobles (art. 53).
— Si j’étais chef de guerre, c’était pour battre les Anglais.
Elle a vécu avec des hommes, refusant les services des femmes (art. 54).
— J’avais des hommes à gouverner ; mais, au logis et au gîte, le plus souvent, j’avais une femme avec moi ; et lorsque j’étais en guerre, je couchais vêtue et armée, quand je ne pouvais pas avoir de femme.
Elle refuse de se soumettre à l’Église militante (art. 61).
— Je voudrais lui porter honneur et révérence de tout mon pouvoir. Quant à ce qui est de me rapporter de mes faits à l’Église militante, il faut que je m’en rapporte à Notre-Seigneur, qui me les a lait faire.
Elle est l’objet de scandale et refuse de s’amender (art. 69).
— Les délits, que le promoteur propose contre moi, je ne les ai pas commis. J’estime n’avoir rien fait contre la foi chrétienne, et, par surplus, je m’en rapporte à Notre-Seigneur.
Le soixante-dixième et dernier article est d’une rare impudence. D’Estivet y affirmait que tous et chacun des faits articulés sont vrais et notoires et que, à plusieurs reprises, l’accusée les a reconnus et avoués. C’était un mensonge effronté. Elle se contenta de répondre :
— Je nie l’article et m’en tiens à ce que j’ai avoué.
§3. Troisième séance (31 mars)
Dans la dernière séance, Jeanne avait demandé délai, jusqu’au samedi, pour répondre au sujet de la soumission à l’Église. Ce jour-là, les deux juges se rendirent à la prison, avec les délégués de l’Université, un secrétaire du roi d’Angleterre et deux gardes. Par conséquent, elle n’a devant elle que des ennemis avérés, sauf peut-être le sous-inquisiteur, qui ne compte pas. Ils n’en ont pas moins la prétention de la juger, au nom de l’Église, dont ils sont les indignes ministres, et ils lui demandent si elle veut se soumettre à l’Église, c’est-à-dire, en fait, à eux et à eux seuls.
Elle répond, d’après le conseil de ses Voix, qu’elle a consultées :
— Je m’en rapporte à l’Église militante, pourvu qu’elle ne 231me commande pas chose impossible à faire. Et voici ce que je répute chose impossible : les faits, que j’ai accomplis et que j’ai exposés, ce que j’ai dit de mes visions et de mes révélations, je ne le révoquerai pas. pour quelque chose que ce soit. Ce que Notre-Seigneur m’a fait faire et commandé, ce qu’il me commandera, je ne le laisserai pas à faire pour homme qui vive, et il me serait impossible de le révoquer. Au cas où l’Église voudrait me faire faire quelque chose de contraire au commandement que Dieu m’a fait, je ne le ferai point, pour quelque chose que ce soit.
— Si l’Église vous dit que vos révélations sont illusions ou choses diaboliques, vous en rapporterez-vous à l’Église ?
— Je m’en rapporterai à Notre-Seigneur, dont je ferai le commandement. Je sais bien que ce qui est contenu dans mon procès est venu par le commandement de Dieu ; il me serait impossible de dire que je l’ai fait pour chose contraire. Et, au cas où l’Église militante me commanderait de dire que je l’ai fait pour chose contraire, je ne m’en rapporterais à aucun homme, mais uniquement à Notre-Seigneur, sans que rien m’empêchât de faire son bon commandement.
— Ne croyez-vous pas être sujette au Pape, aux évêques ?
— Oui, Notre-Seigneur premier servi.
— Vos Voix vous commandent-elles de ne pas vous soumettre ?
— Je ne réponds point chose que je prenne dans ma tête. Ce que je réponds, c’est du commandement de mes Voix. Elles ne me commandent pas de ne pas obéir à l’Église, Notre-Seigneur premier servi.
Cette question de la soumission à l’Église, qui tient tant de place dans les derniers interrogatoires, Cauchon n’avait d’autre motif de la poser que le désir de trouver, dans les réponses de l’accusée, un prétexte à condamnation. En effet, non seulement elle n’avait jamais été diffamée de ce chef, mais les théologiens de Poitiers, qui l’avaient examinée pendant trois semaines, avaient rendu le meilleur témoignage de sa foi et de ses mœurs. Vouloir, sous prétexte de soumission à l’Église, l’obliger à renier sa mission, alors qu’elle était pleinement convaincue de ne 232l’avoir entreprise et menée à bien que sur l’ordre et avec l’aide de Dieu, c’était exiger d’elle un mensonge, une sorte de parjure. Elle avait raison de refuser.
§4. Les douze articles
Le lundi de Pâques (2 avril), Cauchon réunit un conseil intime de docteurs et chargea quelques-uns d’entre eux de relire attentivement toute la suite du procès, puis d’en
extraire des assertions précises, réduites à douze articles, comprenant un sommaire et un abrégé des nombreuses affirmations de Jeanne sur elle-même.
Ce travail, chef-d’œuvre de mauvaise foi, fut achevé en trois jours par des docteurs anonymes. L’accusée n’en eut pas connaissance. Cauchon communiqua les douze articles à un grand nombre de théologiens, avec injonction d’avoir à les étudier et d’en donner leur avis. Ce document est d’une importance capitale, puisque c’est uniquement d’après lui que se sont prononcés les consulteurs, qui n’avaient pas suivi la procédure.
Article premier
Le premier article est le plus long et le plus venimeux. Il commence ainsi : Une femme affirme, etc. On s’est bien gardé d’écrire : Une jeune fille, une pucelle, quoique la virginité de la femme en question, hautement revendiquée par elle, eût été constatée, à Rouen, par la duchesse de Bedford. On ne le pouvait pas d’ailleurs, sans détruire l’accusation par la base ; car, dans les idées du temps, sorcellerie et virginité ne pouvaient jamais se rencontrer dans la même personne. Or, l’article a précisément pour but de laisser entendre que Jeanne est en relation avec les démons, soumise en tout à leur influence et n’agissant que d’après leurs ordres.
Pour cela, on insinue discrètement que ses Voix, étant donné la nature des actes qu’elles lui ont inspirés, ne peuvent être que des démons. Car :
1° Sainte Catherine et sainte Marguerite l’ont quelquefois entretenue auprès de l’arbre des fées. La dite femme les a plusieurs fois vénérées en cet endroit.
On oublie de dire que ce ne fut pas là, mais dans le jardin attenant à l’église, qu’elle avait eu sa première vision.
2352° Elles lui ont dit que, par ordre de Dieu, elle devait se rendre auprès d’un prince du siècle et lui promettre que, par son moyen, il recouvrerait par les armes un grand domaine temporel, beaucoup d’honneur dans le monde.
Ce n’est pas du tout ainsi que la Pucelle avait compris et défini sa mission. Pour la lui faire accepter, l’ange lui avait dépeint la grande pitié, qui était au royaume de France. À ses yeux, il ne s’agissait pas de procurer beaucoup d’honneur dans le monde à un prince séculier, mais de délivrer son pays du joug de l’étranger, de mettre fin à des guerres désastreuses et de replacer sur le trône de ses pères, dont il était injustement dépossédé, un roi vertueux, réduit à la dernière misère.
3° Les mêmes saintes ont prescrit à la même femme, de la part de Dieu, de prendre et de porter l’habit viril. Elle dit préférer mourir que laisser semblable habit. Elle a préféré ne pas assister à la messe, être privée de la communion, plutôt que de reprendre l’habit de femme.
Le fait, ainsi présenté, est faux. Elle avait demandé, pour assister à la messe, une robe longue, comme celle des bourgeoises.
4° Les saintes ont connivé avec la dite femme, alors qu’à l’âge de dix-sept ans, à l’insu et contre la volonté de ses parents, elle a quitté la maison paternelle, pour aller vivre au milieu d’une multitude d’hommes d’armes, sans avoir jamais avec elle ou n’ayant que rarement la compagnie d’une femme.
En lisant ce passage, les théologiens, qui n’avaient pas d’autres renseignements, devaient être fatalement amenés à croire que les esprits, qui avaient connivé à pareille conduite ne pouvaient être que des esprits malfaisants. Mais, ils auraient sans doute changé d’avis, si on leur avait dit que cette jeune fille imposait le respect à tous ceux qui l’approchaient, que ses compagnons la vénéraient comme une sainte ; enfin, qu’elle avait toujours une femme auprès d’elle, durant la nuit, lorsqu’elle se trouvait dans un lieu habité, et que, dans le cas contraire, elle couchait toute vêtue et armée.
2365 Les mêmes saintes lui ont commandé de ne pas se soumettre à l’Église (assertion absolument fausse) ; elles lui ont révélé et fait croire qu’elle serait certainement sauvée.
Après avoir lu ce premier article, plein d’insinuations perfides et de faussetés manifestes, il n’est pas étonnant que des théologiens, ainsi informés, aient cru, de bonne foi, se trouver en présence d’un cas démoniaque.
Article II
Cet article a pour objet le signe donné au roi. On affecte d’y prendre à la lettre le récit, évidemment allégorique, de la Pucelle ; de plus on y dénature sa déclaration ; ainsi, elle avait dit : Un ange vint vers le roi, et nous savons que, dans sa pensée, elle était elle-même cet ange ; au lieu de cela, l’article porte :
Saint Michel vint vers le roi… Cet ange et cette femme marchaient ensemble sur le sol, par le chemin, montaient ensemble l’escalier, etc.
Article III
Elle se croit aussi certaine de la réalité des apparitions de saint Michel, de la vérité et de la sainteté de ses paroles et de ses œuvres, qu’elle l’est de la passion et de la mort de Notre-Seigneur pour notre rédemption.
Article IV
La dite femme affirme être certaine de plusieurs événements futurs, entièrement contingents. Elle se vante d’avoir la connaissance de plusieurs choses cachées
Article V
Elle dit que, dès qu’elle avait reçu le commandement de porter des vêtements d’homme, elle devait prendre tunique courte, braies et chaussures, avec foison d’aiguillettes, couper en rond ses cheveux, ne les laissant tomber que du sommet de la tête aux oreilles.
Cette description du costume de Jeanne est sans doute exacte ; mais le procès-verbal, d’où elle est soi-disant extraite, n’en dit mot.
Article VI
Elle a fait écrire qu’elle ferait mettre à mort ceux qui n’obéiraient pas à ses lettres, et qu’aux coups on reconnaîtrait qui avait le meilleur droit.
Elle avait menacé de tuer les envahisseurs, mais les armes à la main et en combat loyal ; voilà ce qu’il aurait fallu ajouter pour rester dans le vrai.
237Article VII
Partie de la maison paternelle, à l’insu de ses parents, et arrivée près du roi, la dite femme lui déclara qu’elle voulait diriger la guerre contre ses ennemis, lui promettant qu’elle le rendrait possesseur d’une grande seigneurie et qu’elle était envoyée à cette fin par le Dieu du ciel.
Tout cela est vrai, mais on omet de dire que cette seigneurie appartenait légitimement au prince et que ses ennemis étaient des envahisseurs injustes, qui grugeaient ses sujets.
Article VIII
Elle s’est précipitée d’une très haute tour, préférant la mort à la douleur de tomber entre les mains de ses ennemis.
On insinue ainsi qu’elle voulait se tuer, tandis qu’elle ne visait qu’à recouvrer sa liberté.
Article IX
La dite femme avance que ses saintes lui ont promis de la conduire en paradis, pourvu qu’elle garde sa virginité de corps et d’âme. Elle ne pense pas avoir fait de péché mortel.
Article X
La dite femme affirme que Dieu aime certaines personnes, nommées par elle, plus qu’elle-même.
Elle a dit cela, en effet, du roi et du duc d’Orléans, mais seulement pour les biens du corps. Ses saintes
l’entretiennent fréquemment en français et non pas en anglais ; car elles ne sont pas du parti des Anglais.
Si les saintes lui parlaient en français, c’était peut-être bien aussi parce qu’elle ne savait pas l’anglais !
Article XI
La dite femme confesse avoir fait souvent des actes de révérence aux esprits sus-dits, leur a demandé conseil et secours et obéit à leurs ordres ; elle l’a fait, dès le commencement, sans demander conseil à qui que ce soit.
On se garde bien d’ajouter que des théologiens l’avaient examinée longtemps, à Poitiers, sur ce point, et n’avaient rien trouvé de blâmable en sa conduite, bien au contraire.
Article XII
Refus de soumission à l’Église.
Nous avons dit plus haut ce qu’il en faut penser.
Ce court aperçu suffit à montrer avec quelle perfidie les 238douze articles ont été rédigés. Si quelques-uns reproduisent assez exactement les aveux de la Pucelle, d’autres les défigurent, soit en y mêlant des faussetés, soit en supprimant ce qui les explique et justifie sa conduite. Leur ensemble constitue une œuvre de monstrueuse iniquité, conçue et exécutée avec une malice infernale, en vue d’égarer l’intelligence de ceux qui se prononcèrent d’après ce texte.
Cauchon en fit tirer un grand nombre de copies, qu’il distribua aux assesseurs et envoya au clergé de Rouen et des environs, avec ordre de l’examiner et d’en dire leur avis.
§5. Jugements portés, d’après les douze articles
1° Par les consulteurs
Le 12 avril, vingt-deux gradués en théologie, réunis dans la chapelle de l’archevêché, sous la présidence des deux juges, qualifièrent sévèrement les assertions de Jeanne, qui figuraient dans les douze articles. Ce jugement ne pouvait manquer d’exercer une grande influence sur les consulteurs qui n’avaient pas encore donné leur avis, parce qu’il était celui des délégués de l’Université de Paris, qui jouissaient d’un grand crédit et qui d’ailleurs étaient à peu près les seuls à avoir suivi le procès jusqu’au bout. Pour formuler un avis contraire à celui de ces illustres docteurs, il eût fallu une grande indépendance d’esprit, jointe à un grand courage ; car c’eût été s’exposer à des vengeances certaines. Aussi, n’est-on pas étonné de voir l’abbé de Fécamp écrire à Cauchon :
Après l’avis de maîtres, tels qu’on n’en trouverait peut-être pas de pareils dans l’univers, il n’y a rien à dire, sinon adhérer à leur sentiment.
Il n’est pas douteux qu’un grand nombre de consulteurs aient raisonné de même.
Il y eut pourtant des récalcitrants ; ainsi l’official et onze avocats de la cour épiscopale, après avoir donné une appréciation défavorable à la Pucelle, ne craignirent pas de l’infirmer par cette restriction :
Supposé que ces révélations ne viennent pas de Dieu.
C’était tout remettre en question. Trois autres prêtres furent du même avis, disant que tout dépendait de 239l’origine des révélations et se déclarant incapables de discerner cette origine. C’est donc là tout ce que vous avez su faire ? leur dit Cauchon. L’évêque d’Avranches fut plus explicite ; à son avis, c’était là une de ces causes ardues, qui, d’après saint Thomas et le droit canon, doivent être déférées au Saint-Siège. Enfin, l’un des signataires de la consultation du 12 avril, cédant sans doute aux remords de sa conscience, eut le courage de revenir sur son vote et de se prononcer aussi pour l’appel au Pape. L’évêque de Beauvais trouva donc, dans le clergé normand, un certain nombre d’ecclésiastiques assez éclairés et assez fermes pour oser le braver, en refusant de se faire les complices de sa vengeance.
2° Par l’Université
Au contraire, l’Université de Paris tout entière était d’avance gagnée à ses vues. Quatre de ses délégués furent chargés de lui porter les articles et de les commenter. La faculté de théologie, s’étant réunie le 14 avril, pour en délibérer, déclara, d’une voix unanime, la femme mentionnée dans les articles, coupable d’une multitude de crimes abominables, superstition, divination, invocation des démons, idolâtrie, hérésie, impiété, apostasie, etc., etc. Ces docteurs solennels, infatués d’eux-mêmes, ne doutent de rien. Ainsi, non seulement ils savent que les apparitions et visions de Jeanne procèdent des esprits mauvais et infernaux, mais ils ont réussi — on ne sait par quel procédé — à déterminer scientifiquement la personnalité de ces esprits : ce sont Bélial, Satan et Béhémoth ! — La faculté de droit opina à peu près dans le même sens, avec moins de rigueur toutefois.
Ces consultations, si conformes aux désirs de Cauchon, décidaient, en fait, de l’issue du procès. Le sort de l’accusée est désormais fixé d’une manière irrévocable : ou elle se rétractera, ou elle périra par le feu.
Les docteurs, qui avaient été envoyés à Paris, en rapportèrent une lettre, dans laquelle l’Université exaltait, en termes pompeux, la vigilance, la probité, le zèle sincère que l’évêque de 240Beauvais avait déployés, dans
le grand et fameux combat contre la femme qu’on appelle partout la Pucelle. Son poison s’était répandu très loin et avait infecté le bercail très chrétien de presque tout l’Occident.
Ainsi donc, de l’aveu de ses pires ennemis, Jeanne avait convaincu de la réalité de sa mission — car c’est bien là ce qu’ils appellent son poison, — non seulement les Français, mais les peuples voisins.
Cette édification des peuples, — ajoute la lettre, — est une iniquité et un scandale, il faut qu’elle cesse.
Les prêtres juifs et les pharisiens disaient aussi de jésus : Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui ; il faut donc qu’il meure.
§6. Maladie de la Pucelle
Pendant que les théologiens et les canonistes de Rouen et de Paris épluchaient les douze articles, Jeanne tomba gravement malade. Les mauvais traitements qu’elle endurait dans sa prison et qu’elle appelait elle-même un martyre, les fatigues de tant d’interrogatoires, les émotions de ces dix mois de captivité, tout cela, joint à l’abstinence et au jeûne du carême, avait fini par ébranler sa santé, si robuste qu’elle fût.
Le gouvernement anglais avait prévu le cas et pris ses précautions en conséquence : il avait sous la main deux médecins de Paris, appelés d’avance, pour donner leurs soins à la prisonnière, le cas échéant. Warwick les manda tout de suite au château et leur enjoignit de ne rien négliger, disant que la malade avait coûté fort cher et que, pour rien au monde, le roi ne voulait qu’elle mourût de mort naturelle. Les médecins la trouvèrent en proie à la fièvre, étendue sur son lit et les fers aux pieds. Quand ils parlèrent de la saigner : Gardez-vous en bien, dit Warwick, la malade est avisée et elle pourrait bien en profiter pour se faire mourir. Il finit pourtant par consentir et la saignée fut suivie d’un mieux sensible.
La guérison était en bonne voie, lorsqu’une visite fâcheuse du promoteur vint tout compromettre. La maladie ayant 243commencé par des vomissements, survenus après un repas, où Jeanne avait mangé une carpe, envoyée par l’évêque de Beauvais, elle se hasarda à dire que cette carpe était peut-être la cause de son mal. Là-dessus, violente colère de d’Estivet :
— Tu en as menti, s’écria-t-il, d’un ton furibond. Toi, paillarde, tu as mangé des harengs et d’autres choses, qui te sont contraires.
Et il continua de l’invectiver, en termes tels que nous ne voulons pas les reproduire, par respect pour le lecteur. À la suite de cette scène, la fièvre revint, plus forte que jamais.
§7. Première exhortation charitable
Cependant, Cauchon, d’accord avec le régent, cherchait avant tout à obtenir de Jeanne un désaveu de sa mission, parce que ce désaveu eût porté la plus grave atteinte à l’honneur de Charles VII, qui eût été ainsi convaincu d’être redevable de sa couronne aux services d’une aventurière. D’un autre côté, la législation ecclésiastique imposait aux juges l’obligation de ne rien négliger pour amener les coupables à résipiscence. Ce fut sans doute ce double motif qui engagea l’évêque à se rendre sans retard auprès de la prisonnière et à profiter de l’état d’extrême faiblesse où elle était réduite, pour lui arracher plus facilement un désaveu, si gros de conséquences.
Il se rendit donc à la prison, le 18 avril, en compagnie de six ecclésiastiques, et adressa à la malade une exhortation doucereuse, dont nous détachons le passage suivant :
— Les docteurs et maîtres, que vous voyez autour de vous, viennent, par bonne amitié et en esprit de charité, vous visiter dans votre maladie et vous apporter consolation et réconfort. Tous ici, nous sommes des ecclésiastiques ; par vocation, par choix, par inclination, nous sommes disposés à procurer, par tous les moyens possibles, votre salut, spirituel et corporel, comme nous le ferions pour nos proches et pour nous-mêmes.
La conclusion de ce pathétique discours fut que Jeanne devait se conformer aux avis de ces charitables ecclésiastiques ; autrement ils seraient forcés de l’abandonner et elle se trouverait en grand péril.
— 244Je vous remercie, — répondit-elle d’une voix languissante, — de ce que vous me dites pour le salut de mon âme. Il me semble, vu ma maladie, que je suis en grand danger de mort ; et, si tel est le bon plaisir de Dieu envers moi, je vous demande d’avoir la confession, mon Sauveur et l’inhumation en terre sainte.
— Il faut pour cela vous soumettre à l’Église
— Je ne saurais vous en dire maintenant autre chose. Si le corps meurt en prison, je m’attends à ce que vous le fassiez mettre en terre sainte ; si vous ne l’y faites pas mettre, je m’en attends à Notre-Seigneur.
— Si vous ne voulez pas vous soumettre à l’Église, vous serez abandonnée, comme un sarrasine.
— Je suis bonne chrétienne et je mourrai en bonne chrétienne. Pour ce qui regarde cette soumission, je ne vous en répondrai que ce que j’en ai déjà répondu. J’aime Dieu, je le sers, je suis bonne chrétienne. Je voudrais aider et soutenir la sainte Église de tout mon pouvoir.
— Ne voudriez-vous pas que l’on ordonne une belle procession pour vous remettre en bon état, si vous n’y êtes ?
— Je veux très bien que l’Église et les catholiques prient pour moi.
§8. Deuxième exhortation charitable
Jeanne, ayant enfin recouvré la santé, comparut, le, 2 mai, devant une réunion-de soixante-quatre ecclésiastiques, pour entendre une seconde exhortation charitable. Maître Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux, était chargé de porter la parole et tenait en main le manuscrit de son discours. Avant d’en commencer la lecture, il requit l’accusée de consentir à s’amender, conformément aux décisions des savants :
— Lisez votre livre, — lui dit-elle, — et puis je vous répondrai. Je m’en attends de tout à Dieu, mon créateur. Je l’aime de tout mon cœur.
— Vous ne voulez donc plus rien répondre à cette monition générale ?
— Je m’en attends à mon juge ; c’est le Dieu du ciel et de la terre.
Il serait fastidieux d’analyser la harangue de l’archidiacre ; mais les interrogations et les réponses, dont elle fut entrecoupée, présentent un réel intérêt ; nous allons donner les principales.
— Vous avez dit autrefois que vos faits fussent examinés 245par, des clercs ?
— J’en réponds tout autant maintenant.
— Vous soumettez-vous à l’Église militante ?
— Je crois bien l’Église d’ici-bas ; mais, de mes faits et de mes dits, ainsi que je l’ai dit autrefois, je m’en attends et rapporte à Dieu. Je crois bien que l’Église militante ne peut errer ni faillir. Quant à mes dits et faits, je m’en rapporte à Dieu, qui me les a fait faire.
— Si vous ne voulez pas croire l’Église, vous serez punie de la peine du feu.
— Je ne vous en répondrai pas autre chose. Si je voyais le feu, je vous dirais tout ce que je vous dis et je n’en ferais pas autre chose.
— Voulez-vous vous soumettre à Notre Saint-Père le Pape ?
— Menez-moi vers lui et je lui répondrai.
L’archidiacre lui faisant un crime de n’avoir pas voulu prendre un habit de femme, pour être admise à la communion, elle répondit :
— Je veux bien prendre une robe longue et un chaperon de femme pour aller à l’église, pourvu qu’aussitôt après je puisse les quitter et reprendre l’habit que je porte. Quand j’aurai fait ce pourquoi je suis envoyée de Dieu, je prendrai habit de femme.
Elle manifeste ainsi clairement qu’elle ne regardait pas sa mission comme terminée.
— Maintenez-vous vos révélations ?
— Je m’en rapporte à mon juge, à Dieu. Mes révélations sont de Dieu.
— Quant au signe donné au roi, voulez-vous vous en rapporter à l’archevêque de Reims, à La Trémoille, à La Hire ?
— Baillez-moi un messager et je leur écrirai ce qu’il en est de tout ce procès. Autrement je ne m’en rapporterai pas à eux.
— Si vous ne vous soumettez pas à l’Église vous pourriez vous mettre en danger d’encourir les peines du feu éternel pour l’âme, et du feu temporel pour le corps.
— Vous ne ferez pas ce que vous dites là, contre moi, sans qu’il vous en prenne mal, pour l’âme et pour le corps.
§9. Jeanne en face de la torture
Le 9 mai, veille de l’Ascension, Jeanne fut conduite dans la grande tour, du château, pour y subir un nouvel assaut. Aux côtés des deux juges se tenaient 246une dizaine, d’assesseurs, et, tout près des instruments de torture, l’appariteur et son aide, chargés de les appliquer aux accusés dont on voulait obtenir des aveux.
Menacée d’être soumise à la torture, si elle refusait de dire la vérité et de révoquer ses contes mensongers, la sainte enfant répondit avec une noble assurance :
— En vérité, si vous deviez me disloquer les membres et faire partir l’âme du corps, je ne vous en dirais pas pour cela autre chose ; et, si je vous en disais quelque autre chose, après, je vous dirais toujours que vous me l’avez fait dire par force. À la dernière fête de la Sainte Croix, j’ai eu confort de saint Gabriel. J’ai demandé conseil à mes Voix pour savoir si je me soumettrais à l’Église. Elles m’ont dit que, si je voulais que Notre-Seigneur me soit en aide, je m’en attende à lui de tous mes faits. J’ai demandé à mes Voix si je serais brûlée. Elles m’ont répondu de m’en attendre à Notre-Seigneur et qu’il m’aidera.
— Pour le signe de l’a couronne, voulez-vous vous en rapporter à l’archevêque de Reims ?
— Faites-le venir et que je l’entende parler. Il n’oserait pas dire le contraire de ce que je vous ai dit.
En présence de cette indomptable fermeté, Cauchon ne crut pas devoir pousser les choses plus loin. Il ne fit pas appliquer la torture, sans doute parce qu’il vit bien qu’il n’obtiendrait pas ainsi la rétractation désirée.
§10. Troisième exhortation charitable
Cauchon convoqua les consulteurs, le 19 mai, dans la chapelle de l’archevêché, pour leur donner connaissance de la délibération de l’Université. Après lecture du document, il exigea que chacun d’eux émît son avis sur la suite à donner au procès. Tel était le prestige de l’Université que pas un des quarante-huit ecclésiastiques présents ne se permit de formuler le plus léger doute sur le bien fondé de son jugement. Mais la majorité fut d’avis que, avant d’en venir à la sentence définitive, il convenait d’avertir encore une fois charitablement l’accusée et de la mettre en demeure de se rétracter.
247Cette troisième exhortation charitable eut lieu quatre jours après (23 mai) dans une salle voisine de la prison. L’assistance était peu nombreuse mais distinguée ; les évêques de Thérouanne et de Noyon en faisaient partie. Maître Pierre Morice était chargé de porter la parole. Bien que délégué de l’Université, il ne semble pas avoir partagé les sentiments haineux de ses collègues ; en tout cas, son discours témoigne d’un intérêt, qui paraît sincère, en faveur de l’accusée. Peut-être, au fond du cœur, ne la jugeait-il pas coupable ; mais, en présence de la réprobation unanime de l’Université, il savait trop bien qu’elle était perdue, si elle persistait à ne pas vouloir se rétracter. C’est pourquoi il fit tous ses efforts pour l’amener à se soumettre.
— Jeanne, chère Jeanne, — dit-il en finissant, — c’est maintenant le moment, à la fin de votre procès, de bien peser ce qui a été dit. Vos juges, ici présents, désireux du salut de votre âme et de votre corps, ont soumis vos paroles à l’examen de l’Université de Paris, soleil de toutes les sciences, extirpatrice des erreurs. Ils ont reçu ses conclusions et ont ordonné de vous avertir de nouveau, vous priant, vous exhortant, par les entrailles de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de corriger vos assertions et de les soumettre au jugement de l’Église.
Oh ! Jeanne, réfléchissez : si, lorsque vous étiez dans les États de votre roi, un de ses chevaliers s’était avisé de dire :
Je n’obéirai ni au roi, ni à ses officiers, ne le condamneriez-vous pas ! Que direz-vous donc de vous-même, si vous n’obéissez pas aux officiers du Christ, à savoir, les prélats de l’Église ? Si vous persévérez dans vos errements, sachez que votre âme va au devant de la damnation éternelle et je crains la destruction de votre corps.
Jeanne répondit, sans se laisser émouvoir :
— Quant à mes faits et mes dits, que j’ai déclarés au procès, je m’y rapporte et veux les soutenir.
— Ne croyez-vous pas que vous êtes tenue de vous soumettre à l’Église ?
— Je veux maintenir la manière que j’ai toujours dite et tenue au procès, quant à cela. Si j’étais en 248jugement, si je voyais le bourreau prêt à bouter le feu, le feu allumé, les bourrées flamber, si j’étais dans le feu, je n’en dirais pas autre chose et, jusqu’à la mort, je soutiendrais ce que j’ai dit au procès.
Le désaveu, que Cauchon poursuivait avec tant d’âpreté et si peu de succès, lui échappait encore une fois ; il espérait peut-être être plus heureux le lendemain, dans la séance solennelle du jugement. Nous verrons, au chapitre suivant, comment et jusqu’à quel point son espérance se réalisa.
249Chapitre VI Dernières luttes
§1. Au cimetière de Saint-Ouen
Le vendredi, 24 mai, Jeanne fut conduite au cimetière Saint-Ouen, pour y entendre la lecture du jugement. Deux estrades étaient dressées ; les deux juges, le cardinal d’Angleterre, trois évêques et de nombreux ecclésiastiques prirent place sur la première ; la seconde était réservée à l’accusée, au prédicateur, Guillaume Érard, et aux officiers du tribunal.
Devant ces estrades se pressait une foule innombrable : badauds et curieux, en quête d’émotions ; bourgeois et artisans, restés Français de cœur, et faisant, en secret, des vœux pour l’héroïne ; Anglais, altérés de vengeance, impatients de voir brûler la sorcière, qui leur avait infligé tant de défaites.
Même diversité de sentiments parmi les ecclésiastiques : tous, il est vrai, désiraient que Jeanne se soumît, mais pour des motifs combien différents ! Parvenir à lui faire renier sa mission, c’était pour Cauchon et ses complices un triomphe personnel, la justification de leur indigne conduite ; pour le cardinal d’Angleterre et son gouvernement, un éclatant succès politique, à cause de la flétrissure qui en rejaillirait sur le roi de France. D’autres, au contraire, comme Pierre Morice et les dominicains, Isambart et Martin Ladvenu, que nous verrons bientôt unir leurs efforts pour amener la Pucelle à se rétracter, 250agissaient par un sentiment de compassion aveugle, mais sincère. Ils savaient qu’un refus allait infailliblement la conduire au bûcher. Pour lui faire éviter cet atroce supplice, ils sont disposés à lui conseiller la soumission, par bonté d’âme, sans se préoccuper des droits de la vérité.
§2. Sermon de Guillaume Érard
Un discours de maître Guillaume Érard ouvrit la séance. Il n’est pas reproduit dans l’instrument du procès, mais les témoins s’accordent à dire que c’était un misérable tissu d’injures contre le clergé français, qui avait examiné la Pucelle, et contre Charles VII, qui avait accepté ses services :
— Ô maison de France, — s’écria l’énergumène, dans un grand mouvement d’éloquence, — jusqu’à ce jour tu avais été exempte de tous les monstres de l’hérésie, et maintenant, en adhérant à cette femme, sorcière, hérétique, superstitieuse, tu t’es couverte d’infamie.
Après cette belle prosopopée, il se tourna vers l’accusée et l’apostropha en ces termes :
— C’est à toi, Jeanne, que je parle, et je te dis que ton roi est hérétique et schismatique.
Elle avait subi, sans rien dire, les injures qui s’adressaient à sa personne ; mais, quand elle entendit outrager son roi, elle n’y tint plus et lança à la face du prêcheur un solennel démenti :
— Par ma foi, révérence gardée, il n’est pas tel que vous dites ; car je vous ose bien dire que c’est le plus noble chrétien de tous les chrétiens, et qui aime mieux la foi et l’Église.
— Faites-la taire ! — s’écria Érard, en s’adressant à l’huissier, qui se tenait près d’elle.
Sa harangue terminée, il demanda à Jeanne si elle voulait soumettre à l’Église ses dits et faits, ajoutant que les clercs y avaient remarqué plusieurs choses, qui n’étaient pas bonnes à soutenir.
— Je vais, — dit-elle, — vous répondre. Pour ce qui est de ma soumission à l’Église, je leur ai dit, sur ce point :
Que toutes les œuvres, que j’ai faites, que tous mes dits soient envoyés à Rome, devers Notre Saint-Père le Pape, auquel et à Dieu premier je m’en rapporte.Les faits que j’ai faits, je les ai faits de par Dieu. De mes dits, de mes faits, je ne charge personne au monde, 251ni mon roi, ni tout autre. S’il y a quelque faute, c’est à moi et non à un autre qu’il faut l’attribuer.— Dans vos faits et dans vos dits, ce qui est condamné, voulez-vous le révoquer ?
— Je m’en rapporte à Dieu et à Notre Saint-Père le Pape.
— Cela ne suffit pas, — répliqua le prêcheur. — L’on ne peut aller quérir Notre Saint-Père si loin. Les Ordinaires sont juges aussi dans leurs diocèses. C’est pourquoi il faut que vous teniez ce que les clercs et gens qui s’y connaissent disent et ont déterminé de vos dits et faits.
Elle ne répondit pas ; même silence après une deuxième et une troisième admonition.
Remarquons que tout ce dialogue, y compris le nouvel appel au Pape, est consigné dans le procès-verbal officiel ; ce qui n’empêchera pas Cauchon d’insérer, dans les considérants de son jugement, cet impudent mensonge :
En termes exprès et à plusieurs reprises, tu as refusé de te soumettre à Notre Saint-Père le Pape.
§3. L’abjuration
En présence de cette inébranlable fermeté, il ne restait plus qu’à prononcer la sentence, qui allait livrer Jeanne au bras séculier, c’est-à-dire l’envoyer au bûcher. Cauchon en commença donc la lecture. Nous touchons ici au moment le plus sombre d’une vie où tout, jusque-là, a été rayonnement et splendeur.
1°. D’après le procès-verbal
À s’en rapporter au procès-verbal, Cauchon avait déjà lu la majeure partie de son écrit ; lorsque Jeanne
dit qu’elle voulait tenir ce que les juges voudraient dire et sentencier ; que, puisque les gens d’Église disaient que ses apparitions et révélations n’étaient point à soutenir, elle s’en rapportait entièrement aux juges et à notre Mère, la sainte Église. Alors aussi, en présence d’une grande multitude de clergé et de peuple, elle fit son abjuration, d’après une formule rédigée en français, qui lui fut lue en ce moment ; elle récita la formule et la signa de sa propre main.
C’est pourquoi, après avoir pris l’avis du cardinal d’Angleterre, qui lui dit de la recevoir à pénitence, le juge, laissant de 252côté la première sentence, en lut une autre, qu’il avait préparée d’avance ; la Pucelle y était relevée de ses censures, mais condamnée, en expiation de ses fautes, à la prison perpétuelle.
Tout homme de bonne foi, qui aura étudié sérieusement les pièces de l’abominable procès, se refusera à croire que la sainte victime de la haine anglaise ait ainsi, subitement, donné un démenti à toute sa vie et renié sa mission, quelques minutes seulement après l’avoir affirmée à nouveau, d’une manière si solennelle. Et cependant, d’autre part, on ne peut supposer le procès-verbal absolument faux ; car la scène s’était passée au grand jour, devant un public très nombreux. Il a donc dû y avoir, à défaut d’abjuration réelle, un semblant d’abjuration ou une sorte d’abjuration inconsciente, que le juge aura été trop heureux d’accepter comme valable, parce qu’elle servait ses desseins. Telle est la conclusion, à laquelle serait naturellement amené tout esprit judicieux, même en l’absence de preuves positives ; ce qui n’est pas le cas.
2°. D’après les témoins
Nous avons, en effet, pour réduire à leur juste valeur les assertions de la pièce officielle, les témoignages concordants des trois greffiers, de l’huissier et de plusieurs autres témoins dignes de foi. Voici maintenant, d’après leurs dépositions, reçues sous la foi du serment, comment les choses se passèrent : Guillaume Érard, voyant que son discours n’avait point produit l’effet désiré, redoubla d’instances pour amener Jeanne à abjurer.
— Abjurer ? — disait-elle, — je ne sais pas ce que c’est.
Massieu le lui expliqua.
— Nous avons grande compassion de vous, — reprenait le prêcheur ; — il faut que vous rétractiez ce que vous avez dit, ou que nous vous abandonnions à la justice séculière.
— Je n’ai rien fait de mal, — répondait la sainte enfant. — Je crois les douze articles du symbole et les dix commandements de Dieu. Je m’en rapporte à la Cour romaine et veux croire ce que croit la sainte Église.
On lui criait de divers côtés :
— Faites ce qu’on vous conseille ; 253voulez-vous donc vous faire mourir.
— Croyez-moi, Jeanne, — disait Loyseleur, — si vous le voulez, vous serez sauvée. Faites ce qu’on vous ordonne, sans quoi vous êtes en grand danger de mort. Si vous faites ce que je vous dis, vous serez remise à l’Église.
Assurément la perspective de se voir débarrassée de ses geôliers et confiée à la garde de femmes dans une prison ecclésiastique, était de nature à lui sourire. Néanmoins, elle résistait toujours.
— Vous vous donnez beaucoup de peine pour me séduire, — disait-elle.
Cependant Cauchon observait avec grand intérêt l’assaut qu’elle avait à soutenir, seule, contre la haine astucieuse des uns et la compassion mal inspirée des autres. Il ne se hâtait pas, de donner lecture de la sentence et, quand il s’y fut décidé, il eut soin de procéder avec une lenteur calculée. Avant d’arriver à la conclusion finale, il fit une pause, qui excita l’indignation des Anglais. Un clerc, de la suite du cardinal, le prit à partie, lui reprocha ce qu’il appelait sa partialité en faveur de Jeanne et le traita de traître :
— Vous en avez menti, — riposta le prélat, en jetant son papier par terre, — et je n’irai pas plus loin que vous ne m’ayez fait réparation.
Le cardinal dut s’interposer. La foule était en proie à une grande agitation et des pierres volèrent de divers côtés sur l’estrade des ecclésiastiques.
À la fin, de guerre lasse, Jeanne aurait dit à l’huissier, qui lui présentait la formule d’abjuration et l’engageait à la signer :
— Je m’en rapporte à l’Église universelle. Que l’Église et les clercs voient le papier. S’ils me disent que je dois le signer et faire ce que l’on me commande, je le ferai volontiers.
— Signe tout de suite, — dit Érard, — sans quoi tu vas finir aujourd’hui, tes jours par le feu.
Alors seulement elle comprit que ce n’était pas une vaine menace ; elle pouvait d’ailleurs apercevoir le bourreau qui se tenait sur la place avec sa charrette, attendant qu’on la lui livrât. Jusque-là elle ne s’était pas rendu compte de l’imminence du péril. Quand elle se vit ainsi brusquement placée en face du bûcher, sur le point d’être brûlée vive, une terreur 254incoercible s’empara de tout son être et brisa les ressorts de sa volonté. À la place de l’héroïne, qui, tout à l’heure encore, répondait si hardiment à ses juges, il n’y avait plus qu’une pauvre fille apeurée, qui balbutiait d’une voix lamentable :
— J’aime mieux signer que d’être brûlée.
§4. Abjuration dérisoire
Cauchon n’attendait que cette parole. Vite on se hâte de lui lire la formule d’abjuration, préparée d’avance, et elle, machinalement, sans avoir conscience de ce qu’elle fait, sans paraître attacher la moindre importance à ce qu’elle dit, répète, en riant, les mots que lui souffle l’huissier. Puis, en guise de signature, elle fait une croix au bas de la cédule. Celle-ci se composait de six à huit lignes de grosse écriture. On ignore quels en étaient les termes.
Je me rappelle bien, — dit Massieu, — que, dans cette cédule, il était spécifié qu’elle (Jeanne) ne porterait plus ni armes, ni habit d’homme, ni cheveux taillés et autres choses que j’ai oubliées. Je sais bien que cette cédule contenait huit lignes, pas davantage. Je sais, à n’en pas douter, que ce n’est pas celle qui est mentionnée au procès.
Celle que Cauchon jugea à propos de lui substituer est bien dix fois plus longue. Un secrétaire du roi d’Angleterre l’avait tirée de sa manche et présentée à Jeanne, avec une plume, pour la signer :
— Je ne sais ni lire ni écrire, — lui dit-elle.
Comme il insistait, elle y traça un rond, en se moquant. Il lui prit alors la main et lui fit faire on ne sait quel signe.
Toute cette mise en scène avait été évidemment machinée en vue d’arracher à la sainte enfant un acte qu’on pourrait, vaille que vaille, présenter comme un désaveu de sa mission. Affolée, hors d’elle-même, elle fit le geste imposé, sans en comprendre la portée, tellement la crainte avait paralysé ses facultés. Un tel acte est nul et sans aucune valeur. Du reste, les spectateurs ne s’y trompèrent pas ; il n’en manquait pas, rapporte un témoin, qui disaient que cette abjuration était une farce, une dérision.
Telle quelle, elle servait trop bien les desseins de Cauchon 257pour qu’il ne fût pas heureux de s’en contenter. Mais les soldats et les Anglais, qui n’étaient point dans les secrets du gouvernement, furent indignés de sa conduite. Warwick lui-même partageait ce sentiment :
— Les affaires du roi vont mal, — dit-il ; — cette fille nous échappe.
À quoi un des assesseurs répondit :
— Soyez tranquille, nous la rattraperons.
Jeanne, condamnée par un tribunal ecclésiastique, aurait dû être enfermée dans une prison d’Église et gardée par des femmes. On le lui avait d’ailleurs promis pour l’engager à se soumettre. Aussi, après le prononcé du jugement :
— Or ça, — dit-elle, — vous autres, gens d’Église, menez-moi en vos prisons, et que je ne sois plus entre les mains de ces Anglais.
Des assesseurs appuyaient cette trop juste réclamation. Cauchon n’en tint aucun compte :
— Conduisez-la, dit-il, où vous l’avez prise.
Le même jour, dans la soirée, le vice-inquisiteur se rendit à la prison pour exhorter la condamnée à se soumettre humblement à la sentence qui la frappait ; il lui enjoignit d’avoir à quitter ses vêtements d’homme, à se faire raser les cheveux, et l’avertit que l’Église l’abandonnerait sans retour, si elle retombait dans ses anciennes erreurs. La pauvrette, encore sous le coup des terribles émotions du matin, répondit qu’elle obéirait et prit l’habit de femme qu’on lui présenta.
§5. Journées d’angoisse
Le procès-verbal, d’où est extrait ce récit, fut rédigé après coup, en vue du procès de rechute. Il est donc suspect, à tout le moins incomplet ; car il n’est guère croyable que la victime n’ait pas, dans cette entrevue, protesté contre l’injustice qu’on lui faisait, en la privant du bénéfice d’une prison ecclésiastique. La sienne allait bientôt se transformer en un épouvantable enfer (25-27 mai).
Les démons anglais, auxquels Cauchon l’avait livrée, furieux de la voir échapper au bûcher, l’accablèrent de mauvais traitements et la prison devint, dans la journée du samedi, le théâtre d’horreurs que la plume se refuse à décrire. Le surlendemain, elle
disait publiquement, — rapporte Isambart, — que les Anglais 258lui avaient fait et fait faire, en la prison, beaucoup de tort et de violence, quand elle était revêtue d’habits de femme.
Le même témoin déclare l’avoir vue
éplorée, le visage plein de larmes, défiguré et outragé, [au point d’exciter] pitié et compassion.
Elle disait aussi que c’était la cause qui lui avait fait reprendre l’habit d’homme.
Elle le reprit, en effet, le dimanche matin, non toutefois de sa propre initiative, si nous en croyons l’huissier Massieu ; pendant qu’elle était couchée, les gardes auraient enlevé ses habits de femme et, mis à la place son ancien costume. Quoi qu’il en soit, il n’est pas douteux qu’elle le reprit avec joie, parce qu’il protégeait mieux sa pudeur.
Cauchon, informé du fait, chargea les greffiers et plusieurs assesseurs de se rendre à la prison, pour le constater officiellement.
Il est bon, — dit l’un d’eux, — de s’informer du motif qui lui a fait reprendre l’habit masculin.
C’était là précisément ce que les Anglais du château, coupables ou complices des attentats de la veille, avaient intérêt à cacher. C’est pourquoi, à peine entrés dans la cour, les envoyés de Cauchon se virent assaillis par une bande de forcenés, qui les accablèrent d’injures et de menaces, de sorte qu’ils s’enfuirent à toutes jambes sans avoir rempli leur mission.
§6. Procès de relapse
En reprenant l’habit viril, Jeanne devenait relapse ; de là le nouveau procès, qu’on instruisit dès le lendemain (lundi, 28 mai). Les deux juges vinrent à la prison, avec les greffiers et une dizaine d’assesseurs. Le greffier Manchon avait eu tellement peur, la veille, qu’il ne se décida à se rendre au château qu’accompagné par le comte de Warwick. Étant donné cet état d’esprit, on conçoit sans peine qu’il se soit gardé de rien enregistrer contre la volonté des maîtres de céans, et son procès-verbal s’en est naturellement ressenti.
— Pourquoi, — dit Cauchon à Jeanne, — et quand avez-vous repris l’habit d’homme ?
— Il n’y a pas longtemps que j’ai pris l’habit d’homme et laissé l’habit de femme. Je l’ai pris de ma 259volonté et sans nulle contrainte. J’aime mieux l’habit d’homme que l’habit de femme. Étant parmi des hommes, il m’était plus convenable de le reprendre. Je l’ai repris, parce qu’on n’a pas tenu ce qu’on m’avait promis, à savoir, que j’irais à la messe, que je recevrais mon Sauveur et qu’on me mettrait hors des fers.
La réponse a été certainement tronquée à dessein ; Manchon lui-même en convenait, lorsqu’il disait, au procès de réhabilitation :
Interrogée, en ma présence, pourquoi elle avait repris le vêtement viril, elle répondit que c’était pour la défense de sa pudeur ; qu’elle n’était pas en sûreté avec ses gardes, qui avaient voulu attenter à sa vertu.
Elle a dû aussi être falsifiée ; car, si l’on en croit l’huissier Massieu, Jeanne lui aurait dit que les gardes avaient enlevé les habits de femme et mis à la place son ancien costume. Elle n’a donc pas dit qu’elle l’avait repris sans nulle contrainte.
— N’aviez-vous pas juré de ne point reprendre cet habit ?
— Onques ne compris faire serment de ne le pas prendre. J’aime mieux mourir que d’être aux fers. Mais, si l’on veut m’ôter des fers, me laisser aller à la messe, me mettre en prison gracieuse, avec une femme avec moi, je serai bonne et ferai ce que l’Église voudra.
— Depuis jeudi, n’avez-vous pas entendu vos Voix ?
— Oui, je les ai entendues.
— Que vous ont-elles dit ?
— Ce qu’elles m’ont dit ? Dieu m’a mandé, par sainte Catherine et sainte Marguerite, la grande pitié de la trahison que j’ai consentie, en faisant l’abjuration et révocation, pour sauver ma vie. Avant jeudi ces Voix m’avaient dit ce que je ferais, ce que je fis ce jour-là. Sur l’échafaud, les Voix me dirent de répondre hardiment à ce prêcheur ; c’était un faux prêcheur, qui a dit plusieurs choses que je n’ai pas faites. Si je disais que Dieu ne m’a pas envoyée, je me damnerais ; car il est vrai que Dieu m’a envoyée. Mes Voix m’ont dit depuis que j’avais fait une grande mauvaiseté en faisant ce que j’ai fait, en confessant que je n’avais pas, bien fait. C’est par peur du feu que j’ai dit ce que j’ai dit.
— Croyez-vous que vos Voix soient sainte Catherine et sainte 260Marguerite ?
— Oui, je le crois, et qu’elles viennent de la part de Dieu.
— Et la couronne ?
— Je vous en ai dit la vérité au procès, le mieux que j’ai pu.
— Sur l’échafaud vous avez confessé avoir menti, en disant que c’étaient sainte Catherine et sainte Marguerite qui vous parlaient.
— Je n’ai point entendu révoquer mes apparitions, à savoir que ce fussent sainte Catherine et sainte Marguerite. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait par peur du feu, et je n’ai rien révoqué que ce ne fût contre la vérité. J’aime mieux faire ma peine en une lois, à savoir, mourir, que d’endurer plus longue peine en prison. Je ne fis jamais chose contre Dieu et contre la foi, quelque chose qu’on m’ait fait révoquer. Ce qui était en la cédule d’abjuration, je ne l’entendais pas. Au moment où je faisais la révocation, je n’entendais point révoquer quelque chose que ce fût, si ce n’était à condition que cela plût à Notre-Seigneur. Si les juges le veulent, je reprendrai l’habit de femme ; pour tout le reste, je ne ferai rien autre chose.
Ainsi, après avoir écouté humblement les reproches de ses Voix, Jeanne s’était complètement ressaisie. Jamais peut-être elle ne se montra plus sublime que dans cette scène émouvante, où elle jouait sa vie avec une si héroïque simplicité, en affirmant à nouveau, devant ses juges, la mission qu’ils tenaient tant à lui faire renier.
Le dénouement du drame ne pouvait plus tarder. Au sortir de la prison, Cauchon, rencontrant le comte de Warwick, se hâta de l’en informer, en lui disant, d’un air joyeux :
— Farewell, farewell ; c’est fait ; nous la tenons.
Le lendemain, 29 mai, les juges et quarante et un assesseurs se réunirent dans la chapelle de l’archevêché pour entendre la lecture du procès-verbal, et décider de la suite à donner au procès de relapse. L’abbé de Fécamp émit l’avis qu’
il serait bon de lire à Jeanne de nouveau la formule d’abjuration et de lui en exposer le sens.
Trente-huit assesseurs opinèrent de même. Cauchon jugea qu’il était plus prudent de s’en tenir là. Les juges la condamnèrent donc, séance tenante, comme relapse, 261et déclarèrent qu’il fallait l’abandonner à la justice séculière, en priant toutefois celle-ci de modérer ses rigueurs.
§7. Jeanne à son dernier jour
1° Dans la prison
Le lendemain, 30 mai, au matin, les dominicains, Isambart de la Pierre et Martin Ladvenu, arrivèrent de bonne heure à la prison. Ils étaient envoyés par les juges, avec la mission de préparer Jeanne à la mort. L’annonce du terrible supplice, qu’elle allait subir dans quelques heures, la fit tout d’abord frémir. En pouvait-il être autrement ? Elle n’avait pas encore vingt ans ! et il semble bien que, jusque-là, elle n’avait pas perdu tout espoir de délivrance :
— Hélas ! — s’écriait-elle en sanglotant, — me traite-t-on ainsi horriblement et cruellement qu’il faille que mon corps, net en entier, qui ne fut jamais corrompu, soit aujourd’hui consumé et réduit en cendres. Ha ! ha ! j’aimerais mieux être décapitée sept fois que d’être ainsi brûlée ! Hélas ! si j’eusse été en la prison ecclésiastique, à laquelle je m’étais soumise, et que j’eusse été gardée par des gens d’Église et non par mes ennemis, il ne me fût pas si misérablement arrivé malheur. Oh ! j’en appelle, devant Dieu, des grands torts et ingravances que l’on me fait.
Pendant qu’elle exhalait ces plaintes, des assesseurs, des religieux avaient pénétré dans la prison. Lorsque la première émotion fut un peu calmée, elle s’entretint quelques instants avec eux ; s’adressant à Pierre Morice, qui lui avait témoigné de l’intérêt :
— Maître Pierre, — lui dit-elle, où serai-je ce soir ?
— N’avez,vous pas bonne espérance dans le Seigneur ? — répondit-il.
— Oui, avec la grâce de Dieu, je serai en paradis.
Cauchon vint aussi ; quand elle l’aperçut :
— Évêque, — s’écria-t-elle, — je meurs par vous !
— Ah ! Jeanne, — répliqua-t-il, — prenez votre sort en patience ; vous mourez, parce que vous n’avez pas tenu ce que vous aviez promis et que vous êtes retournée à votre, premier maléfice.
— Hélas ! — ajouta-t-elle, — si vous m’eussiez mise aux prisons de cour d’Église, entre les mains de concierges ecclésiastiques convenables, cela ne fût pas arrivé. C’est pourquoi j’en appelle de vous, devant Dieu.
Les visiteurs s’étant retirés, Martin Ladvenu, qui l’avait 262déjà confessée avant leur arrivée, l’entendit de nouveau. La confession finie, elle le supplia de lui donner la sainte communion, dont elle était privée depuis si longtemps. Le cas était embarrassant et le religieux n’osa pas prendre sur lui d’accorder cette demande. Il en référa donc à l’évêque de Beauvais. Celui-ci, mû sans doute par un sentiment tardif de pitié pour sa victime, que, mieux que personne, il savait innocente, permit qu’on lui donnât l’Eucharistie et tout ce qu’elle demanderait. Ainsi il lui accordait la communion, au moment même où il se disposait à la déclarer hérétique et excommuniée ! Étrange contradiction !
La crainte de froisser les Anglais était si grande que la sainte hostie fut d’abord apportée furtivement, dans un corporal, par un prêtre sans étole et sans surplis. Indigné d’une telle irrévérence, Frère Martin renvoya le prêtre, fit allumer des cierges et organisa une procession pour escorter le Saint Sacrement. En défilant, on récitait les litanies, et, à chaque invocation, les assistants répondaient : Priez pour elle. Jeanne reçut le corps de Notre-Seigneur dans les sentiments de la foi la plus vive et de la piété la plus ardente, en versant des larmes abondantes.
2° Sur la place du Vieux-Marché
Avant de la conduire au lieu du supplice, on lui fit revêtir une robe longue et un chaperon de femme. La charrette du bourreau l’attendait dans la cour. Elle venait d’y monter, lorsqu’on vit un ecclésiastique s’en approcher et s’y cramponner, les yeux baignés de larmes, le geste suppliant. C’était le traître Loyseleur, qui, touché de remords, implorait son pardon. À cette vue, les soldats, massés dans la cour, se jetèrent sur lui ; ils allaient le massacrer, si Warwick ne l’eût soustrait à leur fureur, en le faisant promptement disparaître. Il s’éloigna aussitôt de Rouen, où sa vie n’eût pas été en sûreté.
Durant le trajet, Jeanne prie et pleure ; de temps en temps, un cri de douleur résignée s’échappe de ses lèvres :
— Rouen, Rouen, est-ce donc ici que je dois mourir ?
263Il était environ neuf heures lorsque le lugubre cortège arriva sur la place du Vieux-Marché, où se pressait une foule énorme, dix mille personnes, dit-on. Quatre échafauds y étaient dressés ; sur l’un, à côté des juges, prirent place le cardinal d’Angleterre, l’évêque de Thérouanne, chancelier de la France anglaise, les évêques de Noyon et de Norwich, avec de nombreux ecclésiastiques ; Jeanne monta sur un autre, avec le prédicateur, l’huissier et ses deux consolateurs, Isambart de la Pierre et Martin Ladvenu. Le troisième était occupé par les représentants de la justice séculière, qui avaient seuls le droit de prononcer l’arrêt de mort : le bailli de Rouen, Raoul Bouteiller, son lieutenant et ses agents y étaient installés. Le quatrième était le bûcher, formé d’un socle en maçonnerie, d’une hauteur inusitée ; un amas de bourrées s’élevait par-dessus, dominé par le poteau, auquel on allait attacher la condamnée. À côté, se dressait un autre poteau, portant une pancarte, sur laquelle on lisait une inscription, en gros caractères :
Jeanne, qui s’est fait nommer la Pucelle, menteresse, pernicieuse, abuseresse du peuple, devineresse, superstitieuse, blasphématrice de Dieu, présomptueuse, mal créante de la foi de Jésus-Christ, vanteresse, idolâtre, cruelle, dissolue, invocatresse des diables, apostate, schismatique et hérétique.
Le dernier acte de la sinistre tragédie s’ouvrit par un sermon de Nicolas Midi, l’un des maîtres de l’Université de Paris ; il le termina par ces mots :
— Jeanne, va en paix ; l’Église ne peut plus te défendre.
Cauchon prit ensuite la parole ; après avoir brièvement résumé la cause et exposé, à sa façon, les prétendus crimes de sa victime, il donna lecture de la sentence qui la déclarait relapse et hérétique. En conséquence, il l’abandonnait au bras séculier, non sans recommander au bailli d’épargner à la condamnée la mort et la mutilation. Le bûcher, qu’il avait sous les yeux, disait assez le compte qu’on allait tenir de cette formule dérisoire.
La sainte enfant avait écouté le sermon et la sentence dans 264une attitude calme et résignée. Ensuite, à genoux et les yeux baignés de larmes, elle exhala, à haute voix, les pieux sentiments dont son cœur était rempli, invoquant tour à tour Notre-Seigneur, la Sainte Vierge, les saints et saintes du ciel, avec des accents capables d’émouvoir des cœurs de pierre. À part un petit nombre d’Anglais, qui affectaient de ricaner, tous les assistants pleuraient à chaudes larmes, même le cardinal d’Angleterre, même Cauchon ! L’évêque de Thérouanne dira plus tard n’avoir pas tant pleuré à la mort de son père et de sa mère. Le greffier Manchon déclare avoir été plus d’un mois sous le coup des émotions qu’il avait éprouvées en ce moment.
Cependant la martyre n’était pas tellement absorbée dans sa préparation à une mort imminente, qu’elle ne se rendît compte du discrédit que cette mort ignominieuse risquait de jeter sur la cause, qu’elle avait si glorieusement servie et pour laquelle elle mourait. C’est pourquoi, s’oubliant elle-même, dans un sublime élan de générosité patriotique, pour dégager la responsabilité de Charles VII, elle interrompit sa prière et renouvela, devant l’immense, assemblée, la déclaration qu’elle avait déjà faite, en présence de ses juges :
— Quoi qu’on pense de mes œuvres, en bien ou en mal, mon roi ne m’a pas engagée à les faire.
Touchant témoignage de son dévouement envers un prince oublieux de ses services.
Ce pieux devoir rempli, elle s’adressa aux prêtres qui étaient là, les suppliant de lui dire chacun une messe.
Puis elle demanda pardon très humblement à tous les assistants, de quelque condition qu’ils fussent, tant de son parti que de l’autre, leur pardonnant elle-même le mal qu’ils lui avaient fait.
Sa prière s’était prolongée une demi-heure environ.
Cependant les Anglais commençaient à s’impatienter ; des capitaines criaient à l’huissier :
— Eh bien ! prêtre, allez-vous nous faire dîner ici ?
Elle-même, voyant bien, sans doute, qu’il fallait en finir, demanda une croix ; un Anglais lui en fit une avec deux brins de bois.
Elle la baisa et la mit dans son 265sein avec la plus grande dévotion. Elle témoigna cependant le désir d’avoir la croix de l’église ; Frère Isambart se hâta d’aller la chercher. Elle la pressa sur son cœur, la couvrit de ses baisers et de ses larmes, se recommandant à Dieu, à saint Michel, à sainte Catherine, à tous les saints. À la fin elle baisa la croix de nouveau, salua l’assistance et descendit de l’ambon. (Jean Massieu.)
À ce moment les ecclésiastiques se retirèrent, à l’exception des deux dominicains, chargés de l’assister jusqu’à son trépas.
Le bailli, auquel Cauchon l’avait livrée, ne prit pas même la peine de prononcer l’arrêt de mort :
— Emmène-la, — dit-il au bourreau, — et fais ton devoir.
Quand elle fut hissée sur le bûcher et attachée au poteau, on lui mit sur la tête une sorte de mitre, avec cette inscription : Hérétique, relapse, apostate, idolâtre. Puis, Martin Ladvenu approcha la croix de ses lèvres et elle y déposa un dernier baiser. Lorsqu’elle vit le bourreau mettre le feu, elle fit écarter ce bon religieux, mais le pria de tenir la croix devant elle, afin que, jusqu’à la fin, elle pût arrêter ses regards sur l’image du Sauveur, mourant pour nous. En même temps, pendant que la flamme montait, elle continuait ses pieuses supplications, répétant sans cesse le nom de Jésus. Ce fut le dernier mot qui sortit de sa bouche :
— Jésus, Jésus !
s’écria-t-elle, une dernière fois, d’une voix si forte que ce cri fut entendu de toute l’assistance. L’instant d’après elle expirait.
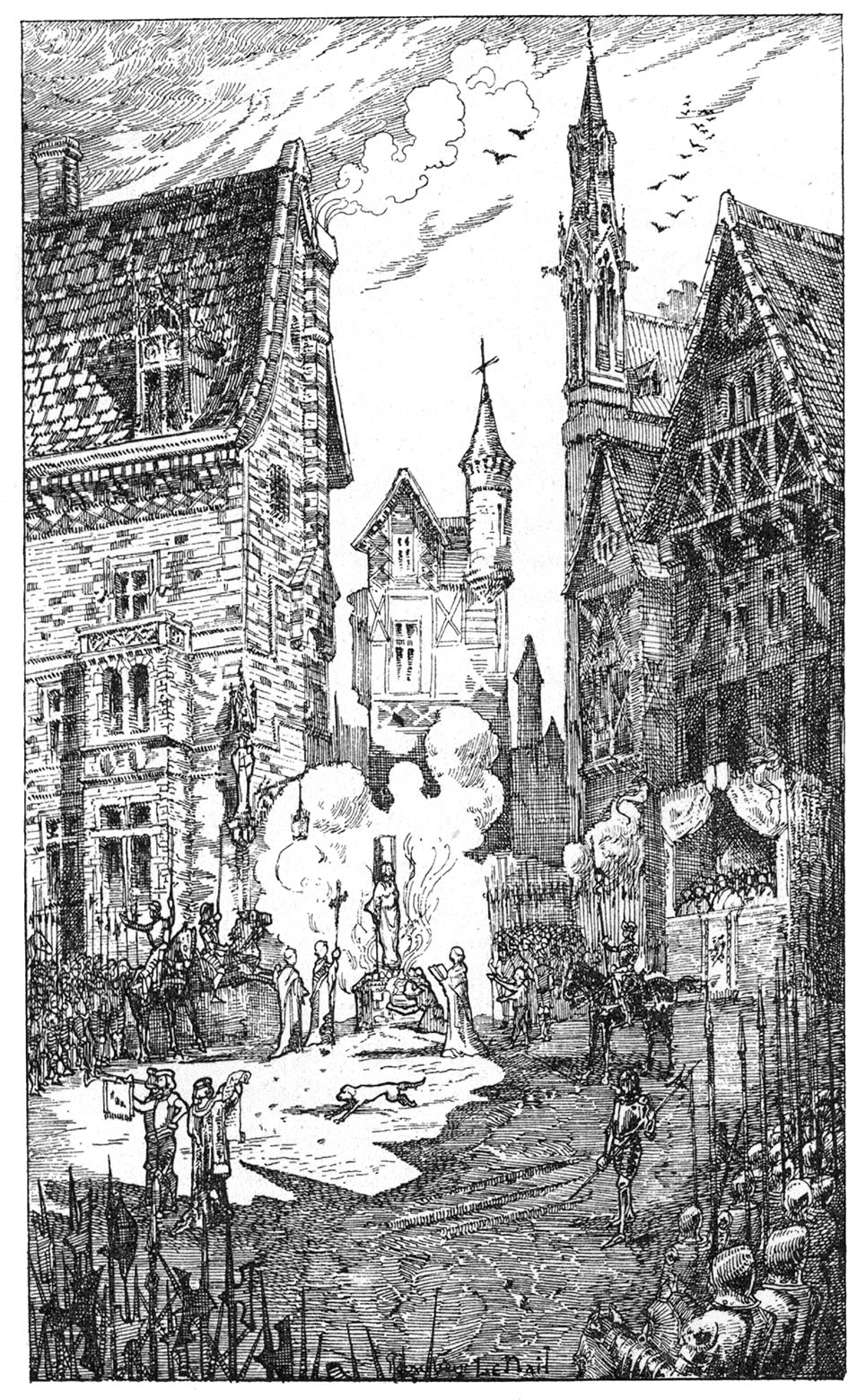
Le bourreau écarta alors la flamme, afin que tout le monde pût voir le corps pantelant. Puis, pendant que le feu achevait son œuvre, la foule se retira lentement, en proie à une poignante émotion. Quelques-uns disaient avoir vu le nom de Jésus, écrit sur les flammes. Un soldat anglais, animé d’une haine féroce, avait juré de jeter, de sa propre main, un fagot au bûcher. Il le fit ; mais on le vit, peu après, chanceler et tomber évanoui. Revenu à lui, il raconta qu’en entendant le dernier cri de la suppliciée, il avait vu une blanche colombe s’envoler du milieu 266des flammes et il ne doutait pas que ce fût l’âme de l’innocente victime. Un secrétaire du roi d’Angleterre, Jean Tressart, revenant de la place du Vieux-Marché, la tête basse et le front soucieux, se laissa aller à dire :
— Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte ; ceux qui ont approuvé sa condamnation sont damnés.
Sur l’ordre du cardinal d’Angleterre, le bourreau mit dans un sac ce qui restait du corps de la suppliciée et jeta le tout à la Seine. Le soir, il se présenta au couvent des dominicains dans un état d’agitation extrême, en proie à une sorte de désespoir. Il craignait, dit-il aux Frères Isambart et Martin Ladvenu, de ne pouvoir jamais obtenir de Dieu pardon
de ce qu’il avait fait à cette sainte femme. Il disait et affirmait que, nonobstant l’huile, le soufre et le charbon, qu’il avait appliqués contre les entrailles et le cœur de Jeanne, il n’avait jamais pu les réduire en cendres. De quoi il était autant étonné, comme d’un miracle tout évident.
Ainsi mourut, le 30 mai 1431, dans la vingtième année de son âge, Jeanne la Pucelle, suscitée de Dieu, pour chasser l’Anglais envahisseur et rendre la France à son roi légitime.
Sainte Catherine et sainte Marguerite lui avaient maintes fois prédit qu’elle serait délivrée à grande victoire. La prophétie venait de s’accomplir, mais d’une manière bien différente de celle qu’avait rêvée l’intrépide guerrière. Cette mort, si pieusement résignée, qui a arraché des larmes à ses pires ennemis et entouré son front d’une auréole de sainteté, aux yeux de ceux qui en furent témoins, n’est-ce pas une grande victoire, la plus glorieuse qu’elle ait jamais remportée ?
Des écrivains catholiques et de nombreux panégyristes laissent entendre qu’elle eut l’intelligence de ce mystère, avant d’expirer ; car ils lui font jeter, du milieu des flammes, ce cri de triomphe :
— Non, mes Voix ne m’ont pas trompée.
Affirmation absolument gratuite ; pas un seul témoin ne mentionne ce fait.
267Tout porte à croire, au contraire, que Jeanne, sur le bûcher, eût pu adresser à ses Voix la plainte que Jésus, en croix, fit monter vers son père : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’avez-vous délaissé ? Si elle n’eut point, dans cette lutte suprême, la consolation de les voir et de les entendre, Dieu, qui la soutenait intérieurement de sa grâce, voulait sans doute rendre, par cet abandon, son sacrifice plus complet et plus méritoire. Les saintes lui avaient promis, simplement, absolument et sans faillir, de la mener en paradis. Lorsque, le martyre étant consommé, elles y auront introduit son âme, alors, mais alors seulement elle aura compris.
Notes
- [19]
Voici la traduction de ces oraisons :
Collecte. — Dieu tout-puissant et éternel, qui, dans votre sainte et ineffable miséricorde et dans votre admirable puissance, avez ordonné à la Pucelle de venir relever et sauver le royaume de France, repousser, confondre et détruire ses ennemis, et qui avez permis que, alors qu’elle vaquait aux œuvres saintes, commandées par vous, elle soit tombée entre les mains et dans les fers de ces mêmes ennemis, nous vous en supplions, par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, accordez-nous qu’elle soit délivrée de leur puissance et qu’elle accomplisse à la lettre ce que vous lui avez prescrit par un seul et même acte.
Secrète. — Père des vertus et Dieu tout-puissant, que votre sainte bénédiction descende sur cette oblation et que, par sa puissance miraculeuse, avec l’intercession de la Vierge Marie et de tous les Saints, elle garde de mal et délivre la Pucelle, retenue dans les prisons de nos ennemis, qu’elle lui accorde d’accomplir sa mission, jusqu’au bout, selon ce que vous lui avez commandé.
Postcommunion. — Dieu tout-puissant, exaucez les prières de votre peuple et, par les sacrements, que nous venons de recevoir, avec l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les Saints, brisez les fers de la Pucelle, qui, accomplissant les œuvres, que vous lui aviez commandées, est maintenant incarcérée par nos ennemis ; accordez-lui, au nom de votre très sainte bonté et miséricorde, de sortir saine et sauve, pour accomplir ce qui reste de sa mission.
- [20]
Il serait fastidieux de citer tous les faits de ce genre, rapportés par des témoins dignes de foi. En voici un, d’un caractère particulièrement odieux, que nous croyons pas devoir passer sous silence.
Privée des sacrements, qui avaient été jusque-là l’aliment de sa vie spirituelle et son grand réconfort, la sainte enfant aspirait de toute son âme vers le Dieu de l’Eucharistie. Elle demanda donc un jour à l’huissier, qui la menait à l’audience, s’il n’y avait pas, sur le trajet, quelque chapelle où l’on gardait le corps de Notre-Seigneur. Massieu lui en indiqua une et lui permit de s’arrêter quelques instants à la porte pour prier. Cet acte de complaisance lui valut de vifs reproches :
Truand, lui dit le promoteur, qui te rend si hardi de laisser approcher cette excommuniée ? Si tu recommences, je te ferai mettre dans une tour où tu ne verras ni lune ni soleil d’ici à un mois.
Cauchon l’avertit aussi de prendre garde à lui, ou qu’on le ferait boire plus que de raison.