Dossier : Documentation : 1873
1873 Lia Félix à la Gaîté.
Le Figaro, 10 décembre 1872
Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével : Offenbach acquiert la Gaîté.
Lien : Gallica
Nous avons annoncé que M. Boulet venait de céder son théâtre. Nous apprenons à l’instant, par une indiscrétion, que c’est à Jacques Offenbach.
Nous sommes heureux d’enregistrer cette nouvelle, persuadé que l’art aura une large part dans cette exploitation. Il paraîtrait que, tout en continuant à jouer le drame, mais le drame à grand spectacle, Offenbach a l’intention de réserver un rôle important à la musique.
C’est une bonne nouvelle pour les compositeurs. Qui sait, si le vrai Théâtre-Lyrique ne sortira pas de là ?
Le Ménestrel, 16 février 1873
Les abonnés à la musique de chant reçoivent avec le présent numéro la nouvelle mélodie de Ferdinand Gumbert, les Fleurs insouciantes, paroles de Jules Barbier.
Lien : Gallica
Le Figaro, 24 février 1873
Article signé un sténographe
, qui rend compte de l’assemblée de la Société des auteurs, réunie à l’instigation d’Offenbach. Celui-ci, qui compte prendre la direction du théâtre de la Gaîté, souhaite que soit levée l’interdiction à un directeur de théâtre de faire jouer ses propres œuvres.
Lien : Gallica
Séance extraordinaire des membres de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Le 22 février 1873. Présidence de M. Alexandre Dumas fils.
La question Offenbach
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques a voulu, pour une fois, faire concurrence à MM. les représentants de l’Assemblée nationale. Vu l’accord survenu entre M. Thiers et la commission des Trente, elle a pensé que les séances du théâtre de Versailles promettant d’être plus calmes, le public aurait besoin d’une séance orageuse dans un théâtre quelconque, et elle a choisi le théâtre des Variétés.
C’est là qu’hier, à une heure, se réunissaient grands et petits auteurs, convoqués afin de discuter une grave question la question Offenbach.
Je n’ai pas à entrer dans le vif de la discussion ni à me prononcer pour ou contre. Ma mission est beaucoup moins compliquée. Elle consiste en une espèce de compte rendu, pour sténographie conforme, d’autant plus impartial que celui qui écrit ces lignes est absolument désintéressé dans les affaires de la Société.
Donc, à une heure précise les représentants de la littérature dramatique française et ceux de la musique commençaient à faire leur entrée au foyer des Variétés.
Dans le couloir du second étage, à là porté du foyer, les employés de M. Peragallo font signer une feuille de présence à tous ceux qui entrent.
Cette formalité aurait pu se prolonger pendant plusieurs heures si l’Assemblée des auteurs ne comptait pas, comme l’Assemblée de Versailles, de très nombreux absents par congé ou pour toute autre cause. Car — je ne m’en serais jamais douté — il n’y a pas moins de huit-cents noms inscrits sur les registres de la Société. Et dire que les théâtres manquent de pièces !
Les deux questeurs, MM. Peragallo et Roger, qui sont les deux Bases de cette Assemblée, vont et viennent, distribuant des poignées de main aux gros bonnets, des sourires aux moyens et des signes protecteurs aux petits.
À côté du comptoir où, le soir, se débitent les carafons de sirops et les boîtes de caramels, est installé le bureau recouvert du tapis vert de rigueur, de la sonnette indispensable et de tout ce qu’il faut pour faire des verres d’eau sucrée.
Les banquettes habillées de velours rouge à franges d’or — comme pour les distributions de prix — sont réservées à MM. les membres.
Au bureau : M. Dumas, président ; M. Auguste Maquet, vice-président ; MM. Ludovic Halévy et Émile de Najac, secrétaires ; puis, tous les membres de la commission.
À la gauche du bureau, adossé contre la cheminée, la jambe étendue sur une banquette, disparaissant à moitié sous un vaste manteau de fourrures, celui qui a provoqué ces graves débats : Jacques Offenbach, encore souffrant de son dernier accès de goutte.
Dans la salle, sur les banquettes rouges, les groupes se sont formés peu à peu. Ne pouvant nommer tout le monde, je crois pourtant devoir noter les.chefs de parti des diverses nuances de l’Assemblée.
- Extrême droite : Mario Uchard, Armand Durantin, Jules Barbier, Nuitter, Tréfeu, Cogniard, Marot, Déjazet, Émile Jonas.
- Droite : Meilhac, Paccini, Philippe Gille, Debillemont, Siraudin, Clairville.
- Centre droit : Victorien Sardou, Eugène Labiche, Albert Wolff, Jules Prével, Édouard Cadol, Alfred Duru, William Busnach, Émile Abraham, et le doyen des auteurs dramatiques Dupin, l’un des collaborateurs les plus assidus de Scribe.
- Centre gauche : Eugène Grangé, Jules Guillemot, Delacour, Paul Boisselot, Charles Bridault.
- Gauche : Raymond Deslandes, Joncières, Léon Beauvallet, Brésil, Gonzalès, Lefebvre.
- Gauche radicale : Victor Koning, Henri Becque, Touroude, les frères Clerc, Lajarte, Amable Bapaume.
Derrière ces têtes de colonnes du parti anti-offenbachien grouille une quantité innombrable de fruits secs dramatiques, jeunes incompris qui ont ruiné plusieurs directeurs du théâtre Molière, vieillards à barbe grise qui ont eu, dans leur extrême jeunesse, une pièce sifflée au théâtre Montmartre, et qui, tous, sont absolument persuadés que les deux-cents représentations de la Timbale d’argent leur ont causé le plus grave préjudice.
Comme toujours, le grand parti des conservateurs a fait preuve de la même indifférence coupable. De très hauts personnages dramatiques ont profité de la séance des Variétés pour aller faire un tour au bois.
À une heure et demie, le président agite sa sonnette.
La séance est ouverte.
Discours de M. Alexandre Dumas
L’auteur de la Dame aux camélias s’exprime avec une grande facilité et ses improvisations sont fort spirituelles en même temps que fort correctes. En parlant, il me rappelle beaucoup son père, l’un des plus charmants causeurs qui aient jamais existé. Il a son aisance, et il commence avoir son embonpoint.
Voici le résumé de son allocution :
Messieurs, vous savez tous pourquoi nous sommes réunis. Il s’agit de discuter amicalement une question fort simple en réalité, mais qui est assez compliquée si on en croit les bruits du dehors. Je fais appel ici à toute votre bonne confraternité.
En notre qualité d’auteurs dramatiques, nous savons tous qu’une exposition pour être bonne doit être courte. Nous ne devons apporter ici ni parti-pris, ni arrière-pensée il ne s’agit pas, Dieu merci ! d’une thèse ou d’une conférence. (Rires.)
Voici le fait un de nos confrères qu’il est à peine utile de nommer, tout le monde le connaît, M. Offenbach, désire devenir directeur de la Gaîté. Dans les traités que nous signons d’habitude avec les théâtres, il y a une clause qui le gênait. (Ah ! Ah ! à l’extrême gauche) : c’est celle qui interdit aux directeurs de jouer leurs propres pièces sur leurs théâtres. Il est venu franchement et loyalement à nous, nous demander, un traité particulier. M. Offenbach nous demande de jouer chaque année une pièce nouvelle de lui. En outre, en prenant la direction de la Gaîté, M. Offenbach trouve dans la succession de M. Boulet deux ouvrages déjà reçus.
Ces pièces se trouvent être de… (Cherchant.) M. Jacques Offenbach. (Hilarité générale.) Or M. Offenbach est un homme d’honneur qui tiendrait à exécuter tous les engagements de son prédécesseur et je dois le dire, ce scrupule nous a touchés. (Rires.) Dame ! messieurs, c’est qu’on ne voit pas tous les jours un directeur exécuter aussi scrupuleusement les engagements de son prédécesseur. Donc voici ce que M. Offenbach nous demande la faculté, pendant les trois premières années de sa direction, de jouer, par an, une pièce nouvelle de lui plus les deux, qu’il est nécessairement forcé de représenter par suite des engagements pris par M. Boulet ; plus deux reprises à son choix parmi les pièces de son répertoire. (À l’extrême gauche : Toujours, alors !) Mais remarquez que M. Offenbach nous demande cette faculté sans avoir l’intention absolue d’en profiter, les joies du directeur pouvant lui faire oublier les intérêts de l’auteur dramatique. La démarche si franche de M. Offenbach nous est un sûr garant de ses loyales intentions. Il n’a pas voulu recourir à un expédient et se cacher sous le couvert d’un directeur fictif. J’espère, messieurs, que chacun de vous lui tiendra compte de cette façon d’agir. Du reste, avant de terminer, je tiens à vous dire que M. Offenbach veut faire de la Gaîté un théâtre éclectique, un théâtre universel, une grande chose enfin où l’on jouerait à la fois l’opéra, le drame, l’opéra-bouffe et la féerie. Quand un homme de cette valeur veut tenter une si belle entreprise, n’est-il pas de notre devoir de l’encourager ? (Applaudissements sur un grand nombre de bancs.)
À M. Alexandre Dumas succède M. Raymond Deslandes, un orateur de la gauche. M. Deslandes, souriant, tout de noir habillé, tire de sa poche un papier dont le seul aspect cause dans la salle un frisson de terreur.
M. Raymond Deslandes
L’orateur commence par supplier M. Offenbach de ne pas croire à une hostilité systématique de sa part. Il ne vise pas le directeur de la Gaîté personnellement, mais tous les directeurs en général.
Cette façon de dorer la pilule ne donne le change à personne. À droite, on se tient sur la réserve et à gauche on se prépare à applaudir.
M. Deslandes continue ainsi :
Quant à moi, je trouve qu’il y aurait un grand danger à autoriser un directeur à jouer ses propres pièces. Il me paraît évident que ce directeur ne prendrait pas soin des pièces de ses confrères comme des siennes. Il les jouerait par hasard, l’été, pendant la canicule, se réservant pour lui les grasses recettes de l’hiver, les meilleures distributions et toutes les splendeurs de la mise en scène. Voyez ce qui s’est passé aux Bouffes. M. Noriac a accroché la Timbale d’argent sur l’affiche de son théâtre pour ne la faire décrocher que sept mois après par les mains augustes de la Petite Reine ; cela sous le régime actuel, par suite de la faiblesse de la commission. Que se passerait-il donc si l’on décrétait la liberté ? Nous verrions pousser les directeurs-auteurs comme des champignons. (Marques d’approbation à gauche et à l’extrême gauche.) Le premier cuistre venu pourra ouvrir boutique avec des collaborateurs aussi anonymes que mal rétribués. Pour les auteurs arrivés, je sais bien que le danger sera moins grand, mais il me paraît fort inquiétant pour l’auteur qui lutte et qui travaille, tombant aujourd’hui pour se relever demain.
M. Touroude. — Bravo !
M. Deslandes. — Ici se place une objection assez spécieuse au premier abord. Mais alors, dira-t-on, Molière et Beaumarchais, s’ils vivaient, ne pourraient donc pas faire jouer leurs pièces sur des théâtres à eux ? Tant de chefs-d’œuvre se trouveraient donc perdus ? Qu’on me permette de faire observer que Molière et Beaumarchais verraient les directeurs sonner à leurs portes, tout aussi bien que M. Offenbach, et n’auraient pas besoin de se faire entrepreneurs de spectacles. J’admets pourtant, car il ne faut pas être absolu, que, dans certains cas, un directeur puisse être autorisé à faire représenter une de ses œuvres — mais exceptionnellement et à titre de faveur spéciale.
À ces mots, un monsieur que personne ne semble connaître se dresse sur sa banquette et demande la parole. À force d’investigations, j’apprends que cet auteur dramatique ( ?) se nomme M. Amable Bapaume ( ?).
M. Bapaume. — Pourquoi une pièce au lieu de trois pièces ? Pas d’exceptions ! Pas de pièces du tout ou toutes les pièces. Tout où rien !
Cette foudroyante improvisation excite les bravos frénétiques de l’extrême gauche.
À l’orateur enfiévré du radicalisme, succède l’éloquence froide et à lunettes de M. Armand Durantin.
M. Armand Durantin. — L’honorable M. Deslandes a parlé de la faiblesse de la Commission, qu’il a accusée d’avoir violé les statuts. Les statuts n’interdisent pas la chose. C’est vers 1843 qu’on introduisit cette restriction dans les traités signés avec les directeurs. La commission avait donc le pouvoir d’autoriser MM. Noriac et Offenbach. (Bruyantes interruptions à gauche. Cris : Ce n’était pas la peine de nous déranger, alors !) Quand on a fait les traités, les privilèges existaient. Maintenant qu’ils sont abolis, nous devons aussi abolir la servitude.
M. Touroude. — Alors, à bas le progrès ! (Nouveau tumulte.)
M. Dumas (sonnant). — Drelin ! drelin !
M. Durantin. — Je disais donc que… pardon… messieurs, vous m’excuserez. Je ne suis pas habitué à la parole. Vous m’avez fait perdre le fil… Ah !… j’y suis… (Rires et applaudissements.)
L’orateur conclut en disant que, selon lui, la Société n’avait aucun intérêt à refuser à M. Offenbach l’autorisation demandée. Tout le monde sait fort bien que les traités sont souvent éludés. Puisque l’on triche, autant tricher au grand jour.
À ces mots l’orateur est littéralement chuté par l’opposition. (Cris : À l’ordre ! Mais c’est la dissolution que vous demandez !)
Le pauvre M. Durantin se rassied en regrettant les beaux jours d’Héloïse Paranquet.
La question s’embrouille. Rien n’annonce qu’on en doive sortir.
Heureusement, un homme pratique se lève. C’est M. Eugène Labiche.
M. Eugène Labiche
Allant droit au but, l’auteur du Voyage de monsieur Perrichon demande qu’au lieu de s’occuper du cas particulier de M. Offenbach, on provoque une nouvelle assemblée générale qui se prononcerait une fois pour toutes sur la liberté des transactions. D’après ce que déciderait l’assemblée, l’autorisation de jouer leurs pièces serait accordée à tous les directeurs ou à aucun.
La gauche se lève comme un seul homme et déclare qu’elle veut voter tout de suite sur la dernière partie de la proposition Labiche.
À droite. — Non ! non !
Le président. — M. Labiche a touché le point juste. Là est la solution. Il faut que la question soit généralisée ! Mais je ne puis consentir à un vote immédiat. Une nouvelle réunion est nécessaire pour cette nouvelle proposition. (Cris : aux voix ! aux voix !)
M. Offenbach. — Je demande la parole !
M. Jacques Offenbach
Le maestro se lève difficilement et s’appuie, pour parler, sur l’épaule de son féal Nuitter :
Il est un point, messieurs, dit-il, dont il n’a pas été question jusqu’à présent et dont je tiens à vous parler. Il y a plus de dix-huit ans que je fais du théâtre. Pendant ces dix-huit ans, j’ai produit plus de quatre-vingts pièces dont quelques-unes, je puis le dire, ont eu un certain succès.
Une voix à droite. — Un très grand succès.
M. Offenbach. — Je vous remercie. (Rires.) Or depuis que nous sommes réunis on ne s’entretient que de ma personne ; je vous l’abandonne bien volontiers. Mais avec moi, il y a mes collaborateurs qui sont extrêmement nombreux et dont beaucoup sont présents ici. Songez qu’en m’empêchant de jouer mes pièces vous m’empêcheriez aussi de jouer les leurs. Parce que je serais directeur de la Gaîté, serait-il juste que les intérêts de mes collaborateurs en souffrent ? (Marques nombreuses d’approbations à droite et aux centres. Protestations à gauche.)
Du reste, vous déciderez ; mais je tiens à vous dire encore que j’ai jusqu’au mois d’avril pour rendre définitif mon traité avec M. Boulet et que, si vous m’empêchez de jouer mon répertoire, vous me mettez dans l’impossibilité de prendre la Gaîté et vous briserez ma carrière de… directeur. (Rires et applaudissements.)
M. Touroude. — Qu’est-ce que cela nous fait !
On donne tour à tour la parole à M. Raymond Deslandes — pour la deuxième fois ; à M. Touroude lui-même qui lance quelques phrases incisives et creuses ; le tout entrecoupé d’interruptions, de bruit et de cacophonie que la sonnette présidentielle est impuissante à conjurer. Pendant une accalmie, un monsieur, qu’on n’entend pas, dit, d’une petite voix, des choses qu’on ne comprend pas pour qu’on vote tout de suite sur la question générale. Puis à ce monsieur succède :
M. Émile Jonas
Grand, sec et triste. Si triste même que lorsqu’il assiste à un enterrement, tout le monde vient lui serrer la main, le prenant pour un parent du défunt.
M. Jonas prononce, d’une voix qui a l’air de sortir de la baleine, une lamentation qui se résume ainsi :
— Messieurs, pensez aux musiciens. (Un sanglot). Que vont devenir les musiciens ? Je suis un musicien et je viens parler au nom des musiciens. (Autre sanglot.) Si M. Offenbach ne prend pas la Gaîté, on n’y fera pas de musique, et si l’on n’y fait pas de musique, que deviendront les musiciens ? Votez donc pour M. Offenbach et pour les musiciens (Les larmes empêchent l’orateur de continuer son discours.)
Tout l’auditoire est vivement ému. Par bonheur, M. Paccini se lève et déclare solennellement qu’il est du devoir de l’Assemblée de décider qu’elle ne décidera rien.
Un rire homérique accueille cette proposition.
Le reste de la séance se compose de cris confus, de conversations animées, de poings agités, les uns voulant qu’on vote tout de suite sur le cas particulier de M. Offenbach, les autres demandant le renvoi à une autre assemblée pour la question de principe.
Enfin, on vote.
La dernière proposition est accueillie à l’unanimité moins deux voix.
M. Touroude (en se levant). — Vous verrez qu’on finira par enterrer la question !
M. Jonas (revenant à lui). — Un enterrement… j’en suis !
Le Figaro, 3 mars 1873
Article signé un sténographe
, qui rend compte de la seconde assemblée de la Société des auteurs sur la question des directeurs/auteurs.
Lien : Gallica
Deuxième assemblée de la Société des auteurs. Présidence de M. Dumas fils. 1er mars 1873. — La question des Directeurs-Auteurs.
Les grandes questions soumises aux Assemblées délibérantes ne peuvent pas être tranchées en une seule séance. Si elles l’étaient, elles cesseraient immédiatement, aux yeux du public, d’être de grandes questions. L’Assemblée de Versailles n’a pas voté en une seule fois le projet de la commission des Trente. On ne pouvait donc pas demander à l’Assemblée des auteurs d’examiner en une seule séance les réformes constitutionnelles qu’on lui propose.
La seconde réunion, annoncée par moi il y a huit jours, a eu lieu hier, — mais non plus aux Variétés.
Est-ce que M. Bertrand aurait refusé de mettre le foyer de son théâtre à la disposition de la Société ?
Cela n’est pas impossible ; car si le directeur des Variétés n’a pu refuser son local pour une réunion où il s’agissait de discuter sur une faveur sollicitée par M. Offenbach, — les recettes des Braconniers sont si belles ! — il aurait été au contraire médiocrement flatté de voir sa maison servir à la confirmation d’une mesure hostile à MM. les directeurs.
La commission, qui veille avec une sollicitude toute paternelle sur les discussions des auteurs et compositeurs, a donc dû chercher ailleurs un endroit de réunion. Elle a évidemment compté sur l’influence musicale de la salle Herz pour adoucir les côtés irritants de la question.
Dès une heure les honorables membres commencent à faire leur entrée. Ils ont à traverser, pour arriver à la salle de séance, deux grands salons encombrés de pianos et d’orgues. Comme il est à peu près impossible de trouver son chemin au milieu de ce dédale d’instruments, M. Peragallo y a posté son fidèle caissier, M. Maréchal, pour servir de guide.
Le bureau est installé sur l’estrade réservée d’habitude aux virtuoses des concerts.
Dans la salle, je cite au hasard MM. Théodore Barrière, Jules Barbier, Chivot, Duru, Lecoq, Claretie, Philippe Gille, Cogniard, Gonzalès, Lauzanne, Dupin, Wolff, Jonas, Paccini, Debillemont, Bedeau, Bouvier, Boisselot, Busnach, Paul Ferrier, Marot, Laurent de Rillé, Durantin, Nuitter, Tréfeu, Beaumont, Costé, Richard, Cadol, Bocage, Adolphe Belot, Jules Guillemot, Legouix, Siraudin, Charles Deslys, Jules Moineaux, Robillard, Choler.
M. de Saint-Georges produit un véritable effet d’entrée, grâce à son paletot couleur de chocolat à la crème.
La séance est ouverte à deux heures moins vingt.
M. le président Dumas. — Messieurs, vous savez tous pourquoi nous sommes réunis. Nous avons à décider la question suivante :
MM. les directeurs auront-ils le droit de laisser jouer sur leurs théâtres des ouvrages dramatiques ou lyriques composés soit par eux, soit par leurs associés, soit par les employés salariés ou gratuits de leurs administrations, et, réciproquement, les auteurs on compositeurs auront-il la liberté de travailler en collaboration avec le directeur d’un théâtre quelconque, ses associés ou employés !
Voulez-vous avant de commencer la discussion me permettre de vous exposer rapidement les conditions dans lesquelles a été fondée notre Société ?
Cris. — Oui ! Oui !
M. le président. — Notre Société a été fondée dès le principe pour nous protéger contre les directeurs. Auparavant, il était de tradition en France qu’un directeur jouait ses propres pièces. Molière, dont il a été question dans la dernière séance, était directeur. Il usait largement de cette faculté et même disons-le il en a abusé. Ainsi il lui est arrivé d’arrêter souvent des pièces en plein succès pour y substituer les siennes. C’est ainsi qu’il a fait disparaître de l’affiche une comédie de Montfleury, le — nous sommes entre hommes — le Cocu imaginaire, qui faisait 1800 francs de recettes, pour le remplacer par le Misanthrope, qui n’en faisait que 300.
Voix. — Il a eu raison !
Autres voix. — Il a ou tort !
M. le président. — Au point de vue de la postérité, il a eu raison ; mais à celui d’une Société des auteurs, il aurait eu tort. D’ailleurs, tous les directeurs ne sont pas des Molière. (Rires.) Les auteurs se sont donc réunis pour régler leurs droits vis-à-vis d’eux. À cette époque, il y avait encore des privilèges. La Société était loin d’être toute puissante, et il fallait en appeler à l’administration pour obtenir qu’on interdit aux directeurs de jouer leurs pièce. Et les plus grands amis de la liberté, je vous citerai M. Victor Hugo lui-même (mouvement), s’employaient activement pour demander au ministre cette interdiction salutaire. Depuis on a proclamé la liberté des théâtres.
Une voix. — Malheureusement !
M. le président. — Mais la liberté des théâtres ne peut modifier en rien les intérêts de notre Société. Elle implique seulement, pour les directeurs, la faculté de jouer librement tous les genres et de fonder des théâtres nouveaux. Libre à eux de vivre en dehors de notre association, et alors de jouer leurs pièces si bon leur semble.
Nous venons donc, après cet exposé peut-être insuffisant (protestations flatteuses), vous prier de passer le plus promptement possible à la discussion, d’autant plus que j’ai à vous faire part d’un petit détail qui a bien son importance.
On vient de me prévenir qu’à cinq heures et demie précises, on aura besoin de la salle pour l’installation d’un concert.
(Rires sur tous les bancs. — Le président s’assoit au milieu d’applaudissements unanimes.)
Ici, après quelques paroles sans importance de M. Desforges, un vaudevilliste à cheveux blancs demande la parole. C’est M. Lauzanne, le collaborateur de Duvert, l’auteur de tous les rôles à succès d’Arnal, celui qui disait de Scribe : Ce petit jeune homme fera quelque chose.
M. Lauzanne. — Je demanderai à M. le président de vouloir bien retracer l’état misérable dans lequel se trouvaient les auteurs avant la fondation de la Société.
M. le président. — Je ferai observer à M. Lauzanne que tel n’est pas précisément le but de cette réunion. D’ailleurs, il y a parmi nous des hommes qui retraceraient mieux que moi…
Une voix. — Eh bien ! ne retraçons pas.
(Ici, on entend dans une pièce à côté les sons mélodieux d’un piano qu’on essaie.)
M. Jules Barbier, se levant à droite. — Messieurs…
M. Cogniard, se levant à gauche. — Messieurs…
Tous les deux, parlant en même temps. — Je prends la parole pour… (Les deux orateurs se, regardent surpris.)
M. Barbier. — Parlez M. Cogniard.
M. Cogniard. — Après vous. je n’en ferai rien.
M. Barbier. — Je vous en prie.
M. Cogniard se décide à parler. Après avoir fait l’éloge de la commission, il demande à savoir quel est l’avis de la commission sur la question en litige.
M. le président. — Nous avons un avis certainement, mais c’est pour entendre le vôtre que nous sommes ici.
Voix nombreuses. — L’avis ! l’avis !
M. Siraudin. — La bourse… ou l’avis !
M. le président. — Eh bien ! messieurs, puisque vous le désirez, je vous dirai qu’à l’unanimité, la commission est d’accord pour prononcer l’interdiction. (Mouvement prolongé.)
M. Barbier. — La réponse de la commission me coupe absolument la parole. J’étais d’une opinion diamétralement opposée, mais maintenant, il me paraît inutile de parler.
Voix nombreuses. — Si ! si !… Parlez !
M. Barbier. — Non, je ne parlerai pas.
M. Barbier se rasseoit. M. Durantin se lève et essuie ses lunettes. L’auteur d’Héloïse Paranquet est un ancien avoué, aussi porte-t-il sous le bras un volumineux dossier qui trahit les plus mauvaises intentions.
Il comprend les scrupules de M. Barbier, mais il ne les partage pas, et il parle, il parle pour arriver à cette conclusion que l’interdiction absolue ne peut que développer la fraude. (Protestations énergiques.)
M. Durantin s’affaisse en lançant, cette exclamation dramatique :
— Excommuniez-moi !
Pendant tout le discours de M. Durantin, M. Jules Barbier semble en proie à un violent combat intérieur.
— Au fait, se dit-il, Durantin parle ; pourquoi ne parlerais-je pas ? Si je parlais ?
Quelques voisins. — Mais oui, parler donc.
M. Jules Barbier. — Messieurs, je me décide à parler ! M. Durantin, nous a proposé de faire, pendant deux ou trois ans, l’essai de la liberté.
Une voix. — C’est ça !… L’essai loyal !
M. Barbier. — Je crois que tout essai de ce genre est impossible. Aussi n’est-ce pas une mesure que je vous proposerai. Je demande la liberté absolue, M. Offenbach, par exemple…
M. Offenbach, l’interrompant. — Pardon, il n’est plus question de moi. Aujourd’hui, je ne suis qu’un membre de la Société prenant part à la discussion, et ma personne n’est pas en jeu.
M. le président. — Je demande à placer un mot à propos de l’expérience que demandait tout à l’heure M. Durantin. Cette expérience a été faite il y a longtemps déjà, et voici ce qu’elle adonné : Feu Ancelot, en 54 jours, dans un théâtre à lui, s’est joué 215 fois ! (Rires et exclamations.) Il est vrai que la mode était alors aux spectacles coupés.
Après cette observation du président M. Cogniard fait la proposition suivante :
— Les directeurs auront le droit de jouer une pièce d’eux chaque année.
Comme une proposition en appelle une autre, M. Crémieux fit l’amendement suivant :
— Les directeurs pourront jouer leurs pièces, mais elles seront frappées d’un droit fixe de 4%, par exemple, au profit de la Société.
À la proposition Crémieux succède la proposition Gourdon de Genouillac :
— Les directeurs pourront jouer leurs pièces, mais toute la part des droits d’auteur leur revenant sera versée dans la caisse sociale. (Interruptions.)
M. de Billemont. — Qu’est-ce que ça nous fait la caisse sociale ? Elle ne sert qu’à nous enterrer. En attendant, il faut vivre !
Un nouvel orateur élargit la proposition Gourdon de Genouillac :
— Les directeurs, dit-il, pourront jouer leurs pièces à la condition de verser dans la caisse sociale, non-seulement leur part de droits, mais aussi celle de leurs collaborateurs.
Enfin, un dernier amendement plus féroce que les autres surgit :
— Les directeurs de théâtre, s’ils ont des filles, ne pourront, sous aucun prétexte, les donner en mariage à des auteurs dramatiques !
Ici, M. Bapaume, dit l’Amable, ( ?) essaie de placer son discours. Des huées unanimes le contraignent difficilement au silence.
Il est avantageusement remplacé par M. Alphonse Pagès, qui ramène tout le monde à la question par ces sages paroles :
— Messieurs, je vous rappellerai qu’il y a un concert à cinq heures et demie.
Tout le monde. — C’est vrai. La clôture ! la clôture !
À peine la clôture est-elle votée, que. M. Paccini, qui n’a encore rien dit, se lève :
— Je demanda la parole contre la clôture. (Éclat de rire général.)
Dans une pièce voisine, on entend le son mélodieux d’un orgue.
Il s’agit de se dépêcher de voter ; mais ce n’est pas facile. Une interminable discussion s’établit pour savoir si dans le vote on donnera la priorité aux amendements ou à la question telle qu’elle a été posée dans la lettre de convocation. On ne s’entend plus, l’agitation est à son comble, tout le monde parle à la fois. Cela dure un bon quart d’heure. La voix plaintive de M. Jonas se mêle à la sonnette du président, et M. Barbier, qui ne voulait pas parler au commencement, ne peut plus se décider à se taire à la fin. Ce qui provoqué cette exclamation :
— Ce Barbier, il n’a pas volé son nom !
On se décide pourtant à voter sur la question posée par la commission.
Le vote a lieu par assis et levé, mais comme M. Dumas n’a pas, comme M. Grévy, l’habitude de juger un vote d’après les mains qui sont en l’air, il dépêche dans la salle M. Peragallo chargé de compter les bras levés. Il est expressément interdit de baisser la main avant le passage de M. Peragallo. Il en est résulté pour plusieurs membres placés au dernier rang une courbature qui dure encore.
M. Peragallo a fini par compter : — 109 bras pour l’interdiction et 22 bras contre.
Par conséquent, MM. les directeurs ne sont pas autorisés à jouer leurs pièces.
M. Offenbach n’a pas pris part au vote.
Quand ce résultat est proclamé, les discussions recommencent de plus belle.
— C’est bien fait !
— C’est inique !
— À la bonne heure !
— C’est grotesque !
À ce moment, un petit homme d’aspect modeste veut entrer dans la salle, malgré l’opposition des employés.
— Mais laissez-moi donc, s’écrie-t-il, on a besoin de moi, je suis l’accordeur !
Il venait pour le concert ; il aurait bien dû venir aussi pour la séance.
Un sténographe.
Le Ménestrel, 30 mars 1873
Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.
Lien : Gallica
En ce moment on répète activement à l’Athénée, troisième théâtre-lyrique provisoire, deux nouveaux opéras-comiques destinés à succéder sur l’affiche à la Dot mal placée, quand cet opéra-bouffe aura terminé sa carrière exhilarante.
Le premier, la Guzla, est, pour les paroles, de M. Jules Barbier, et, pour la musique de M. Théodore Dubois, le second, Ninon et Ninette, a pour librettiste M. Fernand Langlé et pour compositeur M. Pénavaire. Ce sont là deux jeunes musiciens des plus distingués anciens prix de Rome, sur lesquels on est en droit de fonder des espérances.
Le Figaro, 8 avril 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Gustave Lafargue.
Lien : Gallica (réception de la Jeanne d’Arc de Barbier)
Voici une nouvelle artistique intéressante et dont nous pouvons garantir l’exactitude et les détails.
M. Offenbach vient de recevoir, pour être joué l’hiver prochain au théâtre de la Gaîté un grand drame en vers de M. Jules Barbier, Jeanne d’Arc.
M. Barbier, dont l’œuvre comporte une partie musicale extrêmement importante, aura pour collaborateur Charles Gounod. On voit que notre grand musicien, exilé volontairement de son pays depuis quelque temps, ne l’a cependant point oublié, puisqu’il veut y faire sa rentrée par une œuvre éminemment nationale.
Voici la nomenclature des morceaux de musique qui composent la nouvelle partition de l’auteur de Faust :
- Douze chœurs.
- Deux marches : la Marche du Sacre et une Marche funèbre.
- Deux ballades.
- Une chanson.
- Un divertissement.
D’après ce programme, on voit que Jeanne d’Arc sera presque un opéra.
Le Ménestrel, 13 avril 1873
Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.
Lien : Gallica
Enfin, Offenbach a déjà pris possession du cabinet directorial à la Gaîté et des projets grandioses pleuvent de tous côtés.
C’est d’abord la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier, qui comporte une partie musicale extrêmement importante dont Charles Gounod se serait chargé.
La nouvelle partition de l’auteur de Faust comporterait :
- Douze chœurs.
- Deux marches : la Marche du Sacre et une Marche funèbre.
- Deux ballades.
- Une chanson.
- Un divertissement.
D’après ce programme, on voit que Jeanne d’Arc est presque un opéra. Elle serait jouée dans le courant d’octobre prochain ; vers la même époque la Jeanne d’Arc de M. Mermet verra le jour à l’Académie nationale. Il y aura là une sorte de joute, bien faite pour passionner la République artistique.
Offenbach a encore en vue la représentation d’un autre grand drame en vers de M. Coppée : Duguesclin, également avec musique.
Voilà une voie sérieuse dans laquelle il est bien bizarre de voir s’engager le grand maître de la Bouffonnerie, mais nous lui devons assurément tous nos encouragements.
Le Figaro, 23 avril 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével.
Lien : Gallica
La musique, dans la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier, à la Gaîté, ne se bornera pas à un rôle purement symphonique.
D’après le XIXe Siècle, le chœur y interviendra, avec ses coryphées, au commencement et à la fin de chaque acte, comme dans la tragédie antique.
On signale déjà, parmi les morceaux destinés à produire une grande sensation, le chœur des paysans fuyant devant l’invasion, la scène des voix, le cri de guerre des chevaliers, la ronde des ribaudes, le Veni Creator, la marche du Sacre, l’Orate pro ea qui accompagne la marche funèbre et le morceau d’ensemble qui termine la pièce, et qui exigera, dit-on, l’emploi de grandes masses chorales.
En dehors de ces morceaux, il y a une ballade, un duetto, un divertissement, des intermèdes, etc… Enfin, ce sera une vraie, grande et belle partition.
M. Gounod est enthousiasmé de son sujet si enthousiasmé, d’après ce qu’il écrit à M. Offenbach. que ce dernier compte sur un nouveau chef-d’œuvre de l’auteur de Roméo et Juliette.
Le directeur de la Gaîté prépare à MM. Barbier et Gounod une splendide exécution de leur œuvre, qui sera représentée, selon toutes prévisions, vers la fin de l’année.
Le Figaro, 3 mai 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével : engagement de Lia Félix.
Lien : Gallica
Offenbach vient d’engager mademoiselle Lia Félix pour créer le rôle de Jeanne dans la Jeanne d’Arc, de MM. Jules Barbier et Charles Gounod.
Jeanne d’Arc après Jane ! Elle est donc vouée aux Jeanne et aux Jane à perpétuité ?
À ce propos, quelle singulière manie que celle d’écrire, comme l’ont fait M. Touroude, pour son drame de la Renaissance, et M. Coppée pour son Petit marquis, Jane au lieu de Jeanne !… Est-ce que, dans les Ouvriers et dans l’Acrobate, pour ne citer que deux exemples récents, MM. Eugène Manuel et Octave Feuillet n’ont pas écrit Jeanne comme tout le monde ?
C’est mademoiselle Jane Essler qui a mis cette orthographe à la mode. Elle est bien, coupable.
Le Bien Public, 10 mai 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Émile Abraham.
Lien : Retronews
Mlle Lia Félix vient de signer un engagement des plus avantageux avec M. Offenbach, le nouveau directeur de la Gaîté.
C’est cette excellente artiste qui remplira le rôle de Jeanne d’Arc dans le drame de Jules Barbier, qu’on promet pour le 1er novembre.
Le Figaro, 17 mai 1873
Extrait de la Soirée théâtrale, par un monsieur de l’orchestre
.
Lien : Gallica
Les Hanlon à la Gaîté. — On parlait encore hier soir de la charmante matinée enfantine donnée hier, à la Gaîté, par M. Jacques Offenbach. Les frères Hanlon, les clowns étourdissants des Folies-Bergère, ont joué une de leurs pantomimes les plus désopilantes devant un public, surtout composé d’enfants, depuis le bébé emmailloté au sein de sa nourrice jusqu’au petit collégien venant d’étrenner son uniforme. Jamais la salle de la Gaîté n’a offert un coup d’œil plus gai ni plus gracieux, il y avait là un nombre respectable de célébrités parisiennes, représentées par leurs enfants.
Ludovic Halévy et toute sa petite famille, madame Bertail et ses trois petites filles jumelles, trois blondes adorables de sept ans qui ont eu un vrai succès ; la famille Offenbach — quatre filles et un fils, — Gaston Mitchell et son fils, Comte et ses deux fils, Pierre Wolff, neveu d’Albert, Ernest Daudet et ses deux enfants, les deux petits-enfants de Victor Hugo, madame R. Faivre et son fils, Calzado et ses deux enfants, les enfants de M. Peragallo, le fils du sculpteur Franceschi, Tourette et ses deux filles, Lépine et ses trois enfants, madame Gonzalès et ses deux charmantes jeunes filles, ne plus confondre avec les bébés, M. Nuitter et son fils, l’archiviste de l’Opéra ; puis le comte d’Osmond, le comte et la comtesse de Grandval, Mario Uchard, la famille Jules Barbier, et en fait d’artistes mesdames Heilbron, Thérésa et Damain.
Les frères Hanlon, excités par les rires si francs de leur jeune auditoire, ont été plus étonnants que jamais. On s’est amusé depuis le lever du rideau jusqu’au moment fatal où de toutes les petites bouches s’est échappée la même exclamation pleine de regrets : C’est déjà fini !
Pauvres chers bébés ! Ils ne savent pas encore que rien ne finit plus vite que le plaisir.
Le Ménestrel, 8 juin 1873
Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.
Lien : Gallica
Cette semaine, le magicien Offenbach est entré définitivement en possession de la Gaîté. Voici la composition exacte de sa magnifique troupe :
MM. Lafontaine, Clément Just, Desrieux, William Stuart, Angelo, Alexandre, Laurent, Gravier, Antonin, Montaubry, Falchieri, Habay, Bonnet, Grivot, Daubray, Courcelle, Jean-Paul, Damourette, Mallet, etc., etc.
Mmes Victoria Lafontaine, Marie Laurent, Laurence Grivot, Marie Brindeau, Marie Vannoy, Laurence Gérard, Aimée Tessandier, Pauline Lyon, Mariani, Davenay, Mette, Sylvana, Heilbron, A. Dartaux, Théo, Perret, Durand, E. Gilbert, Angèle, Castello, Albouy, Julia H., M. Bourgeois, M. Godin, Th. Guiotti.
Artistes en représentation : M. Lesueur, Mlle Lia Félix.
Ballet : Premières et deuxièmes danseuses : Mlles Fontébello. Ad. Compayre, L. Vernet, Pelletier, A. del Pozzo, Mézamat, Solari, M. Cardès.
L’ouverture de la Gaîté nouvelle aura lieu le 16 août, par le Dernier Gascon, grand drame en cinq actes, de MM. Théodore Barrière et Poupart-Davyl.
Viendront successivement : Jeanne d’Arc, de Jules Barbier et Charles Gounod ; Orphée aux Enfers, de H. Crémieux, L. Halévy et J. Offenbach.
Extrait des Nouvelles diverses.
Charles Gounod est vivement sollicité de se rendre à Vienne, pour y diriger des concerts dans le genre de ceux qu’il a fondés à Londres et qui y produisent si grande sensation. Mais, avant de prendre un engagement absolu avec Vienne, Gounod veut avoir terminé à Londres les derniers morceaux de la Jeanne d’Arc de Jules Barbier, pour Paris.
Le Ménestrel, 22 juin 1873
Les Compositeurs-chefs d’orchestre, lettre 1/4 de Charles Gounod.
Lien : Gallica
La question que j’aborde soulèvera, je n’en doute pas, de nombreuses objections et de violentes oppositions. C’est ce qui arrive toutes les fois qu’on s’attaque à un usage invétéré, à des opinions reçues et d’autant plus difficiles à déraciner que le sol sur lequel elles reposent est la routine, ce vaste et fatal domaine de l’insaisissable, ce statu quo dont toute la force est dans l’inertie, qui échappe à la discussion faute d’armes logiques, et dont le règne se perpétue et s’appesantit de toute l’insouciance avec laquelle on le supporte et de toute la nonchalance qu’on met à l’attaquer.
Partout ailleurs qu’en France, les compositeurs de musique ont l’occasion et la faculté de diriger, soit au théâtre, soit dans de grands concerts, l’exécution publique de leurs œuvres. En Italie, en Allemagne, cela s’est pratiqué de temps immémorial ; et non-seulement on y a reconnu aux auteurs ce droit incontestable et le plus naturel du monde, mais on leur en a spontanément offert l’exercice. D’où vient donc qu’on le leur refuse en France, et quelles raisons donne-t-on de ce refus ?
On allègue que cette prétention du compositeur est une atteinte aux droits et à la dignité du chef d’orchestre, et compromet son autorité. On ajoute que nombre de compositeurs sont incapables de diriger un orchestre ou l’exécution d’une œuvre dramatique. Enfin, et pour trancher la question ce n’est pas l’usage !
Ainsi : 1° Les droits, la dignité, l’autorité du chef d’orchestre. 2° L’incapacité des compositeurs. 3° L’usage.
Voyons un peu la valeur de toutes ces raisons. Et d’abord, les droits du chef d’orchestre.
En vertu de quelles lois ou de quels principes, les droits d’un chef d’orchestre excluent-ils le droit qu’a le compositeur de diriger son ouvrage ? Le chef d’orchestre se considère-t-il comme indépendant du compositeur ? N’est-il pas, avant tout, l’interprète, le mandataire d’une pensée qui n’est pas la sienne, et dès lors, son premier devoir n’est-il pas de se pénétrer de cette pensée d’une manière aussi complète, aussi parfaite que possible, et de n’être que la reproduction fidèle des intentions de l’auteur ?
On n’imagine pas à quel point une dérogation, légère en apparence, aux conditions de mouvement, d’accent, de nuances, telles que l’auteur les a conçues et voulues, peut altérer sa pensée et lui enlever son expression et sa couleur jusqu’à la rendre parfois méconnaissable ! J’ai vu Richard Wagner se débattant comme un lion furieux dans la loge du Directeur de l’Opéra pendant la représentation du Tannhäuser à Paris, et prêt, à tout moment, à sauter sur la scène et à escalader l’orchestre pour arracher le bâton des mains du chef qui dirigeait l’œuvre tout au rebours des intentions du compositeur. On ne sait pas que le chef d’orchestre est le principal interprète d’une œuvre musicale, et que mieux vaut mille fois une troupe ordinaire avec un excellent chef d’orchestre, qu’un régiment d’étoiles avec un chef d’orchestre inférieur.
J’en appelle ici aux chefs d’orchestre eux-mêmes, et je les fais juges de la question. Y en a-t-il un, un seul, parmi eux, qui, s’il était l’auteur d’une œuvre dramatique quelconque, en confierait volontairement et volontiers la direction à d’autres mains que les siennes ? Pas un.
Et c’est tout simple.
Il y a, dans une œuvre musicale (surtout dans une œuvre dramatique), une infinité de détails, d’intentions, de nuances, de touches instantanées, fugitives, mobiles comme des jeux de physionomie, indispensables à la vie musicale et scénique, dont il est impossible de fixer la valeur et le sens par aucun signe graphique, et qu’il faut absolument confier, livrer par voie de tradition à l’intelligence, à la mémoire et à la sensibilité, du chef d’orchestre. Et s’il manque de mémoire ? — Et s’il n’a pas de sensibilité ? — Et s’il pèche du côté de l’intelligence ? — (Car enfin tous ces inconvénients peuvent se rencontrer, soit isolément, soit tous ensemble : cela s’est vu ; cela peut se voir encore !…) Et voilà le compositeur obligé de dévorer, en silence, le tort fait à son œuvre par suite de méprises ou d’incapacités dont tout le dommage retombe sur lui. Croit-on, par hasard, qu’une conception musicale soit une selle à tous chevaux, une fantaisie en caoutchouc qui se prête indifféremment à tous les caprices de mouvements, de lumière ou d’ombre par lesquels on la fera passer ? Il faut être absolument réfractaire au sens musical, pour ne pas comprendre et ne pas sentir qu’une période musicale perd autant à être dénaturée dans son mouvement que dans sa forme, et que l’exactitude dans l’observance du mouvement est une condition essentielle à l’intelligence de l’idée même dont l’impression peut être détruite et le sens complètement défiguré par l’altération du mouvement.
Il y a des chefs d’orchestre froids et apathiques ; il y en a de brouillons et emportés ; j’en ai connu qui ramenaient tous les mouvements (les allegros aussi bien que les adagios) à une sorte de moderato uniforme, insipide, sans caractère et sans accent, dont la monotonie semblait être la pulsation tranquille de leur propre indifférence.
Eh bien ! je demande honnêtement une réponse honnête, sans ambages, sans plaisanteries et sans lazzis ; est-ce que cela est juste ?
Est-ce que cela est respectueux ? est-ce de la probité ? est-ce que ce n’est pas de la calomnie intellectuelle, la pire de toutes, puisque le public ne peut voir que ce qu’on lui montre et que la victime ne peut pas plaider en diffamation ? — Comment ! un homme a dépensé son âme, son cœur, son recueillement, l’observation intérieure, assidue, scrupuleuse de toute une vie ; il a tâché de fixer, dans cette langue fugitive et délicate des sons, une image sincère, fidèle, de ces mille aspects de la sensibilité humaine, pour que le premier venu, étranger peut-être, vienne niveler sous le bâton de l’incurie ou de l’inintelligence tout ce qu’il peut y avoir de délicat, d’intime, de coloré, d’individuel dans une œuvre qui est le portrait d’une nature et peut-être d’un monde ! Mais cela est la monstruosité de l’absurde et du cruel. Je le répète, il faut n’avoir aucun soupçon de ce que c’est que l’expression dans chacune de ses ressources soit vocales soit instrumentales, pour ne pas comprendre la relation étroite, l’identité intime qui existe entre l’esprit qui a conçu et la main qui dirige et anime l’ensemble et le détail de l’exécution.
On répond : Mais le chef d’orchestre suit les répétitions !
Cela ne veut rien dire. Il les suivrait pendant cent ans, sans profit, s’il manque d’intelligence, de mémoire ou de sensibilité. Le meilleur et le plus sûr pour lui, c’est une série de représentations devant le public, sous la direction de l’auteur.
Interrogez Richard Wagner, Félicien David, les souvenirs d’Offenbach, les écrits de Berlioz, ce grand coloriste, dont la main semblait faire vibrer elle-même les sons de l’orchestre qu’elle animait, et vous verrez quelle part d’influence revient à la direction personnelle de l’auteur sur la clarté d’exécution et par conséquent sur les chances de succès de son œuvre.
Passons maintenant à la question de dignité du chef d’orchestre.
(Suite : 28-juin.)
Extrait des Nouvelles diverses.
La première série des concerts du Gounod’s Choir a été close dernièrement à Londres, par un grand concert vocal et instrumental au bénéfice du maître. Le programme, outre un morceau de Jacques Lefebvre (1645), comprenait des œuvres du compositeur, notamment son nouveau Requiem, exécuté pour la première fois à grand orchestre ; Gallia, l’ouverture de Mireille, des chœurs, des morceaux de chant solo, et le ballet de Faust, une primeur pour le public anglais, qui n’a pas encore eu occasion de l’entendre au théâtre. Gounod n’avait pas cru devoir, en cette circonstance, renouveler l’expérience vocale qu’il a tentée l’année dernière en Belgique ; il s’est contenté de diriger l’orchestre et les chœurs, et d’accompagner ses mélodies au piano, au lieu de les chanter. il a été accueilli avec enthousiasme, et son concert a obtenu un immense succès. À la fin de la soirée, la musique du 1er Life-Guards l’a régalé d’une fanfare composée sur des motifs de ses opéras.
Extrait des annonces de nouvelles publications.
- Nouvelles mélodies de Charles Gounod :
L’Ouvrier (The worker) ; La fleur du foyer (O happy home) ; Que ta volonté soit faite ! (Thy will be done) ; Prière du soir ; Lamento ; La Fauvette ; Si vous m’ouvrez ; Heureux sera le jour ; Le pays bien heureux. — Duo : Fleur des bois (Little Celandine) ; Chanson de la brise (Message of the breeze) ; Barcarola. — Pour piano : Dodelinette (à 2 et 4 mains) ; Ivy (Lierre) ; Funeral March of a Marionette.
- Biondina : un roman musical en douze chapitres, paroles italiennes de Giuseppe Zafira, traduction française par Jules Barbier et Charles Gounod.
Le Ménestrel, 28 juin 1873
Les Compositeurs-chefs d’orchestre, lettre 2/4 de Charles Gounod ; son affaire judiciaire à Londres.
Lien : Gallica
Que veut-on dire quand on prétend que la dignité de chef d’orchestre est outragée s’il cède au compositeur le bâton de la direction ? J’avoue et je déclare sincèrement que je ne le comprends pas.
Le désir qu’éprouve un auteur de diriger son œuvre ne signifie pas le moins du monde que le chef d’orchestre ne soit un musicien très-recommandable, très-expérimenté, très-capable de remplir parfaitement les fonctions dont il est chargé. La question est simplement celle-ci : Pour bien diriger une œuvre musicale, pour en donner une interprétation juste, fidèle, véridique, il faut absolument connaître et posséder parfaitement les rapports de nuances, d’accent, de mouvement qui relient entre elles les diverses périodes d’un même morceau, et entre eux les divers morceaux d’un même ouvrage. Le sens et le coloris d’une œuvre sont à cette condition.
Or, je le demande, y a-t-il un seul chef d’orchestre, même le meilleur, qui puisse prétendre avoir dans l’esprit une synthèse et une analyse aussi exactes d’une œuvre quelconque que le compositeur qui l’a conçue et qui l’a exprimée dans des termes dont lui (l’auteur) connaît, mieux que qui que ce soit, le rapport avec l’objet qu’il a voulu peindre ?
Je le répète, et on ne saurait trop le redire, le désordre, la perturbation introduits dans une œuvre musicale par les contre-sens de toute nature auxquels peut aboutir la négligence ou l’ignorance sur les intentions du compositeur sont quelque chose d’incalculable et peuvent causer à son œuvre un préjudice dont on semble ne pas se rendre compte. Un degré de lenteur de plus dans tel allegro, ou de moins dans tel adagio, suffit souvent pour enlever à l’un son entraînement et à l’autre sa solennité, et par conséquent pour altérer et même détruire l’impression qu’ils étaient destinés à produire.
On paraît ignorer que l’idée musicale ne consiste pas uniquement dans le son que représentent les notes, mais aussi et essentiellement dans les conditions esthétiques de ces mêmes sons, c’est-à-dire dans leurs rapports de mouvements et de nuances, qui constituent leur expression et leur physionomie. Ces conditions varient à l’infini : elles sont aussi multiples et aussi délicates que le sont, dans l’art de la peinture, ces milles chatoiements de glacis, ces milles souplesses de pâtes et demi-pâtes, ces frottis légers et rapides que la brosse saisit comme par instinct sur la palette, et dont le peintre lui-même n’aura peut-être pas le secret deux fois dans sa vie, quelque connaissance qu’il ait de son art, parce que ces touches sont passagères, fugitives, insaisissables comme la vie qui les a fait deviner, et comme l’heure qui les a inspirées.
On m’accordera sans peine, je suppose, que tout cela constitue un monde de détails dont l’altération ou la suppression n’équivalent à rien moins qu’à une diffamation musicale, à une véritable calomnie. On m’accordera, je pense également, qu’il est impossible de se pénétrer d’un pareil ensemble à moins d’avoir entendu souvent et suivi avec une attention scrupuleuse toutes les ondulations, toutes les sinuosités de cette machine vivante qu’on appelle une œuvre d’art musical, et dont la régularité mathématique du métronome ne saurait donner la moindre idée.
Il ne faut pas honorer du nom de dignité toutes les formes que peut revêtir la susceptibilité de l’amour-propre. Avec un critérium aussi mobile, aussi arbitraire que cette disposition à voir une offense dans les moindres avis et une blessure dans les moindres observations, il est absolument impossible d’apprécier avec justice ce que la dignité nous impose et ce qu’elle nous interdit.
Rien au monde n’est plus digne que le sentiment qui nous fait reconnaître et avouer qu’il est de notre devoir absolu de nous pénétrer intimement d’un mandat, quel qu’il soit, dès que nous l’acceptons. Or, qu’est-ce que la fonction de chef d’orchestre ? un mandat. Le chef d’orchestre, si le compositeur est vivant, est un délégué de ses intentions ; si le compositeur est mort, le chef d’orchestre est un délégué de la tradition. En tous cas, il est tenu en conscience de se renseigner et non pas de s’imposer. La vraie dignité, c’est de ne rien négliger de ce qui peut le mettre en communion complète et intime avec la pensée de l’auteur.
Admettons que le chef d’orchestre s’en rapporte à sa propre intelligence (que je suppose réelle et que je ne discute pas) ; qu’arrivera-t-il ? C’est qu’au lieu de faire aux œuvres diverses leur part de variété dans l’interprétation, il les ramènera toutes fatalement à l’uniformité de sa propre manière de comprendre et de sentir ; il jettera sur toutes ces conceptions de tempéraments si divers la monotonie de son propre tempérament, tant il est vrai que notre intelligence propre ne saurait nous soustraire, à elle seule, aux suggestions de notre sensibilité. Je ne terminerai pas cette partie de mes réflexions sur le sujet qui m’occupe sans y faire une part à la nomination récente du nouveau chef d’orchestre de l’Opéra.
Lorsque j’ai commencé ce travail, je venais d’apprendre la mort de Georges Hainl, et j’ignorais qu’il fût déjà remplacé, comme je l’appris quelques jours plus tard. Ernest Deldevez, qui lui succède, est un musicien de trop de mérite pour que je ne réclame pas ma place parmi les sympathies qui auront accueilli son avènement. Deldevez a été mon condisciple au Conservatoire, dans la classe de composition d’Halévy. J’ai toujours trouvé en lui un artiste consciencieux et un musicien sévère et accompli. Membre de la Société des Concerts du Conservatoire depuis près de 35 ans, il a vécu et grandi au contact des grands maîtres, sous les traditions de l’illustre Habeneck, dont il remplit aujourd’hui les fonctions à la Société des Concerts aussi bien qu’à l’Opéra. Deldevez est donc, par la valeur de son éducation traditionnelle et de son propre mérite musical, un des exemples de garantie et de sécurité les plus concluants que je puisse invoquer. Il a été un témoin ; il est un héritier du patrimoine de notions, d’expérience, de transmission des doctrines qui l’ont formé lui-même : il a ses titres de créance d’une part, et de l’autre il a fait ses preuves. Son arrivée au double poste qu’il occupe aujourd’hui sera donc saluée avec joie par tous ceux qui ont quelque souci et quelque idée des qualités nombreuses et sérieuses que doit réunir en lui le chef d’orchestre considéré comme homme et comme artiste.
(Suite : 6 juillet.)
Extrait des Nouvelles diverses.
Les deux ouvrages désignés pour être exécutés au théâtre impérial de Vienne devant le tsar de Russie étaient Lohengrin [opéra de Richard Wagner] et Mignon [tragédie lyrique d’Ambroise Thomas, livret de Jules Barbier et Michel Carré]. Sur la demande expresse de l’illustre voyageur, le premier de ces opéras a été remplacé par le Faust de Gounod. C’est Richard Wagner qui ne doit pas être content et le Guide musical non plus.
Les musiciens, disait il y a deux jours Jennius, de la Liberté, ont parfois des vivacités de plume qui les emportent plus loin qu’ils ne voudraient : le genus irritabile vatum, la race irritable des poètes
, dont parle Virgile, est peut-être moins susceptible que celle des compositeurs. Charles Gounod a eu dans ces derniers temps un différend avec un éditeur anglais, Master Novello, et comme il s’est exprimé avec toute la vivacité française, tandis que son adversaire britannique conservait son flegme national, le voilà qui vient de comparaître devant les juges du Banc de la Reine. La cause a été jugée, mais non, paraît-il, entendue, car voici la lettre adressée au Times par notre illustre collaborateur :
Monsieur, — permettez-moi quelques mots dans les colonnes de votre honorable journal touchant le procès en diffamation en date de samedi dernier, 21 juin : Littleton, maison Novello, contre Gounod.
Ma cause n’a pas été entendue. Je suis étranger ; je parle difficilement la langue anglaise. Je n’ai pas été aidé par l’interprète, ce qui a jeté beaucoup d’obscurité sur le peu de questions qu’on m’a adressées, et le peu de réponses incomplètes qu’il m’a été possible de donner. Madame Weldon, que j’avais appelée comme témoin et sur qui je comptais, comme étant en possession de tous les documents nécessaires pour éclairer la question, n’a même pas été interrogée, si ce n’est sur son nom de baptême et si elle était l’auteur de
l’article. Quel article ? Il était impossible de comprendre de quoi l’on voulait parler.J’ai été condamné à 40 s. de dommages-intérêts et aux frais. Je déclare que je ne paierai ni les uns ni les autres, malgré toute la déférence due au Juge et au Jury qui, dans de pareilles conditions, ne pouvaient pas juger autrement.
On me dit que je ne peux pas en appeler de ce jugement. J’en appelle à vous, Monsieur, pour me rendre le service de publier cette lettre, afin que je puisse du moins protester publiquement de la manière dont j’ai été traité.
Votre obéissant serviteur,
Ch. Gounod.
Tavistock-house, Tavistock-square, 24 juin.
Le Ménestrel, 6 juillet 1873
Les Compositeurs-chefs d’orchestre, lettre 3/4 de Charles Gounod.
Lien : Gallica
J’ai tâché de faire voir qu’en reconnaissant aux compositeurs le droit de diriger leurs œuvres, le chef d’orchestre non-seulement conserve sa dignité intacte, mais encore fait preuve de dignité. Je veux montrer aujourd’hui que son autorité loin d’être, ainsi qu’on le prétend, compromise par cette déférence, y trouve, au contraire, une garantie et une sanction.
Il faut, avant tout, s’entendre sur le sens de ce mot, l’autorité ; comme c’est un mot plein de tempêtes, gros de conflits de toute sorte, prétexte et mot d’ordre des prétentions les plus oppressives, et, en même temps, prérogative des droits les plus incontestables, je suis bien aise de le rencontrer sur mon chemin, et j’essaierai de dissiper, autant qu’il me sera donné de le faire, les nuages de sophisme et de paradoxe dont on l’enveloppe et qui en obscurcissent le sens et en amoindrissent le crédit.
Ce serait une erreur grossière de croire que l’autorité procède de la volonté : elle procède de l’intelligence.
Ce n’est point la force qui fait l’autorité, c’est la lumière. L’autorité n’est pas une contrainte, c’est une persuasion : elle détermine non pas l’obéissance à contre-cœur, mais la soumission volontaire, l’adhésion du consentement intime. Un homme vient de dire une sottise, un autre la réfute par un mot de sens commun et s’empare des suffrages : voilà l’autorité. Il n’a pas dit : Vous devez me croire, je veux que vous me croyiez
; — il n’a pas imposé sa volonté ; c’est uniquement la somme de vérité contenue dans sa parole qui a triomphé de la somme d’erreur contenue dans celle de son adversaire. L’autorité est donc, par nature et par droit, en raison directe de la vérité, contrairement au principe mensonger : La force prime le droit.
Ce que j’ai dit de la force, il faut l’appliquer à la routine qui n’est que la force du convenu, se substituant au mécanisme légitime et au libre exercice du droit et de la vérité.
Ces quelques mots sur la nature et le caractère de l’autorité me semblent suffisants pour mettre dans son véritable jour ce qu’il faut entendre par l’autorité du chef d’orchestre, et pour résoudre les malentendus que peut engendrer et maintenir la méprise sur cette question.
Si l’autorité est en raison de la lumière, il est évident que la confiance et la soumission envers cette autorité se mesureront à la somme de lumière qu’elle représente.
Il est donc clair que plus un chef d’orchestre s’assimilera de rayons au foyer de lumière original, plus il multipliera parmi les membres de son orchestre les chances de respect envers son autorité. Or, chez qui cette autorité est-elle plus concentrée que chez l’auteur ? Qui, mieux que lui, peut la conférer à un autre que lui ? Tout autre que lui est, en quelque sorte, un second chef d’orchestre, un délégué, un vicaire. Avoir vécu, agi, éprouvé sous la direction personnelle de l’auteur, avoir reçu la transmission de sa pensée, non pas sous cette forme incomplète et glacée de l’explication, mais vivante, sensible, transformée en émotion directe, soudaine, palpitante, n’est-ce pas la meilleure et la plus sûre garantie de fidélité à la parole créatrice ? L’autorité du délégué trouvera-t-elle jamais une base plus solide, et l’indépendance de ses propres vues aura-t-elle jamais raison et droit d’en tenir lieu ?
Assurément, il y a des œuvres musicales qui ont, plus ou moins les unes que les autres, à perdre ou à gagner sur ce terrain de la fidélité scrupuleuse aux intentions de l’auteur. Mais il y a des œuvres sérieuses, graves, profondes, prises dans les replis les plus intimes, les plus délicats de la physionomie humaine : ces œuvres ont la valeur et la mission du portrait : en altérer les moindres lignes, c’est enlever au portrait tout l’intérêt de sa ressemblance, et le réduire à un poncif, à une figure de confection, dénuée de toutes les particularités qui en composaient le caractère, cette saveur de la personnalité.
Je sais que beaucoup traiteront ces réflexions de chimériques, peut-être même de puériles, mais peu importe ; ce qu’il importe d’établir, c’est la nécessité pour le chef d’orchestre d’être un traducteur fidèle de la pensée de l’auteur, sous peine d’être un trahisseur, selon le vieil adage italien : traduttore, traditore.
C’est précisément ce degré d’intelligence et de sensibilité qui fait que les chefs d’orchestre éminents sont des produits très rares, et ce n’est assurément pas le maintien de leur autocratie qui en augmentera le nombre.
La grande affaire, au fond, c’est de soustraire l’œuvre d’art à la servitude de la lettre qui tue, et de la mettre sous la garde de l’esprit qui vivifie. Platon disait, avec cette admirable intuition des choses idéales qui lui a mérité le surnom de divin
, qu’un livre est une parole qui n’a plus son père pour la défendre
. Une partition est un livre ; il faut faire en sorte qu’elle reste le plus possible une parole ; et pour cela, il faut qu’elle ait autant et aussi souvent que possible son père pour la défendre
, c’est-à-dire pour être la figure dont le texte n’est que l’enveloppe extérieure et muette, l’âme dont le livre n’est que le corps, la vivante parole dont les notes écrites ne sont que la voix.
On ne saurait trop le redire : de tous les arts, y compris l’art littéraire, la musique est le plus sujet à subir des altérations dans son trajet entre la pensée de l’artiste et le public. Les autres arts ont une forme plus précise ; de plus, cette forme est fixée par l’auteur lui-même, directement, sans la coopération d’intermédiaires sujets à la dénaturer : entre l’œuvre du peintre et du sculpteur et le public, il n’y a personne ; entre le public et l’œuvre du musicien, il y a tout un monde ; ce monde peut être ou transparent ou opaque, il peut transmettre ou intercepter le rayon. Qu’une œuvre littéraire soit récitée, lue, déclamée avec plus ou moins de vérité dans l’intonation, sans aucun doute, cela n’est pas indifférent ; mais, du moins, il reste toujours à l’œuvre littéraire la présence du mot, qui est un signe d’idée, qui appartient à un vocabulaire déterminé, et dont la signification est la même pour chacun des auditeurs ou des lecteurs.
Combien il en va autrement pour le signe musical ! Outre que la lecture n’en est accessible qu’à un public spécial et limité, combien le signe lui-même n’est-il pas susceptible de devenir non le sens mais le contre-sens, entre les mains d’un interprète peu ou point renseigné sur sa véritable signification ! Une phrase musicale faussée dans son mouvement, dans son expression, c’est une lettre que le facteur substituerait en route à celle qu’on lui aurait confiée ; c’est un message mal rempli, dont l’inexactitude retombe toute entière non sur le messager, mais sur celui qui l’a envoyé.
Le chef d’orchestre est un mandataire : plus il aura le sentiment et la conscience de son mandat, plus il dégagera sa responsabilité, plus il affermira son autorité sur une base solide et inébranlable.
(Suite : 13 juillet.)
Extrait des Nouvelles diverses.
La nouvelle partition de Pedrotti, Olema la schiava a déjà disparu de l’affiche du théâtre Dal Verme [à Milan]. On y prépare le Faust de Gounod et l’Ernani de Verdi.
Les intéressantes lettres de notre maître Charles Gounod sur les compositeurs chefs d’orchestre défraient non-seulement les controverses de la presse française et étrangère, mais elles stimulent aussi la plume de ceux de nos artistes capables d’exposer et de développer leurs idées à ce sujet. Déjà notre violoniste-compositeur Charles Dancla répond aux premières lettres de Charles Gounod par une brochure dont nous aurons occasion de parler, quand l’auteur de ces mémorables lettres aura dit toute sa pensée à l’égard des chefs d’orchestre. Jusque là, on comprendra que nous laissions la parole, tout entière, à l’illustre correspondant du Ménestrel, dont nous avons d’ailleurs l’honneur de partager toutes les doctrines, sur le droit si légitime, des compositeurs à s’emparer du bâton de chef d’orchestre pour diriger leurs œuvres.
Le Monde illustré, 12 juillet 1873
Article de la rubrique Théâtre de Pierre Véron.
Lien : Gallica
Malgré cette disette, nous allons pourtant avoir deux Jeanne d’Arc d’un seul coup ; l’une de Mermet, l’autre de Gounod. Je parie pour Mermet.
Il a déjà prouvé dans Roland qu’il avait le souffle patriotique. M. Gounod, au contraire, nous paraît avoir choisi un singulier milieu pour composer une telle œuvre. Ne l’a-t-il pas écrite chez les Anglais ? Vous me direz à cela qu’ils ont brûlé Jeanne d’Arc, et que c’est peut être pour cela que M. Gounod voulant traiter le sujet avec feu…
Drôle d’idée tout de même !
Le Ménestrel, 13 juillet 1873
Les Compositeurs-chefs d’orchestre, lettre 4/4 de Charles Gounod.
Lien : Gallica
Enfin, dit-on, les compositeurs n’ont pas à se mêler de conduire leurs ouvrages, ce n’est pas leur affaire ; il y a des gens pour cela : À chacun son métier, et les vaches seront bien gardées.
D’ailleurs, ce n’est pas la coutume. Nous y voilà donc. Toujours l’argument péremptoire choisi avec soin et prédilection dans ce qu’il y a de plus absurde. Ce n’est pas la coutume ! Eh bien ! Qu’on la change. Est-ce que ce sera la première fois ? Nous passons notre vie à cela, fort heureusement. Est-ce que la mode ne change pas ? Qu’est-ce donc que la mode, sinon la coutume ? Vraiment, tâchons de nous guérir de la maladie de ces réponses fades, machinales, automatiques : c’est une véritable léthargie. On invente les chemins de fer, dont la rapidité me permet, à moi chirurgien, d’arriver assez vite auprès d’un blessé, d’un mourant, pour lui sauver la vie par une opération : mais la coutume est d’aller en diligence ; je prendrai la diligence : j’arriverai trop tard, peut-être ; qui sait si le patient n’aura pas succombé d’épuisement et de souffrances !… Le chemin de fer m’eût permis d’arriver à temps !… Mais ce n’est pas la coutume.
Le domaine public, ce voleur anonyme, s’empare d’une de mes œuvres à moi compositeur ; il va enrichir l’éditeur de mon opéra, le directeur qui monte l’ouvrage et les chanteurs qui vont le chanter ; enfin tout le monde, excepté moi, l’auteur. Quant à moi, je reste sur la paille et j’y meurs, parce que c’est la coutume. Sans doute, des conventions (soit nationales, soit internationales) pourraient substituer à ce régime des mesures plus larges de justice et d’humanité ; ces mesures apparaîtront dans un temps donné : — mais, ce n’est pas la coutume. En attendant, va, pauvre artiste, travaille, souffre, pleure, creuse ta tombe en même temps que ton idéal, et meurs à la peine en ravissant au ciel la lumière et le feu qui vont éclairer et réchauffer tes semblables : c’est la coutume ! — J’entre en relations avec un éditeur de Londres ; cet éditeur, après m’avoir deux fois amené à consentir une diminution sur des prix médiocres convenus verbalement entre nous, essaye une troisième fois de me retenir la moitié d’une somme qu’il me doit : je lui intente un procès ; au bout de six mois, et au moment de plaider, il recule et s’exécute. Je raconte les faits ; il m’intente à son tour un procès en diffamation. Nous sommes cités devant le tribunal : on l’interroge en détail, lui, plaignant, ainsi que son témoin ; on les écoute tous deux avec patience et recueillement : j’en conclus que c’est la coutume. Mon tour arrive : on m’interroge à peine, non plus que mon témoin ; on ne confronte pas les dénégations de mon adversaire avec mes affirmations. À peine m’a-t-on posé une question que le bruit couvre et décapite mes réponses ; ma situation et mon langage d’étranger compliquent l’obscurité du débat, si bien que je suis jugé et condamné sans être entendu !… Est-ce aussi la coutume ?…
Je pourrais multiplier les exemples et prolonger à l’infini cette liste douloureuse des griefs contre la déesse Coutume. J’en ai dit assez pour attirer l’attention des gens qui pensent et réveiller les gens qui dorment. Fort de ma justice et de la conscience de mon droit, je suis déterminé, et je l’ai écrit publiquement, à ne pas payer un liard de la somme à laquelle m’a condamné un jury dont la conscience a été non pas éclairée, mais induite en ignorance. Fort également de la conscience du vrai et de la justice des réformes que je propose en ce moment, je dis :
La guerre est partout, ici-bas, entre l’Idéal et le Réel. L’Idéal nous sollicite par une attraction qui nous développe et nous élève ; le Réel nous retient par une attraction qui favorise notre paresse et nous enchaîne sous l’empire de la routine,
L’Idéal est le principe positif, indestructible, effervescent de toute réforme, de toute révolution, de tout progrès ; le Réel est le principe négatif, inerte et passif, de toute somnolence, de toute servitude, de tout statu quo. L’un est le mouvement, l’autre, l’immobilité. Ces deux forces, en harmonie constante dans l’univers, où leur concours produit la gravitation des astres, sont, dans l’histoire de l’esprit humain, à l’état de lutte perpétuelle, et leur prépondérance alternative mesure la lenteur ou la rapidité de notre marche.
Nous ne savons que trop, hélas ! le temps qu’il faut, en toutes choses, à l’idéal, pour tirer la Société des ornières du Réel. La simplicité, la bonhomie, la candeur de l’Idéal sont tout ce qu’il y a de plus opposé au clinquant et au tapage des objets ou des raisonnements qui ébaubissent la foule.
Aussi, à l’Idéal, les réussites tardives, à longue échéance, mais durables, séculaires, immortelles : au Réel, les succès faciles, immédiats, mais éphémères ; et finalement la défaite certaine.
L’histoire de l’humanité est un empiétement sans relâche de l’Idéal sur le Réel, c’est-à-dire de ce qui doit être sur ce qui est, ainsi que l’exprimait admirablement Raphaël, dans sa définition sur l’Art, qui, disait-il, consiste avoir les choses non pas telles que la nature nous les montre, mais telles qu’elle aurait dû les faire
.
Les prisons de la Routine sont toujours debout, et les murs sont épais. De loin en loin un détenu s’échappe et jette l’alarme dans le camp de l’opinion ; le levain nouveau soulève la vieille pâte ; la masse fermente, et, un beau jour, on voit ce qui révoltait hier la banalité de tous, satisfaire aujourd’hui le sens commun de tous.
La coutume est un phénomène de temps et d’espace ; le temps et l’espace ont des limites ; la vérité n’en a pas. La lenteur des communications a fait découvrir la vapeur et l’électricité. — Eh bien ! moi, je demande qu’à la lenteur de nos communications avec le public par le moyen des vieux coches, fiacres, diligences, véhicules de toute sorte de l’intelligence humaine, on substitue la communication directe, instantanée, magnétique, brûlante, lumineuse de la flamme originale, du regard personnel, du geste soudain et passionné ; en un mot, je demande qu’on reconnaisse, en principe et en fait, à ce corps qui s’appelle un orchestre, son âme, son cœur et sa tête légitimes, le compositeur.
Mais, me dira-t-on, l’auteur ne peut pas être partout où l’on joue son œuvre, et d’ailleurs, beaucoup ne se soucieraient pas de cette vie errante à laquelle les obligerait votre théorie de transmission personnelle de leur pensée. — J’en conviens : mais il y a quantité de chefs d’orchestres étrangers qui viennent se renseigner à la représentation, soi-disant authentique d’une œuvre, dans le pays même où l’œuvre a paru d’abord : ce serait donc bien le moins que l’on concentrât sur cette exécution modèle, sur ce type primitif, toutes les chances de perfection, et que l’on neutralisât ainsi, autant que possible, les chances de déviation dont les effets (j’ai pu en juger moi-même) sont parfois monstrueux.
On allègue encore l’incapacité des auteurs pour diriger leurs œuvres. Un moment. Tous ne se trouvent pas dans ce cas. J’ai nommé Berlioz, Félicien David, Wagner, que de nombreux auditeurs ont vus à l’œuvre ; j’aurais pu citer l’illustre Mendelssohn, que j’ai eu l’occasion de voir diriger ses ouvrages à Leipzig en 1843. Je ne sache pas qu’on ait contesté à ces musiciens célèbres la capacité de chef d’orchestre, et je suis certain que l’exécution et l’intelligence de leurs œuvres n’a pu que gagner sous leur direction personnelle, et, par conséquent, décider peut-être un succès qui eût passé à côté d’exécutions moins fidèles, et par là, moins intelligibles.
Mais enfin, dans le cas, où le compositeur n’a pas l’instinct ou l’expérience de la direction d’un orchestre, il est clair que la question est résolue ; il faut bien qu’il s’en remette à quelqu’un d’autre pour remplir cet office et ma thèse implique et maintient la nécessité du chef d’orchestre.
Je termine ces réflexions que j’aurais pu développer davantage ; elles suffisent, je pense à démontrer que les raisons qu’on allègue pour contester aux auteurs le droit de conduire leurs œuvres se réduisent à des préjugés.
Comme il est peu probable que j’applique personnellement les réformes que je suggère, on ne soupçonnera pas mes arguments d’avoir été dictés par un mouvement de partialité. Ce que je souhaite, c’est qu’on donne à un art aussi fugitif, aussi délicat, aussi pénétrant que la musique, tous les moyens possibles d’échapper à des infidélités d’expression et d’intention qui, je le répète, peuvent dénaturer une œuvre musicale au point de tromper absolument l’auditeur sur la véritable pensée du compositeur.
Le Ménestrel, 20 juillet 1873
Réponse de Jacques-Léopold Heugel, directeur du Ménestrel, aux Compositeurs-chefs d’orchestre de Charles Gounod.
Lien : Gallica
Cher maître,
C’est à Vienne, pendant les répétitions générales d’Hamlet, qu’il m’a été donné de lire vos dernières lettres sur les compositeurs-chefs d’orchestre et d’en pouvoir comprendre, sur le vif, toute la portée, tout le sens pratique.
Vous avez bien raison de souhaiter que les compositeurs deviennent le plus possible les chefs d’orchestre de leurs opéras. Il importerait tout au moins qu’ils n’abandonnassent pas leurs œuvres à l’interprétation fantaisiste des scènes étrangères, si remarquablement organisées que soient lesdites scènes, ce qui est le cas de celle de l’Opéra impérial de Vienne.
Quand, en effet, un chef d’orchestre, fût-il même des plus habiles, se trouve placé devant une importante partition, cherchant, sans le secours de l’auteur, la reproduction vivante et sonore d’une œuvre, à travers ces myriades de signes graphiques, qui forment notre écriture musicale, il ne tarde pas à comprendre son impuissance relative.
L’auteur seul, à certains moments, peut donner la vie et le mouvement à telle phrase mélodique, à tels dessins d’orchestre qui en sont comme le souffle ou les membres complémentaires. En effet, la stricte exécution de la note écrite n’en saurait donner ni le phraser, ni le sentiment, ni la couleur ?
C’est à ces divers points de vue, que le plus parfait musicien, le plus habile chef d’orchestre sent échouer toute sa science, toutes ses aptitudes, s’il ne peut s’inspirer lui-même du souffle créateur de l’œuvre.
Les mouvements métronomiques et tous les accents indiqués dans la musique moderne ne sauraient tenir lieu que de régulateur relatif ; d’ailleurs tel chanteur ne peut les approprier absolument à sa voix, à son talent ; d’où résultent des modifications essentielles, non-seulement dans la phrase chantée, mais aussi dans l’orchestration placée sous la mélodie. Or le compositeur seul est apte à modifier certains passages de son œuvre sans en détruire le caractère et l’unité.
Autre chose : la langue française a ses accents particuliers auxquels la prosodie allemande et la prosodie italienne sont absolument rebelles, nouvelles modifications indispensables qui touchent non seulement au chant mais parfois à l’orchestration. Or, qui peut se les permettre, sinon l’auteur.
Bien plus, les musiciens de l’orchestre ont leurs qualités et leurs défauts tout comme les chanteurs, et souvent tel passage gagne à une légère modification, ou même à une mutation, à une sorte de virement que l’art ne saurait condamner, au contraire ; un seul exemple pour preuve : lors des répétitions générales d’Hamlet à l’Opéra de Paris, le solo de cor du prélude de l’Esplanade dut être transporté des notes indécises du corniste à celles plus sûres du trombone. Eh bien ! à l’opéra de Vienne, le fait contraire s’est produit. Le chef d’orchestre se trouvait fort embarrassé de son solo de trombone et me remercia de lui indiquer la première version qu’il s’empressa d’adopter, ayant un excellent corniste à sa disposition.
Ce n’est là qu’un exemple des nombreuses modifications auxquelles est généralement appelée cette œuvre en passant des scènes françaises sur les scènes étrangères, où le fil de la tradition se perd et se trouve même forcément rompu : 1° par des moyens d’exécution qui ne sont plus les mêmes ; 2° par d’importantes modifications résultant de la traduction ; 3° enfin par de trop nombreuses coupures, qui s’expliquent par le temps plus restreint consacré à l’audition des œuvres lyriques en Allemagne et en Angleterre.
Ces pages supprimées en l’absence de l’auteur sont souvent arrachées aux plus belles parties de son œuvre, parce qu’on les juge moins appropriées au goût du public spécial appelé à entendre une partition nouvelle. Ainsi, loin de ménager des surprises aux auditeurs, de façonner leur goût à de nouvelles impressions, on leur sert nos opéras à l’allemande, à l’anglaise ou à l’italienne.
Voilà la stricte vérité appuyée sur des faits incontestables, si bien, que si j’avais l’honneur d’être l’auteur d’une partition importante, je n’en permettrais jamais l’exécution sur une grande scène étrangère sans mon concours personnel.
Si cela n’implique pas l’idée absolue de la direction de l’orchestre par l’auteur lui-même, ce qui pourrait devenir un embarras pour quelques-uns, tout ce qui précède affirme du moins d’une manière irrécusable la thèse qui a pour but de remettre plus ou moins directement, aux mains des compositeurs, l’interprétation de leurs œuvres sur les scènes principales qui font école ou tradition.
À Paris, cette autorité si naturelle existe pour toutes œuvres nouvelles d’auteurs vivants. Si le compositeur ne dirige pas lui-même son orchestre et ses chanteurs, il a si bien discipliné et inspiré les interprètes par de nombreuses et laborieuses répétitions, que le chef d’orchestre n’est, à l’heure de la représentation publique, que le reflet assez fidèle de la pensée de l’auteur. Mais sur les scènes étrangères où les exécutions musicales s’improvisent, en saurait-il être de même ?
Évidemment non, et si nos compositeurs ne se font pas un devoir d’y aller porter en personne la lumière qui vivifie, ils feront subir à l’art français, bien des mécomptes.
Vous avez donc rempli une véritable mission de grand artiste, mon cher Gounod, en appelant l’attention des compositeurs sur la triste situation qui leur est faite ou qu’ils se font eux-mêmes, par trop d’insouciance, à l’endroit de toute direction de leurs œuvres à l’étranger. Vous vous êtes souvenu qu’aux premières répétitions de votre Faust, à Londres, vous l’auteur, vous fûtes consigné à la porte de Covent Garden [Opéra Royal, à Londres], pour avoir voulu faire prévaloir vos idées sur celles du chef éminent qui dirigeait alors l’orchestre de ce théâtre. Vous avez voulu prouver que les, compositeurs devraient être les chefs d’orchestre de leurs opéras, au moins pour les premières représentations, et, en soutenant cette thèse, vous n’avez fait que revenir aux grandes traditions de l’Allemagne, celles qui ont rendu immortelles les œuvres de Weber.
Le Ménestrel, 27 juillet 1873
Lien : Gallica
L’Opéra-Comique va reprendre les Deux journées, de Cherubini. […] Les Deux journées, représentées le 15 janvier 1800, ont pour sujet un épisode de la Fronde. […] Le poème, qui, il faut bien le dire n’est pas très intéressant, sera remanié par M. Jules Barbier.
Le Ménestrel, 3 août 1873
Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.
Lien : Gallica
Jacques Offenbach Ier lui-même, directeur-roi au théâtre de la Gaîté, a définitivement installé sa maison musicale. Comme général en chef de ses masses lyriques, il a pris naturellement son fidèle Achate, M. Albert Vizentini, et nous connaissons assez le jeune chef d’orchestre pour être convaincu qu’il tiendra le bâton du commandement comme il maniait jadis la plume du critique ou l’archet du violoniste. Les lieutenants principaux de M. Vizentini sont M. Arnaud Godin (2e chef d’orchestre) qui sort de l’Opéra-Comique, où chacun le regrette, et M. C. Bourdeau (chef des chœurs) qui a fait ses vaillantes preuves au Vaudeville en y montant l’Arlésienne de Bizet. Les choristes seront au nombre de 75. L’orchestre, composé de 55 musiciens, aura pour solistes : MM. Miramont (flûte), Boulu (hautbois), Pares (clarinette), Lalande (basson), Garrigue (cor), Bello (piston), Roger (trombone), Weber (timbalier), Billoir et Frémaux (violoncelles), Gianini et Jouet (violons) ; tous noms avantageusement connus des amis de l’art et de la bonne musique. C’est dans la Jeanne d’Arc de MM. Jules Barbier et Gounod, que nous pourrons juger du résultat produit par ces talents réunis.
C’est le 16 août que doit avoir lieu la réouverture du Théâtre de la Gaîté par le Dernier Gascon, de M. Th. Barrière, et dès le lendemain commenceront les études de Jeanne d’Arc, drame en vers, où, comme on sait, l’élément musical occupe une si large place.
Le rôle de Jeanne d’Arc sera créé par Mlle Lia Félix ; celui d’Agnès est confié à Mlle Tessandier, la même artiste que celle choisie par Barrière pour le rôle principal de son nouveau drame. Mme Marie Brindeau a bien voulu accepter le personnage un peu marqué d’Isabelle Romée, la mère de Jeanne. C’est à Mlle Brunet, la charmante transfuge de l’Opéra-Comique, qu’est dévolu le rôle, en partie lyrique, de Loys de Contes. M. Clément Just représentera La Hire ; M. Desrieux, le vicomte de Thouars, favori du roi ; M. Stuard, Charles VII ; M. Angelo, un jeune paysan, Thibaut. Nous ignorons encore la distribution des autres rôles, très-nombreux et dont quelques-uns sont très-importants.
La partition de M. Gounod, complètement terminée, se compose de quatorze morceaux dont voici le nomenclature :
- Introduction d’orchestre ;
- Chœur de paysans ;
- Scène des voix ;
- Romance de Charles d’Orléans ;
- Chant religieux ;
- Menuet ;
- Chœur des Chevaliers ;
- Chœur et ronde des soldats et des ribaudes ;
- Prière (Veni Creator) ;
- Chœur de femmes dialogué ;
- Marche et Chœur du sacre ;
- Chœur de soldats et duo des saintes ;
- Marche funèbre ;
- Scène du Bûcher.
Quelques-uns de ces morceaux seraient, dit-on, appelés à un succès populaire ; une indiscrétion nous livre ce détail curieux que c’est la marche funèbre qui a eu tout d’abord les préférences du maître Offenbach, le bouffe par excellence.
M. Vizentini, le chef d’orchestre du théâtre, vient de faire tout exprès un voyage à Londres pour aller se pénétrer des intentions du compositeur, spirituelle et courtoise réponse aux articles que M. Gounod a publié sur les chefs d’orchestre dans les colonnes mêmes de ce journal. Les études des chœurs sont commencées.
En somme, la partition de Jeanne d’Arc, après Gallia, se chargera de prouver, en dépit de certaines allégations malveillantes, que M. Gounod est resté aussi bon Français que grand musicien.
Les costumes, dessinés par M. Thomas, d’après les documents de la bibliothèque, seront d’une grande richesse et d’une scrupuleuse exactitude. M. Giraud, le peintre si distingué, éloigné depuis longtemps des choses du théâtre par un grand malheur de famille, a bien voulu se charger de dessiner ceux de Mlle Lia Félix.
Les décorations des trois premiers actes : la chaumière de Jeanne d’Arc à Domrémy, l’appartement d’Agnès à Chinon et les remparts d’Orléans ont été confiés à M. Fromont ; celle du 4e acte : le portail de la cathédrale de Reims, appartient à M. Cambon, qui, d’autre part, par une singulière coïncidence, se trouve déjà chargé par la direction de l’Opéra de peindre l’intérieur de cette même cathédrale pour l’ouvrage de M. Mermet ; M. Chéret a pour sa part les deux décorations du 5e acte : la prison avec l’apparition du beau mai, et la place du vieux marché avec une étrange et curieuse apothéose.
Voilà bien des promesses ; espérons que le succès répondra aux efforts des auteurs et du théâtre. On croit que Jeanne d’Arc passera vers la fin d’octobre ou le commencement de novembre ; mais tout dépend de la fortune du Dernier Gascon de MM. Barrière et Davyl.
Le Monde illustré, 9 août 1873
Article du Courrier de Paris, par Pierre Véron.
Lien : Gallica
Autre nouvelle.
Gounod a terminé la musique de sa Jeanne d’Arc. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit.
Vous avez entendu parler des démêlés du maestro avec la justice anglaise. Gounod a été fort aigri par ces tracas et l’enthousiasme qu’il professait naguère pour l’Angleterre en a été singulièrement atténué. Sur ses entrefaites et comme il avait déjà quelques velléités de quitter Londres, de splendides propositions lui sont venues des États-Unis.
On lui offre deux-cent-mille francs comptant, s’il veut livrer à un théâtre de New-York une partition inédite. On y ajoutera cent-mille francs s’il veut venir pendant une année conduire l’exécution de cet ouvrage dans les principales villes de la République américaine.
On comprend que Gounod soit séduit. Il a pourtant demandé à réfléchir jusqu’à la fin du mois.
Il est à craindre qu’une fois conquis par les Yankees, Gounod ne nous revienne plus jamais et que nous n’ayons plus ainsi que la deuxième édition de sa musique.
Le Ménestrel, 10 août 1873
Lien : Gallica
Déclamation dramatique. — (Séance du mardi 29 juillet 1873.) Jury : MM. Ambroise Thomas, directeur-président ; Charles Blanc, A. de Beauplan, Émile Perrin, Jules Barbier, Gustave Chouquet, Alexandre Dumas [père], Duquesnel, Got, Édouard Thierry.
Le Ménestrel, 24 août 1873
Extraits des Nouvelles diverses
Lien : Gallica
Il y aura, paraît-il, à la Gaîté, un instrument nouveau dans l’orchestre pour accompagner la partition de la Jeanne d’Arc, de Gounod. Cet instrument, dont s’est occupé récemment l’Académie des sciences et dont nous avons entretenu nos lecteurs à plusieurs reprises, produit ses sons sous l’action d’un gaz enflammé circulant dans des tubes en cristal. On se rappelle que l’inventeur de cet instrument, M. Frédéric Kastner (fils du savant et regretté Georges Kastner, membre de l’Institut), lui a donné le nom significatif de pyrophone. Le son du pyrophone participe à la fois de la voix humaine et de la harpe éolienne ; c’est un timbre sui generis, d’une expression pénétrante, douloureuse, à la fois poétique et fantastique. Gounod a pensé que toutes les combinaisons des instruments connus ne vaudraient pas deux octaves du pyrophone pour accompagner des voix célestes qui parlent et commandent à l’héroïne de Domrémy ; des démarches seront faites, croyons-nous, auprès de M. Frédéric Kastner pour le prier de mettre un de ses instruments à la disposition des auteurs de Jeanne d’Arc.
La célèbre valse du Beau Danube bleu de Johann Strauss vient d’être transcrite et variée pour chant par Jean-Baptiste Weckerlin sur des paroles françaises de Jules Barbier traduites en italien par Achille de Lauzières, en allemand par M. Ferdinand Gumbert et en anglais par John Oxenford. La valse chantée du Beau Danube bleu, comme on le voit, est destinée à faire son tour du monde.
Le Figaro, 27 août 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével.
Lien : Gallica
Une dame russe, madame Adaïewski, est parvenue à obtenir une, audition à l’Opéra-Comique.
Comme chanteuse ?…
Non.
Comme compositeur.
Elle est l’auteur de la musique d’un ouvrage intitulé Ivan, et c’est Jules Barbier qui a remanié le poème.
Cette audition, accordée sur les instances de l’ambassade de Russie, aura lieu demain mercredi.
Audition dont nous ne prévoyons pas le résultat.
Mais les directeurs de l’Opéra-Comique ont poussé l’obligeance jusqu’à faire apprendre par MM. Melchissédec et Coppel les deux rôles d’hommes, pour que l’on put mieux apprécier, s’il y a lieu, les qualités musicales.
Le Figaro, 3 septembre 1873
Article d’Alfred d’Aunay sur la réouverture de la Gaîté.
Lien : Gallica
Réouverture de la Gaîté
C’est ce soir que le maestro Jacques Offenbach rouvre au public les portes du théâtre de la Gaîté. Mes confrères vous diront leur avis sur la valeur du premier ouvrage : le Gascon, et sur les magnificences de la mise en scène. Je n’ai à vous parler que des efforts faits par le nouveau directeur pour satisfaire matériellement le public.
Tout d’abord, comme vous le savez, le théâtre a été absolument remis à neuf. Il est éblouissant de dorures, et le confortable y a été soigné par d’intelligents sybarites. Sous le velours rouge des sièges, des mains vigilantes ont insinué un crin moelleux. On y était fort bien déjà sous la direction précédente, et c’est par un excès de prévenance qu’on a passé en revue ce matériel réputé l’un des meilleurs de Paris.
Mais une innovation des plus heureuses, c’est la suppression du plafond lumineux, et son remplacement par un lustre, dont les feux, répandant sur le balcon une vive lumière, permettront aux spectatrices de faire valoir leurs toilettes. Rien n’était triste comme l’éclairage de ce théâtre, rien n’est plus gai que ce lustre et que les nombreuses girandoles suspendues aux grands étages des galeries.
Cette transformation a permis d’installer dans la salle un système de ventilation très réussi. L’air est appelé de bas en haut par les cintres, jadis lumineux, qui entourent le plafond, et ces cintres, qui alors étaient des foyers de chaleur, deviennent les auxiliaires d’une puissante et salutaire ventilation. C’est là un progrès réel, dont les spectateurs du Gascon vont ressentir les précieux avantages. Vienne l’hiver, et l’on verra que la question du chauffage a été traitée avec la même intelligence et le même soin.
Je note en passant que les loges, resplendissantes dans leur tapisserie rouge semée d’arabesques d’or, ont été pourvues de patères pour les chapeaux, et sont garnies de tapis haute laine. Le bruit des sièges qu’on change de place n’incommodera plus les spectateurs.
On ne se plaindra plus, ni bruyamment, ni tout bas, des ouvreuses, attendu que les erreurs de placement sont devenues impossibles, grâce à une très ingénieuse innovation. Le coupon de chaque spectateur a un talon, séparé du billet par une ligne dépeints à jour. L’ouvreuse garde le coupon et laisse le talon aux mains du spectateur, qui possède ainsi la preuve de son droit d’occuper sa place.
Il est assez difficile d’expliquer comment on a pu établir à chaque étage, de petites dépendances indispensables dont le confort ne laisse rien à désirer.
On sera heureux d’apprendre, en cette saison, que, pendant les entractes, les spectateurs pourront aller fumer une cigarette dans le square des Arts-et-Métiers, dont la grille, située en face des portes du théâtre, restera ouverte jusqu’à la fin du spectacle. C’est une gracieuseté de l’administration municipale envers la nouvelle direction.
Enfin, on ignore généralement que le théâtre de la Gaîté est pourvu de sorties très commodes et très spacieuses, et de larges escaliers descendant de toutes les places vers les issues. L’ancienne direction, par économie de personnel, n’utilisait pas ces vastes dégagements, que la direction nouvelle va, dès aujourd’hui, ouvrir au public à la fin de la soirée.
Tel est le programme, très fidèlement suivi, des améliorations qui doivent signaler la prise de possession de ce beau théâtre par M. Jacques Offenbach.
De l’autre côté du rideau on a aussi bien fait les choses. Deux foyers ont été construits pour les danseuses et les choristes, ce qui montre l’intention bien arrêtée où l’on est de toujours agrémenter les pièces de musique et de danse. L’orchestre, toujours conduit par M. Albert Vizentini, sera plus où moins nombreux, selon les cas. Le petit mur de bois qui sépare les spectateurs de l’espace réservé aux musiciens est mobile, afin d’agrandir ou de rétrécir à volonté cet espace. Toutefois, le nombre des instrumentistes sera toujours de quarante au moins.
M. Tréfeu est le bras droit du maestro. MM. Émile Taigny, directeur de la scène, Vazeilles, régisseur général, Eugène Godin, chef machiniste, et Baudu, premier régisseur, ont été légués par l’ancienne direction à la nouvelle, et on sait que cet excellent personnel a su monter les plus éblouissantes féeries. M. Fuchs Taglioni est chargé de diriger la troupe de danse, composée de quatre premières danseuses, quatre secondes, et quarante dames dont dix Anglaises et dix Italiennes.
Enfin, MM. Robecchi, Cambon, Chéret, Fromont et Lavastre ont peint ou sont en train de peindre les trente grandes décorations du Gascon, de Jeanne d’Arc et d’Orphée aux enfers.
Telles sont les indiscrétions qu’il m’est possible de commettre sans marcher dans les plates-bandes de mes collaborateurs du compte rendu.
Le Figaro, 4 septembre 1873
Lettre de Charles Gounod à Hippolyte de Villemessant, patron du Figaro, sur ses démêlés judiciaires à Londres.
Lien : Gallica
Londres, 1er septembre 1873.
Monsieur,
J’ai reçu, ces jours derniers, un grand nombre de lettres me demandant si je ne gémis pas sur la paille humide des cachots de Newgate
? Permettez-moi, pour répondre à cette marque de sollicitude des nombreuses personnes qui veulent bien s’intéresser à moi, de faire comme pour les convoie funèbres : Les personnes qui n’ont pas reçu de réponses sont priées de considérer la présente lettre comme une information et un remerciement.
Non, monsieur, je ne gémis, pas sur la paille humide des cachots de Newgate : je doute même que ce soit là le plancher qui m’attendait, si, comme j’en avais l’espoir, on m’eût conduit en prison et si je n’y suis pas, je vous jure que ce n’est pas de ma faute.
Voici mon histoire :
Je me suis permis, en répondant à d’injurieuses attaques, d’exposer comment j’avais eu lieu de trouver peu délicate la conduite d’un éditeur anglais à mon égard. Les termes dont je me suis servi, et qui étaient la traduction anglaise de mots français qui n’avaient en eux-même rien de diffamatoire, ont été considérés par mon adversaire comme calomnieux.
Il s’en est suivi un procès dans lequel, pour le dire en passant, MM. les avocats anglais se sont livrés à des facéties étymologiques qui m’ont donné la plus pitoyable opinion de leurs connaissances en latin. Ainsi, à propos du mot mulcted dont il est facile de deviner par son orthographe même la véritable origine mulcta (amende, peine, diminution, indemnité, impôt), ces messieurs ont été chercher le mot anglais milk qui signifie lait ! Ô Cendres de Lhomond ! n’avez-vous pas frémi ?… Mais passons.
J’arrive au tribunal. On m’interroge ; c’est-à-dire qu’on m’adresse deux ou trois questions, sans écouter mes réponses et mes explications, non plus que celles de mon témoin… et là-dessus on bâcle ma condamnation à 3.000 francs d’amende, après m’avoir demandé de faire des excuses que je garde, bien entendu. Je proteste, et déclare que je ne paierai rien.
Au bout de quinze jours, citation à comparaître devant le juge (chief justice) pour payer ou me rendre en prison. Je comparais. Interrogatoire.
Le juge. — Vous êtes M. Charles Gounod ?
— Oui, monsieur.
— Êtes-vous en état de payer la somme à laquelle vous êtes condamné ?
— Oui, monsieur.
— Êtes-vous disposé à la payer ?
— Non, monsieur.
— Pourquoi ?
— Parce que je me trouve condamné injustement, mes explications n’ayant pas été entendues.
— Vous préférez donc aller en prison ?
— Oui, monsieur.
— Cependant, réfléchissez ! une misérable somme de 3.000 francs !
— Monsieur, il ne s’agit point de la somme, mais de la justice : je ne payerai pas plus un centime que je ne payerais un million, si ce centime m’est demandé injustement.
— Mais, je ne puis pas changer la sentence ; je suis obligé d’appliquer la loi !
— Monsieur, je n’attends pas autre chose.
— Tout ce que je peux faire pour vous, c’est de vous accorder un délai de quinze jours pour vous raviser.
— Monsieur, je suis extrêmement touché de l’intérêt personnel que vous me témoignez ; mais le droit ne se ravise pas, et je doute que ma conviction, âgée de 55 ans, change en quinze jours.
Le juge s’est alors adressé aux clercs de l’avoué de mon adversaire, et, après avoir exprimé que jamais de sa vie il n’avait signé un arrêt qui lui fût plus désagréable, il a ajouté :
— Vous le voyez, M. Gounod est absolument déterminé, et je ne vois pas quel bénéfice la partie, adverse trouvera à le faire emprisonner.
Et maintenant, comme d’habitude, je travaille. Voilà où j’en suis, monsieur. Pardon de cette longue lettre, et merci d’avance de la publicité que vous voudrez bien lui donner.
Recevez, je vous prie, l’assurance de ma considération distinguée.
Ch. Gounod.
Extrait de la Soirée théâtrale, par un monsieur de l’orchestre
.
Inauguration de la nouvelle Gaîté.
La voilà faite enfin, cette réouverture si impatiemment attendue et qu’une indisposition du nouveau directeur de la Gaîté a retardée d’une huitaine de jours ! Froufrou, prétendant que son vrai public des premières, son public à lui, vagabonde encore aux bords de la mer ou à travers bois à la recherche d’un lièvre accommodant, Froufrou s’en est rapporté à moi pour le compte rendu des petits côtés de la représentation. Et Froufrou a eu tort, car le spectacle de la salle a été aussi intéressant que possible.
Jamais, de mémoire de buraliste, les places n’ont été aussi recherchées en cette saison que celles de cette première à sensation. On a payé, dans la matinée d’hier, des fauteuils d’orchestre jusqu’à cent-cinquante francs. Des gommeux, que je pourrais nommer, sont revenus de Trouville tout exprès pour cette représentation ils repartiront demain. Bon voyage !
Et pourtant la véritable inauguration de la nouvelle Gaîté ne se fera que par la grande œuvre de Gounod, car c’est par la musique plutôt que par le mélodrame que la direction Offenbach compte se distinguer.
Voici, aussi fidèlement que possible, les noms des privilégiés de cette première soirée :
Dans les loges Madame Offenbach et M. Comte occupent la grande avant-scène de gauche. Çà et là nous remarquons MM. le préfet Léon Renault avec M. Patinot, le prince Troubetzkoï, d’Ennery, comte Duchâtel, comte Welles de la Valette, Henri Rivière, Lambert de Sainte-Croix, Robert et Gaston Mitchell ; puis, mesdames Schneider, Thérésa, Jeanne Bernhardt ; les Variétés sont représentées par M. Bertrand et sa famille et par Dupuis.
À l’orchestre et au balcon, MM. Arsène Houssaye, comte Camondo, Mario Uchard, Bischoffsheim, Hector Crémieux, Arthur Meyer, Narey, Pertuiset, Peragallo, Duquesnel, Moreau-Sainti, Jules Moinaux, Cantin, Costé, Delpit, Grévin, Darcier, Goupil, Montépin, Laferrière, Meilhac et Halévy. Mesdames H. Neveux, Valtesse, Buisseret, Grivot, Grandet, et mesdemoiselles Périga, Rosine Bloch, et Magnier dans une délicieuse toilette bleu et paille.
Dans une avant-scène de droite nous trouvons M. Barrière, l’heureux auteur, et sa fidèle collaboratrice madame de Prébois.
Je ne sais si le résultat de la soirée contribuera à rapprocher les deux auteurs du Gascon ; mais ce qui est certain, c’est qu’au théâtre on les appela les collaborateurs-ennemis. Quelle est l’origine de l’inimitié qui règne entre Barrière et Poupart-Davyl, entre Poupart-Davyl et Barrière ? Mes informations à cet égard ne sont pas assez précises pour que je puisse m’en servir. Mais ceux qui ont assisté aux répétitions ont pu voir les deux auteurs, faisant répéter leur ouvrage, à respectable distance l’un de l’autre, Barrière trouvant mauvais les gestes et les intonations qui semblaient plaire à Davyl, et celui-ci restant coi, comme il convient à un auteur novice devant l’auteur acclamé d’une quantité d’œuvres remarquables.
À l’encontre des collaborateurs connus, Meilhac et Halévy, Chivot et Duru, qu’on ne voit pas l’un sans l’autre, Barrière, en dehors des répétitions, s’en allait bien loin aussitôt qu’il apercevait Davyl, et Davyl s’esquivait le plus prudemment possible quand Barrière montrait le bout de ses moustaches. Je me demande si ces sentiments de haine divisant deux collaborateurs ne facilitent pas singulièrement leurs travaux, surtout lorsqu’il s’agit de mettre en scène deux rivaux quelconques. Il suffit alors de se donner la réplique.
M. Offenbach, qui connaît sur le bout des doigts son public parisien sceptique et blasé, lui a ménagé une série de surprises dignes d’être notées.
Première surprise. — La salle, autrefois triste et sombre, est toute ruisselante de lumières et de dorures. Le Figaro a du reste raconté hier les améliorations matérielles. Je passe.
Deuxième surprise. — Généralement les drames, les féeries et autres grandes machines commencent vers les neuf heures et demie, après de nombreuses marques d’impatience manifestées par le parterre sur l’air des Lampions. Le Gascon, annoncé pour sept heures et demie, a commencé à sept heures et demie tant pis pour les retardataires !
Troisième surprise. — L’orchestre n’est plus un vulgaire orchestre de mélodrame avec un cornet à piston poussif qui a de la peina à suivre la clarinette. Ah ! mais non, il est tout bonnement excellent — cet orchestre. L’ouverture seulement a paru un peu longue. Mais cela se tassera comme on dit au théâtre.
Quatrième surprise. — Paul Meurice était en habit noir !
Cinquième surprise. — Plus de voyous au poulailler. On attendait, suivant l’usage, les manifestations de haut goût dont ces messieurs ont coutume de régaler nos oreilles. Point. Pas le plus petit chahut, aucuns miaulements, le cri du coq n’est même pas imité, et les messieurs chauves ne sentent pas leur crâne désagréablement chatouillé par la pluie classique d’écorces d’orange.
On aperçoit bien des blouses là haut mais elles sont aussi correctes que des habits de notaires.
Une seule interruption a eu lieu au deuxième acte, et elle est partie des premières loges !
C’est le renversement des renversements.
Sixième et dernière surprise. — Lafontaine [qui tient le rôle titre du Gascon] s’est révélé chanteur ! On l’a beaucoup applaudi dans sa chanson béarnaise.
— Et pourtant, a dit quelqu’un, ce n’est qu’un filet de voix qui coule de Lafontaine !
La Liberté, 4 septembre 1873
Extrait de la rubrique des Théâtres, par Jennius (pseudonyme de Victorin de Joncières).
Lien : Gallica
Très brillante réouverture du théâtre de la Gaîté. Dans la salle, éblouissante de lumières et de dorures, un vrai public de première, comme en plein hiver. Dans l’avant-scène de gauche se tient, fort ému, le maestro Offenbach, entouré de sa famille. Nous remarquons au premier étage le prince Troubetzkoï, MM. d’Ennery, Lambert de Sainte-Croix, le préfet de police, Duquesnel, Arthur Meyer, Costé ; à l’orchestre, Mario Uchard, Arsène Houssaye, Meilhac, Halévy, Hector Crémieux, Goupil, de Montépin, Paul Meurice, Héreau. Dans l’avant-scène de droite, divisée en deux loges, Mlles Schneider et Bernhardt cadette. Cette dernière porte un chapeau constellé de diamants. Sa sœur Sarah est modestement au balcon, dans une toilette pleine de simplicité. Thérésa occupe une baignoire d’avant-scène ; mais elle n’est pas assez dissimulée pour se dérober aux ovations des titis du poulailler, qui l’acclament. Dumaine aussi est interpellé par ces joyeux spectateurs ; l’un d’eux salue son entrée de ces mots, applaudis à outrance par ses camarades :
— Bonjour, gros joufflu !
Enfin, le rideau se lève à sept heures et demie précises, comme l’indique l’affiche, et la nouvelle pièce de MM. Barrière et Davyl commence.
Nous n’avons pas à faire ici l’analyse du Gascon ; mais nous croyons pouvoir dire, sans empiéter sur les droits de la Revue dramatique, que l’ouvrage a réussi. La mise en scène est superbe. Il y a surtout un décor, représentant les fossés du château de la reine Marie Stuart par une nuit d’hiver, d’un très grand effet. Le ballet des Écossais est splendide.
Quant aux artistes, notre confrère Laforêt vous dira dimanche comment ils se sont acquittés de leur tâche.
Signalons cependant le succès très mérité qu’a obtenu Lafontaine comme chanteur ; un bis unanime a accueilli sa chanson béarnaise, qu’il a redite avec une émotion qui prêtait à sa voix un charme de plus. La musique est de Jacques Offenbach ; elle est charmante. Cette chanson est dans la manière de celle de Fortunio. C’est l’éditeur Choudens qui doit la publier très prochainement.
La soirée s’est terminée à une heure du matin, au milieu de la satisfaction générale.
Le Figaro, 9 septembre 1873
Nouvelle lettre de Charles Gounod à Hippolyte de Villemessant, patron du Figaro.
Lien : Gallica
Londres, 6 septembre 1873.
Monsieur,
Voulez-vous me permettre de compléter aujourd’hui les informations que je vous adressais dans ma lettre en date du 1er de ce mois, touchant ma soi-disant captivité entre les murs des prisons de Newgate.
Ainsi que je vous le disais, un délai de quinze jours pour opter entre l’amende et la prison m’avait été offert par le magistrat. Ce délai, qui courait du 29 juillet, expirait le 12 août. À partir de cette époque, j’attendais de jour en jour l’ordre de me rendre en prison ; mais je n’entendis plus parler de rien. Enfin le jeudi 28 août, voulant savoir à quoi m’en tenir, j’écrivis au Solicitor de mon adversaire. Ne recevant pas de réponse, je me décidai à vous adresser ma lettre en date du lundi 1er septembre, et le lendemain mardi 2, je reçus du Solicitor la lettre suivante :
Monsieur, nous, avons l’honneur de vous informer que notre client, M. Littleton, ayant été intégralement payé de l’amende à laquelle le tribunal vous avait condamné, nous sommes relevés de la pénible obligation de continuer nos poursuites contre vous.
Je tiens à protester contre cette réponse. Ayant déclaré moi-même, formellement et publiquement, par écrit, que je ne me soumettrais pas à une condamnation injuste et que je préférais la prison à l’acceptation d’un jugement inique, il est évident que personne au monde n’a pu s’arroger le droit de payer contre mon aveu et de donner un démenti à ma conscience.
Je déclare donc que, le Solicitor ayant refusé de faire connaître le nom et l’adresse du soi-disant payeur, et ayant dit qu’il ne les connaissait pas, je ne croirai pas un mot de la lettre qu’il m’a adressée, à moins que la personne qui se serait permis d’agir ainsi contre ma décision, ne se fasse connaître.
Ce que j’ai tout lieu et toute raison de croire jusqu’à nouvel ordre, c’est que mon adversaire n’a pas osé consommer son odieux projet en me faisant incarcérer, et qu’il a compris tout le scandale qui en rejaillirait sur lui et qui eût été ma meilleure vengeance.
Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Ch. Gounod.
P.-S. Je vous serai obligé de vouloir bien donner la publicité à cette lettre le plus prochainement possible.
Le Ménestrel, 14 septembre 1873
Les abonnés à la musique de chant reçoivent avec le présent numéro la nouvelle mélodie de Ferdinand Gumbert, intitulée : Ta mère, paroles de Jules Barbier.
Lien : Gallica
Le Figaro, 19 septembre 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Gustave Lafargue.
Lien : Gallica
Notre voisin et ami le Monsieur de l’orchestre annonce que M. Strackosch a obtenu de la famille Meyerbeer l’autorisation d’enlever le Pardon de Ploërmel au théâtre de l’Opéra-Comique et de le transporter aux Italiens.
Il est possible que les héritiers du grand maître aient donné l’autorisation en question au directeur du Théâtre-Italien. Mais reste à savoir si cette autorisation peut amener un résultat, et nous ne le croyons pas, avant que l’auteur du poème ait fait connaître sa volonté à son tour.
Or, nous pouvons certifier qu’il y a trois jours, M. Jules Barbier s’est entendu avec MM. de Leuven et du Locle pour la reprise du Pardon de Ploërmel, avec madame Carvalho, dans les premiers mois de l’année prochaine.
Le Ménestrel, 21 septembre 1873
Extrait des Nouvelles diverses, par Jacques-Léopold Heugel.
Lien : Gallica
La nouvelle partition à laquelle travaille en ce moment l’auteur de Mignon et d’Hamlet est celle de Francesca di Rimini, poème de M. Jules Barnier et Michel Carré. Bien qu’assez avancée, cette grande œuvre ne sera certainement pas prête pour l’hiver 1874.
Le Figaro, 23 septembre 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Gustave Lafargue.
Lien : Gallica
Une grosse indiscrétion : M. Barbier a lu samedi soir, à madame Adelina Patti, Paul et Virginie.
La jeune marquise a été très émue en entendant ce drame lyrique, dont la musique est de Victor Massé.
Et… l’hiver prochain, Paul et Virginie pourrait bien être l’opéra d’ouverture de la saison italienne, avec Adelina Patti et Capoul.
Le Monde illustré, 27 septembre 1873
Extrait de la Chronique musicale, par Albert de Lasalle.
Lien : Gallica
À l’Opéra, on répète la Jeanne d’Arc de M. Mermet.
Le Figaro, 3 octobre 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Gustave Lafargue.
Lien : Gallica
Les vingt-cinq premières représentations du Gascon ont produit, au théâtre de la Gaîté une somme totale de 131.781 francs, ce qui fait une moyenne de 5.271 fr. 24 c. par représentation.
Le Gascon est d’ailleurs merveilleusement monté décors, costumes, ballet, musique, tout y rivalise de luxe et d’entrain, tout y témoigne un goût artistique des plus élevés. Jamais drame ne fut encadré d’une telle mise en scène. Lafontaine y est admirable comme comédien et même comme chanteur. — Chaque soir, il se fait bisser la délicieuse ballade béarnaise d’Offenbach.
Le Gascon ira facilement à sa centième représentation et donnera plus que le temps nécessaire pour monter la Jeanne d’Arc de Barbier et Gounod, au sujet de laquelle on nous promet de véritables merveilles.
La mère de Rachel, madame Esther Félix, qu’on a enterrée avant-hier a été la plus heureuse des mères. Jamais ses filles, même au plus fort des entraînements de la jeunesse et de la vie artistique, n’ont négligé un seul jour leurs devoirs envers elle.
C’était une personne sensée sans être aucunement brillante et qui pouvait, sans se troubler, répondre aux compliments qu’on lui adressait, sur l’enfant sublime qu’elle avait mise au monde.
La duchesse de Kent lui fit un jour la grâce de lui dire en lui montrant la reine d’Angleterre :
— On est heureuse, n’est-ce pas, d’avoir une telle fille.
Mais les yeux de madame Félix contemplant la charmante créature qui avait nom Rachel, répondit tranquillement :
— Pardon, madame la duchesse, je croyais que vous parliez de Rachel.
Les enfants qui lui restaient, mesdames Sarah, la fée, Lia et Dinah, appelée en famille Mélichon, entouraient sa vieillesse de soins, mais madame Félix avait été frappée trop cruellement dans ses affections maternelles pour pouvoir triompher d’une tristesse trop légitime.
Ses petits enfants, les fils de mademoiselle Rachel, dont l’un, le comte Walewski est consul, marié à la charmante mademoiselle Sala et père de famille, et l’autre Gabriel Félix, officier de marine, avaient pour leur aïeule les sentiments les plus respectueux.
Le Ménestrel, 12 octobre 1873
Extrait de la Semaine théâtrale.
Lien : Gallica
Nouvelles. — Les répétitions de la Jeanne d’Arc de l’Opéra se poursuivent avec une grande activité ; celles de la Jeanne d’Arc de la Gaîté sont comme terminées au point de vue dramatique. L’étude lyrique avance beaucoup et l’on espère que la musique de Charles Gounod pourra, sous peu de jours, être complètement reliée au poème de M. Jules Barbier. À l’Opéra-Comique, le Florentin s’annonce sous les meilleures auspices et devancera les deux Jeanne d’Arc de MM. Mermet et Jules Barbier.
Extrait des Nouvelles diverses.
Étranger. — On nous écrit de Londres qu’à l’heureuse issue d’une assez grave indisposition, le grand compositeur Charles Gounod à dû se rendre aux bains de mer sur l’ordonnance des médecins. M. et Mme Weldon y ont accompagné l’illustre convalescent.
Charles Gounod, l’auteur de la musique de la Jeanne d’Arc de Jules Barbier, a introduit, dans le ballet de cette tragédie lyrique le curieux fragment d’une symphonie de sa composition exécutée et publiée à Londres, sous le titre : Marche funèbre d’une marionnette.
À propos de ses publications, le maestro Gounod nous fait savoir que son éditeur anglais est M. Goddard, et qu’il ne fait aucune transaction par l’intermédiaire de M. Stefan Polès.
L’orchestre du théâtre de la Gaîté devant chaque jour s’améliorer et prendre de l’importance, M. Offenbach et son chef d’orchestre, M. A. Vizentini, ont décidé que toute place vacante serait dorénavant mise au concours. Mardi 14 octobre, à 10 heures du matin, aura lieu le premier concours pour des places de 1er et 2e violon. Se faire inscrire à l’avance.
Le Figaro, 15 octobre 1873
Extrait de la Soirée théâtrale, par un monsieur de l’orchestre
.
Lien : Gallica
Le Gascon fait toujours d’excellentes recettes, ce qui n’empêche pas qu’on répète avec zèle la Jeanne d’Arc, de Jules Barbier et de Gounod.
Au foyer, on me racontait que Barbier n’étant pas venu hier à la répétition, Offenbach s’est écrié :
— Cela ne m’étonne pas, il aura eu peur de la pluie. Il est si grand qu’il est toujours mouillé dix minutes avant les autres !
Le Ménestrel, 19 octobre 1873
Extrait de la Semaine théâtrale.
Lien : Gallica
Depuis quelques jours, la Gaîté est tout entière aux études et aux préparatifs de la Jeanne d’Arc de MM. Jules Barbier et Gounod. Voici la distribution complète et définitive de l’ouvrage :
- La Hire : Clément Just ;
- de Thouars : Desrieux ;
- Jacques d’Arc : Antonin ;
- Thibaut : Reynald ;
- Dunois : W. Stuart ;
- le roi : Angelo ;
- Warwick : Gravier ;
- Loiseleur : Scipion ;
- Xaintrailles : Gaspard ;
- Jean d’Estivet : Ucherard ;
- Richard : Mallet ;
- Jean d’Aulon : Damourette ;
- Siward : Galli ;
- Manchon : Colleville ;
- Maître, Jean : Henri ;
- Gordon : Vizentini ;
- Brown : Chevalier ;
- Pierrelot : Alexandre fils ;
- le bailli : Hénicle ;
- Laurent Guesdon : Jeannin ;
- le comte de Vendôme : Vaudegent ;
- Jeanne d’Arc : Lia Félix ;
- Agnès Sorel : Tessandier ;
- Loys : Perret ;
- Isabelle : Jeault ;
- Mengette : Julia H. ;
- Perrine : Durieu ;
- sainte Catherine : Mesle ;
- Mme de Gaucourt : Davenay ;
- Mme de Trèves : Sylvana ;
- sainte Marguerite : Briart.
Extrait des Nouvelles diverses.
4.104 francs, voilà le total des droits d’auteurs des premières représentations de l’Hamlet de MM. Ambroise Thomas, Jules Barbier et Michel Carré au Théâtre impérial de Vienne.
Le Figaro, 23 octobre 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Gustave Lafargue.
Lien : Gallica
Le théâtre de la Gaîté prépare activement la Jeanne d’Arc de Barbier et Gounod. Sur ce sujet éminemment national, M. Jules Barbier a écrit un drame superbe, en vers. La corde patriotique y est mise sans cesse en vibration ; la foi, l’amour de la patrie, le respect de la famille, telles ont été les bases de cette œuvre qui retrace à larges traits la vie héroïque de Jeanne d’Arc. De Domrémy à Rouen, elle passe par Chinon, Orléans, Reims, glorieuses étapes dont le souvenir seul fait battre les cœurs.
Madame Lia Félix sera, dit-on, splendide dans le rôle de Jeanne. Depuis son illustre sœur Rachel, jamais l’art dramatique ne se sera élevé à une telle puissance.
On sait que M. Charles Gounod a écrit pour ce drame une vraie partition qui paraît-il, peut être placée entre Faust et Roméo. Elle se compose de plusieurs morceaux de chant soli, de dix chœurs, de la marche du sacre, et d’une marche funèbre d’un effet irrésistible.
Bref, cent choristes et soixante musiciens ; un grand orgue de la maison Cavaillé-Coll qui accompagnera chaque apparition des saintes ; sept-cents costumes qu’on dit être des merveilles d’exactitude historique ; une mise en scène surprenante ; sept grands décors dus aux pinceaux de MM. Cambon, Chéret et Fromont ; un ingénieux divertissement dans lequel, se souvenant que sous les murs d’Orléans les soldats français avaient parodié la mort de l’Anglais Salisbury, Gounod a intercalé un de ses délicieux fragments symphoniques intitulé la Mort d’une marionnette concourent à faire de la Jeanne d’Arc, à la Gaîté, un événement artistique de la plus haute importance.
La République française, 24 octobre 1873
Extrait de la Revue des sciences historiques, en feuilleton, contenant quelques propos irrévérencieux envers Jeanne d’Arc.
Lien : Retronews
Marguerite Marie [Alacoque] est bien plus sympathique que ce pauvre garçon enjuponné qui a nom Jeanne Darc ; l’ironie de Voltaire a pour tous les siècles détruit le prestige de la Pucelle. L’héroïne équivoque du drapeau blanc relève bien de la science d’un chef de clinique de Sainte-Anne.
Le Ménestrel, 26 octobre 1873
Extrait de la Semaine théâtrale, par Arthur Pougin.
Lien : Gallica
Les études de la Jeanne d’Arc de l’Opéra marchent à la satisfaction générale. On espère pouvoir répéter prochainement en scène ; mais personne n’ignore quels soins doivent être apportés à l’enfantement d’une œuvre de cette importance sur notre première scène lyrique. N’espérons donc pas la représentation immédiate de la Jeanne d’Arc de M. Mermet. — Celle de M. Jules Barbier, au contraire, avec musique de M. Gounod, est déjà presque prête à être offerte au public. Les premières répétitions à orchestre ont eu lieu cette semaine, et le théâtre se prépare à faire les relâches nécessités par les grandes répétitions générales. On pense que la représentation pourra avoir lieu dans le cours de la première semaine de novembre. Il va sans dire que Mlle Lia Félix n’y fera point concurrence à Mlle Fidès Devriès au point de vue chantant. Son rôle n’a rien absolument de musical. Mais elle s’y montrera, dit-on, la digne sœur de Rachel.
Le Charivari, 28 octobre 1873
Extrait de la Chronique du jour, de Paul Parfait.
Lien : Gallica
On répète à la Gaîté la Jeanne d’Arc de M. Barbier, musique de Gounod.
Mlle Lia Félix, à ce que disent les nouvellistes de théâtre, répète le rôle de la Pucelle en costume
afin de se mieux pénétrer de l’esprit du rôle.
Mais ce n’est point là le fait grave des répétitions. Le fait grave, c’est la couleur du drapeau qu’il va falloir mettre entre les mains de Jeanne d’Arc.
En effet M. de Chambord a solennellement déclaré, à plusieurs reprises, que son drapeau était celui de Jeanne d’Arc.
Or, d’après MM. Brun et Chesnelong, M. de Chambord accepterait maintenant le drapeau tricolore.
Faut-il donc mettre entre les mains de Jeanne d’Arc un drapeau tricolore ?
Logiquement, oui.
À moins que les deux messagers aient mal compris.
Mais ça, ce n’est pas possible !
L’Illustration, 1er novembre 1873
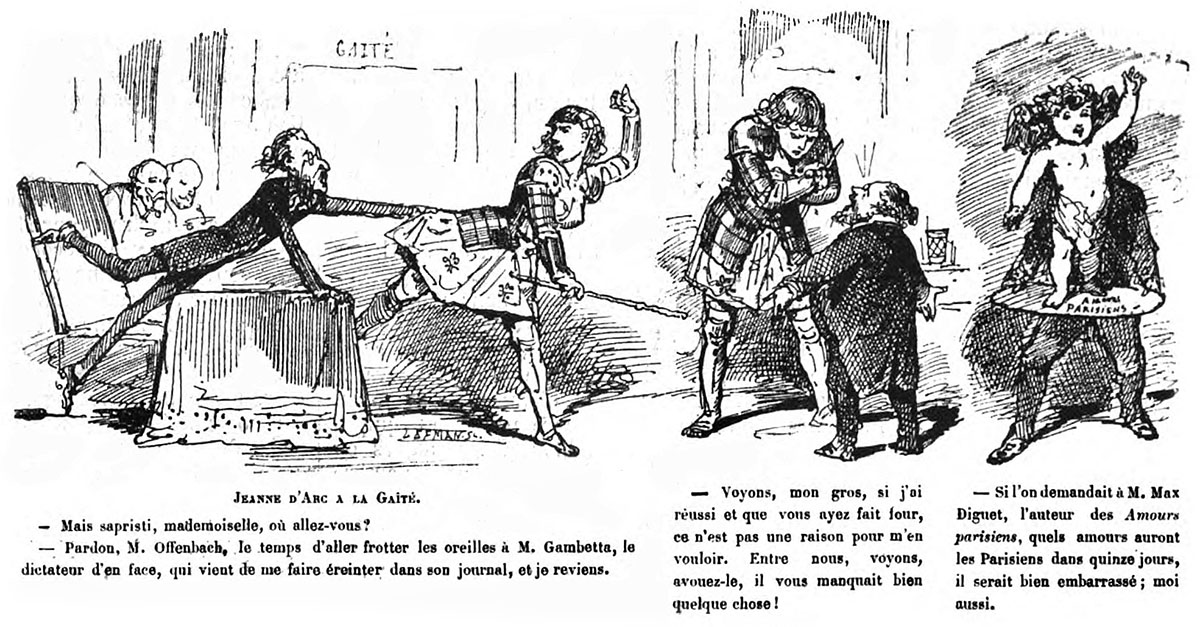
[Transcription :]
— Mais sapristi, mademoiselle, où allez-vous ?
— Pardon, M. Offenbach, le temps d’aller frotter les oreilles à M. Gambetta, le dictateur d’en face, qui vient de me faire éreinter dans son journal, et je reviens.
[Une référence au feuilleton outrancier du 24 octobre de la République française, journal de Gambetta dont le siège se trouvait rue du Croissant, à quelques pâtés de maisons du théâtre de la Gaîté, rue Papin. Lire l’extrait.]
— Voyons, mon gros, si j’ai réussi et que vous ayez fait four, ce n’est pas une raison pour m’en vouloir. Entre nous, voyons, avouez-le, il vous manquait bien quelque chose !
— Si l’on demandait à M. Max Diguet, l’auteur des Amours parisiens, quels amours auront les Parisiens dans quinze jours, il serait bien embarrassé ; moi aussi.
La Liberté, 3 novembre 1873
Extrait de la rubrique des Théâtres, par Jennius (pseudonyme de Victorin de Joncières).
Lien : Retronews
Le théâtre de la Gaîté donnera, jeudi prochain, la première représentation de Jeanne d’Arc, de M. Jules Barbier. Ce beau drame, pour lequel Gounod a écrit une véritable partition, sera, sans conteste, le plus grand événement artistique de cet hiver.
On dit merveille de Mlle Lia Félix, qui aurait trouvé dans le rôle de Jeanne sa meilleure création.
La mise en scène que prépare la direction sera splendide.
Citons seulement les 750 costumes dessinés par Thomas ; les armures martelées par Grangé et Klein ; 100 choristes qui chanteront les magnifiques chœurs de Gounod ; un orchestre de 70 musiciens conduits par Albert Vizentini.
De plus, un grand orgue été installé au fond du théâtre ; il accompagnera une magnifique prière et l’extase de Jeanne d’Arc. Enfin, huit grands décors :
- la Chaumière de Jeanne d’Arc, l’Appartement d’Agnès Sorel, le Camp français, peints par Fromont ;
- une Vue de Reims, le Portail de la cathédrale, par Cambon ;
- la Prison, le Bûcher et la Vision céleste, par Chéret.
Au troisième acte, il y aura un divertissement des plus originaux, dans lequel Gounod a intercalé sa musique amusante des Funérailles d’une marionnette.
La marche funèbre sera exécutée entre le 6e et le 7e tableau. C’est, paraît-il, une des plus belles pages instrumentales que Gounod ait écrites.
Le Figaro, 6 novembre 1873
Extrait des Échos de Paris, par le Masque de fer (pseudonyme de Philippe Gille).
Lien : Gallica
À propos de la prochaine représentation de la Jeanne d’Arc, de Gounod et Barbier, au théâtre d’Offenbach, un critique musical regrette avec candeur qu’un sujet national comme celui-là n’ait pas fourni plus de tragédies, de drames et d’opéras
.
Ô cher et attendri confrère, cessez de regretter. Je puis vous affirmer qu’il existe plus de soixante œuvres dramatiques importantes dont Jeanne d’Arc a fourni le sujet, sans compter le Mystère du siège d’Orléans, déchiffré et publié en 1862 (d’après le manuscrit unique conservé à la bibliothèque du Vatican), par MM. Guessard et Eugène de Certain.
Ajoutons que ce dernier drame, qui ne contient pas moins de 20.529 vers, était joué par 143 acteurs, sans compter les figurants et a été écrit dans les dix années qui ont suivi la mort de la Pucelle. Son auteur ou ses auteurs a ou ont, suivant toutes probabilités, vu Jeanne d’Arc et assisté au siège d’Orléans.
Pas de démenti, je donnerais la liste des soixante et quelques tragédies ; pas de défi, je les reproduirais toutes in extenso !
Le Ménestrel, 9 novembre 1873
Extrait de la Semaine théâtrale, par Joseph-Hippolyte L’Henry.
Lien : Gallica
Répétition générale de Jeanne d’Arc à la Gaîté.
M. Jules Barbier n’est pas seulement le meilleur librettiste que nous possédions, depuis la mort de Scribe, c’est un esprit cultivé, un fin lettré, qui est entré dans la carrière par une bonne traduction en vers français des satires de Perse, que peu de personnes peut-être connaissent aujourd’hui. De plus, M. Barbier s’est fait connaître au théâtre par un certain nombre d’ouvrages d’une valeur littéraire réelle, et qui n’étaient point écrits en vue de la musique. Nous citerons entre autres les Contes d’Hoffmann à l’Odéon, Faust et Marguerite au Gymnase [l’auteur confond Faust et Marguerite (1869) du compositeur Frédéric Barbier, et l’opéra de Gounod Faust (1859) dont Jules Barbier a écrit le livret], sans compter diverses pièces données par lui à la Comédie-Française : le Poète, l’Ombre de Molière. Ceci soit dit pour bien préciser que M. Jules Barbier n’est pas seulement un bon librettiste — ce qui d’ailleurs est beaucoup moins facile qu’on ne le suppose généralement — mais que c’est aussi un auteur dramatique original et un écrivain de talent.
Il y a longtemps, je crois, que le drame de Jeanne d’Arc est écrit. Il est même imprimé depuis quelques années. Mais je pense que l’idée d’y joindre une partie musicale importante date de moins loin. On se rappelle sans doute que M. J. Barbier est l’auteur des paroles de la cantate donnée il y a deux ans aux concurrents de l’Institut, et qui a valu le pris de Rome à M. Serpette. Cette cantate avait justement pour sujet et pour titre : Jeanne d’Arc. C’était évidemment une heureuse idée que d’avoir choisi ce sujet à une époque où les récents malheurs de la patrie, en remplissant nos cœurs d’amertume, nous imposaient le devoir de rentrer sévèrement en nous-mêmes, et, par les souvenirs les plus poignants et les plus glorieux de notre histoire, de retrouver le courage, l’espoir et l’énergie nécessaires au relèvement de notre cher et infortuné pays.
C’est peut-être là ce qui a inspiré à M. Barbier l’idée de mêler la musique au drame dans sa Jeanne d’Arc, et d’en faire, non un drame lyrique, mais un drame musical. Ce genre de production dramatique, dont l’Allemagne nous offre de nombreux exemples, n’est pas non plus sans précédents chez nous, bien que le succès n’ait pas toujours paru couronner les efforts faits en ce sens. La tragédie de Timoléon, de Marie-Joseph Chénier, représentée à la Comédie-Française pendant la Révolution, était accompagnée d’un certain nombre de chœurs et de morceaux symphoniques de Méhul, qui écrivit aussi diverses pages d’un grand caractère pour un drame en vers, donné un peu plus tard à la Porte-Saint-Martin, les Hussites. Lors de la guerre de l’Indépendance hellénique, l’Odéon produisit un grand drame poétique d’Ozaneaux, le Siège de Missolonghi, pour lequel Hérold s’était chargé de composer une ouverture et trois chœurs importants. Enfin, on se rappelle bien que M. Gounod lui-même écrivit, au temps de ses débuts, pour une tragédie de Ponsard, Ulysse, une série de chœurs qui produisirent un très-grand effet, et plus tard, pour le drame très littéraire de M. Legouvé, les Deux Reines de France, représenté il y a deux ans à la salle Ventadour, une partition très-considérable, très fournie, et qui contenait des pages fort remarquables.
Ce n’est donc pas chose absolument nouvelle chez nous que cette alliance de la musique au drame, conçue de telle façon que l’un ne soit pas absorbé par l’autre, comme cela a lieu dans le drame lyrique proprement dit. Il faut malheureusement constater que cette alliance n’a jamais produit, au point de vue du succès, de résultats complètement satisfaisants. Je le regrette pour ma part, car c’est là un genre qui me plaît très-fort, et qui me semble digne des sympathies du public. Il est bien entendu qu’en parlant ainsi, je ne prétends pas préjuger des destinées qui attendent la Jeanne d’Arc de la Gaîté ; rien, d’ailleurs, ne me satisferait plus que le succès de ce drame très-littéraire, tout imprégné d’un souffle mâle et patriotique, et dans lequel abondent les beaux vers et les nobles pensées.
Nous n’avons pas à raconter ici le sujet de Jeanne d’Arc. Notre histoire nationale est assez connue de tous pour qu’un tel récit soit superflu. Le malheur est que, dans un sujet de ce genre, l’intrigue soit forcément absente, et que l’intérêt du spectateur soit forcément émoussé par la connaissance qu’il a du dénouement. D’une part, en effet, le personnage et les actions de Jeanne d’Arc doivent tout primer, et absorber complètement les forces vives du drame ; de l’autre, et en raison de cette primauté, il est impossible à l’écrivain de nouer, à côté et au-dessous du personnage principal, une intrigue qui ne saurait être que vulgaire, et qui n’aurait d’autre résultat que d’amoindrir le caractère fier, héroïque et national du sujet.
M. Jules Barbier s’est bien gardé de commettre une telle faute. Il a seulement essayé d’ébaucher, au premier acte, une sorte de petit roman amoureux entre Jeanne et l’un de ses compagnons d’enfance, le jeune Thibault, mais cela dans le seul but d’amener, dans une scène vraiment touchante, le récit des visions de Jeanne et de sa prédestination. C’est là le seul moment du drame où l’amour trouve sa place, et le caractère chaste et pudique de cet amour s’accorde on ne peut mieux avec les sentiments de notre immortelle héroïne.
Il y a d’ailleurs de fort belles scènes dans Jeanne d’Arc, et l’une des plus heureuses est précisément celle par laquelle s’ouvre le drame, et qui représente les paysans lorrains fuyant en caravane devant l’invasion — spectacle douloureux et terrible qu’il nous était donné de revoir, et qui, par ses souvenirs récents, rend plus douloureuse encore l’émotion éprouvée. Cette scène donne lieu à un chœur qui est l’une des pages les plus saisissantes de la nouvelle partition de M. Gounod : Nous fuyons la patrie. La scène de la vision est fort belle aussi, et d’un spectacle nouveau. L’un des épisodes les plus touchants est celui de la reconnaissance, lorsque le père et la mère de Jeanne viennent trouver à Reims leur fille, qui ne s’attendait point à les voir et qui fond en larmes à leur approche.
Le caractère le plus remarquable peut-être de l’œuvre de M. Barbier est dans les beaux vers qu’elle renferme, et dans les belles pensées qui y éclatent à chaque instant. Jeanne d’Arc, on peut le dire, est l’œuvre d’un poète, d’un patriote et d’un artiste inspiré. C’est là un drame bon, non-seulement à la vue, mais qu’on lira avec intérêt et avec émotion, et qui brille particulièrement par le style, par la couleur et par la puissance du souffle. Dans l’interprétation, il faut surtout tirer de pair Mme Lia Félix, qui s’est incarnée dans le rôle de Jeanne et en a fait une création superbe et pleine d’originalité. Tour à tour mélancolique et tendre, touchante et résignée, enthousiaste et héroïque, ardente et fière, elle a déployé dans ce rôle une souplesse de talent et une unité de conception singulièrement remarquables. La scène avec Thibault, celle de la vision, celles avec Agnès, avec La Hire, avec le roi ; lui ont valu de grands succès et les applaudissements enthousiastes du public. On ne saurait, en vérité, mieux personnifier Jeanne d’Arc, et la rendre plus noble, plus sympathique et plus touchante. Les autres rôles importants sont confiés à MM. Clément Just (La Hire), Angelo (le roi), Desrieux (de Thouars), et à Mlle Tessandier (Agnès Sorel). M. Clément Just et M. Desrieux sont excellents tous deux, mais M. Angelo manque essentiellement de tenue et de dignité. Quant à Mlle Tessandier, il vaut mieux assurément se taire sur son compte que d’appeler l’attention sur elle. Mais il n’est que juste d’adresser de sincères compliments à MM. Raynald et Stuart, chargés des rôles importants, quoique secondaires, de Thibault et de Dunois.
Parlons maintenant de la partition de Charles Gounod, qui ne contient pas, il le faut constater tout d’abord, d’épisode aussi considérable que la fameuse bataille des vins des Deux Reines de France. Parmi les pages les mieux réussies, on doit citer surtout l’introduction du premier acte, avec son mélancolique et joli chant de hautbois en écho, et le beau chœur en mi mineur, d’un caractère étrange et douloureux, dans lequel la phrase initiale : Nous fuyons la patrie ! revient avec insistance. Gounod nous a paru peut-être moins bien inspiré dans la scène de la vision et dans le chœur héroïque bissé du second acte : Dieu le veut ! qui est d’une allure martiale, mais d’un rythme vulgaire auquel les rentrées de trompettes et les coups de grosse caisse ne sauraient apporter de distinction. Nous passerons sous silence la ballade du jeune page Loys et son interprète, et nous signalerons, au troisième acte, les couplets de la ribaude : Rentrez, Anglais, dont le dessin mélodique est charmant et dont les contours sont d’une rare franchise. Dans le divertissement, qui pourrait bien être un des succès de la pièce, se trouve une partie comique on ne peut mieux réussie au point de vue scénique et musical, c’est la Marche funèbre pour l’enterrement d’une marionnette, qui a été si bien accueillie l’an passé en Angleterre. Cela est étrange, original et charmant. Enfin, il faut encore signaler la prière du troisième acte, qui est d’un beau caractère, le chœur féminin du quatrième, remarquable par sa douceur, la marche du sacre, et, par-dessus tout, la marche funèbre du dernier tableau. Ce sont là autant de pages bien inspirées, dans lesquelles on retrouve avec bonheur la main qui a signé déjà tant de belles œuvres, et sur lesquelles nous serons heureux de revenir après la première représentation.
Quant à la splendeur de la mise en scène de Jeanne d’Arc, à la richesse et à la vérité des décors et des costumes, nous renonçons à les décrire. Il faut cependant bien citer, d’une façon toute particulière, le tableau du siège d’Orléans, le décor et le cortège du Sacre, et enfin la scène finale du bûcher. La foule irait se presser à la Gaîté, rien que pour voir, contempler et admirer de telles merveilles, si le beau drame de M. Jules Barbier et la remarquable musique de son illustre collaborateur n’y suffisaient et au delà.
En ce qui se rapporte à cette dernière, on doit féliciter très-chaleureusement la direction de la Gaîté pour la splendeur de l’hospitalité offerte par elle à l’œuvre du maître, et pour les soins apportés à son exécution. Celle-ci était confiée à un jeune chef d’orchestre plein d’ardeur et d’enthousiasme, M. Albert Vizentini, qui ne mérite pas moins d’éloges, et qui n’a pas hésité à franchir le détroit pour aller prendre, à Londres même, les intentions et les conseils de l’auteur. Bref, on doit constater qu’en cette circonstance MM. Offenbach et Vizentini ont bien mérité du grand art, et que les amis de la musique leur doivent de la reconnaissance.
Le Figaro, 10 novembre 1873
La Soirée théâtrale, par un Monsieur de l’orchestre
.
Lien : Gallica
Jeanne d’Arc.
Silence au camp ! La vierge est prisonnière ;
Par un injuste arrêt Bedford croit la flétrir ;
Jeune encore, elle touche à son heure dernière…
Silence au camp ! La vierge va périr !
Ombre de Casimir ! Ô Schiller ! Ô Soumet !
À notre jugement la pièce qu’on soumet
Au fond du gouffre immense aux flamboyants cratères,
Doit faire tressaillir vos demeures dernières.
Quittez pour un instant vos éternels quartiers
Et venez avec nous vers les Arts et Métiers !
Silence au camp ! La vierge est prisonnière ;
Par un injuste arrêt Bedford croit la flétrir ;
Jeune encore, elle touche à son heure dernière…
Silence au camp ! La vierge va périr !
Trois jours ! trois jours, hélas ! sans repos et sans trêve !…
À peine l’Oncle Sam au boulevard s’achève,
Que, sans prendre le temps de boire ou de dormir,
Au passage Choiseul bien vite il faut courir ;
Dois-tu pas, chroniqueur, entendre la Quenouille
Où la diva Judic avec Peschard gazouille ?
Cela fait, tu voudrais t’arrêter, éreinté ;
Marche encore, maudit ! Cocher ! à la Gaîté !
[…]
Ils y sont tous ! Œil creux, teint pâli, face blême,
Le buste encore croit par un effort, suprême.
Tous ! Ceux, de la Quenouille et ceux de l’Oncle Sam,
Courageux rejetons des héros de Wagram,
Portant le frac austère ou la jaquette aisée,
Et, sous le gilet noir, la chemise empesée !
Caraguel des Débats, Monselet, fier lutteur,
Saint-Victor et Fournier, les chevaliers sans peur,
Lapommeraye, Hostein, Claretie et Banville,
Paul Foucher (et sa dame), et Venet, et Biéville,
Bénédict, Aubryet, luttant avec effort
Pour ne pas imiter ce bon Sarcey qui dort.
(Musique nouvelle de Charles Gounod.)
Doux séraphins, troupe bénie,
Du haut des cieux,
Doux séraphins, je vous en prie,
Veillez sur eux !
La salle est très brillante au balcon, à l’orchestre,
Les plus belles houris du paradis terrestre ;
Schneider dont les brillants jettent partout leurs feux,
Valtesse au chignon roux, Gauthier aux noirs cheveux,
Delphine de Lizy dont l’œil noir étincelle,
Drouard avec sa sœur, et Demay toujours belle.
Et puis la vieille garde, immuable, à son rang,
Qui, toujours au combat, ne meurt pas mais se rend.
Toutes elles sont là ce soir : ces demoiselles
Viennent voir Jeanne d’Arc — sujet nouveau pour elles.
(Musique nouvelle de Charles Gounod.)
Ô chasteté !
Douce innocence !
Sainte ignorance !
Ô pureté !
Dans les couloirs on cause, on parle politique :
On dit… On me raconte… Il paraît authentique…
Les ministres s’en vont… Monsieur Thiers va parler…
Il s’agit maintenant de ne pas reculer…
C’est lundi… C’est mardi… Non, la chose est remise…
Avancée, au contraire… À moins qu’on se dédise !
Plus loin on fait des mots, dans le clan des gommeux :
— Vous savez… ce cher X… on le dit amoureux
De la blonde Clara. — Allons donc, et Frisette ?
— Bah ! ça n’a duré plus longtemps que Polkette !
— On n’a jamais vu ça, ma parole d’honneur !
— Ce n’est pas étonnant, mon cher, il est changeur !
(Musique nouvelle de Charles Gounod.)
Mais silence,
On recommence,
À sa place il faut revenir.
L’entracte va finir
Silence au camp ! La vierge est prisonnière ;
Par un injuste arrêt Bedford croit la flétrir ;
Jeune encore, elle tombe à son heure dernière…
Silence au camp ! La vierge va périr !
Elle monte au bûcher ! Sur cette apothéose,
Halanzier, de sa stalle, jette un regard morose ;
Mermet étouffe un pleur et leurs yeux se croisant
Expriment leur angoisse en un pareil moment !
Le drame est palpitant, on sanglote, on se mouche,
Mais, ne l’oublions pas, c’est l’heure où l’on se couche ;
Le drame est terminé, mais on peut s’écrier :
Cela n’est pas rasant, bien qu’étant de Barbier !
(Musique nouvelle de Charles Gounod.)
La foule
Comme un torrent s’écoule !
Hosanna ! Hosanna !
Ô Jéhovah !
C’est fini ! l’on s’en va.
L’Événement, 10 novembre 1873
Article de la rubrique des Premières élégantes, par Grelot : éloge de la musique par Oscar Comettant.
Lien : Retronews
Jeanne d’Arc à la Gaîté. — Grand succès… pour Lia Félix ! Et pourtant, en allant voir cette poésie
de M. Barbier, avec musique de Gounod, chacun se promettait une bonne soirée. On comptait même beaucoup sur l’auteur de Faust ; il semblait que, dans ce sujet historique un peu usé, le librettiste avait dû tailler à l’auteur de Roméo des situations à sa taille. Il n’en est rien. À l’instar de Chapelain qui occupa innocemment son loisir
à souiller la réputation de l’héroïne jeune personne
d’Orléans, ainsi que l’ont fait Voltaire, Schiller, M. Paccini et mille autres ayant causé de grands dégâts à l’histoire, M. J. Barbier nous montre à son tour une Pucelle pleurnicharde et cléricale, follement éprise de son roy et de sa paroisse ! (On s’en offusquera dans le Loiret.)
Ça commence vers sept heures pour finir très avant dans la nuit. Le drame, en vers est plutôt un panorama qu’une pièce. Les tableaux s’y suivent sans trop de liaison ; les événements les plus gros se passent pendant les entractes. — Il est vrai que ceux-ci durent assez longtemps pour qu’il n’y ait pas trop d’invraisemblance… — D’autres vous feront avec autorité la critique de Jeanne d’Arc ; à cette heure, je dois me borner à procéder par grandes masses et à donner l’effet produit sur le public par chaque tableau :
Premier acte
Un peu long ! On est à Domrémy. On voit le père et la mère Romée et leur demoiselle
, qui rêve sous l’arbre des fées
et voit sainte Marguerite et sainte Catherine dans les nuages — deux jolies saintes fort bien coiffées toutes deux. L’orchestra murmure un air de délivrance… c’est la fin de l’acte.
Second acte
Nous voici à Chinon où se tient la cour de Charles VII — costumes moyen âge de pendules ! — Agnès Sorel, la maîtresse du roi (Mlle Tessandier), y règne et y reçoit Jeanne qui vient pour sauver le trône et l’autel
. Après un chœur patriotique ! moins beau que celui des soldats de Faust, c’est pour cela qu’on l’a bissé. Ce tableau finit par un appel aux armes.
Troisième acte
La tranchée sous Orléans. — Joli décor. — Grand succès pour le divertissement ; le besoin s’en faisait sentir. Figurez-vous au fond la bataille, les coups d’arquebuse et dans la tranchée l’enterrement d’une marionnette. Musique fine, originale, des airs à la Guignol, des pas mimés par de jolies danseuses ; tout cela bien réglé, bien compris. Le ballet des Ribaudes n’est autre que celui de la Nonne sanglante. Quand on a démoli à coups de fronde la grande marionnette en baudruche, Jeanne d’Arc survient au bruit des arquebusades ; elle ranime sa troupe amollie, l’électrise, s’agenouille comme Richet dans la Marseillaise, s’enveloppe d’un drapeau et récite des strophes où le roy, Dieu, Domrémy et l’Église reviennent à tout bout de champs. J’allais oublier de vous dire que le drapeau est bleu fleurdelisé. Il y a quelques jours, c’est-à-dire avant la lettre
, il était blanc, mais depuis on a dû le passer au bleu.
Lia Félix a eu là un immense succès. Elle est costumée à ravir et ressemble à cette statue fameuse de la princesse Marie, cheveux au vent, cotte de maille aux jambes, et tenant en main cette épée propre à donner de bonnes buffes et de bons torchons
.
Quatrième acte
Le sacre, à Reims, de Charles VII. — Décor qui, dit-on, a coûté 40.000 fr., mais il faut en rabattre. — Cérémonie à l’autel, marche guerrière (rien du Prophète), gens d’armes, moines, chants d’église, mouvement d’orgueil du roy et de sa Jeanne triomphant au milieu des acclamations. Il y avait là (sans la fameuse lettre), une allusion politique à sensation, mais on a heureusement passé au bleu l’étendard fleurdelisé, la tunique royale et… les cris. Seule, la reine est vêtue de blanc, avec un vaste manteau d’hermine qui n’en finit plus. Il s’est produit dans cette scène un effet comique sur lequel les auteurs auraient dû compter. Charles VII, après avoir exalté Jeanne, qu’il a placée sur le même rang que lui (pas dégoûté ! a crié un titi), lui offre tout ce qu’elle peut désirer, titres, honneurs, noblesse pour elle et les siens.
— Non, s’écrie l’héroïne émue, je demande au roy… que mon village soit grevé d’impôts ! ! !
Pour le patriotisme, voilà du patriotisme !
M. Magne en a souri.
Cinquième acte
Il a dû se passer énormément de choses dans l’entracte, car au relever du rideau on nous montre Jeanne garrottée, condamnée dans la prison de Rouen. Des groupes d’Anglais boivent et jurent sa mort : un prêtre est là pour la tromper. Un Anglais, le brutal Warwick, veut qu’elle ne monte pas pure sur le bûcher
. Elle, dans son hallucination, rêve de son roy, qu’elle aime, de son trône qu’elle a sauvé. Belle scène !
Au dernier tableau, nous voici devant le bûcher ; comme au cinquième acte de la Juive, même défilé, même cérémonial, j’allais dire même musique, car Gounod s’est inspiré de son maître Halévy dans la fameuse marche jouée d’abord à l’unisson et ensuite en sourdine par tout l’orchestre, avec accompagnements de tambours et éclats de trompettes… Quant au bûcher, malgré l’heure tardive, il a eu un succès bien mérité. Jeanne s’y élance la croix en main, elle est enveloppée de flammes et… elle ne brûle pas.
J’ai dit que le grand succès de la soirée est pour Lia Félix qui s’est surpassée et a été chaudement réclamée dans ce rôle de Jeanne d’Arc. Elle a su donner à la physionomie de la jeune personne d’Orléans
un caractère bien tranché. Elle est à la fois simple, fière et élevée. Dans les moments patriotiques qui abondent, elle n’a pas la force, la ligne (sans calembours), la beauté de sa grande sœur, mais elle en a la race et toute l’aristocratique distinction. Gounod disait — car le maître était là, rencogné dans une baignoire. — Lia rappelle Rachel d’une façon qui fait mal, non pas comme Rachel était au théâtre, mais telle qu’elle était chez elle quand elle recevait ses amis : mêmes gestes, mêmes mouvements, elle donne la main comme la donnait Rachel.
Paris a déjà vu trois étoiles dans ce rôle de Jeanne. Rachel, elle-même, malgré son génie, n’a pu soutenir la Jeanne d’Arc de Soumet. Mme Stoltz, dans le rôle d’Odette de Charles VI (Odette n’était qu’une Jeanne de convention), n’a pas encore été remplacée, et l’œuvre magistrale d’Halévy et Casimir Delavigne est d’un style plus élevé que le drame lyrique de Barbier et Gounod.
La 3e Jeanne d’Arc fut l’adorable Patti. Celle-là était Jeanne qui rit. Verdi, l’auteur de Giovanno d’Arco
, avait écrit un duo d’amour entre Charles VII et Jeanne qui avait révolutionné la Seine-Inférieure !
On se souvient de la Patti cuirassée, et de Mario (Carlo septimo), aux Italiens !
À notre avis, et d’après l’immense effet produit ce soir, Lia Félix, plus heureuse que ses illustres devancières, fera vivre cent jours la Jeanne d’Arc de la Gaîté.
En un mot, Jules Barbier n’a pas dépassé Casimir Delavigne, qui dans Charles VI s’était approché des grands maîtres classiques. La musique de Jeanne d’Arc est — sauf le ravissant ballet, — du petit Gounod… demandez plutôt à mon ami Chauvin.
La salle était resplendissante ; aux belles loges Mmes Waleska, de Sesto, Beulé, Bizet, Perrin, Halévy, de Poilly. On remarquait, à son panache blanc, une minaudière princesse russe, Mme de T…oi, surnommée la Célimène politique — toujours compromise, jamais perdue, la comtesse de Lavalette, en mousseline blanche, décolletée, avec un papillon de diamants et un collier de velours bleu au cou, attirait tous las regards ; Mmes André, de Marval, Joncières, Whürer, Mitchel, Comte, Laurent, etc. MM. A. Dumas, Alphand O’Connel, Pernetti, Lavertujon, Strauss, Abraham, Lambertye, Barrière.
Le public des troisièmes galeries a sifflé le joli ballet et applaudi les chœurs d’orphéon dont on attribuait tout bas la paternité à… d’autres que Gounod.
Dans les couloirs et à l’orchestre, cohue comme aux grands jours ; tous les dilettanti, l’état-major des oreillards (on sait que les musiciens ont de vastes oreilles), de là le surnom donné à Ambroise Thomas, V. Massé, Bizet, Paladilhe, Mermet, Diaz, Faure, Roger, de Polignac, Détroyat, Halanzier, Cabanel, Dubufe, Detaille, Franceschi, Jules Cohen (qui nous prépare une surprise).
Gounod a paru fort heureux de retrouver son public de Paris. Il a dit à un mien ami qui lui reprochait sa longue absence : Le musique est, comme la dévotion, un refuge pour les grandes âmes.
Il a annoncé que son Polyeucte était terminé et qu’il avait une voix d’ange, une voix d’ange, une voix blanche pour sa Pauline…
Descendons aux baignoires où, comme les violettes trahies par leur doux parfum se cachaient la duchesse de Newcastle, le capitaine et Madame Waldon. Celle-ci ornée de lunettes vertes, Mme de Girardin, le duc de Montpensier, de Saxe-Cobeurg et Paul de Saint-Victor…
À l’heure où nous mettons sous presse, Jeanne d’Arc n’est pas encore brûlée et les auteurs n’ont pas eu le temps d’être nommés. Il est partant une heure du matin !
Le Temps, 10 novembre 1873
Quelques mots sur Jeanne d’Arc en conclusion de la Chronique théâtrale hebdomadaire de Francisque Sarcey, laquelle était consacrée à la première de l’Oncle Sam (critique négative et moqueuse).
Lien : Gallica
Ce matin nous sommes sortis à une heure de la Gaîté, où l’on nous a donné la Jeanne d’Arc de Barbier, musique de Gounod. Drame austère, qui eût renvoyé le public un peu attristé, si les deux derniers actes n’étincelaient de beaux vers. Nous en reparlerons avec détail lundi prochain.
Le Siècle, 10 novembre 1873
Extrait de la Revue musicale du compositeur et musicologue Oscar Comettant.
Lien : Retronews
Il est une heure et demie du matin. Nous sortons du théâtre de la Gaîté, où l’on vient de donner la première représentation de Jeanne d’Arc, de MM. Jules Barbier et Charles Gounod.
Notre collaborateur de Biéville vous parlera de ce drame historique, tout palpitant de patriotisme, que les circonstances douloureuses où nous ont placé les événements derniers rendent plus poignant encore, et qui a suscité dans toute la salle un généreux et sublime tressaillement. C’est un grand succès de pièce, croyons-nous, et c’est aussi une fortifiante leçon d’amour de la patrie. Jeanne d’Arc était illuminée, soit, je le veux bien ; mais les voix qui commandaient à cette fille du peuple de sacrifier ses plus chères affections, sa famille, le bonheur du foyer domestique, pour donner l’exemple du courage et de la foi patriotique, ces voix seront toujours celles-qui parlent au cœur des nobles amants de leur pays et enfantent les sublimes folies.
Jeanne d’Arc est une sainte martyre ; canonisée, sans le secours de Rome, par la France reconnaissante.
La musique dont l’auteur de Faust a embelli le poème de M. Jules Barbier est de celle qu’on n’apprécie à sa juste valeur qu’après plusieurs auditions. Ce n’est point qu’elle présente des amplifications de parti pris faites pour les yeux et qui fatiguent l’oreille en la mettant en défaut ; tout au contraire la musique de Jeanne d’Arc est fort simple de mélodie, de rythme et d’orchestration. Mais un souffle poétique anime ces tableaux sonores, et jusqu’à ce que les liens mystérieux de la pensée s’établissent parfaits entre le compositeur et l’auditeur, la meilleur de la pensée du poète-musicien est perdu ou affaibli. On comprendra mieux par la suite qu’on ne l’a fait à cette première audition tout le charme mystique du duo des voix inspiratrices de Jeanne d’Arc, du chœur des anges, du beau chœur : Nous fuyons la patrie
d’un charme douloureux, de la délicieuse introduction d’orchestre, de la prière, et de quelques autres morceaux religieusement patriotiques.
Quant au final du second acte, c’est une marche militaire taillée sur le patron des airs patriotiques français, et dans laquelle — avec intention certainement — le compositeur a introduit des lambeaux caractéristiques de la Marseillaise, du Chant du départ et des Girondins. L’effet de cette marche par un chœur nombreux et un orchestre très-complet a été grand. On l’a redemandée, et le même honneur a été fait à plusieurs autres morceaux.
Le divertissement sur les fortifications de la ville d’Orléans (un très beau décor) est une suite d’airs de ballet ravissants.
Je citerai notamment un air très-vif et éminemment gracieux donné aux violons, et une marche funèbre grotesque du plus original et du plus charmant effet. Ce morceau d’ailleurs nous était connu sous le titre de Marche funèbre d’une Marionnette. Il a été publié pour piano par l’éditeur Lemoine.
J’en passe, et des meilleures, comme dit le poète, car le temps nous presse, pour arriver au morceau capital de cette partition, à la marche funèbre. Le chant en est poignant sans cesser d’être un instant gracieux et pur comme l’âme de la pauvre fille dont il soutient les pas chancelants. De temps à autre, l’orchestre exprime les terreurs de l’infortunée, qui n’entend plus ses voix, pleure son village chéri et ses parents adorés. La scène est émouvante, et l’orchestre se fait l’harmonieux commentateur des sentiments divers qui se succèdent dans le cœur de la martyre, en les retraçant à l’esprit avec la pénétrante éloquence des sons.
Nous l’avons dit, il convient d’entendre plusieurs fois cette musique, en quelque sorte picturale de Jeanne d’Arc, avant de la juger définitivement. Ce que nous pouvons affirmer dès aujourd’hui, c’est qu’elle est digne du maître qui l’a signée.
Le Figaro, 11 novembre 1873
Extrait de la rubrique Premières représentations, par Auguste Vitu.
Lien : (classes populaires) Gallica
Gaîté. — Jeanne d’Arc, drame en cinq actes, en vers, par M. Jules Barbier, musique de M. Charles Gounod.
Jeanne d’Arc est, sans comparaison, la plus haute figure de l’histoire de France ; sa vie et sa mort offrent à l’historien comme au poète le plus beau sujet qui puisse tenter un esprit généreux. Plusieurs l’ont essayé qui n’ont pas complètement réussi, mais qui n’ont pas non plus tout à fait échoué. L’âme rêveuse de Schiller était faite pour saisir le côté naïf et extatique d’une pareille existence ; malheureusement il a défiguré son œuvre en y faisant intervenir des amours romanesques absolument déplacées et même ridicules. Parmi les tragédies françaises, je n’ai présentes à la mémoire que celle d’Alexandre Soumet et celle de M. d’Avrigny, qu’on estime toutes deux à des degrés divers, animées qu’elles sont par un souffle plus patriotique que dramatique. Ce fut la tragédie d’Alexandre Soumet que mademoiselle Rachel choisit un soir pour ressusciter, avec la sublime héroïne de Vaucouleurs, la figure popularisée par la ciseau d’une artiste de royale lignée. La tentative de mademoiselle Rachel fut honorable, mais stérile. Pour la recommencer, M. Jules Barbier ne pouvait mieux choisir que la sœur de Rachel, mademoiselle Lia Félix.
Hélas ! les désastres des temps présents n’ont rendu que trop d’actualité aux exploits de Jehanne, la bonne Lorraine
, comme l’appelait François Villon ; heureux encore que Vaucouleurs et Domrémy n’aient pas cessé d’être des villages français et que le drapeau national flotte encore sur le berceau de Jeanne-d’Arc !
Pour moi, je ne saurais parler sans émotion de cette pieuse fille, qui sauva son pays par l’épée et par la la croix, et qui fonda, au milieu des décombres de la France féodale, la religion de la patrie. Elle en fut la vierge immaculée, et parut aux yeux des populations désespérées comme le port de salut et l’étoile du matin.
On doute, en lisant la vie de Jeanne d’Arc, si c’est une histoire ou une légende. Ne doutez pas : c’est une légende et c’est de l’histoire ; les prodiges de la mission de Jeanne, du secret qu’elle révéla à Charles VII, de la délivrance d’Orléans, de la défaite des Anglais à Patay et de la marche triomphale d’Orléans sur Reims sont attestés par les documents contemporains les plus authentiques et par les dépositions de cent-quarante-quatre témoins devant l’infâme tribunal de Rouen. Cette petite paysanne, qui, jusqu’à l’âge de dix-huit ans avait gardé les moutons, prit soudain le harnois de guerre et conduisît à la victoire de vaillants chevaliers qui désespéraient du salut de la patrie. Pour atteindre ce but merveilleux, elle eut deux problèmes à résoudre, renverser leurs desseins et ne se servir que de leur épée.
Telle est l’étonnante épopée dans laquelle M. Jules Barbier a découpé un drame ou plutôt une tragédie qui prend Jeanne d’Arc à Domrémy et la conduit, jusqu’au bûcher de Rouen, en passant par Chinon, Orléans et Reims.
M. Jules Barbier n’a introduit aucun élément étranger dans la vie de Jeanne d’Arc, sauf l’épisode aussi secondaire qu’inutile d’un amour discret que l’humble bergère inspire au laboureur Thibault, son compagnon d’enfance.
Ce plan, fort sage, mais très sévère, ne comporte qu’une seule figure, agissant et remplissant l’œuvre de son éblouissante personnalité, celle de Jeanne d’Arc. Les autres rôles, même le roi de France, s’effacent et se réduisent aux proportions exiguës de simples comparses.
L’auteur a rendu visibles au spectateur les apparitions célestes qui déterminèrent la vocation de Jeanne. Elles se manifestent trois fois, d’abord dans la chaumière de Domrémy, ensuite dans la prison de Rouen, enfin sur la place publique, lorsqu’au-dessus des flammes de l’horrible bûcher, le paradis s’entrouvre pour recevoir celle qui fut l’épée du Seigneur sur la terre.
Ce parti pris, que commandait d’ailleurs la triple alliance de la poésie, de la musique et de la peinture décorative, rapproche l’œuvre de M. Jules Barbier d’un genre de composition aujourd’hui bien oublié, je veux parler des mystères, qui firent les délices de la France pendant tout le moyen âge et jusqu’au règne de Henri III. Les exploits de la Pucelle forment le sujet du Mystère du siège d’Orléans qui fut joué à Orléans même, aux frais du fameux maréchal de Rais, antérieurement à 1440. Dès 1839, M. Paul Lacroix avait signalé l’existence, parmi les manuscrits du Vatican, de ce vénérable manuscrit de notre antique littérature, publié depuis par MM. Guessard et de Certain. M. Jules Barbier a dû s’en inspirer en plus d’une rencontre.
La couleur générale de l’ouvrage est exacte et convenable aux événements qu’il rappelle. Elle motive cependant quelques observations.
Je ne m’arrête pas à un anachronisme sans importance, et qui précisément parce qu’il est inutile, doit être absolument corrigé. Ou j’ai mal entendu, ou il est question au deuxième acte des troubadours qui ornaient la cour du bon roi René. Mais le bon roi René avait à peu près l’âge de Jeanne d’Arc et ne devint roi que longtemps après la mort de la Pucelle.
Ce qui me paraît moins pardonnable, c’est d’avoir mis en présence Jeanne d’Arc et Agnès Sorel, qui certainement ne se rencontrèrent jamais. Jeanne d’Arc avait péri sur le bûcher en 1431, lorsque, cette même année ou l’année d’après Agnès Sorel fut présentée à la cour. M. Jules Barbier, en partageant entre la sainte et la maîtresse l’influence qui ramène Charles VII à ses devoirs envers la France, altère la pureté de souvenirs qu’il convient de respecter, et diminue, sur ce point capital, la valeur morale de son œuvre, d’ailleurs si estimable et si noblement inspirée.
Je m’empresse d’ajouter qu’un très grand et très légitime succès a couronné les efforts réunis du poète, du compositeur et du théâtre.
Les vers de M. Jules Barbier ne possèdent pas les qualités éclatantes de facture auxquelles nous ont habitués les virtuoses de l’école moderne ; mais la pensée en est haute et ils se condensent, lorsqu’ils reproduisent des mots historiques de la Pucelle, en effets saisissants.
C’est surtout au cinquième acte, lorsque la Pucelle, traquée par les inquisiteurs anglais, évite tous les pièges car ces réponses sublimes qui nous ont été conservées intégralement dans les procès-verbaux de son interrogatoire, que le public s’est laissé gagner par la contagion de l’enthousiasme et du merveilleux.
Il faut dire que mademoiselle Lia Félix, jusque-là très remarquable, mais parfois inégale, s’est élevée, dans cette scène de l’interrogatoire à des hauteurs interdites aux artistes vulgaires.
Lorsque, expliquant à ses juges comment elle entraînait les soldats à la victoire, Jeanne d’Arc rappelle qu’elle leur disait :
Avancez hardiment ! Et j’entrais la première.
Elle a un geste, un élan d’une vibration électrique qui s’est communiquée à tous les spectateurs. Tout le monde applaudissait, tout le monde pleurait ! Nous applaudissons mademoiselle Lia Félix, et nous pleurions la Lorraine !
J’ai dit qu’en dehors de Jeanne, les autres personnages demeurent au second ou même au troisième plan. Leurs interprètes n’en sont pas sortis. M. Angelo a cependant prononcé avec un certain charme la prière du roi de France, du fils d’Isabeau de Bavière qui doute de sa légitimité, et M. Clément Just, affligé d’un fort rhume, a prêté une belle prestance au chevalier La Hire, ce type légendaire du routier, qui savait être la fois un guerrier patriote et le roi des pillards.
Parmi les sept décors qui ont été peints exprès pour Jeanne d’Arc, quatre méritent d’être particulièrement cités, celui du château de Chinon, celui du pont d’Orléans, celui de la cathédrale de Reims, et celui du bûcher sur la place du Vieux-Marché de Rouen.
Les costumes sont nombreux, exacts et curieux à voir. La procession du sacre devant la cathédrale de Reims est d’un magnifique ensemble et a vivement frappé la foule.
Enfin le tableau du bûcher, où l’on voit l’innocente victime enveloppée par les tourbillons de flammes et de fumée pendant que le paradis s’ouvre et que le chœur des anges domine le gémissement lugubre des bourreaux, clôt magistralement cette œuvre, assurément languissante et vide en certaines parties, mais qui arrive à s’emparer du spectateur et à l’émouvoir profondément.
Le succès immense de la soirée d’hier s’étendra-t-il jusqu’aux classes populaires ? Je le désire pour le Théâtre de la Gaîté, qui a fait un effort méritoire vers les régions élevées de l’art. Mais si vous aviez entendu messieurs les citoyens des galeries supérieures ! J’ai vu le moment où ils allaient entonner le Ça ira, afin d’humilier la mémoire des aïeux qui se faisaient tuer pour la France.
Extrait de la Chronique musicale, par Bénédict (pseudonyme de Benoît Jouvin).
Le sujet de Jeanne d’Arc a inspiré — bien ou mal — jusqu’à douze compositeurs de génie ou de talent des trois écoles : la Française, l’Italienne et l’Allemande. Le plus grand, le plus original parmi les noms que je vais citer, Weber écrivit des intermèdes pour la Jeanne d’Arc de Schiller. Trois autres musiciens allemands, dont il n’y a ni nécessité ni mérite à troubler l’honnête obscurité, tentèrent de faire autrement (et ils y réussirent) que l’illustre maître du Freischütz en cousant des ritournelles à l’œuvre du poète. L’auteur des partitions oubliées de Lodoïska et de Paul et Virginie, le violoniste Kreutzer, fit représenter en 1790 sur la scène italienne (lisez : Opéra-Comique) une Jeanne d’Arc de sa façon. Je ne connais point cette misère mais je vois d’ici le musicien d’Aristippe attachant au cou d’une statue légendaire des grelots pour marquer le rythme d’un couplet de vaudeville ! Il faut citer en courant la Jeanne d’Arc de Carafa jouée à l’Opéra-Comique en mars 1821 ; celle de Vaccai représentée au-delà des monts en 1827 ; une autre encore du compositeur bouffe Pacini, laquelle se gargarisa de roulades sur un des théâtres de Milan en 1830. Si nous quittons l’Italie pour l’Angleterre (Jeanne d’Arc glorifiée par les descendants de ses bourreaux ! voilà qui est original… et scandaleux) nous rencontrons la Pucelle en 1839 chantant à Drury Lane la musique du chanteur-compositeur Balfe. Puis, si nous retraversons la Manche en 1865, nous allons retrouver la vierge de Domrémy installée dans une halle : le grand théâtre parisien, et y interprétant un opéra héroïque de la composition du ténor Duprez.
Il faut clore cette liste avec la Giovanna d’Arco, de Verdi, chantée à la Scala, au mois de février 1845, et à Ventadour le 2 avril 1868. Jeanne, sous les traits de la Patti casquée et cuirassée était une Jeannette. Partition médiocre, banale et bruyante ; poème plat et ridicule. Jeanne d’Arc, amoureuse du roi de France, tenait dans ses armées la place d’Agnès Sorel à la petite cour de Bourges. C’était chez un librettiste italien le chef-d’œuvre de la sottise !
La tentative de Charles Gounod compte d’illustres, exemples. Beethoven a écrit pour les Ruines d’Athènes, pièce à spectacle de Kotzebue, une suite d’intermèdes pour voix et orchestre, dont quelques fragments, exécutés aux concerts du Conservatoire, y furent accueillis avec enthousiasme. Sur la tragédie de Michel Béer, son frère, Meyerbeer a composé en 1847 une ouverture, des chœurs et des ritournelles symphoniques. La Marche de Struensée
est populaire. Avant de collaborer à la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier, Charles Gounod avait écrit, en côtoyant le poème des Deux Reines, de M. Legouvé, une partition d’une assez grande étendue.
Le caractère de la musique écrite par Charles Gounod sur les marges du drame en vers représenté à la Gaîté, sauf un petit nombre de morceaux, est essentiellement religieux. Éveillant des voix sacrées ou profanes autour de la chaste héroïne de Domrémy, le musicien a fait pivoter en quelque sorte son inspiration sur une idée fixe, l’idée du salut de la France qui remplit la grande âme de Jeanne. L’unité de composition, l’unité mélodique et harmonique découlaient nécessairement de cette pensée obstinée, énergique et — passez-moi l’expression — de cette monomanie patriotique de la sublime bergère.
La chanson de la ribaude, le ballet, les couplets à boire des soldats anglais qui gardent Jeanne dans son cachot, sont des épisodes destinés à rompre, sans la détruire, l’uniformité haute et sereine de l’inspiration du musicien. Celui-ci ne fait une halte dans les bruits de la terre qu’afin de reprendre haleine avant de rentrer, d’un seul coup d’aile, dans ce bleu éternel du firmament d’où descendent les voix qui prêchent à la Pucelle sa tâche et lui annoncent son martyre. Il faut bien se rappeler le point de départ où s’est placé le maître afin de se familiariser avec son procédé et d’entrer dans l’uniformité voulue de son œuvre. J’ai entendu dire autour de moi par ceux qui n’écoutent et ne permettent point aux autres d’écouter : Mais Gounod nous fait assister aux Vêpres !
— oui aux Vêpres françaises des terribles années 1429, 30 et 31…
Je suis loin de vouloir affirmer que le compositeur de Faust et de Roméo a écrit un nouveau chef-d’œuvre : les hommes de génie n’en font qu’à certaines heures, qui sonnent lentement, et dont l’invisible horloger ne les consulte point au moment d’avancer ou de reculer les aiguilles. L’œuvre est-elle consciencieuse ? Oui. Eh bien cela peut suffire.
L’œuvre débute par une introduction orchestrale dans laquelle interviennent des voix mystérieuses chantant derrière le rideau baissé. Le premier chœur : Nous fuyons la patrie ! à un beau caractère de douleur mélancolique. C’est le Super flumina Babylonis de la France envahie et refoulée. La grande page du premier acte, c’est l’ensemble des voix célestes accompagnées des graves harmonies de l’orchestre et de l’orgue ; c’est sainte Marguerite et sainte Catherine dictant impérativement à une pauvre paysanne ignorante sa grande mission patriotique. Le petit chœur des compagnes d’Agnès Sorel, qui ouvre le deuxième acte, a une fraîcheur mondaine tout à fait agréable. Il faut chercher la ballade du prisonnier
à travers l’exécution molle, pâteuse et terre-à-terre de mademoiselle Perret, le page Loys. On a fait répéter la chanson des ribaudes, qui est fort piquante, et que mademoiselle *** chante très agréablement faux. Le ballet des ribaudes dansantes à beaucoup de couleur. Il y a dans la Marche du Sacre
un effet de carillon dans l’orchestre d’une sonorité superbe. La chanson à boire des Anglais avec le refrain : C’est l’argent de France qui payera a de la rondeur et de la verve ; le compositeur la marie en contrepoint, et d’une façon très heureuse, avec la voix de sainte Marguerite et de sainte Catherine. La marche funèbre a du caractère ; le chant des voix célestes, reproduit par l’orchestre, y alterne avec le motif principal. On a trouvé cette marche un peu longue ; peut-être s’est-on trop hâté de la juger.
M. Albert Vizentini, qui a dirigé les études de la partition de Gounod, suspend à son bâton de mesure le bataillon difficile à discipliner des récitants, de l’orchestre et des chœurs. Le jeune chef d’orchestre a du coup-d’œil et de la main ; mais les éléments d’exécution dont son énergique volonté dispose sont disparates et mal fondus ensemble : de ce chaos réussira-t-il à faire sortir un monde ? Dans l’intérêt d’un grand musicien, cela serait fort à désirer.
Extrait des Échos de Paris, par le Masque de fer (pseudonyme de Philippe Gille).
Au troisième acte de la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier, l’héroïne demande au roi l’exemption d’impôts à perpétuité pour le village où elle est née. Charles VII la lui accorde.
Rien de plus exactement historique, et rien aussi de plus légitime. On peut donc croire qu’à Domrémy on ne paie pas d’impôt, car une semblable ordonnance royale n’eût certainement été rapportée par aucun gouvernement.
Eh bien ! il n’en est rien. Par suite d’une erreur de la trésorerie royale, c’est le village de Greux, voisin de Domrémy, qui fut exempté de toutes tailles, aides et subsides
. L’erreur étant reconnue plus tard, on rétablit les impôts à Greux, sans se préoccuper d’exécuter l’ordre de Charles VII dans la patrie véritable de Jeanne d’Arc.
En 1820, le roi Louis XVIII fit élever à Domrémy un monument commémoratif, mais personne ne songea à demander pour le pauvre village l’exécution de la promesse solennelle, faite à Reims par le roi de France, en échange d’une couronne, à la pucelle d’Orléans.
Il est vraisemblable que la Jeanne d’Arc de la Gaîté va mettre tous les journaux en frais d’érudition ; ce sera à qui reproduira des fragments de son procès, dont toutes les pièces sont conservées au palais des Archives.
Mais, c’est là de l’histoire, et j’aime mieux offrir un simple cancan aux lecteurs des Échos de Paris.
Il résulte de documents certains que le supplice de l’héroïne a été révoqué en doute par ses contemporains, et le père Viguier essaya de prouver par des pièces trouvées à Orléans et à Metz, que non seulement Jeanne d’Arc n’avait pas été, brûlée par les Anglais, mais qu’on l’avait vue en 1436, c’est-à-dire 5 ans après la conclusion du procès de Rouen, avec ses frères. Ce n’est pas tout, il ressort d’un acte notarié qu’elle aurait épousé un sieur Robert des Hermoises [Armoises], seigneur de Tichemont, riche propriétaire à Harancourt. Si je n’avais sous les yeux des extraits de ces pièces pour y renvoyer les incrédules, j’avoue que je n’oserais pas parler d’une aussi singulière légende.
Ce qui est vraisemblable, c’est que de même qu’il y a eu de faux Louis XVII, il s’est produit, après la mort de l’héroïne, de hardies aventurières qui ont pris son nom. L’une d’elles, disent les mémoires, eut l’audace de se présenter à Charles VII lui-même.
Les Anglais, prévoyant ces supercheries et comprenant ce qu’elles pouvaient avoir de dangereux, avaient veillé à ce que la mort de Jeanne fût bien constatée. Un témoin du procès de justification rapporte que, lors de l’exécution, les Anglois, doutans que l’on voulut semer que la Pucelle ne fust point morte, et quelque autre qu’elle fust brûlée en son lieu, firent après qu’elle fust morte, retirer le feu et tout le bois arrière du corps, afin que on congneut qu’elle fust morte
.
Ainsi reste intacte la légende de Jeanne d’Arc.
Le Petit Moniteur universel, 11 novembre 1873
Extrait de la rubrique Théâtre de Gustave Claudin.
Lien : Retronews
Ceux qui ont le goût difficile et qui aiment l’art pour l’art, ne devront pas marchander les éloges à la direction du théâtre la Gaîté, qui vient d’offrir au public parisien une véritable fête artistique. La Jeanne d’Arc, avec les vers de M. Jules Barbier, encadrés dans la musique de M. Gounod, est une œuvre sérieuse qui sera fort goûtée par ceux encore très-nombreux parmi nous, qui aiment à trouver au théâtre autre chose que des balivernes. La Gaîté vient en un mot de tenter un essai qui aurait fait honneur à la Comédie-Française et au Grand-Opéra. On lui tiendra compte de ces efforts généreux, et on l’en récompensera. Ceci dit, arrivons à la pièce.
C’est l’épopée de cette héroïne martyre dont figure poétique brille au premier rang dans les fastes de notre histoire nationale. Les poètes et les musiciens se sont emparés depuis longtemps déjà de Jeanne d’Arc. Elle a été mise en scène, dans des poèmes, des drames et des opéras. Schiller cite les Allemands, Soumet chez nous, et Verdi en Italie ont exalté et chanté cette héroïne étrange ont l’histoire et la légende se partagent la vie. Un seul parmi les grands esprits qui se ont occupés d’elle a tenté de l’amoindrir, et celui-là est Voltaire, dans son poème de la Pucelle. On est à son aise pour lui reprocher cette mauvaise action, qu’il a rachetée, dans l’ensemble de ses œuvres, par tant d’autres belles prouesses. Ce fut un pur caprice qui décida Voltaire à composer ce détestable chef-d’œuvre que Chateaubriand appelait un écart du talent, une débauche du génie, et Mme de Staël un crime de lèse-nation. Il est prouvé que Voltaire hésita longtemps, et que sa première idée était d’écrire un poème comique avec la Henriade, et un poème épique sur Jeanne d’Arc. Il a été, à ce propos, jugé sévèrement par tous, même par les libres penseurs, qui, sur le piédestal de la statue qu’ils lui ont élevée l’année dernière, n’ont point osé, dans l’énumération de ses œuvres, inscrire le nom de la Pucelle. Allez au square Monge voir cette statue, et vous verrez sur le marbre une ligne de points.
Jeanne d’Arc se disait inspirée. C’est dans une vision qu’elle apprit le grand rôle qu’était appelée à jouer une humble bergère comme elle. En rappelant ce détail de l’histoire, nous n’avons pas la fatuité de rien apprendre à personne. Si nous l’avons fait, c’est pour rapprocher l’année 1428, époque à laquelle Jeanne d’Arc combattait sur la Loire les envahisseurs de la France, de l’année 1870, où, sur les rives de ce même fleuve, nous avions à combattre d’autres envahisseurs. La foi de Jeanne d’Arc nous donna la victoire. Nous savons bien qu’une foule de gens hausseront les épaules en tirant eux-mêmes de ce rapprochement des inductions que nous sous-entendons à dessein. Peu importe. L’histoire est un grand enseignement. Qu’on la consulte, et on verra que les générations qui ont marqué par de grandes choses leur passage sur la terre ont toutes eu la foi. Rome a été la maîtresse du monde tant qu’elle a cru à ce crâne trouvé dans le Capitole dès les premiers jours de sa fondation. Sa puissance déclina au fur et à mesure que ses libres penseurs entamèrent cette légende et répudièrent le crâne.
L’histoire de Jeanne d’Arc offre ceci d’étrange que sa réalité semble calquée sur les fictions les plus ingénieuses imaginées par les poètes. C’est de l’humble chaumière d’un petit village que sort l’héroïne inspirée. Elle part trouver le roi de France qui a perdu ses États, et arrive frapper à la porte de sa tente, seule et sans prestige. On dirait un personnage d’un conte de fée. Le premier tableau du drame est admirablement mis en scène, la décoration impressionne par son aspect vague et mystérieux. Ces grandes saintes qui se dressent sur leurs piédestaux font rêver.
L’arrivé chez le roi Charles VII est également très-bien mise en scène, ainsi que le siège d’Orléans. De là, on passe rapidement à Reims, où Jeanne, qui a vaincu les Anglais, amène son roi pour le faire sacrer. L’entrevue de Jeanne d’Arc avec son père, sa mère, sa sœur et son fiancé, quatre bons paysans accourus à sa rencontre, a un caractère tout à la fois grandiose et simple. C’est une scène de la Bible, qui nous ramène au temps des patriarches. Elle rappelle la famille de Joseph venant le visiter dans toute sa splendeur, à la cour du Pharaon.
Enfin, la scène de la prison, à Rouen, produit un grand effet, auquel vient mettre le comble celle du bûcher.
Mlle Lia Félix, dans le rôle de Jeanne d’Arc, a joué avec un talent qui, par instant, est allé jusqu’au génie. Impossible d’être plus touchante qu’elle ne l’a été dans cette entrevue, à Reims, avec ses parents. Son succès, déjà fort grand, devait éclater comme un coup de tonnerre dans la belle scène de la prison, alors que la pauvre vierge captive et désarmée, se débat contre les bourreaux qui torturent son âme avant de brûler son corps. Mlle Lia a joué cette grande scène d’une façon tout à fait sublime. Elle a, à diverses reprises, soulevé la salle entière qu’elle tenait suspendue à ses lèvres, et dans deux ou trois élans rapides comme l’éclair, fait partager à ceux qui l’écoutaient l’émotion, l’enthousiasme et la douleur qu’elle traduisait avec tant d’éloquence et de vérité. Mlle Lia a été rappelée trois fois de suite et couverte de fleurs et d’applaudissements. Il y a plus de dix ans qu’on ne vit une artiste remporter un pareil triomphe.
Mais pourquoi une comédienne de la valeur de Mlle Lia reste-t-elle vouée à la vulgarité du mélodrame ? Pourquoi son talent qui sait donner de si grands coups d’aile quand il se mesure avec un rôle fait à sa taille, est-il emprisonné toujours dans une vile et basse prose ? Hier les beaux vers de M. Barbier, dits par Mlle Lia, reluisaient comme de l’acier et sonnaient comme de l’or pur.
Mme Tessandier, dans le rôle épisodique d’Agnès Sorel, Clément Just dans La Hire, et Desrieux dans de Thouars, se sont fait applaudir.
M. Barbier a ce mérite d’avoir su renfermer toute la légende de Jeanne d’Arc, dans un récit émouvant et concis. L’acte de la prison, à lui seul, forme un drame écrit en très-beaux vers. Le poète était ému.
La musique de M. Gounod a été très-applaudie. Il faut citer comme morceaux remarquables, écrits avec ampleur, le chant guerrier sous les murs d’Orléans, et par dessus tout la marche funèbre de Jeanne allant au supplice. Dans un tout autre genre, la musique gaie du ballet des Ribaudes est d’une facture très-originale.
La mise en scène de l’ouvrage est tout à fait splendide. Les décors sont merveilleux. Celui du premier tableau et celui de la cathédrale de Reims, ont produit beaucoup d’effet.
Le Bien public, 11 novembre 1873
Extrait du Feuilleton d’Henri de Lapommeraye.
Lien : Retronews
Nous voulons donner le pas à la France sur l’Amérique, à Jeanne d’Arc sur l’Oncle Sam [comédie de Victorien Sardou créée au Vaudeville le 6 novembre], à l’art sur le métier. Parlons donc du drame de M. Jules Barbier, représenté hier soir à la Gaîté. L’heure est propice pour de semblables spectacles qui élèvent l’âme et enflamment les cœurs. Nous avons besoin de retremper notre patriotisme dans ces souvenirs grandioses et consolants à la fois.
Salut donc au poète bien inspiré qui vient nous conter cette belle légende, disons mieux, cette admirable histoire, et qui, au lieu de tableaux érotiques et de caricatures outrées, offre à nos yeux la représentation de la France sauvée par une humble paysanne, la fille de Dieu, fille au grand cœur, comme l’appelait le peuple.
Vierge héroïque, honneur et salut de ta patrie, la raillerie t’a traînée dans la fange pour souiller en toi la noble image de l’humanité. L’esprit moqueur est en lutte éternelle avec le beau, il ne croit ni à l’ange, ni à la divinité. Il veut ravir au cœur ses trésors, il veut détruire l’illusion et la foi. Mais la Poésie, enfant comme toi, et, comme toi, une pieuse bergère, la poésie te tend sa main divine, et t’enlève dans son vol vers les astres éternels. Elle t’a entourée d’une auréole, et tu seras immortelle, car tu es une créature du cœur.
Ces dernières paroles sont de Schiller ; elles ont été tracées par lui au moment où il terminait le drame qu’il a consacré à Jeanne d’Arc, et elles serviraient bien d’épigraphe à l’œuvre de M. Jules Barbier.
De sa pièce, en effet, on peut dire ce que Schiller dit de Jehanne la Lorraine : c’est une création du cœur. M. Barbier a cherché surtout à présenter au public le côté tendre et religieux de la pastourelle de Domrémy.
Les hauts faits de la guerrière sont laissés non pas dans l’ombre, car ils rayonnent nécessairement sur toute la vie de Jeanne, mais dans un horizon lointain qui laisse au premier plan l’exposition du caractère et la personnalité presque intime de la femme.
Cette conception enlève peut-être un peu d’éclat à l’œuvre de M. Barbier, qui par là même est rendue plus sobre, plus austère ; mais elle lui donne en revanche un accent mélancolique et doux qui enchante l’esprit et développe encore l’amour idéal qu’on ressent pour cette martyre du devoir.
Comme Schiller, la drame de M. Jules Barbier nous conduit d’abord à Domrémy, dans la chaumière de Jacques d’Arc. La famille vient de terminer le repas du soir ; devant l’âtre où brûle un feu de sarment, est le vieillard ; Isabelle Romée, la mère de Jeanne, et Catherine, sa sœur, desservent la table. Plus loin, sont les trois frères de Jeanne, et à son rouet, Jeanne occupée à filer. On est triste, car la France est envahie ; on est inquiet, car on a vu des soldats anglais parcourant les alentours, y semant l’effroi et la menace. Des paysans défilent devant la porte entrouverte.
Jeanne
Arrêtez-vous ! entrez ! mon père vous en prie.
Mais quoi ! d’où venez-vous ?
Un vieillard
Nous fuyons la patrie !
Femmes, enfants, vieillards, chassés de nos hameaux,
Devant nous au hasard nous poussons nos troupeaux.
Hélas ! reverrons-nous en des temps moins funestes,
De nos murs dévastés les misérables restes,
Nos champs semés par nous, par d’autres moissonnés,
Et le paisible chaume où nos enfants sont nés !
[Note : les vers 4 et 5 du vieillard sont ceux du texte de 1869, différents de ceux de 1873.]
Voilà l’invasion avec ses douleurs, et la voici avec ses crimes : une petite amie de Jeanne accourt, elle est poursuivie par un brutal soldat qui, après boire, a des appétits amoureux, et peut prendre
Le meilleur de la France en lui prenant ses filles.
Jeanne défend sa compagne en s’armant d’une faucille et, de cette main qui tiendra l’épée victorieuse à Patay, elle désarme Siward, qu’elle chasse de la maison.
Toute cette exposition est simple et belle, et prépare à merveille l’extase de Jeanne qui, sous l’impression que lui cause la vue de ces malheureux exilés et de ces vainqueurs grossiers, sent son âme envahie par l’exaltation du patriotisme le plus ardent.
Elle prie, et tout à coup au fond du théâtre apparaissent deux saintes, envoyées du Seigneur, qui disent à Jeanne :
Jeanne, Dieu t’a parlé !… tu n’as pas entendu ?
Ce sont les voix, voix dont Gounod a noté l’harmonie, et qui donnent à la scène une puissance immense, redoublée encore par le dernier cri d’adieu jeté par la jeune fille au toit paternel qu’elle ne reverra plus.
Ce premier acte est vraiment fort beau.
Le second est plus froid et vaut moins.
La faute en est peut-être moins au poète qu’aux personnages qu’il a été forcé d’introduire dans l’action. On est de mauvaise humeur, bien plus, on a de la colère contre ce roi efféminé qui perd si gaiement et si nonchalamment son royaume, et contre ces grands dignitaires qui, au lieu de se réunir pour chasser de France l’Anglais, compromettent les dernières chances de la couronne et de la nation, par de basses et mesquines intrigues de palais.
La présence d’Agnès Sorel elle-même semble presque insupportable, à cette heure funèbre, bien que M. Barbier ait, suivant la tradition, donné à cette femme galante des éclairs de patriotisme.
L’arrivée de Jeanne ranime l’intérêt, et la fameuse entrevue de la Pucelle avec Charles VII, à Chinon, est reproduite avec une saisissante vérité.
C’était le 24 février 1429. De Vaucouleurs à Chinon, il fallait faire cent-cinquante lieues dans des provinces soumises aux Anglais, à travers mille bandes d’aventuriers qui couraient le pays ; mais Jeanne était soutenue par la foi, et elle avait déclaré qu’elle irait devers le roi, avant la mi-carême, dut-elle user ses jambes jusqu’aux genoux pour y aller, car il n’y avait pour la France, secours qu’en elle.
Atteindre Chinon tenait déjà presque du miracle ; on lui impose, malgré cela, diverses épreuves dont elle triomphe simplement, humblement, fermement.
Charles VII revêt de Thouars de ses insignes royaux et se cache dans la foule de ses courtisans ; la paysanne lorraine, qui n’a jamais vu le souverain de Bourges, va droit à lui ; elle lui redit la prière qu’il a faite tout bas à Dieu, et que personne n’avait pu entendre ; elle indique le lieu où se trouve la fameuse épée de Fierbois avec laquelle la France doit être reconquise, enfin elle montre de façon irrécusable qu’elle est la prédestinée.
Au troisième acte nous retrouvons Jeanne à Orléans.
Dans un cercle de fer Orléans étourdit,
En dix jours elle a su, ramenant la victoire
Briser cette ceinture et dégager la Loire !
Aussi l’on est gai dans les campements français ; on chante :
Rentrez, Anglais, rentrez vos cornes
Car jamais n’aurez beau gibier !
En France ne menez vos cornes
Êtes matés en l’échiquier ;
Tôt donc ! emmenez vos licornes !
Ou n’obtiendrez point de quartier !
Aussi l’on danse, on célèbre l’enterrement pour rire d’une marionnette, et ces funérailles comique ; sont un divertissement malin et spirituel qui constitue, avec le chœur final — le chœur d’appel aux armes et de bravoure — les deux parties principales de ce tableau.
Il y a à l’acte suivant une bien mauvaise scène entre Agnès Sorel et Jeanne d’Arc.
D’abord, on a fait remarquer avec raison qu’Agnès Sorel ne fut aimée de Charles VII que quelques mois après la mort de Jeanne d’Arc. Agnès était fille d’honneur d’Isabeau de Lorraine, duchesse d’Anjou, lorsque cette dame eut, dit-on, occasion de venir, en 1431, à la cour de Charles VII afin de solliciter une grâce. Le roi devint aussi éperdument amoureux d’Agnès et l’attacha au service de la reine en qualité de dame d’honneur.
On sait ce que ce titre signifiait au beau temps de l’ordre moral des souverains galants !
Mais, sans nous arrêter à un anachronisme qui pourrait être excusé an théâtre, ce que nous reprocherons à M. Barbier, c’est de faire lancer par Agnès, aux oreilles de la Pucelle, une tirade sur l’amour.
La connais-tu,
Cette ivresse, une fois que nos cœurs ont battu ?
Va !… criminel ou non quand l’amour nous embrase,
Il marche, l’œil au ciel, sans voir ceux qu’il écrase,
Et superbe, étalant sa honte avec fierté,
Des mépris de la foule il fait sa volupté !…
Oh ! je devine bien, ce me semble, quelle est la pensée qui a poussé M. Barbier à risquer cette hardiesse. Il a été séduit par le contraste que présentait le rapprochement de la courtisane et de la vierge, et il s’est figuré que du choc de ces deux âmes, l’une souillée, l’autre pure, il sortirait un saisissant effet.
M. Barbier s’est trompé. Cette leçon d’amour heurte l’esprit qui voit Jeanne entourée de l’auréole de la vertu, et ces confidences d’une passionnée produisent une sensation analogue à celle que cause l’aspect d’une chenille sur une rose.
Le drame se relève au moment ou Jeanne revoit sa famille et rêve un moment le retour vers son village chéri ; il tombe ensuite dans la pompe et la décoration, avec le sacre de Charles VII dans la cathédrale de Reims.
Nous avons le regret de ne point partager l’admiration de la majorité du public pour cette partie du spectacle. À notre sens, le décor manque de perspective et de profondeur ; j’aurais voulu que le regard se perdit sous les arceaux des voûtes de la basilique.
Le cortège est maigre, et à moins d’une réelle répugnance de Mlle Lia Félix pour le cheval, nous eussions désiré qu’on reproduisit fidèlement, d’après les indications d’un témoin oculaire, Guy de Laval, le costume et la suite de la lieutenante de Charles.
Elle était armée tout en blanc, écrit de Laval, une petite hache en sa main, montée sur un grand coursier noir, un gracieux page portant son étendard déployé ; son frère, tout armé comme elle, la suivait.
Son étendard était blanc, semé de fleurs de lis avec une figure du Christ, et ces mots Jésus, Marie
, et la chronique ajoute qu’elle portait aussi gentiment son harnois que si elle n’eût fait autre chose tout le temps de sa vie. On avait en outre donné à Jeanne un étal, c’est-à-dire une maison ; un écuyer, deux pages, deux hérauts d’armes et un aumônier, le tout sous les ordres de Jean d’Aulon, un vieux gentilhomme.
On eût dû tenir compte de tout cela et d’autres détails encore dans la distribution du cortège.
Je n’attache pas plus de prix qu’il n’en faut au spectacle s’adressant uniquement aux yeux, mais je suis exigeant pour qui se lance dans le luxe du drame à grand apparat.
C’est pour retracer les derniers moments de Jeanne d’Arc que M. Jules Barbier a trouvé les accents les plus vigoureux, les vers les mieux frappée, et l’inspiration du poète s’est vraiment élevée à la hauteur du sujet.
La salle a frémi tout entière à ce passage de l’interrogatoire :
Jean d’Estivet
Sais-tu donc l’avenir ?
Jeanne
Mieux encor ! je le vois !
Warwick
Et Dieu nous hait ?
Jeanne
Non, Dieu ne hait pas ! Toutefois,
Je sais qu’il vous fera mettre genoux en terre :
Et c’est la seule paix qu’il faille à l’Angleterre !
Jean d’Estivet
Oui, tu te plais à voir coûter le sang chrétien !
Jeanne
Moi, grand Dieu !… ma seule arme, et vous le savez bien,
(Que pour me démentir les morts même renaissent !)
Était mon étendard ! Les Anglais le connaissent !
Warwick
Tu l’avais enchanté, sorcière, conviens-en !
Jeanne
C’est faux ! je le montrais aux miens, en leur disant,
Quand aux rangs ennemis flottait votre bannière :
Entrez-là hardiment !…
Et j’entrais la première !
L’enthousiasme a soulevé tous les auditeurs, et tous les cœurs alors battaient, à l’unisson, de reconnaissance et de respect pour cette Française aussi sublime devant ses juges que devant l’ennemi.
Hélas ! pourquoi n’avions-nous pas cette Lorraine, à la tête de nos braves régiments de Metz !
Telle a été cette belle soirée, qui fait honneur à tous : à l’auteur, à la direction et aux interprètes.
Nous ne parlons pas du musicien, car cette tâche est réservée à notre savant et cher confrère Charnacé.
Mais nous nous félicitons d’avoir à acclamer, comme elle le mérite, la digne sœur de Rachel.
Mlle Lia Félix a remporté un de ces triomphes qui comptent dans la carrière d’une artiste. Elle a eu un souffle entraînant dans toutes les parties héroïques du rôle ; mais, j’en conviendrai, elle m’a encore touché davantage dans les passages d’expansion et de douceur.
Elle a su être et rester femme, et je lui sais gré même de certaines allures un peu embarrassées dans sa cote de mailles, car Jeanne ne doit marcher ni militairement, ni en virago.
Cette attitude serait tout au plus bonne pour interpréter la Jeanne d’Arc que Shakespeare a dénaturée dans sa tragédie Henri VI. Ah ! J’en veux à ce grand poète de n’avoir pas su s’élever au-dessus des haines nationales, et d’être parmi les insulteurs de Jeanne. L’impartialité dans l’histoire devrait être un des attributs du génie !
La physionomie de Jeanne d’Arc rayonne si lumineuse au milieu de ce drame que tous les autres personnages en sont comme éclipsés.
Signalons toutefois Clément Just, qui a rendu avec originalité et esprit le caractère de La Hire ; M. William Stuart, un Dunois chaleureux, et M. Angelo toujours élégant, qui a dit avec une touchante émotion la prière du roi.
Reynald, cette fois, n’a pas de rôle, quelques vers à peine, M. Desrieux en a un détestable.
Tessandier n’est pas sans charme, mais elle a besoin de travailler beaucoup sa diction et de se rompre à l’alexandrin.
Quant à M. Offenbach, nous le remercions d’avoir risqué tant d’argent et d’avoir consacré tant de soins à une œuvre aussi austère. C’est la meilleure réponse qu’il ait pu faire à ceux qui le soupçonnaient le vouloir consacrer la Gaîté au culte de l’opérette.
D’autres théâtres, auxquels la pièce était plus naturellement et plus directement destinée, avaient reculé devant les frais de mise en scène qu’elle devait entraîner, et après bien des tentatives infructueuses, M. Barbier avait dû se décider à éditer son drame repoussé partout.
Après cinq années d’attente, Jeanne d’Arc a eu enfin son jour de couronnement. Encore une fois merci à celui qui a eu la louable audace de tenter la fortune avec une œuvre artistique.
Le Rappel, 11 novembre 1873
Article non signé de la rubrique Théâtre. Le critique loue le jeu de Lia Félix et la mise en scène mais se désole que Barbier ait gâté sa pièce par le sentiment monarchique et clérical
. Léon Duprat le tournera en ridicule (Le Gaulois, 14 novembre).
Lien : Retronews
Ce qu’il faut louer avant tout et sans aucune réserve dans cette représentation, c’est le grand et beau talent de Mlle Lia Félix, et c’est la mise en scène, qui est merveilleuse, non-seulement de richesse et d’éclat, mais de goût et de vérité historique ; jamais rien de plus magnifique et de plus réussi comme décors et comme costumes, n’a été vu à l’Opéra.
Quant au drame de M. Jules Barbier, il a un grave défaut ; c’est que ce n’est pas un drame ; c’est une tragédie.
Il est en vers qui ont la prétention d’être lyriques et presque classiques, et il manque totalement d’action.
Or, rien n’est plus éloigné que le noble alexandrin
, de la langue familière, vive et franche, gaie et gauloise parfois, grande toujours par la seule simplicité, que parlait d’abondance et sans embarras la paysanne de Domrémy, devant n’importe qui, devant le roi, devant ses juges. Rien n’est plus déplacé que cette fausse poésie pour traduire cette poésie vraie. Est-ce qu’un tel idéal a besoin d’être idéalisé ?
Est-ce que ce n’est pas un gros contresens que d’ajouter à cet or pur des ornements en chrysocale ? Nous ne comprenons guère Jeanne d’Arc parlant autrement qu’en prose.
Pour ce qui est du défaut d’action, il est bien certain qu’il fallait religieusement respecter la grande et pure légende de Jeanne, et nous sommes d’avis que Schiller a presque commis un crime en y mêlant un amour. Mais si, dans des personnages et dans une action à côté, on ne trouve pas moyen de créer un intérêt qui ne soit pas prévu et connu d’avance, et d’éveiller dans le spectateur un autre sentiment que l’admiration continue, il faut en conclure que le sujet de Jeanne d’Arc est décidément irréalisable au théâtre, et que la trop sublime héroïne, relevant de Michelet, non de Schiller, est faite pour porter bonheur à ses historiens et malheur à ses poètes.
Nous reconnaissons et nous applaudissons le sentiment patriotique dont M. Jules Barbier a eu l’intention d’animer son drame ; mais pourquoi l’a-t-il compliqué et gâté par le sentiment monarchique et clérical ? Jeanne était par dessus tout une fille du peuple, qui, avec une foi très profonde, avait un esprit très libre. Elle croyait et elle obéissait aux ordres de Dieu et aux voix de ses saintes, mais elle savait fort bien résister et même commander aux prêtres. Elle vénérait, elle adorait, dans le roi, la personnification de la France ; mais combien de fois a-t-elle été irrévérencieuse et presque rebelle vis-à-vis de Charles VII ! Ce n’est pas pour rien que le roi l’a abandonnée et presque livrée, et que les prêtres l’ont condamnée et brûlée.
Qu’on n’oublie pas que l’Église l’a suppliciée comme hérétique et n’a jamais voulu la canoniser comme sainte.
La musique de M. Gounod, fort belle par endroits, a le tort de la poésie de M. Barbier : elle vient trop en avant. Les chœurs sont trop nombreux et trop absorbants. Mlle Lia Félix est obligée de faire semblant d’y prendre part ; mais la figure de Jeanne d’Arc ne s’en perd pas moins dans cette foule chantante.
Répétons qu’il y a cependant de remarquables pages dans cette partition. L’apparition des Saintes a produit un effet véritablement très saisissant. C’est une belle inspiration que l’adjuration de ces deux créatures célestes qui descendent dans le nuage d’or, avec leurs grandes robes flottantes et leurs auréoles, et qui chantent à Jeanne le cantique de l’appel.
Mlle Lia Félix a été superbe d’extase et de douleur dans cette scène ; superbe aussi au tableau suivant, dans la scène où Jeanne reconnaît le roi. À cet acte de la cour de Chinon, admirons en passant la vérité et la splendeur des costumes. Les suivantes d’Agnès Sorel et les chevaliers sont des portraits sortis de leurs cadres.
Le troisième tableau appartient au ballet, qui ne manque pas d’originalité. Cela se passe dans Orléans et commence par une chanson gouailleuse à l’adresse des Anglais. On se souvenait des plaisanteries héroïques des Parisiens sur Bismarck. Le sujet du ballet, c’est l’enterrement d’un mannequin qui représente un général ennemi ; M. Gounod a utilisé là une sorte de parodie symphonique qu’il avait faite sur l’Enterrement d’une poupée.
Au quatrième tableau, la scène où Jeanne retrouve ses parents, a été pour Mlle Lia Félix l’occasion d’un nouveau triomphe. Au 5e, le spectacle du sacre et de la cathédrale de Reims est une merveille. Il y a, encore là, dans la procession, une exactitude et une richesse de costumes inouïe ; les échevins sont à eux seuls un chef-d’œuvre de résurrection et de réalité.
Mlle Lia Félix, rappelée après l’acte de la prison, a été couverte de fleurs, parmi lesquelles un bouquet noué d’une large écharpe tricolore.
Le bûcher du dénouement est un vrai bûcher sur une vraie place. Jeanne y monte, et le bois s’enflamme, et le bois brûle, et il y a des effets de lumière surprenants, colorant de rose la robe blanche de la martyre, tandis que le fond du théâtre s’ouvre, et que les Apparitions chantent l’Hosanna in excelsis.
Ce court résumé suffit à montrer comme la pièce disparaît, et comme l’actrice et la mise en scène se partagent les honneurs de la soirée, À ne regarder que le spectacle, c’est tout un poème, auquel ne manque que le poète. On cherche Shakespeare mort et Hugo absent.
Le Charivari, 12 novembre 1873
Article de la rubrique Théâtre de Pierre Véron.
Lien : Gallica
À la sortie, une voix qui partait derrière moi, et que je reconnus pour la voix d’un confrère en critique, disait :
— Allons, c’est un vrai succès… pour Alexandre Soumet.
La formule était dure, mais la vérité m’oblige à déclarer que quant au fond le verdict est absolument exact.
Nul n’inspire une plus juste sympathie que M. Jules Barbier. Travailleur consciencieux, vivant à l’écart des compétitions et des coteries, lettré distingué, M. Barbier ne compte que des amis dans la littérature même. Et je n’ai pas besoin n’ajouter que le cas est rare.
Ses débuts promettaient d’ailleurs un vrai poète, et l’avenir aurait tenu cette promesse, si le librettisme n’avait accaparé et détourné un talent qui valait mieux que ce qu’il a produit.
Aujourd’hui, il paraît bien difficile à l’écrivain de se délivrer des habitudes prises, et sa Jeanne d’Arc est plutôt elle-même un livret d’opéra qu’une pièce.
Elle eût gagné incontestablement à être chantée d’un bout à l’autre.
Non pas que les vers soient mauvais, mais ils ont la correction banale d’un devoir d’élève très fort en prosodie. L’action, à peu près nulle, languit aussitôt que la musique l’abandonne, et ce n’est qu’à de trop rares intervalles que quelque étincelle patriotique jaillit de ces cendres uniformément grises.
Je ne veux pas y insister.
Il m’en coûte assez déjà de constater ce que je constate, et j’aborderai sans délai le chapitre de la partition.
Car c’est une partition véritable que Gounod a écrite.
Elle abonde en traits remarquables ; en délicatesses qui raviront les harmonistes, en subtilités savantes qui dénotent le maître. Plusieurs morceaux ont été acclamés, notamment l’air de la Ribaude et le chœur mystico-guerrier, que je me permettrai de surnommer la Marseillaise du bon Dieu.
Je n’adresserai qu’un reproche à M. Gounod, c’est d’avoir, comme on dit, un peu trop cherché la petite bête.
Trop de souci du menu détail et peut-être pas assez des grandes lignes. Voilà mon impression sincère.
Je n’hésiterais pas non plus à couper dans le ballet la pasquinade médiocre intitulée : l’Enterrement d’une marionnette. C’est mesquin et déplacé, aussi bien comme tableau que comme musique.
C’est d’ailleurs l’unique critique qu’on puisse formuler en ce qui concerne la direction. Elle a semé à pleines mains, elle a été prodigue avec art. Savoir dépenser est une science aussi.
Tout est admirable, décors et costumes.
On se fait seulement cette réflexion en voyant les pierreries ruisseler sur les habits de la favorite et des seigneurs, qu’il est difficile de prendre ensuite au sérieux la pénurie du royaume en général et en particulier celle du roi qui, prétend-on, n’a plus de quoi acheter un poulet pour son dîner.
Ceux qui ont conservé les lugubres souvenirs du siège de 1870 n’ont pu s’empêcher de trouver aussi un peu folâtres les assiégés de la Gaîté avec leurs danseuses en maillot rose et leurs entrechats inattendus.
Mais soyons sérieux et disons un mot des interprètes ou plutôt de Mlle Lia Félix, car l’interprétation c’est elle.
Les autres rôles, Agnès Sorel, La Hire, etc., sont tous secondaires.
Mlle Lia Félix est une artiste de race douée surtout d’une sensibilité et d’une délicatesse auxquelles on ne résiste pas.
Elle a fait preuve de ses qualités ordinaires. Elle joue toutefois un peu étroit, si l’on peut parler ainsi.
Avec elle, le cas de Jeanne d’Arc devient trop une névrose.
J’aurais voulu plus d’onction et moins de saccades.
N’oublions pas en terminant de féliciter M. Albert Vizentini de la façon magistrale dont il a mené son orchestre.
Jeune comme il l’est [32 ans], M. Vizentini devint un futur chef désigné d’avance pour l’Opéra ou l’Opéra-Comique.
Le Gaulois, 14 novembre 1873
Article de Léon Duprat qui raille avec un humour cinglant, un certain critique radical (Le Rappel, 11 novembre) qui trouva la Jeanne d’Arc de Barbier trop éloignée du personnage historique telle que révélée par un manuscrit contemporain inédit : La vraye Jeanne d’Arc démocratyque et socyale.
Lien : Retronews
I
Un critique radical vient d’exprimer les regrets les plus vifs de ce que M. Jules Barbier, l’auteur de Jeanne d’Arc, ait compliqué et gâté son sujet par le sentiment monarchique et clérical. Un autre aurait tourné autour, aurait dit : il y a ceci, il y a cela ! Le critique radical va droit au but et, du premier coup, indique le défaut de la pièce : c’est d’avoir présenté Jeanne d’Arc comma cléricale et monarchique. En effet, il y a là un culte de la routine, une manie de l’ornière classique qu’on a peine à comprendre chez un homme de talent. M. Jules Barbier pourrait objecter qu’il a l’histoire pour lui ; que MM. Henri Martin et Michelet eux-mêmes ont fait courir le bruit du dévouement de Jeanne d’Arc au roi Charles VII et de la piété extatique de l’héroïne d’Orléans. Ces excuses ne sont pas sérieuses. D’abord, en admettant que Jeanne d’Arc ait été très pieuse, qu’elle ait cru en Dieu, au Christ, à la sainte Vierge et aux saints, ce sont là des superstitions d’un autre âge, et qu’il est puéril de remettre sous les yeux d’un peuple depuis longtemps éclairé par les flambeaux du Siècle et du Rappel.
De même pour la monarchie : il serait malheureusement vrai que la Pucelle d’Orléans ait eu un faible pour cette forme de gouvernement, qu’il ne faudrait pas révéler cette faiblesse à un public depuis longtemps payé, ou plutôt payant pour connaître la supériorité de la forme républicaine. Mais ce n’est là qu’une double hypothèse. Le besoin d’un critique sincère, d’un historien impartial qui rétablît la vérité des choses, se faisait vivement sentir. Enfin ce critique est venu : c’est le critique radical ci-dessus. À la suite de ses vifs regrets, il veut bien nous apprendre que Jeanne d’Arc était une fille du peuple qui avait un esprit très libre, qui résistait et commandait aux prêtres et qui a été fréquemment irrévérencieuse et presque rebelle vis-à-vis de Charles VII. Enfin ces paltoquets d’historiens, messieurs Henri Martin et Michelet y compris, ont trouvé quelqu’un pour les faire rougir de leur mauvaise foi et pour nous restituer la vraie Jeanne d’Arc, trop longtemps dissimulée sous des voiles menteurs.
II
Si je suis bien informé, le critique radical ci-dessus a découvert un manuscrit précieux absolument inconnu jusqu’à ce jour, et duquel émergent, comme la vérité de son puits, les révélations qu’on vient de lire. Seulement, comme il ne faut pas manger tout son bien en un jour, le critique n’a pas tout dit. Une indiscrétion me permet de compléter ses renseignements.
Dès sa plus tendre enfance, Jeanne d’Arc manifesta les sentiments démocratiques les plus avancés. À peine âgée de sept ans, un jour qu’on prononçait devant elle le mot de roi : Des rois ? s’écria-t-elle, il faut en finir c’est la république qui est le vrai gouvernement.
Ces paroles firent sur son père Jacques d’Arc et sur sa mère Isabelle Romée une impression d’autant plus profonde que ces braves gens n’y comprirent absolument rien, car on ignorait à cette époque heureuse ce que c’était que la république. En outre, ils constatèrent bientôt avec douleur que Jeanne n’avait aucune religion. Ainsi, la famille d’Arc recevait quelquefois, de quatrième main, par le notaire de l’endroit, quelques numéros de l’Univers. Eh bien ! toutes les fois que devant l’âtre le père de famille lisait à haute voix soit un remarquable premier-Paris de M. Louis Veuillot, soit un mandement d’évêque, leur fille manifestait la plus vive impatience. Ces excellentes gens étaient navrées, mais un dernier coup les attendait. Depuis quelque temps Isabelle Romée remarquait de la lumière dans la chambre de sa fille jusqu’à une heure assez avancée de la nuit. Un soir, Jacques d’Arc s’avança sur la pointe du pied et regarda par le trou de la serrure que vit-il ? Jeanne d’Arc, rayonnante d’enthousiasme, tenant à la main un numéro du Rappel et récitant par cœur un article de M. Vacquerie.
Comme on le pense bien, les parents saisirent cette feuille, introduite on n’a jamais su comment sous leur toit primitif. Mais l’amour de Jeanne d’Arc pour la république et la libre-pensée puisait dans la persécution une nouvelle force. Une nuit elle eut une vision, mais combien différente fut cette vision de celle que les historiens cléricaux et même non cléricaux se sont jusqu’ici obstinés à donner comme authentique ! Je laisse la parole au manuscrit précieux (La vraye Jeanne d’Arc démocratyque et socyale) découvert par le critique radical ci-dessus :
III
Adonc estoyt dans sa chambrette quand eust estrange vysion. Voyre ! lui sembla ung gros homme, ieune encore, barbu et à longs cheveux, dont ung œil estoyt immobile tandys que l’aultre s’agitoit et dardoyt la prunelle ains que les ieix ont accoutumance de faire. Et ce ieune homme gros et barbu, ay-je dit, souffloyt de toutes ses forces, dont ses ioues estoyent bouffyes et son œil mobile luy sortoyt de la teste, dedans une sorte de vessye qui se gonfloyt, se gonfloyt, tant et sy bien que tout d’ung coup le ieune homme se trouva sous elle suspendu dans les ayrs. Et dict alors :
Ie suis Gambetta ; mais ie ne doys venir que plus tard pour le bien de la France et le tryomphe de la Respublique. Soys mon précurseur et chasse les Anglois ; ie feroy mieux ung jour avec mon ballon, mais on ne peut tout faire à la fois.
Et en mesme temps dans ung nuage veit deux vieils hommes aux costés du ieune au ballon : l’ung au bec crochu et l’autre crespu de cheveux avec le nez camard, qui ensemble dirent : Ie suys Glays-Byzoyn ! Ie suys Crémyeux ! Nous ne devons non plus venyr que plus tard pour le byen de la France et le tryomphe de la Respublique. En attendant chasse les Anglois. Nous ferons myeux à Tours et à Bordeaux !
Et disparurent la layrant pénétrée d’admiration et cryant : Vive la Respublique ! Adonc alla à Bourges trouver le tyran Charles VII : luy dict son fayt, ains qu’aux curés, et chassa les Anglois. Mays ayant voulu establyr la Respublique démocratique et sociale ains que le luy enjoygnoit la vysion, feut victime de la coalition monarchique et cléricale.
Telle est la vraie histoire de la Jeanne d’Arc rêvée par le critique radical ci-dessus. J’ai, faut-il le dire, quelque idée que le manuscrit sur lequel il s’appuie a pour auteur le célèbre Vrain Lucas. En ce cas il faudrait peut-être en revenir quand même à la Jeanne d’Arc de la légende, pieuse, sainte, aimant son roi et sa patrie, et martyre. La libre-pensée et la République y perdront peut-être, mais la France a tout à y gagner.
Le Figaro, 15 novembre 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével.
Lien : Gallica
On s’étonnait que l’Oncle Sam ne fût pas l’objet d’un petit scandale.
Quoi ! une pièce de Sardou qui ne Soulève pas la moindre protestation !… cela n’est pas naturel.
La protestation est venue ce matin, et nous ne perdrons rien pour avoir attendu quelques jours.
Bref, M. Alfred Assollant publie, dans le XIXe Siècle, une très longue lettre où, après avoir dit à M. Sardou qu’il a pris dans ses Scènes de la vie des États-Unis les deux premiers actes et la dernière moitié du quatrième de l’Oncle Sam, il ne le prend pourtant à partie qu’au sujet du préjudice que lui a causé la non-représentation du Dieu Dollar.
Cette pièce, faite par M. Jules Barbier d’après le livre de M. Assollant, fut reçue jadis par M. Harmant, et elle allait entrer en répétition quand M. Sardou vint causer avec M. Carvalho, récemment nommé directeur du Vaudeville.
M. Sardou apprit alors qu’on préparait le Dieu Dollar.
Il réclama, disant qu’il se proposait, lui aussi, d’écrire une pièce américaine, qu’il avait un traité avec l’ancien directeur du Vaudeville, etc…
Bref, le Dieu Dollar fut rendu à M. Barbier.
C’est de cela que se plaint aujourd’hui M. Assollant, qui termine ainsi sa lettre, à M. Victorien Sardou :
C’est donc à vous, monsieur et cher confrère, que nous devons le manque de parole (sans doute involontaire), de M. Carvalho, et la perte d’argent qui en a été la conséquence inévitable. En un mot, vous avez pris mon paletot déjà taillé et cousu, et vous en avez fait un habit. La coupe est différente, mais la plus grande partie de l’étoffe est à moi. Vous m’avez donc causé un préjudice que je vous prie de réparer.
Quelques personnes d’essence sublime se récrieront peut-être à ce mot. Mais vous, monsieur et cher confrère, qui savez parfaitement qu’un livre, aussi bien qu’une maison, est une propriété, vous ne repousserez pas, j’espère, la proposition suivante, qui, sans aucun bruit ni débat, peut donner satisfaction à vous et à moi.
Vous choisirez parmi les gens de lettres nos confrères un arbitre. J’en choisirai un second. Ces deux réunis nommeront un troisième. Ils seront chargés tous trois de comparer l’Oncle Sam et les Scènes de la vie des États-Unis, de signaler la ressemblance, ou, si vous préférez, la coïncidence, et de décider, si la coïncidence, comme je le crois, est trop forte, dans quelle mesure je dois participer à vos droits d’auteur.
Je crois, monsieur et cher confrère, que vous ne pouvez avoir aucune raison solide de vous refuser cet arrangement, et je vous s prie d’agréer l’assurance de mes meilleurs sentiments.
Alfred Assollant.
La parole est l’accusé… à moins que M. Sardou n’envoie sa réponse par Peragallo, avec prière de passer à la caisse.
C’est douteux.
L’Univers illustré, 15 novembre 1873
Extrait du Courrier de Paris, par Gérôme (pseudonyme commun à plusieurs journalistes de l’Univers illustré).
Lien : Gallica
(Vue de l’Opéra avant l’incendie, page suivante.)
Avec l’Oncle Sam, M. Sardou a gagné une bataille personnelle. Avec Jeanne d’Arc, M. Jules Barbier a fait plus : il a gagné la cause du grand art dont, tous tant que nous sommes, critiques, littérateurs, directeurs de théâtre, nous commencions à désespérer. Et la victoire est ici d’autant plus belle que l’œuvre qui en est l’instrument est plus pure, que le sujet choisi par l’auteur est de ceux que leur élévation même semble exclure du domaine dramatique. Ce n’est pas la première fois qu’on a essayé de traduire sur la scène française cette admirable figure de Jeanne d’Arc ; les auteurs qui l’ont tenté, Soumet, tout le premier, n’ont pu aller au delà d’un succès d’estime. C’est que, si la carrière de Jeanne d’Arc présente toutes les conditions qui conviennent à l’épopée, des tableaux de guerre et de fête, l’intervention du merveilleux et du surnaturel, elle manque au contraire de celles qu’exige la contexture du drame, à commencer par la passion, avec ses élans et ses faiblesses, ses retours sur elle-même, ses chocs et ses combats d’où jaillissent les situations et les péripéties qui sont la vie même du théâtre. Schiller l’avait bien compris lorsque, s’étant épris du sujet de Jeanne d’Arc, il imagina d’introduire dans son drame l’élément amoureux. Jeanne d’Arc amoureuse ! Cette idée saugrenue ne pouvait venir qu’à un étranger et à un Allemand : jamais un Français ne se fût avisé de cette mascarade ridicule.
Qu’y a-t-il donc dans le personnage de Jeanne d’Arc qui puisse fournir à un écrivain dramatique matière à intéresser un public aussi léger que le nôtre, et le retenir dans une salle de théâtre pendant toute une soirée ? L’amour passionné de la patrie s’éveillant chez la bergère de Domrémy, inspirant l’héroïne dans le feu des batailles et soutenant son courage jusque sur le bûcher, puis le spectacle de cette carrière si courte et si glorieusement remplie ; après Domrémy et Vaucouleurs, Chinon, Orléans, Paris, Compiègne, Rouen, est-ce suffisant ? M. Jules Barbier ne l’a pas pensé, et sans toucher en rien à la légende ni à l’histoire, il a trouvé pour son œuvre un nouvel élément. Ces voix qui parlaient à Jeanne d’Arc, ces visions mystiques qui, ainsi que l’explique Lamartine dans une page magnifique, pouvaient être des illusions sans être des mensonges
[Jeanne d’Arc, 1852], M. Barbier les a personnifiées et, en les personnifiant, il en a tiré des effets d’une grande puissance dramatique. Je citerai, puisque me voici sur ce chapitre, la scène finale du premier acte, où la pauvre enfant voit apparaître les deux saintes qui lui apportent les ordres du ciel. C’en est fait ; il faut qu’elle renonce à sa chaumière, à son village, qu’elle quitte, sans même leur dire adieu, son vieux père, sa mère, ses sœurs. En vain elle se débat, en vain elle implore un sursis. — Demain, demain ! s’écrie-t-elle. — Non, répondent les voix. — Et alors, entraînée par une force supérieure, elle s’éloigne, brisée, haletante, pour aller accomplir sa mission divine. Cette scène, que le jeu de Mlle Lia Félix met d’ailleurs en relief d’une façon saisissante, a produit un immense effet.
Mais pour cet élément nouveau il fallait une forme nouvelle qui se prêtât à l’introduction du merveilleux dans le domaine tragique. Cette forme, M. Jules Barbier a cru là trouver dans le drame lyrique, c’est-à-dire dans l’union par juxtaposition de la poésie et de la musique. La tentative n’était pas nouvelle. Ponsard avait ouvert la voie par ses chœurs d’Ulysse. En mêlant d’une façon plus intime les deux arts jumeaux dans son drame des Deux Reines, où il eut aussi Gounod pour collaborateur, M. Legouvé fut moins heureux. Nous avions constaté à regret le succès négatif de cette dernière épreuve. Celle-ci a été décisive en sens contraire. Soit que le sujet se trouvât mieux approprié à la forme nouvelle, soit que les dispositions du public fussent meilleures, les spectateurs de la Gaîté se sont montrés enthousiastes là où ceux de la salle Ventadour étaient restés froids. Le poème et la musique de Jeanne d’Arc sont allés aux nues l’un portant l’autre. Désormais le drame lyrique a conquis droit de cité dans le théâtre moderne.
Dans son beau drame, M. Jules Barbier suit pas à pas l’héroïne populaire, depuis son départ de la maison paternelle jusqu’à son martyre. Au second acte et au quatrième, il la met en présence d’Agnès, la maîtresse du roi. De cette rencontre naissent deux scènes, ingénieuses sans doute, mais dont l’influence sur l’action est plus apparente que réelle, et l’on se demande alors si c’était bien la peine de faire violence à l’histoire pour un résultat si mince. Le reste de la pièce retrace, sous la forme dramatique que lui a donnée le poète, la vie de Jeanne d’Arc, telles que nous l’ont transmise les annalistes et les chroniqueurs. M. Jules Barbier a surtout tiré un excellent parti des réponses de la Pucelle recueillies dans son procès original et qu’il a eu soin de reproduire dans leur charmante naïveté. Le dernier acte, celui de la prison, lui fournissait une plus ample carrière. Il y a trouvé le sujet d’une scène entraînante, d’une énergie et d’une émotion irrésistibles. Il suppose, et le fait malheureusement ne s’accorde que trop ici avec l’histoire, qu’un des geôliers de Jeanne d’Arc est venu lui proposer un infâme marché. Voici la réponse de la prisonnière :
Jeanne
Ainsi je vais mourir,
Et ce n’est pas assez ! Vous voulez me flétrir
Ut prouver par mon crime, aux chrétiens effroyable,
Que vous n’avez été battus que par le diable !…
Allez ! je vous comprends !… C’est la France et son roi
Que vous voulez flétrir et souiller avec moi !…
Eh bien ! je vous le dis, quittez cette espérance !
Vous pouvez me tuer et mutiler la France
Mais vous ne pourrez pas, milord, sachez-le bien,
Asservir à la honte ou son cœur ou le mien.
Vous pouvez, de ce peuple élargissant la plaie,
Cadavre encore vivant, le traîner sur la claie
Et punir ma victoire et m’en payer le prix,
Mais non pas nous soumettre à nos propres mépris !
Le même honneur tous deux nous garde et nous enflamme.
Je connais mon pays ; il m’a donné son âme !…
Il se redressera comme moi sous l’affront !
C’est quand il est perdu qu’il relève le front
Faites, faites sur lui peser le joug des armes !
Noyez-le tout entier dans le sang et les larmes !
Reculez sa frontière, ivre de vos succès !…
La France renaîtra dans le dernier Français !…
Que le temps soit à vous… La France aura pour elle
Dans l’avenir certain la justice éternelle !…
Et plus loin le bourreau pousse l’iniquité
Plus haut va le martyr dans l’immortalité !…
Maintenant que le feu me brûle et me dévore !
Mon corps, fait de limon, pourra trembler encore,
L’âme est libre, il suffit !… le tourment dure peu !
Et la France est ainsi ; c’est le plaisir de Dieu !
Warwick
Infâme, c’est la mort que tu veux ?
Jeanne
Je l’appelle !…
Auprès de votre amour la mort redevient belle !
Assurément voilà de beaux vers, où l’expression est à la hauteur de la pensée, qui ne doivent rien à l’outrance de la couleur ni au charlatanisme de la rime. Tout le dernier acte est écrit dans ce langage sobre, élevé, vigoureux, qui est le véritable style dramatique. Mais la forme eût-elle été moins parfaite que cet acte n’en eût pas moins profondément ému les spectateurs. Lorsque Jeanne a marché au supplice, lorsqu’elle est montée sur le bûcher, bénissant à la fois ses juges infâmes et son ingrate patrie, des larmes coulaient de tous les yeux, et quand le rideau s’est baissé, des applaudissements enthousiastes ont salué le nom de l’auteur de cette œuvre magistrale.
Un autre triomphe qu’il me faut m’empresser de signaler est celui qu’a remporté Mlle Lia Félix. Dans tout le cours de ce rôle écrasant, et notamment au dernier acte, elle s’est élevée à l’apogée de l’art. Émotion, sensibilité, noblesse, inspiration, héroïsme, indignation, enthousiasme, toutes ces nuances si diverses ont été rendues par la grande artiste avec un talent qui touche au génie. Lorsque dans sa prison elle a écrasé sous ses mépris l’infâme qui venait la séduire, le nom de Rachel était sur toutes les lèvres.
Dans cette bataille qui n’était pas sans danger, étant donné le public habituel de l’endroit, MM. Clément Just, Desrieux, Angelo, Reynald et Mlle Tessandier, ont vaillamment secondé Mlle Lia Félix.
Je regrette que le défaut d’espace ne me permette pas aujourd’hui d’analyser, avec tout le soin respectueux qu’elle mérite, la partition de Gounod. J’y reviendrai quelque jour en détail. Quant à présent, je me borne à signaler parmi les plus belles pages : le finale du premier acte et le chœur Nous fuyons la patrie, qui le précède ; au troisième, le ballet et la chanson de la ribaude, au cinquième enfin la marche funèbre. Les chants de guerre et la marche triomphale m’ont paru moins bien réussis. La corde mystique, religieuse et tendre, convient mieux à Gounod que la corde héroïque.
À cette œuvre hors ligne, la nouvelle direction a donné un cadre digne d’elle. La mise en scène, les décors, les costumes, les armes sont d’une splendeur qui eût excité, il y a quinze jours encore, la jalousie de M. Halanzier. Et maintenant, après la Jeanne d’Arc d’Offenbach, à quand sa Jeanne d’Arc à lui, après celle celle de Barbier et de Gounod, à quand celle de Mermet ?
Le Monde illustré, 15 novembre 1873
Extrait de la chronique Théâtres, par Charles Monselet.
Lien : Gallica
M. Michelet, qui prend souvent l’histoire par ses petits côtés, comme il convient qu’on la prenne, a raconté ce trait touchant : J’entrais un jour chez un homme qui a beaucoup vécu, beaucoup fait et beaucoup souffert. Il tenait à la main un livre qu’il venait de fermer, et semblait plongé dans un rêve ; je vis, non sans surprise, que ses yeux étaient pleins de larmes. Enfin, revenant à lui-même : — Elle est donc morte ! dit-il. — Qui ? — La pauvre Jeanne d’Arc.
Et Michelet ajoute : Telle est la force de cette histoire, telle est sa tyrannie sur le cœur, sa puissance pour arracher les larmes ! Bien dite ou mal contée, elle fera toujours pleurer.
Le célèbre historien avait raison : Jeanne d’Arc vient encore une fois de faire pleurer, non des lecteurs, mais des spectateurs. On ne compte plus les pièces de théâtre qu’elle a inspirées ; celle de M. Jules Barbier, sans faire oublier celle de Soumet, se distingue par une fidélité plus absolue à l’histoire ; il y a tels passages, principalement dans l’interrogatoire, qui sont presque littéralement traduits du procès. Mais, au fond, cela n’est guère qu’une biographie. Cela pouvait-il être autre chose ? Un homme de génie répondrait peut-être oui.
L’analyse d’une pièce intitulée Jeanne d’Arc est inutile, n’est-ce pas ? L’action suit pas à pas les étapes de la légende : Domrémy, Chinon, Orléans, Reims, — et finalement Rouen. Malgré les sept tableaux annoncés, l’auteur a dû rejeter en récits un grand nombre d’épisodes, ce qui donne parfois à son drame un accent de tragédie. On ne sait trop, d’ailleurs, comment classer l’œuvre de M. Jules Barbier, car c’est aussi un livret d’opéra : M. Gounod y a mis des chœurs, des marches et des contre-marches ; cela regarde mon voisin Lasalle [voir ci-dessous]. Quoi qu’il en soit, il résulte de tous ces éléments un magnifique spectacle. Là aussi, la mise en scène épuise ses somptuosités.
Rien ne peut se comparer au succès obtenu par Mlle Lia Félix dans le rôle de la sainte guerrière. Cette création dominera toute sa carrière d’artiste, déjà si bien remplie.
Extrait de la Chronique musicale, par Albert de Lasalle.
Le théâtre de la Gaîté fait une campagne très-hardie. Il prétend être tour à tour lyrique et littéraire. En ce moment, il essaye même de mériter les deux adjectifs à la fois. La Jeanne d’Arc qu’il représente tous les soirs est un pur mélodrame, dans l’acception où le mot s’entend quand on parle de l’Egmont de Beethoven, du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, ou du Struensée de Meyerbeer ; c’est-à-dire un drame entrecoupé de quelques morceaux de musique, tels que ouverture, chœurs, chansons, ballets et marches.
Mon ami Monselet vous dira, comme il sait dire, ce qu’il pense de l’œuvre de M. Jules Barbier, tandis que peut-être vous me demanderez quelques commentaires sur la partition de M. Gounod. Mais je serai bref, car je souffrirais trop de n’avoir pas à applaudir une musique dont la noble intention était d’illustrer une des grandes pages de l’histoire de France.
Jeanne d’Arc est une héroïne au cœur vaillant et au bras d’acier ; M. Gounod n’a vu en elle qu’une sainte du paradis, et il l’a entourée, comme dans des nuages d’encens, d’une musique virginale, plus propre à être chantée au catéchisme que sur le champ de bataille. Or, ni le chœur patriotique qui termine le second tableau, ni la chanson de soldat qui égaye les scènes du rempart d’Orléans, n’ont pu troubler l’impression générale que nous avons ressentie, et qui est celle qu’on éprouve après l’audition d’un oratorio.
M. Gounod a un sentiment très-net de l’art sacré ; mais il a souvent le tort de porter au théâtre sa musique d’église. Pourtant les voûtes d’une cathédrale et les frises d’une salle d’opéra, n’ont point les mêmes échos et appellent des chants distincts.
Nous n’avons pas besoin de dire tous les vœux que nous formons pour le succès du théâtre de la Gaîté dans ses tentatives musicales. D’ailleurs, à cet égard, nous pouvons nous reposer sur le bâton de mesure que tient d’une main si ferme le chef Albert Vizentini.
Vert-vert, 15 novembre 1873
Article d’Étienne Desgranges.
Lien : Retronews
C’est un très grand succès pour le théâtre de la Gaîté, et un magnifique triomphe pour la principale interprète de la pièce, Mlle Lia Félix.
Voilà ce que tout le monde disait avant-hier en sortant du théâtre. Il était une heure et demie du matin. La représentation avait commencé à sept heures et personne n’avait trouvé le temps long.
Jeanne d’Arc est une héroïne qui, en tout état de cause, ne pouvait qu’être accueillie avec transport dans le moment où nous sommes. Jeanne d’Arc c’est la France glorieuse, libre, et délivrée de l’étranger ; Jeanne d’Arc c’est la personnification la plus pure du patriotisme, du dévouement, de la foi ardente qui accomplit des miracles. La France, malheureuse dans le présent, trouvera plus d’une consolation et plus d’une espérance dans la contemplation de son passé.
M. Jules Barbier avait, il y a quelques années, destiné au Théâtre-Français, le drame émouvant qu’il nous présente aujourd’hui enrichi dit la splendide musique de M. Gounod. Le Théâtre-Français, qui a déjà une Jeanne d’Arc dans son répertoire, ne crut pas devoir accepter celle de M. J. Barbier. En bonne conscience, il n’y a pas à le regretter. L’œuvre a pris des proportions considérables et la musique en rehausse brillamment le mérite poétique. Ajoutez des merveilles de mise en scène qui lui font un cadre éblouissant. On n’a rien fait, on ne fera jamais rien de plus beau, et voilà le théâtre de la Gaîté assuré de cent représentations… au moins.
Il nous serait difficile, en raison de l’espace restreint dont nous disposons, d’analyser les cinq actes dont se compose ce drame remarquable. Nous pouvons dire seulement que M. Jules Barbier a été on ne peut mieux inspiré et qu’il a fort habilement et très dramatiquement traité un sujet que nul Français n’ignore, qu’il a mis en lumière la grande et chaste figure de la vierge héroïque, que son drame intéresse, attache, attendrit et par moments remue profondément l’âme du spectateur. Les vers sous fort beaux, et il est difficiles d’exprimer des sentiments plus nobles, plus élevés, plus ardents, dans une langue plus harmonieuse et plus virile.
Le drame est coupé par des chœurs, dont la réunion constitue une partition d’une importance considérable. Au deuxième acte, une chanson patriotique écrite avec une verve charmante et dite par les masses vocales avec une rare énergie, a été bissée. Citons aussi la ballade du prisonnier, d’un style mélancolique et expressif, très bien chantée par Mlle Perret, et enfin une chanson de ribauds, qui a valu un vrai succès à Mlle Durieu.
Nous avons parlé de Mlle Lia Félix ; cette éminente actrice, en effet, peut à bon droit être fière de son triomphe… Elle a été tout simplement admirable ; le rôle est écrasant, elle le porte avec une aisance surprenante ; elle le joue, elle le détaille avec un incomparable talent.
C’est le type idéal de l’innocente et radieuse jeune fille, de la douce et vaillante guerrière, de la divine et touchante victime dont on prononce le nom avec autant d’attendrissement que d’admiration et de fierté. La manière dont Mlle Lia Félix a composé et reproduit cette angélique et noble figure a plus d’une fois fait penser à son illustre sœur, la grande et à jamais regrettable Rachel.
Clément Just, Desrieux, Angelo, Stuart ont largement contribué au succès de la pièce. Mlle Tessandier a remarquablement joué se rôle d’Agnès Sorel.
Tous les décors sont merveilleux, nous l’avons dit. Citons pourtant parmi les plus beaux le tableau du premier acte (l’apparition des saintes), une vue d’Orléans vraiment pittoresque et splendide, et le tableau du Sacre dans la cathédrale de Reims dont l’effet a été inouï.
Nous devons nous borner aujourd’hui, à ces quelques lignes, mais nous aurons l’occasion de revenir sur ce succès.
Le Ménestrel, 16 novembre 1873
Extrait de la Semaine théâtrale.
Lien : Gallica
Décidément, les Italiens redeviennent à la mode. Du reste, malgré les préoccupations publiques, la plupart de nos théâtres encaissent de superbes recettes : La Jeanne d’Arc de MM. Jules Barbier et Charles Gounod fait salle comble à la Gaîté ; l’Oncle Sam du Vaudeville était réellement l’oncle d’Amérique attendu, et la Quenouille de verre des Bouffes-Parisiens se transforme en vraie Quenouille d’or.
Le Temps, 17 novembre 1873
Extrait de la Chronique théâtrale de Francisque Sarcey, en feuilleton.
Lien : Gallica
La Gaîté nous a donné, cette semaine, Jeanne d’Arc, drame en vers et avec chœurs, en cinq actes et sept tableaux, de M. Jules Barbier, pour les paroles, et de M. Gounod, pour la musique.
La Jeanne d’Arc de la Gaîté, vient de prouver une fois de plus combien il est prudent de ne pas trop se fier aux impressions que l’on emporte d’une première représentation. Nous en sommes sortis presque tous secouant la tête [lire ses quelques lignes du 10 novembre], et le succès nous en paraissait bien incertain en dépit des acclamations qui avaient accueilli les beaux vers du dernier acte. La pièce nous avait paru longue, et il est vrai que l’on en a retranché depuis quelques épisodes inutiles ; fatigante, et, il faut dire que les entractes avaient été, selon l’usage, interminables, et que le spectacle avait poussé jusqu’à une heure du matin. Et puis, toute une partie du public avait manqué de respect et de recueillement. C’était la plus haut perchée ; mais ses lazzi, pour tomber du quatrième étage, n’en troublaient pas moins l’attention d’un public plus poli. Peut-être aussi avait-on senti plus vivement certains défauts très réels de l’œuvre sur lesquels, à cette heure, on a passé condamnation.
Tant il y a que la pièce s’est très brillamment relevée aux représentations suivantes. J’y suis retourné hier ; non-seulement la salle était toute pleine, mais pleine d’un public de choix, qui a écouté d’un bout à l’autre la légende de Jeanne d’Arc avec une évidente sympathie. J’y ai pris moi-même beaucoup plus de plaisir que le premier soir, et je ne serais pas étonné que cette tragédie sacrée ne fit autant d’argent qu’une opérette. On ira la voir en famille.
Si j’avais même un conseil de professeur a donner aux mères, ce serait de mettre entre les mains de leurs filles l’histoire de Jeanne d’Arc par M. Michelet. Elle se vend à part dans un petit volume dont le prix est fort modique. La lecture faite, et je n’en sais pas de plus émouvante, on irait ensemble à la Gaîté ; ce serait une excellente leçon d’histoire, et l’on apprendrait ainsi sur Jeanne d’Arc tout ce que les gens du monde sont tenus d’en savoir.
M. Jules Barbier a évidemment eu raison d’écrire son drame, puisque nous y avons passé une bonne soirée. Mais ce drame même n’a fait que mieux me convaincre que la légende de Jeanne d’Arc était de tous les sujets le moins propre à être porté sur la scène. Le théâtre ne vit que de contrastes, de passions qui se heurtent, et dont les péripéties excitent la curiosité ou l’émotion. Il n’y a qu’une passion en jeu dans toute cette histoire, l’héroïsme, et encore l’héroïsme sous une forme bien particulière, et peu accessible au commun des hommes : l’héroïsme extatique. Une fois qu’il paraît, il domine tout, il emporte tout ; pas l’ombre d’une lutte ; pas ombre de drame, par conséquent.
Le respect même qu’impose à l’écrivain cette grande figure de Jeanne d’Arc, empêche de lui attribuer la moindre faiblesse. Quelques poètes ont cru bien faire de lui donner des sentiments plus humains, espérant en tirer des effets de vérité dramatique. Ils en ont été punis par le ridicule. Jeanne d’Arc n’est plus Jeanne d’Arc, si on lui prête une autre idée que celle de tirer la France des mains de l’Anglais. C’est un idéal de pureté, de chasteté, de grandeur et d’héroïsme rien de terrestre ne saurait la souiller. Dieu respire et agit en elle, mais Dieu n’a jamais été un personnage de comédie.
Sans doute, il est possible (et M. Jules Barbier l’a tenté assez heureusement) de lui opposer les défiances des vieux capitaines et les intrigues des courtisans dépités ; mais l’obstacle est si vite et si aisément surmonté ! Jeanne entre, et elle emplit tout aussitôt la scène de son éclat rayonnant ; elle attire, elle absorbe toute l’attention ; les autres ne sont plus que des comparses, sans couleur et sans vie. J’ignore si un poète plus puissant que M. Jules Barbier n’aurait pas pu donner à ces physionomies plus de relief, s’il n’aurait pas pu faire leur intervention plus active dans les événements, et par là exciter et suspendre l’intérêt ; je ne le crois pourtant pas.
Il faut compter avec les préventions qu’apporte un public français, à qui l’on a promis une Jeanne d’Arc. Il s’est fait de l’héroïne de Vaucouleurs une image si éblouissante, qu’il souffrira à la voir toucher même du bout du pied l’humaine fange des intrigues politiques. Nous ne savons pas trop à cette heure comment les choses se sont passées en ce temps-là. Michelet laisse soupçonner qu’il y avait un parti à la cour qui s’est servi de Jeanne comme d’un merveilleux instrument, inopinément tombé du ciel, et que d’autres, au contraire, dont elle traversait, sans le savoir, les obscurs desseins, lui ont fait une opposition déclarée ou sourde, et lui ont dressé toutes sortes de pièges.
Tous ces manèges de cour pourraient, dans un autre sujet, former des scènes de drame, puisque on y verrait des passions aux prises. Mais ici, nous sommes en pleine légende, et cette légende est sacrée. Que l’écrivain les marque d’un trait, voilà qui est bien. Mais s’il y insiste, il dérange l’idéal que nous avons apporté. Une pièce intitulée Jeanne d’Arc doit, pour plaire à nos préjugés, flotter entre ciel et terre. Mais si la poésie lyrique, si l’épopée même s’accommodent de personnages et d’événements surhumains, qui emportent l’imagination dans les espaces, le théâtre préfère la réalité de la vie, celle que l’on touche de la mains.
S’il est presque impossible de trouver dans les intrigues de la cour un moyen de varier l’intérêt, il est bien difficile aussi d’exprimer à la scène, sous une forme concrète et vivante, l’enthousiasme du peuple. On parle beaucoup de l’art avec lequel Shakespeare sait faire parler les foules. Mais si la multitude intervient parfois dans ses drames, elle n’y joue pas le premier rôle ; elle n’est pas d’un bout à l’autre partie principale.
C’est le peuple qui a tout fait dans la légende de Jeanne d’Arc. Tandis que les sages doutaient, elle s’est jetée en avant, et il a suivi, emporté du sentiment qui l’animait. Nous avons moins de peine que n’en avaient sans doute les La Harpe du temps passé à comprendre ces entraînements populaires. Il n’y a qu’une chose vraiment grande dans le siège de Paris que nous venons de subir, c’est l’invincible résolution d’un million d’hommes, qui s’étaient butés à cette idée unique : nous ne nous rendrons pas. Les gens d’un sens froid avaient beau démontrer que la résistance, ainsi prolongée, était absurde, et qu’elle coûterait des milliards ; la population tout entière, poussée d’une même rage d’entêtement, ne savait répondre qu’un mot : nous ne nous rendrons pas. Et certes, il ne faut pas comparer notre paisible humeur bourgeoise et notre scepticisme parisien à la foi qui échauffait les imaginations violentes de ces temps crédules.
Mais comment transporter à la scène ces sentiments collectifs, et leur donner une expression qui frappe. L’artifice ordinaire des poètes est de les personnifier dans un homme, qui ramasse en lui toutes les passions de la foule, et qui les déploie dans le drame. Mais c’est là précisément, dans un sujet comme celui de Jeanne d’Arc, que gît la difficulté. Si vous créez un héros de cette sorte, il fait double emploi avec Jeanne d’Arc. Ou il n’est qu’un reflet, qu’un écho et alors à quoi bon cette pâle doublure ? ou il a une vie propre et une physionomie distincte, et en ce cas il distrait l’attention qui se détourne de la figure principale. Vous retombez dans l’inconvénient que je signalais tout à l’heure.
M. Jules Barbier s’est donc résigné à mettre la foule en scène et à lui donner une voix. Au troisième acte, on est devant Orléans les conseillers du roi et les meilleurs capitaines ont décidé que ce serait une folie d’attaquer les Anglais fortement retranchés. Jeanne, désespérée de leur peu de foi, mais confiante en ses saintes, déclare qu’elle ira toute seule, son étendard à la main, et que ceux qui croient en elle la suivront.
— Tous ! tous ! s’écrient les soldats et les hommes du peuple.
Tous, tous ! oui, oui ! et quelques phrases dites par-ci par-là par un figurant, c’est ainsi qu’au théâtre s’exprime la voix du peuple. Et l’un des capitaines dit à part à ses collègues :
— Nous sommes débordés !
Il a raison de le dire, car on ne s’en douterait pas.
Non, les sentiments collectifs n’arrivent à l’expression au théâtre, que s’ils sont rassemblés en un personnage qui les représente, et le rôle de ce personnage serait impossible dans le sujet de Jeanne d’Arc. Ou plutôt, car en art dramatique il n’y a d’impossible que ce qui n’a pas encore été bien fait, ce rôle ne nous semble pas compatible avec les nécessités de la donnée première.
Je ne sais lequel de nos confrères, en parlant de l’œuvre de M. Jules Barbier, a prononcé le mot mystère. Il a dit plus vrai encore qu’il ne pensait peut-être. La Jeanne d’Arc est un mystère, au vrai sens du mot ; car elle a été taillée sur le patron qui a servi pour les premiers monuments de l’art dramatique, encore en son enfance.
Que faisait un écrivain de mystères ? Il prenait une légende, soit de l’Ancien, soit du Nouveau Testament, et il en découpait les principaux épisodes, reproduisant de son mieux l’histoire connue, l’accommodant de propos délibéré ou par des scrupules de piété personnels aux idées courantes de son temps, sans se soucier de donner à son action la moindre unité, ni de peindre des personnages, sans se conformer à aucune des lois qui régissent la composition de ces sortes d’œuvres. Il était content s’il avait montré Jésus au premier acte naissant dans une crèche, et mourant sur la croix au dernier ; il introduisait, sans compter, des centaines de personnages dans le cours de son drame et les retirait quand il n’en avait plus besoin. Tout son art, si tant est qu’il y eût là-dedans le moindre art, consistait dans le choix des épisodes, reproduits de préférence.
Ce que les Gringoire du temps passé faisaient avec la naïveté de l’ignorance, M. Jules Barbier l’a repris de dessein formé. Il est revenu à cette vieille méthode, contraint par un sujet qui n’en souffrait pas d’autre. Il a compté, pour nous intéresser, sur notre pieuse et patriotique dévotion au souvenir de la vierge héroïque ; le succès lui a donné raison, et nous n’y trouvons rien à redire, parce que la contagion de ce système n’est pas bien dangereuse.
Il a appelé la musique à son aide. Je ne voudrais pas marcher ici sur un terrain qui est réservé à mon collaborateur M. Weber [critique musicale du 18 novembre]. Je me bornerai donc à quelques considérations générales qui ne relèvent que de l’esthétique du théâtre.
Je n’aime pas beaucoup l’alliance de la musique avec le drame. Non pas qu’elle soit condamnable en soi ; c’est une convention tout comme une autre. Si l’on convient que des personnages, au lieu de parler en simple prose, peuvent exprimer leurs pensées et leurs sentiments dans un langage cadencé ; si l’on convient qu’au lieu de les produire en vers ils les chanteront avec accompagnement d’orchestre, il n’est pas assurément plus difficile de convenir que tantôt ils se serviront d’une de ces deux langues et tantôt de l’autre, suivant la nature des sentiments que le poète mettra dans leur bouche.
Cependant la musique est une langue si puissante, dont l’effet est si sensible sur l’imagination et sur les nerfs, qu’il est bien difficile, si on lui laisse prendre un pied, qu’elle n’en prenne pas aussitôt quatre. Je doute qu’entre le drame pur (soit en prose, soit en vers) et l’opéra, on trouve jamais un genre intermédiaire, composé de l’un et de l’autre, qui soit bien fécond en œuvres remarquables. Le dialogue parlé ne se comprend plus que pour les sutures du drame, pour les explications, dont l’intelligence de l’action exige la connaissance mais qui ne vaudraient pas la peine d’être mises en musique aussitôt qu’on arrive à la situation aussitôt qu’un grand sentiment est en jeu, l’oreille, impérieusement, réclame l’intervention de l’orchestre le vers idéal n’exerce plus qu’une sensation bien affaiblie.
S’il y a néanmoins un sujet au monde où cette alliance de la déclamation et du chant semble naturelle, c’est bien celui de Jeanne d’Arc. Comment le traiter, sans mettre en scène les apparitions célestes, et de quelle autre langue sauraient-elles se servir que de celle des anges, qui chantent éternellement les louanges du Seigneur en s’accompagnant de la harpe.
Une fois la musique introduite dans le drame, elle y trouve des places toutes marquées ; la marche triomphale du roi, se rendant à l’église de Reims, la marche funèbre de Jeanne s’avançant au supplice, un chant de combat patriotique, s’exhalant des voix de la foule, et quelques autres encore moins importantes. Ainsi, la tradition veut que Jeanne ait chassé de l’armée les femmes de mauvaise vie qui l’infestaient ; nous pourrons donc avoir une chanson, un chœur et un ballet de ribaudes. Ce sont là des espaces expressément indiqués pour la musique et ce sont aussi ceux que le poète a réservés au compositeur. J’ai bien mon idée sur la valeur des morceaux que M. Gounod a ainsi cousus à l’œuvre de son collaborateur ; mais M. Weber se connaît mieux que moi et a plus d’autorité en ces matières.
Le grand, le premier mérite de M. Jules Barbier dans sa Jeanne d’Arc, c’est la foi dont elle témoigne, ou, si ce mot tous semble trop ambitieux, c’est la profonde et respectueuse sympathie pour son sujet. Peut-être y a-t-il cru ; mais à coup sûr il en a eu l’amour. Il s’est senti pris pour cette grande et charmante figure, d’une vénération mêlée de tendresse qui respire dans toute son œuvre et la parfume.
Il n’a rien ajouté à la légende ; il n’en a rien ôté non plus, que certains détails qui auraient effarouché nos pudeurs contemporaines. Il a enchâssé avec un soin pieux et un rare bonheur d’expression les réponses sublimes que la tradition prête à Jeanne d’Arc. Tous les sentiments dont il a mis l’expression dans sa bouche, il en a trouvé l’indication première dans les récits de l’histoire. Il a pris à tâche de ne rien inventer il a choisi les détails les plus caractéristiques et les a mis en œuvre avec habileté et émotion ; c’est ce qu’il avait de mieux à faire.
Si ce système lui a mieux réussi dans les deux derniers tableaux que dans les cinq premiers, c’est que là, le pathétique de la situation et la grandeur des idées l’ont soulevé de terre. Il a mis en beaux vers ces répliques étonnantes, merveilleuses de simplicité, de bon sens et de fierté héroïque que nous a transmise la relation officielle du procès fait à Jeanne. J’ose dire qu’il n’est personne qui ait pu les entendre sans en être touché jusqu’aux larmes.
C’est là vraiment qu’on voit ce que vaut ce public de première représentation, si souvent calomnié. Les premiers actes nous avaient chagrinés, je l’avoue, un peu plus qu’il ne fallait, et bien plus qu’ils n’ont fait depuis, mais ce dernier nous avait transportés ce soir-là d’une admiration dont je n’ai retrouvé, qu’un écho affaibli le cinquième ou le sixième jour. Nous sentons, je crois, plus vivement. On s’ennuie à périr, ou l’on rit à se tordre, ou l’on pleure à chaudes larmes. On se passionne davantage pour ou contre. Les publics des jours suivants se font plus volontiers une moyenne. je retournerai un de ces jours à l’Oncle Sam. J’imagine que je n’éprouverai plus la même vivacité de plaisir aux endroits qui m’ont plu, que je ne sentirai plus le même agacement aux scènes que j’ai trouvées mauvaises. C’est affaire de milieu.
Mlle Lia Félix était chargée du rôle de Jeanne d’Arc. Voilà bien longtemps que Mlle Lia Félix, malgré des qualités supérieures de diction et un talent incontestable, était tenue éloignée de la scène, et qu’elle courait après un bon rôle qui la fuyait toujours. Il n’y a qu’heur et malheur en ce monde. Elle a eu son jour de chance, et cette création comptera, dans sa carrière d’artiste, comme une des premières.
Ce n’est pas qu’elle soit parfaite, il s’en faut de beaucoup ; mais elle y est supérieure par endroits, et c’est bien quelque chose. Cette nature maigre, un peu sèche, dont la voix n’a rien de mouillé ni de tendre, est peu faite pour rendre les extases du premier acte. Elle n’a pas l’organe assez riche, ni le débit assez nuancé pour varier la monotonie d’un héroïsme uniformément guerrier. Elle a fort bien dit, mais sans onction pénétrante, la grande scène du quatrième acte, où elle retrouve sa famille et l’embrasse en pleurant.
Où elle s’est retrouvée grande tragédienne, c’est au dernier acte. De ce petit corps chétif, qu’on dirait brûlé d’une indomptable résolution, s’échappe une voix toute pleine de sonorité vibrante, dont l’effet est irrésistible. Quand le juge lui reproche que son étendard est ensorcelé, et qu’elle répond que sa seule sorcellerie était de le prendre en main et de marcher en avant :
Je leur criais entrez ! et j’entrais la première.
Elle a lancé ce vers avec une merveilleuse énergie, dont la salle a tressailli tout entière. Elle a dit aussi dans un admirable sentiment de fierté patriotique, tout un couplet où le poète parle de cette indestructible nation française, qui se relève toujours de ses chutes les plus profondes, et tire de ses revers le meilleur de sa gloire.
Elle à été superbe d’un bout à l’autre de ce cinquième acte, qui est le point culminant de l’ouvrage ; et si elle m’a paru manquer d’éclat dans quelques endroits, c’est peut-être autant l’écrivain qu’on en doit accuser que l’actrice. Ah ! si la conviction suffisait à faire les grands poètes ! Mais il y faut quelque chose de plus. Et quoi ? Dame ! le don, le je ne sais quoi, l’au delà. C’est précisément cet au delà qui fait trop souvent défaut dans la pièce de M. Jules Barbier.
Le vers est correct et ferme ; il plaît par son air de probité vaillante et émue ; il n’a que rarement le jet lumineux de l’étincelante métaphore ; la magnifique et compacte sonorité de la tirade à la Corneille ou à la Victor Hugo. Il satisfait l’esprit sans ébranler l’imagination. Il est toujours d’un honnête homme qui le fait bien ; il n’est que rarement d’un grand poète. Et le sujet est par malheur de ceux qui exigent impérieusement ces qualités d’éclat.
Après Mlle Lia Félix, il n’y a plus guère d’artistes à signaler. Tous les autres rôles sont effacés par elle. Celui d’Agnès est tenu par Mme Tessandier, qui n’a que bien peu de grâce personnelle. Clément Just donne assez d’accent au personnage de La Hire ; Angelo représente agréablement Charles VII ; Desrieux n’est pas joli, joli, privé de barbe, sous sa perruque rousse.
La mise en scène est très voyante, et plus faite pour éblouir les yeux que pour les charmer. On a cependant paru fort satisfait ; et il est certain que l’on ne peut pas demander à la Gaîté le goût exquis et riche des décorations et des costumes de l’Opéra. Offenbach a très bien fait les choses, et il faut lui savoir gré d’avoir hasardé tant d’argent à montrer une pièce dont il ne devait guère espérer qu’un succès d’estime. Il aura été tort heureusement trompé dans ses prévisions, et fera recette malgré lui.
Le ballet nous avait beaucoup choqué à la première représentation. On en a retranché quelques épisodes, auxquels nous n’avions rien compris. Je persiste à le trouver plus bizarre qu’agréable. La musique en est charmante ; mais est-ce bien là la danse et la musique des durs routiers et des ribaudes sans vergogne du quinzième siècle ?
En somme, Jeanne d’Arc est un spectacle à voir et qui attire beaucoup de monde. Je voudrais que ce succès inespéré ouvrit les yeux de la Comédie-Française et l’engageât à monter des œuvres nouvelles qui fussent très sérieuses et en vers. Le goût du public est porté de ce côté, et ce n’est pas à nous de nous en plaindre.
La Patrie, 17 novembre 1873
Article d’Édouard Fournier, dans la Revue dramatique du feuilleton.
Lien : Gallica
Pour la première fois, depuis deux siècles au moins que l’on essaie de la mettra en drame ou en opéra, la vie de Jeanne d’Arc, cette merveilleuse histoire-légende, vient de réussir de la façon la plus incontestable au théâtre.
Ce n’est pas un demi-succès, comme pour la Jeanne d’Arc à Rouen de d’Avrigny, en 1819, et pour celle de Soumet, en 1825 : c’est, je le répète, un succès des plus complets, des plus francs, et j’ajouterai des plus salutaires : il n’est lait que d’émotions saines et fortifiantes, il ne repose que sur les plus hautes inspirations du patriotisme et de la foi ; il ne vibre que de ce qui peut réveiller un peuple et le rendre à lui-même en ces heures douloureuses où, soucieux du présent, plus inquiet de l’avenir, il n’a que son passé pour se reprendre à quelque chose de grand, et que des souvenirs pour se refaire des espérances.
Le poète, quand il fit cette Jeanne d’Arc, si heureusement venue, semble avoir eu quelque chose des intuitions de son héroïne ; il l’écrivit, en effet, longtemps avant nos malheurs, et, pendant bien des mois, il lui chercha une place qui lui fut refusée partout.
L’heure n’était pas venue ; quand elle sonna, trop hâtée cette fois par les désastres qui faisaient à l’œuvre un poignant à-propos, la place tant cherchée se trouva faite d’elle-même. Autant, en plein bon-heur, on ne comprenait plus Jeanne d’Arc et ses prodiges centre l’invasion anglaise, autant, après une autre invasion, dont pareils prodiges ne sont malheureusement pas venus nous sauver, on recommençait à la comprendre, on trairait la revoir, on avait soit de la mieux connaître.
Or, bien servi encore par le pressentiment qui, lui inspirant l’idée de son drame avant l’heure, lui avait imposé la nécessité de le faire vrai, pour qu’il fût utile, quand cette heure serait venue, M. Jules Barbier nous a fait Jeanne d’Arc telle qu’il faut qu’on la connaisse.
C’est ce mérite de vérité historique, si rare au théâtre, qui a contribué pour une bonne part au succès que l’à-propos avait préparé.
Jusqu’à présent, personne ne s’en était même préoccupé : toutes les Jeanne d’Arc du théâtre n’avaient été que de fantaisie. Comme si la réalité de l’histoire ne suffi-sait pas, en cette affaire surhumaine, à tout ce que l’imagination peut river de plus merveilleux, on s’était évertué en toutes sortes d’inventions, là oit justement rien n’était à inventer. C’était à qui greffe-rait son roman sur la légende, au lieu d’y développer l’histoire.
Les plus illustres tombèrent d’une cette faute, Shakespeare le premier, chez qui la haine de l’Anglais tua cette fois le génie du poète. Dans la première partie de son Henri VI, il imagina je ne sais quelles dégradantes amours pour Jeanne d’Arc, avec un dénouement plus flétrissant encore : condamnée, elle se déclara enceinte pour se sauver du bûcher !
Dans Schiller, le roman, s’il est plus respectueux, n’est pas moins ridicule. La Pucelle s’y trouve aux prises avec trois amours, et, pour échapper à cette complication de tendresses se fait tuer bravement dans une dernière bataille.
Chez nous, d’Avrigny et Soumet — pour ne pas remonter à de plus anciens — ne se sont pas permis ces contre-vérités monstrueuses, que l’Angleterre et l’Allemagne nous reprocheraient bien haut si nous nous les permettions dans leur histoire ; mais plus vrais pour le fond, ils ont été tout aussi faux pour la forme et le ton.
Leur Jeanne d’Arc, toute confite en tragédie, n’est qu’à peine frottée d’histoire sans rien garder de son nimbe légendaire. Elle parle l’alexandrin de toutes les héroïnes, et n’a rien du vrai langage de la véritable, si plein de naïve inspiration et d’héroïque simplesse ; rien de cet adorable parler, où le bon sens s’échauffait, s’éclairait par l’exaltation, et qui n’a eu qu’à passer dans les vers de M. Jules Barbier pour leur donner une saveur et une force sans pareilles.
Il est vrai que du temps de d’Avrigny et de Soumet, les moyens manquaient encore pour se bien pénétrer de ce suc et de cette saveur. Jeanne d’Arc ne revivait pas encore dans ce qui l’a fait le mieux revivre. Les deux procès, celui de sa condamnation et celui qui la réhabilita, n’avaient pas encore été publiés.
On connaissait la Pucelle par ses actions, mais on ne savait presque rien de ce qui devait en animer l’histoire : les réponses à ses juges, où elle les expliqua ou les justifia par des paroles aussi surprenantes, aussi merveilleuses qu’elle.
M. Jules Barbier, plus heureux, a trouvé tout ouvert cet inappréciable trésor d’éloquence et de raison, et il y a puisé à pleines mains, ne se donnant presque pour tâche que de sertir et d’enchâsser les admirables perles de cette légende enfin parlée.
Je viens de relire. ainsi que la plupart des chroniques qui la concernent, les interrogatoires de Jeanne, et j’ai été frappé de l’art surprenant, comme délicatesse et habileté d’exactitude, avec lequel son poêle a mie en rimes, pour le théâtre, tout ce qu’elle a dit dans l’histoire, sans rien changer au sens et presque toujours en conservant l’expression même. C’est donc vraiment Jeanne d’Arc qu’on voit et qu’on entend dans ces cinq actes, puisqu’elle y revit de sa vie même et y reparle son vrai langage.
Dès les premières scènes, celles où elle raconte l’entretien de ses voix secrètes, quelques-unes de ses paroles se trouvent déjà enchâssées dans le récit que lui prête le poète. C’est saint Michel, le patron guerrier, le dompteur du Dragon, qui lui apparaissait, et elle aimait à redire ce qu’il lui disait : Il me racontoit, dit-elle, la pitié qui estoit au royaume de France, et depuis lors, j’eus grande volonté et affection que le roy eut son royaume.
Il m’a conté, dit M. Barbier,
Les villes sans secours,
Les vainqueur sans merci, le roi sans espérance.
Et la grande pitié du royaume de France.
Vous voyez à quel point, pour le trait principal et en relief, la reproduction versifiée est exacte. Il en est partout de même, du premier au dernier acte ; aussi vais-je me contenter de citer les paroles de Jeanne, laissant au lecteur le plaisir d’en aller entendre l’écho rimé dans le drame de la Gaîté.
C’est à qui détournera la Pucelle de son entreprise, que nul ne comprend ; c’est à qui lui en fera voir les périls : Ne craignez rien, répond-elle avec la douce opiniâtreté de ces esprits à prédestination, ne craignez rien, Dieu me fait ma route ; c’est tour cela que je suis née.
Cette route que Dieu lui fait, elle la voit toute, dès l’entrée, et jusqu’au terme, qui, elle le sait aussi, n’est pas loin. En partant, elle dit déjà : Il me faut employer ; je ne durerai qu’un an et guère plus.
Qui l’arrêtera dans sa voie ? Elle ne l’ignore pas non plus : Je ne crains rien, dit-elle à ses parents, qu’elle a retrouvés à Reims, je ne crains rien que la trahison.
Et, en effet, c’est ce qui devait la perdre, après bien des pièges franchis, bien des embûches évitées, dont M. Barbier nous montre en passant quelques-uns des plus périlleux, ceux que lui dressaient les courtisans jaloux.
Le doute et la chicane l’accueillent par-tout avec leurs airs discrets ou leur ricanement. Elle passe sans en être embarrassée, ou, quand elle daigne répondre, se tire toujours par un mot triomphant, même de l’argutie du plus fin docteur.
— Tu prétends, lui dit un moine, que Dieu veut délivrer le peuple de France ; a-t-il pour cela besoin de gens d’armes ? — Les gens d’armes batailleront, Dieu donnera la victoire.
Jamais le mot ne lui manque, et souvent il est des plus vifs, et on pourrait dire à la bonne franquette
; la paysanne reste sous l’héroïne. Quand on se moque, elle le sent, et sa riposte rive à la moquerie sa pointe. Quelqu’un lui demande-t-il en raillant : Quelle langue parlait la voix céleste ? — Langue meilleure que la vôtre, réplique-t-elle vivement.
Plus tard, au procès, un des juges lui ayant demandé, en façon de plaisanterie assez indécente, si saint Michel était nu dans ses apparitions :
— Pensez-vous donc, dit-elle, que Notre Seigneur n’ait pas de quoi le vêtir.
Rien n’étonne le prime-saut de sa franchise. Elle est vraie en tout, même en ses goûts de jeune fille, qu’elle ne cache pas. Guerrière, sa coquetterie sont les belles armes, elle le fait voir et s’y comptait : Et, dit Guy de Laval, la vis monter à cheval, armée tout en blanc, sauf la teste, une petite hache en sa main sur un grand courrier noir…
Cette hachette et non épée sont ses armes, mais plutôt de parsie que de bataille, car même au plus fort des mutées, elle ne frappe jamais. Elle s’expose aux coups, mais n’en porte point elle-même. C’est avec son étendard qu’elle va presque toujours à l’ennemi. Quand les juges l’interrogent sur sa façon de le porter, elle répond que ce n’était qu’un guidon de combat : Je disais aux gens d’armes du roy : Entrez parmi les Anglois, et j’y entrois moi-même.
Parole vaillante, où M. Barbier a trouvé un de ses plus beaux vers, Mlle Lia Félix un de ses plus admirables élans.
Un autre mot de Jeanne, sur son étendard encore, n’a pas moins heureusement inspiré la tragédienne et le poète : — Pourquoi, lui dit un des jupe, le portiez-vous au sacre, tout près du pennon royal ? — Il avoit été à la peine, c’étoit bien raison qu’il fust à l’honneur.
De cela encore, M. Barbier a fait, je l’ai dit, deux bons vers, mais qui ne valent pourtant pas la phrase de Jeanne.
En beaucoup d’autres, rien ne peut davantage égaler ce qu’elle a dans ses protes d’éloquence concise et fière. Un jour les chefs : Dunois, La Hire, Xaintrailles veulent la lancer dans une entreprise pour laquelle ils ont délibéré seuls : Vous avez été en vostre conseil, j’ai été au mien
, et elle refuse.
Cette fierté sans jactance, cette crânerie naturelle et simple la suit partout, et ses juges mêmes en sont stupéfaits lorsqu’ils croient le mieux l’intimider et la tenir.
Souvent ils lui demandent, lorsqu’ils recommencent à l’interroger :
— Que vous ont dit vos voix ?
Chaque fois elle réplique :
— Que je vous réponde hardiment !
Le drame de M.Barbier a tout de Jeanne d’Arc, excepté ce ressort et cette résistance. La mysticité dans laquelle il la noie un peu trop, amollit et détend ce qu’elle eut d’héroïque et de guerroyant. Ce n’est pas que j’eusse demandé qu’on la vit combattre ou monter à une brèche, comme elle le fit si valeureusement à Jargeau ; mais j’aurais désiré qu’on sût, par quelque récit ou autrement, à quelles actions elle prit part, sans jamais se marchander, et comment elle fut blessée jusqu’à trois fois, à Orléans, à Jargeau et devant Paris.
Il eut fait beau voir, par exemple, La Hire racontant comment à Jargeau elle fut la première à l’escalade, et passa un instant pour morte sous l’énorme pierre qu’un Anglais lui avait lancée du haut des créneaux.
Dans le Mystère du siège d’Orléans, pièce en vingt et quelques mille vers, qui fut jouée à Orléans même quinze ans après le supplice de Jeanne d’Arc, on avait mis en scène cet épisode avec la plus franche et la plus brutale réalité. Quand on y arrive à l’énorme pierre que l’Anglais fait tomber sur Jeanne, l’auteur écrit en marge : Chacun doist la voir cheoir sur sa teste.
Ce mystère était tout à la glorification de la courageuse cité, qui se donnait ainsi la part d’honneur que le nouveau poète lui a quelque peu refusée. Le tableau du siège d’Orléans est le moins excellent de son drame, et le plus maigre surtout pour ce qui regarde la ville même. M. Barbier ne dit pas assez qu’elle avait, sept mois durant, soutenu tout l’effort des Anglais, et, en accomplissent si bien cette longue tâche, préparé ainsi celle de Jeanne d’Arc. Si par cette lutte de sept mois Orléans n’avait pas laissé au miracle le temps de venir, il fût venu trop tard et la France n’eût pas été sauvée.
Je pourrais faire une autre chicane à M. Barbier pour l’intervention d’Agnès Sorel dans le drame de Jeanne, qu’elle n’approcha même pas de loin, puisqu’elle n’apparut dans la vie de Charles VII qu’après la mort de l’héroïne ; mais c’est une inexactitude trop vénielle pour que j’y insiste. Un grave historien, Rapin Thoyras, l’a commise, un poète pouvait bien se la permettre, d’autant qu’un autre, Schiller, ne l’avait déjà pas évitée.
Pour conclure donc, les fautes sont en minorité dans ce drame, et presque toutes sans importance, tandis que les beautés s’y imposent en grand nombre et avec le plus vif éclat. Quelques tableaux sont du plus irrésistible effet. Je ne sache rien, par exemple, de plus puissant comme action et en même temps comme spectacle que celui de la prison : il est à lui seul un drame entier. C’est pour la terreur et l’émotion ce que celui du château de Chinon est pour la magnificence gracieuse, et celui du sacre pour la splendeur. Le tableau du bûcher est admirable aussi. C’est une véritable résurrection du vieux Rouen à la lueur d’un autodafé.
La partition de M.Gounod, avec ses symphonies en tangente, a de grandes qualités comme caractère et couleur. Le musicien des Deux Reines de M. Legouvé s’y retrouve plus ample d’accent et d’un archaïsme mieux nuancé. Il a fait là pour le moyen-âge ce qu’il avait fait pour la Grèce anti-que dans les chœurs de l’Ulysse de Ponsard.
Le prélude du premier acte, qu’il eût peut-être dit grandir en symphonie complète, est d’un sentiment moitié rustique, moitié religieux tout à fait distingué. La plus pénétrante mélancolie plane sur le chœur Nous fuyons la patrie, et l’idéal même des plus séraphiques visions empreint le duo des saintes voix qui d’en haut inspirent et conseillent Jeanne. Il y a là un admirable ensemble harmonique entre l’orgue, l’orchestre, et ces deux voix dont la chant tombe du ciel, en mélodieuse rouée. La chanson de la ribaude fait plus tard un étonnant contraste, par son mouvement et son rythme d’antique gaillardise. C’est la chanson du chantre au cabaret, après le plain-chant. Le ballet des ribaudes est d’une étrangeté rythmique fort curieuse ; c’est la science amusante appliquée à la musique.
La marche du sacre est de la plus majestueuse allure. Rien de plus solennel que cet immense accord des cuivres avec le carillon de la cathédrale.
Le chœur des soldats dans la prison, sorte de brindisi de la conquête insolente, est d’un merveilleux entrain ; l’effet en serait encore plus grand si la phrase de chant des deux saintes qui se marie en contre-point était d’une sonorité plus franche.
Enfin, la marche funèbre est d’un admirable sentiment de douleur et de deuil.
Je ne détaillerai pas la mise en scène, dont j’ai déjà indiqué du doigt les principales parties ; il faudrait un article spécial pour en dire une à une les merveilles d’art et de magnificence.
J’aime mieux en venir tout de suite à la reine de ce grand succès, à Mlle Lia Félix, qui, par l’incomparable distinction de son talent, tout de poésie en mime temps que de force, par l’admirable accord de la grâce et de l’énergie, de la tendresse et de la vaillance, de l’inspiration et du naturel, a su atteindre à toutes les hauteurs infinies de con rôle, au multiple idéal, et faire un véritable prodige de cette héroïne du miracle. Il y a longtemps que je l’ai proclamée la première artiste de drame de Paris ; maintenant tout Paris va le dire avec moi. Les autres rôles sont tenus très dignement, surtout par Clément Just, qui donne la plus fièvre et la plus franche allure au rôle de La Hire, ce soudard que Jeanne a dompté, et par Desrieux, le plus aimable et le plus richement doré des traîtres de cour.
Hier soir, au Palais-Royal, le Chef de division de M. Gondinet a très franchement réussi, par l’entrain d’observation qui en égare chaque scène, et par l’imbroglio qui s’y enroule et s’y déroule, avec une aisance d’évolutions merveilleuse. Dimanche je vous en dirai plus, si pendant ces huit jours la mémoire de tous ces escamotages ne s’est pas escamotée de mou cerveau. Ce dont je me souviendrai à coup sûr, c’est que le premier acte est prodigieux de combinaison comique, et que la pièce est admirablement jouée.
Le Siècle, 17 novembre 1873
Extrait de la Revue des théâtres d’Edmond Desnoyers de Biéville.
Lien : Retronews
Notre collaborateur Comettant a déjà annoncé à nos lecteurs [10 novembre] la représentation, au théâtre de la Gaîté, de Jeanne d’Arc, drame en cinq actes, en vers, par M. Jules Barbier, avec chœurs mis en musique par M. Charles Gounod.
Cet admirable personnage de Jeanne d’Arc, dont les anciens eussent fait une déesse et que les catholiques ont voulu, mais en vain, faire canoniser à Rome, ni plus ni moins qu’une Marie Alacoque, cet adorable personnage a tenté beaucoup do poètes depuis Chapelain jusqu’à Casimir Delavigne, beaucoup d’auteurs dramatiques depuis Schiller jusqu’à d’Avrigny et Soumet. Mais, sous l’ancienne monarchie, Jeanne d’Arc était un sujet impossible à traiter dans sa grandeur et dans sa vérité. Comment à cette époque composer un poème dans lequel une fille des champs eût été mise au premier plan, et le roi au dernier ? Comment surtout faire parler une héroïne populaire ? C’était impossible dans une épopée, c’était bien plus impossible au théâtre.
D’ailleurs, avec les règles classiques, la fin seule de Jeanne d’Arc pouvait donner une tragédie : encore devait-on faire un personnage académique de la paysanne de Domrémy, et se priver des complices des Anglais dans sa condamnation : l’évêque de Beauvais, les inquisiteurs. On ignorait de plus une multitude de détails caractéristiques, de propos simples et sublimes, révélés seulement depuis la publication du procès de Jeanne d’Arc par M. Quicherat, et depuis les histoires de MM. Michelet et Henri Martin. On était conduit fatalement à des compositions froides et inexactes, comme celles de d’Avrigny et de Soumet. Le sujet de Jeanne d’Arc n’a pu être mis au théâtre d’une manière expressive et complète que depuis le travail de restauration historique achevé de nos jours et depuis que la forme shakespearienne a été définitivement acceptée sur nos scènes. On pouvait dès lors donner une image fidèle de la Pucelle d’Orléans en la montrant successivement humble fille des champs, vierge inspirée, soldat, captive et martyre. Mme Daniel Stern [nom de plume de Marie d’Agoult] l’a essayé, dès 1857, dans un drame où l’on sentait beaucoup d’inexpérience du théâtre, mais qui, avec quelques modifications faciles, eût réussi assurément à l’Odéon ou sur une de nos grandes scènes populaires. Nous l’avions dit et nous avions indiqué dès ce moment Lia Félix pour le personnage de Jeanne d’Arc.
M. Jules Barbier a coupé son sujet comme Mme Daniel Stern ; comme Mme Daniel Stern, il a su amener naturellement une partie des plus belles paroles de Jeanne d’Arc. Il a rappelé ce que nous regrettions que Mme Stern n’eût pas fait, l’horrible tentative de violence dont la vierge martyre avait eu à se défendre dans son cachot contre un grand lord d’Angleterre. Enfin il a eu l’heureuse et poétique idée de rendre visibles sur la scène les saintes que Jeanne d’Arc croyait voir et de faire entendre les voix qu’elle croyait entendre. Ces visions très artistement représentées, ces voix traduites dans des mélodies ou touchantes ou transportantes par M. Gounod, ajoutent merveilleusement à l’effet du drame et font concevoir au spectateur la foi en même temps religieuse et patriotique qui entraînait et soutenait Jeanne d’Arc.
Le premier acte se passe dans la chaumière de Jacques d’Arc, le père de Jeanne. La famille vient de terminer le repas du soir. Une large porte ouverte sur la route laisse voir une troupe de paysans, de femmes et d’enfants qui fuient l’invasion ennemie. Jeanne les montre à son père : Voici la nuit, ne peut-on leur offrir un asile ?
Jacques y consent. Les fugitifs entrent sur l’invitation de Jeanne, et chantent un chœur profondément douloureux : Nous fuyons la patrie.
Un vieillard raconte la détresse du pays. Orléans tient encore ; mais s’il est pris, c’en est fait de la France. Jeanne s’écrie avec désespoir :
C’est la France pourtant ! Elle ne peut mourir !
Elle s’informe du roi. Dit-on qu’il ait marché vers Orléans ? — Non, dit le vieillard, il est seul à Chinon,
Sans troupes, sans argent, prince sans diadèmes,
Abandonné de tous, s’abandonnant lui-même.
— Qui donc sauvera la France ? dit Jeanne pleine d’anxiété. Le vieillard répète sans y croire une vieille prédiction : La France perdue par une femme (la mère du roi, Isabeau de Bavière), sera sauvée par une femme.
Par une vierge née aux marches de Lorraine.
Jeanne tressaille. Son père lui dit de cesser ses questions et invite ses hôtes au repos.
Ce chœur qui rappelle les maux du pays, cette curiosité anxieuse de Jeanne, préparent habilement le drame. Une discussion entre Jacques d’Arc et sa femme Isabelle achève de faire connaître Jeanne. C’était la meilleure fille du village, simple, douce, charitable, très pieuse et même un peu trop dévote, disaient quelques-uns. Elle était profondément touchée des maux du pays, de la grande pitié qui était au royaume de France
. Elle s’animait au récit des combats, elle était rêveuse, elle s’isolait, elle n’allait plus aux danses.
Jacques d’Arc, rude et honnête paysan, inquiet des rêveries continuelles de sa fille et de ses propos étranges, jurait que si elle voulait s’en aller avec les gens de guerre, il la noierait plutôt de ses propres mains. D’un autre côté, Jeanne, depuis quelque temps, depuis plusieurs années, croyait entendre des voix céleste qui lui ordonnait d’aller au secours du roi de France et de lui rendre son royaume. Ces voix lui indiquaient ce qu’elle devait faire. Sainte Catherine et Sainte Marguerite, les saintes qu’elle voyait sans doute sur les vitraux de l’église du village, promettaient de l’assister. Elle résistait, elle pleurait. Quoi ! il fallait qu’elle délaissât sa mère, son père qui malgré sa rudesse la chérissait ; ses frères, ses sœurs, ses bonnes amies, la maison où elle est née, le petit jardin sous l’ombre de l’église. Il lui fallait aller parmi les hommes, parler aux hommes, aux soldats, elle qu’un seul mot déconcertait.
M. Michelet fait la peinture la plus touchante de la lutte qu’elle soutint dans son cœur pendant plusieurs années. M. Jules Barbier, qui a eu le bon esprit de s’inspirer de M. Michelet, montre cette lutte et, durant tout le drame, le désir de Jeanne de retourner au logis paternel dès que sa mission sera accomplie. Cette humilité, cette tendresse constante, outre qu’elles étaient vraiment dans le personnage, jettent un grand charme sur toute la pièce.
Jeanne, dit M. Michelet, trouva dans sa famille non pas seulement résistance, mais tentation. On essaya de la marier dans l’espoir de la ramener aux idées qui semblaient plus raisonnables. Un jeune homme du village prétendit qu’étant petite, elle lui avait promis mariage.
M. Jules Barbier n’a eu garde de négliger ce trait, et, avec une extrême délicatesse de touche, il a indiqué chez Jeanne, pour cet ami d’enfance, une inclination à laquelle elle résiste, de peur de contrevenir à la volonté Dieu. Elle confie sous le sceau du secret de cet ami Thibaut les miraculeuses obsessions auxquelles elle est en butte. Cependant, depuis deux mois, les voix célestes se taisent. Si leur silence continue, elle y verra la preuve que Dieu, cédant à ses prières, l’exempte de la redoutable mission à laquelle ses voix l’appelaient. Dans ce cas, elle obéirait à son père, qui veut qu’elle se marie.
Thibaut la quitte sur cette promesse. Toute la famille s’est retirée. Jeanne, avant d’aller reposer, veut finir un travail commencé. Elle s’assied devant son rouet. On entend le bruit des cloches, Jeanne tressaille et s’agenouille. Un chœur invisible l’appelle. Ce sont les voix des anges, qui lui reprochent de n’avoir pas encore obéi. Elle demande grâce pour elle, pour son père. Le chœur devient plus impérieux. Sainte Marguerite et sainte Catherine lui apparaissent, et, comme nous l’avons dit, cette apparition est très artistement représentée. On dirait deux images de saintes détachées des vitraux d’une église et volant vers Jeanne. Elles l’encouragent :
Dieu ta choisie.
Va, pauvre âme d’effroi saisi,
Va, fille de Dieu, va !
Jeanne éperdue jette un adieu désespéré à la chambre de ses parents et s’éloigne.
Le deuxième acte nous mène à Chinon, où Charles VII, au milieu de sa cour, auprès d’Agnès Sorel, use à la chasse, en fêtes, en festins, les dernières ressources de son trésor et les derniers moments de sa royauté. On disait que nos royalistes se flattaient que cette pièce, où l’on devait étaler des bannières fleurdelisées, où l’on devait voir le sacre d’un roi, rallumerait dans les cœurs l’amour pour le roi. C’était une grande erreur. Rien ne saurait, au contraire, faire apprécier la royauté à sa plus juste valeur que ce drame de Jeanne d’Arc, où l’on voit le roi s’amuser avec des maîtresses, des courtisans et des bateleurs, tandis que les trois quarts de son royaume sont envahis et qu’une humble fille de paysan n’a qu’une pensée, le danger de la France, qu’un but poursuivi à travers mille fatigues, mille embûches, mille périls : le salut de la France.
Le favori de Charles VII, La Trémouille, tient à Jeanne à peu près les mêmes propos que certains de nos généraux tenaient aux Messins pendant la dernière guerre : Ah ça ! vous avec donc du patriotisme, vous ?
La Trémouille s’entend avec Agnès pour empêcher la jeune Lorraine d’arriver jusqu’au roi, mais Agnès se laisse gagner par le patriotisme de Jeanne. L’entrevue de la maîtresse du roi et de la vierge patriote est curieuse et traitée avec un juste sentiment de la situation et du caractère des deux femmes. Agnès décide le roi à voir Jeanne. Pour éprouver la jeune fille, Charles VII, selon la tradition historique, fait prendre sa place à La Trémouille ; mais Jeanne ne se trompe pas et va droit au roi ; puis, le tirant à part, lui dit quel doute secret le tourmente. Les débordements de sa mère lui font craindre que ceux qui l’accusent de n’être pas l’héritier légitime du trône n’aient raison. Jeanne le rassure.
De la part de messire
Roi du ciel, je te dis que le trône est à toi,
Étant seul héritier de France et fils de roi.
Charles VII, transporté, ne doute plus que Jeanne ne soit envoyée par Dieu. Il ordonne qu’elle marche de pair avec ses barons, et demande qui veut la suivre pour secourir Orléans. Tous les gentilshommes veulent y aller, excepté La Trémouille et le roi. Le roi se réserve de mener à Jeanne les nouveaux soldats qu’il va faire lever. L’acte se termine par un chœur entraînant qu’on a bissé et où se trouve vingt fois répété ce vers, le plus doux à entendre aujourd’hui.
Nous délivrerons la patrie !
Le troisième acte, c’est le siège d’Orléans. Un ballet de soldats et de ribaudes. La colère historique de la Pucelle contre les femmes de mauvaise vie ; son influence sur La Hire, le brave soudard à qui elle ne permet plus de jurer que par son bâton. Son influence sur le peuple, sur les soldats ; la jalousie des autres capitaines. Elle veut, contre leur avis, attaquer sur-le-champ les Anglais dans leurs derniers retranchements. Les soldats déclarent qu’ils la suivront ; les capitaines, poussés par Dunois et La Hire, cèdent à l’entraînement général ; mais avant l’attaque Jeanne veut qu’on implore le secours de Dieu. Tout le monde s’agenouille et l’acte finit par un chœur d’invocation.
Le quatrième acte est divisé en deux tableaux, l’un et l’autre à Reims : le premier tableau sur une terrasse dominant la ville, près d’une chapelle. Ce tableau commence par un nouveau chœur religieux. Des femmes du peuple chantent les louanges de Jeanne, l’ange de Dieu. Une mère demandait à Jeanne de ranimer son enfant malade et de le tenir sur les fonts du baptême. La pièce tournait trop au mystère. C’était plus de mysticisme que n’en comporte le théâtre : on a coupé ce baptême et on a bien fait.
Le second tableau, c’est le sacre, avec un décor magnifique, le portail de la cathédrale de Reims, un cortège splendide, une entrevue de Jeanne avec ses parents accourus de Reims pour l’embrasser. Elle veut retourner avec eux au village ; mais le roi la retient, lui rappelant que sa tâche n’est pas achevée et qu’elle a promis de chasser tous les Anglais, jusqu’au dernier, hors de France. Elle reste donc, mais avec un triste pressentiment.
Le dernier acte divisé aussi en deux tableaux, c’est la captivité et le bûcher. La captivité au milieu des soldats anglais ; mais Jeanne revoit ses saintes qui la soutiennent. Les inquisiteurs la condamnent.
Chacune de ses réponses, traduite en excellent termes par M. Barbier, devient un vers sublime. Le cortège funèbre, le bûcher sont admirablement mis en scène. On voit flamber les vêtements de la vierge martyre. Le ciel s’ouvre au-dessus de sa tête et les anges reçoivent cet ange du patriotisme.
Mlle Lia Félix est digne de son rôle. Elle manque un peu de force et ne réussit pas à se donner complètement les allures d’une guerrière ; mais que de sensibilité, de pudeur, de foi, de dignité ! En somme, grand succès de drame d’actrice, de musique, de mise en scène.
Le Temps, 18 novembre 1873
Extrait de la Critique musicale hebdomadaire en feuilleton de Johannes Weber, qui est parti après le 4e acte.
Lien : Gallica
Tout le monde est d’accord qu’une tragédie ou un drame mêlé de quelques morceaux de musique, n’est pas une œuvre conforme aux principes sévères de l’art. Dans Athalie, la pièce de Racine et la musique de Mendelssohn gagnent toutes les deux à être exécutées séparément. Cependant on ne renonce pas à donner des ouvrages nouveaux de ce genre. Les directeurs de théâtre espèrent, non sans quelque raison, que la musique augmentera les attraits de la pièce ; les compositeurs, de leur côté, ont trop peu d’occasions de se produire en public pour ne pas saisir celles qui se présentent ; si leur musique est bonne, ils sont sûrs, quoi qu’il arrive, de ne pas l’avoir écrite en vain. Struensée, de Meyerbeer, et l’Arlésienne, de M. Bizet, restent au répertoire des concerts de musique sérieuse, tandis qu’on s’occupe peu de la tragédie de Michel Beer, et que le drame de M. Daudet est oublié.
M. J. Barbier avait d’abord présenté sa Jeanne d’Arc au Théâtre-Français et à l’Odéon, qui, la refusèrent avec un touchant accord. Ignorant s’il réussirait jamais à la faire jouer, il résolut de la faire imprimer ; ce fut en 1869. Quelques situations semblaient destinées d’avance à être accompagnées de musique ; ailleurs, on a pu en ajouter d’autant plus facilement que M. Barbier a fait à sa pièce quelques changements considérables qui exigent une édition nouvelle de l’œuvre. Dans l’attente de l’opéra de M. Mermet, je n’ai pas à examiner aujourd’hui la valeur musicale du sujet de Jeanne d’Arc ; je ne m’occuperai que de la partition de M. Gounod ; l’arrangement pour piano et chant a paru chez l’éditeur M. Gérard, ce qui me permet d’en donner une analyse plus complète que je ne l’aurais pu faire après une seule audition au théâtre.
De même que dans les Deux Reines, les morceaux de chant dominent dans la nouvelle œuvre de M. Gounod ; je ne vois que le prélude instrumental, un court menuet, les airs de ballet et quelques petits mélodrames dont le chant soit exclu. Le prélude a un caractère pastoral ; il est fait au moyen de deux motifs dont le premier doit être exécuté avec des échos sur le théâtre ; le second est emprunté à la vision de Jeanne dans la prison. (Voir page 91 de la partition.) On y remarque aussi la petite phrase de deux mesures : Jésus, Maria
, dite par le chœur invisible ; la cadence finale est celle du chant des deux saintes : Fille de Dieu, va !
Il ne faut pas y voir une intention spéciale que les auditeurs seraient incapables de saisir. Ce prélude est d’ailleurs d’un style élevé et ne ressemble nullement aux vulgaires airs de musette dont on se contente le plus souvent en guise de musique champêtre.
Dans l’analyse qui va suivre, je passerai sous silence les petits mélodrames, vu leur peu d’importance. Le chœur des malheureux qui quittent leur pays pour échapper aux ravages de la guerre débute bien ; mais la suite ne me satisfait pas. La progression commençant sur les paroles : Le sol disparaîtra sous d’arides buissons
est trop banale pour exprimer l’accroissement de la douleur que le compositeur devait et voulait rendre. Dans la scène finale de l’acte, l’effet surnaturel se bornait primitivement à une lumière éclatante ; telle fut, selon l’histoire, la première vision de Jeanne ; plus tard, elle vit ou crut voir tantôt sainte Marguerite et sainte Catherine, tantôt l’archange saint Michel.
Au théâtre de la Gaîté, Mlle Lia Félix ne pouvant chanter, on fait apparaître les deux saintes chantant un duo et alternant avec le chœur qui reste invisible ; le tout est accompagné par un orgue dans la coulisse et l’orchestre de la salle. Ce morceau a produit beaucoup d’effet, mais j’avais d’abord réservé mon jugement, pensant que le mélange du chant et de la déclamation m’avait trop choqué. En lisant la partition, je me suis convaincu que les deux saintes, où plutôt Mlles Maury et Iriart, commettent un grave contre-sens. Le chœur invisible reproche d’abord durement à Jeanne ses hésitations, son refus d’obéir à l’ordre de Dieu ; puis les deux saintes parlent d’un ton consolant, promettant à la jeune fille leur aide dans l’œuvre qui lui est commandée ; le chœur se borne à dire de temps en temps : Jésus, Maria !
Évidemment le chant des saintes doit être dit presque en entier avec une extrême douceur, pour lui donner un caractère céleste et rassurant qui seul peut inspirer à Jeanne la confiance dont elle a besoin. De cette manière aussi les séries de tierces qui forment ce duo sont bien justifiées. Les saintes de la Gaîté ne songent qu’à donner beaucoup de voix. Cela suffit pour dénaturer ce morceau très simple qui est un des meilleurs de la partition.
Au deuxième acte nous trouvons d’abord un agréable chœur de femmes et une ballade que Mlle Perret débite mollement et froidement ; je n’en avais pas compris un mot. C’est une ballade dans le sens primitif de cette dénomination, ainsi que je l’ai expliqué dans mon dernier feuilleton. Les deux couplets ont chacun dix vers, faits sur trois rimes qui sont les mêmes pour les deux couplets aussi bien que le refrain. Le texte, exprimant une plainte amoureuse, est écrit en vieux style ; la musique aussi a des tendances rétrospectives ; je crois qu’elle aurait du succès si elle était bien chantée.
Pendant que le roi fait sa prière, l’attention des autres personnages est détournée par un plain-chant dit dans la coulisse. Un court menuet accompagne l’entrée de la cour ; M. Gounod y a mis lui-même l’indication : À la manière des anciens menuets.
Naturellement, il s’est gardé de rétrograder jusqu’au quinzième siècle, d’autant plus qu’à cette époque le menuet n’était pas encore inventé. Le chœur belliqueux et patriotique : Dieu le veut !
nous ramène aux temps modernes. On y voit l’intention évidente de M. Gounod de faire un pendant à des chants patriotiques bien connus.
Son chœur a été redemandé avec enthousiasme par le public ; les juges sévères ne l’ont pas approuvé sans réserves : tout n’y est pas d’égale valeur. Les passages moins heureux que le reste sont d’abord quatre mesures en mode mineur puis la partie dans le ton de la sous-dominante commençant aux paroles : Cri sacré
; l’auteur reprend toute sa vigueur aux paroles : Pour la haine de l’étranger !
Enfin la dernière phrase jouée par l’orchestre avant la chute du rideau manque absolument de nouveauté. D’autres ressemblances qu’on a cru remarquer entre le chœur de M. Gounod et des œuvres plus anciennes ne me paraissent pas justifiées.
Au commencement du troisième acte on trouve déjà dans la première édition de la pièce l’indication : Chœur de soldats et de ribaudes.
Le mot ribaud a signifié pendant longtemps, crocheteur ou portefaix ; puis il a pris le mauvais sens de luxurieux ou impudique. Le troisième acte débute par un chœur de soldats français buvant et narguant les Anglais ; le cinquième acte débute par un chœur de soldats anglais buvant, jouant aux dés et raillant les Français. M. Gounod a réussi dans les deux camps ; la chanson de la ribaude Perrine aussi est bien tournée.
La musique de ballet est encore une des bonnes parties de l’œuvre ; elle comprend trois morceaux dont je regrette de ne trouver que le premier dans la partition grave. Le second n’est pas de création nouvelle ; il a été publié pour le piano chez un autre éditeur que celui de Jeanne d’Arc, sous le titre : Funérailles d’une marionnette. Afin de l’intercaler dans le ballet, on avait imaginé de donner pour cible aux soldats un gros mannequin représentant un jobard anglais et que l’on faisait porter en triomphe quand il était renversé. Cette procession finissait par impatienter le public ; on l’a supprimée. J’ignore si l’on a supprimé aussi la musique ; ce serait un tort, car elle ne saurait avoir un caractère assez précis pour exiger d’être accompagnée de funérailles bouffonnes ; un maître de ballet judicieux peut y adapter un pas dansé.
Avant d’aller attaquer les Anglais, Jeanne avec les soldats se met en prière ; elle dit son oraison, sans chanter, sur le prélude du chœur ; puis les soldats l’imitent en chantant. Quelques auditeurs auraient voulu ici un morceau brillant dans le genre du finale du troisième acte du Prophète. La comparaison est mal choisie, d’abord parce que ce finale, examiné de près, n’est pas une des meilleures inspirations de Meyerbeer, ensuite parce que M. Gounod n’avait pas à corriger la pièce de M. Barbier. Jeanne d’Arc n’a de puissance et d’audace qu’à force de dévotion ; psychologiquement et historiquement, ce point de vue ne me semble pas exact, mais c’est celui de M. Barbier. Ce qu’on peut dire avec justice, c’est qu’à la place d’un chœur doux et onctueux, on aurait désiré des accents pleins de ferveur et de grandeur, comme doivent en proférer des gens ayant le ferme espoir de triompher par la protection divine dans une entreprise que, par prudence humaine, ils n’avaient d’abord pas voulu tenter.
Le chœur des femmes qui précède la scène de la guérison miraculeuse d’un enfant est assez faible. Cette scène est un hors-d’œuvre ajouté par M. Barbier pour le théâtre de la Gaîté ; elle a été supprimée. La marche du sacre a un caractère large et pompeux ; son seul inconvénient, c’est de ne pouvoir être mise au même rang que deux morceaux qui se présentent nécessairement à la mémoire de tout le monde : la marche du sacre du Prophète et la marche avec chœur de Tannhäuser. Au milieu de la marche de Jeanne d’Arc, jouée par l’orchestre seul, on remarquera une période de douze mesures (en sol bémol majeur), empruntée au chant des saintes dans le premier acte.
Je n’ai pas entendu le dernier acte. Quand la toile tombait sur le quatrième il était minuit, et j’ai voulu m’en tenir là. Une pluie battante m’attendait à la porte ; mais l’eau me semblait préférable aux projectiles plus ou moins comestibles qui, pendant les entractes me tombaient sur la tête. Un voisin crut me consoler en me disant que c’était l’habitude à ce théâtre. Je m’applaudissais dans mon intérieur de n’avoir jamais approuvé la chimère d’un Opéra populaire, adjectif qui, pour être exact, devrait changer de terminaison.
Le cinquième acte ne formait d’abord qu’un seul tableau comprenant la condamnation et l’exécution de Jeanne ; aujourd’hui il y en a deux, intitulés la Prison et le Bûcher. Le chœur des soldats dont j’ai parlé plus haut alterne avec le chant consolant des deux saintes patronnes de Jeanne. Celles-ci répètent d’abord une partie de leur chant du premier acte, sur d’autres paroles puis elles font apparaître à la jeune fille, dans une vision, son pays natal ; c’est à ce morceau qu’est emprunté le second motif du prélude instrumental du drame ; dans la conclusion de cette scène, les voix des saintes se font entendre en même temps que celles des soldats.
D’après les affiches, la grande marche funèbre
est exécutée dans l’intervalle entre le sixième et le septième tableau ; cette marche, m’a-t-on dit, cesse à l’entrée de Jeanne. Faut-il en conclure que la musique du dernier tableau a été mutilée ? Du moment où l’on mettait en scène le supplice de Jeanne, malgré son caractère horrible et infâme, il fallait, sans le prolonger plus qu’il n’est nécessaire, en tirer un effet terrifiant qui en fit le point culminant du drame. Telle paraît avoir été la pensée de M. Gounod. Après une courte scène pour annoncer l’arrivée de Jeanne, commence la marche funèbre dont voici les principaux éléments : un motif dans la tonalité vague du plain-chant (on me dispensera de donner une indication scientifique plus précise), une phrase dans la même tonalité, dite à l’unisson par les moines (c’est la seule partie vocale), un motif en mi bémol majeur, et la mélodie des saintes, qui a été reprise déjà dans la marche du sacre.
Dans la scène finale, pendant les derniers moments de Jeanne, on entend alternativement les cris des soldats insultant Jeanne et se réjouissant de son supplice, les exclamations des bourgeois consternés, le chant uniforme des moines, les consolations que les saintes et le chœur invisible donnent à la jeune martyre. L’effet de ce court finale dépend nécessairement de l’exécution et de la mise en scène. La manière dont le chant des saintes est ramené plusieurs fois vient à l’appui de ce que j’en ai dit au premier acte.
L’Univers illustré, 22 novembre 1873
Lien : Gallica
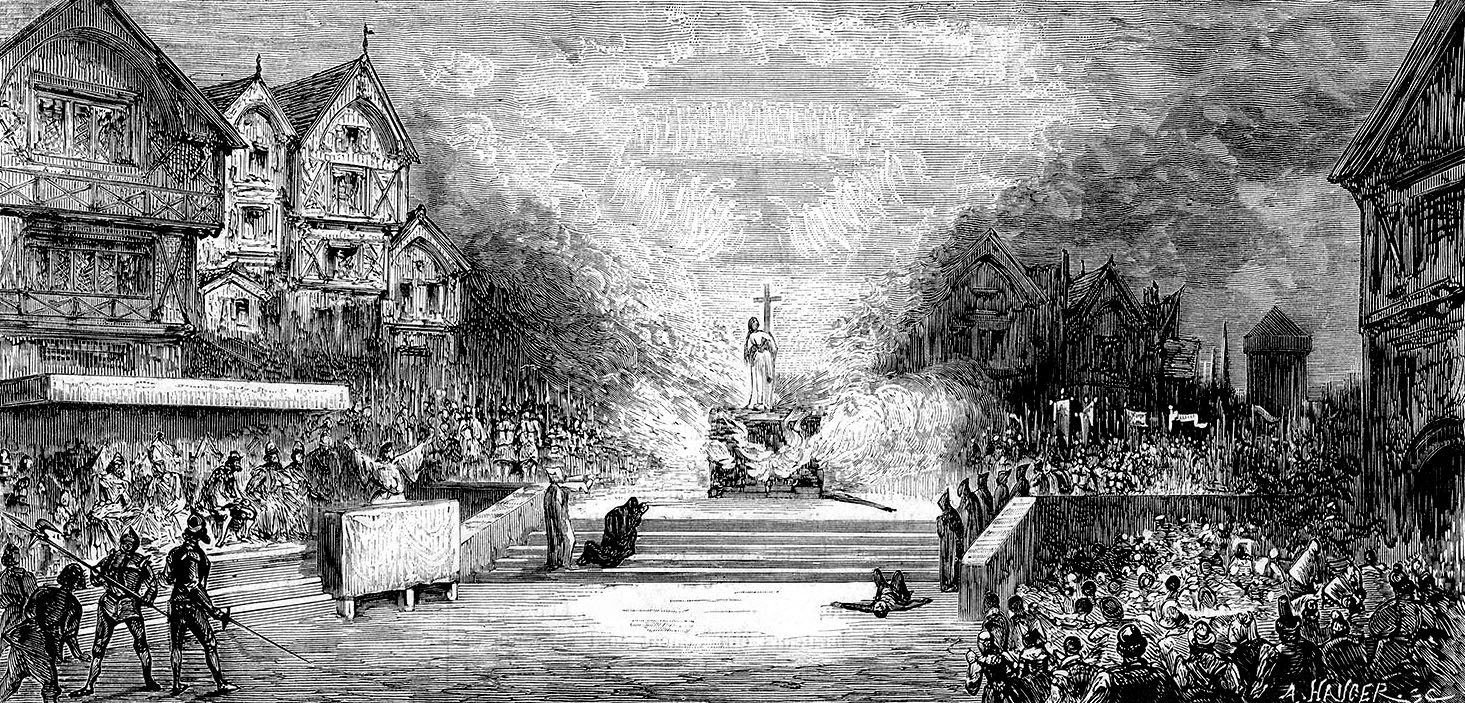
Le Figaro, 24 novembre 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Gustave Lafargue.
Lien : Gallica
Voici la lettre que M. Grou, caissier du théâtre de la Gaîté, tient d’adresser à M. Jules Barbier, auteur de Jeanne d’Arc :
Paris, le 20 novembre 1873
(10 heures du soir).Cher Monsieur,
Cent fois merci
Pour la surprise agréable
Que je trouvé sur ma table
Ce soir, en rentrant ici.
Je ne suis pas un profane
Quoique comptable et caissier,
Et je sais apprécier
Les beautés de votre Jeanne.
Je relis pieusement
Votre drame — À chaque page
De ce magnifique ouvrage
Je sens un frémissement :
Quand vous parlez de patrie
Et de la France en danger,
La haine de l’étranger
Vibre en mon âme attendrie !
Que n’a-t-on dit vos beaux vers
Pendant la guerre dernière,
Une autre Vierge guerrière.
Eût pu venger nos revers !…
Comme cela nous repose
Des cascades de nos jours !…
Mais le public sait toujours
Goûter une bonne chose
Voyez son empressement,
Malgré les sottes critiques
Et les ennuis politiques
Il accourt incessamment.
C’est un succès littéraire,
Un succès d’homme de bien,
Et ce qui ne gâte rien…
C’est une très bonne affaire !
[…]
Mais on m’appelle… Allons !… Qu’est-ce ?
Qui vient frapper à mon trou ?…
Encor sept mill’ que j’encaisse ! ! !
Mes compliments !… — Charles Grou,
Caissier de la Gaîté.
Le Monde illustré, 29 novembre 1873
Dessin d’Edmond Morin.
Lien : Gallica
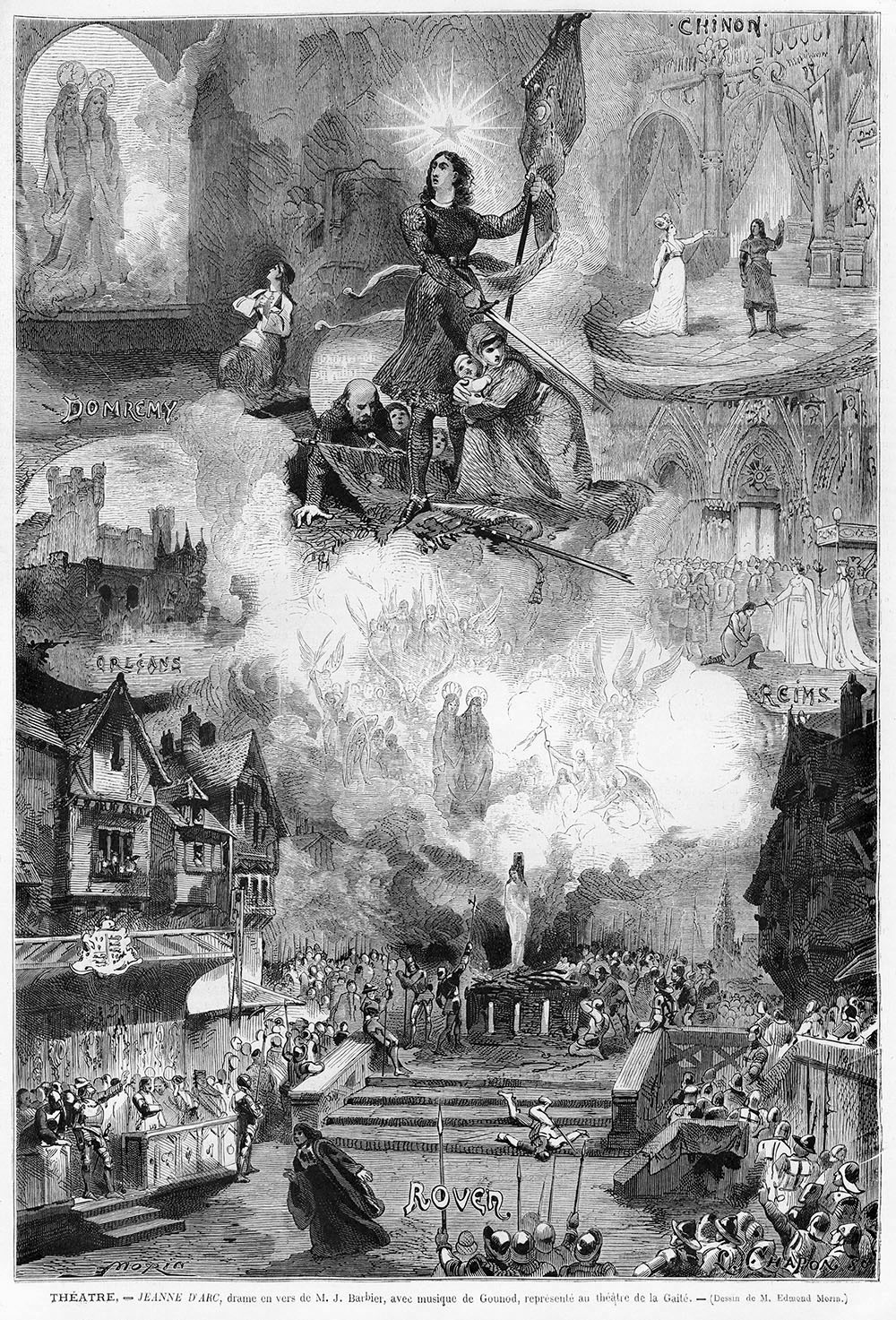
Le plus ancien portrait de Jeanne d’Arc. Fac-similé d’une miniature datée de 1451, par Lorédan Larchey (1831-1902).
Si la France n’a point le bonheur de posséder un portrait véritable de sa libératrice, ce n’est pas la faute de l’érudition moderne. Peintures, tapisseries, statuettes, croquis à la plume même, on a tout décrit, tout comparé, tout analysé. Et, de cet examen scrupuleux, il est sorti un ensemble si contradictoire, qu’on s’est un peu découragé. On a dû reconnaître que les monuments les plus recommandables par l’antiquité comme par le mérite de leur exécution n’offraient pas des garanties telles qu’on pût y retrouver un véritable portrait de Jeanne d’Arc. Le savant Walckenaer [1771-1852] en a fait le premier l’aveu :
Nous n’avons aucun tableau, aucun monument authentique qui nous retrace les traits de cette héroïne, objet éternel d’admiration et de pitié. Ceux que l’on a considérés comme tels sont non-seulement imaginaires, mais en contradiction avec les témoignages des contemporains et ses propres déclarations. [Charles Athanase Walckenaer, Vies de plusieurs personnages célèbres des temps anciens et modernes, 1830, vol. 1, p. 220.]
Ces paroles ont été confirmées depuis par Vallet de Viriville. Nous lisons dans ses consciencieuses Recherches iconographiques :
La Pucelle (et il cite le texte même de l’interrogatoire de Jeanne d’Arc), interrogée s’elle avoit point veu ou fait faire aucuns images ou portraicts d’elle et à sa semblance, respond qu’elle vit à Arras (en novembre 1430) une paincture en la main d’un Escot (Écossais) et y avoit la semblance d’elle toute armée et présentoit unes lectres (lettre) à son roy et estoit agenoullée d’un genoul. Et dit que oncques ne vit ou fist faire autre ymage ou paincture à la semblance d’elle.[Auguste Vallet de Viriville, Recherches iconographiques sur Jeanne d’Arc, 1855, p. 7.]
M. Vallet ajoute :
Ce passage, extrait textuellement du procès de condamnation (t. I, p. 100) est grave. Car si l’on admet que la Pucelle, en faisant cette réponse, ait voulu dire la vérité, il faudrait tenir pour constant qu’elle ne posa jamais devant un artiste. Quant à la peinture de l’Écossais d’Arras, on n’en connaît absolument aucune trace, si ce n’est les quelques mots que nous venons de transcrire.
La réflexion est juste ; elle nous ferait perdre absolument tout espoir, si, trois pages après, M. Vallet ne nous donnait presque à son insu, une espérance nouvelle. Poursuivant ses recherches, il examine les peintures de vieux manuscrits qui intéressent son sujet, et il débute ainsi :
Le plus ancien ouvrage de ce genre que nous ayons pu jusqu’ici découvrir, se voit dans le manuscrit 632-2 de la bibliothèque nationale. La date à laquelle il fut exécuté est consignée dans la note suivante, insérée à la fin du texte même de l’ouvrage.
Explicit le Ve et dernier livre du Champion des dames… escript ou cloistre de l’église de Nostre-Dame d’Arras en l’an de l’incarnation. Nostre Seigneur 1451.Au folio 101 verso se trouve un chapitre intitulé De dame Jehanne la Pucelle, nouvellement veue en France. En regard de ce chapitre, l’artiste a réuni dans une même vignette Judith et Jehanne la Pucelle. Cette image fut donc peinte à Arras, vingt ans après la mort de Jeanne. Le manuscrit offert à Philippe le Bon, duc de Bourgogne, est d’une exécution soignée et l’œuvre d’un enlumineur au-dessus du médiocre.
Je viens de citer un peu longuement Vallet, pour mieux montrer une coïncidence qu’il n’a pu méconnaître, mais qui me semble ne l’avoir pas assez vivement frappé :
D’une part la déclaration de Jeanne disant qu’elle n’a vu d’autre portrait d’elle qu’à Arras, en 1430.
De l’autre, la provenance d’un portrait de Jeanne appartenant à un manuscrit exécuté vingt ans après, aussi à Arras, où le souvenir de la Pucelle prisonnière devait être encore présent, en supposant qu’on n’y ait pas conservé trace du portrait de l’Écossais.
Une miniature exécutée dans de telles conditions acquiert certainement une valeur pour la critique la plus défiante, et, si on n’y trouve pas la copie de la composition de l’Écossais, telle qu’elle est décrite, on y rencontre du moins une sorte de garantie en ce qui touche le costume, l’armure et l’aspect général de l’héroïne.
Nous avons donc été demander à la bibliothèque de la rue Richelieu, ce curieux manuscrit du Champion des dames que M. Jules Quicherat, le grand historien de Jeanne d’Arc, nous avait déjà signalé de son côté ; il porte aujourd’hui le n° 2476 (Ms. Français). Nous avons retrouvé au folio désigné la figure précieuse et nous en avons fait un nouveau dessin qui ne saurait différer essentiellement de celui de Vallet, mais qui nous a paru toutefois mieux caractérisé et plus conforme à l’esprit du modèle.
Ce dessin, nous le donnons tel qu’il est, car il faut se garder d’enjoliver en pareille matière. Il ne peut, nous le répétons, passer pour un portrait, mais il offre la représentation la plus digne de foi qui existe. Jeanne est debout, tenant de la main droite une lance assez courte, et retenant de la main gauche un écu blasonné à ses armes, dont le dessin compliqué exclut toute idée de fantaisie (au-dessous des deux fleurs de lys se trouve l’épée traversant la couronne royale, qu’elle soutint, en effet, avec tant de bravoure). Sa tête, légèrement inclinée, est coiffée d’un chapeau de feutre gris (ce feutre est positivement gris, et non noir, comme le dit Vallet) à grands poils. Les cheveux, d’un châtain clair, tombent naturellement sur les épaules. Une armure, aux formes féminines nettement accusées, couvre la poitrine et l’épigastre. Des jambières de fer protègent les jambes, les pieds sont chaussés de cuir noir. Sous l’armure, s’allonge la robe, d’un brun carminé, à manches ouvertes ; la jupe s’arrête au genou. Cette robe couvrait un pourpoint rouge orangé, comme on le voit par les bras sortant de l’ouverture des manches.
Dans les vieux vers du texte, il est fait allusion à cette tenue semi-militaire. Le poète dit :
La pucelle se vestoit
De pourpoint et robe escourtée ;
Chappiau (chapeau) de faultre (feutre) elle portoit.
Il convient d’ajouter que ce texte ne suivit en réalité que de dix ans le passage de Jeanne d’Arc, car la même mention, attestant qu’il fut copié en 1451 par un calligraphe nommé Poignarre, dans un cloître d’Arras, nous apprend ensuite que sa composition remonte à 1440 et que son auteur fut alors maître Martin, prévôt de Lausanne.

Le plus ancien portrait de Jeanne d’Arc.
(Fac-similé d’une miniature datée de 1451, par Lorédan Larchey.)
L’Illustration, 29 novembre 1873

Le Figaro, 2 décembre 1873
Extrait de la Chronique musicale, par Bénédict (pseudonyme de Benoît Jouvin).
Lien : Gallica
Je voudrais ajouter quelques mots encore à ce que j’ai écrit [le 11 novembre] à l’apparition de la belle partition de Jeanne d’Arc de Gounod. Le succès de l’œuvre n’a rien à gagner, je le sais, à ces redites de la critique ; celle-ci peut ajouter ou retrancher, s’il lui plaît, à son admiration : le public, qui court à la Gaîté pour entendre la voix de Lia Félix et la musique de Gounod, n’y prendra pas garde. Mais si je reviens à cette partition d’un compositeur de génie, c’est à mon plaisir, c’est à mon émotion que je paye une dette, et je n’ai pas besoin pour me satisfaire à cet égard de la quittance d’un spectateur ou d’un lecteur.
L’indécision des premières soirées a cessé. Les chœurs et l’orchestre, sous la discipline du bâton de mesure de M. Albert Vizentini, sont pleinement entrés aujourd’hui dans l’intelligence de l’œuvre. Le souffle du maître les soulève et les enflamme. Quelle composition grande et puissante avec simplicité que ces fragments inspirés, ajoutant une aile immortelle aux vers de M. Barbier C’est tour à tour la voix de Dieu et la voix des hommes, celle-là disant à celle-ci : Tu chanteras pour moi, tu monteras jusqu’à moi, ou tu seras vaincue !
Dès les premières notes de l’introduction il y a comme un sentiment ineffable et triste dans les voix pastorales de l’orchestre : le village qui s’éveille pleurera, avant que la nuit soit venue, le départ de Jeanne. Ces voix champêtres ont, comme la vierge de Domrémy, le pressentiment de la terrible mission donnée d’en haut à une sainte héroïne. Quelles pages que celles qui vont succéder à l’introduction ! Le finale des voix, le chœur des fugitifs, l’hymne de la patrie, la prière, la marche du sacre, la marche funèbre… Puis, comme variété dans cette unité de l’inspiration la plus haute, les délicieux épisodes du chœur madrigalesque, de la ballade du prisonnier, du petit menuet (pastiche exquis !), de la ronde de la ribaude, de la chanson avinée des geôliers anglais. Plus je relis cette partition de l’auteur de Roméo et de Faust, plus j’y découvre des choses neuves et profondes qui m’avaient échappé. Tantôt c’est un jet de lumière mélodique semblable à un éclair déchirant le nuage ; tantôt c’est le scintillement produit par un choc d’harmonie laissant une traînée lumineuse dans les voix où dans l’orchestre, un ver-luisant dans l’herbe ! — J’en suis bien fâché pour quelques-uns de mes confrères, qui se sont hâtés de juger la partition sans l’avoir peut-être suffisamment écoutée : ils auront à se dédire, je les en préviens !
Le Ménestrel, 7 décembre 1873
Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.
Lien : Gallica
La Jolie parfumeuse du théâtre de la Renaissance. — Le maestro Offenbach ne nous en voudra pas, à propos de la Jolie Parfumeuse, de lui reparler de Jeanne d’Arc. Ce grand, succès épique l’honore tant comme imprésario qu’on ne saurait manquer cette occasion de l’en féliciter derechef. Ce qu’un théâtre richement subventionné n’eût osé tenter, le simple théâtre de la Gaîté l’a réalisé, nous prouvant une fois de plus qu’en France l’impossible n’est qu’un vain mot. La Jeanne d’Arc du square des Arts-et-Métiers défie les splendeurs de l’Opéra, et les chœurs, comme l’orchestre de M. Albert Vizentini, peuvent rivaliser avec les meilleurs éléments de nos théâtres lyriques. Aussi la belle musique de Charles Gounod est-elle de plus en plus goûtée du grand public, qui se presse aux représentations du noble drame de M. Jules Barbier. Voilà un succès qui réhabilite le Paris des théâtres, et console les esprits moroses de l’envahissement des opérettes.
L’Univers illustré, 13 décembre 1873
Extrait du Courrier de Paris, par Gérôme (pseudonyme commun à plusieurs journalistes de l’Univers illustré).
Lien : Gallica
Quant à la Gaîté, la Jeanne d’Arc, de M. Jules Barbier est décidément un énorme succès. J’avais entendu dire que, dans un quartier où l’élément populaire domine, il serait impossible de conquérir la vogue avec une œuvre éminemment littéraire, puisant ses éléments d’attraction dans les sentiments les plus nobles et les plus purs, l’ardeur de la foi, l’enthousiasme du patriotisme, la chasteté, le dévouement ; et de fait, l’attitude de quelques aimables sceptiques du poulailler, à la première représentation, pouvaient donner quelque vraisemblance à cette prédiction. J’ai voulu revoir Jeanne d’Arc ; eh bien, je puis certifier que la foule qui remplit la vaste salle, depuis le parterre jusqu’aux plus hautes galeries, est absolument dominée, empoignée, pour me servir d’un mot familier, mais que l’Académie a laissé à la porte de son dictionnaire. Soyez sûr que si quelque farceur risquait des lazzis déplacés, il serait promptement mis à la raison par les titis eux-mêmes.
L’honneur de cet entraînement profond et unanime doit, de toute justice, être partagé entre l’auteur de cette œuvre magistrale et l’admirable artiste qu’il a eu la bonne fortune d’obtenir pour interpréter le personnage de la vierge héroïque. Dans ce rôle magnifique et redoutable, Mlle Lia Félix a atteint le point culminant du grand art. Après une pareille création, la voilà, sans conteste, la première actrice de drame que nous possédions aujourd’hui. Les succès auxquels son nom fut associé à la Porte-Saint-Martin et à la Gaîté avaient fondé sa réputation et attesté son rare talent ; on lui rendait hommage en l’appelant la sœur de la grande Rachel ; dans Jeanne d’Arc, on lui doit plus encore : il faut l’appeler Lia Félix, et cela suffit. Il semble que l’âme de la patrie soit passée en elle et parle par sa voix. Le talent louche au génie quand il s’élève si haut sur les ailes de l’inspiration, quand il possède le don de jeter le frisson à travers les foules et d’y provoquer d’irrésistibles enthousiasmes. Il y a là je ne sais quelle domination mystérieuse que bien des artistes, malgré leur incontestable valeur, n’ont jamais pu acquérir, et qui demeure le privilège de quelques natures d’élite. Lia Félix est de celles-là, il n’y a pas à en douter, et l’on comprendra aisément pourquoi nous mettons aujourd’hui son portrait sous les yeux de nos lecteurs.

L’Illustration, 13 décembre 1873
Le succès de Jeanne d’Arc, que notre collaborateur M. Savigny avait signalé dès la première représentation de ce drame lyrique, qui devient populaire, s’affirme de jour en jour. L’Illustration lui doit les honneurs d’une gravure et les lui fait bien volontiers, en s’associant à la vive sympathie du public pour le poète, M. Barbier, et pour le musicien, M. Gounod. Elle rend aussi le tribut d’éloges dû aux décorateurs et aux interprètes de cet ouvrage. Elle donne les principales scènes du drame et dans la décoration du fort et de la courtine d’Orléans, au-dessous desquels se dessine le pont de la Loire, et dans cette vue du parvis et de l’église de Reims, et dans cet acte où s’élève le bûcher qui doit dévorer l’héroïne. Au centre, le dessinateur a placé le portrait de Mlle Lia-Félix. Bien des rôles ont marqué la carrière déjà longue de l’éminente artiste. Élevée à cette grande école du bien dire que Mlle Rachel a formée autour d’elle et dans sa propre famille, au milieu de ses sœurs dont elle est aussi une des gloires, Mlle Lia-Félix a fait, dans une série de drames joués depuis tantôt quinze ans, une foule de créations qui lui ont mérité une légitime réputation et qui lui ont valu la première place parmi les interprètes du drame. Jamais le triomphe de Mlle Lia-Félix, même aux jours de la Fille du paysan, n’a été plus vif et plus grand que dans Jeanne d’Arc. Jamais elle n’a déployé des qualités dramatiques aussi saisissantes. Mlle Lia-Félix a résumé dans ce rôle toute la puissance de son talent, par l’émotion vraie, le sentiment, la noblesse et l’énergie. Il y a là comme le souvenir de l’illustre tragédienne, et nous avons cru la voir revivre surtout dans cette scène finale du drame, dans laquelle Mlle Rachel n’aurait pas arraché plus de larmes et appelé à elle plus d’applaudissements.

Le Ménestrel, 14 décembre 1873
Article sur la Révision de la convention internationale entre la France et l’Angleterre.
Lien : Gallica
La Commission chargée de préparer la révision des conventions relatives à la propriété littéraire et d’art entre la France et l’Angleterre, s’est réunie vendredi dernier au ministère des affaires étrangères. Les membres de la Commission française étaient : M. Paul Féval, représentant la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ; MM. Muller, Oscar Comettant, Paul Saunière et Pierre Zaccone pour la Société des gens de lettres. M. Gavard, assisté d’un secrétaire, représentait M. le ministre ; M. de Kennedy, également assisté d’un secrétaire, représentait le gouvernement anglais. Les représentants des Sociétés des auteurs dramatiques et des gens de lettres, se sont élevés contre l’abus de plus en plus criant de ce qu’on appelle en Angleterre les adaptations, et qui ne sont le plus souvent que des contrefaçons à peine déguisées de nos ouvrages dramatiques et de nos livres. M. de Kennedy a répondu qu’il ne doutait pas que le gouvernement de la Grande-Bretagne ne donnât satisfaction à toutes les réclamations légitimes.
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique n’ayant pas de représentant à cette séance, M. Oscar Comettant a été invité par M. Gavard à fournir une note qui sera annexée au procès-verbal. Voici la note que M. Comettant a rédigée et qu’il a fait parvenir au ministère. Les conclusions en seront chaleureusement approuvées par les compositeurs et les éditeurs de musique français, comme elles l’ont été par le président et tout le comité de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Note-annexe du procès-verbal de la séance du 5 décembre 1873, pour la révision des conventions relatives aux œuvres de littérature et d’art, passées entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne.
Œuvres musicales
Trente-sept États ont conclu avec la France des conventions pour la garantie de la propriété intellectuelle, œuvres littéraires et d’art. Ce sont : l’Angleterre — l’Anhalt — Bade — la Bavière — la Belgique — Brème — Brunswick — l’Espagne — Francfort — Hambourg — le Hanovre — Hesse-Cassel — Hesse-Darmstadt — Hesse-Hombourg — l’Italie — Lippe-Detmold — Lübeck — le Luxembourg — le Mecklembourg-Schwerin — le Mecklembourg-Strelitz — Nassau — Oldenbourg — les Pays-Bas — la Prusse — Reuss-Greitz — Reuss-Gera — la Russie — la Saxe-Royale — la Saxe-Altenbourg — la Saxe-Cobourg — la Saxe-Meiningen — la Saxe-Weimar — le Schwarzbourg-Sondershausen — la Suisse — Waldeck et Pyrmont — le Wurtemberg.
Sur ces trente-sept États, tous à cette heure, excepté deux, ont reconnu l’inutilité des dépôts d’exemplaires pour garantir aux auteurs français le droit de propriété de leurs ouvrages à l’étranger*. Ces deux exceptions sont l’Angleterre et l’Espagne.
(* En France, le décret de 1852 garantit de plein droit aux compositeurs étrangers la propriété de leurs œuvres sans aucune formalité, le dépôt n’est obligatoire qu’au moment de poursuivre les reproductions non autorisées par les auteurs, s’il vient à s’en produire. Combien il serait désirable que tous les pays civilisées adoptassent cet axiome de probité : que nul ne peut s’approprier le bien d’autrui sans commettre un vol.)
Cinq nations exigent encore des enregistrements aux légations établies à Paris ; ce sont : La Prusse — la Saxe — la Suisse — le Portugal et l’Autriche.
Pour tous les autres États, les auteurs français d’œuvres de littérature et d’art, n’ont d’autres formalités à remplir, afin d’assurer leur propriété à l’étranger, que le dépôt au ministère de l’intérieur, à Paris, lequel assure en même temps leur droit de propriété pour la France.
L’enregistrement aux Légations, à Paris, est une formalité qui peut être gênante et dont l’utilité n’apparaît pas clairement. En tout cas, ce n’est qu’une formalité toujours possible à remplir. Le dépôt exigé en Angleterre à l’hôtel de la corporation des libraires, est une formalité beaucoup plus gênante, une menace permanente pour les auteurs, de voir leur propriété confisquée au profit de tous, eux seuls exceptés.
En effet, il est un certain nombre d’éditeurs de musique, à Paris, qui publient jusqu’à trois-cents œuvres de musique par an. Il peut arriver (il arrive journellement) que toutes ces œuvres ne peuvent être déposées dans l’espace si court de trois mois, après leur apparition en France, assigné par la convention anglaise ; l’œuvre tombe alors dans le domaine public en Angleterre. Si l’ouvrage n’a pas de succès, aucun éditeur anglais ne l’édite et il n’y a point de dommage pour l’auteur ; mais s’il est accueilli par la faveur publique, chacun s’empresse d’user de la loi et de faire à son profit des éditions nombreuses qui enrichissent le marchand de musique sans aucun bénéfice pour l’auteur.
Le public lui-même ne trouve aucun bénéfice à cette expropriation, sans dédommagement pour le propriétaire, car les prix de la musique sont invariables, qu’elle appartienne au domaine public ou qu’elle soit propriété d’auteur ou d’éditeur.
Un des membres de cette commission ayant négligé, il y a 23 ans environ, de faire déposer en temps utile, en Angleterre, un morceau de piano de sa composition dont il ne pouvait prévoir les destinées, ce morceau tomba dans le domaine public sous ce titre Raphaël, étude par Oscar Comettant.
Cette petite pièce de quatre pages seulement, a été éditée par une vingtaine de marchands de musique dans les trois Royaumes-Unis, et représenterait aujourd’hui encore pour son auteur, une propriété du rendement de dix-mille francs par an. Le calcul en a été fait approximativement par un des premiers éditeurs de Londres.
Le succès a ses caprices, il en a beaucoup, et les exemples du genre de celui que nous venons de citer sont nombreux. En général dans la pratique, les éditeurs de musique français et les compositeurs, négligent souvent forcément de déposer les petits ouvrages : or ce sont ceux-là, quelquefois, qui deviennent le plus productifs.
La commission, fidèle interprète des compositeurs français et de leurs éditeurs, émet le vœu que le royaume de la Grande-Bretagne renonce à la formalité du dépôt au Stationers’ Hall, pour rentrer dans une voie plus libérale, plus conforme à l’esprit même de la convention et plus en harmonie avec le grand caractère de probité qui distingue cette loyale et généreuse nation.
Oscar Comettant,
Membre de la Commission des gens de lettres, représentant de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
Et si nos lecteurs veulent juger de toutes les entraves apportées en Angleterre à la reconnaissance de la propriété littéraire et artistique par la double formalité du dépôt, — car l’enregistrement de l’œuvre au point de vue de l’édition, ne dispense pas d’une déclaration spéciale à celui de la représentation, — qu’ils prennent connaissance de l’intéressante lettre qui suit, adressée par Charles Gounod, au dit sujet, au Pall Mall Gazette, de Londres.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Le numéro d’hier mardi, 2 décembre, de votre estimable journal contient une critique de la lettre que j’ai adressée au Times (en date du 1er décembre), au sujet d’une démarche faite par moi pour l’enregistrement, à Stationers’ Hall, de la date de la première représentation de Jeanne d’Arc, à Paris.
L’auteur de cette critique me reproche de n’avoir absolument rien compris à la loi de copyright, et me trouve un homme irritable. Je ne vois rien d’irrité ni d’irritant dans ma lettre au Times ; j’ai simplement la manie de ne pas vouloir me laisser ni maltraiter ni duper. Je prie, en conséquence, votre critique de me faire l’honneur de résoudre le problème suivant :
Faust est joué à Paris pour la première fois le 19 mars 1859. La partition est publiée à Paris le 15 juin 1859. Elle est envoyée dès le 13 juin, par l’éditeur français, à MM. Chappell de Londres, avec une lettre les priant d’enregistrer immédiatement. Elle est déposée et enregistrée à Stationers’ Hall, le 22 juin. Du 19 mars au 22 juin, si je sais compter, il y a trois mois et trois jours. Or, l’enregistrement de ma partition, huit jours après sa publication à Paris, n’a pas suffi, sur les registres de Stationers’ Hall, pour protéger en Angleterre mes droits de représentation, qui ont été précisément perdus par les trois jours excédant les trois mois de délai accordés par la loi, attendu que la loi assimile et identifie le fait d’une première représentation au fait tout différent d’une première publication.
Il me semble qu’il n’est pas besoin d’être un génie non plus qu’un homme irritable pour comprendre le danger de cette situation, qui est une des plus absurdes créations du chaos législatif. Mais, puisque votre judicieux critique trouve que je n’y ai rien compris, et puisque, lui aussi, confond le dépôt d’un livre (qui peut n’avoir pas encore vu le jour) et l’enregistrement d’une première représentation (qui est un fait accompli), et qui est précisément mon titre à la propriété de mes droits de représentation à l’étranger (liberty of performance), je serai très-reconnaissant à l’auteur de cette critique de vouloir bien préciser mon erreur, la définir, et m’expliquer pourquoi j’ai perdu mes droits sur les représentations de Faust, en dépit des clauses qui les réservaient et les protégeaient dans mes actes de vente et dans mes traités.
J’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très-obéissant serviteur,
Ch. Gounod.
3 décembre 1873.
Le Ménestrel, 21 décembre 1873
Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.
Lien : Gallica
À l’Odéon, l’Athalie de Racine a dû faire sa rentrée hier soir samedi, avec la musique de Mendelssohn. Le succès de la Jeanne d’Arc de Jules Barbier, musique de Gounod, a tenté M. Duquesnel ; nous lui souhaitons de fructueux lendemains à son Marquis de Villemer.
Le Figaro, 31 décembre 1873
Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével.
Lien : Gallica
Jeanne d’Arc est incontestablement le plus grand succès de l’année :
En cinquante représentations, la Gaîté a encaissé la somme colossale de 323.089,50 fr., ce qui ne s’était jamais vu.
L’immense succès de cette pièce, si merveilleusement montée, est dû non-seulement au grand talent de Lia Félix, à la musique de Gounod, aux beaux vers de Barbier et à la magnificence de la mise en scène mais aussi à son patriotisme élevé, réconfortant.
En un mot, c’est une leçon d’histoire, animée, éblouissante de richesses, morale sans être ennuyeuse, qui a surtout le grand mérite de pouvoir être montrée à tous, aux hommes comme aux jeunes gens, aux femmes comme aux jeunes filles.
Le Figaro, 15 janvier 1874
Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével : annonce des dernières représentations.
Lien : Gallica
On annonce au théâtre de la Gaîté les dernières représentations de Jeanne d’Arc ; non pas que le succès de l’œuvre de MM. Jules Barbier et Charles Gounod soit amoindri, ni que les recettes ne se soient maintenues à un niveau très élevé. Tout faisait présager, au contraire, que Jeanne d’Arc était appelée à devenir centenaire mais il est des cas de force majeure devant lesquels il faut s’incliner.
Le rôle de Jeanne d’Arc, où mademoiselle Lia Félix a rencontré son plus grand succès, menace d’épuiser ses forces, sinon son courage, et l’administration, en faisant doubler tous les rôles de la pièce, a cru devoir faire exception pour celui de Jeanne.
Il est en effet des personnalités qu’on ne saurait remplacer. Mademoiselle Lia Félix a donné à son personnage une physionomie dans laquelle s’est absorbé tout l’intérêt du drame. C’est donc en plein succès que le théâtre de la Gaîté va se voir obligé d’interrompre les représentations de Jeanne d’Arc, mais non sans espoir de retour ; car il nous en promet une reprise éclatante.
Orphée passera le 28 janvier.
Le Figaro, 20 janvier 1874
Extrait de la Soirée théâtrale, par un strapontin, pour le Monsieur de l’orchestre
.
Lien : Gallica
Je sors de la Gaîté dont les coulisses présentent en ce moment un aspect étrange. Le théâtre est hanté — même ce soir — par les artistes d’opérette qui viennent prendre l’air de la maison, essayer leurs costumes d’Orphée aux Enfers et répéter certaines phrases musicales qui ne leur sont pas bien entrées dans la tête durant les répétitions de la journée.
En sorte que l’on voit Jupiter serrer la main à Chartes VII, et La Hire offrant un bock à John Styx, tandis qu’Eurydice demande à Agnès Sorel des nouvelles de sa santé et que Junon offre des bonbons à sainte Catherine.
Je passe dans la salle par la porte de communication — cette bienheureuse porte que le profane regarde avec envie. Dans les théâtre de ce genre, les gommeux considèrent cet huys
, comme dirait Dunois — avec un œil attendri… Derrière cette porte, il y a des fames en maillot, avec du rouge, du bleu, du blanc et des perruques.
Je sais un fils de famille qui a payé bien cher la clef d’une porte de communication. Cela se passait, il y a quelques années, dans un petit théâtre faisant mal ses affaires. L’ingénue de la maison, en puissance de gandin, eut l’imprudence de prononcer devant son directeur le chiffre des revenus de son bon jeune homme. Notez qu’elle gagnait 100 fr. par mois et qu’elle les touchait avec un bonheur indicible. Ces cent francs étaient à ses yeux la compensation du talent qu’elle croyait avoir. Le lendemain du jour où elle divulgua la fortune de son sigisbé, elle fut mandée dans le cabinet de l’imprésario qui lui tint ce langage :
— Mon enfant, je dois vous faire une confidence, je vais faire banqueroute. Vous pouvez me sauver. Faites-moi prêter cent-mille francs par votre ami.
Vingt-quatre heures après, l’ingénue frappait à la porte de son directeur. Elle tenait à la main un énorme paquet de billets de banque.
Le directeur, fou de joie, tendit la main vers la liasse bénie.
— Un instant, fit la jeune femme en la dérobant vivement derrière son dos — un instant ! vous aurez vos cent-mille francs quand vous m’aurez augmentée de vingt francs par mois…
Le gommeux eut une clef de communication, mais ne revit jamais un sou de son prêt, qui n’empêcha pas d’ailleurs la déconfiture du théâtre.
Mais revenons à la Gaîté où j’apprends qu’il y a trois jours une ravissante tête blonde, une vraie vignette anglaise ! attirait tous les regards vers une loge de face.
La jeune étrangère suivait avec un intérêt passionné le drame de Jeanne d’Arc et payait à la tragédienne, sœur de Rachel, le tribut de ses applaudissements et de ses larmes.
Cette sympathique beauté n’était autre que Jeanne, la propre fille de madame Lia Félix, élevée à Londres dès l’âge le plus tendre et mariée, au sortir du couvent, à un insulaire, gallophobe au superlatif.
Ce dernier avait permis à sa jeune femme de venir incognito assister au triomphe de sa mère ; mais il avait mis pour condition expresse à son autorisation que Jeanne quitterait Paris dès le lendemain. Il ne voulait pas qu’elle eût la tentation d’aller embrasser celle qui, jouant le personnage de la Pucelle d’Orléans, avait servit de prétexte à des imprécations contre les Anglais… Infortunée Lia ! je lui apprends peut-être un fait qu’elle ignore. Mais il faut qu’on le sache, la carrière dramatique a ses quarts d’heure cruels et ses situations poignantes. Le public ignore que parfois l’acteur qui l’amuse a l’âme en proie à une douleur terrible. Parfois aussi ce même acteur ne se doute pas qu’au moment où il provoque les applaudissements du spectateur, un de ses proches expire sans qu’il soit là pour lui fermer les yeux !
C’est ce qui est arrivé hier à Pierre Berton dont le père rendait l’âme, tandis qu’il jouait le Péril en la demeure. Un de ses amis consterné attendait dans la coulisse la chute du rideau pour lui apprendre la triste nouvelle. Pierre Berton savait son père à l’agonie, mais sa tendresse pour ce père qu’il adorait, le berçait d’illusions. Il s’entêtait à espérer.
Lorsqu’il apprit la nouvelle, il fondit en larmes et le public qui l’applaudissait encore ne se doutait guère que le brave garçon dont il saluait le talent était orphelin depuis quelques minutes.
Tout ceci n’est pas gai, mes chers lecteurs, et vous m’en voudrez peut-être de vous attrister, alors que ma mission est de vous distraire. Que voulez-vous ? Les soirées théâtrales ont un envers !
Le Ménestrel, 25 janvier 1874
Extrait des Nouvelles diverses.
Lien : Gallica
On nous écrit de Londres que Charles Gounod va recommencer ses concerts et que la musique de Jeanne d’Arc en fera les honneurs.
Le Figaro, 9 février 1874
Extrait de la Soirée théâtrale, par un Monsieur de l’orchestre
.
Lien : Gallica
Enfin, nous y voilà donc ! Après des travaux gigantesques qui ont surmené et mis sur les dents tout un monde de décorateurs, de costumiers, de machinistes, de menuisiers, de charpentiers, sans compter les artistes, les musiciens, les choristes, les administrateurs, les régisseurs, les avertisseurs et le souffleur, Offenbach vient de lancer cette immense machine qui s’appelle Orphée aux Enfers.
J’avais eu tout d’abord l’intention d’emprunter à M. Crémieux son grec de fantaisie pour vous conter cette soirée mémorable. Les dieux de l’Olympe me semblaient avoir droit à cette distinction. Mais le titre une fois écrit, je me suis dit que même ce grec-là ne serait peut-être pas à la portée de toutes mes lectrices (heureusement pour elles ; les dieux nous préservent des femmes qui savent le grec !) et j’ai renoncé à la langue du divin Homère.
Rappelez-vous tout ce qu’il y a eu de grandes premières depuis deux ans, prenez-y les noms les plus en vue du fameux tout Paris, et vous pourrez vous faire une idée de l’aspect que présentait la salle de la Gaîté.
Ceux qui ont vu Orphée aux Bouffes [créé le 21 octobre 1858 au théâtre des Bouffes-Parisiens] — et ils sont nombreux — ne peuvent vraiment se figurer ce qu’est le nouvel Orphée de la Gaîté. Les Bouffes d’alors étaient encore plus petits que ceux d’aujourd’hui ; c’était la scène miniature de l’ancien théâtre Comte, et Bache y faisait l’effet d’un géant : en levant les bras il touchait les frises. Aussi y a-t-il entre ces deux Orphées la différence d’une périssoire au Great-Eastern et des buttes Montmartre à l’Himalaya.
Depuis qu’il est directeur, Offenbach nous a habitués à des surprises. Le Gascon, qui a ouvert la marche des succès à la Gaîté, était déjà monté avec le plus grand luxe ; mais à ceux qui vantaient cette prodigalité, les amis de la maison répondaient :
— Ce n’est rien ; attendez Jeanne d’Arc !
Jeanne d’Arc arrive et chacun de s’extasier.
— Mais ce n’est rien encore, disaient les mêmes amis, vous verrez Orphée !
Nous l’avons vu en effet : c’est un véritable éblouissement en douze tableaux. Jamais science de la mise en scène n’a été poussée plus loin. Et ne croyez pas que j’exhume, pour la circonstance, l’éternel cliché qui a servi pour toutes les féeries depuis le premier Pied de mouton jusqu’aux dernières Pilules du diable. Ce n’est plus le clinquant banal, ce ne sont plus les apothéoses roses et bleues, à flammes de Bengale et à paillettes, cette décoration brutale et à coups de poing qui force les applaudissements d’en haut ; c’est de l’art véritable, un art qui se révèle dans les moindres détails et au service duquel on n’a rien épargné.
Mon collaborateur Bénédict donnera demain, aux lecteurs du Figaro, ses impressions sur la partition revue et considérablement augmentée, ainsi que sur l’interprétation. Mais le spectacle m’appartient et négligeant un peu pour cette fois le petit côté pittoresque de la salle, je veux essayer de vous en donner une faible idée. […]
Le Figaro, 14 février 1874
Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével.
Lien : Gallica
Le théâtre de la Gaîté a fait hier soir sa plus forte recette : 9.272 fr. 75 centimes.
[À titre de comparaison, un article du Figaro du 15 septembre donnera une recette moyenne de 6.000 fr. sur la première année d’exploitation du théâtre.]
Le Ménestrel, 22 février 1874
Extrait des Nouvelles diverses.
Lien : Gallica
Le premier concert de M. Gounod à Saint-James Hall a eu lieu, le 7 de ce mois, avec l’orchestre de la Société Wagner. La partie chorale était représentée par le Gounod’s Choir, et les solistes par M. Garcia, Mmes Weldon, Martorelli-Garcia, Morren et Westmacott, ainsi que par le maître lui-même. La messe de Sainte-Cécile et la musique de Jeanne d’Arc ont fait les frais de la séance.
Le Figaro, 27 février 1874
Extrait du Courrier des théâtres, par Gustave Lafargue.
Lien : Gallica
Les droits d’auteurs de Jeanne d’Arc, partagés également entre l’auteur du drame et celui de la partition, ont atteint, avec les droits de billets, la somme de 56.123,20 fr., soit 28.061,60 pour M. Barbier et pareille somme pour madame Gounod, à qui son mari abandonne tous les droits qui lui reviennent en France.
Le Figaro, 26 juin 1874
Extrait du Courrier des théâtres, par Jules Prével : annonce d’une future reprise.
Lien : Gallica
Offenbach ajoutera, pour les vacances, un nouveau tableau à Orphée aux enfers.
Et, quand Orphée aura dit son dernier refrain, on reprendra la Jeanne d’Arc de Barbier et Gounod.
Voilà les travaux avec lesquels on attendra la Gemma de Marly.
Le Ménestrel, 28 juin 1874
Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.
Lien : Gallica
Les Variétés en profitent pour faire salle des plus honorables avec les Brigands d’Offenbach, rafraîchis par la bienvenue de Mlle Paola Marié, la nouvelle Fiorella. — De par Offenbach, recettes soutenues à la Gaîté, qui prépare un nouveau tableau pour son Orphée aux enfers, destiné à faire les honneurs des prochaines vacances, après quoi on enterrera l’Olympe pour faire place à la Jeanne d’Arc de Jules Barbier, avec Mlle [Rosélia] Rousseil [de la Comédie-Française] pour héroïne. C’est annoncer que le maestro-directeur a renoncé au Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, et non sans raison. À la Gaîté, il faut faire du théâtre et pas de la symphonie. Après tout, me direz-vous, le Requiem de Verdi vient bien de faire courir tout Paris à l’Opéra-Comique.
Qu’en déduire ?… Que le succès justifie tout et qu’il n’y a qu’à applaudir lorsqu’il s’agit de belles et bonnes choses.
Le Ménestrel, 5 juillet 1874
Extrait des Nouvelles diverses.
Lien : Gallica
Le festival triennal de Liverpool est dès à présent fixé aux dates suivantes : 29 et 30 septembre, 1er 2, et 3 octobre. L’exécution générale sera conduite par sir Julius Benedict ; le violoniste Sainton dirigera l’orchestre. On y exécutera des oratorios de Mendelssohn, Sullivan, Haydn, Haendel, la nouvelle messe Angeli custodes de Gounod, Jeanne d’Arc, du même auteur, la Symphonie avec chœur de Beethoven, une nouvelle Symphonie de Benedict, une ouverture de Macfarren, une suite d’orchestre de F. Barnett ; ces trois dernières œuvres ont été écrites spécialement pour le festival. L’avant-dernier jour il y aura un concours de sociétés chorales et de chanteurs solistes.
Le Figaro, 11 juillet 1874
Extrait de la rubrique Paris en voyage, par Frou-Frou.
Lien : Gallica
Parmi les personnages que j’ai vus ce matin autour de l’établissement thermal, j’ai noté :
La comtesse de Rayneval, M. et Mme Lefébure de Fourcy, M. Deseilligny, l’ancien ministre, et Mlle Deseilligny, la comtesse de Chabrillan, M. et Mme Douët d’Arcq, la princesse Obrénovitch, le baron de Sartiges, le comte et la comtesse de Chabot, et Mlle Lia Félix.
Cette dernière souffre un peu de la gorge et vient prendre des forces pour la prochaine reprise de Jeanne d’Arc.
Le Figaro, 15 septembre 1874
Extrait du Courrier des théâtres, par Gustave Lafargue : bilan de la 1ère année de la Gaîté.
Lien : Gallica
Notre confrère Émile Mendel, qui est secrétaire de la Gaîté, donne, sur l’exploitation de la première année de ce théâtre par Offenbach, les renseignements suivants :
Au 1er septembre, il y a eu juste un an que le théâtre de la Gaîté est entre les mains d’Offenbach ; nous n’avons pas besoin d’ajouter combien cette première année d’exercice a été prospère. Les chiffres suivants, que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs, en diront beaucoup plus que tout.
1er septembre 1873 au 1er septembre 1874 inclus, les recettes ont atteint la somma colossale de : 2.000.511 50 fr.
Ce qui donne, en comptant les 14 ou 15 jours de relâche occasionnés par les répétitions générales, une moyenne énorme de près de : 6.000 fr. ! ! !
Chiffre qu’aucun théâtre n’a pu atteindre.
Les auteurs ont touché : 200.051,16 fr.
Les pauvres 220.056,25 fr.
Est-il nécessaire de rappeler que 700 personnes, tant employés qu’artistes, musiciens, choristes, figurants, machinistes ont trouvé leur pain quotidien dans cette recette inouïe de 2.000.511,50 fr., qui se décompose ainsi :
- Gascon : 261.308,75 fr.
- Jeanne d’Arc : 533.071,25 fr.
- Orphée : 1.185.971,50 fr.
- Matinées littéraires et musicales : 20.160 fr.
Le Ménestrel, 17 janvier 1875
Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.
Lien : Gallica
Un succès, qui date de bien moins loin, va très-certainement se renouveler cette semaine au théâtre de la Gaîté. Nous voulons parler de la reprise de la Jeanne d’Arc de Jules Barbier, musique de Charles Gounod. Le maître surveille en personne l’exécution de son œuvre confiée, comme l’an dernier, au jeune et vaillant chef d’orchestre Vizentini. Mlle Lia Félix reparaîtra dans Jeanne d’Arc, et c’est Mlle Vannoy qui remplira le rôle d’Agnès Sorel.
Le grand public parisien retient déjà ses places. Avis aux retardataires !
Le Figaro, 21 janvier 1875
Extrait du Courrier des théâtres, par Charles Darcours.
Lien : Gallica
Ovations sur ovations, tel est le bilan de la répétition générale de Jeanne d’Arc à la Gaîté.
C’est la première fois que M. Charles Gounod entendait sa dernière œuvre sur une scène française. Les artistes, les chœurs et l’orchestre l’ont salué par d’unanimes acclamations.
L’auteur de Faust s’est montré très agréablement surpris de l’interprétation, à laquelle il ne se serait jamais attendu en dehors de l’Opéra et de l’Opéra-Comique. Après avoir reconnu l’excellente sonorité du choral de M. Bourdeau, et vivement remercié M. Albert Vizentini d’avoir si bien compris ses mouvements, M. Gounod a indiqué à tous l’accentuation artistique qui lui est personnelle et qui rehausse si bien sa musique.
Au dernier entracte, comme Gounod arrivait sur le théâtre, M. Vizentini lui a lu une dépêche d’Offenbach, lui souhaitant la bienvenue sur son théâtre, et lui exprimant la joie qu’on a éprouvée à monter son œuvre. Gounod a répondu, par un speech des mieux tournés, dans lequel il a vanté l’excellence de l’interprétation et remercié tous ceux qui y ont coopéré.
Extrait des annonces de Spectacles.
Gaîté, 7 h. 1/2 : 1ère reprise de Jeanne d’Arc.
La Hire : Clément Just ; de Thouars : Desrieux ; Charles VII : Angelo ; Thibault : Reynold ; Jacques d’Arc : Antonin ; Dunois Billier [Stuart] ; Xaintrailles : Gaspard ; Jeanne d’Arc : Lia Félix ; Agnès Sorel : Vannoy [Tessandier] ; Loys : Perret ; Isabelle Romée : Jeault ; sainte Marguerite : Maury ; sainte Catherine : Durieu [Yriard] ; Mengette : Julia H.
Le Ménestrel, 24 janvier 1875
Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.
Lien : Gallica
À la Gaîté, belle reprise de la Jeanne d’Arc de Jules Barbier, arrêtée l’année dernière en plein succès. Lia Félix superbe et Mlle Vannoy très-touchante dans le rôle d’Agnès Sorel. La musique de Gounod gagne de jour en jour dans les sympathies. Voilà une reprise qui va être fructueuse. C’est toujours Vizentini qui dirige l’action, et c’est un chaleureux chef accoutumé au succès.
Le Figaro, 25 janvier 1875
Extrait de la Soirée théâtrale, par Charles Darcours.
Lien : Gallica
La reprise de Jeanne d’Arc à la Gaîté obtient un immense succès, et semble même devoir dépasser celui que le magnifique drame lyrique de MM. Barbier et Gounod obtint à sa création.
Le rôle de Jeanne est tenu par Lia Félix, plus belle que jamais, et que le public acclame chaque soir. Lia Félix est fort bien entourée ; quant aux merveilles de la mise en scène et à la perfection de l’exécution musicale, elles sont l’objet de l’admiration unanime.
Le bureau de location est assiégé ; chacun se presse pour revoir le drame populaire, et déjà un grand nombre de directeurs de pensionnats ont fait retenir des places, heureux de pouvoir offrir à leur jeune troupeau un spectacle intéressant, splendide et si bien fait pour élever les cœurs.
Le Figaro, 27 janvier 1875
Extrait de la Soirée théâtrale, par Charles Darcours.
Lien : Gallica
Jeanne d’Arc, le beau drame lyrique de Gounod et Jules Barbier, n’aura plus qu’un nombre très restreint de représentations à la Gaîté, les répétitions de Geneviève de Brabant avançant rapidement.
Le Figaro, 29 janvier 1875
Extrait de la Soirée théâtrale, par Charles Darcours : indisposition de Lia Félix la veille.
Lien : Gallica
Une grave indisposition de Mlle Lia Félix a été, hier sur le point d’interrompre la représentation de Jeanne d’Arc à la Gaîté.
La vaillante artiste a pu néanmoins finir la pièce ; mais c’était tout ce qu’on pouvait lui demander.
Aujourd’hui donc, relâche.
Offenbach aurait été dans le plus grand embarras, s’il n’avait eu heureusement sous la main Orphée aux Enfers, qui n’avait pas encore été démonté.
Aussi pouvons-nous annoncer pour demain la reprise de ce fastueux et amusant opéra-féerie, avec Mme Peschard dans le rôle d’Eurydice, et la jolie Théo dans celui de Cupidon. Mlle Perret reprendra le rôle de Diane, et M. Grivot, celui de Mercure.
Le Figaro, 30 janvier 1875
Extrait de la Soirée théâtrale, par Charles Darcours : interruption.
Lien : Gallica
Les représentations de Jeanne d’Arc étant momentanément suspendues par suite de l’indisposition de Mlle Lia Félix, la Gaîté reprend ce soir samedi Orphée aux Enfers, avec Mmes Peschard et Théo dans les rôles d’Eurydice et de Cupidon, et M. Courcelle dans celui de Jupin.
M. Grivot et Mlle Perret rentreront dans les rôles de Mercure et de Diane.
Le Figaro, 31 janvier 1875
Extrait de la Soirée théâtrale, par Charles Darcours : mariage de Marie Offenbach.
Lien : Gallica
Hier samedi a été célébré à Notre-Dame-de-Lorette le mariage de Mlle Marie Offenbach, fille du directeur de la Gaîté, avec M. Achille Tournai, associé d’agent de change.
Dès onze heures, l’église était remplie par les nombreux amis des deux familles et aussi par les curieux venus pour voir les artistes invités à la cérémonie. Pour employer — et bien à juste titre — le cliché d’usage, on peut dire que tout le Paris artistique, musical, littéraire et théâtral s’y était donné rendez-vous, ainsi que le monde de la Finance et de la Bourse.
À midi Offenbach a fait son entrée, donnant le bras à sa fille, tandis que l’orgue jouait une marche nuptiale.
La messe a été fort belle. Le Domine Deus et l’O Salutaris ont été chantés par Faure avec la maîtrise de la paroisse. Duchesne a ensuite chanté l’Ave Maria de Gounod.
À l’issue de la cérémonie, les mariés se sont rendus à la sacristie, où ils ont reçu les félicitations de tous leurs amis. Le défilé a duré plus d’une heure. Il y avait là deux mille personnes au moins.
Il nous est impossible de citer tous les noms. Nommons seulement MM. Halanzier, Comte, Du Locle, de Leuven, Bertrand, Camille Doucet, le baron Taylor, de Villemessant, Philippe Gille, Mortier, Émile Blavet, Sari, Alexandre, Grivot, Daubray, Émile Taigny, Vizentini, Vazeille, Baudu, Émile Mendel, Henri de Pène, Jehan Walter, Edmond Magnier, Aurélien Scholl, Edmond About, Dupuis, Berthelier, Baron, Schey, Cantin, Montigny, Albert Wolff, Auguste Vitu, Lafargue, etc. ; Mmes Lia Félix, Perret, Théo, Peschard, Judic, Maury, Gilbert, Pauline Lyon, Augèle, Julia H., tout le corps de ballet de la Gaîté ainsi qu’une foule d’artistes appartenant aux différents théâtres.
Le Ménestrel, 7 février 1875
Extrait de la Semaine théâtrale, par Henri Moreno.
Lien : Gallica
Orphée aux Enfers a reparu sur les affiches de la Gaîté, la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier et Charles Gounod se trouvant empêchée par indisposition de Mlle Lia Félix, brisée au contact même des émotions qu’elle transmettait si bien au public.
Espérons le prompt rétablissement de la sympathique Jeanne d’Arc.
La Comédie, 21 février 1875
Illustrations des sept tableaux.
Lien : Gallica