Dossier : Documentation : 1890
1890 Sarah Bernhardt à la Porte-Saint-Martin. — Tournée Jeanne d’Arc.
Le Figaro, 13 novembre 1889
Extrait du Courrier des théâtres.
Lien : Gallica
Après Jeanne d’Arc à la Porte-Saint-Martin, Mme Sarah Bernhardt compte créer le principal, rôle dans Anna Fœderowna, drame nouveau de nos confrères Armand Silvestre et Georges Maillard, emprunté à un des épisodes les plus émouvants de l’histoire de Russie et spécialement écrit pour elle.
Le Gaulois, 1er décembre 1889
Article d’Yveling Rambaud.
Lien : Gallica
Jeanne d’Arc et Gounod
J’entrai un jour chez un homme qui a beaucoup vécu, beaucoup fait et beaucoup souffert. Il tenait à la main un livre qu’il venait de fermer et semblait plongé dans un rêve ; je vis, non sans surprise, que ses yeux étaient pleins de larmes. Enfin, revenant à lui-même :
— Elle est donc morte ! dit-il.
— Qui ?
— La pauvre Jeanne d’Arc.
Telle est la force de cette histoire, telle sa tyrannie sur le cœur, sa puissance pour arracher des larmes. Bien dite ou mal contée, que le lecteur soit jeune ou vieux, qu’il soit, tant qu’il voudra, affermi par l’expérience, endurci par la vie, elle le fera pleurer. Hommes, n’en rougissez pas, et ne vous cachez pas d’être hommes. Ici, la cause est belle. Nul deuil récent, nul événement personnel n’a droit d’émouvoir davantage un bon et digne cœur. [Jules Michelet, Jeanne d’Arc (1853), Introduction.]
Jules Michelet a raison : Jeanne d’Arc exerce une si mystérieuse fascination que, peu importe, quand on la met en scène, qui la met en scène.
Il semble que, pour parler de cette étrange créature, il faudrait être un Shakespeare. Eh bien ! non, un poète d’un fort ordinaire talent peut s’attaquer à ce sujet écrasant. Il nous intéressera toujours.
Nous verrons bientôt Jeanne d’Arc à la Porte-Saint-Martin. Jeanne apparaîtra sous les traits de Sarah Bernhardt, parmi les vers de M. Jules Barbier et l’envolée des mélodies de Gounod. Incarner la vierge de Vaucouleurs, quel rêve pour une tragédienne fouettée de hautes ambitions ! Il y a longtemps que Sarah caressait ce rêve : dix ans !
Comment se fait-il que la Porte-Saint-Martin soit prête à montrer Jeanne d’Arc sur ses planches ? Un hasard capricieux, un tout petit point de départ détermina cet événement. L’anecdote est assez bizarre pour valoir qu’on la conte.
Il y a quelque temps, un de nos confrères reçut une lettre d’une dame de ses amies, appartenant au meilleur monde, laquelle lettre disait en substance :
Ne pourriez-vous pas, vous qui connaissez Mme Sarah Bernhardt, dire à cette grande artiste que beaucoup de femmes et de jeunes filles voudraient l’applaudir, mais que le genre des pièces qu’elle joue leur interdit d’aller au théâtre, témoin de ses triomphes ? C’est une fatalité ! elle joue tantôt une reine vicieuse, tantôt une gourgandine quelconque, tantôt une bourgeoise ou une grande dame d’une moralité suspecte. Pourquoi ne jouerait-elle pas Jeanne d’Arc ? Bien des mères iraient l’applaudir, et de grand cœur.
Le journaliste se contenta d’envoyer la mettre à Sarah. La tragédienne fût touchée de la requête qui lui était adressée par ricochet.
— Mais, répondit-elle, voilà dix ans que je caresse ce projet de jouer Jeanne d’Arc ; voilà dix ans que je le veux. Et il est temps. Dans trois ans, je serai trop vieille. Songez que je suis grand-mère [le 20 mai 1889 était née Simone, la première fille de son fils Maurice]. J’ai lu et relu toutes les Jeanne d’Arc existantes. Je me suis arrêtée à celle de Barbier.
Voilà comment la Porte-Saint-Martin fut amenée à monter, pour les fêtes de Noël, cet ouvrage qui, malgré sa grande simplicité, comporte un déploiement de mise en scène peu commun. Le titre est changé. Il est ainsi libellé : Jeanne d’Arc, drame-légende en trois parties.
Ces trois parties pourraient s’appeler : la Mission, le Triomphe, la Mort. Dans la première, Domrémy, la vision ; dans la seconde, Orléans, Reims, le sacre ; dans la troisième, Rouen, la prison, le bûcher.
L’illustre musicien qui doit écrire les mélodies de Jeanne d’Arc est le même qui, avant-hier soir, triomphait avec Mireille. Hier matin, je voulais entendre le maître si éloquent, si enthousiaste, raconter quelque impression sur l’héroïne humaine de l’amoureuse légende de Provence ou sur l’héroïne surhumaine de la grande légende de France.
Il y avait dans la maison une consigne sévère, qui, heureusement, fut levée pour le visiteur.
— Mon mari, me dit Mme Gounod, est en ce moment en grande conférence avec M. Duquesnel [directeur du théâtre] et le chef d’orchestre de la Porte-Saint-Martin ; il s’agit de la Jeanne d’Arc de Jules Barbier. Voulez-vous l’attendre un instant ?
Au même moment, Gounod apparut, très affairé, la figure éclairée d’un heureux sourire.
— Venez vite !
Duquesnel me fait voir la maquette du nouveau tableau de Jeanne d’Arc. C’est une véritable merveille.
J’étais dans la place.
Un domestique tenait à contre-jour le petit décor, planté dans son frêle cartonnage, un véritable chef-d’œuvre de Lavastre : la cathédrale de Reims. Un premier plan, destiné à l’action, et les plans suivants, réservés au chœur, au maître-autel, aux chapelles latérales, aperçues dans des profondeurs, s’étendant à des distances inouïes et éclairées par des verrières éblouissantes.
— Est-ce superbe, mes amis ! disait Gounod tout transporté. Quel silence dans ce vaisseau grandiose !
Et se tournant vers M. Duquesnel, il le complimentait en termes enthousiastes.
— Vous voulez parler de moi, me dit-il, eh bien ! mais voilà une occasion superbe. Ne nous occupons cas de Mireille, parlons de Jeanne d’Arc. Écoutez ! M. Duquesnel va me lire le quatrième tableau, et nous allons régler ensuite les endroits où doit figurer ma musique.
Ce quatrième tableau est celui de l’Église. Le rideau se lève sur un chœur qui précède la marche triomphale. C’est un Veni creator écrit en plain-chant.
Gounod plaqua un accord sur le clavier qui fait partie de son bureau, et, de sa belle voix pénétrante, entonna le chant religieux. Sa tête se promène, jetée en arrière, les yeux levés vers les poutres du plafond de l’atelier ; il évoquait en nous l’image d’un moine du moyen âge. Une chaleur mystique passait dans sa voix persuasive et émue.
— Oui, mon ami, c’est du plain-chant, sans un renversement d’accords, rien qu’avec les fondamentales ! Et ceci, chanté simplement par quarante voix de femmes remplaçant des voix d’enfants du chœur, sera d’un grand effet au milieu de décor magnifique que vous venez de voir.
M. Duquesnel, assis sur un fauteuil en face, lut le manuscrit.
— Après la marche, dit Gounod, l’archevêque procède au sacre du Roi ; pendant qu’il boucle la cuirasse et met les étriers de Charles VII ; Jeanne d’Arc s’avance et récite cinq strophes en a parte. C’est là que se place la musique d’orchestre qui doit suivre, accompagner le débit de Sarah Bernhardt. Donnez-moi le manuscrit que je les lise à mon tour.
Et il commence :
Enfin la France existe et ma tâche est remplie !
Après la première strophe, où Jeanne ne pense qu’au triomphe, on entend la voix grave de l’archevêque, qui psalmodie Gloria in excelcis… Gloria in excelcis, disent en répons, dans un murmure nombreux et lointain, les assistants, parmi lesquels figurent dans leur stalle, d’un côté, les évêques, crossés et mitres, de l’autre, les princes et les pairs du royaume.
À la seconde strophe, Jeanne est subitement devenue craintive : elle n’entend plus les voix du Ciel !
Deo gratias, répète l’archevêque. Deo gratias, reprennent les fidèles d’une voix sourde qui va s’éteignant sous la profondeur des arceaux.
Jeanne fait un retour vers sa cabane de Domrémy, elle songe aux jours heureux, se prend à regretter les lis de son jardin et les oiselets qui chantaient à sa fenêtre. C’est la troisième strophe.
Dans la quatrième, elle demande à Dieu la force et le temps de terminer son œuvre.
Mais, dans une vision, elle aperçoit l’horrible bûcher qui doit brûler vif son corps servant de spectacle aux Judas haineux et aux Pilates qui n’osent la défendre.
Après ces strophes, la musique cesse. Jeanne remonte la scène ; l’archevêque vient de placer la couronne royale sur le front de Charles VII. Elle va se prosterner devant lui.
Alors, le prélat, d’une voix forte, s’écrie : Viva rex in æternum !
Viva rex ! répond par trois fois la foule, et le chœur entonne un noël, que Gounod vient de terminer.
Mais pendant que Duquesnel lisait ce tableau, que j’esquisse au hasard de la mémoire, Gounod, comme illuminé, écoutait religieusement.
— Oui, je vois bien la musique à faire : il faut que la musique, dans ce cas, soit la servante de la situation, Ecce ancilla Domini, comme dit la salutation angélique. Il faut que ces strophes soient répétées par Sarah Bernhardt dans une sorte d’atmosphère chantante : ça doit être léger comme une mousseline. L’orchestre se sera petit, la mélodie ne sera pas devant Jeanne, mais derrière elle.
Et le maître resta absorbé un instant.
Ce fut le chef d’orchestre qui le rappela aux réalités de ce monde, en lui demandant quelques détails sur la place qui devait être réservée à quelques morceaux.
Car ne faut-il pas toujours que l’artiste sorte de son rêve pour se mettre à le réaliser !
Le Figaro, 2 décembre 1889
Extrait du Courrier des théâtres.
Lien : Gallica
Nouvelles du théâtre de la Porte-Saint-Martin. — On fait le possible pour que la première représentation de Jeanne d’Arc, le drame-légende de Jules Barbier, puisse être donnée dans le courant de décembre.
Il y a, en effet, grand intérêt à arriver avant la fin de l’année, car la première semaine de janvier, avec ses soirées et ses matinées, produira, à elle seule, certainement une centaine de mille francs de recettes : — Jeanne d’Arc est, avant tout, la pièce de la jeunesse, à qui elle plaît par son côté national et héroïque, et ce serait vraiment dommage de ne pas lui en donner le régal pendant les congés du jour de l’an.
Sarah Bernhardt est très éprise du rôle de Jeanne, qui convient merveilleusement à ses qualités, et dont elle fera, à coup sûr, une de ses plus belles créations ; elle répète avec beaucoup d’ardeur : la première arrivée, elle part la dernière, ou plutôt, pour ainsi dire, elle ne quitte pas le théâtre. Les répétitions ne finissant que vers six heures, elle n’a que le temps de dîner légèrement, dans sa loge, et de s’habiller ensuite, afin d’être en scène à huit heures, pour le premier acte de Théodora.
Aussi, dans ces conditions, le travail des répétitions est très avancé, et l’on serait prêt rapidement, n’était le côté matériel de la mise en scène qui est considérable et demande encore un grand effort de travail. Six grands décors avec transformations et plus de cinq cents costumes, cela ne s’improvise pas.
D’autre part, on sait que la Jeanne d’Arc de Barbier est appuyée d’une partie musicale importante, à la manière des drames lyriques (Egmont et Struensée, par exemple). La pièce ayant subi de nombreux changements, par suite, la musique a besoin, elle aussi, d’être remaniée et mise au point. C’est le travail dont s’occupe en ce moment Charles Gounod, l’auteur de la partition. Le maître doit, en outre, écrire tout exprès deux musiques de scène, destinées à accompagner des stances dites par Sarah Bernhardt, et composer la partition d’un tableau tout entier (le Sacre de Charles VII), qui est nouveau venu dans le drame — tableau presque exclusivement musical et qui comprend un chœur de plain-chant, un chœur de triomphe à toutes voix et une musique de scène qui soutient l’acte entier.
Le Gaulois, 4 décembre 1889
Interview de Sarah Bernhardt par Yveling Rambaud.
Lien : Gallica
Chez Mme Sarah Bernhardt,
à propos de Jeanne d’Arc
— Ah ! vous voilà ! me dit la tragédienne, au moment où j’entrais dans sa loge. Je m’attendais à votre visite, après l’article que vous avez publié dans le Gaulois, à propos de ma reprise de Jeanne d’Arc. Que voulez-vous de moi ?
— Causer avec vous de l’héroïne et tenir de votre bouche la façon dont vous la comprenez.
— Ce n’est pas un examen, je suppose, mais mon impression que vous me demandez ? Eh bien, la voici :
Je suis, depuis longtemps, vous l’avez dit du reste, éprise du personnage de Jeanne d’Arc. J’ai eu, en effet, l’obsession de cette grande et superbe figure de notre histoire. Après avoir lu Michelet, Henri Martin, Lamartine, j’ai cherché tout ce qui avait été écrit pour le théâtre : la tragédie de Pierre Dumesnil [Jeanne d’Arc ou la France sauvée, 1818, poème en douze chants], la trilogie de Soumet [Jeanne d’Arc, trilogie nationale dédiée à la France, 1846], le superbe drame de Schiller [Die Jungfrau von Orléans, 1801] et la pièce de d’Avrigny [Jeanne d’Arc à Rouen, 1819, tragédie en cinq actes, en vers, jouée au Théâtre-Français, il y a plus de cinquante ans ; enfin, j’ai choisi, au milieu d’œuvres inédites qu’on m’a proposées depuis, l’œuvre de M. Jules Barbier.
Sa Jeanne d’Arc me semble mieux taillée pour la scène française, où l’œuvre magistrale de Schiller n’aurait trouvé que peu de partisans.
— Alors, vous mettez la pièce de Jules Barbier au-dessus des autres ?
— Ne me faites pas dire ce, que je ne dis, pas, et surtout, ne prenez pas, dans mes paroles, texte à une critique désobligeante pour le poète français.
Sa pièce se tient et rentre dans les conditions exigées, à tort ou à raison, par le théâtre en France. Il s’est inspiré, d’ailleurs, beaucoup du poète allemand. Ce qu’il a fait, c’est une suite de situations représentant la grande Jeanne d’Arc sous les jours les plus différents. Malheureusement, il ne nous l’a pas donnée sous tous ses aspects. Pour ma part, je regrette que nous n’ayons pas cette scène merveilleuse où Jeanne, la simple fille de Vaucouleurs, tient en échec toute la casuistique, la science chicanière des docteurs en théologie réunis pour l’outrager et dans le but de la confondre. Ses réponses sont merveilleuses !
Jeanne est tantôt d’une naïveté sublime, tantôt ironique et même enjouée. Son à-propos, son sang-froid, jetaient dans le désarroi ses juges, que la logique imprévue de la pauvre femme réduisait à l’aveu tacite de leur impuissance.
Oui, j’aurais voulu cette scène et, dans mon esprit, je l’avais pour ainsi dire préparée.
Je me suis, en somme, imprégnée, pour ainsi dire, de la vie de l’héroïne en lisant tout ce qui a été imprimé sur elle.
— Au point de vue physique et du costume, avez-vous des idées arrêtées ?
— Absolument ; je sais par les documents que Jeanne était maigre et élancée — rien de la paysanne : elle l’était beaucoup moins, dans sa structure, que la Marguerite robuste imaginée par Goethe, et qu’Ary Scheffer a faite émaciée. J’ai visé à une restitution archaïque. Ma Jeanne, à moi, est une sainte de vitrail — elle est illuminée, visionnaire et agit sous l’impulsion d’une volonté exhérente de la science.
Dans les nimbes de son mysticisme, il y a une suggestion, un cas d’hypnotisme — c’est mon humble avis que je vous donne — qui peut et doit être d’un effet certain au théâtre s’il est rendu sincèrement, surtout à notre époque où la science daigne mettre le pied dans le domaine du merveilleux.
— Vous y croyez donc, vous aussi, au merveilleux ?
— Comment n’y croirais-je pas ? J’ai eu tant de constatations dans ma vie de ce qu’on n’explique pas, mais qu’on est obligé de reconnaître, que j’ai bien dû me rendre à l’évidence. Tenez, un exemple entre dix. Je pars pour l’Amérique ; c’est mon premier voyage. J’étais, depuis le troisième jour, installée dans l’hôtel, à New-York, lorsqu’une nuit je me réveille en sursaut, chassant un rêve épouvantable.
Je réveille Mme Guérard, qui couchait dans ma chambre. Ma chère amie, lui dis-je ; je suis au supplice ; je viens de voir mon pauvre fils, mordu par des chiens enragés. C’est épouvantable, dites-moi que je suis hallucinée, que ce n’est pas vrai !
À la premiers heure, le lendemain, j’envoyai une dépêche à mon enfant, qui me répondit télégraphiquement : Ne t’inquiète pas, les deux chiens ont été abattus ; la morsure que j’ai au bras est sans gravité.
Je pourrais multiplier à l’infini ces exemples. Oh oui, il y a des choses qui ne sont pas le résultat du simple hasard.
En attendant, je pioche mon rôle, que j’aime tel qu’il est. J’espère que cette nouvelle création, tant désirée, correspondra aux efforts et aux recherches que je m’impose, pour donner au superbe et exquis personnage de Jeanne d’Arc une interprétation digne de cette patriotique figure.
À ce moment, on vint avertir Mme Sarah Bernhardt que la répétition allait commencer.
Vert-Vert, 22 décembre 1889
Extrait des Nouvelles. Dernière de Théodora.
Lien : Retronews
Théodora n’aura plus que deux représentations, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, et Jeanne d’Arc, le drame-légende de Jules Barbier pourra être joué pendant la semaine du jour de l’An.
Nous pouvons même annoncer, dès maintenant, que Jeanne d’Arc sera donnée en matinée les jeudi 2, samedi 4 et dimanche 5 janvier 1890.
Vert-Vert, 27 décembre 1889
Extrait des Nouvelles.
Lien : Retronews
Au théâtre de la Porte-Saint-Martin, on fait relâche, on répète généralement Jeanne d’Arc depuis lundi denier, et on annonce la première représentation pour lundi 30, sans remise.
Il reste à régler le quatrième tableau, celui du Sacre de Charles VII, qui comporte une mise en scène très importante, — ce tableau, qui ne dure pas plus de dix à douze minutes, occupe une figuration de plus de deux cents personnages, représentant les pairs du royaume, les chapitres de Reims et de Saint-Denis, les pages, hérauts d’armes, dames d’honneur.
Le décor, exécuté par J.-B. Lavastre et Carpezat, donne la reproduction exacte de la cathédrale de Reims, le jour du sacre du roi de France. Il absorbe le théâtre dans toute sa largeur et dans toute sa profondeur.
La scène est coupée en deux parties : la première occupée par l’autel du sacre et le chœur de la cathédrale où s’accomplit la cérémonie.
L’arrière-plan est occupé par les chapelles du fond éclairées par des verrières de couleur. L’effet est, dit-on, très curieux et tout à fait nouveau au théâtre.
À dater de demain, c’est Gounod qui va suivre les répétitions musicales de l’orchestre et des chœurs, pour faire les raccords du mélodrame.
Jeanne d’Arc sera jouée en matinée, pendant la semaine du jour de l’an, les jeudi 2, samedi 4 et dimanche 5 janvier.
Vert-Vert, 31 décembre 1889
Extrait des Nouvelles.
Lien : Retronews
On a fait courir le bruit que Sarah Bernhardt était souffrante ; il n’en est rien, jamais la grande artiste ne s’est jamais mieux portée ; mais, un peu fatiguée par une série de cent vingt représentations consécutives, elle a demandé à prendre vingt-quatre heures de repos nécessaire ; après quoi, elle s’est remise avec une ardeur sans pareille aux répétitions de Jeanne d’Arc — et l’on peut dire que jamais rôle n’a paru lui plaire davantage ; — si même nous en croyons les bruits du théâtre, ce sera, pour elle, l’occasion d’une création tout à fait remarquable.
Il est fâcheux que les complications de mise en scène aient nécessité ce retard de quatre jours, qui est une très grosse perte pour la direction ; mais on ne veut passer qu’avec une pièce tout à fait au point et montée avec une absolue perfection de détails. Or, Jeanne d’Arc est la pièce à mise en scène la plus considérable qui ait été montée à la Porte-Saint-Martin, depuis dix ans — et cette mise en scène se trouve encore compliquée par la partie musicale, qui a nécessité la formation de chœurs et d’orchestres comprenant 140 exécutants.
Quant à la première représentation de Jeanne d’Arc, elle est définitivement fixée, et sans remise cette fois, à vendredi prochain, 3 janvier.
La répétition générale se fera le jeudi 2.
Malgré cela, Jeanne d’Arc sera jouée, quand même, en matinée, deux fois dans la semaine du jour de l’an, le samedi 4 et le dimanche 5 janvier.
Nous venons d’apprendre à la dernière heure que la répétition de Jeanne d’Arc, qui avait eu lieu hier soir à la Porte-Saint-Martin, a été signalée par un déplorable accident.
Au moment où l’héroïne — Mme Sarah Bernhardt — est attachée sur le bûcher, les machinistes qui se trouvaient sous la scène ont allumé tout d’un coup les feux de Bengale destinés à simuler l’embrasement final.
Une fumée acre, épaisse et étouffante se répandit aussitôt autour d’eux et monta jusqu’à l’artiste, qui, menacée d’asphyxie, se mit à pousser des cris d’appel. On put heureusement la détacher à temps, et quelques soins, prodigués habilement, la ranimèrent bientôt.
Mais il n’en fut pas de même des deux machinistes, dont l’un a payé de sa vie son imprudence et dont l’autre est dans un état désespéré.
Le Temps, 31 décembre 1889
Extrait des Spectacles et concerts. Accident d’électricité.
Lien : Gallica
Quelques-uns de nos confrères ont beaucoup exagéré l’importance d’un accident arrivé hier à la Porte-Saint-Martin, pendant une répétition de Jeanne d’Arc. Le bruit avait couru que Mme Sarah Bernhardt avait failli être brûlée vive sur son bûcher, qu’elle avait été suffoquée par des torrents de fumée, qu’il avait fallu l’emporter sans connaissance et que deux machinistes avaient été asphyxiés. Rien de tout cela n’est vrai. Voici l’accident ramené à ses véritables proportions : le chef des accessoires, Saclier, était placé sous ce bûcher et chargé de produire les flammes à l’aide de lycopode et de suc de lait, selon le procédé bien connu pour imiter les éclairs au théâtre. Pour ne pas se déranger trop souvent, il avait placé à côté des récipients en fer blanc un seau contenant ces matières. La flamme ayant atteint ce seau, tout s’est enflammé d’un coup, projetant une vive lueur et un nuage de fumée, comme un tas de poudre auquel on met le feu. Saclier a eu la figure littéralement flambée comme un poulet ; barbe, cheveux, sourcils ont été grillés. Mme Sarah Bernhardt n’a couru aucun danger et n’a éprouvé aucune alarme. Elle est descendue du bûcher très tranquillement et a donné elle-même les premiers soins à l’imprudent chef des accessoires, qui a été ensuite transporté à l’hôpital dans une voiture des ambulances urbaines. Son état n’inspire, du reste, aucune inquiétude.
Le Figaro, 2 janvier 1890
Entretien avec Sarah Bernhardt à la veille de la première à sensation.
Lien : Gallica
À propos de Jeanne d’Arc. — Une visite à Sarah Bernhardt.
Jeanne d’Arc, drame-légende de Jules Barbier, chœurs et musique de scène de Charles Gounod, avec Sarah Bernhardt — comme principale interprète — certes voilà un beau programme et une véritable curiosité artistique ! Un jour, à peine, nous sépare de la représentation, et il nous a paru intéressant, à la veille de cette première à sensation, de causer avec la célèbre tragédienne, de lui demander ce qu’elle pense de son rôle, comment elle comprend la figure de notre héroïne nationale, comment elle s’y incarnera, et nous nous sommes dirigé vers la demeure de Théodora.
Celle qui était, hier encore, l’Impératrice ce Byzance, occupe, boulevard Pereire, 58, un petit hôtel confortable construit par Cantin, l’ancien directeur des Folies et des Bouffes, le propre père de la Fille de madame Angot — laquelle, par parenthèse, en fille bien apprise, a largement doté son père, ce qui lui permet de bâtir des hôtels et d’avoir pignon sur rue.
Je sonne, on m’ouvre, et je pénètre sous la voûte, où je suis, tout d’abord, accueilli par les familiers de la maison, Tosco et Capitaine, deux admirables épagneuls écossais, de haute taille.
Tosco, dont la robe est d’un jaune fulgurant et tout à fait immaculée, s’approche lentement de moi, me fixe avec ses yeux d’or, me flaire dédaigneusement, et s’en va, témoignant ainsi du mépris que je lui inspire, et me faisant comprendre par sa froideur qu’il m’a assez vu.
Tout autre est Capitaine, un aimable chien, à la robe d’un noir soyeux, il s’approche de moi amicalement, me regarde avec ses grands yeux de gazelle, me caresse et agite gaiement ce panache, qu’un philosophe, ami des chiens, a appelé le balancier de leur cœur. Il me témoignera sa joie de me voir et m’exprime, par une pantomime vive et animée, que la maison est hospitalière et que je vais y être le bienvenu.
Capitaine ne m’a pas trompé, je fais passer ma carte et l’on m’introduit en me faisant passer à travers une grande portière mexicaine, faite de lianes entre-mêlées de verroterie, dans le hall où Théodora tient ses assises.
— Vous vous doutez, lui dis-je, du motif qui m’amène ?
— Parfaitement, point n’est besoin d’être sorcière pour deviner que vous allée me parler de Jeanne d’Arc.
— J’aime mieux l’avouer tout de suite. Permettez-moi, d’abord, une question indiscrète : Qu’y a-t-il de vrai dans le dire d’un de nos confrères, qui a prétendu que c’est à la suite d’une lettre à lui adressée par une dame du monde, une mère de famille, lettre qu’il vous a transmise, que vous avez pris la résolution de jouer Jeanne d’Arc ?
— Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais ce n’est pas tout à fait ainsi que se sont passées les choses au mois d’août dernier, alors que j’étais à la campagne, au repos
— vous souriez, et ces mots au repos
vous étonnent dans ma bouche ; ils m’étonnent encore plus que vous, croyez-le bien — au mois d’août, dis-je, un de vos confrères, qui est fort de mes amis, me transmit, en effet, la lettre d’une très aimable femme, une mère de famille qui, paraît-il, a trois enfants, deux filles et un fils — trois tourments, pour elle toute seule, la gourmande ! — Ma correspondante se plaignait que ses enfants n’avaient jamais pu me voir jouer, parce que mon répertoire se composait de pièce un peu trop… comment dire cela ? un peu trop vives. Pourquoi, ajoutait-elle, Sarah Bernhardt ne joue-t-elle pas, ne fût-ce que par exception, une pièce que tout le monde pourrait voir
et où nous pourrions mener nos enfants, qui voudraient bien la connaître et l’applaudir ?… Je passe toute les formules laudatives que voue devinez ; — quand on écrit aux artistes ou pour les artistes, on a l’habitude d’employer ce que les Chinois appellent l’encre d’or. — Des lettres du genre de celle-ci, vous supposez bien que j’en ai reçu des centaines et depuis bien des années ; j’en pourrais tapisser une chambre entière, comme fit jadis je ne sais plus quel bon abbé, avec les assignats de la première République.
Au fond, j’étais bien un peu de l’avis de la brave dame ; car, je sais qu’il y a, en effet, un certain public que mon répertoire n’attire pas, qui voudrait bien me connaître, et que vraiment je connais trop peu — tout cela n’avait rien de bien nouveau pour moi. Mais, où la lettre tombait à pic — comme nous disons, dans notre langue familière, — et faisait vibrer les notes plus sensibles du clavier, c’est quand elle ajoutait : Pourquoi Sarah Bernhardt ne joue-t-elle pas une Jeanne d’Arc ? — Or, il y a plus de dix ans que je suis hantée par ce désir. Oui, le croiriez-vous, il y a plus de dix ans que la figure de la grande héroïne française, de la grande sainte nationale me fascine et m’attire. Je l’ai étudiée sans cesse et l’étudie toujours. Il me semble qu’elle me possède bien, et que c’est une des créations les plus complètes que je pourrais faire, au moins y apporterais-je toute ma volonté de femme et tout mon cœur d’artiste.
Inutile de vous dire que j’ai lu et relu, avec passion, tout ce qui a été publié sur Jeanne d’Arc, soit en France, soit à l’étranger et, dernièrement encore, j’ai poussé la conscience jusqu’à me faire traduire la thèse d’un certain docteur allemand, un monsieur très grognon, qui voudrait bien nous prouver que Jeanne d’Arc n’a jamais existé ! — Dire que, dans quelques centaines d’années, il se trouvera certainement un docteur, — encore plus docteur que celui-là, pour prouver que Napoléon Ier, lui aussi, n’a jamais existé, et que l’armée française a été culbutée à Wagram !
Une fois qu’il a été décidé, en principe, que nous jouerions Jeanne d’Arc, il a fallu choisir et il nous a paru, à mon directeur et à moi, que le drame de Jules Barbier était celui qui pouvait nous convenir le mieux : d’abord, il est théâtral, et, l’on y sent la main d’un ouvrier habile qui sait pétrir la pâte, — puis l’auteur suit, pas à pas, la légende historique, et n’est-ce pas ce qu’on doit doit, alors qu’on traite un pareil sujet ? Ajouter est inutile, nuisible même, à mon gré du moins, car il me semble que ce que le spectateur demande, avant tout, c’est qu’on lui présente la grande héroïne, sous ses différents aspects, qu’on le fasse assister aux phases diverses de sa vie, qu’en un mot on matérialise pour lui l’idéal légendaire — la figure est trop connue, trop populaire, pour qu’il soit nécessaire de l’enluminer de couleurs inutiles, et d’ajouter quoi que ce soit au récit de l’aventure ; celle-ci est si dramatique par elle-même que la fable nouvelle, quelle que soit celle qu’on pourrait imaginer, serait toujours au-dessous de la réalité.
Un exemple entre autres ; il y a, dans le drame de Barbier, un tableau qui est, à lui seul, une trouvaille, c’est celui de la prison, où on nous montre Jeanne aux prises avec ses accusateurs. C’est un effet considérable, et savez-vous pourquoi ? C’est parce que l’auteur a recueilli pieusement toutes les réponses de la Pucelle qui nous ont été transmises par les chroniques, et que ce n’est plus lui qui fait parler Jeanne, mais bien Jeanne qui parle elle-même. Et il y a là un tel accent de vérité et des élans tellement sublimes, que je défie qu’on puisse entendre la scène avec Warwick, sans éprouver un serrement de cœur et une émotion véritable. Quant à moi, je ne saurais la jouer sans me sentir monter les larmes aux yeux.
Ajoutez que le poème de Barbier se trouve soutenu de la musique de Gounod qui s’adapte admirablement aux situations, et nous donne un exemple, presque unique à la scène française, du drame lyrique, tel que, le comprennent les Allemands, ce qui est une des plus belles formes de l’art-dramatique.
— Lorsqu’il a été décidé que vous joueriez la Jeanne d’Arc de Barbier, est-ce vous qui avez annoncé la bonne nouvelle à l’auteur ?
— Certes. J’ai prié mon directeur et ami de me laisser cette joie. J’aime beaucoup Barbier, que je tiens pour un homme de talent — talent dépensé peut-être un peu en monnaie, il a tant produit ! — Puis c’est un très galant homme envers lequel j’ai été heureuse de pouvoir acquitter une dette contractée jadis, à l’époque où je gagnais cent francs par mois ; Barbier est le premier auteur qui ait osé me confier un rôle — c’était dans une petite pièce en deux actes, la Loterie du Mariage — vrai, ça n’était pas méchant, et je ne crois pas que cela ait contribué à renverser l’empire ; mais enfin ç’a été ma première création, et cela ne s’oublie pas.
— Est-ce que la pièce et la partition ont subi, ainsi qu’on l’a dit, de grandes modifications ?
— Oui, le drame a été très resserré, l’auteur a voulu en faire comme une synthèse de la vie de Jeanne d’Arc ; il a divisé son œuvre en trois parties : la Mission, le Triomphe, le Martyre, qui résument, à traits rapides, l’étonnante légende de la Pucelle.
— Pour la partition, Gounod s’est modelé sur le drame, et a supprimé tout ce qui pouvait donner une allure d’opéra, en renforçant et augmentant, au contraire, tout ce qui était musique de scène et mélodrame.
Il y a même deux tableaux qui sont simplement de mise en scène, où la musique est ininterrompue et accompagne l’action, qui est toute mimique : ce sont les IVe et VIe — le Sacre de Charles VII, dans la cathédrale de Reims, et le Bûcher, sur la place du Vieux-Marché, à Rouen. — Ce sont deux tableaux muets, comme il y en avait jadis dans les Mystères, et le drame de Barbier est précisément une sorte de Mystère, c’est ainsi qu’il faut le l’accepter et le comprendre.
Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi ce rôle de Jeanne d’Arc me plaît et m’attire, je vais vous le dire : Je suis un peu chauvine, on n’est pas parfaite, n’est-ce pas ? — j’adore mon pays, et pour moi Jeanne en est comme la personnification la plus pure — je vous assure qu’il faut s’être trouvé de l’autre côté du monde pour savoir combien on l’aime ce vieux coin de la terre qui s’appelle la France, cette chère patrie qu’on n’emporte pas à la semelle de ses bottines, mais qui est toujours là, bien vivante, dans le fond du cœur. — Tous les peuples ont leurs héros, mais ils ressemblent tous les uns aux autres ; Jeanne d’Arc, elle, ne ressemble qu’à elle-même, et elle est à nous, à nous seuls ; c’est l’héroïne nationale, la sainte Française, et je ne sais pas une fleure plus belle, plus touchante, plus héroïque ; il faudrait n’être ni artiste, ni Française, pour ne pas se sentir, tout à la fois, attirée et effrayée par l’idée de représenter la grande inspirée, à laquelle nous avons dû le salut et l’existence même de notre patrie.
Et tenez, écoutez ceci, et dites-moi s’il n’y a pas là comme une consolation, comme un cri de suprême espérance ; je ne sais, quant à moi, rien de plus beau et de plus patriotique.
La tragédienne, s’étant levée, se mit alors à déclamer, de sa voix d’or, et avec une émotion réelle, la belle strophe du 5e tableau, qui n’est, en quelque sorte, que la paraphrase de la réponse de Jeanne à ses juges, alors qu’on lui annonça qu’elle allait être brûlée.
Quand elle eut terminé, dans un admirable élan de foi et d’enthousiasme, ses yeux étaient remplis de larmes.
— Bravo, lui dis-je, très ému moi-même, c’est admirable mais est-ce que vous pleurez pour tout de bon ?
Dame, me répondit-elle, si je veux vous émouvoir, il faut bien que moi-même… vous connaissez la formule.
— Encore question, et celle-ci sera la dernière, mais c’est aussi celle dont la réponse m’intéresse le plus. Comment comprenez-vous le personnage de Jeanne d’Arc, comment en voyez-vous la figure ?
— Je ne suis ni philosophe, ni historien, je suis simplement artiste dramatique, et je n’ai à voir Jeanne d’Arc que sous l’aspect théâtral ; pour moi, c’est une figure mystérieuse, mais avant tout inspirée et mystique. C’est une sorte d’hallucinée, d’extatique qui va vers un but fatal, guidée par une volonté à laquelle elle ne résiste pas ; guerrière, elle a horreur du sang, et ne tire pas l’épée. C’est son étendard à la main qu’elle entraîne les soldats à la victoire. Puis, le but atteint, la mission divine accomplie, elle redevient femme, et la figure se transforme et retrouve ses côtés humains. Il me semble que Jeanne d’Arc est un personnage de mystère bien plutôt qu’une héroïne de drame, c’est ainsi que je la comprends d’ailleurs et m’efforce de la rendre, vous me direz si j’ai réussi… et maintenant, l’interrogatoire est-il terminé ? Êtes-vous satisfait ?
— Très satisfait. Il ne me reste qu’à vous remercier et à vous souhaiter un grand succès qui, d’ailleurs, n’est pas douteux. Donc, à demain, n’est-ce pas ?
— Oui, à demain.
En sortant, je retrouve, sous la voûte, Tosco et Capitaine — et l’accueil est le même au retour qu’à l’aller. — Tosco, dédaigneux, me regarde à peine, et s’éloigne avec mépris, il a flairé un s… de petit journaliste, et il est sans estime pour la presse. — Tout au contraire, Capitaine redouble de courtoisie, il grogne amicalement, secoue son panache, m’accompagne jusqu’à la porte de sortie, et frotte contre mes mains son museau de velours noir, en m’assurant de sa considération la plus distinguée.
Lahire.

Vert-Vert, 3 janvier 1890
Extrait des Nouvelles. Générale.
Lien : Retronews
Au théâtre de la Porte-Saint-Martin, aujourd’hui, on répète généralement Jeanne d’Arc, dont la première représentation reste fixée à demain vendredi, sans remise ; mais, afin d’épargner aux artistes et au personnel une trop grande fatigue et une veille trop prolongée, il a été décidé que la répétition générale se ferait en deux fois, moitié dans la journée et moitié dans la soirée.
Il reste, en effet, beaucoup de détails à régler, et une répétition du soir, qui serait forcément prolongée très avant dans la nuit, eût peut-être rendu impossible la représentation de vendredi ; — par ce moyen, au contraire, il est certain que la première représentation sera donnée demain vendredi 3, — et la première matinée le lendemain, samedi 4 janvier.
Depuis les relâches. c’est Gounod qui fait répéter les chœurs et l’orchestre, dont il se montre très satisfait ; il avait même été question que le maître dût conduire à la première représentation ; mais il s’est récusé, à cause des mouvements de lumière nécessités par la mise en scène de la pièce ; il craint la fatigue des yeux, et a prié M. Louis Pister de conserver le bâton.
La pièce, telle qu’elle est aujourd’hui, durera régulièrement un peu moins de quatre heures, ce qui permettra de commencer tous les soirs à huit heures un quart ; les entractes seront serrés, autant que possible ; cependant, il y aura forcément un entracte de vingt minutes entre le troisième tableau (l’attaque des Tourelles) et le quatrième (le sacre de Charles VII), à cause des complications de ce dernier décor.
Le Figaro, 4 janvier 1890
Article de la rubrique Premières représentations, d’Auguste Vitu.
Lien : Gallica
Porte-Saint-Martin. — Reprise de Jeanne d’Arc, drame-légende en trois parties et six tableaux, par M. Jules Barbier, musique de M. Charles Gounod.
Quelle belle soirée ! Que d’émotions, que d’enthousiasme, soulevés à la fois par la splendeur inouïe du spectacle, par la puissance admirable d’une tragédienne de premier ordre, et, plus encore, par l’impression profonde que produit sur nos âmes la résurrection de cette légende de la vieille France et de la vaillante fille qui fut le porte-drapeau de la patrie ! Gesta Dei per Francos.
Au lendemain même de nos inoubliables revers, M. Jules Barbier fit paraître devant la nation encore frémissante la grande figure de Jeanne d’Arc, qui nous enseignait le courage et la foi, sources divines d’espérance et de relèvement pour la patrie en deuil.
Ce n’était pas la première œuvre dramatique que Jeanne d’Arc eût inspirée, car, depuis le Mystère d’Orléans, représenté antérieurement à 1440, c’est-à-dire du vivant même de Charles VII et de ses capitaines, et la Pucelle de Domrémy, par personnages avec chœurs et musique (1581), les annales du théâtre ont enregistré une douzaine de tragédies, les unes anonymes, une autre attribuée à La Mesnardière ou à Benserade, une troisième (en prose), par l’abbé d’Aubignac ; enfin, le présent siècle, irrévérencieusement oublieux des Dumolard et des Nancy, a gardé quelque souvenir de deux Jeanne d’Arc, l’une de d’Avrigny, jouée à la Comédie-Française en 1819, l’autre d’Alexandre Soumet, représentée à l’Odéon en 1825.
Quel que soit le mérite de ces deux dernières compositions, M. Jules Barbier s’est placé d’un bond très au-dessus d’elles, sinon par la forme, du moins par la conception générale, en rejoignant, par-dessus les siècles écoulés, les sources pures de l’histoire et de la légende, et en nous rendant Jeanne d’Arc sous les trois aspects que présenta sa vie terrestre, la bergère, la guerrière, la martyre.
En parlant de la première représentation (8 novembre 1873), je résumais ainsi le caractère général de l’œuvre :
Ce parti pris, que commandait la triple alliance de la poésie, de la musique et de la peinture décorative, rapproche l’œuvre de M. Jules Barbier d’un genre de composition aujourd’hui très oublié, je veux parier des mystères qui firent les délices de la France pendant tout le moyen âge et jusqu’au règne de Henri III. [Lire : Le Figaro, 11 novembre 1873]
Cette impression première fut partagée par les connaisseurs et entre autres par le très distingué directeur de l’Odéon d’alors, M. Félix Duquesnel, qui, à ce moment-là, préparait la luxueuse mise en scène de la Jeunesse de Louis XIV. Aussi, lorsque la présence d’une artiste exceptionnelle eut fait naître chez M. Duquesnel, devenu le directeur de la Porte-Saint-Martin, l’idée de reprendre la Jeanne d’Arc de Jules Barbier, le travail de remise à la scène fut-il dirigé, par l’accord unanime de l’acteur et du directeur, vers un resserrement, un abandon de tout épisode inutile, une concentration systématique, qui ne laissassent en lumière que les trois phases distinctes de la vie de Jeanne d’Arc. Pour tout dire, qu’on se figure un triptyque, tels qu’en peignaient les maîtres primitifs, et dont les trois panneaux représentent : la Mission, le Triomphe, le Martyre.
Pour donner à cette pensée la réalisation objective qui l’imposerait au public, il fallait au poète un collaborateur qui mit à sa disposition toutes les ressources de l’art décoratif et vestimental. M. Duquesnel avait déjà rêvé et exécuté bien des merveilles en ce genre ; cette fois, il s’est surpassé lui-même. Gounod, l’illustre compositeur, s’est associé avec joie à cette œuvre toute française, et il a écrit pour Jeanne d’Arc une partition, presque entièrement nouvelle, qui ne compte pas moins de seize numéros.
Il s’agit maintenant de retracer la marche de la pièce dans sa forme définitive.
Après une introduction d’un caractère champêtre où domine le hautbois, le rideau se lève sur la maison de Jeanne d’Arc ; la famille vient de terminer le repas du soir, et l’on voit passer sur la route, par une large baie d’où l’œil s’étend vers la campagne, une troupe de paysans, hommes, femmes et enfants ; chassés par la guerre, ils fuient devant l’envahisseur ; Jeanne prie son père de leur offrir un asile jusqu’au lendemain ; les pauvres gens acceptent avec joie et chantent le chœur des exilés : Nous fuyons la patrie !
, une sorte de lamentation biblique, super flumina Babylonis, d’une mélancolie grandiose. À ces accents plaintifs, l’âme de Jeanne d’Arc frémit et s’échappe au dehors en paroles ardentes ; secourir Orléans assiégé et délivrer la France du joug anglais, telles sont les pensées de la jeune fille. Elle inquiète ses parents, et Jacques d’Arc voudrait la détourner vers le mariage ; il laisse son neveu Thibaut déclarer son amour ; mais au premier mot, Jeanne l’arrête d’un geste décisif.
Hélas ! je n’aurais pas repoussé ton amour !
Et comme Thibaut la regarde avec une sorte d’effroi, Jeanne lui confie son secret ; depuis l’âge de treize ans, elle est assaillie par des voix, qui lui ordonnent de sauver la patrie ; l’archange saint Michel, sainte Marguerite et sainte Catherine ont commandé au nom du Seigneur : Va, fille de Dieu, va !
Thibaut est bien près de la croire folle ; mais un incident vient rompre l’entretien ; une fille du village est poursuivie par un soldat anglais jusque dans la chaumière ; Jeanne, se place entre eux, s’armant d’une faucille ; le reître tire son épée, mais au premier contact il se trouve désarmé. La bande de pillards qui s’était ruée sur Domrémy est chassée par les paysans, et Jeanne, demeurée seule, comprend que l’instant est venu pour elle d’obéir aux voix célestes. Ici se place l’admirable monologue, imité de Schiller, la meilleure page, à coup sûr, de sa médiocre tragédie. Au moment où elle s’agenouille et prononce ces quatre vers :
Seigneur Dieu tout-puissant, j’implore ta bonté !
Laisse, laisse ma vie en son obscurité,
Et daigne rejeter, par une marque insigne,
Ce fardeau si pesant sur une autre plus digne !
les rayons de la lune éclairent Jeanne d’une lumière de plus en plus vive, et bientôt les deux saintes apparaissent à ses yeux comme un gothique vitrail sur fond d’or ; leur voix s’accompagne d’un chœur invisible. Vainement Jeanne lutte contre les ordres d’en haut ; vaincue et désespérée elle s’éloigne en disant :
Dieu le veut ! Pardonnez, mon père, à votre Jeanne !
À vous désobéir c’est Dieu qui me condamne.
Au deuxième tableau, nous sommes à Chinon, au logis royal, dans l’appartement d’Iseult de Loré, la maîtresse de Charles VII, substituée par M. Jules Barbier à l’anachronique Agnès Sorel de sa première version. On annonce de toutes parts l’arrivée de Jeanne, la vierge de Domrémy, qui doit sauver la France ; entre l’incrédulité intéressée d’Iseult et du sire de Thouars, son complice, qui veulent maintenir le roi dans l’inaction pour le mieux asservir, et le brave La Hire, qui ne demande au contraire qu’à faire sentir aux Anglais le poids de sa lourde épée, Charles VII est perplexe mais l’on sait, historiquement, comme il éprouva Jeanne d’Arc. La jeune fille reconnaît le roi, qu’elle n’avait jamais vu, s’agenouille devant lui, et répond, comme si elle lisait dans un livre, à la secrète pensée du roi : Suis-je ou ne suis-je pas le fils légitime de Charles VI ?
Le roi, à la fois saisi de joie et d’étonnement, ordonne à ses courtisans de s’incliner devant l’envoyée de Dieu :
Jeanne, tu marcheras à l’égal des barons,
Et, nos soldats levés, nous te les conduirons !
Tout le monde est debout, prêt à partir, et Jeanne déclame les stances enflammées Dieu le veut !
À cet instant le succès, déjà préparé par la belle et savante introduction du premier acte, prend des proportions colossales ; c’est un tonnerre d’applaudissements en même temps qu’une émotion qu’on n’essaie pas de déguiser.
Au troisième tableau, nous sommes dans Orléans, à la date glorieuse du 7 mai 1429 ; le fond du théâtre est bordé par les remparts, chargés de catapultes, de balistes et de coulevrines, et au delà desquels on aperçoit les fortifications ennemies sur l’autre rive, au delà du cours sinueux de la Loire.
Jeanne d’Arc donne ses ordres pour l’attaque ; l’armée royale, agenouillée autour d’elle, entonne une prière solennelle Dieu de miséricorde !
et c’est merveille d’entendre la voix de madame Sarah Bernhardt dominer le choral plein de puissance et de foi écrit par le génie religieux du maître Charles Gounod.
Le quatrième tableau achève le triomphe. Un spectacle magique éblouit nos yeux. La nef et le chœur de la cathédrale de Reims nous apparaissent illuminés comme ils le furent le 17 juillet 1429 pour le sacre du roi Charles VII ; voilà l’autel et le tabernacle, les princes du sang, les pairs de France, les grands officiers de la couronne ; six évêques et l’abbé de Saint-Denis assistent l’archevêque de Reims, portant la sainte ampoule ; c’est une mer ondoyante de chevaliers, de courtisans, d’hommes d’armes, de dames, de valets, de pages, de clercs, d’enfants de chœur et d’hommes du peuple, tous revêtus de costumes somptueux ou pittoresques, dont les chatoiements harmonieux sont une fête pour l’œil. Rien de si beau ne s’était vu jusqu’à ce jour sur aucun théâtre. À la marche triomphale de Jeanne, aux sonorités éclatantes, succède le Veni Creator ; pendant lequel l’archevêque accomplit les rites du sacre, tandis que Jeanne d’Arc, vêtue de blanc, et tenant à la main son étendard où sont brodés les noms de Jésus-Maria, a le pressentiment que sa mission est achevée, et que, si elle ne pose l’épée, elle sera trahie et livrée ; mais l’amour de la patrie l’emporte.
… Vais-je donc déserter ma bannière
Sans tenir ce que j’ai promis ?
Sans avoir à la France indiqué sa frontière,
Libre de tous ses ennemis ?
Elle ira jusqu’au bout, et s’adressant à son drapeau, elle s’écrie :
Quand l’ange de la mort me touchera de l’aile,
Ensevelis-moi dans tes plis !
Le roi tire l’épée que l’archevêque vient d’attacher à son flanc, et il donne l’accolade de chevalerie à Jeanne, qui s’agenouille devant lui et lui baise les mains. Les cloches sonnent à toute volée.
Tel est ce merveilleux spectacle, prestigieux comme une vision, saisissant comme la réalité, rapide et fugitif comme elle.
Avec la troisième partie du drame, nous ne verrons plus que des scènes de douleur et de deuil. Voilà Jeanne dans sa prison, outragée, menacée et finalement condamnée par les Anglais qui se vengent de leur défaite non pas en soldats, mais en bourreaux ; enfin, au dernier tableau, le bûcher de l’innocente et vaillante martyre est dressé sur la place du Vieux Marché, à Rouen, et Jeanne expire dans les flammes, tandis que la voix des saintes et le chœur invisible l’appellent vers elles, dans les sphères divines.
L’effet de cette soirée a été immense, et il n’y a pas à craindre d’en exagérer l’intensité. Le public en était arrivé à cet état physiologique dans lequel personne, pas même le plus sceptique, ne cherche plus à dissimuler son frémissement et ses larmes.
L’œuvre de M. Jules Barbier n’est plus à juger, et tout le monde en reconnaît les grands et solides mérites, qui sont la parfaite intelligence du sujet, le souffle patriotique et la sincérité. Le premier acte, grandiose et touchant, et qui ouvre dès l’abord la source des larmes, puis l’acte de la prison, où l’art de l’écrivain a enchâssé d’une main si ferme les admirables répliques de Jeanne d’Arc à ses juges infâmes, sont les beautés les plus saillantes du poème, et font à M. Jules Barbier une large part du succès.
Des décors, des costumes, de la mise en scène, de la partie, musicale, volontairement maintenue par Gounod dans la modestie des seconds plans, où les amateurs sauront bien la retrouver, il n’y a que des éloges à faire ; sans aucune restriction.
Et maintenant que dirai-je de madame Sarah Bernhardt, sinon qu’elle a été l’initiatrice de cette glorieuse reprise comme elle en est l’âme, l’irrésistible force et le succès triomphal ? Tour à tour douce avec l’humble jeune fille, vaillante et impérieuse comme chef d’armée, l’héroïne redevient femme devant la souffrance, et pleure comme un enfant. Toutes ces nuances ont été savamment étudiées et rendues par madame Sarah Bernhardt. Mais où elle a surpris tout le monde, ses admirateurs passionnés comme ses juges prévenus, c’est dans la force extraordinaire, passionnée, irrésistible qu’elle a su donner aux élans patriotiques de l’héroïne. J’ai déjà cité les stances éloquentes Dieu le veut !
soutenues par un intéressant accompagnement d’orchestre ; elle s’est élevée encore plus haut dans l’acte de la prison et dans ses fières répliques aux inquisiteurs ou au farouche Warwick ; l’art tragique ne saurait aller plus loin, et il n’est personne dans la salle qui n’ait senti tressaillir sa chair en entendant les cris prophétiques de la vaillante Lorraine
Qu’Anglais brûlèrent à Rouen.
Les autres interprètes de Jeanne d’Arc, tout estimables qu’ils soient, MM. Léon Noël, Bouyer, Rosny, mesdames Jane Méa, Marie Grandet, Avocat, me permettront de ne leur offrir que cette mention sommaire, à laquelle il faut joindre une débutante, mademoiselle Nesville, qui joue et chante d’une façon charmante le rôle du page Loys.
Article de la rubrique : La Soirée théâtrale, par un Monsieur de l’orchestre
.
Jeanne d’Arc. Il n’y a rien qui se propage avec une rapidité plus vertigineuse que la nouvelle d’un succès. C’est comme un courant électrique qui secoue en même temps le public aux quatre coins de la ville. Avant-hier, à minuit, la répétition générale de Jeanne d’Arc était à peine terminée, que déjà le public spécial des théâtres était au courant de l’énorme effet produit par Sarah Bernhardt et par la mise en scène de ce drame vraiment national. Les critiques arrivés en retard aux premières des Nouveautés et de l’Éden proclamaient avec enthousiasme que décors et costumes étaient, du prologue au dénouement, des merveilles de couleur et de pittoresque, que Gounod, le maître artiste, avait illustré les situations du drame d’une musique exquise exécutée par un orchestre de premier ordre, et chantée par des chœurs irréprochables, aux voix jeunes, fraîches et vibrantes.
Aussi, dès le matin, le bureau de location était-il l’objet d’un siège en règle, au mépris de l’influenza. Que sera-ce demain ? Car le succès de la répétition générale vient de se transformer en triomphe. La salle entière a ratifié les prévisions les plus optimistes et, chose bizarre, les plus emballés
étaient peut-être les Anglais, qui professent, comme on sait, pour la Pucelle une profonde admiration. Ah ! ce n’est pas eux qui se seraient évertués à détruire la pieuse légende ! La meilleure preuve, c’est qu’en ce moment trois théâtres à Londres se disputent la nouvelle version de M. Jules Barbier et que tous les correspondants des journaux d’outre-Manche assistaient à la répétition générale, prenant force notes et force croquis.
Le tableau-clou de la mise en scène est assurément le sacre de Charles VII dans la cathédrale de Reims. C’est une reconstitution éblouissante, avec cet accent de vérité, qui n’est pas amoindri par les souvenirs du Prophète. Chose curieuse, dans la version primitive, ce tableau n’existait pas. Et c’est fort heureux, car je n’aurais pas eu le plaisir de vous dire et vous de lire cette plaisante anecdote.
M. Jules Barbier trouva M. Duquesnel hésitant, lorsqu’il vint lui parler de Jeanne d’Arc.
— Voyons, lui dit-il, que craignez-vous ? Sarah sera superbe dans le rôle de la bonne Lorraine… Tout le monde voudra l’y voir… Les mères pourront y conduire leurs filles, qui ne connaissent guère la grande artiste que de réputation… Le succès, déjà certain, se renforce de cet élément nouveau, qui n’est pas négligeable.
— Oui, mais c’est l’énormité de la dépense qui me rend rêveur !
— Certes, l’œuvre est lourde à monter… les chœurs, l’orchestre…
— Oh ! ça, ce n’est rien !
— Les décors, les costumes, les armures…
— Rien encore…
— Mais alors ?
— Il y a le sacre de Charles VII !
— Le sacre !… mais on ne le voit pas. Il a lieu dans la coulisse… Deux ou trois évêques viennent au-devant du Roi, sur le parvis de la cathédrale, et c’est tout.
— Vous vous trompez.
— Comment, je me trompe ?
— Sans doute… le sacre se fait en plein théâtre… décor énorme représentant l’intérieur de la cathédrale… une restauration complète, avec la verrière de fond (celle qui fut détruite en 1760) éclairant le grand autel… Sur le devant, l’autel de cuivre repoussé, avec les tentures bleues fleurdelisées d’or… à droite, l’estrade où se tiennent les gentilshommes invités… devant eux, les quatre dames marraines en corselet d’or, agenouillées sur de riches coussins… derrière les pages portant de longues lances, à l’extrémité desquelles flotte le royal fanion de soie rouge, avec le soleil d’or, — car Louis XIV n’a pas eu le privilège du soleil, et, avant lui, les Valois en avaient pris l’emblème ; — à gauche, la banquette royale, avec le Roi, la Reine et les grands-officiers ; … sur le premier plan, Jeanne, vêtue de son costume blanc et or, décrit tout au long, dans les chroniques… au fond, à l’autel, l’archevêque de Reims et ses assistants, parmi lesquels l’abbé de Saint-Denis portant sur sa poitrine le reliquaire de la Sainte-Ampoule ;… dans l’arrière-chœur, les stalles gothiques, où se tiennent, d’un côté, les douze pairs du royaume, couronnés, comme le Roi lui-même ; de l’autre, les sept évêques suffragants et les cinq abbés mitrés… puis des lustres, des lumières à profusion, de l’orgue, des chants religieux, deux-cents personnes et même plus peut-être. C’est un étincelant tableau qui doit durer de dix à douze minutes, pas plus. Seulement les frais qu’il nécessite représentent une fortune !… Voilà pourquoi j’hésite.
— Dame ! je comprends que vous hésitiez, fit l’auteur dont la surprise tournait à l’ahurissement à mesure que cette progression de merveilles défilait devant ses yeux… Et pourtant, ce serait superbe !…
— Aussi, soyez tranquille, conclut M. Duquesnel ; j’hésite, mais ça se fera !
Et ça c’est fait !… Deux jours après, le directeur était chez Gounod, et lui demandait toute une combinaison musicale nouvelle, pour accompagner le tableau projeté ; chez J.-B. Lavastre, auquel il commandait une maquette ; chez M. Thomas, pour la mise en train des costumes… Combien s’est-il écoulé de temps entre la conception et l’exécution ? Qu’importe ! Toujours est-il que, hier soir, à dix heures, le rideau se levait sur cet apothéotique tableau du sacre… Comme l’avait dit Duquesnel à Barbier, elle ne dure pas plus de dix minutes, cette inoubliable vision ! Ne me demandez pas ce qu’il tient de billets de mille dans chacune de ces minutes… Tout ce que je puis vous dire, c’est que, avec l’or prodigué dans ce seul épisode, on aurait pu monter luxueusement un ouvrage tout entier.
Il ne faut pas que l’admiration nous rende injuste. Tous les autres tableaux sont exécutés avec le même soin, le même luxe et la même recherche de pittoresque et de couleur.
Le 2e tableau — l’Arrivée de Jeanne à Chinon — est un bijou d’élégance et de richesse. Toutes les dames de la cour, avec leur hennin d’or, à voile de mousseline, et leurs escoffons couverts de pierreries, encadrés dans un décor clair, peint avec un soin extrême et qui fait grand honneur à M. Lemeunier, donnent l’aspect d’une enluminure du XVe siècle. Tout cela est d’une vie et d’une couleur qui font ressortir mieux encore, Jeanne dans son costume de jeune cavalier. C’est à la fin de ce tableau que Gounod a remplacé le chœur de Dieu le veut !
par des stances que dit adorablement Sarah Bernhardt et qu’accompagne en sourdine un motif guerrier. Il y a là comme un souffle patriotique dont a frémi toute la salle, qui ne se lassait pas d’applaudir et bissait les stances, comme elle eût fait d’un air de bravoure.
Très curieux aussi et très pittoresque, le tableau d’Orléans. Côté français, le boulevard de la Croix, crénelé, fortifié, hérissé de terribles machines de guerre, laissant apercevoir au lointain, à travers les créneaux, la Loire serpentant au milieu des plaines dévastées et les fameuses tourelles dont l’attaque fit verser tant de sang français et dont la prise décida la levée du siège.
Le plus bel éloge qu’on puisse faire des costumes — cinq cents bien comptés — c’est qu’ils sont en tous points dignes des décors. Des six costumes de Sarah — six merveilles — je n’en veux citer que quatre qui méritent une mention toute spéciale. D’abord le costume de paysanne lorraine à Domrémy : corsage ouvert, lacé devant, à basques crénelées en serge bleu de ciel ; jupe de bure grise relevée par un chapelet à grains de bois. La tête nue est coiffée de nattes courtes. C’est bien la jeune fille, la vierge de vingt ans, que nous avons devant les yeux. L’illusion est complète et vraiment saisissante.
Au second tableau, Jeanne se montre en cavalier élégant, transition excellente entre le vêtement féminin du premier tableau et l’habit de bataille du troisième.
Ce dernier, un éblouissement, est le vrai costume de Jeanne d’Arc, tel que nous le donnent les dernières chroniques retrouvées, mais qui n’a jamais été représenté, jusqu’à ce jour, par les peintres : les bras et les jambes de la guerrière sont sous l’armure, dont l’acier étincelle, mais la poitrine est recouverte d’une cuirasse de cuir blanc, sur le milieu de laquelle est peinte l’image de la Vierge entourée de branches de lys et de jasmins brodées à relief. La tête est couverte du casque arrondi, avec le cache-nuque en mailles ; les oreilles sont protégées par des plaques rondes, à la manière des bonnets frisons.
Mais il faut mettre tout à fait hors de pair le costume du sacre, en cuir blanc, brodé d’or, avec les manches en étoffe orientale recouvertes de mailles d’or. C’est d’un beau caractère et d’un aspect grandiose dans sa simplicité voulue. Un point, c’est tout, car il faut une fin, même aux éloges. Je n’ai fait en ces quelques lignes que résumer ce que toute la salle disait hier soir, ce que tout Paris dira dans quelques jours, ce que le monde entier dira dans quelques mois, lorsque Paris et le monde auront vu, revu, applaudi et réapplaudi Sarah dans la plus admirable création de toute sa carrière, où les créations admirables ne se comptent plus.
Le Gaulois, 4 janvier 1890
Article d’Hector Pessard.
Lien : Gallica
Dans la ferme perdue des marches de Lorraine, aux sanglantes lueurs d’un soleil couchant, embrasant les forêts et les plaines dévastées, Jeanne rêve. Le fuseau s’échappe de ses doigts insensibles. Elle écoute les Voix mystérieuses qui passent, emportées parla brise à travers les frondaisons du bois chenu.
De la terre, labourée par les éperons des hommes d’armes, s’élève un brouillard, une buée de larmes chaudes, et les nuages, frangés de deuil, qui courent vers le levant, sont faits des sanglots du peuple de France. Rien n’est plus que la souffrance : rien ne vit plus que l’agonie et la mort. Jeanne rêve toujours.
Quand le rideau s’est levé sur ce tableau, première station de la Passion de notre Jeanne, il y a eu dans toute la salle un long murmure de surprise et d’admiration.
C’était bien la vierge de Domrémy qui était là, devant nous, dans sa pensive beauté, dans sa radieuse jeunesse, résignée à racheter, par son martyre, un peuple, un royaume et une humanité. On eut dit que le souffle de l’admirable Française animait le corps de Sarah Bernhardt, perdue en ses héroïques contemplations ; de telle sorte que la foule, captivée, trompée, séduite par cette irrésistible puissance d’évocation, ne savait plus si elle tendait les bras à la plus grande artiste des temps modernes ou à la plus divine figure de femme qui ait illuminé l’histoire.
À partir de ce moment, il était évident que le drame-légende de M. Jules Barbier retrouverait son immense succès de 1873, grandi encore du génie de son interprète actuelle et des splendeurs d’une mise en scène incomparable.
L’épopée de Jeanne a si bien pénétré les cellules les plus délicates des cœurs français, nous sommes tous si bien imprégnés par le fier et suave parfum qui se dégage, à travers le temps, de cette féminine apparition, que son récit, même naïvement fait par des enlumineurs d’Épinal, nous émeut et nous ravit.
On peut imaginer, dès lors, quelle impression profonde, quelle indicible émotion peut provoquer la mise en action de ce véridique mystère, court comme un rêve, se déroulant dans des décors de maîtres, enrichis des dépouilles des musées et nous reportant, par une reconstitution érudite et habile, dans les milieux mêmes où se sont accomplis les événements les plus décisifs et les plus extraordinaires de notre vie nationale.
Mais telle est la grandeur de l’héroïne ! L’angoisse du drame n’a jamais été plus poignante que lorsque le poète, s’effaçant devant Jeanne, la laisse répéter seule, entre les murs nus d’un cachot étroit, les paroles sublimes dont elle humiliait les Pharisiens anglais et bourguignons, pressés de dissimuler aux flammes rouges du bûcher de Rouen, la rougeur de leurs fronts de bourreaux.
Mme Sarah Bernhardt, envahie comme la pythonisse par le souffle du dieu, avait tout oublié ; ce n’était plus une tragédienne sachant toutes les ruses de son art, toutes les habiletés de son métier. Frémissante, dans les tressaillements involontaires de sa chair torturée, terrifiée dans les affres de la fin si cruelle, dans ses pudeurs de jeune fille, femme, sainte, guerrière, vierge et patriote, elle s’est donnée tout entière à la foule et l’a prise tout entière.
L’auteur a suivi Jeanne d’Arc pas à pas, dans son rêve, dans sa gloire et dans sa mort. Il n’a rien inventé, rien ajouté à l’histoire et il s’est trouvé que jamais habile artisan en besogne dramatique n’a mieux réussi à nouer une action et à la conduire d’une main plus ferme, par des moyens plus simples, vers un dénouement plus tragique.
Dans ces étapes sublimes dont la destinée a marqué elle-même les arrêts, Jeanne quitte d’abord son village, arrachant de sa poitrine les fibres douloureuses qui l’attachent à ce foyer tant aimé. Nulle ivresse dans ce cœur innocent et désintéressé nul souci orgueilleux, mais une pitié immense pour les faibles et les opprimés.
Douce aux choses et aux hommes, le regard tendu vers le ciel, elle écoute la cruelle loi qu’elle doit subir, pliant sous le faix, étonnée d’avoir été choisie, elle si humble, pour des tâches si grandes.
À Chinon, à la Cour, Jeanne n’a plus seulement la foi. Elle a confiance en elle. Elle est la messagère céleste.
Elle consent encore à persuader, à convaincre ; mais déjà l’impatience la gagne à voir par quelles résistances impies on se dérobe aux ordres qu’elle apporte. Avec le danger qui grandit, elle se fait plus rude. Dans des attitudes d’archange, elle brise les révoltes, pétrit dans ses frêles mains les rudes corselets de fer et les âmes plus rudes encore des capitaines. Elle entraîne à la victoire, à la conquête d’une patrie, ces hordes dont elle va faire une armée et une nation.
Tous ces états d’âme de la bonne et de la terrible Jeanne, Mme Sarah Bernhardt les a ressentis, compris, exprimés, avec une intensité qui ne sera jamais dépassée. C’était bien hier soir la vraie rentrée en France de l’incomparable artiste, résolue à séduire cette foule parisienne qui sait rendre au centuple les émotions qu’on lui donne. Nous suivions la comédienne passionnément, dans ses moindres gestes, dans le moindre mouvement de son visage, prévoyant une défaillance involontaire, un repos d’une seconde, une reprise de souffle.
Mme Sarah Bernhardt n’a pas eu une faiblesse. Elle n’a pas cessé d’être l’héroïne inspirée, toujours sereine et toujours anxieuse, écoutant les paroles des hommes et les chants des saintes, mêlant sa voix aux cantiques des fidèles, vivant comme Jeanne vivait, entre le ciel et la terre.
Dans l’acte de la prison, l’artiste s’est encore surpassée quand, défendant contre les subtilités meurtrières d’un prêtre indigne l’honneur de son faible roi, elle a eu, comme les mourants, la vision de l’avenir, et qu’avant de s’élancer dans les bras des séraphins elle a mis son douloureux adieu à la terre dans un hymne à la France. Elle a eu des façons de répondre non
ou oui
aux interrogations de ses bourreaux, qui faisaient bondir ou glissaient, éperdues, comme des plaintes d’agonisante.
Ce n’était plus Jeanne d’Arc, ce n’était plus une artiste inspirée qui pleurait et faisait couler les larmes : c’était la patrie elle-même que nous entendions gémir, mutilée, insultée, et jetant, avec son souffle suprême, un dernier regard, au loin, sur ses vengeurs !
Le maître Gounod a écrit seize morceaux pour Jeanne d’Arc. Je ne me permettrai pas de juger sur une simple audition une œuvre si importante et qui, mêlée étroitement à l’action, la soutenant, la colorant, se confond avec elle, lui prête et lui emprunte tour à tour son charme pénétrant.
Mais j’ai l’impression que ces mélopées séraphiques, ces murmures, ces plaintes notées par le plus poète des maîtres musiciens contribuent dans une large proportion à nous faire perdre terre et à nous emporter aux régions indécises où le rêve continue la réalité. De toutes ces ondes sonores, dont le musicien règle avec une incomparable maîtrise le flux et le reflux, les caresses et les violences, s’élève une vapeur légère, grisante et mystique comme celle qui se dégage de la myrrhe et de l’encens.
L’absence d’un corps de ballet au théâtre de la Porte-Saint-Martin a malheureusement obligé M. Gounod à supprimer un petit chef-d’œuvre, intercalé autrefois dans une danse de ribaudes, la marche funèbre de la marionnette
. Mais la partition, en dépit de cette suppression, reste assez considérable pour satisfaire même les insatiables.
La reprise de Jeanne d’Arc et le grand succès que le public parisien vient de lui faire arrivent à propos. D’affreux, rongeurs de parchemins, qui prennent un étrange plaisir à laisser leurs traces répugnantes dans l’histoire, comme des souris et des rats, commençaient, ces temps derniers, à grignoter des documents relatifs à la vierge de Domrémy.
Sous prétexte de critique historique, de vérité scientifique, ces cuistres s’étaient mis en tête d’établir que Quicherat était un âne, Henri Martin un sot, et Michelet un écervelé, et que la raison exigeait qu’on mit leurs livres au pilon. Avec leurs gros doigts, tachés d’encre, ces faux savants ne craignaient pas, dix fois plus malpropres que les geôliers anglais, de déshabiller la chaste fille et de l’outrager de leurs investigations.
Ils se faisaient fort de prouver, disaient-ils, que Jeanne d’Arc, à moitié idiote, n’avait été qu’un instrument inconscient entre les mains des habiles conseillers de Charles VII.
Bien plus, ils affirmaient que l’effroyable tragédie de Rouen était pure imagination. S’autorisant des commérages du Journal d’un bourgeois de Paris écrit en 1440, ils s’inscrivaient en faux contre tous les documents colligés, révisés et contrôlés par nos grands historiens et soutenaient que les Anglais étaient trop sages et trop humains pour avoir brûlé une petite folle. Par fortune, il y avait eu, en 1436, une aventurière qui sous le nom de dame des Armoises, avait essayé d’escroquer les Orléanais, en se faisant passer pour Jeanne d’Arc. Cet incident connu par tous les concierges de bibliothèque, relaté par tous les dictionnaires, a été pour ces salisseurs d’idéal une découverte imprévue. Ils ont voluptueusement recouvert des jupes de la drôlesse le noble corps de Jeanne, espérant le salir de ces nippes de voleuse.
Puis, hissés sur leur petit tas de fumier, ils ont chanté victoire, se vantant d’avoir détruit une légende outrageante pour la raison, la sagesse et la vaillance des Rouennais et des Orléanais.
Les bonnes âmes feront bien d’aller observer comment le public de 1890, si peu mystique pourtant et si peu enclin à s’en laisser conter, salue l’image de celle dont la poitrine renferma, pendant quelque mois, le cœur de la France, comme sa mignonne tête en contenait le génie. Et qu’ils se gardent surtout de ricaner ! Au dernier acte, on les brûlerait, eux et leurs vilains papiers.
Les interprètes de cette belle œuvre me pardonneront de ne pas leur avoir fait la part qui leur est due. Ils ont un peu disparu dans le tumulte de cette épopée historique et artistique. Mais ils ont dû être excellents, car la moindre fausse note eût fait éclat dans cette symphonie si parfaite.
Tant que nous avons gardé notre sang-froid, nous avons constaté la belle diction, la science de composition de Léon Noël, la chaleur poétique de Rosny, la grâce de Mlle Méa ; mais, après, nous n’avons plus rien vu, sinon des êtres du quinzième siècle émerveillés à la vue de Jeanne.
Un instant, sous les murs d’Orléans, une fillette costumée en page a gentiment gagné, par sa malice et son chant, un très vif succès personnel, et on a voulu savoir comment elle s’appelait. Au moment où on se racontait qu’elle venait du Conservatoire et qu’on la nommait Mlle Nesville, Sarah Bernhardt est entrée en scène et la petite gloire de la pensionnaire s’est perdue dans le triomphe de la grande artiste.
Article de la Soirée parisienne de Frimousse (alias Raoul Toché).
Jeanne d’Arc. — Eh bien vous savez, il est trouve le remède contre l’influenza.
Si j’étais rancunier, je ne devrais pas vous le dire, car, enfin, voilà huit jours que je sacrifie, moi aussi, à la maladie fin-de-siècle, huit jours que je n’ai causé avec vous, ce qui m’a privé du plaisir de vous souhaiter la bonne année, et pas une seule fois vous ne vous êtes dérangés pour prendre de mes nouvelles. Mais rassurez-vous, je suis le meilleur garçon qui soit au monde, et je vais vous donner la recette tout de même.
Le moyen de guérir l’influenza, c’est d’aller entendre Sarah Bernhardt dans la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier.
Voyez plutôt ce qui est arrivé hier.
À partir de huit heures du soir, un observateur attentif aurait pu voir de nombreuses voitures s’arrêter devant le théâtre de la Porte-Saint-Martin.
De ces voitures descendaient des hommes et des femmes, soigneusement emmitouflés, qui s’avançaient péniblement, courbés en deux et soutenus par des serviteurs dévoués. Les infortunés furent conduits avec soin qui dans sa loge, qui à son fauteuil, et tous se mirent aussitôt à tousser d’une façon lamentable. Des gens très riches avaient amené leurs médecins, qui avouaient piteusement leur impuissance.
L’ouverture commença. Elle est charmante, cette ouverture écrite par Gounod, ainsi du reste que toute la petite partition de Jeanne d’Arc ; mais il fut impossible d’en entendre une note. Les nombreux musiciens commandés par M. Louis Pister n’étaient pas en nombre pour lutter contre la phalange des influenzés. Enfin, le rideau se leva. Sarah Bernhardt était en scène, dans l’humble chaumière de ses parents, assise près de son rouet et tenant sa quenouille à la main. On toussa un peu moins.
Sarah Bernhardt ouvrit la bouche ; on toussa beaucoup moins.
Sarah Bernhardt parla ; on ne toussa presque plus.
Sarah Bernhardt se montra la grande artiste qu’elle seule est capable d’être à l’époque où nous vivons ; on ne toussa plus du tout.
Mais n’anticipons pas sur les événements.
Il faut d’abord vous dire que la salle était fort bette et élégante à souhait. Elle contenait, cela va sans dire, tous les habitués des premières, tous ceux qui y viennent parce qu’ils sont forcés, et ceux qui se croient forcés d’y venir. Mais on y voyait en plus certaines personnalités qui ne se dérangent qu’à bon escient. Citons, entre autres : Mme la baronne Gustave de Rothschild, la duchesse de la Trémoille, la vicomtesse de La Rochefoucauld, la comtesse de Chevigné, la marquise de Beauvoir. MM. le prince de Sagan, le marquis de Breteuil, le comte de Contades, le prince de Tarente, le marquis de Castellane, le marquis de Fiers, Edmond de Lagrenée, G. Broet, etc.
Eh bien ! chose bizarre, après le premier acte, comme après le second, comme après tous les autres, l’impression était absolument la même dans le camp des gens du monde et dans celui des journalistes, chez les clubmen et chez les boursiers, dans les représentants de la bourgeoisie et chez les gens de théâtre. Tout le monde était emballé, littéralement emballé. Les plus sceptiques, les plus blasés avaient les larmes aux yeux, et de tous les coins de la salle on entendait partir les exclamations les plus enthousiaste :
— Cette Sarah est vraiment admirable !
— Jamais je ne l’avais vue aussi étonnante !
— Et d’une jeunesse !
— Et d’une poésie !
— On cherche malgré soi à lui voir une auréole autour de la tête.
— Et comme elle est en scène, constamment !
— Je crois bien ! Elle chante même avec les chœurs.
— Et comme elle dit les vers !
— Est-ce assez beau quand elle écoute les voix de ses Saintes ?
— Et son Dieu le veut !
donc. Ça m’a fait froid dans le dos.
— Et ses Stances pendant le Sacre !
— Et l’interrogatoire dans la prison !
— C’est grand ! superbe ! splendide ! extraordinaire ! patriotique !
Et toute une série d’épithètes plus louangeuses les unes que les autres. Et la sonnette de l’entracte avait à peine retenti que chacun s’empressait de regagner sa place, afin de ne rien perdre de ces sensations aussi étranges qu’inattendues. Et c’était, pendant chaque tableau, de véritables tonnerres d’applaudissements. Et, à chaque baisser de rideau, c’était une de ces ovations qui ne sont pas loin de confiner au délire. Les mains se choquaient avec frénésie, des Bravo !
tumultueux s’échappaient de toutes les poitrines, les chapeaux, atteints de vertige, s’agitaient dans l’espace, et Sarah, rappelée deux, trois, quatre, cinq fois de suite, revenait saluer le public, fatiguée par un effort ininterrompu, brisée par une émotion bien naturelle, mais très contente tout de même, je crois pouvoir l’affirmer.
Les gens qui tiennent à tout savoir me diront peut-être :
— Mais vous ne nous parlez que de Sarah Bernhardt !
Ah ! monsieur, ah ! madame, c’est que cette femme surprenante remplit tout, englobe tout, fait disparaître tout ce qui s’agite autour d’elle. Il faut le temps de la réflexion pour se rappeler que Jeanne d’Arc n’est pas un long monologue, et que la pièce comporte d’autres personnages : Mlle Méa, par exemple, fort belle sous la couronne de Mme Iseult (couronne qu’elle a perdue, d’ailleurs, juste au moment où elle ne se jugeait plus digne de la porter) ; Mme Marie Grandet m’a également paru fort bien sous les cheveux blancs d’Isabelle Romée.
J’ai apprécié comme il convient la belle barbe de M. Léon Noël, les beaux cheveux de M. Rosny et les belles moustaches de M. Herbert, ainsi que la bonne figure de M. Bouyer, un La Hire tout à fait bon enfant. Et Warwick donc ! en voilà un qui est bien mis ! Et le beau Dunois, que j’allais oublier ! Pour beau, il est beau et vêtu d’une façon bien élégante pour un homme qui passe son temps à partir pour la Syrie. M. Xaintrailles m’a moins plu, mais j’étais peut-être gâté par les autres.
Et puis, il y a la mise en scène. Inutile de vous dire qu’elle est remarquablement soignée, puisque c’est M. Duquesnel qui l’a établie. Tous les costumes sont superbes, et ceux des fugitifs, et ceux des nobles seigneurs ainsi que des nobles dames, et ceux des guerriers qui se pressent sur les remparts d’Orléans, et ceux de la foule nombreuse et recueillie qui a envahi la cathédrale de Reims pour le sacre du roi Charles VII. Pittoresque, richesse, exactitude, ainsi peut se résumer cette partie du programme.
Et il faut encore revenir à Sarah pour dire que ses costumes à elle sont de véritables merveilles. Au premier tableau, c’est la simple paysanne avec le corsage d’étamine bleue et la jupe d’étamine grise sur laquelle pend le lourd chapelet à gros grains de bois. Au deuxième tableau, c’est le jeune cavalier revêtu de la longue tunique blanche dentelée avec le capuchon de drap bleu et les manches de soie rouge. Au troisième tableau, c’est la guerrière recouverte d’une armure de fer sous une armure de cuir blanc. Au quatrième tableau, c’est la Jeanne d’Arc de la princesse Marie, avec la cuirasse dorée et les broderies d’or fleurdelisées. Et, sous tous ces costumes, Sarah Bernhardt est superbe, admirable, extra… Ah ! je l’ai déjà dit.
Il faut aussi faire la part des décorateurs qui se sont particulièrement distingués. MM. Amable et Gardy ont brossé la chaumière de Jacques d’Arc, avec vue sur un paysage éclairé par le soleil couchant et fond sur toile métallique, laissant voir à la fin du tableau l’apparition des Saintes. M. Lemeunier a signé la belle salle du château de Chinon, dans le style gothique, tendue de bleu et ornée d’innombrables fleurs de lis d’or.
On. doit à MM. Rubé, Chaperon et Jambon, le très beau décor de l’Attaque des Tourelles, dont le panorama se déroule à perte de vue. Le commencement de ce tableau a été marqué par un incident. Il a fallu bisser le premier chœur par la faute de Mlle Nesville, une gentille petite personne qui avait deux couplets à chanter et qui ne pouvait arriver à entrer dans ses bottes.
Le décor de la cathédrale de Reims est de MM. Lavastre et Carpezat. Il est superbe et a été très justement applaudi.
Quand j’aurai adressé quelques éloges à la Prison de M. Lemeunier et à la Place du Vieux-Marché de MM. Rubé, Chaperon et Jambon, je crois bien que je n’aurai oublié personne. Je dois pourtant une mention honorable au bûcher, qui s’est très bien comporté et a brûlé pour Sarah Bernhardt de moins de feux, certes, qu’elle n’en avait allumés.
En résumé, la soirée n’a été qu’un long et incontestable triomphe pour celle qu’on est de plus en plus en droit d’appeler la grande tragédienne. Jamais, peut-être, Sarah ne s’est plus livrée à un public plus reconnaissant ; et on peut dire qu’au point de vue de l’art, l’année 1890 ne commence pas mal du tout.
La Comédie-Française a repris Coquelin. Quand reprendra-t-elle Sarah Bernhardt ?
The New York Herald, January 4, 1890
Générale.
Lien : Retronews
Jeanne d’Arc.
Mme Sarah Bernhardt Scores a Success as the Maid of Orleans.
M. Gounod’s Music. The Coronation March. An Outburst of Patriotism.
Enthusiastic cheers.
- Jeanne d’Arc : Sarah Bernhardt ;
- Iseult : Jane Méa ;
- Isabelle Romée : Marie Grandet ;
- Mengette : Julie Avocat ;
- Loys : Nesville ;
- Jacques d’Arc : Léon Noël ;
- La Hire : Bouyer ;
- Thibaut : Rosny ;
- Siward : Hebert ;
- Warwick : Rebel ;
- le Roi Charles VII : Deneubourg ;
- De Thouars : Darmont ;
- Dunois : Darlès ;
- Xaintrailles : Delisle ;
- Nicolas Loiseleur : Piron ;
- Pierrelot : Prévost ;
- Gordon : Duberry ;
- Maître Jean : Mallet ;
- Manchon : Jégu ;
- Jean d’Estivet : Samson ;
- Laurent Guesdon : Besson.
Mme Sarah Bernhardt made her appearance at the Théâtre de la Porte-Saint-Martin last night as Jeanne d’Arc, and it was a decided success.
M. Jules Barbier’s work, in three parts
and six tableaux, with choral and orchestral score composed by M. Charles Gounod, is more of an opera than a drama. From beginning to end, there is the one continuous chord of Jeanne d’Arc‘s mystic patriotism and militant religion blended with the solemn mass like conceptions of Gounod. It is one unceasing vibration of Sarah Bernhardt’s crystalline diction, set in a framework of the absolutely chaste, melancholy, solemn strains of M. Gounod’s sacred music.
I have been to church, not to the theater,
was a remark heard on leaving the Porte-Saint-Martin last night, and this accurately describes the sensations of four-fifths of the audience.
There is not a solitary gleam of laughing sunshine, nor a drop of the milk of human kindness, nor a flash of passionate we nor hatred nor jealousy nor human passion in the whole play. It is a succession of cameo like pictures succeeding each other will the symmetry of the kaleidoscope.
The Play.
The first tableau represents the cottage at Domrémy with Jeanne d’Arc and her aged parents. Mme Sarah Bernhardt wears a costume almost identical with that of Faust’s Marguerite — a gray dress, a blue corsage, white sleeves and two golden, blonde, braided tresses of hair hanging over the shoulders. It is sunset. A band of exiles pass by, having been driven from their homes by the tocsin of war and the ravages of the English soldiers. Jeanne invites them into the cottage to rest. Nous fuyons la patrie !
exclaims an old man. Nous fuyons la patrie !
is the refrain of the chorus, with a charming flute and violin accompaniment.
It is here in this very first scene that Mme Sarah Bernhardt makes one of her most successful points. As the aged pilgrim says : — If Orleans fall, there will be an end of France — aucun moyen humain ne le peut secourir
— Jeanne d’Arc interrupts with a splendid burst of patriotism : — C’est la France, pourtant ! Elle ne peut mourir !
This passage is, and ever will be, most warmly applauded, especially with the fire and energy that Sarah Bernhardt throws into it.
After the exiles leave, a stray half drunken English soldier, with a long sword, rushes into the cottage and tries to kiss Jeanne’s younger sister. Jeanne with a reaping hook in her hand springs at him like a tiger.
The soldier draws his long sword and charges at her.
Jeanne parries the thrust with her sickle, and with the exclamation : Démon !
disarms him.
She then stands triumphantly upon his fallen sword. Mine. Sarah Bernhardt makes the most of this powerful situation. The soldier then draws a poignard and nearly stabs Jeanne. But Thibaut, a young peasant, appears at the right moment with a scythe and is about to mow the drunken soldier down.
Jeanne rests her hand upon Thibaut’s arm with the words : — Non, pas de sang !
and saves the Englishman’s life.
What, you pardon him ?
exclaims Thibaut.
Go ! the door is open
, she replies. As the English soldier passes the window he swings his sling and the stone wounds Thibaut in the head.
Then, when Jeanne is alone in the cottage, the moon shines through the window, the church bells ring, and the two saints — Sainte Marguerite and Sainte Catherine — appear. An invisible chorus chants : —
Jeanne ! Jeanne ! Dieu t’a choisie !
Va, pauvre âme d’effroi saisie !
Va, fille de Dieu ! Va !
Ton Seigneur à toi se révèle ;
C’est la voix de Dieu qui t’appelle !
Va, fille de Dieu ! Va !
Jeanne, with her golden hair encircled by a saintly halo, stealthily withdraws from the cottage to fulfill her divine mission, and free France from the English.
The King’s Mistress.
We are next brought by a sudden change to the apartments of Agnes Sorel, the mistress of Charles VII. Here all is luxury, profusion, lutes and dancing. The weak, vacillating king and the pretty Agnes are chatting and quarreling. La Hire, the stern, old soldier, has come for reinforcements that the king refuses to grant him, and as La Hire says : Jamais roi ne perdit si gaiement son royaume.
Jeanne, after her numerous victories over the English [elle n’a alors encore rien gagné !], appears, and is received at first by the King’s mistress, and after-wards by the King. Mme Sarah Bernhardt in this scene wears the national colors — red, white and blue. The cape is blue, the long leather justaucorps is white, and the sleeves are red. In fact, she looks exactly as if she were clad in the French flag of the Third Republic.
The scene with the king is very effective. Jeanne conjures Charles VII. to put on a bold front and fight. He finally consents. And it is here, in presence of Charles VII. and his court, of the army and the people, that Jeanne d’Arc, brandishing the oriflamme in her arms, pronounces the following couplets that Mme Sarah Bernhardt declared to a Herald correspondent, immediately after the performance, to be, in her estimation, the finest passage in the play, and, as she said, can never fail to arouse a French audience to the very acme of enthusiasm.
These couplets are : —
Soit réprouvé du ciel qui vous en dissuade !
Je parle à des chrétiens ! Le cri de la croisade
Chez vos aïeux a fait des miracles ! Il peut
En faire chez leur fils ! Dieu le veut !
Tous. — Dieu le veut !
Cri sacré qui faisait frissonner l’oriflamme
Sur le chemin du Christ que nous allions venger,
Rends la force à nos bras, rends l’espoir à nôtre âme !
Affranchis cette terre, et chasse l’étranger !
Dieu le veut ! Lève-toi, pauvre France meurtrie !
Sous un rayon du ciel, je lis dans l’inconnu !
Nous te délivrerons sainte mère Patrie !
Tes malheurs sont passés et ton jour est venu !
Dieu le veut ! Donnons-nous, Français, et Dieu se donne !
Sous nos pieds frémissants, le sol même s’émeut !
Crimes et lâchetés sont absous ! Dieu pardonne !
La Patrie est en nous… Dieu le veut !
Tous. — Dieu le veut !
Mme Bernhardt’s judgment was not at fault. As the final Dieu be veut !
was repeated by all the actors on the stage, the audience broke into a perfect tornado of applause. Many persons rose to their feet to cheer more mistily. Mme Sarah Bernhardt had to come before the curtain no less than four times to bow her acknowledgments.
Le Triomphe.
The second act terminates that portion of the drama called La Mission
. We next come to Le Triomphe
. Here we have the famous siege of Orleans, with archers, drums, trumpets, culverins and all the pomp and bustle of war in the good old days of the fifteenth century.
Then comes the coronation of Charles VII. in the Cathedral of Reims. This scene is very effective as a spectacle — as a panorama, as it were.
The music is solemn and at times almost superb. But there is not one really dramatic situation in Le Triomphe
, and the two acts that compose it might very advantageously be condensed into one. Mme Sarah Bernhardt’s costumes are, however, most effective — chain armor with white leather justaucorps and high top boots.
Le Martyre.
With the third portion of the play — Le Martyre
— things become more dramatic.
Jeanne, being deserted or betrayed by her companions in a fight near Compiègne, was left on the wrong side of a draw-bridge and fell into the hands of the enemy. The curtain rises as she reclines in chains on a bed of straw. English soldiers guard their prisoner. Other English soldiers are drinking and talking.
Warwick arrives and declares that she is sentenced to be burned to death at the stake. Warwick, however, tells Jeanne, that if she will become his mistress she will be free. An effective scene here takes place in the prison. Jeanne, in a very spirited passage, declares — C’est la France et son Roi que vous voulez flétrir et souiller avec moi !
Warwick attempts to ravish her, exclaiming as he puts aims around her : —
Va ! je te livrerai, païenne, à ton bûcher,
Mais flétrie et maudite !
Jeanne calls for help. Two English priests [probablement français] appear and save her from being dishonored.
This scene was received with a perfect ovation, and Mme Sarah Bernhardt was called out five times amidst wild cheers and bravos.
Burned at the stake.
Then comes the final tableau — the execution at Rouen.
A huge pile of wood is in the public’s square at the foot of the stake. On top is the executioner clothed in red with a red beard. Jeanne, in a white flowing robe and with a ghastly palid countenance that Mme Sarah Bernhardt thirst have studied at the place de la Roquette, is led to the stake by a priest.
She mounts to the very top of the pile of fagots, and is lashed to the stake with cords. She asks for a cross. A soldier improvises one with two fagots. Another soldier lights the fire, but falls dead as he does so. As the flames dart up and reach the clothing of the martyr, the apparition of the Saintes Marguerite and Catherine is seen in the distance. An invisible chorus, as the curtain falls, chants the couplets : —
Jeanne ! Jeanne ! fille de Dieu !
Va ! Je serai avec toi !
Va, fille de Dieu, va !
Such is the outline of last night’s representation of Jeanne d’Arc
. Mme Sarah Bernhardt never seemed in better form or more en train. She acted with force and judgment. She recites verse as the nightingale sings ; but in Jeanne d’Arc
she has no opportunity for the interpretation of the passions, and the tiger like ferocity, hatred, jealousy, revenge, that makes her superb as Phèdre, La Fille de Roland, Fédora, or Théodora. The saintly character of the Maid of Orleans, embued with the holy, patriotic fervor untainted by the passions of flesh or the devil, is not the rôle for Mme Sarah Bernhardt to attain a real triumph. The rôle is not cravachante enough for her. The sacred music of Gounod seemed to hold her down as if with silken meshes, and to prevent her from taking the button, from the point of her foil. In spite off Mme Sarah Bernhardt’s success last night it must be admitted that she seldom appears to such advantage as she does in the rôles of M. Sardou.
The costumes.
In her dressing room Sarah patiently received a score of friends, who flocked in with congratulations. I am more ill, than tired,
she said, and ant still suffering from influenza, but — here is my peasant’s dress for the first act,
showing a habit of gray cloth, which she changes for a suit, in which she appears as a bey, of white cloth with a blue cape about the neck and a Capucine hood and large white sleeves.
This, in the third act is changed for a warrior’s costume of white leather, short to the knees, and open on the sides to the waist. The white leather doublet is covered with a tattered design of white stars outlined with gold, and over the breast is painted in relief a medallion of the Virgin and Child in blue and gold with a scroll of old rose, continuing around the neck ; with this the arms and legs are enclosed in jointed steel armor, and a casque is worn on the head.
At the coronation of the King, in the fourth act, Sarah wears a white kid doublet covered with gold fleur de lys, and the same medallion embroidered on the breast. Light blue velvet sleeves, embroidered with gold lines. The legs are covered with close fitting white kid hose, and long pointed white shoes. In her white gauntleted hand she carries the white standard.
In the prison scene, a very becoming and effective costume is worn, consisting of a doublet of gray cloth cut in a unique design of irregular points around the edge, worn over tan colored Suede tights, slightly wrinkled.
In the last scene at the stake, when Jeanne asks to be allowed to wear a woman’s dress, and says, It is enough of it to be only long,
she wears a simple, long white cloth robe, something after the fashion of the Capucine monks, with a white girdle and ample sleeves.
Sarah does not wear a wig, but her own hair falls to her shoulders, curled to stand out with a straight hanging frizz over the eyes.
The costumes of the other actors are very simple, with peasants, warriors and a conventional king and queen in blue velvet embroidered with gold fleur de lys over white satin embroidered petticoats. The garb of the priests, monks and higher dignitaries make a very effective picture in the last act.
Another appreciation.
The spirit of Jeanne d’Arc, so far as the character of that extraordinary woman pervades French history, is symbolized by Bernhardt. This is the Jeanne d’Arc of French imagination. Other conceptions are put aside. There is the maid of Shakespeare, who was willing to plead that she was with child to save herself from an execution that was to become a martyrdom. There is Voltaire’s profane conception. But Shakespeare was capable of any libel that would atone for the folly or crime of Englishmen. There is the ideal maiden warrior whom Dupanloup strove, in vain, to have canonized by the Pope as among the patron saints of France. The canonization is still a problem. Where saintly honors are concerned the Vatican moves slowly. But whether the Maid of Orleans goes upon the sacred role or not, her memory is canonized in the hearts if France. It was to this sentiment that Bernhardt appealed. Although it was appointed that Jeanne d’Arc was in the bloom and joy of her youth to die an ignominious death at the hands of treacherous conquerors, her work was done. She drove the English out of France. The spirit she awakened made English rule in France impossible. The sympathy surrounding her misfortunes, the resentment of the treachery which brought her doom, the belief that she was a martyr for France were fatal to English prestige. We saw the same in the case of Napoleon. If that unfortunate and badly whipped Emperor had been allowed to escape to America after Waterloo he would have been of no more value in French politics than the foolish Boulanger, now in a kind of serio comic opéra-bouffe exile over in Jersey. Persecution invariably ends in the glory of the persecuted. Saint Helena made the Second Empire. The burning of Jeanne d’Arc made France. The flames which enveloped her stake fused France into a nation. This historical reflection was the animating thought in Bernhardt’s acting. She was the incarnation of the piety, the enthusiasm and the valor of France, and we should not be surprised if this performance, so regarded, became one of this eminent artist’s most memorable creations.
The music.
The music of M. Gounod is very fine, and was keenly appreciated. The Coronation March
was most effective, and had a thoroughly military swing.
The impersonation of the other rôles — both men and women — was below the average. Mme Nesville, however, made a very bright and vivacious little page. She sang very gracefully and correctly a ballad in the second act.
The mise en scène.
The mise en scène and the costumes are historically accurate, and the stage carpentry is quite up to the mark. The scene of the interior of the cathedral of Reims was very effective. The fifteenth century costumes, the high, steeple-like head coverings of the women, were quaint and picturesque.
The audience.
The audience was a very brilliant one, containing all the fashion and bohemianism of Paris. There were lots of petty women in the stalls and balconies, and the effect of the tasty little, bright colored, gold edged hats was very effective and brilliant.
With such a house, it would be impossible to give more than a few names of those who were present. Here are some, jotted down almost at haphazard : — Baronne Gustave de Rothschild, Duchesse de la Trémoille, Vicomtesse de La Rochefoucauld, Comtesse de Chevigné, Marquise de Beauvoir, Prince de Sagan, Marquis de Breteuil, Comte de Contade, Marquis de Castellane, Marquis de Flers, M. Edmond de Lagrenée and M. G. Broet.
M. Vitu’s opinion.
As a Herald correspondent was leaving the theater he met M. Auguste Vitu, the dramatic critic of the Figaro.
Well, what do you think ?
M. Vitu replied : — Jeanne d’Arc is a succès énorme. And this is not only because Mme Sarah Bernhardt impersonates it with such perfection, but because the play is in harmony with the spirit and sentiment of the French people.
Resuming his criticism, M. Auguste Vitu writes : — Such is this marvelous spectacle, fascinating as a vision, striking and fugitive as the reality… The effect of this soirée was so immense that it would be impossible to exaggerate its intensity. The audience reached that physiological state in which not even the most skeptical person seeks to hide his excitement or his tears.
After praising M. Jules Barbier’s work, this critic asks : — What shall I say of Mme Sarah Bernhardt, except she was the initiator of this glorious revival as she is the soul of it, its irresistible force and its triumphal success ?… Where she surprised everyone, her passionate admirers as well as her critics, was in the extraordinary, impassioned, irresistible force she gave to the patriotic outbursts of the heroine. Her replies to her judges and to Warwick can never be excelled in the range of tragedy, and nobody in the house but felt a thrill as he heard the prophetic cries of the valiant maid.
M. Pessard’s appreciation.
The épopée of Jeanne d’Arc,
writes M. Hector Pessard, in the Gaulois, has so penetrated into the most delicate cells of the French heart ; we are all so impregnated by the suave odor which clings through the ages to the character of the heroine, that her story, however rudely told, moves and ravishes us. One can understand, then, the profound impression, the indescribable emotion produced by the mise en action of this veracious mystery, with scenery worthy of a master’s hand.
But such is the grandeur of the heroine that the anguish of the drama was never more poignant than when, in a bare and narrow prison cell, she repeats the sublime words with which she humiliated the English and Burgundian Pharisees.
Mme Sarah Bernhardt, impregnated like the Pythoness by the breath of the deity, ceased to he a tragédienne awake to all the ruses of her art, all the tricks of her business.
Referring to M. Gounod’s music, the same critic says : — These seraphic passages, these murmurs, these plaints, put into music by the most poetic of master musicians contribute in a large proportion to carry us off the earth to those vague regions where dreamland succeeds the reality. From all these sonorous waves whose ebb and flow the musician controls with incomparable mastery, rises a light, intoxicating and mystic cloud like that from incense and myrrh.
The Soleil‘s criticism.
M. Émile Faguet, the dramatic critic of the Soleil, says : — Both the theater and the actress have gained a very brilliant success… Perchance a trifle monotonous in the plaintive and elegiac part of her rôle, Mme Sarah Bernhardt rendered the ecstatic and inspired portion of the conception as no other actress in the world could have done. In those scenes where strength and energy were required she showed a real power quite unlooked for from her, inasmuch as she had to struggle against her peculiar talents and surcharge a voice made for elegy and not for imprecation… By her malediction against Warwick she evoke applause such as perhaps she has never obtained before.
Vert-Vert, 5 janvier 1890
Article de Georges Boyer.
Lien : Retronews
Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Jeanne d’Arc, drame-légende eu trois parties, six tableaux, de M. Jules Barbier, musique de M. Charles Gounod.
Si jamais Sarah Bernhardt a mérité qu’on l’appelât la grande tragédienne, c’était assurément hier soir.
En vingt occasions, elle avait montré un immense talent ; dans Jeanne d’Arc, elle a positivement atteint le sublime, et c’était merveille de voir la foule sceptique, blagueuse, oubliant tout, même l’influenza, pour se lever frémissante, pour applaudir, pour crier, pour agiter les chapeaux. J’ai cru un instant qu’on allait les jeter sur la scène, ni plus ni moins qu’à la Plaza.
Est-ce là un miracle dû encore à la bonne Lorraine ? Que Rome se hâte alors d’ordonner sa canonisation. Écartant le merveilleux, faut-il croire seulement que nous avons été transportés par l’incomparable talent d’une artiste hors ligne ? Que la Comédie-Française alors se dépêche, nous ferons du décret de Moscou le même cas que nos pères, en 1830, des ordonnances, et glorieusement nous installerons Sarah rue de Richelieu.
On a fait une révolution pour Coquelin qui certes est bien loin de la valoir.
L’effort artistique qu’elle vient de donner n’a d’analogue que celui de Mounet-Sully dans Hamlet ; encore la tragédienne nous semble-t-elle, — portée davantage peut-être par le rôle, — avoir surpassé le tragédien.
On l’a trouvée rayonnante de foi dans les strophes ; Dieu le veut !
idéale d’énergique conviction dans ses réponses aux juges ; incomparable d’émotion lorsque, la chair faiblissant au pied du bûcher, elle laisse voir, un instant seulement, qu’elle est femme, — comme le Christ au jardin des Oliviers pleura parce qu’il avait revêtu une enveloppe humaine. — Certes. il est impossible de montrer plus de force, plus d’attendrissement ; mais je ne sais si ce n’est pas encore au premier acte que je la préfère.
Elle est dans la chaumière de son père, vêtue en paysanne, un chapelet à la ceinture ; elle entend les cris des routiers dans la campagne, elle ne-cueille les malheureux fuyards et les réconforte, et des voix la hantent. Son père la voudrait marier ; son cousin, le bon Thibaut, la presse doucement, mais sa vocation lui étreint le cœur. Un soudard ivre poursuit une de ses compagnes, il a tiré sa grande épée ; elle s’avance, une faucille à la main, et elle abat l’épée d’un geste large, que l’archange Saint-Michel a dû lui enseigner. Puis le mysticisme la reprend, elle parle, les yeux dans le ciel, elle voit et nous voyons avec elle ; elle est hypnotisée, nous sommes hypnotisés avec elle… Et tout cela est fait avec une sobriété inouïe. L’effet est immense, précisément à cause de la simplicité des moyens.
Plus tard, c’est l’âme de la Patrie qui tressaille en elle ; le souffle de la France passe par ses lèvres, et tous nous frissonnons, tous, les vieux et les jeunes, les matérialistes et les poètes ; tout ce public si mêlé des premières est haletant, quand la bonne et grande Lorraine parle d’une voix inspirée des malheurs de la nation, quand elle annonce avec tant de prophétique certitude son relèvement.
En vérité le spectacle hier, sur la scène comme dans la salle, a été singulièrement suggestif.
Le directeur de la Porte-Saint-Martin a monté Jeanne d’Arc avec un goût exquis et une générosité qui ne sait pas compter.
Mais je ne crois pas qu’il ait plus tard à s’en plaindre : tout le monde voudra assister à cette miraculeuse évocation de la patriote par excellence.
De plus, pour la première fois, les jeunes filles recevront l’autorisation, jusqu’ici refusée, — à cause de son répertoire, — d’aller applaudir la tragédienne inspirée ; voici donc des recettes fructueuses assurées pour longtemps.
M. Duquesnel n’aura donc pas à regretter ses magnifiques décors, parmi lesquels il faut citer l’intérieur de la cathédrale de Reims, un chef-d’œuvre de Lavastre c’est-là qu’il lieu le couronnement de Charles VII. Rien ne saurait donner idée du luxe des costumes, ni de l’exactitude des détails. C’est une reconstitution absolue.
C’est véritablement sous des voûtes gothiques, où le jour pénètre par des verrières éclatantes, que l’on entend cette musique céleste que Gounod a composée pour le beau drame de son ami Jules Barbier.
Les deux collaborateurs de Faust se sont retrouvés, non plus pour chanter l’œuvre du diable, mais pour célébrer celle de Dieu, et, cette fois encore, ils ont triomphé de compagnie.
J’ai beaucoup parlé de Sarah Bernhardt ; elle est l’œuvre entière, mais il serait, injuste d’oublier l’excellente troupe qui l’entoure, et l’on doit des éloges à MM. Léon Noël, Bouyer, Rosny, Herbert, Rebel, Deneubourg, à Mmes Jane Méa, Marie Grandet, Julie Avocat, aussi a une bien gentille débutante, Mlle Nesville, qui joue et chante avec une petite crânerie très drôle et très jeune le rôle du page Loys.
La Gazette, 5 janvier 1890
Critique élogieuse de la reprise de 1890 ; explications des modifications du livret et de la musique.
Lien : Retronews
Port-Saint-Martin. — Reprise de Jeanne d’Arc, drame en cinq actes, en vers, avec chœurs, par M. Jules Barbier, musique de Charles Gounod, le 3 janvier 1890.
Quatre ans après le supplice de Jeanne d’Arc, le théâtre s’empara du drame émouvant qui avait eu pour scènes principales : Vaucouleurs, Chinon, Orléans, Reims, Compiègne et Rouen.
Le Mistère du siège d’Orléans fut représenté dans cette ville le 30 mai 1435. Composé par divers auteurs, il ne contenait pas moins de vingt-cinq mille vers. Charles VII, la Pucelle, Notre-Dame, saint Euverte, saint Aignan et l’archange saint Michel étaient les personnages importants. Cent autres acteurs les entouraient. Saint Michel annonçait ainsi à la Pucelle la mission que Dieu lui imposait :
Sa volonté et son plaisir
Est que vous alliez à Orléans
Pour Anglois en faire saillir
Et lever le siège devant.
Jeanne d’Arc, à la fois étonnée et ravie, lui répondait :
Mon bon Seigneur, que dictes-vous ?
Vous me faites trop esbaye ;
Ceci ne vient point à propoux,
En ce je ne scay que je die.
Moi pauvre pucelle ravie
Des nouvelles que vous me dictes,
Sachez, je ne les entend mie
Que y me sont trop auctentiques.
Elle se soumet cependant à la volonté divine et l’archange la bénit :
Adieu, Jehanne, vraye pucelle
Qui est d’icelui bien aymée
Ayez toujours ferme pensée.
De Dieu entre sa pastourelle.
À cette pièce naïve succédèrent d’autres compositions dramatiques du père Fronton du Duc, de Virey des Graviers, Nicolas Vernulz, l’abbé d’Aubignac, Shakespeare, Schiller, A. Zamora, Desforges, Dumolard, Dieulafoy, d’Avrigny, Soumet, Desnoyers. Je ne veux pas non plus oublier les œuvres de Renard, David, Mairet, Materne, Soulier, Scribes…
J’arrive enfin, après cette rapide nomenclature, à la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier, qui fut représentée le 8 novembre 1873 sur le théâtre de la Gaîté. Je m’en souviens comme si c’était d’hier. L’émotion que causèrent la pièce et sa principale interprète, Lia Félix, est encore vivante en mon esprit… C’est en 1869 que M. Jules Barbier avait imprimé son drame, faute de trouver un théâtre, car les directeurs s’étaient montrés inexorables et cruels pour le poète. Aucun de ces messieurs, avec l’adresse, le flair et l’intelligence qui les caractérisent d’habitude, n’avait trouvé la pièce opportune. L’opportunisme… théâtral existait déjà. Aussi, M. Jules Barbier écrivait-il dans sa préface : Je publie cette pièce, n’ayant pu la faire jouer. Il a semblé au Théâtre Français, comme à l’Odéon, que l’action dramatique d’une Jeanne d’Arc avec son dénouement prévu, n’était pas assez riche pour payer sa gloire, je veux dire pour payer les frais d’une mise on scène qu’elle devait nécessairement amener. C’est, je crois, méconnaître le goût du public et restreindre étrangement le domaine du théâtre…
M. Jules Barbier se vengeait des dédains de la Comédie Française en l’appelant le temple désert d’une religion morte…
Le poète critiquait une voie commode qui allait devenir tôt ou tard une ornière. Il gémissait sur la mauvaise fortune de sa pièce. Se trouvera-t-il un théâtre et un directeur pour la recueillir ? Je l’ignore… Mais pour être prévu, le bûcher de Jeanne d’Arc ne m’en paraît pas moins un élément dramatique aussi intéressant en somme que le mariage ou l’adultère obligés de nos héroïnes modernes du Théâtre-Français.
Depuis vint l’affreuse guerre que vous savez et sur nous tombèrent et s’accumulèrent les catastrophes. Nos bons directeurs consentirent à reconnaître alors que le chauvinisme français — il n’avait pas disparu — accueillerait peut-être avec faveur une Jeanne d’Arc. L’un d’eux, qui dirigeait la Gaîté, Offenbach, je crois — voila un piquant contraste ! — résolut d’agrémenter le drame de Barbier d’une musique lyrique et guerrière. Il faut dire tout de suite qu’il ne la fit pas lui-même. Il eut la main plus heureuse. Il s’adressa au maître illustre, Gounod, qui écrivit trois ou quatre belles pages — que nous avons eu la joie d’applaudir hier avec autant d’enthousiasme que le premier soir.
Le public, le bon public fit un accueil des plus chaleureux au drame de M. Jules Barbier, accueil d’autant plus extraordinaire que les critiques, en général, s’étaient montrés assez réservés. ce qu’on appelle le public des premières n’était pas dans le train
ou dans le bateau
, ce soir-là. Il avait pris sur un ton gouailleur et avec sa légèreté habituelle, les tirades patriotiques de l’héroïne et ses invocations religieuses. Cela ne vous étonnera guère.
Vous le connaissez comme moi, sans doute, cet étrange public et vous savez de quelle minceur est son sérieux. À part quelques critiques — rari nantes — qui se font honneur de remplir consciencieusement leur tâche, la salle est pleine de désœuvrés, de demoiselles du demi-monde, d’actrices en rupture de ban ou de petits bancs, de jeunes étourneaux à monocles et à talons plats, sachant mieux manœuvrer la blague que l’observation, cerveaux remplis de hannetons ou de chenilles. Ajoutez à ces petits détraqués, des Parisiens pour qui une première, quelle qu’elle soit, est toujours un évènement et qui ne voient là que le tout Paris dont ils ont la prétention d’être un fragment considérable, de vraies femmes du monde qui n’ont d’autre idée que de détailler et de commenter les toilettes nouvelles… Tout cela forme un concert discordant, un frémissement, un papillotement, un chuchotement énervants et continus au milieu desquels la pièce et l’auteur sont envoyés à tous les diables. C’est bien la faute des directeurs qui réservent leurs gracieusetés et leurs billets à ces étourneaux. Ce public frivole qui se rencontre tous les soirs sur tel ou tel point de la ville, vient pour être vu, pour causer, pour s’amuser, pour rire ou sourire. Il n’écoute point, pas plus que ces fâcheux qui, devant un orchestre, sifflotent entre leurs dents une mélodie qu’ils savent ou croient savoir par cœur. Il y a cependant une exception. Lorsqu’un mélodrame — comme dans certains romans en faveur auprès des concierges — jette trois ou quatre chenapans sur la scène et met en action les scènes sinistres de n’importe quelle rue parisienne, le public des premières consent à leur prêter uns attention fébrile, car il est resté concierge, c’est-à-dire badaud et bavard. Voilà qui l’intéresse plus que les hautes et nobles idées, les sentiments généreux, les scènes patriotiques.
C’est ce qui explique l’insuccès partiel du 8 novembre 1873 et le succès réel des autres soirs. Le public qui pense, s’émeut et comprend, le public qui est venu pour son argent — celui-là vengea M. Jules Barbier de l’indifférence des petits messieurs qui disaient — se croyant nés malins et vaudevillistes, parce que Boileau l’a affirmé — Dieu respire et agit en Jeanne d’Arc, mais Dieu n’a jamais été un personnage de comédie.
Je les plains tous s’ils n’ont pas vu — hier encore — quelle action puissante la foi de Jeanne d’Arc exerce sur la foule. C’est elle qui est le levier du drame ; c’est elle qui démontre aujourd’hui — comme elle l’a fait autrefois — ce que peut sur les Français un être vraiment inspiré par Dieu.
M. Jules Barbier a un très grand mérite. Je n’en fais point du tout un poète de premier ordre — ce serait exagéré — mais j’en fais — ce qu’il est réellement — un artiste de vrai talent et un bon Français qui a cru sincèrement à la mission divine de Jeanne d’Arc. Il a raconté son histoire avec une ardeur qui saisit, qui émeut. Il a compris, aussi bien et mieux que ses devanciers, le sentiment intense de pitié qui suscita la Pucelle, les mouvements de générosité et de foi qui élevèrent une simple jeune fille au-dessus d’elle-même, et lui firent, en quelque sorte, faire des miracles.
Il n’est pas tombé dans le ridicule de ces faux savants, de ces esprits sceptiques — est-ce bien esprits qu’il faut écrire ? — de ces prétendus libres penseurs qui ont rédigé des phrases de ce genre : Le Ciel l’aida fort peu et c’est en cela qu’elle est admirable. Les grandes choses qu’elle fit, elle les fit d’elle-même. Le Ciel qu’elle voyait, était dans son âme…
Mais dire et soutenir cela, c’est insulter à la vérité, c’est mentir à l’histoire même, c’est méconnaître les propres aveux de Jeanne d’Arc. La Pucelle — depuis le premier jour jusqu’au dernier — n’a cessé, sous toutes les formes, de déclarer qu’elle était l’envoyée de Dieu. Le procès est là, les interrogatoires sont là pour prouver ce que j’avance. Une Jeanne d’Arc laïque n’est autre chose qu’un monstre. C’est pour le coup que son histoire serait une légende, une fable, un conte… Mais n’insistons pas. Notre cause est trop juste pour n’être pas gagnée d’avance.
M. Jules Barbier a donné, a rendu à Jeanne d’Arc son véritable caractère. Il a accompli cette œuvre avec respect, avec conviction, avec talent et je m’empresse de le féliciter de tout cœur. Oui, je le répète, il a fait acte de bon patriote et c’est quelque chose aujourd’hui où tant d’auteurs, plus eu moins dramatiques, font concevoir à l’étranger une si triste et si fausse idée de la France, de ses mœurs de ses habitudes.
M. Barbier a remanié toute son œuvre. Il a supprimé certaines scènes qui allongeaient le drame : il a transformé Agnès Sorel en Iseult, se rendant à la vérité historique qui veut qu’Agnès Sorel ne fut connue du Roi qu’en 1432. Mais pendant qu’il faisait des remaniements, il aurait pu aussi bien rayer Iseult qu’Agnès Sorel. Cette damoiselle n’ajoute rien de très intéressant à la pièce. Au contraire. Enfin il a modifié tout le quatrième acte à Reims, faisant du sacre triomphal un spectacle éblouissant pour les yeux. La scène si touchante entre Jeanne et ses parents a disparu ; je la regrette.
La Pucelle, dans un très beau monologue, pressent que sa mission est terminés ; mais cédant aux instances du Roi, elle consent à rester auprès de lui pour défendre encore la patrie française.
Supprimant donc les épisodes qu’il croyait inutiles, M. Jules Barbier a divisé son drame en trois parties bien distinctes : la mission, le triomphe, le martyre. Au premier acte, il nous montre Jeanne d’Arc dans la maison de Domrémy, entendant les voix des saintes Marguerite et Catherine qui lui dictent sa mission sacrée.
À ton village dis adieu.
Tu fuiras ton père et la mère.
Pour suivre le Seigneur ton Dieu !
Jeanne
Demain, demain… encore un jour !
Les saintes
Dieu l’a choisie,
Va pauvre âme d’effroi saisie,
Va, fille de Dieu, va !
Au second acte, la Pucelle arrive à Chinon, pénètre jusqu’au Roi qui s’est caché dans la foule des courtisans et le salue. Elle lui révèle sa divine mission et pour lui en donner une preuve immédiate, elle répète la prière que le Roi avait dite en secret à Dieu. Charles VII partage alose la foi de Jeanne d’Arc. Il lui dit qu’elle marchera l’égale des barons et que ces soldats suivront, comme lui, son étendard. Jeanne jette le cri des Croisades : Dieu le veut !
et déclame les belles strophes que chantait autrefois le chœur.
Au troisième acte, Jeanne d’Arc délivre Orléans, et au quatrième, conduit le Roi à Reims. Le poète nous fait assister au sacre dans la vieille cathédrale ornée de tentures, de draperies et de lumières. Là le quinzième siècle avec ses chevaliers, ses barons, ses hérauts, ses varlets, ses pages, ses évêques, semble revivre comme dans une vision inoubliable. Enfin, au dernier acte — le plus émouvant de tous — apparaissent la prison et le bûcher.
M. Jules Barbier a su enchâsser en beaux vers les réponses admirables de la Pucelle qui, dites merveilleusement par Mme Sarah Bernhardt, ont jeté comme un frisson d’enthousiasme dans la salle ravie. Et lorsque Jeanne d’Arc, prévoyant l’avenir, défie le sinistre Warwick et venge la France du mépris des Anglais, ç’a été une acclamation sans fin. L’artiste ne s’y était pas trompée. Il y a là, disait-elle, la veille de la première représentation, un tel accent de vérité et des élans tellement sublimes que je défie qu’on puisse entendre la scène avec Warwick sans éprouver un serrement de cœur et une émotion véritable. Quant à moi, je ne saurai la jouer sans me sentir monter les larmes aux yeux.
C’était vrai. Et le public, partageant l’émotion de l’artiste, applaudissait et pleurait. Cette impression a été plus vive encore à la vue de Jeanne d Arc mourant sur le bûcher et lorsque le ciel s’est ouvert pour montrer les saintes et les anges chantant :
Va, je serai vers toi, va, fille de Dieu, va !
Celui qui, à ce moment, aurait nié la mission divine de la Pucelle, eût été couvert de risées. De tels spectacles, encore une fois, relèvent un peuple, l’ennoblissent et l’encouragent. Lorsqu’on n’a habituellement pour pâtures que les atrocités, les scandales ou les niaiseries de la plupart de nos théâtres, on se sent singulièrement réconforté. Une mise en scène admirable, une musique superbe, une interprétation hors ligne donnent à cette grande œuvre un relief saisissant.
Sarah Bernhardt s’est passionnée pour le rôle de Jeanne d’Arc, si pur, si idéal, si dramatique. Elle l’a jouée avec feu, avec âme, avec transport. Sa voix a souvent fait tressaillir la salle. Cependant elle a çà et là quelque chose de martelé. Dans les cris de passion, dans les élans, elle prend parfois des tons durs et rauques. Mais ce ne sont là que de légers accidents. L’actrice est en pleine possession de tous ses moyens et elle se donne tout entière. Il m’a seulement paru qu’elle faisait ou voulait faire de Jeanne d’Arc — au premier acte surtout — plutôt une hallucinée qu’une sainte et religieuse enfant. C’est un tort sur lequel il lui serait facile de revenir. Je trouve la confirmation de ma critique dans les paroles mêmes que le Figaro prêtait avant-hier à l’artiste. Pour moi disait Mme Sarah Bernhardt, c’est une sorte d’hallucinée, d’extatique, qui va vers un but fatal, guidée par une volonté à laquelle elle te résiste pas…
Eh ! bien, non, ce n’est pas cela. Jeanne d’Arc est surtout une fille pieuse, conduite par la foi, naïvement et simplement. Il ne faut pas lui donner les yeux hagards et fous que lui prêtait Bastien Lepage dans ton tableau ridicule, mais le regard pur et minant qu’a rendu si admirablement notre grand statuaire Chapu. Je n’aime pas beaucoup non plus les contorsions de Jeanne, lorsqu’elle voit au premier tableau les saintes lui apparaître. La foi et l’extase, l’extase surtout, suffisaient. Les soupirs, les mains agitées, les bras tendus me choquent et me gênent. Ces réserves faites, il faut louer la passion extraordinaire, la flamme, la vigueur, la force sans pareilles que Mme Sarah Bernhardt a su donner aux transports patriotiques de la Pucelle. C’est très beau.
Le brave La Hire a été fort bien joué par M. Bouyer. J’aimais mieux Angelo que M. Deneubourg dans Charles VII. Le père de Jeanne d’Arc a trouvé un excellent et digne interprète dans M. Léon Noël. Le farouche Warwick a été rendu avec une sombre énergie par M. Rebel, artiste très consciencieux, qui s’était fait déjà remarquer au théâtre de l’Odéon par plusieurs bonnes créations.
Mlle Méa a fait ce qu’elles pu pour réchauffer le rôle d’Agnès Sorel, qui avait servi, en 1873, de rôle de début Mlle Tessandier. Enfin, il faut signaler l’orchestre dirigé par M. Pister, les chanteurs et les chœurs qui ont contribué, pour une bonne part, au succès. Notre grand maître Gounod a remanié sa partition et a écrit de nouveaux morceaux qui, comme les anciens, ont été applaudis et acclamés.
Somme toute, c’est un beau et noble spectacle. La foule s’y rendra pour saluer l’incarnation vivante de Celle qui a été la gloire et la consolation de notre histoire. Ce sera, comme le disait si bien Paul de Saint-Victor, le pèlerinage du patriotisme.
Martinville.
Le Gil Blas, 5 janvier 1890
Article de Léon Bernard-Derosne.
Lien : Gallica
La Porte-Saint-Martin a repris hier la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier, qui a été représentée pour la première fois il y a seize ans, à la Gaîté. Le succès ne s’en était pas imposée d’emblée. La pièce, accueillie d’abord avec quelque réserve, avait fini par intéresser tout de bon le public. Elle fut jouée un grand nombre de fois et ceux-là même qui en avaient le plus justement contesté la force dramatique durent reconnaître qu’elle était dans son ensemble une œuvre non seulement estimable mais attachante.
On était alors au lendemain de la guerre, et il était difficile de ne point se sentir ému devant l’héroïque et sainte image de cette fille du peuple, en qui s’incarne le mieux la patrie française. Le rôle de Jeanne était tenu d’ailleurs avec un grand éclat par madame Lia Félix, et la musique de M. Gounod venait ajouter un charme plus vivant à la représentation de ce mystère. La Jeanne d’Arc de M. Barbier est bien, en effet, un mystère, et en y songeant elle ne pouvait guère être que cela. L’auteur, en voulant respecter l’histoire, ne se condamnait-il pas lui-même à supprimer de sa pièce tout ce qui lait la raison d être et l’intérêt de toute œuvre dramatique, à savoir la lutte des passions. Le drame n’est rien s’il n’est pas la représentation de cette lutte.
Or, je l’ai déjà remarqué, à propos de la sévère et curieuse tentative de Julien Dallière, — la Mission de Jeanne d’Arc, — il ne saurait être question ici de nous montrer le spectacle d’une pareille lutte. Jeanne d’Arc, c’est l’héroïsme même, et par son essence l’héroïsme suppose un état moral d’une simplicité absolue. Un seul sentiment, une seule passion, le culte de la patrie emplit l’âme de Jeanne. La voix de Dieu lui a dit : Sauve ton pays !
Elle écoute pieusement cette voix et lui obéit jusqu’au bout avec une docilité sereine et comme surnaturelle. L’idée que Jeanne pourrait ne pas accomplir sa tâche sacrée ne nous vient même pas et tout ce qui contrarierait la sublime inconscience de son dévouement nous semblerait absurde et presque monstrueux. C’est partait, mais cela nous oblige du même coup à exiger que dans la mise à la scène de l’histoire de Jeanne d’Arc il n’y ait aucune trace d’action dramatique. Les étrangers, comme le poète anglais Southey et Schiller, qui ont le mieux chanté l’héroïque pucelle, l’ont compris ainsi, et pour donner à leur œuvre la vie dramatique, ils ont commencé par défigurer l’histoire avec une bravoure insolente et tranquille. Schiller, dont la Pucelle d’Orléans est peut être le drame le plus parfait, n’a pas hésité, par exemple, à nous représenter une Jeanne amoureuse d’un jeune Anglais.
Sans s’astreindre à un respect aussi étroit de la réalité historique que l’a fait Dallière, M. Jules Barbier tient lui aussi à nous montrer qu’il entend dire les choses comme elles sont et non pas comme elles devraient être pour avoir un intérêt dramatique. Il indique avec une discrétion extrême d ailleurs que Jeanne est aimée d’un certain Thibaut, mais cet amour ne tire pas à conséquence et, au fond, le poète se fait gloire de ne rien changer aux faits dont il évoque le grandiose et douloureux souvenir. La Mission de Jeanne d’Arc, de M. Dallière, se terminait par le sacre de Charles VII à Reims, la pièce dé M. Jules Barbier nous mène jusqu’à la mort de Jeanne.
Il ne faut pas regretter que M. Jules Barbier ait voulu être plus complet, car les deux derniers tableaux de Jeanne d’Arc : la Prison et le Bûcher, sont de beaucoup, les plus saisissants. Le vers du poète qui, jusque-là, ne nous avait guère frappé que par ses qualités honorables, prend tout à coup du nerf et de l’ampleur. Il a peut-être plus de plénitude que de sonorité, mais il est vivant et se prête bien au dialogue scénique. Le public qui avait suivi avec plus d attention que de plaisir les quatre premiers tableaux, s’est échauffé tout à fait aux deux derniers et la représentation a fini au milieu des applaudissements de la salle entière.
Une part de ces applaudissements revient, il est vrai, au musicien et aux interprètes. Je ne parlerai pas de la musique de M. Gounod, c’est mon collaborateur M. Massiac, qui vous dira ce qu’il faut e :i penser. J ai seulement remarqué avec regret, la suppression du ballet des Ribaudes, car j’avais gardé de ce ballet un très bon souvenir. Ce n’est pas d ailleurs la partition seule qui a été remaniée. M. Barbier, en effet, a modifié la pièce en plus d’un endroit et d’une façon assez sensible. Un tableau tout entier a été enlevé au quatrième acte, — celui de la Terrasse à Reims, et c’est Jeanne elle-même et non pas le chœur qui dit les strophes avec accompagnement d orchestre par où se termine le deuxième acte. Agnès Sorel, de plus a changé de nom. Elle s’appelle maintenant Iseult. Il paraît qu’en 1429 Agnès n’avait pas encore tourné la tête du roi.
J’arrive à l’interprétation. Madame Sarah Bernhardt jouait le rôle de Jeanne d’Arc. Je n’étais pas sans inquiétude sur la façon dont l’éminente tragédienne se tirerait de cette épreuve que je jugeais un peu hasardeuse. Je sais bien quelles sont les ressources du grand talent de madame Sarah Bernhardt, mais je craignais que le personnage, à la lois simple et surnaturel de Jeanne, ne convint pas de tous points à ce talent. Je redoutais surtout les effets de ce maniérisme où se compromet parfois le jeu, tour à tour trop tendu et trop lâché de madame Sarah Bernhardt. J’ai eu le plaisir de m’apercevoir presque tout de suite que j’avais tort de m’inquiéter ainsi. La représentation a été pour la principale interprète l’occasion d’un nouveau triomphe. Le public n’a cessé de lui faire l’accueil le plus enthousiaste, Elle a été applaudie, rappelée, acclamée et il m’a paru que cela était juste.
Au premier acte, quand Jeanne, se retournant, dit à son père : Mon père
, il y a eu un frémissement d’admiration dans toute la salle. Avec son regard limpide et profond, sa perruque blonde, la sveltesse de toute sa personne, son ail exalté, naïf et grave, sa victorieuse et fraîche jeunesse, l’artiste est soudain apparue comme la personnification même de la vaillante, de l’héroïque et douce Lorraine. L’attitude, le geste sont demeurés d’ailleurs pendant toutes les scènes où Jeanne se montre sous les différents aspects de son personnage d’une aisance, d’une noblesse, d’une perfection achevées.
Quant à là diction, j’ai cru y remarquer de temps à autre quelques-uns des défauts que madame Sarah Bernhardt a contractés en s’appliquant à faire entendre notre langue à des spectateurs dont elle n’est pas la langue maternelle. J’ai été plus d une fois surpris par cette habitude singulière de marteler la première syllabe des mots que madame Sarah Bernhardt paraît, je ne sais pourquoi, décidée à je pas perdre. De plus, je dois le dire, la voix, surtout dans le registre élevé, m’a semblé avoir un peu perdu de sa force. Mais ce sont là, en somme, de légères réserves. Madame Sarah Bernhardt a compris et rendu ce rôle difficile, en. grande artiste qu’elle est, et pendant les dernières scènes, elle a simplement été admirable de ferveur, d’intrépidité ingénue, de tendresse poignante.
Les autres rôles sont comme toujours très bien tonus par la troupe de la Porte-Saint-Martin. Mademoiselle Jane Méa est une Iseult tout à fait digne de l’amour d’un roi de France. M. Léon Noël prête son jeu sûr à Jacques d’Arc, M. Bouyer prête sa belle prestance et sa diction juste à La Hire. M. Deneubourg ne manque pas de distinction sous la tunique fleurdelisée de Charles VII, et MM. Rosny, Herbert, Perrier, Rebel et mesdames Marie Grandet, Julie Avocat et Nesville, sont assez près de réaliser l’excellent ensemble rêvé. J’ajoute que la mise en scène est superbe et que les décors le sont au moins autant.
Article de Théodore Massiac (critique musicale).
Jeanne d’Arc est certainement une des grandes figures qui ont le plus préoccupé M. Gounod. Non seulement il a écrit une volumineuse partition sur la pièce de M. Barbier, mais encore il a compose récemment une messe des plus remarquables, qu’il a dédiée à la mémoire de la sainte héroïne, et où se trouve une marche triomphale du plus beau caractère.
La partition de Jeanne d’Arc, sans compter parmi les chefs-d’œuvre du musicien, est cependant une œuvre de haute valeur, où se reconnaît la main d’un maître. De la tenue la plus élevée, à travers laquelle perce souvent l’inspiration d’une âme émue et vibrante, elle est surtout d’une clarté constante et d’une rare abondance mélodique (rare aujourd’hui principalement).
Le caractère mystique de l’héroïne y est rendu avec une pénétration remarquable. On sait, d’ailleurs, que le maître est lui-même un mystique. À ce point de vue, il devait trouver facilement les accents nécessaires pour rendre toute cette partie de la figure de la Pucelle.
En outre, il a traité supérieurement tout ce qu’il y a de religieux dans le drame de M. Barbier. Où le métier apparaît davantage, c’est dans les morceaux destinés à faire diversion, à égayer un peu la trame sombre de l’œuvre.
Nous citerons principalement, au 1er tableau : l’introduction, le chœur : Nous fuyons la patrie, et le final, morceau d’un effet saisissant, où Jeanne hallucinée, écoute les voix des saintes qui lui commandent d aller combattre et délivrer la France. Rien de plus pathétique que ces deux voix de femmes, soutenues par les accords de l’orgue. Le passage : Le Seigneur à toi se révèle ; C’est la voix de Dieu qui t’appelle ! et l’ordre : Fille de Dieu, va ! vous communiquent une de ces émotions puissantes, qui font vibrer vos fibres les plus intimes. C’est à notre avis, le plus beau morceau de la partition, et il est bien chanté par Mlles Valbré et Parini, deux belles voix, principalement la deuxième, qui possède un contralto magnifique. Le soprano de Mlle Valbré, très beau dans le registre élevé, manque un peu de force dans le médium.
Nous citerons encore, au deuxième tableau, la Ballade du Page, un morceau dans le genre archaïque, gentiment chanté par mademoiselle Nesville, qui est d’ailleurs un Loys des plus gracieux ; les stances déclamées, sous lesquelles le maître a écrit une page symphonique où les cors, en sons bouchés, rappellent les cloches que l’on a entendues au premier tableau ; au troisième tableau, le’ Chœur des soldats, au rythme si curieux, et la Prière ; au quatrième tableau, la splendide Marche du sacre, où les cloches carillonnent d’une manière si piquante sur les majestueux accords de l’orgue ; enfin, au sixième tableau, la Marche funèbre, une page de toute beauté, et le Final du bûcher.
L’orchestre et les chœurs étaient sous la direction de M. Louis Pister, un excellent chef d’orchestre, qui fut le bras droit de Pasdeloup, aux derniers temps du vieux lutteur, et qui jouait en montant Jeanne d’Arc une grosse partie. Cette partie, il l’a gagnée sans conteste.
Article de Richard O’Monroy.
La Soirée parisienne : Jeanne d’Arc, 3 janvier 1890.
Il n’y avait pas plus de trois quarts d’heure que nous attendions à la Porte-Saint-Martin — on nous avait dit d’être là à huit heures — et pour nous distraire nous lorgnions les théories de vierges ( ?) étagées sur les gradins de M. Duquesnel lorsque l’orchestre, dirigé par M. Pister, a entamé l’introduction de Gounod, puis le rideau s’est levé sur le :
Premier tableau. — La chaumière de Domrémy en 1429. — Je ne suis pas fâché de vous éblouir en passant par mon érudition historique. Une chaumière à ogive, avec vaste porte ouvrant sur la campagne éclairée par le soleil couchant. Jeanne d’Arc (Sarah Bernhardt) vêtue en modeste campagnarde, file au rouet, à côté de son père Jacques d’Arc (Léon-Noël). Et voilà un tas de gens qui entrent en scène, de pauvres diables qui chantent le chœur des fugitifs : Nous fuyons la patrie.
Le brave Jacques leur offre l’hospitalité, puis Jeanne restée seule entend à nouveau des voix — les voix de la mission. Le fond de la scène s’entrouvre et l’on aperçoit sur un ciel étoilé un tabernacle d’or devant lequel chantent les deux anges (mademoiselle Valbré et Parini) vêtues de belles robes rouges avec de grandes ailes dans le dos.
Ai-je besoin de vous dire qu’elles chantent comme des anges, tant et tant que Jeanne peu à peu se dirige vers la porte — oh ! la figure extatique de Sarah pendant le chant céleste ! — et se décide enfin à abandonner la maison paternelle. On rappelle Sarah avec enthousiasme.
Deuxième tableau. — À Chinon (8 mars 1429). — Gracieux tableau présenté par la favorite Iseult (Jane Méa), occupée à sa toilette et entourée de petits pages. Elle est charmante, la favorite, avec sa robe de velours rose, son corsage de brocard d’or garni d’hermine et son diadème garni de perles.
Charles VII n’avait peut-être pas grand chose — mais il avait bon goût. Un petit page (mademoiselle Nesville) chante une romance en s’accompagnant sur la mandoline, et le roi fait son entrée (Deneubourg).
Aucun prestige, décidément ; maintenant je sais bien qu’à cette époque là. Mais il a une façon de se laisser traiter par le colonel Ramollot, — pardon ! par La Hire, — qui m’a un peu étonné.
Arrivée de Jeanne en tunique blanche, cotte de mailles et poignard à la ceinture. Après avoir dit son fait à la favorite, après avoir reconnu le roi malgré sa piètre apparence, — le voilà bien le miracle ! — elle scande l’épopée de : Dieu le veult ! avec une telle force, une telle conviction, que la salle entière, électrisée, acclame chaque strophe. Le rideau baisse et toute la salle se lève pour saluer Sarah.
Troisième tableau. — L’attaque des tourelles d’Orléans (7 mai 1429). — Vastes perspectives sur la campagne, tours crénelées, catapultes bizarres : les soldats chantent et boivent — car il est reconnu qu’au théâtre les soldats ne font jamais que ça. Incident. Le petit page déjà nommé (Nesville) doit chanter un couplet, mais le petit page n’est pas là ! On baisse le rideau, et au moment où on le baisse le petit page arrive tout essoufflé et explique, par une pantomime vive et animée, qu’il n’y a pas de sa faute. Alors on relève le rideau et l’on recommence la scène.
Attaque-t-on réellement les tourelles ? Heu ! heu ! Il y a bien eu un peu de fumée produite par une couleuvrine, on lance une flèche ; puis les guerriers casqués et amassés crient à chaque instant à Xaintrailles et à La Hire-Ramollot : Marchez ! nous vous suivons !
Mais la vérité est qu’on ne marche pas. Ramollot jure par son bâton. Aujourd’hui il dirait sacrégnongnieugnieu.
Quatrième tableau. — Intérieur de la cathédrale (13 juillet 1429). — (Hein, qu’est-ce que vous dites de mon érudition ?) Un magnifique décor de cathédrale ; au centre le maître-autel où officie l’évêque, puis, sur des stalles le clergé, les seigneurs, les pages, les dames de la cour à genoux sur des coussins, dans le fond les arceaux éclairés par de par de grands lustres à bougies. Sous un dais de velours bleu brodé de fleurs de lys d’or le roi et la reine.
Puis, dans un coin, radieuse, transfigurée, Jeanne, en longue tunique blanche, tenant l’oriflamme qui a été à la peine et qui est maintenant à l’honneur. Alors, au son des orgues, l’évêque remet successivement à Charles VII le long manteau garni d’hermine, l’épée ornée de pierreries, le sceptre et enfin il lui pose sur la tête la couronne d’or fleurdelisée. Alors le roi sacre à son tour Jeanne chevalier, en lui frappant chaque épaule du plat de son épée. Gros effet. On a sacré Charles VII… il n’y a que La Hire qui ne sacre plus.
Cinquième tableau. — La prison (31 mai 1431. — Je continue à vous étonner). — Dans un coin Jeanne reposant sur un pauvre grabat de paille.
Elle est gardée par des soldats anglais qui jouent et boivent. J’en étais sûr ! L’interrogatoire de Jeanne par le prêtre drapé dans sa robe blanche et noire produit un gros effet, mais que dire de la grande tirade de Jeanne à Warwick, souffletant le vainqueur de son mépris, bravant la force, et laissant entrevoir la revanche.
À ce moment, nous sommes tous empoignés par une émotion extraordinaire. Un grand souffle patriotique passe dans la salle. Sarah, rugissante, lance chacun de ses vers insultants à pleine voix, et chaque alexandrin est salué de bravos frénétiques. À la fin du tableau, c’est du délire. On redemande Sarah trois fois. Pardonnez-moi, lecteur, mais il y a des moments où Richard O’Monroy lui-même se sent dans l’impossibilité de blaguer.
Sixième tableau. — Le bûcher sur la place du Vieux-Marché à Rouen (31 mai 1431). — Voilà ce que je craignais ! On joue une marche funèbre, puis Jeanne monte sur le grand bûcher central. On lui lit sa sentence, et les flammes de lycopode s’élèvent vers, le ciel avec des tourbillons de fumée. Grand finale en musique, orgues, voix célestes. Adieu Jeanne, adieu…
Sarah revient saluer. Elle n’était pas morte : Merci, Duquesnel ! C’est égal, si les murs de la Porte-Saint-Martin ne se sont pas écroulés ce soir sous le bruit des applaudissements, c’est qu’ils sont solides. Merci aussi, grande et incomparable Sarah, de nous avoir procuré une soirée semblable, et d’avoir fait revibrer la fibre patriotique dans nos cœurs sceptiques et blasés.
P. S. — J’ai un petit scrupule de conscience. Vous savez les dates historiques… eh bien ! j’aime mieux vous l’avouer… elles étaient sur mon programme.
Le Gil Blas, 6 janvier 1890
Article de Jehan des Ruelles.
Lien : Gallica
Jeanne d’Arc et M. Renan
Dans un dîner de camarades, on parlait de Jeanne d’Arc, de Sarah… voilà que tout d’un coup, une très jolie femme pleine d’esprit et qui connaît son Paris comme personne, se tourne vers moi.
— Vous qui interviewez tout le monde, me dit-elle, vous devriez aller demander à M. Andrieux ce qu’il pense de Jeanne d’Arc.
Je ne suis pas allé voir M. Andrieux, mais je suis allé au Collège de France et j’ai eu avec M. Renan une heure de bonne causerie.
Pelotonné au fond d’un fauteuil, comme un gros chat qui fait ses ronrons, l’Immortel s’égayait à l’idée qu’on pouvait être curieux de connaître son opinion sur la Pucelle.
— La Pucelle ! Voltaire lui a joué un vilain tour, bien vilain… il s’est livré sur elle à des plaisanteries d’un bien mauvais goût, mais soyez assuré, qu’au fond, il ne lui voulait pas de mal… Non, il n’a jamais eu l’idée d’entacher sa réputation.
— J’ai lu, je ne sais plus où, que Voltaire avait beaucoup aimé Jeanne d’Arc, et que c’était la peur de la voir canonisée, enlevée par les prêtres, qui l’avait déterminé à entacher son innocence.
— Voltaire n’a pas vu si loin que cela, il n’aimait pas Jeanne d’Arc autant que vous le dites, il n’avait pas non plus de raison de lui en vouloir.
Il a parlé de Jeanne d’Arc, parce que le sujet lui est venu sous la plume, il en a dit un peu de mal, mais il n’a pas rencontré de protestations.
Car — vous le ferez remarquer — c’est seulement notre siècle qui a élevé à la Pucelle ce culte qu’on lui rend aujourd’hui ; on n’en parlait pas auparavant, ou pas beaucoup.
Voyez François Ier. Le souvenir de Jeanne, il aurait dû l’avoir bien précis, puisque cent ans s’étaient à peine écoulés depuis le jour où elle avait aidé à sauver la France. Eh bien, François Ier ne dit pas que c’est Jeanne d’Arc qui a délivré la patrie, et c’est à Agnès Sorel qu’il fait remonter l’honneur de cette délivrance, témoin ces vers :
Gentille Agnès, plus d’honneur tu mérite
La cause estant de France recouvrer
Que ce que peut dedans cloistre ouvrer
Clause nonain ou bien dévot hermite
Je vous le dis, Jeanne d’Arc n’a été révérée qu’à partir du commencement de ce siècle, auparavant on en parlait à peine.
C’est une belle légende que la sienne. Je sais bien qu’on l’a embellie, cette légende, Jeanne d’Arc a apporté aux soldats de Charles VII son prestige de vierge — et vous savez combien les soldats de l’époque révéraient les vierges — elle leur a dit les révélations qu’elle avait entendues, et ces hommes, aux mœurs violentes, mais pleins de superstitions, de croyances et remplis de l’esprit chevaleresque, ont fait un nouvel effort et ont repoussé l’étranger. Jeanne d’Arc était pour eux, comme une de ces saintes qui ornaient leurs bannières et qui serait descendue au milieu d’eux pour les conduire à la victoire.
Je ne voudrais rien nier de ce qui contribue à rendre la Pucelle glorieuse, mais la lecture des écrits de l’époque me fait croire que bien peu parmi les soldats savaient sa présence dans leurs rangs : l’état major — si je puis m’exprimer ainsi — était presque seul à savoir qu’elle était là, et encore, parmi ces guerriers s’en trouvait-il qui eussent souhaité la voir ailleurs.
On fait bien d’élever des autels à Jeanne d’Arc. Si son rôle a été moins brillant qu’on ne le dit, ses belles réponses devant le tribunal qui l’a jugée, témoignent de sentiments si élevés qu’on doit être plein d’admiration pour elle.
Est-ce à dire qu’il faille la donner en exemple aux jeunes filles modernes ? Il serait imprudent de le prétendre. Je cherche vainement la Jeanne d’Arc du vingtième siècle.
Et puis il est des choses qui ne se renouvellent pas. Les armées de la Révolution ont fait des prodiges : en feraient-elles aujourd’hui ? Napoléon pourrait-il recommencer de nos jours son épopée du commencement du siècle ? Je ne le crois pas.
De même Jeanne d’Arc n’aura pas d’imitateurs : et si elle ressuscitait de ses cendres, elle ne pourrait lutter avec les canons Krupp.
C’est absolument comme si, dans les armées modernes, on donnait aux hommes la consigne d’imiter les cris d’animaux pour effrayer l’ennemi. De tels moyens étaient bons à employer dans l’antiquité. Aujourd’hui ils n’auraient plus d’effet.
N’importe, il faut aimer Jeanne d’Arc. Les sentiments qui l’ont fait agir sont de ceux qu’on doit admirer. Les personnes sages que la logique guide et dont les révélations
d’une Pucelle pourraient gêner les résolutions, peuvent être tranquilles, ces choses-la sont d’un autre âge et ne se reproduisent pas. Finie Jeanne d’Arc, finies les révélations ; les voix ne se font plus entendre.
C’est pour cela que notre hommage doit être entier, sans réserve d’aucune sorte. Voyez le peuple, qui a démoli toutes les divinités, il aime Jeanne d’Arc et ne cherche pas la petite bête.
Imitons son exemple. Et si dans la légende il y a des erreurs, laissons-les subsister.
Le peuple n’est pas fait pour la vérité. La vérité est longue à trouver ; lorsqu’on veut la rechercher il faut faire le sacrifice de sa vie toute entière et quelques privilégiés seuls le peuvent.
Causons de ces choses entre nous puisqu’elles nous intéressent et laissons le peuple adorer les idoles qui ont remplacé les dieux. Suivons en cela l’exemple des Allemands, qui, les premiers, avec Goethe et Schiller ont adoré Jeanne d’Arc, rions des historiens anglais qui diminuent la Pucelle sous le prétexte qu’il n est pas admissible que Dieu ait envoyé une vierge pour chasser l’Anglais de la France.
Et réjouissons-nous de voir Sarah, la grande artiste, incarner la Pucelle…
Voilà, cher monsieur, ce que je puis vous dire… ce sont des réflexions de vieillard ! [Renan allait sur ses 67 ans.] Mais aussi, quelle drôle d’idée de venir me demander ce que je pense de Jeanne d’Arc !
Le Temps, 6 janvier 1890
Chronique théâtrale, en feuilleton, de Francisque Sarcey.
Lien : Gallica
La Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier fut jouée pour la première fois en 1873, à la Gaîté, que dirigeait alors Offenbach. Comment Offenbach avait-il eu l’idée de monter une tragédie, ou plutôt un mystère chrétien, car la Jeanne d’Arc de Barbier n’était pas autre chose ? C’est une histoire assez singulière et qui vaut d’être contée, car elle montre à plein comment au théâtre les calculs les plus habiles sont incessamment déjoués.
Offenbach, en prenant la direction de la Gaîté, s’était fait délivrer par le comité des auteurs dramatiques, où il ne comptait que des amis, l’autorisation de jouer une ou deux de ses pièces. Vous savez, ou vous ne savez pas, que les directeurs de théâtre s’engagent, par le traité qu’ils signent avec la commission des auteurs dramatiques, à ne jamais jouer leurs pièces sur leur théâtre. Bien en a pris à Molière de naître deux siècles avant cette clause. Au reste, les directeurs peuvent, si le cœur leur en dit, tourner la difficulté et faire signer par un homme de paille une pièce dont ils touchent les droits.
Offenbach avait toujours eu l’idée de remonter Orphée aux Enfers et de le transformer en pièce à grand spectacle. Orphée, dans ce vaste théâtre, pouvait faire de neuf à onze mille francs de recette. Si la reprise réussissait, et le succès en était des plus probables, vous voyez quelle fortune pour l’imprésario, et surtout pour l’auteur.
Il avait besoin de quelques semaines pour mettre la pièce sur pied ; il lui fallait jouer quelque chose en attendant, quelque chose dont le succès ne pût pas être long et qui pourtant fît honneur à sa direction. Vous vous rappelez qu’en ce temps-là on ne parlait que de se régénérer. La presse elle-même affectait des sentiments de gravité austère : elle demandait que le théâtre revînt aux grandes œuvres. C’était à cette époque une bêtise, courante dans le journalisme, que l’opérette était née de la corruption impériale et que, si nous avions perdu la bataille de Sedan, c’est qu’on avait chanté la Grande-Duchesse aux Variétés. Offenbach sentait donc le besoin de jeter à ce public affamé de régénération une œuvre sévère, en harmonie avec le sérieux de ses idées ; il comptait bien, à part lui, connaissant à fond la frivolité du public parisien, que l’œuvre sévère serait comblée d’éloges, mais ne durerait-guère sur l’affiche. Il en serait d’elle comme des vers de Lefranc de Pompignan :
Sacrés ils sont, car personne n’y touche.
La Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier faisait bien son affaire. Il n’y avait pas de sujet plus régénérant que celui-là ; l’œuvre, à la lire, lui semblait avoir toute l’austérité souhaitable et réunir toutes les chances d’un éclatant et court succès d’estime. Au reste, il était décidé à faire la partie belle aux amateurs du grand art et de la moralisation par le théâtre ; il monterait la pièce avec luxe et, comme il avait un orchestre, l’orchestre du futur Orphée aux Enfers, il demanderait de la musique à Gounod, qui se laisserait séduire au mysticisme du sujet et composerait un bel oratorio. L’ouvrage fournirait évidemment quelques belles représentations ; les recettes ne tarderaient pas à baisser et Offenbach pourrait dire au public : Vous voyez, j’ai sacrifié à l’art sérieux ; je vous ai donné d’abord le Gascon de Barrière et je n’ai pas fait d’argent ; je vous ai servi ensuite la plus régénérante des tragédies et je n’ai encaissé que des louanges. Force m’est bien de revenir à l’opérette, et en avant le quadrille d’Orphée aux Enfers.
Il faut dire que la première représentation de Jeanne d’Arc ne démentit point ces prévisions. Le public très spécial qui a la prétention d’imposer son goût aux Parisiens ne sentit qu’un plaisir modéré à cette légende, découpée en tableaux, dont quelques-uns ennuyèrent ou même déplurent. Le vers de M. Jules Barbier, qui est honnête et sain, n’avait rien d’enlevant ; c’était de la poésie correcte, loyalement versifiée par un homme qui ne paraissait point se douter que, depuis Casimir Delavigne,Victor Hugo avait écrit la Légende des siècles. Je me souviens qu’à l’orchestre on faisait des mots, on blaguait ; on ne fut sérieusement pris qu’au dernier acte, que Mlle Lia Félix enleva avec un extraordinaire déploiement de force. Dans les couloirs — oh ! ces terribles conversations de couloirs ! — on se disait, en passant son paletot : En voilà pour quinze jours ! Au bout du mois, nous entendrons chanter ici : Évohé ! le ciel m’inspire !
J’avais été cependant très frappé de l’ardeur d’attention avec laquelle on avait paru suivre la pièce aux galeries supérieures. Ils n’avaient point paru s’ennuyer là-haut ; tout au contraire, ils avaient semblé émus ; ils avaient même manifesté un certain chagrin de nous voir si peu attentifs. Ce souvenir me tracassait ; je retournai trois ou quatre jours après écouter la pièce à nouveau, la veille du feuilleton. Quelle différence ! un public tout entier, recueilli, touché, docile à passer par toutes les émotions que lui avait ménagées l’auteur, et moi-même emporté par le même courant d’admiration et de sympathie.
À la sortie, je rencontrai une parente à moi, que je fus très étonné d’y voir, car je la savais pieuse et se défiant du théâtre :
— Francisque, me dit-elle d’un ton pénétré, j’aime à croire que tu diras du bien de cette Jeanne d’Arc. Voilà une pièce comme il faudrait que l’on en jouât souvent ! J’y mènerai tout mon monde.
— Fichtre ! pensai-je aussitôt, c’est nous, les beaux esprits, qui nous sommes trompés. Voilà l’opinion du vrai public. Il ne se soucie guère, lui, des questions de forme ; il ne s’offusque point d’un style incolore et d’un vers terre-à-terre ; il se laisse pénétrer à l’héroïque grandeur des sentiments exprimés, à la sincérité de l’accent, à la beauté du spectacle. Le succès va être considérable. Il sera énorme, si dans le monde la convention s’établit qu’on se régénérera en voyant Jeanne d’Arc. Il n’est fils de bonne mère qui ne voudra se régénérer à bon compte ; on ira à la Gaîté comme à la messe d’une heure.
Je n’ai pas besoin de vous dire que je m’arrangeai pour écrire un feuilleton qui ne me tuât pas ma pauvre tante à bout portant. Je ne laissai pas d’indiquer les réserves que nous avions faites ; mais j’insistai de préférence sur les qualités de l’ouvrage, sur l’enthousiasme qu’il excitait dans le public.
Cet enthousiasme était fort réel. Les recettes montèrent au maximum ; Offenbach ne s’en désola pas trop d’abord ; il ne croyait pas à la durée de cette vogue. Mais il commença à devenir inquiet quand il les vit, après le premier mois, se maintenir au même chiffre. Ce succès le ruinait. Il avait fait tous ses engagements pour Orphée aux Enfers ; la pièce était sue, et il fallait payer cette troupe, dont il ne pouvait rien faire ; car il n’y avait pas moyen d’enlever de l’affiche une pièce qui faisait le maximum. Deux mois se passèrent, puis trois ; Offenbach n’y tint plus. Il fit mettre dans les journaux une petite note qui avertissait le public que Mlle Lia Félix, fatiguée d’avoir joué quatre-vingt-dix fois de suite un rôle aussi fatigant, avait besoin de repos ; le directeur se voyait donc, à son grand regret, obligé de retirer Jeanne d’Arc, qu’il se proposait de reprendre, quand l’actrice serait rétablie.
Je me rappellerai toujours la fureur de cette malheureuse Lia. Elle vint chez moi et se répandit en plaintes.
— Ah ! me disait-elle, il prétend que je suis lasse, que ma voix s’est altérée… Eh bien, écoutez !
Et de cette voix éclatante, dont la puissance et la vibration paraissaient d’autant plus merveilleuses qu’elle sortait d’un corps émacié et frêle, elle me lança à toute volée quelques vers de la grande tirade du dernier acte. Les vitres en tremblaient.
— Voilà, s’écriait-elle, voilà comme je suis fatiguée ! Voilà comme je ne peux plus jouer le rôle ! Mais je le jouerai cent cinquante fois, si l’on veut. C’est une abomination ! On n’a pas le droit d’étrangler une pièce en plein succès. Ça ne s’est jamais vu !
Et de ses yeux étincelant de colère, il jaillissait des larmes.
Je ne pouvais malheureusement rien à cette situation ; ni moi, ni personne. Charbonnier est maître au logis. Offenbach avait hâte de toucher les droits d’auteur d’Orphée aux Enfers. Il égorgea cette infortunée Jeanne d’Arc, dont la destinée, à ce qu’il paraît, est de sauver les gens et d’être brûlée en récompense.
M. Barbier avait toujours nourri l’espoir d’une revanche. Le nom de Jeanne d’Arc a grandi depuis tantôt vingt ans. Sa vie a été l’objet d’études nombreuses ; M. Joseph Fabre, qui a voué un culte de latrie à la noble et chaste héroïne, a publié coup sur coup trois volumes, où toutes les pièces de son premier procès et du procès de réhabilitation ont été traduites et accompagnées par l’écrivain de commentaires enflammés. Mgr Dupanloup a proposé Jeanne d’Arc comme candidate, en cour du Vatican, au titre de sainte ; M. Joseph Fabre a, du temps qu’il était député, demandé à la Chambre que l’anniversaire de la naissance de Jeanne fût déclaré fête nationale et se substituât au 14 Juillet. Le 14 Juillet a cet inconvénient d’exciter des défiances et des rancunes chez une partie de la population. La fête de Jeanne d’Arc réunirait dans un sentiment commun de reconnaissance les hommes de toutes les opinions et de toutes lus croyances. Ce serait la fête de la patrie.
Aux élections, dernières, je demandais a Joseph Fabre, s’il se représenterait à la députation :
— Non, me dit-il, je n’y avais voulu entrer que par amour pour Jeanne d’Arc, pour plaider sa cause devant l’Assemblée. Je suis sûr maintenant qu’elle sera gagnée un jour ou l’autre ; ce n’est plus qu’une affaire de temps.
La dévotion à Jeanne d’Arc n’a fait que croître durant ce quart de siècle. On a vu même un officier, M. Paul Marin, sous ce titre : Jeanne d’Arc tacticien et stratégiste, écrire un volume où il cherchait à prouver que cette illuminée était avant tout un grand capitaine et pouvait soutenir la comparaison avec les César et les Napoléon. Il est vrai que, d’un autre côté, un autre écrivain, M. Lesigne, composait sous ce titre : Fin d’une légende, un ouvrage où il prouvait, clair comme le jour, que Jeanne d’Arc n’avait point subi le martyre, qu’elle s’était échappée de prison et mariée. Mais ces débats ne montrent que mieux l’intensité de la préoccupation publique. Jeanne d’Arc à présent, pour nous, c’est la grande Lorraine, c’est la personnification de la patrie, c’est la sainte par excellence. On peut être sûr en portant au théâtre cette figure légendaire, d’y trouver une foule respectueuse et vibrante, qui croirait commettre, en n’applaudissant pas de tout son cœur, une manière de sacrilège.
M. Duquesnel cherchait un grand coup à frapper. Il avait passé en revue, dans Théodora et dans la Tosca, toutes les formes de talent que peut revêtir Mme Sarah Bernhardt ; il avait épuisé, sous les yeux du public, toute la gamme de ses procédés. Comment en renouveler la curiosité près de la foule ? Ce pauvre Joseph Fabre avait une Jeanne d’Arc en prose, écrite avec quel amour ! avec quelle conviction avec quelle sincérité ! Il y a quelque chose de touchant dans l’extraordinaire naïveté avec laquelle il a composé ce mystère. C’est un mélange singulier où l’on retrouve de l’enfant, du poète et de l’érudit ; mais ce qu’on y trouve toujours, c’est de l’amoureux, du dévot sincèrement et ardemment épris. Jamais on ne brûla de plus chastes feux pour la Pucelle, Et ne croyez pas que je raille : non, j’admire cette passion idéale, enthousiaste et tenace ; je l’admire et je l’envie. Il est très heureux, mon ami Joseph Fabre. Il a donné un but à sa vie, et un but désintéressé : le triomphe de Jeanne. Ne croyez pas que, s’il désire voir sa pièce jouée, ce soit chez lui gloriole ou espoir de fortune. Non ; c’est piété. Il voudrait que son drame montât comme un pur encens au paradis, d’où Jeanne d’Arc protège la France. Il voudrait s’évaporer lui-même en un subtil arôme de poésie pour la consoler et pour la réjouir. C’est un homme du moyen âge égaré dans le nôtre.
M. Jules Barbier est un librettiste de beaucoup de talent. Il avait coupé avec infiniment d’adresse dans la légende de Jeanne d’Arc les scènes qui prêtaient soit à un beau déploiement de spectacle, soit à l’explosion des sentiments héroïques, qui est naturelle sur les lèvres de Jeanne d’Arc. Il a encore simplifié son action, dans cette version nouvelle de son œuvre. Il l’a réduite rigoureusement à trois moments, divisés en plusieurs tableaux : la mission, le triomphe, le martyre c’est une sorte de triptyque sacré.
De ces trois moments, le premier et le dernier sont de beaucoup les meilleurs, et si j’avais une préférence à marquer, ce serait pour le premier. Le théâtre représente la chaumière de Domrémy. Le vieux Jacques d’Arc, est assis dans un grand fauteuil, songeur et triste près de l’âtre, et Jeanne file sa quenouille à quelques pas de lui. Lorsque, aux premières plaintes du bonhomme, Mme Sarah Bernhardt s’est retournée, disant : Mon père
, il y avait dans son regard limpide et profond, dans sa voix douce et nette, tant de naïveté, d’innocence grave et de poétique exaltation, que le public a été remué jusqu’au fond du cœur. Ce sont là de ces moments qui font pardonner toutes les défaillances, parce qu’ils sont d’une grande artiste.
Des paysans, chassés de leur village par la guerre et l’incendie, passent dans le fond. Jeanne les fait entrer avec la permission de son père ; son œil s’allume au récit des souffrances qu’ils ont endurées ; le vieux Jacques la gronde de l’intérêt qu’elle paraît prendre à des choses qui ne regardent pas une petite fille comme elle. Depuis longtemps ses allures l’inquiètent. Il voudrait la marier, pour détacher sa pensée des chimères et la tourner vers des occupations plus pratiques. Il a fait choix de Thibaut, un brave garçon qui l’aime et l’a demandée en mariage.
Le père les laisse ensemble. Et Jeanne, avec une fièvre mêlée de je ne sais quel effroi mystérieux, lui conte les voix qu’elle a entendues, les apparitions des saintes qui lui ordonnent de conduire le roi à Reims et d’arracher aux Anglais le pays de France. Il y a déjà quelque temps que les saintes ne lui ont parlé si elles l’ont oubliée, c’est qu’elles n’ont plus besoin d’elle ; elle obéira à son père. Mais il faut qu’elle prie encore et consulte. Elle tombe à genoux, et le fond du théâtre s’ouvre ; les saintes se dressent dans l’éloignement elles parlent à Jeanne, ou plutôt elles chantent. Quelle parole ici pourrait valoir la musique ?
On a dit que Jeanne d’Arc était un mystère ; c’est aussi un oratorio ; c’est une façon d’opéra, La musique y a nécessairement sa part ; non pas seulement une musique de scène, accompagnant en sourdine les paroles des personnages, mais une musique de chant. Ainsi tout à l’heure, les paysans réfugiés chez le vieux Jacques d’Arc n’ont pu exprimer leur douleur collective qu’à l’aide d’un chant qui est d’ailleurs fort pathétique. Les deux saintes s’adressent à Jeanne elles chantent ce qu’elles ont à lui dire, tandis qu’un chœur invisible jette de temps à autre un appel impérieux et tendre sur une même note : Jeanne ! Jeanne !
Et Mme Sarah Bernhardt, à genoux, s’avançant vers elles comme si elle était entraînée, les bras tendus, par une puissance supérieure, les écoute, le regarde ravi, les lèvres ouvertes comme dans une extase, le visage rayonnant ; elle est admirable, et je ne sais rien de plus beau, de plus émouvant, de plus pathétique que cette scène. Il est impossible de la voir sans être touché jusqu’aux larmes. Ah ! quel malheur que les vers soient d’un versificateur excellent et non d’un grand poète ! Mais il n’y a pas de bonheur parfait dans ce monde.
Tout le second acte languit un peu. Nous sommes à la cour du roi Charles VII. Sa maîtresse Iseult s’entend avec son trésorier pour le retenir et l’accompagner à des fêtes où il perd gaiement son royaume. Mlle Méa est une fort jolie favorite ; Deneubourg, qui représente le roi, ne manque pas de désinvolture ni d’élégance et Bouyer, qui joue La Hire, rabroue de très verte façon et son roi et la maîtresse de son roi. Mais toute cette peinture du désordre de la cour est très pâle ; le librettiste n’a point paru songer qu’il y avait là matière à contraste, et qu’il eût fallu relever ce tableau de touches égayantes, ne fût-ce que pour reposer des extases de Jeanne d’Arc.
Jeanne arrive ; on la laisse à examiner à Iseult, qui est animée contre elle des sentiments les plus hostiles ; elle la retourne, et c’est Iseult elle-même qui plaide près du roi la cause de la France. La Hire, le farouche soudard est converti lui-même ; le roi se mettra à la tête de ses troupes ; on ira secourir Orléans, sous la conduite de Jeanne. Il y avait là dans la première version un chœur de Gounod, chanté par toutes les voix : Dieu le veut ! On a préféré la donner à dire à Mme Sarah Bernhardt qui le lance à pleins poumons, tandis que la musique l’accompagne, pour me servir de l’expression technique, en mélodrame.
Le succès de ce morceau a été immense. J’aurais mauvaise grâce à ne pas le reconnaître. Mais après avoir constaté l’opinion du public, opinion certaine, et qui n’était nullement frelatée ici par l’adjonction de la claque, il m’est bien permis de donner mon impression personnelle. Mme Sarah Bernhardt n’a pas la voix de ces Marseillaises. Elle est obligée de l’enfler, de la grossir, et d’altérer ce contour des syllabes. Écoutez-la dans le couplet elle crie à tue-tête, et l’on n’entend pas distinctement tous les mots. Elle était, dans le premier acte, ravissante de douceur extatique ; elle est inquiétante, dans ce passage de force ; on craint que son organe ne se rompe.
C’est que, voyez-vous, on a beau faire, on a beau être une grande artiste, on ne change pas la nature de son talent. Mme Sarah Bernhardt était douée à merveille pour jouer les Bérénice, les Monime, les Maria de Neubourg ; elle a pu ajouter à son talent primordial quelques cordes plus ou moins voisines il lui a toujours été impossible de rendre le quatrième acte de Phèdre, et, en dépit des acclamations qu’elle a soulevées, je crains qu’elle n’outrepasse les limites qui lui sont imposées par la nature, quand elle prétend jeter un air de guerre et tirer d’une harmonieuse flûte des éclats de trompette.
Le troisième tableau est presque tout entier donné au compositeur. Nous sommes sous les murs d’Orléans. Il y avait là autrefois un ballet de ribaudes, dont quelques détails nous avaient choqués, mais dont la musique nous avait semblé très originale. Il a complètement disparu. Il ouvre par une fort jolie chanson, que chante avec beaucoup de brio Mme Nesville, qui nous avait déjà, à l’acte précédent, chanté avec grâce un lai d’amour. Il se termine par un chœur guerrier. Dans l’intervalle, M. Jules Barbier nous a fait assister aux conseils des vieux capitaines, Dunois, La Hire, Xaintrailles, qui, ne comprenant rien à la puissance de l’enthousiasme, ne voulaient point que l’on attaquât. Mais Jeanne d’Arc enflamme le peuple des soldats.
— Vous me suivrez ? leur crie-t-elle.
— Oui, oui, répondent-ils tous ensemble.
— Nous sommes débordés, fait observer Xaintrailles.
La réflexion est juste ; elle n’est d’aucun effet au théâtre. C’est qu’à vrai dire on n’a pas vu la foule, bien qu’elle soit honnêtement figurée par un certain nombre de comparses. Il n’y a rien de plus difficile que de transporter à la scène (sans le secours de la musique), les sentiments collectifs, et de leur donner une expression qui frappe. L’artifice ordinaire du poète dramatique est de les personnifier dans un homme, qui ramasse en lui toutes les passions de la foule et qui les déploie dans le drame. Mais cet artifice n’est guère de mise en un sujet comme celui-ci. Jeanne d’Arc est elle-même une personnification de l’enthousiasme populaire. Si h côté d’elle vous créez un personnage qui rassemble en lui les passions du peuple, il fera double emploi avec elle ; il ne sera qu’un pâle reflet, qu’un écho. Il faut donc absolument mettre la foule en scène et lui donner une voix. Mais je ne sais guère que Shakespeare au monde qui ait su manœuvrer une foule sur la scène et l’y faire parler. Et encore n’y a-t-il réussi que dans deux ou trois scènes que l’on cite toujours. Dans la Jeanne d’Arc de Barbier, les comparses ont beau crier : Oui ! oui ! ou encore : Tous ! tous ! on n’a pas la sensation d’un peuple tout entier, transporté d’enthousiasme, et, comme on s’exprimerait aujourd’hui, suggestionné. Xaintrailles fait bien de dire : Nous sommes débordés
, car, sans ce mot, personne ne s’en fût douté dans la salle.
Le tableau suivant nous montre le sacre du roi dans la cathédrale de Reims. C’est une fort belle mise en scène, plus somptueuse encore que réellement belle, mais d’un grand effet. Tandis que les cérémonies s’accomplissent aux sons de la musique sacrée, Jeanne se tient debout et sur le devant de la scène, son étendard à la main. Après que le roi a prêté serment, il lui fait signe d’avancer et de se mettre à genoux ; il tire son épée, l’étend sur sa tête et lui donne l’accolade. Il n’y a rien d’autre dans cet acte, qui n’est qu’un magnifique spectacle.
Il me semble que, dans la version primitive, c’est là que Jeanne revoyait son vieux père et ses frères, et les embrassait en pleurant. La scène, si j’ai bonne mémoire, était fort pathétique, et elle avait ce mérite de rappeler le bon cœur de Jeanne, qui, au milieu de sa gloire et en plein triomphe, n’avait point oublié son humble origine et avait gardé la même tendresse pour les lieux où s’était écoulée son enfance. Je ne sais pourquoi on l’a retranchée, car il me semble que Mme Sarah Bernhardt en eût tiré grand parti.
Nous voici arrivés au troisième moment de l’action : le sacrifice.
Le rideau se lève sur la prison où est enfermée Jeanne. Elle dort au fond sur une espèce de lit de camp. Des soudards occupent le devant du théâtre, causant, riant, buvant. On nous conte en quelques vers rapides comment elle a été prise et livrée aux Anglais, qui veulent la faire condamner comme hérétique et sorcière. Puis les juges entrent, l’interrogent. M. Jules Barbier a été, dans cette scène, vraiment inspiré par la situation. Il a mis en beaux vers ces répliques, merveilleuses de simplicité, de bon sens, de fierté héroïque, d’esprit même, que nous a transmises la relation officielle du procès fait à Jeanne d’Arc. Il n’y a pas de Français qui puisse les entendre sans en être ému jusqu’au fond des entrailles.
M. Jules Barbier, usant de son droit de poète, a mis ici dans la bouche de Jeanne un grand couplet où elle parle avec amour et fierté de cette indestructible nation française qui se relève toujours de ses chutes les plus profondes et tire de ses revers le meilleur de sa gloire. La tirade est admirable, d’un beau souffle patriotique, et je regrette de n’avoir pas la brochure sous les yeux pour en citer quelques vers, car M. Barbier a été dans ce passage supérieur à lui-même.
L’effet du morceau a été grand l’autre soir ; combien plus vif en 1873 ! Songez donc nous sortions à peine de cette terrible guerre, si féconde en désastres ! Avec quelle émotion on écoutait ces beaux vers, qui nous disaient que la France n’avait été que blessée, qu’elle n’était point morte, qui nous consolaient de nos revers en faisant luire à nos yeux l’espoir du relèvement et de la revanche ! Comme il était facile de faire vibrer nos âmes, en touchant cette corde.
Et puis l’actrice, qui jouait en ce temps-là Jeanne d’Arc, c’était Mlle Lia Félix, la sœur de Rachel. Oh ! Mlle Lia Félix n’était pas bonne partout ! Cette nature maigre, un peu sèche, dont la voix n’avait rien de mouillé ni de tendre, n’était pas faite pour rendre les extases du premier acte. Elle n’avait ni l’organe assez riche, ni le débit assez nuancé pour varier la monotonie d’un héroïsme uniformément guerrier. Mais au dernier acte, à ce couplet, de ce corps si chétif, qu’on eût dit brûlé d’enthousiasme, s’échappait une voix plus éclatante que le son de la trompette, une voix métallique, toute pleine de sonorités vibrantes, qui secouaient le public et l’emportaient.
Et quand le juge lui reproche que son étendard est ensorcelé et qu’elle répond que sa seule sorcellerie était de le prendre en main et de marcher en avant :
Je leur criais : Entrez ! Et j’entrais la première.
avec quelle énergie elle lançait ce vers je vois encore ses yeux étinceler dans son visage troué de petite vérole. La salle tressaillait tout entière.
Mme Sarah Bernhardt ne peut atteindre à ces effets d’intensité son organe ne se prête pas à ces déploiements de vigueur. Comme la tirade est superbe, comme elle l’a dite avec une émotion très sincère, bien qu’en forçant sa voix, comme elle se nomme Sarah Bernhardt, elle a été furieusement applaudie à ces passages.
Et ce n’est pourtant pas là qu’elle est la meilleure. Où elle est incomparable, c’est dans la grâce poétique de la personne. Elle a des attitudes d’une fierté et d’un charme inouïs. Tous ses gestes sont d’une irréprochable justesse et d’une élégance merveilleuse. Elle est Jeanne, la Jeanne rêvée par nous, et elle l’est à tous les moments, sans efforts ni grimaces. Oui, la légende a pris corps. Voilà ce qui est admirable chez elle, et comme on ne peut applaudir une science de composition qui se répand sur tout le rôle et le pénètre, on est bien obligé, si l’on veut témoigner de son admiration, de choisir les passages où il semble qu’elle ait voulu elle-même provoquer l’applaudissement. J’ai donc fait comme les autres j’ai battu des mains aux endroits qu’elle a marqués, sans être convaincu que j’étais dans le vrai. La diction, chez Mme Sarah Bernhardt, a beaucoup perdu de sa netteté et de sa variété. Mais à quoi bon chicaner ? Jouissons de ce qui reste. Après tout, si elle ne donne plus comme autrefois la sensation du parfait et de l’exquis, elle a encore de quoi enlever une foule et séduire les plus délicats.
Au dernier tableau, nous voyons Jeanne conduite au bûcher. M. Jules Barbier a mis en action les vers de Casimir Delavigne qui sont dans toutes les mémoires.
Au pied de l’échafaud, sans changer de visage
Elle avançait à pas lents.
Tranquille, elle y monta ; quand debout sur le faîte,
Elle vit ce bûcher qui l’allait dévorer,
Les bourreaux en suspens, la flamme déjà prête,
Sentant son cœur faillir, elle baissa la tête
Et se prit à pleurer.
Ces pleurs, ces gémissements, que la crainte du feu arrache à Jeanne ont été rendus de la façon la plus douloureuse par Mme Sarah Bernardt, et la soirée s’est achevée dans un triomphe.
Il n’y a pas grand-chose à dire des artistes qui ont prêté leur concours à Mme Sarah Bernhardt. Leurs rôles sont bien sacrifiés. J’ai déjà parlé de quelques-uns, chemin faisant. Il faut louer encore M. Léon Noël, qui donne au père de Jeanne beaucoup de bonhomie et d’onction. Il faut citer aussi les noms des deux saintes qui chantent au premier acte la musique de Gounod ce sont Mlles Valbré et Pacini. Elles ont une fort belle voix de contralto et ont chanté avec beaucoup de correction et de pureté.
La Jeanne d’Arc de Jules Barbier aura, je crois, beaucoup de succès. C’est un spectacle que l’on peut voir en famille. On pourra, avant d’y mener les jeunes filles, leur donner à lire le récit de Michelet et mettre entre les mains des jeunes gens les volumes de Joseph Fabre. Ils en verront la pièce avec plus de plaisir et de fruit.
Je devrais vous parler de la pièce nouvelle que l’on a donnée aux Nouveautés. Mais j’ai été cloué depuis dix jours à la chambre par une bronchite obstinée et n’ai obtenu permission de sortir que pour voir Mme Sarah Bernhardt dans Jeanne d’Arc. Je ne pourrai donc vous parler de la Grande Vie que la semaine prochaine. La pièce est de MM. Henri Bocage et Pierre Decourcelle.
Il y a eu aussi des représentations intéressantes à la Comédie-Française. Ainsi Coquelin a repris dans l’Aventurière et, m’a-t-on dit, avec beaucoup d’éclat son rôle de don Annibal. On a remis aussi à la scène Oscar ou le Mari qui trompe sa femme de Scribe. Ce sera pour un prochain feuilleton, car je suis à peu près sur pied. Il nous souviendra de cette fin d’année de 89 et de l’influenza
.
Vert-Vert, 6 janvier 1890
Extrait des Nouvelles.
Lien : Retronews
Le succès de Jeanne d’Arc est bien ce que nous avions prévu.
Hier samedi, il y avait foule, plus que foule, encombrement, pourrions-nous dire, au bureau de location, et dans cette première journée, le chiffre de location réalisé d’avance atteint vingt-mille francs.
Quand au succès personnel de Sarah Bernhardt, il dépasse tout ce qu’on peut imaginer ; la grande artiste, rappelée indéfiniment après chaque acte et exténuée de fatigue, a dû demander grâce au milieu des applaudissements du public et des fleurs qu’on lui jetait de tous côtés.
Vert-Vert, 7 janvier 1890
Extrait des Nouvelles.
Lien : Retronews
En deux jours, samedi et dimanche, les représentation de Jeanne d’Arc ont réalisé plus de trente mille francs de recettes.
La représentation de dimanche a été particulièrement curieuse et animée ; tout naturellement, il y avait salle comble à craquer, et le public populaire a manifesté son enthousiasme par des bravos ininterrompus, rappelant la grande artiste jusqu’à quatre et cinq fois, après chaque acte, et surtout après le cinquième tableau (la prison), dont l’effet a été indescriptible.
Sarah Bernhardt, bien qu’un peu fatigue par ces cinq représentations données en trois jours, n’a pas eu un moment de défaillance et a joué avec autant d’énergie qu’à la première ; et comme on lui disait de ménager ses forces, elle a répondu :
Écoutez le public, il ne se ménage pas. J’ai Je devoir de faire comme lui et de ne pas me ménager non plus.
Extraits d’articles d’autres journaux après la première : Opinion de la presse sur Jeanne d’Arc
(1/3)
Le Figaro.
L’effet de cette soirée a été immense, et il n’y a pas à craindre d’en exagérer l’intensité. Le public en était arrivé à cet état physiologique dans lequel personne, pas même le plus sceptique, ne cherche plus à dissimuler son frémissement et ses larmes.
[…] L’œuvre de M. Jules Barbier n’est plus à juger, et tout le monde en reconnaît les grands et solides mérites, qui sont la parfaite intelligence du sujet, le souffle patriotique et la sincérité.
[…] Et maintenant que dirai-je de Mme Sarah Bernhardt, sinon qu’elle a été l’initiatrice de cette glorieuse reprise comme elle en est l’âme, l’irrésistible force et le succès triomphal ? Tour à tour douce avec l’humble jeune fille, vaillante et impérieuse comme chef d’armée, l’héroïne redevient femme devant la souffrance, et pleure comme un enfant. Toutes ces nuances ont été savamment étudiées et rendues par Mme Sarah Bernhardt.
Auguste Vitu.
[L’article en entier : Le Figaro, 4 janvier.]
Le Gaulois.
Mme Sarah Bernhardt n’a pas eu une faiblesse. Elle n’a pas cessé d’être l’héroïne inspirée, toujours sereine et toujours anxieuse, écoutant les paroles des hommes et les chants des saintes, mêlant sa voix aux cantiques des fidèles, vivant comme Jeanne vivait, entre le ciel et la terre.
Le maître Gounod a écrit seize morceaux pour Jeanne d’Arc. Je ne me permettrai pas de juger sur une simple audition une œuvre si importante. […] Mais j’ai l’impression que ces mélopées séraphiques, ces murmures, ces plaintes notées par le plus poète des maîtres musiciens contribuent dans une large proportion à nous faire perdre terre et à nous emporter aux régions indécises où le rêve continue la réalité.
Hector Pessard.
[L’article en entier : Le Gaulois, 4 janvier.]
L’Autorité.
Jeanne d’Arc est bien la véritable héroïne française, et aucun sujet n’est plus attrayant que celui de l’histoire de cette noble fille, inspirée par les voix d’en haut et poussée par une force mystérieuse à abandonner son village et à courir auprès de son roi pour le sauver en même temps que sa patrie du péril dont les menace l’ennemi.
[…] Tous les rôles sont insignifiants à part celui de Jeanne, tâche écrasante que Mme Sarah Bernhardt a entreprise et qu’elle accomplit courageusement.
La scène de la prison a été splendide, elle a pu y déployer son grand talent de tragédienne et elle s’est vu rappeler frénétiquement à six reprises différentes.
Valère.
Le XIXe siècle.
[…] La Jeanne d’Arc de M. Barbier a, d’ailleurs, des mérites de pittoresque plastique très supérieurs à ceux de la tragédie classique de Soumet, pleine de déclamations. C’est par le pittoresque aussi, l’allure, l’attitude, que Mme Sarah Bernhardt s’est d’abord montrée excellente, ce soir, dans ce très lourd rôle de l’héroïne française.
Elle a apporté là ce sens artistique indéniable qui fait qu’elle intéresse toujours, alors même qu’on n’approuve pas tout de son jeu. Cette impression d’art emporte tout.
Henry Fouquier.
(À suivre.)
Le Figaro, 8 janvier 1890
Souscription pour une statue de Jeanne d’Arc à Vaucouleurs.
Lien : Gallica
Mgr Pagès, évêque de Verdun, profite très à propos du courant d’opinion qui porte aujourd’hui la France vers Jeanne d’Arc pour commencer, dans son diocèse et dans tous ceux du pays, une croisade sans danger d’ailleurs pour ceux qui la suivront : il s’agit simplement d’une souscription nationale dont l’Observateur français nous indique l’objet :
La chapelle castrale se relèvera de ses ruines et reprendra sa forme du quatorzième siècle. Au sommet de la colline qu’occupait le château de Baudricourt, à la place même où elle fut armée chevalier, Jeanne apparaîtra sur un socle gigantesque, coulée dans le bronze, l’épée à la main, entourée des hommes d’armes qui l’accompagnaient à Chinon. Il faut que le moment soit grandiose ; c’est à la France entière que je veux le demander, écrit l’évêque de Verdun, et la France ne peut faire ni petit ni mesquin.
Il y a un mois environ, j’étais à Rome et je soumettais mon vaste projet au Souverain-Pontife [Léon XIII]. Le Souverain-Pontife l’approuvait, le bénissait, l’encourageait avec cette bienveillance tendrement paternelle qu’on est toujours sûr de rencontrer chez lui quand on lui parle de Jeanne d’Arc et de la France. Cédant à mes instances filiales un peu audacieuses, Sa Sainteté m’accordait un Bref qui recommande l’œuvre de Vaucouleurs à la générosité de tous les catholiques français.
Il peut aussi compter sur la souscription de Mme Sarah Bernhardt et de M. Duquesnel ; ils seraient bien ingrats s’ils ne rendaient pas cet hommage à l’héroïne qui leur vaut à tous deux un éclatant succès.
Vert-Vert, 8 janvier 1890
Extrait des Nouvelles.
Lien : Retronews
À l’issue de la première représentation de Jeanne d’Arc, le correspondant du New-York Herald envoyait à Londres et à New-York, où se publient les deux éditions simultanées du célèbre journal américain, une double dépêche de quatre-mille mots, et, le lendemain 4 janvier, au moment même où les journaux parisiens publiaient leur compte-rendu, un article de six colonnes sur cette même représentation paraissait, en même temps, à Londres et a New-York.
Ce même jour, vers les trois heures, sur le vu de l’article du Herald, qui constatait l’immense succès de la représentation, le directeur de la Porte-Saint-Martin recevait une dépêche d’un impresario de New-York demandant d’acheter décors, costumes et matériel complet de mise en scène, pour des représentations à donner en Amérique…
Voilà ce qu’on peut appeler agir électriquement
.
M. Louis Pister, qui a organisé l’exécution de la partie musicale et formé les chœurs et l’orchestre de Jeanne d’Arc, vient d’être nommé officier d’académie.
Extraits d’articles d’autres journaux après la première : Opinion de la presse sur Jeanne d’Arc
(2/3)
La France.
Après cela, vais-je prendre une loupe pour examiner si, dans l’ensemble du rôle, je ne découvrirais pas quelques faiblesses ? Je n’en veux rien savoir. Je m’en tiens au charme que j’ai subi, à l’émotion que j’ai éprouvée et que je croirais gâter en épiloguant sur les petits détails. Indépendamment de mon impression personnelle, j’ai encore dans les oreilles et dans les yeux le grisement de toute une salle se levant dans un élan d’acclamation et rappelant quatre ou cinq fois de suite, après la scène de la prison, l’admirable et triomphante tragédienne.
Ch. Gilbert-Martin.
Le Soleil.
La musique de Gounod, surtout dans le premier tableau (les Voix du ciel) et dans l’introduction, est très distinguée et très noble.
[…] La soirée a été belle pour la Porte-Saint-Martin et pour Mme Sarah Bernhardt. Le théâtre et l’actrice ont remporté, tous les deux, un très brillant succès.
[…] Somme toute, Jeanne d’Arc est une chose à voir. C’est un opéra d’une grandeur simple et d’une émotion profonde, bien monté et interprété par une artiste de génie.
Émile Faguet.
L’Écho de Paris.
Ces images naïves et émouvantes, qui réveillent en nous les nobles ardeurs endormies. affectent une forme accessible à tous ; les enfants et les jeunes tilles s’éprendront à cette revue mystique comme à un magnifique conte de fées.
[…] En pleine possession de son génie, la superbe artiste, Mme Sarah Bernhardt, parvient à l’émotion et à l’effet intense par le naturel et la simplicité. C’est d’un art achevé et puissant. Quant à ses moyens d’expression, jamais ils ne furent plus vibrants, plus éclatants.
[…] Son succès, grandissant d’acte en acte, s’est terminé en triomphe éclatant. Heureux Barbier ! Heureux théâtre !
Henri Bauër.
Le Matin.
Il n’y a pas de spectacle plus beau que celui-là.
[…] Disons tout d’abord que le succès de Mme Sarah Bernhardt a été immense. Impossible d’être plus simple, plus touchante, plus soumise, plus fière, d’avoir en même temps plus d’innocence champêtre et plus de sublimité extatique.
[…] M. Gounod, dont l’intelligence artistique est faite pour admettre la part secondaire que la musique pouvait prendre dans ce mystère, a écrit une partition discrète et religieuse qui n’intervient que que quand il faut, dont l’expression mystique est très en rapport avec la situation, et qui produit un effet absolument saisissant.
Le Temps.
Où [Sarah Bernhardt] est incomparable, c’est dans la grâce poétique de la personne. Elle a des attitudes d’une fierté et d’un charme inouïs. Tous ses gestes sont d’une irréprochable justesse et d’une élégance merveilleuse. Elle est Jeanne, la Jeanne rêvée par nous, et elle l’est à tous les moments, sans efforts, ni grimaces.
[…] La Jeanne d’Arc de Jules Barbier aura, je crois, beaucoup de succès. C’est un spectacle que l’on peut voir en famille. On pourra, avant d’y mener les jeunes filles, leur donner à lire le récit de Michelet et mettre entre les mains des jeunes gens les volumes de Joseph Fabre. Ils en verront la pièce avec plus de plaisir et de fruit.
Francisque Sarcey.
La Liberté.
Maintenant, qu’adviendra-t-il de cette tentative si courageuse, si soignée et vraiment si belle ? Le succès récompensera-t-il la passion de Mme Sarah Bernhardt et les efforts de la direction de la Porte-Saint-Martin ? Le public se laissera-t-il gagner par cette résurrection du grand art
— toujours pour parler comme ce voltigeur
d’un autre temps, que j’ai déjà cité ?
Je l’espère ; j’ai même envie de le croire.
Paul Perret.
L’Événement.
Si la seconde partie est la plus remarquable des trois au point de vue décoratif, la troisième partie est la meilleure au point de vue dramatique. M. Barbier suivant son système, s’est borné a mettre en vers la plupart des discours et réponses historiques de Jeanne d’Arc à ses juges. Et il est certain qu’un poète ou même un dramaturge n’aurait pu trouver mieux.
Mme Sarah Bernhardt a composé avec amour, je pourrais presque dire avec piété, le rôle de Jeanne d’Arc. — Si elle ne personnifie guère l’illuminée de Domrémy, telle que l’a reconstitué Bastien Lepage, elle est superbe, comme la Jeanne de Frémiet dans l’acte du triomphe est adorable de charme, d’éloquence et de farouche énergie dans son glorieux martyre.
Rarement nous avons vu public plus enthousiaste et artiste plus fêtée.
[…] La partie musicale est très artistiquement réglée.
Louis Besson.
Paris.
J’ai dit la pompe du spectacle ; il ne reste donc plus qu’a souhaiter — souhait qui serait superflu sans l’influenza ! — que le succès soit prolongé, durable. Voilà le genre de théâtre qui me plaît et que je voudrais voir donner des fruits abondants, afin que tous les directeurs fussent amenés à le pratiquer, par intérêt.
Henri de Lapommeraye.
Le Mot d’ordre.
Un des principaux mérites de la Jeanne d’Arc d’hier est certainement son heureuse sobriété d’exécution. De la merveilleuse odyssée de la Pucelle, l’auteur n’a extrait que les incidents principaux, élaguant avec soin tous les faits accessoires de la légende.
[…] Avec Sarah Bernhardt, le triomphe n’était pas douteux : il a donné plus encore qu’on ne pouvait espérer. Grâces lui en soient rendues par l’heureux auteur !
Alfred Dubrugeaud.
(À suivre.)
Vert-Vert, 9 janvier 1890
Extraits d’articles d’autres journaux après la première : Opinion de la presse sur Jeanne d’Arc
(3/3)
Lien : Retronews
L’Estafette.
Enfin, pour terminer, nous adresserons à M. Duquesnel toutes nos félicitations pour sa remarquable mise en scène digne en tous points de l’éminente artiste que nous avons applaudie, hier, quatre heures durant.
Tous les décors sont de petits chefs-d’œuvre.
Les costumes, dessinés par M. Thomas, sont très réussis.
Voilà Jeanne d’Arc partie pour le succès, nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite et, n’en déplaise aux démolisseurs de gloire, si elle n’avait jamais existé il eût fallu l’inventer.
L’Angely.
Intransigeant.
L’histoire ainsi dramatisée par le poète ne manque ni d’intérêt ni même de conviction, et les vers ont de la chaleur et de la fermeté.
Mme Sarah Bernhardt a été superbe dans les différentes phases dramatiques. Quelle merveilleuse artiste, et comme elle est organisée pour comprendre, sentir, rendre et dominer partout où il lui plaît de paraître.
Quant à M. Duquesnel, il a monté Jeanne d’Arc avec sa magnificence habituelle ; il a appelé à lui ces décorateurs merveilleux qu’on appelle Rubé, Chaperon, Jambon, Lemeunier, Amable et Gardy, et ils ont fait des merveilles.
On ne saurait rien imaginer de plus beau que l’intérieur de la cathédrale de Reims, de MM. Lavastre et Carpezat.
Il semble enfin que tout est réuni à la Porte-Saint-Martin pour un succès incontesté et durable.
Don Blasius [Georges Meusy].
Le Siècle.
Le, drame de M. Jules Barbier, que la Porte-Saint-Martin a repris hier soir, est peut-être celui où l’histoire et la légende sont le plus respectées.
Le plus grand nombre des spectateurs d’hier connaissait les vers de M. Barbier et la musique de M. Gounod, mais la grande attraction de la soirée c’était la prise de possession par Mme Sarah Bernhardt du rôle créé jadis par Mlle Lia Félix.
La grande tragédienne désirait beaucoup, paraît-il, composer cette merveilleuse figure, qui tient la fois de la légende et de l’histoire.
L’heure me presse et je dois me borner à dire que la tentative a pleinement réussi, Mme Sarah Bernhardt a soulevé à maintes reprises l’enthousiasme du public des premières, d’ordinaire assez froid.
La mise en scène est somptueuse, et la musique empreinte du sentiment mystique qu’on trouve dans les œuvres de M. Gounod. Telle que vient de la monter M. Duquesnel, avec Mme Sarah Bernhardt, la Jeanne d’Arc de M. Barbier fournira, je crois, une carrière longue et fructueuse à la Porte-Saint-Martin.
Le Petit Parisien.
M. Jules Barbier, lui, s’est borné à suivre la légende dans sa version, et c’est l’épopée de la guerrière qu’il a présentée dans les six tableaux qui vont de Domrémy (où il a rendu visibles au spectateur les apparitions, les voix
) jusqu’à Rouen, en passant par Chinon, Orléans et Reims.
Mme Lia Félix, en 1873, s’était taillé un grand succès personnel dans le rôle de Jeanne. Mme Sarah Bernhardt y a mis sa marque, et elle l’a joué avec toutes les ressources de son art, avec le lyrisme et la virtuosité qu’on pouvait attendre d’elle. Elle a communiqué plus d’une fois à la salle un élan d’enthousiasme.
Le Parti National.
Mme Sarah Bernhardt a remporté hier un des plus beaux triomphes de sa carrière. Le public l’a acclamée de huit heures à minuit ; chacun des tableaux du drame a été suivi d’une enthousiaste ovation.
Ovations méritées ; enthousiasme justifié. Mme Sarah Bernhardt a composé avec amour le doux personnage de la Pucelle ; elle en a rendu tous les aspects avec un égal bonheur.
Adolphe Brisson.
Le Moniteur universel.
En somme, un grand succès de toutes manières, dont la plus grande part revient à la principale interprète, aux décorateurs, aux costumes de M. Thomas, mais auquel il est juste d’associer pour tant les noms de Mlles Méa, Grandet et Avocat, de MM. Léon Noël, Bouyer, Rosny, Deneubourg, etc.
Des Tournelles.
Le Télégraphe.
La légende héroïque
de M. Jules Barbier, musique de Gounod, que la Porte-Saint-Martin a reprise hier soir répond aux exigences assez délicates de cette adaptation scénique de l’histoire de Jeanne d’Arc. De là son vif succès à la Gaîté, où elle a été représentée pour la première fois le 7 novembre 1873 sous la direction Offenbach.
[…] Cette interprète unique, c’est Mme Sarah Bernhardt, qui a remporté hier, suivant la phrase consacrée, un des plus beaux succès de sa carrière. On l’a acclamée d’acte en acte, de tableau en tableau. À huit heures, ovation ; à minuit, apothéose.
C. Le Senne.
Le Gil Blas.
Le public, qui avait suivi avec plus d’attention que de plaisir les quatre premiers tableaux, s’est échauffé tout à fait aux deux derniers et la représentation a fini au milieu des applaudissements de la salle entière.
[…] Madame Sarah Bernhardt a compris et rendu ce rôle difficile, en grande artiste qu’elle est, et, pendant les dernières scènes, elle a simplement été admirable de ferveur, d’intrépidité ingénue, de tendresse poignante.
Léon Bernard-Derosne.
La partition de Jeanne d’Arc, sans compter parmi les chefs-d’œuvre du musicien, est cependant une œuvre de haute valeur, où se reconnaît la main d’un maître. De la tenue la plus élevée, à travers laquelle perce souvent l’inspiration d’une rime émue et vibrante, elle est surtout d’une clarté constante et d’une rare abondance mélodique.
Th. Massiac.
Le Monde illustré, 11 janvier 1890
Lien : Gallica
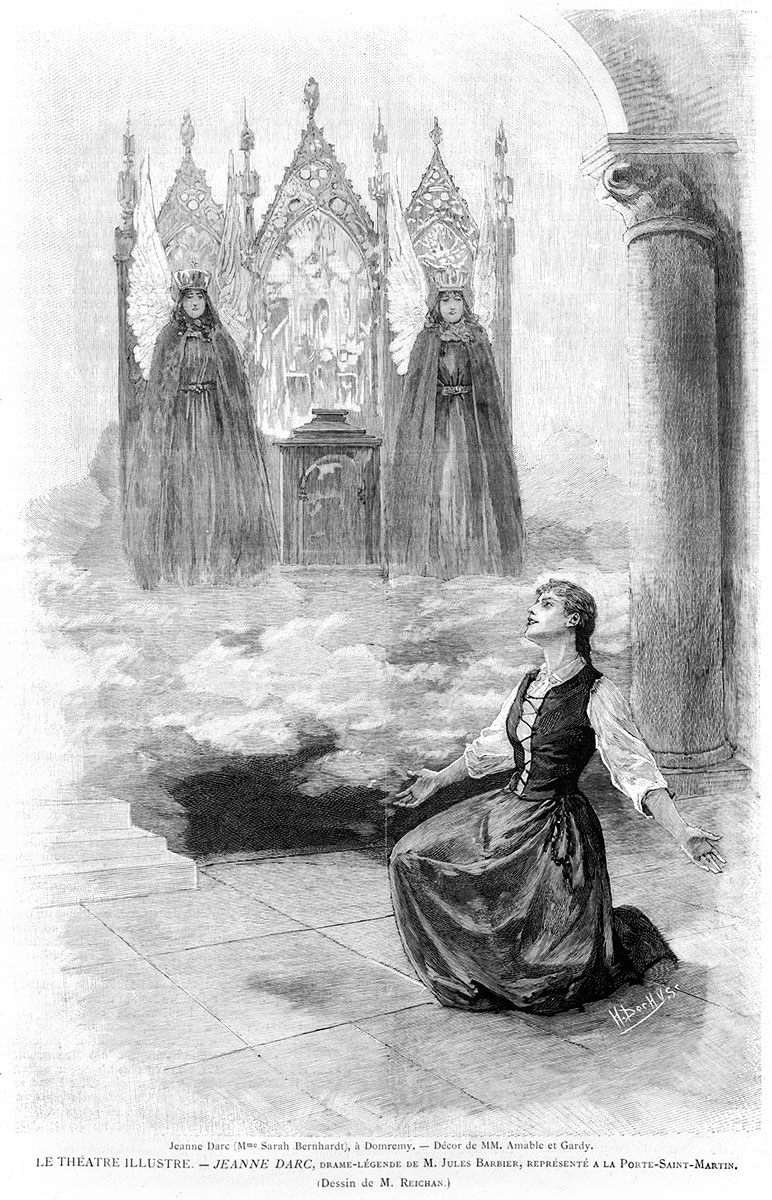
Extrait de la rubrique Théâtres, par Hippolyte Lemaire.
L’événement artistique de la semaine, c’est la représentation, au théâtre de la Porte-Saint-Martin de Jeanne d’Arc, drame-légende en trois parties de M. Jules Barbier avec les chœurs et la musique de scène de M. Charles Gounod.
La soirée a été triomphale et tout fait présumer que le succès de cette reprise dépassera de beaucoup celui qui accueillit à l’origine, en 1873, l’œuvre de MM. Barbier et Gounod.
D’ailleurs ce n’est point là, à proprement parler, une simple reprise, mais bien une version nouvelle de la pièce primitive, autant pour le poème que pour la musique de scène qui l’accompagne. M. Jules Barbier a resserré l’action, en la débarrassant scrupuleusement de tous les détails profanes et il l’a ramenée en quelque sorte à la simplicité hiératique des mystères du moyen âge. De son côté, le compositeur, dans le même sentiment mystique, a modifié sa partition à la façon d’un oratorio, d’une inspiration exclusivement religieuse. C’est une manière de spectacle sacré dont le caractère édifiant est incontestable et auquel on pourra conduire tout le monde, aussi bien qu’aux concerts spirituels du carême.
Sous cette nouvelle forme, le drame lyrique de Jeanne d’Arc a été divisé par M. Jules Barbier en trois parties qui représentent les trois phases de l’épopée de la vierge lorraine : la Mission, le Triomphe, le Martyre. Ces trois tableaux retracent toute la légende héroïque en une sorte de triptyque grandiose d’où l’admirable figure de Jehanne la Pucelle se détache, idéale et pure, éclairée tour à tour par le rayonnement des apparitions célestes, par la gloire du couronnement à Reims, enfin par les lueurs sinistres du bûcher de Rouen.
Le rideau se lève sur la chaumière de Jacques d’Arc, le père de Jeanne, à Domrémy. La famille vient de terminer le repas du soir. Par la porte entrouverte, on voit passer à travers la campagne des groupes de paysans, chassés par la guerre et fuyant devant l’envahisseur. Ils exhalent leurs plaintes d’exilés en un chœur d’un grand caractère mélancolique : Nous fuyons la patrie !
À ces accents l’âme de Jeanne frémit de douleur patriotique. Elle révèle à son fiancé Thibaut les visions qui la poursuivent et les voix qu’elle entend depuis plusieurs années. C’est l’archange saint Michel, ce sont les saintes Marguerite et Catherine, qui lui ordonnent, au nom du roy du ciel de voler au secours du roy de France et de sauver la patrie : Va, fille de Dieu, va !
Thibaut l’écoute, interdit, lorsqu’une rumeur l’attire au dehors : ce sont des bandes armées qui pillent le village. Il s’élance à la tète des paysans. Pendant qu’il est parti, une jeune fille, Mengette, accourt essoufflée dans la chaumière : elle est poursuivie par un reître et vient se réfugier dans les bras de Jeanne d’Arc. Celle-ci, une faucille à la main, la protège contre le soldat, ivre de fureur, qui a tiré son épée, mais qui se trouve désarmé au premier contact. À ce signe miraculeux, Jeanne comprend qu’elle ne doit plus hésiter, qu’il lui faut obéir à l’ordre divin. Restée seule, elle tombe à genoux et prie ardemment.
L’extase arrive aussitôt. Le fond du théâtre s’illumine peu à peu, et, comme dans un vitrail flamboyant, les saintes apparaissent resplendissantes en une clarté d’or, les voix célestes se font de nouveau entendre : Va, fille de Dieu, va !
Jeanne se traîne sur les genoux, les mains tendues, ravie, mais luttant encore. Puis, comme entraînée par une puissance supérieure, irrésistible, elle se lève au milieu de son rêve, l’œil agrandi et fixe ; avec la démarche raidie d’un automate, elle se dirige vers la porte. Là, elle s’arrête un instant et demande pardon à son père de lui désobéir. Puis, à travers l’huis entre-bâillé, elle se glisse comme un fantôme et disparaît dans la nuit.
Mais à quoi bon vous raconter la pièce ? Je vous l’ai dit, c’est la légende elle-même, suivie pas à pas ; c’est, couplet à couplet, l’héroïque chanson de gestes
relatant les hauts faits
… de Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu’Anglois bruslèrent à Rouen !
Nous voyons Jeanne à Chinon, convainquant de sa mission divine le peuple, les seigneurs, la gente favorite du dauphin la belle Iseult de Loré,et enfin le dauphin lui-même dont elle devine miraculeusement les plus secrètes pensées.
Nous l’admirons aux portes d’Orléans, son étendard à la main, électrisant les troupes de son ardeur guerrière, puis radieuse et triomphante dans les splendeurs du couronnement à Reims. Enfin la voici prisonnière des Anglais, raillée, maltraitée, insultée par ses mortels ennemis, et bientôt après condamnée et livrée aux flammes du bûcher sur la place du Vieux-Marché en la ville de Rouen.
Et Jeanne, c’est Mme Sarah Bernhardt qui a fait de cette sublime figure une création inoubliable ! C’est à elle que revient presque tout l’honneur de cette magnifique soirée.
Sans doute la pièce de M. Jules Barbier est d’une intéressante simplicité mystique, encore que le vers généralement correct y manque un peu trop de sonorité, sans doute la musique de M. Gounod est très belle et fort convenablement exécutée ; d’un autre côté la mise en scène est luxueuse, habilement réglée et les décors sont superbes : il y en a même un d’une rare somptuosité, celui de la basilique de Reims brillamment décorée et illuminée pour la cérémonie du sacre. Mais tout cela n’aurait pas suffi, j’en ai grand peur, à conjurer la crise qui sévit en ce moment sur les théâtres. C’est Mme Sarah Bernhardt par la force seule de son admirable talent qui a assuré et qui assurera l’immense succès de cette reprise mémorable.
Elle a incarné le type populaire de Jeanne d’Arc avec une puissance dramatique tout à fait exceptionnelle. Malgré la monotonie mélopéenne de son débit dans les passages neutres, malgré les défaillances de son organe dans les morceaux de force, elle a su animer cette admirable figure d’une vie idéale, pour ainsi dire surnaturelle. La Jeanne d’Arc qu’elle a créée vivra éternellement dans la mémoire de tous ceux qui l’auront vue.
Dès le premier tableau, l’héroïne est campée en pleine lumière, dans une auréole de poésie mystique qui ne la quitte plus et dont le rayonnement augmente d’intensité jusqu’à la fin, brillant, à chaque pas qu’elle fait, d’un éclat de plus en plus vif.
Mme Sarah Bernhardt nous a fait admirer là une merveille de composition, où tout est étudié avec une science parfaite et où tout concourt à l’harmonieux effet de l’ensemble. C’est, pour ma part, une des plus belles impressions d’art que j’aie ressentie au théâtre depuis longtemps.
À côté de Jeanne d’Arc, c’est-à-dire à côté de Mme Sarah Bernhardt, il n’y a point de rôles, il n’y a que des comparses, et ce n’est la faute de personne. Dieu et la légende le veulent ainsi. Il faut cependant louer quelques-uns des artistes de la façon consciencieuse dont ils ont rempli leur tâche.
Ce sont MM. Léon Noël, Bouyer, Rosny, Rebel et la gracieuse Mlle Nesville, qui chante d’une façon ravissante la ballade et la ronde du petit page Loys.

(Dessin de M. Reichan.)

(Dessin de M. Reichan.)

(Dessin de M. Reichan.)
Le Temps, 13 janvier 1890
Extrait de la Critique musicale en feuilleton de Johannes Weber, qui n’est pas allé voir la pièce.
Lien : Gallica
Je lis dans mon premier feuilleton sur Jeanne d’Arc de MM. J. Barbier et Gounod [18 novembre 1873] que M. J. Barbier commença par présenter sa pièce au Théâtre-Français et à l’Odéon qui la refusèrent. Ne sachant s’il réussirait jamais à la faire jouer il la fit imprimer ; ce fut en 1869.
Quelques situations semblaient destinées d’avance à être accompagnées de musique ; ailleurs, on a pu en ajouter d’autant plus facilement que M. Barbier a fait à sa pièce des changements assez considérables ; aussi fit-on une nouvelle édition
de la pièce, conforme à la représentation
. La partition, piano et chant, parut dès que l’ouvrage eût vu la rampe.
Un drame mêlé d’intermèdes de musique, constitue un genre qu’il serait aussi facile qu’inutile de critiquer. Les exemples en abondent et des plus célèbres ; aujourd’hui encore un compositeur ne refusera jamais de saisir une telle occasion pour prouver qu’il est capable d’écrire de la musique scénique et dramatique ; il est même arrivé plus d’une fois que la musique a survécu au drame pour lequel elle a été créée.
À ce genre se rattachent aussi les ouvrages dont le sujet est dramatique, mais qui ne sont pas écrits pour le théâtre et où un compositeur a introduit un nombre arbitraire de morceaux de musique. Tels sont Manfred et Faust, de Schumann, ainsi que des productions auxquelles ces œuvres ont servi de modèles ou de prétexte.
Si nous descendons un peu plus bas, dans la forme musicale, nous trouvons le monologue déclamé en mélodrame sur une musique plus ou moins discrète. Nous avons eu ainsi, il y a peu d’années, deux versions de la Fiancée du timbalier, de Victor Hugo, l’une de M. Saint-Saëns, l’autre de M. Thomé. Je les ai jugées comparativement toutes les deux.
Avant Jeanne d’Arc, M. Gounod avait écrit une douzaine de morceaux de musique instrumentale ou instrumentale et vocale pour les Deux Reines, de M. Legouvé. Le sujet ou plutôt la disposition des scènes du premier de ces drames, était le plus avantageux à la musique et la partition de Jeanne d’Arc a produit plus d’effet que celle des Deux Reines. Dans Jeanne d’Arc M. Gounod ne s’est nullement cru obligé d’écrire des entractes comme prélude à chaque acte ; le premier acte seul est précédé de l’introduction obligatoire. À part cette introduction, un court menuet, le ballet et quelques mélodrames, il n’y a que des morceaux de chant. L’introduction instrumentale est faite de deux motifs dont l’un est pastoral, avec des échos sur la scène ; l’autre est emprunté à la vision qu’a Jeanne dans sa prison. Le chœur : Nous fuyons la patrie
, est bien en situation pour marquer la détresse du peuple ; seulement il n’a pas un caractère assez marqué. Quant à l’apparition des deux saintes, chantant, soutenues par un chœur invisible, l’interprétation m’avait paru, il y a seize ans, faire contre-sens. Je n’ai pu aller m’assurer si aujourd’hui elle est meilleure, car l’influenza n’est pas la seule corde que le diable ait à son arc ; mais, pour mettre mes lecteurs à même d’en juger, je reproduis une partie de ce que j’avais dit : Le chant des saintes doit être dit presque en entier avec une extrême douceur pour lui donner un caractère céleste et rassurant qui seul peut inspirer à Jeanne la confiance dont elle a besoin. De cette manière aussi les séries de tierces qui forment ce duo sont bien justifiées. Les saintes de la Gaîté ne songent qu’à donner beaucoup de voix. Cela suffit à dénaturer le morceau, un des meilleurs de la partition.
Au second acte, nous trouvons d’abord un chœur de femmes avec une ballade dans la forme ancienne.
Le morceau est naïf, charmant la difficulté, c’est de le bien dire, et ce sera une chance si le page d’aujourd’hui vaut mieux que celui de 1873.
Pendant que le roi fait sa prière, l’attention des autres personnes est détournée par un plain-chant dit dans la coulisse. L’entrée de la cour est accompagnée d’un court menuet à la manière des anciens menuets
, c’est-à-dire de ceux du temps de Louis XIV. Il n’y a donc là aucune prétention à la couleur locale, le menuet n’existant pas encore sous Charles VII.
Le chœur belliqueux : Dieu le veut !
a été redemandé avec enthousiasme en 1873 ; il est écrit pour produire un grand effet, comme un vrai chant patriotique. Aujourd’hui on a changé tout cela. Il est arrivé parfois que dans des représentations répondant à une circonstance politique une actrice déclamât la Marseillaise, ne pouvant la chanter ; je ne suis pas sûr que Rachel elle-même n’ait pas été dans ce cas. Allez de régiment en régiment, déclamer devant chaque compagnie, chaque escadron les vers de la Marseillaise ; quand même ce ne serait pas cette déclamation fausse et antimusicale dont j’ai déjà parlé, quel effet croyez-vous que vous produiriez ou que vous eussiez produit même à l’origine du chant de Rouget de l’Isle, en 1792 ? Oui, la Marseillaise doit être déclamée, mais d’une déclamation parfaitement musicale et chantée ; plus il y aura de voix mieux cela vaudra. Au lieu de cela on en fait, ce qui m’horripile le plus en musique : du mélodrame, de la déclamation affreusement discordants sur un accompagnement instrumental !
Eh bien ! voilà ce que Mme Sarah Bernhardt fait du chœur patriotique de M. Gounod. Mais vous ne l’avez pas entendue ! me dira-t-on. Je préfère même n’y pas aller voir, et je me contente de l’aveu que mon collaborateur M. Sarcey n’a pu s’empêcher de faire. Il ne faudrait avoir entendu Mme Sarah Bernhardt pas seulement pendant cinq minutes pour ignorer que sa voix n’est point faite pour ces exagérations, n’ayant aucune valeur sérieuse. Elle lance son cri de guerre à pleins poumons : Elle est obligée d’enfler sa voix, de la grossir, d’altérer le contour des syllabes. Elle crie à tue-tête et l’on n’entend pas distinctement tous les mots.
Cela ne saurait être autrement, et je ne suis pas fâché de constater qu’en pareille circonstance, s’appelât-on Mme Sarah Bernhardt, on en revient fatalement aux grossiers moyens d’une écolière.
Le chœur de soldats et de ribaudes avait déjà été indiqué dans la première édition de la pièce. Le ballet comprenait trois morceaux dont le premier seul se trouve dans la partition. Le second morceau avait été publié antérieurement à la partition et chez un autre éditeur c’était un arrangement de la Marche funèbre d’une marionnette, morceau de piano assez facile, charmant et un peu humoristique. On en a fait plus tard une nouvelle édition avec des illustrations et une pièce de vers se rapportant au titre du morceau mais non pas à la musique. Quant au programme que j’en ai donné, pour rire, dans mes Illusions musicales, je me suis borné à dire qu’il n’était pas de M. Gounod ; je l’avais copié un jour sur l’affiche des concerts Besselièvre (concerts des Champs-Élysées).
Pour introduire le morceau dans le ballet de Jeanne d’Arc, on avait imaginé de donner pour cible aux soldats français un mannequin représentant John Bull, et qu’on portait en triomphe quand il était renversé. Cette procession impatienta le public ; il a fallu la supprimer d’ailleurs, la charge était trop grossière pour convenir à la musique de M. Gounod.
Le finale du troisième acte est une prière déclamée par Jeanne en mélodrame, tandis que l’orchestre joue la mélodie chantée ensuite par le chœur. L’acte suivant comprend un chœur de femmes et la marche du sacre, fort honorable, malgré la comparaison qu’elle a provoquée infailliblement. Au cinquième acte, les soldats anglais sont en liesse, comme l’étaient les Français au troisième acte. Les saintes viennent consoler Jeanne dans sa prison. Le dernier tableau est naturellement court il contient une marche funèbre et la scène finale terminée par les saintes et le chœur céleste.
La Dépêche, 26 janvier 1890
Jeanne d’Arc au théâtre populaire de Millau.
Lien : Retronews
Millau. Théâtre populaire. — C’est ce soir dimanche, selon toutes probabilités, que la troupe félibréenne, dirigée par M. Gritty, nous donnera Jeanne d’Arc, le drame en quatre actes de Jules Barbier.
Le Figaro, 17 février 1890
Extrait du Courrier des théâtres, par Georges Boyer.
Lien : Gallica
Hier, dimanche, Mme Sarah Bernhardt, prise d’une indisposition subite, à l’issue de la représentation donnée en matinée, n’a pu jouer, le soir, et on a dû faire relâche. Vers sept heures, une bande a été posée sur l’affiche, au grand désappointement du public qui formait déjà une longue queue sur le boulevard.
Certes, il était dur de faire relâche avec une location qui dépassait sept mille francs ; mais il a bien fallu s’y résoudre, le médecin de service ayant déclaré qu’une soirée de repos était indispensable dans l’intérêt même des représentations suivantes.
Nous pouvons rassurer les nombreux amis de la grande artiste, dont l’indisposition n’a eu aucune suite et qui est aujourd’hui reposée et plus vaillante que jamais, et annoncer au public, pour ce soir lundi gras, la 46e représentation de Jeanne d’Arc et pour demain mardi gras, à 2 heures, la 10e matinée, et le soir, à 8 h. 1/2, la 47e représentation.
L’Univers, 22 février 1890
Article d’Eugène Veuillot. Sarah Bernhardt dans la Passion.
Lien : Gallica
Quelques journaux du boulevard viennent d’annoncer que Mme Sarah Bernhard, ayant réussi dans le rôle de Jeanne d’Arc, se prépare à jouer un autre rôle qui la séduit davantage encore, celui de la Sainte Vierge. Oui, il s’agit de mettre en scène, sur un théâtre quelconque, permettant des pièces à grand spectacle, la Mère du Sauveur et le Sauveur lui-même dans les conditions les plus propres à empoigner
le public et a faire briller, d’abord Mme Sarah Bernhardt, ensuite un acteur de mélodrame du nom de Garnier, que le Gil Blas déclare particulièrement apte à représenter N.-S. Jésus-Christ.
C’est un poète peu connu, sinon ignoré, M. Haraucourt, auteur de l’Âme nue et d’une adaptation du Shyloch de Shakespeare, qui se charge d’adapter, d’arranger et, au besoin, de compléter l’Évangile afin que le Mystère de la Passion — ce sera le titre de la pièce — ait une bonne forme dramatique et permette à Mme Sarah Bernhardt d’abord, puis à M. Garnier de développer toutes leurs qualités scéniques : voix, attitudes, gestes, etc.
Le monde du théâtre et du boulevard a bien accueilli cette nouvelle, qui prêtait à de fortes plaisanteries sur Sarah Bernhardt et promettait un spectacle absolument nouveau. Tout est là pour ce monde-là. Mais, d’autre part, même dans des journaux que le respect des choses religieuses n’absorbe pas, on a montré une pénible surprise et fait entendre d’assez vives réclamations. Le Journal des Débats est de ceux qui ont le mieux donné cette note, sans cesser, d’ailleurs, d’être lui-même et d’afficher son scepticisme. Nous le citons :
Voici une tentative imprévue : on annonce qu’un poète, qui naguère s’est exercé sur Shakespeare, veut maintenant s’en prendre aux évangélistes ; il écrit, dit on, pour édifier les Parisiens au temps de la semaine sainte, un pieux
Mystèresur la Passion de Jésus. L’œuvre sera représentée deux fois par jour, les jeudi, vendredi et samedi saints, sur un théâtre de Paris ; on ne nous dit pas encore sur lequel ; mais comme, pour bien célébrer ce triduum, il faudra un grand déploiement de mise en scène, en interrompre, sans doute, les représentations des Pilules du Diable ; on pourrait aussi choisir la salle de l’Éden. Mme Sarah Bernhardt jouera un rôle dans le drame du Calvaire. Après avoir incarné la Pucelle d’Orléans, elle devait désirer représenter la Vierge : c’est une vocation, tardive, mais irrésistible.On raconte aussi que l’acteur Philippe Garnier, dont on connaît la voix mélodieuse et la mimique distinguée, fera le Nazaréen.
Voilà un beau projet, ajoute ironiquement le Journal des Débats ; mais la censure, sévère aux poètes, — elle l’a prouvé pour le Pater de M. Coppée, — permettra-t-elle à Mme Sarah Bernhardt et à M. Haraucourt une semblable fantaisie ? Le Journal des Débats ne veut pas le croire et, pour mieux faire passer son appel à la censure, il y mêle une épigramme contre nous :
Cette exhibition, dit-il, blessera dans leurs croyances de très honnêtes gens. Sans doute, si la censure interdit, elle recevra les félicitations de l’Univers ; mais, si elle autorise, elle recevra celles de MM. Navarre et Cattiaux. Mieux vaudrait se résigner aux compliments de M. Veuillot. Il n’y aurait point d’ailleurs que les dévots à se scandaliser d’un pareil spectacle : tout homme de goût souffrira de voir l’immortelle beauté de la légende chrétienne profanée par les grimaces et les cris des comédiens.
En attendant que la censure se résigne à nos compliments, c’est le Journal des Débats qui doit s’y résigner. Pareil accident le menacera et même lui arrivera chaque fois qu’il parlera avec bon sens, soutiendra plus ou moins courtoisement une bonne cause et osera, quoique républicain, se séparer de MM. Navarre, Cattiaux et autres représentants de la libre-pensée dans le conseil municipal de Paris.
Notre confrère traite ensuite un autre point de la question, celui de la liberté laissée autrefois à la représentation des mystères. Ici encore il parle bien, et, de nouveau, nous le citons :
Les entrepreneurs de l’affaire ne seront pas à court de beaux arguments pour défendre leur
Mystère.On veut interdire aux poètes de toucher aux légendes sacrées ; on veut les empêcher de porter au théâtre les scènes que les peintres de tous les siècles et de toutes les écoles, depuis Giotto jusqu’à Munkaczy, ont représentées pour la plus grande édification des bons chrétiens ! Et lesVoilà le thème ; vous devinez les variations. Le malheur est que leMystèresqui se jouaient sous le porche des cathédrales ! Et, de nos jours, les représentations religieuses des paysans d’Oberammergau ! Et Parsifal à Bayreuth ! Laissez-nous ressusciter l’art des primitifs et donner à l’âme moderne l’aliment mystique dont elle est affamée !Mystèrede M. Haraucourt n’est évidemment pas destiné à être représenté sous le porche de Notre-Dame.Le malheur est que les excellents comédiens qui seront chargés de l’interpréter n’ont pas la foi ingénue d’un paysan bavarois. Le malheur est que jamais public parisien ne connaîtra le recueillement presque religieux des pèlerins de Bayreuth. Quant à l’âme moderne, elle a déjà le
Chat Noirpour satisfaire ses instincts mystiques ; c’est suffisant. Mme Sarah Bernhardt n’a vraiment pas besoin de s’en mêler. Si la bonne nouvelle nous doit être apportée, qu’elle ne nous tombe pas des lèvres de M. Philippe Garnier.
Tout cela est juste. Le théâtre parisien par ses habitudes, ses mœurs, son personnel et la grande, la très grande majorité du public, ne peut nous rendre les vieilles représentations que l’on invoque pour autoriser le Mystère de la Passion. Ce serait, assurément, fond et forme, tout autre chose. Là où dans le passé la foi trouvait une satisfaction, et peut-être, une force, il y aurait aujourd’hui pour les chrétiens, et même pour les indifférents encore respectueux, scandale et profanation.
Le Gil Blas, 7 mars 1890
Représentation au Vaudeville.
Lien : Gallica
La matinée donnée mardi [4 mars, au Vaudeville], au bénéfice de Camille Bias, avec le concours des artistes les plus célèbres a été des plus brillantes.
Il suffit de citer mesdames Sarah Bernhardt, Lureau-Escalaïs, Mily-Meyer, Molé-Truffier, Guffroy et MM. Fugère, Pierre Berton, Marietti, Escalaïs, etc., pour comprendre le succès obtenu par cette pléiade d’artistes.
Les Châteaux en Espagne, de madame Leone de Lisle, la Clef de Metellu, un acte de Meilhac et Halévy, ont été très applaudis, de même que l’air de Don Carlos, si merveilleusement traduit par madame Guffroy, que nous verrons certainement bientôt sur la scène de l’Opéra. Quant à mademoiselle Mily-Meyer, elle a chanté avec l’originalité qu’on lui connaît, Jusqu’au bout ! une charmante chansonnette, paroles de M. Galipaux, musique de M. O. de Lagoanère. Le public l’a redemandée trois fois. Ajoutons que la désopilante Cendrillonnette des Bouffes chantera aujourd’hui, à l’Hôtel Continental, la Cosmographie des mêmes auteurs.
La Cocarde, 12 mars 1890
Extrait de la rubrique des Théâtres.
Lien : Retronews
À dater de maintenant, le chiffre des matinées de Jeanne d’Arc sera joint à celui des représentations du soir.
Hier lundi 10 mars, le drame-légende de Jules Barbier en était à sa 80e représentation — c’est le chiffre que porte l’affiche, — et c’est dire que, dans peu, Jeanne d’Arc sera centenaire.
À propos de Jeanne d’Arc, annonçons que M. Mayer, de Londres, vient de traiter avec Sarah Bernhardt pour une série de représentations du drame de Jules Barbier à donner à Londres, pendant la saison prochaine.
La grande artiste serait accompagnée, pour cette série, par la troupe de théâtre de la Porte-Saint-Martin, et Jeanne d’Arc serait jouée, en Angleterre, avec la même distribution qu’à Paris.
Le Temps, 12 mars 1890
Extrait des Spectacles et concerts.
Lien : Gallica
Demain mercredi, à trois heures, au Théâtre d’application, matinée-causerie de M. Delaunay sur le Misanthrope et l’École des maris. Samedi, M. Sarcey parlera sur Béranger, et enfin, le mercredi 19 mars, c’est Mme Sarah Bernhardt qui se fera entendre.
C’est là le commencement d’une série de conférences qu’a imaginées M. Bodinier, pour mettre en rapport le public, et les artistes les plus aimés. Il estime que les Parisiens ne connaissent pas assez leurs plus célèbres amuseurs, et il consacre le Théâtre d’application à la vulgarisation par les comédiens eux-mêmes des procédés et des secrets du théâtre.
Le Gil Blas, 16 mars 1890
Extrait des Propos de Coulisses : Cléopâtre.
Lien : Gallica
La Cléopâtre de M. É. Moreau, qu’a remaniée M. Sardou, passera le 20 avril.
Ce n’est pas, comme on l’a dit, une adaptation de Shakespeare, mais bien une œuvre personnelle.
Madame Sarah Bernhardt est ravie de son rôle, qu’elle répète avec une fougue extraordinaire.
M. Garnier tiendra le rôle d’Antoine, mademoiselle Malvau jouera Octavie. Les autres rôles seront tenus par MM. Léon Noël, Bouyer, Herbert, Rebel, Deneubourg, etc. Il reste quelques rôles à distribuer.
Sarah Bernhardt apparaîtra en véritable Égyptienne, c’est-à-dire qu’elle aura la peau dorée et la chevelure noire.
Le Figaro, 16 mars 1890
Extrait du Courrier des Théâtres, par Georges Boyer : Cléopâtre.
Lien : Gallica
Nous recevons la lettre suivante :
Montmorency-Ermitage, 15 mars 1890.
Mon cher monsieur Boyer,
M. Duquesnel va monter une Cléopâtre à la Porte-Saint-Martin avec Mme Sarah Bernhardt pour principale interprète. C’est fort bien mais il me sera permis sans doute d’établir la priorité de mes droits en ce qui concerne et Cléopâtre et Mme Sarah Bernhardt.
Voici, en effet, ce que la grande artiste m’écrivait dans une lettre datée du 15 novembre 89 :
Voulez-vous, pouvez-vous me conserver votre Cléopâtre ? C’est une œuvre admirable de forme, originale et forte ; j’ai toujours rêvé cette grande figure de la reine d’Égypte. J’en ai lu au moins dix traductions. Voici la première qui me captive, et je sens que le public fera comme moi. Duquesnel hésite à jouer la pièce tout de suite il se dit qu’après Jeanne d’Arc peut-être… (ici une phrase que je vous demande la permission de supprimer). Je verrai mon ami Porel, directeur de l’Odéon. C’est un oseur, et un oseur intelligent il y aura peut-être moyen de s’arranger avec lui ; je me ferai libre pour cela. Je suis sûre qu’il sera séduit par l’œuvre. Attendez encore un peu et nous en recauserons.
Je vous serre bien fort les deux mains en vous disant à bientôt.
Sarah Bernhardt.
M. Porel, en effet, fut
séduit par l’œuvre; le malheur a voulu que M. Duquesnel ait été, lui,séduit par l’idée; — et qu’après avoir pris connaissance de ma pièce, il se soit empressé d’en accepter une autre sur le même sujet, mais en prose, de MM. Émile Moreau et Sardou. C’était, d’ailleurs, son droit strict et je n’ai pas à le contester, pas plus que le mérite littéraire de l’œuvre nouvelle, qui m’est inconnue. Je tiens seulement à sauvegarder ce qui m’appartient en propre, c’est-à-dire la façon dont j’ai compris la figure de Cléopâtre et les reconstitutions que j’ai faites de l’époque, telles que la procession Isiaque et la curieuse cérémonie du Maneros, dans laquelle j’ai cherché à reproduire, selon son rythme particulier, le chant de fête des anciens Égyptiens.Dans le théâtre de M. Duquesnel, c’est un peu comme dans le royaume des cieux où les derniers sont les premiers.
Qu’y faire ?… Il était dit que Cléopâtre devait susciter des rivaux dix-neuf siècles même après sa mort.
Cordialement vôtre,
Jean Bertheroy.
L’Univers, 1er avril 1890
Extrait de la Chronique
. Polémique au sujet de la lecture par Sarah Bernhardt de la Passion au Cirque d’Hiver.
Lien : Gallica
Il paraît que nous aurons décidément la représentation des Mystères de la Passion, de M. Haraucourt, au Cirque d’été.
Voici ce que l’auteur aurait dit lui-même à un rédacteur du Parti National, après avoir conté toutes les péripéties par lesquelles il a passé avant d’aboutir à la réalisation de son dessein :
Quant aux interprètes, ils sont tous di primo cartello.
D’abord, Mme Sarah Bernhardt, qui fera tous les rôles de femme. La grande actrice a dû, comme bien vous pensez, s’astreindre à un travail formidable. Elle remportera un grand succès, j’en suis certain. M. Garnier interprétera le rôle de Jésus.
M. Brémond, de l’Odéon, me prête aussi son précieux concours.
Les répétitions ont très bien marché. Quand je dis très bien… il s’est passé des scènes très attendrissantes, et plusieurs fois, en maints passages, mes interprètes, empoignés par la situation, avaient les larmes aux yeux et étaient obligés de s’arrêter.
De même, nous pleurions tous le jour de la lecture !
Je n’ai plus qu’à ajouter que Mme Sarah Bernhardt sera tout de blanc habillée, puis qu’elle représente la Vierge.
Quant à MM. Garnier et Brémond, ils seront en habit noir.
Ce dernier trait nous dispense d’insister sur l’inconvenance, que nous avons déjà signalée, de faire représenter devant un public comme celui de Paris, par telle actrice ou tel acteur, en vogue, les personnages sacrés de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge.
Le Figaro, 4 avril 1890
Extrait du Courrier des Théâtres
.
Lien : Retronews
Ce soir, concerts spirituels :
Au Conservatoire (8 h. 1/2), Symphonie en ut mineur (C. Saint-Saëns) ; Marche religieuse de Lohengrin (Wagner) ; Concerto pour piano (R. Schumann), par M. Paderewski ; Gallia, lamentation (Ch. Gounod), par Mlle Sybil Sanderson ; Le Songe d’une Nuit d’été (Mendelssohn).
Au Cirque d’Hiver (8 h. 3/4), Concert Lamoureux :
- Symphonie en ut mineur (Beethoven) ;
- Air de Joseph, par M. Talazac (Méhul) ;
- A. La Fuite en Égypte (orchestre) ; B. Le Repos de la Sainte Famille, de l’Enfance du Christ (Berlioz). Le récitant : M. Talazac ;
- Ouverture du Tannhauser (Wagner) ;
- Prélude de Parsifal (Wagner) ;
- La Passion, 1er chant : Le Fils de l’Homme. I. L’Idée (Au Temple de Jérusalem) ; II. L’Amour (La Cène) ; III. La Peine (Le Jardin des Oliviers) ;
- L’Enchantement du Vendredi-Saint, de Parsifal (Wagner) ;
- La Passion, 2e chant : Les Fils des Hommes. I. Le Nombre (Chez Caïphe) ; II. La Justice (Chez Pilate) ; III. L’Œuvre (Au Golgotha) ;
- Marche nuptiale de Lohengrin (Wagner).
La Passion, de M. Edmond Haraucourt, sera interprétée par Mme Sarah Bernhardt, MM. Philippe Garnier et Brémond.
Au théâtre du Châtelet (8 h. 1/2), sous la direction de M. Charles Gounod : Symphonie en mi bémol (Gounod) ; Cantique d’Athalie (Gounod), par Mmes Krauss et de Montalant ; Hymne à sainte Cécile (Gounod) ; Fragments de Mors et Vita (Gounod), par Mmes Krauss et de Montalant, MM. Mauguière et Auguez.
Concerto pour piano pédalier (Gounod) par Mme Lucie Palicot ; Vision de Jeanne d’Arc (Gounod), par M. Paul Viardot ; Gallia, lamentations (Gounod), par Mme Krauss.
L’Univers, 4 avril 1890
Extrait de la Chronique
.
Lien : Gallica
Nous lisons dans la Pall Mall Gazette de Londres :
Mme Sarah Bernhardt a écrit à l’archevêque de Paris pour lui demander si c’était offensant pour les catholiques de jouer vendredi saint au soir, en costume ordinaire et sous forme d’oratorio, entremêlé de déclamation, le drame de la Passion de M. Haraucourt. Elle a ajouté que son seul désir était d’y introduire quelques allures monastiques et graves, plus conformes au caractère élevé du poème. Le cardinal Richard n’a pas répondu directement, mais il a fait savoir qu’en principe il désapprouvait le jeu des mystères, qui convenaient seulement à un état de société plus catholique et à un cadre très simple comme Oberammergau et Brixlegg [deux bourgades, de Bavière et du Tyrol, connues pour leurs représentations de la Passion].
C’est sous réserves que nous reproduisons cette information.
Le Temps, 4 avril 1890
Article d’un Monsieur du Parquet
sur la censure théâtrale, à l’occasion de la Passion.
Lien : Gallica
Les nouveaux confrères de la Passion
Pendant que Mahomet est rayé de la liste des héros de tragédie licites et que M. de Bornier, écrivain peu subversif, se voit obligé de sacrifier le fruit de ses doctes veilles aux susceptibilités de la Porte ottomane [L’ambassadeur turc venait d’obtenir le retrait du drame Mahomet, d’Henri de Bornier, qui devait être créé à la Comédie-Française], on cite divers acteurs dont le rêve est de représenter Jésus de Nazareth ; Mme Sarah Bernhardt, à qui le rôle de Jeanne d’Arc a procuré une sorte d’entraînement dans la voie mystique et à qui remontent peut-être aussi des souvenirs du rôle de Joas, où elle a trouvé l’un de ses premiers succès, a conçu l’ambition de se montrer sous les traits de Madame la Vierge, comme disaient révérencieusement les fidèles du vieux temps ; un poète, qu’on s’était habitué à classer comme tout à fait fin de siècle
, M. Edmond Haraucourt, a écrit pour satisfaire à ces désirs un mystère, le mystère de la Passion tout uniment, avec l’espoir de le faire représenter.
Cela n’était pas si simple, et l’on conçoit que la commission d’examen se soit trouvée prise un peu au dépourvu en face d’un cas aussi exceptionnel et sur lequel ni les censeurs d’aujourd’hui ni leurs devanciers n’avaient eu à se prononcer, car il y a près de trois siècles et demi que la question ne s’était posée. Quelques Parisiens ont bien pu voir assez récemment le Christ en scène dans une pièce épisodique de M. Darzens, mais c’était au Théâtre-Libre, qui, par son organisation, échappe à la juridiction des examinateurs et dont la raison d’être est précisément de tenter ce que, pour une raison ou pour une autre, on n’ose pas risquer dans les représentations publiques. On n’a pas cru pouvoir accéder, au moins d’emblée, au désir de M. Haraucourt. Son mystère ne sera pas jusqu’à nouvel ordre représenté avec costumes et mise en scène ; mais on va le réciter avec un concert spirituel du vendredi saint. Mme Sarah Bernhardt, en roba blanche, mais en toilette de ville, dira tous les rôles de femmes ; les répliques lui seront données par MM. Philippe Garnier et Brémond — en habit noir. Ce sera, en somme, un oratorio déclamé au lieu d’être chanté. Il semblait que ces précautions auraient dû calmer les alarmes des feuilles religieuses, du moins jusqu’à ce qu’elles connaissent l’œuvre de M. Haraucourt et qu’elles sachent si elles ont à y relever quelque atteinte à l’orthodoxie. La poésie sacrée a une existence tout aussi légitime que la musique sacrée. Eh bien, non seulement l’Univers n’est point désarmé, mais il se choque de l’habit noir et en tire un prétexte de plus de crier à l’inconvenance. Il y a des gens bien difficiles à contenter.
Il s’en faut que la tradition catholique répugna comme la doctrine musulmane aux représentations plastiques. Non seulement l’Église multiplie les images peintes ou sculptées de Dieu et des saints, elle met sous les yeux des fidèles dans tous ses temples la représentation des stations du chemin de la croix, mais elle a encouragé longtemps la représentation animée de tous les épisodes de l’Évangile et de la vie des saints. Au moyen âge, que l’Univers fait profession d’admirer et où il place volontiers la réalisation de son idéal sur la terre, on a donné dans les églises de véritables représentations notamment de la Nativité et de la Passion. Les exhibitions que l’on fait encore dans beaucoup d’églises à Noël et dans la semaine sainte ne sont plus peuplées que de figures immobiles de cire ou de plâtre. Dans les siècles qu’on appelle avec quelque raison des siècles de foi, le drame était joué par les officiants et se confondait avec la liturgie ; c’est un lieu commun de dire que le sanctuaire a été le premier berceau du théâtre moderne.
Dans la suite des temps, il y eut distinction ; ce furent des sociétés, des confréries qui se chargèrent d’entretenir dans les masses l’émotion du drame divin et des légendes sacrées ; mais c’était avec l’aide et sous la protection du clergé, qui changeait au besoin l’heure des offices pour faciliter aux fidèles l’accès à un spectacle qui devait concourir à leur édification. Toutes les histoires de notre théâtre parlent en détail de la Confrérie de la Passion, qui, au quatorzième siècle, s’installa à Saint-Maur aux portes de Paris, puis dans Paris même, au début du quinzième. Mais si cette association fut la plus importante, elle était loin d’être la première en ce genre ; il existait de nombreuses confréries analogues dans les provinces, les unes sédentaires, les autres nomades. Des documents nombreux montrent les très lourdes charges que s’imposaient des villes d’importance secondaire pour attirer chez elles une troupe de bon renom pour qui il fallait édifier de coûteuses charpentes et qui étaient défrayées très libéralement. Les acteurs avaient un répertoire assez abondant ; mais il n’était pas rare que la représentation du seul mystère de la Passion exigeât huit ou dix jours consécutifs. Des amateurs, bourgeois ou gens de métier, se chargeaient de quelques rôles, et l’on peut croire que la plupart étaient joués avec plus de zèle que d’art. Il n’y avait aucun conservatoire pour former ces artistes naïfs. Mais il est certain aussi que beaucoup en faisaient leurs moyens d’existence, et qu’on avait égard aux talents. On généralise beaucoup trop quand on dit que ce n’étaient pas des acteurs de profession ; une partie d’entre eux en cumulaient une autre, et, de plus, ils manquaient d’instruction, voilà le vrai.
Les confrères de la Passion furent battus en brèche par la Renaissance, qui leur retira leur prestige. Le procureur général du parlement de Paris se montra très dur pour ces gens non lettrés ni entendus en telles affaires, de condition infime, comme un menuisier, un tapissier, un vendeur de poisson
, et, en 1548, le parlement, ayant à renouveler leurs privilèges, les restreignit aux sujets profanes, c’est-à-dire les supprima.
Si le seizième siècle n’avait plus la naïveté de foi nécessaire pour se plaire à ces spectacles, le scepticisme est-il assez terrassé à la fin du dix-neuvième pour que nous assistions à une véritable résurrection des mystères, et est-ce M. Haraucourt qui est destiné à rajeunir le monde à ce point ? Attendons l’épreuve, mais c’est un peu difficile à croire.
Le Figaro, 5 avril 1890
Article d’un Monsieur du Parquet
.
Lien : Retronews
La Passion
au boulevard des Filles-du-Calvaire
Le concert spirituel donné, hier soir [4 avril], par M. Lamoureux a été marqué par quelques incidents orageux qui ont enlevé à, la soirée un peu du caractère solennel que tout concert du Vendredi-Saint est censé avoir.
Tout avait fort bien marché : on avait applaudi l’admirable, la sublime symphonie en ut que l’orchestre Lamoureux joue dans la perfection ; on avait fort goûté un air de Joseph chanté par M. Talazac ; on avait écouté avec plaisir des fragments de l’Enfance du Christ de Berlioz ; on avait acclamé l’ouverture du Tannhauser (dans la salle même où s’étaient livrées les grandes batailles wagnériennes du temps de Pasdeloup), on avait beaucoup regardé et lorgné une salle des plus brillantes, une salle de grande première ; puis on en est arrivé à la lecture de la Passion tant annoncée et tant discutée avant son apparition. On attendait avec une certaine curiosité l’œuvre sacrée de M. Haraucourt qui ne paraissait pas prédestiné aux poèmes religieux par ses productions précédentes. L’Âme nue n’a rien de religieux et une certaine plaquette qui a un nom de légende l’est encore moins.
Sarah Bernhardt entre, tout de blanc byzantinement vêtue ; elle s’assied, on l’applaudit ; M. Garnier la suit et s’assied aussi, M. Brémond en fait autant et la lecture commence. Est-ce le sérieux de l’œuvre ? Est-ce la difficulté d’entendre les lecteurs qui, peu habitués à l’acoustique du Cirque, lisaient trop bas ? le fait est qu’au bout de cinq minutes la salle se mit à tousser, à se moucher, à causer et enfin à protester ! Un spectateur placé tout en haut crie :
— Et la musique ?
On l’applaudit et le boucan commence : on se serait cru à la Chambre !
Mme Sarah Bernhardt pleurait, M. Garnier pâlissait. On crie de plus en plus :
— Assez ! Musique ! On n’entend pas !
Quand tout à coup on voit un monsieur descendre les gradins du Cirque et se précipiter vers l’estrade : c’était M. Haraucourt qui assistait dans la salle à l’exécution de son œuvre, il embrasse une main que Mme Sarah Bernhardt lui tend, il serre une autre main, celle de M. Garnier, et finit par dire d’une voix émue :
— Mme Sarah Bernhardt et ces messieurs voudront bien attendre pour donner le temps de sortir aux personnes mécontentes.
M. Haraucourt en prononçant ces mots, met le comble au désordre. On crie, on s’interpelle. Les amis du poète applaudissent — le reste de la salle proteste, et c’est au milieu d’un tumulte croissant que nous entendons M. Haraucourt prononcer une phrase que nous croyons être celle-ci :
— On aura la musique quand le moment sera venu. Vous avez payé pour entendre un poème, il convient que vous l’entendiez.
Et M. Haraucourt était fort pâle, agitant frénétiquement son chapeau. Étant donné les rapports qui existent entre la critique et les auteurs, nous nous abstiendrons de tout commentaire, mais où irions-nous si la théorie de M. Haraucourt s’implantait ?
Le public a payé pour entendre un poème, c’est vrai ; mais s’il lui convient de ne pas l’entendre, ce poème, parce qu’il s’ennuie, est-ce au poète à l’y obliger ? On irait loin avec cette prétention.
M. Haraucourt, après l’avoir émise, s’est contenté de remonter à sa place et d’embrasser plusieurs personnes de sa famille ! Toute une salle ayant assisté à cette petite scène, il faut bien la raconter, quoi qu’on en puisse penser. Elle a du reste paru calmer le public, qui a écouté dans un calme relatif une autre scène du poème.
Puis, M. Garnier a dit avec une intonation qui voulait être explicite :
— Le poème dont nous avons eu l’honneur de réciter des fragments devant vous est de M. Haraucourt.
Et le public, comprenant qu’il n’allait pas entendre la seconde partie du poème annoncée sur l’affiche, a laissé les amis du poète applaudir à tour de bras pendant que les effusions de famille recommençaient. Au milieu d’un silence relatif, M. Lamoureux put alors reprendre la partie musicale de la soirée par une étonnante exécution du divin Enchantement du Vendredi-Saint de Parsifal.
Et voilà le procès verbal exact de la lecture (annoncée unique à l’avance) de la Passion de M. Haraucourt, œuvre faite pour la lecture par un poète de beaucoup de talent, qui a eu le grand tort de parler en prose à un public qui avait payé pour entendre un poème
. C’est lui-même qui l’a dit !
Le Temps, 9 avril 1890
Extrait du Bulletin de l’Étranger. En Angleterre, appel au boycott des représentation de Sarah Bernhardt.
Lien : Gallica
Angleterre. — Le correspondant à Londres du Courrier de Manchester écrit :
Une grande agitation règne dans les cercles de la haute église anglicane et du monde catholique. Il s’agit de boycotter Mme Sarah Bernhardt quand elle montera sur le théâtre à Londres. C’est un fait positif que le clergé catholique invite les membres de ses congrégations à s’abstenir d’assister aux représentations de Mme Sarah Bernhardt, afin d’apprendre à la grande actrice que ses excentricités doivent se confiner dans les limites du bon goût.
Le Gil Blas, 15 avril 1890
Extrait des Propos de Coulisses.
Lien : Gallica
Madame Sarah Bernhardt va de nouveau entreprendre une grande tournée, sous la direction de Grau, l’imprésario.
La grande tragédienne parcourra les deux Amériques, l’Australie, l’Asie, l’Inde, la Perse ; c’est-à-dire qu’elle fera tout simplement le tour du monde, mais pas en quatre-vingt jours. Son absence durera vingt-deux mois.
Le Figaro, 22 avril 1890
Extrait du Courrier des Théâtres. Sarah Bernhardt remplacée pour indisposition.
Lien : Retronews
Hier, lundi [21 avril], on a failli faire relâche, à la Porte-Saint-Martin, Mme Sarah Bernhardt s’étant trouvée assez sérieusement indisposée au moment de se rendre au théâtre. Après une annonce au public pour lui faire part de l’incident et réclamer sa bienveillance, le rôle de Jeanne a été repris par Mlle Forgue, une jeune artiste qui double Mme Sarah Bernhardt, et qui, prévenue en toute hâte, a dû jouer tout à fait à l’improviste.
Mlle Forgue, qui est un premier prix de l’avant-dernier concours du Conservatoire, s’est acquittée de sa lourde tâche en très vaillante artiste, et a fait preuve de sérieuses qualités dramatiques. Elle était très émue — cela se conçoit de reste — bien qu’elle ait été très sympathiquement, accueillie par le public, qui ne lui a ménagé ni ses encouragements ni ses bravos.
L’état de santé de Mme Sarah Bernhardt n’inspire, d’ailleurs, aucune inquiétude, son indisposition, qui paraît être la suite d’un excès de fatigue, n’offre rien de grave, et on nous annonce que dès, ce soir, elle reprendra possession de son rôle de Jeanne d’Arc, qu’elle continuera à jouer au moins jusqu’à la fin du mois.
Le Figaro, 23 avril 1890
Extrait du Courrier des Théâtres.
Lien : Retronews
Contrairement à ce qu’on avait espéré, Mme Sarah Bernhardt n’a pu jouer encore hier [22 avril] son rôle de Jeanne d’Arc, et, comme la veille, elle a été remplacée par Mlle Forgue, dont le succès a d’ailleurs été très grand et qui n’a pas failli devant l’énormité de la tâche entreprise.
Les médecins, par excès de prudence, ont exigé que Mme Sarah Bernhardt prît un second jour de repos ; mais nous pouvons annoncer pour aujourd’hui, en toute sûreté et sans remise, la rentrée de la grande artiste, à qui ces deux jours ont fait le plus grand bien et qui se retrouve plus vaillante que jamais. Ceux d’ailleurs qui ne l’ont pas encore vue dans cette admirable création de Jeanne d’Arc feront bien de se hâter, car elle ne jouera plus que huit fois seulement le drame-légende de Jules Barbier, c’est-à-dire jusqu’à mercredi prochain, 30 avril, date à laquelle prend fin son traité avec le théâtre de la Porte-Saint-Martin.
À dater de jeudi, 1er mai, c’est Mlle Forgue qui reprendra définitivement le rôle de Jeanne, pour la dernière série de représentations à donner.
L’Univers, 26 avril 1890
Extrait de la Chronique
.
Lien : Gallica
À la matinée donnée hier [jeudi 24] au Trocadéro, au profit de la Société des Alsaciens-Lorrains, Mme Sarah Bernhardt a dit les vers suivants, composés pour la circonstance par le poète Jean Bertheroy :
Pour l’Alsace-Lorraine
Vingt ans ! et la blessure en nos cœurs saigne encore.
Vingt ans ! et nous avons gardé d’un même accord
Notre foi souveraine.
Avec les jours passés a grandi notre deuil,
Et toujours nos regards se tournent vers le seuil
De l’Alsace-Lorraine !
Pour saluer vos fronts, ô frères exilés,
La patrie a fait taire aux remparts crénelés
Le clairon de sa haine,
Et c’est un long appel de tendresse et d’espoir
Que la France te jette à travers le ciel noir,
Ô Alsace-Lorraine !
À travers le ciel noir elle te tend la main.
Aujourd’hui morne et triste, il se peut que demain
L’aube se rassérène,
Car les Vosges n’ont pas de leur sommet bruni
Déchiré le lien qui toujours nous unit
À l’Alsace-Lorraine !
Et nous t’aimons, ô sol qu’ont aimé nos aïeux !
Comme aux sillons lassés le laboureur pieux
Sème la bonne graine,
Nous versons sous tes pieds, qu’ont meurtris les vainqueurs,
L’or de notre travail et la sang de nos cœurs
Pour l’Alsace Lorraine !
Les journaux constatent que Mme Sarah Bernhardt, dans la récitation de ces vers, a obtenu un grand succès.
Le Figaro, 30 avril 1890
Extrait du Courrier des Théâtres.
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt joue, ce soir [mardi 29 avril], pour la dernière fois, le rôle de Jeanne d’Arc, c’est dire qu’on refusera pas mal de centaines de spectateurs au théâtre de la Porte-Saint-Martin.
La grande artiste qui, depuis six mois, a donné une série d’environ deux cents représentations consécutives, éprouve le besoin de prendre quelques jours d’un repos bien mérité, avant de commencer la série des représentations de Jeanne d’Arc, qu’elle va donner dans les principales villes de France, sous la direction de MM. Abbey et Maurice Grau, qui se sont adjoint M. Émile Simon comme administrateur.
Cette première tournée, qui durera un peu plus d’un mois — du 10 mai au 14 juin — va donner satisfaction aux nombreuses municipalités qui ont réclamé, avec grande instance, des représentations du drame lyrique de Jules Barbier, qui est, tout à la fois populaire et national. Et jamais, croyons-nous, Sarah Bernhardt n’aura obtenu pareil succès, car, dès maintenant, on se fait inscrire à la location des théâtres où ces représentations sont annoncées, avant même que la location soit ouverte.
Voici, quant à présent, l’itinéraire de la première série de ces représentations :
- 10 et 11 mai : Nantes ;
- 12 mai : Lorient ;
- 13 : Brest ;
- 14 : Rennes ;
- 15 : Angers ;
- 16 : Tours ;
- 17 et 18 : Rouen ;
- 19 : Roubaix ;
- 20 : Gand ;
- 21 : Anvers ;
- 22 : Luxembourg ;
- 23 : Namur ;
- 24 : Reims ;
- 25 : Nancy ;
- 26 : Dijon ;
- 27, 28, 29, 30 et 31 : Lyon.
Nous donnerons, en temps utile, la suite de l’itinéraire, jusqu’au 15 juin, époque à laquelle commenceront les représentations de Mme Sarah Bernhardt, à Londres.
Le Figaro, 2 mai 1890
Extrait du Courrier des Théâtres, par Georges Boyer. Dernières de Sarah Bernhardt.
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt a terminé sa série de représentations au théâtre de la Porte-Saint-Martin.
Hier on a fait relâche à ce théâtre, et ce soir a lieu la réouverture avec la 140e représentation de Jeanne d’Arc. Mlle A. Forgue continuera ses débuts dans le rôle de Jeanne d’Arc, qu’elle a joué dernièrement avec grand succès, lors de l’indisposition de Mme Sarah Bernhardt.
Le théâtre de la Porte-Saint-Martin reprend son ancien tarif de prix des places qui avait été surélevé pour les représentations de Mme Sarah Bernhardt.
À partir d’aujourd’hui, le lever du rideau aura lieu à 8 h. 3/4 seulement.
Le Petit Journal, 10 mai 1890
Article : La Tournée Sarah Bernhardt.
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt allait entreprendre pendant six semaines une tournée théâtrale dans toute la France, sous la direction de MM. Grau et Abbey et l’administration de M. Émile Simon. On devait commencer par Nantes où la tragédienne aurait joué aujourd’hui la Tosca et demain Jeanne d’Arc.
Le départ d’une troupe de ce genre, son acheminement à travers les principales villes de France n’est pas une petite affaire. Il y a là de grosses dépenses, de gros frais… et gros colis.
Aussi la déception des artistes et des administrateurs a-t-elle été grande hier matin [vendredi 9 mai], à la gare Saint-Lazare, lorsqu’à l’heure fixée pour le rendez-vous général, une heure avant le départ du rapide de Nantes, M. Sima est venu annoncer de la part de MM. Grau et Abbey que la mise en route de la tournée était différée.
Mme Sarah Bernhardt qui, à la répétition de la veille dans la salle Flaxland, faisait des efforts inouïs pour dissimuler une douleur très aiguë au genou, était hier matin incapable de quitter le lit, une éruption s’étant déclarée dans la nuit autour de la rotule. Conséquence : impossibilité absolue de partir à la date indiquée.
Trois médecins aussitôt consultés ont prescrit un repos absolu, et il a fallu toute leur autorité pour empêcher l’artiste de se lever quand même et de rejoindre ses camarades.
La location dans toutes les villes de Bretagne atteint un chiffre formidable. À Nantes, pour les deux représentations fixées aux 10 et 11 mai, elle était déjà de 19.500 fr. On conçoit l’embarras des directeurs. M. Simon a immédiatement envoyé à Nantes son secrétaire, M. Bridault, avec mission de se mettre à la disposition de la municipalité et du public, et de demander le renvoi des deux représentations aux 14 et 15 courant. Les médecins espéraient encore à cinq heures qu’à cette date Mme Sarah Bernhardt pourrait partir sans danger. Mais dans la soirée le docteur Lucas Championnière, appelé par la malade, lui a défendu de poser le pied à terre avant dix jours au moins. Il s’ensuit que la tournée est maintenant subordonnée aux événements.
La blessure qui pour la première fois depuis douze ans a fait manquer un départ à l’infatigable artiste, lui est venue des chutes répétées qu’elle faisait chaque soir sur un genou, au cours des représentations de Jeanne d’Arc à la Porte-Saint-Martin.
Cet incident avait causé hier un certain mouvement dans la gare Saint-Lazare. Toute la troupe, soit trente-cinq personnes, a déposé ses menus colis à la consigne.
Quant aux gros bagages, ils ont été laissés en dépôt dans des fourgons spéciaux. Ils représentent 4.500 kilos. M. Simon a télégraphié dans toute la région de l’Ouest pour annoncer aux municipalités et au public cette fâcheuse nouvelle.
(Dépêche de notre correspondant.)
Nantes, 9 mai, 9 h. 25 soir. Une dépêche est arrivée à cinq heures prévenant une personne de notre ville de l’indisposition de Sarah Bernhardt et ajournant les représentations. Les journaux du soir que le viens de lire annoncent les représentation : comme si rien n’était retardé, de sorte que le public ignore encore l’ajournement qui sera public demain.
Il y a près de vingt-mille francs de location déposés au Crédit lyonnais. Il y aura de fortes réclamations demain quand il faudra rendre l’argent, car malgré toute la sincérité de nouvelle, il y a bien des gens qui croiront qu’on leur joue un mauvais tour.
Extrait du Courrier.
Hier matin, à onze heures, au moment ou les artistes de la tournée Abbey-Grau s’apprêtaient à prendre le train de Nantes où doit avoir lieu la première représentation de Jeanne d’Arc, Mme Sarah Bernhardt a fait prévenir qu’elle se trouvait hors d’état de partir. La tragédienne est atteinte d’une lymphangite inflammatoire des vaisseaux sanguins de la jambe, qui nécessite un repos de quelques jours. On a télégraphié aux divers théâtres pour annoncer ce retard et d’abord à Nantes, où la location pour samedi et dimanche s’élevaient déjà à plus de vingt-mille francs.
Permutations : Mlle Laure Fleur qui jouait récemment Rodogune à l’Odéon, reprend ce soir à la Porte-Saint-Martin le rôle d’Iseult dans Jeanne d’Arc.
Vert-Vert, 15 mai 1890
Extrait des Nouvelles.
Lien : Retronews
Dernières nouvelles de Mme Sarah Bernhardt :
La grande artiste paraît aller un peu mieux, quoique toujours alitée et condamnée au repos, nous pourrions presque dire à l’immobilité la plus absolue.
La jambe gauche, sur laquelle paraît s’être porté l’effort du mal (un gonflement violent des veines, avec extravasion du sang) est toujours très rouge et un peu tuméfiée, mais l’inflammation n’augmente pas, et les médecins espèrent que, d’ici quelques jours, elle entrera dans la période décroissante.
Comme on le voit, cet état très douloureux, d’ailleurs, n’offre pas de gravité sérieuse ; c’est simple question de calme, de soins et de repos ; et, s’il est encore difficile d’assigner un terme précis à la maladie, nous pouvons, tout au moins, rassurer les nombreux amis de Sarah Bernhardt, et donner le plus formel démenti aux bruits inquiétants qu’on faisait courir, hier au soir, dans le monde des théâtres.
Tout naturellement, par suite de la maladie de Sarah Bernhardt, on a dû ajourner les représentations de Jeanne d’Arc, annoncées dans plusieurs grandes villes de province, et qui devaient commencer par Nantes, les 9 et 10 de ce mois.
On a mis des bandes sur les affiches d’annonce, et on a voulu procéder au remboursement de la location faite. Mais les choses ne se sont pas passées aussi simplement qu’on pourrait le supposer. Ainsi, à Nantes, entre autres, les personnes qui ont loué ont, pour la plupart, refusé le remboursement, et ont préféré rester inscrites pour les représentations qui, disaient-elles, se donneront… un jour ou l’autre !
Sur vingt-deux mille francs environ de location inscrite pour les deux représentations, on a pu rembourser deux à trois mille francs à peine ; et l’on attend la convalescence de la grande artiste et les futures représentations de Jeanne d’Arc.
Le Temps, 19 mai 1890
Extrait de la Chronique théâtrale, par Francisque Sarcey, en feuilleton.
Lien : Retronews
La Jeanne d’Arc de M. Barbier va disparaître de l’affiche de la Porte-Saint-Martin. Il ne serait pas juste de la laisser partir sans dire un mot de la vaillante artiste qui a recueilli la lourde succession de Mme Sarah Bernhardt, qui a sauvé la direction de l’ennui et de la honte de fermer en pleine saison.
Voyez pourtant la singulière façon dont nos théâtres sont gouvernés à cette heure. On n’y prévoit rien, on n’y prépare rien. Voici un directeur, qui, de complicité avec un impresario américain, monte pour nous exhiber Mme Sarah Bernhardt dans un nouveau rôle, la Jeanne d’Arc de M. Barbier. Le public y court ; c’est un peu, je le veux bien, pour le mérite de l’œuvre et la splendeur de la mise en scène, mais enfin, il n’y a pas à se le dissimuler, la plus forte part d’attraction était Mme Sarah Bernhardt elle-même. C’est sur sa tête seule que reposait la combinaison. Elle manquant, l’édifice croulait tout entier.
On savait par avance combien de représentations elle pouvait donner ; on savait juste à quel jour d’autres engagements l’enlèveraient à la Porte-Saint-Martin. Il n’y avait donc rien de si simple que de s’arranger pour avoir un nouveau spectacle à afficher le lendemain de son départ ; on avait trois mois et plus pour le préparer et le mettre au point.
Il semble, à voir comme se sont passées les choses, qu’on n’y ait pas songé. Ce n’est que sous le coup même d’un événement, qui était prévu, certain, qu’on s’est effaré, qu’on s’est mis en quête et de l’œuvre à jouer et des acteurs qui pouvaient la jouer. Car aujourd’hui on n’a plus de troupe. Quand on monte une pièce, on s’en va quêter dans les autres théâtres ou sur le pavé de Paris les artistes que l’on juge le plus capables de rendre les principaux rôles. On les associe pour la circonstance, ayant soin d’en avoir toujours un qu’on puisse mettre en vedette, qui soit l’étoile. C’est le système anglais le plus déplorable des systèmes ! Et quand on pense qu’il y a des gens qui font des pieds et des mains pour l’introduire à la Comédie-Française : Il ruinerait notre premier théâtre, comme il en a déjà stérilisé quelques autres.
Ah ! quel service nous rendra Antoine, s’il tient toutes les promesses qu’il nous fait dans la brochure où il nous annonce qu’il va construire un nouveau théâtre et l’établir dans des conditions qui seront nouvelles comme lui. L’un des articles les plus formels de son programme est la suppression absolue des étoiles. Chaque rôle d’une même pièce sera joué tour à tour par plusieurs artistes, et le nom des acteurs ne sera pas affiché. Ce serait peut-être pousser la défiance un peu loin. Mais j’aime encore mieux cet excès que celui par lequel nous périssons.
Je vous avais promis dans mon dernier feuilleton, qu’un des lundis de cet été j’entamerais une série d’études sur la mauvaise organisation de nos théâtres. La brochure que vient de publier Antoine nous sera comme une table des matières. Car il a dans cet opuscule touché en courant à la plupart des points douloureux sur lesquels je me propose d’insister. Il me plaît, cet Antoine. Il est plein de crânerie ; il aime le théâtre, il a des vues originales, il possède le don rare de l’autorité. Nous aurons, je le sens bien, souvent maille à partir ensemble, parce que je n’aime pas toujours son esthétique. Mais ces dissentiments n’altèrent en rien la sympathie que je lui porte. J’en ai dit bien d’autres à M. Perrin, que je tenais cependant pour un directeur de grande volée et un homme rare.
Quelle misère que ce théâtre de la Porte-Saint-Martin, où se donnèrent autrefois de si belles batailles et qui est venu à rien dans les mains où il est tombé ! Vous ne pouvez vous imaginer ce qu’a été cette queue de représentations de Jeanne d’Arc après le départ de Mme Sarah Bernhardt. Ce n’est pas que celles où jouait auparavant la grande artiste fussent toujours bien bonnes ! Ah ! Dieu, non ! Il y en a eu de lamentables, je dirais presque de cyniques. J’ai assisté à l’une d’elles, blotti dans un fond de loge. J’en suis revenu navré. J’étais tombé sur un de ces jours où Mme Sarah Bernhardt, épuisée de fatigue, mécontente ou dédaigneuse du public international qui avait payé fort cher pour l’entendre, en prenait à son aise avec lui, affectait de ne pas jouer et ne donnait vraiment de sa personne qu’à deux endroits où elle criait tout du haut de sa tête, sans conviction ni flamme. C’était elle ! on n’osait rien dire ! Peut-être même y avait-il dans la salle, tant le préjugé est fort, des personnes enchantées et qui se pâmaient d’aise.
Pauvre Mlle Forgue ! comme elle tremblait à l’idée de remplacer Mme Sarah Bernhardt.
— Je vous en prie, me disait-elle, ne venez pas me voir à la première. Je n’oserais pas… Laissez-moi le temps de me remettre…
Et je l’encourageais : après tout, ce n’était pas là un rôle que Mme Sarah Bernhardt eût fortement marqué de son empreinte ; Mlle Lia Félix lui avait été, au moins dans les passages d’enthousiasme et de force, de beaucoup supérieure. Il était facile de montrer le factice de cette diction chantante et monotone, que Mme Sarah Bernhardt étend aujourd’hui sur ses rôles, en y substituant un débit nuancé et varié qui se pliât au sens de la phrase poétique et la fît valoir.
J’ai vu depuis Mlle Forgue ; il est certain qu’elle n’a pas, dans l’ensemble de la personne, cette divine élégance, ni dans les attitudes et les jeux de physionomie cette grâce extatique qui nous avaient ravis chez Mme Sarah Bernhardt. Mais elle a de l’énergie et du feu ; et les deux derniers actes, qui sont les plus beaux du drame, ont été enlevés par elle avec une force singulière. Autour d’elle, hélas ! on jouait mollement, et, comme disent les bonnes gens, pour l’amour de Dieu. Le public était clairsemé et froid ; c’était une salle grise. Les acteurs, qui avaient déjà redit tant de fois les mêmes vers, semblaient bâiller en dedans à les répéter une fois de plus. La claque elle-même battait des mains languissamment. Partout, sauf chez Mlle Forgue, le laisser-aller et l’ennui.
Antoine (je reviens toujours à lui) nous jure que, dans son théâtre, on ne donnera jamais la même pièce plus de quinze jours de suite. Quinze jours, le terme sera peut-être un peu court, quand il y aura grand succès. C’est chez Antoine l’exagération d’une idée très juste. Il est absurde de prolonger une pièce sur l’affiche, quand la recette commence à baisser. Les acteurs, qui en sont fatigués, ne la jouent plus avec le même zèle ; ils ne travaillent plus en scène, ils ne se renouvellent plus ; ils tournent simplement la manivelle de leur rôle. Ajoutez qu’une œuvre qui s’éternise ainsi sur l’affiche bouche le passage aux autres qui attendent. La Porte-Saint-Martin nous donne une pièce nouvelle par an, et encore cette pièce nouvelle n’est-elle parfois qu’une reprise, comme la Jeanne d’Arc de M. Barbier.
Le Figaro, 12 juin 1890
Extrait du Courrier des Théâtres, par Georges Boyer. Lettre de Sarah Bernhardt au Figaro annonçant son rétablissement.
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt nous adresse la lettre suivante, qui mettra fin aux bruits fâcheux qui courent sur son état de santé.
Mon cher ami,
La note parue dans les journaux de ce matin est faite pour inquiéter le public anglais devant lequel je dois jouer dans quelques jours.
Le docteur Lucas Championnière a envoyé un certificat à Mayer, directeur du théâtre de Londres. Ce certificat me donne l’autorisation de jouer le 23 juin, et je jouerai, je vous l’affirme.
Amitiés.
Sarah Bernhardt.
Le Figaro, 16 juin 1890
Extrait du Courrier des Théâtres, par Georges Boyer sur la jambe de Sarah Bernhardt.
Lien : Gallica
Une plaisante histoire que nous trouvons dans le Monde artiste :
La jambe de Mme Sarah Bernhardt.
Je vous le donne en cent !… Je vous le donne en mille !.. comme dit le personnage de la comédie. C’est le cas de le répéter après lui, car la chose en vérité est plus qu’invraisemblable.
On se souvient que dès les premiers jours de la maladie de Mme Sarah Bernhardt nous avions annoncé que si l’intéressante malade ne prenait pas les plus grandes précautions, la maladie pourrait s’aggraver, et nous citions l’exemple de la pauvre et sympathique Herbert-Cassan, à laquelle on avait été forcé de couper la jambe.
Plusieurs de nos confrères avaient, très aimablement, reproduit cette information alarmiste et le bruit s’était répandu en Europe et en Amérique l’amputation de la jambe de la grande tragédienne était imminente. Aussitôt un barnum des plus connus, des mieux cotés, envoya à Mme Sarah Bernhardt un télégramme dans lequel il lui demandait de lui vendre sa jambe coupée ! qui devait être embaumée et promenée à travers les trente-six États de l’Union. Le télégramme ajoutait que deux représentants du barnum allaient s’embarquer aussitôt pour venir à domicile prendre possession de l’achat !
N’est-ce pas incommensurable, en vérité ? Et pour qu’on ne doute pas de l’exactitude de cette information, nous dirons que la nouvelle en a été donnée à un de nos amis par Mme Sarah Bernhardt elle-même, qui, en pleine voie de guérison à cette heure, rit un peu de cet excès de célébrité qui l’expose à d’aussi excentriques propositions.
Le Gil Blas, 17 juin 1890
Extrait des Propos de coulisses : report de la tournée.
Lien : Gallica
Potins d’Amérique : Le regret a été général, écrit-on de New-York au Palignani, en apprenant que madame Sarah Bernhardt ne remplirait pas son engagement envers M. Henry-E. Abbey.
Il court ici cette absurde rumeur, que la véritable cause empêchant la célèbre tragédienne de tenir ses promesses, c’est son amour, non partagé, pour le major Marcus Mayer, l’affable agent et gérant général de M. H. Abbey.
Toutefois, M. Mayer est un célibataire décidé, et bien qu’il admire madame Sarah Bernhardt, son dévouement chevaleresque pour madame Patti, n’a jamais fait doute. Tant que Nicolini vivra, Mayer ne pensera pas au mariage.
The New York Herald, June 21, 1890
Arrivée de Sarah Bernhardt à Londres.
Lien : Gallica
Mme. Sarah Bernhardt.
Mme. Sarah Bernhardt has arrived in London, and will, notwithstanding reports to the contrary, appear, as already stated in the Herald, at Her Majesty’s Theatre on Monday next [June, 23]. She will also lend her artistic assistance on the occasion of the Marlowe Memorial performance at the Shaftesbury Theatre next week.
Le Temps, 22 juin 1890
Rejet de la Jeanne d’Arc de Joseph Fabre par la Comédie-Française, malgré l'engouement suscité par le succès de la reprise de Barbier à la Porte-Saint-Martin.
Lien : Gallica
Jeanne d’Arc et la Comédie-Française
Un homme que l’on rencontre en ce moment navré et doucement irrité, car c’est un doux, est M. Joseph Fabre. L’honorable professeur se révèle sous l’aspect un peu inattendu d’un auteur dramatique déçu. Ce qui l’a conduit à porter un manuscrit au théâtre, c’est son culte pour Jeanne d’Arc, qui est devenu depuis quelques années la grande affaire, la pensée absorbante de sa vie. Il a publié successivement deux ouvrages imposants sur l’héroïne ; il s’est fait le promoteur d’une agitation pour faire de la fête de Jeanne d’Arc une fête nationale et peut-être la seule. En dernier lieu, il a traité son sujet sous la forme du drame historique et, son travail fini, il s’est rendu tout droit à la Comédie-Française. Là, il n’a pas été médiocrement scandalisé d’entendre le doyen Got, sans même dénouer les faveurs du manuscrit, lui expliquer que le moment ne lui paraissait pas propice pour monter une Jeanne d’Arc. M. Fabre peut difficilement admettre qu’il y ait quelque chose de plus pressé, de plus impatiemment attendu. Voilà l’Hippodrome qui va donner une Jeanne d’Arc. Quelle leçon pour notre première scène ! Et M. Fabre signale qu’il n’a pas été joué aux Français de pièce sur la Pucelle, depuis une tragédie de d’Avrigny, représentée en 1819, et qui est à vrai dire d’une platitude rare. Les plus subtils chercheurs auraient de la peine à trouver un prétexte pour dire : Il y a un beau vers
, et les vers ridicules y foisonnent. C’est donc sans doute uniquement en considération du sujet que le théâtre avait accepté cette tragédie.
M. Fabre s’étonne que M. Got ait discuté si le moment était bien choisi avant d’avoir lu sa pièce. Mais il était bien entendu qu’il n’y avait pas à compter sur une intrigue savante ou sur des coups de théâtre trop ingénieux. M. Fabre a mis en tableaux l’histoire merveilleuse en serrant de fort près les documents originaux. En homme qui a vécu dans la familiarité des chroniques et des pièces du procès, il fait tenir à chaque personnage son langage propre, avec un tour d’archaïsme qui augmente l’intensité de la couleur locale, qui ajoute à l’impression de vérité, du moins à la lecture, car c’est une question de savoir si, à la scène, le public suivrait toujours sans fatigue un dialogue d’une ingénuité si savante. Quoi qu’il en soit, c’est une œuvre méritoire et la première fois qu’un théâtre croira le moment venu de mettre Jeanne d’Arc sur son affiche, il fera bien de penser à l’adaptation de M. Fabre comme à l’une des plus précises et des plus colorées.
C’est que l’occasion peut se présenter pour des théâtres de tout ordre, sans compter l’Hippodrome. On ne s’arrangerait plus de la sobriété de mise en scène et de la fidélité à l’unité de lieu qui subsistaient dans la tragédie de d’Avrigny, et il n’est pas douteux que des pièces qui sont, avant tout, un enseignement animé de l’histoire nationale, pièces à grand spectacle avec cortèges et cavalcades, ne soient particulièrement bien placées sur les théâtres populaires. M. Fabre reproche à la Comédie-Française d’obéir à des préoccupations trop commerciales ; mais il n’est pas du tout établi que la représentation d’une pièce sur Jeanne d’Arc soit nécessairement une mauvaise affaire, un pur acte d’abnégation patriote : on a eu des preuves du contraire jusqu’à nos jours. Mais, tout d’abord, quand un théâtre se décide à aborder ce sujet, c’est qu’il voit
une Jeanne d’Arc. M. Jules Barbier a présenté plusieurs années son drame en vers jusqu’au jour où Offenbach le demanda pour la Gaîté, avec de la musique de scène de M. Gounod, en vue de Mme Lia Félix. Il vient d’obtenir de nouveau un grand succès à la Porte-Saint-Martin, parce que le rôle avait tenté Mme Sarah Bernhardt. La Comédie-Française aurait-elle agi sagement, non seulement au point de vue commercial, mais dans l’intérêt de sa réputation artistique, en choisissant ce moment pour opposer Jeanne d’Arc à Jeanne d’Arc, si, comme il est vraisemblable, elle n’était pas sûre d’avoir sous la main une comédienne désignée pour réussir complètement dans ce rôle ? Et puis, il faudrait pouvoir se représenter exactement les circonstances ; au lendemain précisément de l’apparition de Mme Sarah Bernhardt dans le drame de M. Barbier, il y a eu une émulation d’hommages à Jeanne d’Arc qui menaçait de fatiguer le public, si le sujet n’était pas de ceux qui n’ont plus rien à craindre des caprices de la mode. Chaque jour faisait éclore un projet de monument sur un point différent ; chacun devait éclipser tous les autres. On a même vu naître une rivalité assez âpre entre deux diocèses voisins. La Comédie-Française a bien pu légitimement ne pas se soucier de se jeter dans cette concurrence bruyante et réserver son heure pour un hommage de reconnaissance nationale qui, dans notre pays, sera toujours d’actualité
. Dès à présent, M. Fabre a assez de lecteurs pour que la patience lui devienne facile.
L’Ordre de Paris, 22 juin 1890
Barbier a adapté son texte pour ne pas blesser la susceptibilité du public anglais
.
Lien : Retronews
Nous avons le plaisir d’annoncer que Mme Sarah Bernhardt est presque complètement guérie et qu’elle espère commencer, lundi prochain, à Londres, ses représentations de Jeanne d’Arc.
M. Barbier a fait quelques légères modifications à son drame pour ne pas blesser la susceptibilité du public anglais.
Mme Sarah Bernhardt compte toujours jouer la Cléopâtre de M. Victorien Sardou, l’hiver prochain, à la Porte-Saint-Martin, avant sa grande tournée en Amérique.
Vert-Vert, 22 juin 1890
Extrait de la rubrique Province et Étranger.
Lien : Retronews
Le départ de Sarah Bernhardt pour Londres avait pris, hier matin [vendredi 20 juin], à la gare du Nord, les proportion d’un événement. Beaucoup de monde, et, en dehors des curieux, des amis en grand nombre, venus pour serrer la main à la grande artiste, qui, le soir même, d’après une dépêche, débarquait à Londres en bonne santé.
C’est après-demain, lundi 23, que commenceront à Her Majesty Théâtre, les représentations tant attendues de Jeanne d’Arc. L’annonce de ces représentations excite à Londres, une grande curiosité, ainsi qu’en témoigne la location faite d’avance, qui est considérable.
Les Anglais, qui savent que cette création de Jeanne d’Arc est assurément une des plus belles et des plus originales créations de notre célèbre tragédienne, dont ils tiennent le talent en si haute estime, se préparent à lui faire fête, à sa rentrée au théâtre, après deux mois de sérieuse maladie.
Jeanne d’Arc sera jouée à Her Majesty par toute la troupe de la Porte-Saint-Martin, avec toute la mise en scène de ce théâtre ; la partition de Gounod accompagnera le drame de Jules Barbier, et c’est M. Louis Pister, le chef d’orchestre qui a présidé cent cinquante fois à Paris à l’exécution musicale du drame, qui dirigera également à Londres.
The New York Herald, June 24, 1890
Lien : Gallica
Mme. Bernhardt at Her Majesty’s.
Mme. Sarah Bernhardt is certainly entitled to credit herself with the achievement of a memorable feat. She attracted to Her Majesty’s to-night a far greater number of playgoers than have assembled within the walls of that theatre for many a long year. For once in a way the big house in the Haymarket may be said to have been crowded to overflowing.
The fact is all the more remarkable as indicating the magnetic character of Mme. Bernhardt’s personality when the peculiar nature of the play in which she appeared is taken into consideration. Jeanne d’Arc
is, in reality, no play at all.
Everyone will be anxious to see her impersonation, for it is unlike anything which the actress has done in England on the occasions of her previous visits.
Le Gaulois, 25 juin 1890
Extrait des Échos de l’étranger.
Lien : Retronews
Avant-hier soir lundi [23 juin], après dîner, le duc d’Orléans s’est rendu, avec le duc d’Aumale, le marquis de Breteuil, le vicomte de La Rochefoucauld et ses autres invités, au Majesty’s-Theater, où ils ont pris place dans la loge royale.
Mme Sarah Bernhardt jouait Jeanne d’Arc.
Dans un entracte, le duc l’Orléans et le duc d’Aumale ont prié M. Mayer, directeur du Majesty’s-Theatre, qui a eu toutes les attentions possibles pour les Princes, de les conduire à la loge de la grande artiste pour la féliciter, car c’était la première fois que le duc d’Orléans entendait Mme Sarah Bernhardt.
Mme Sarah Bernhardt a été très touchée des compliments du duc d’Orléans et du duc d’Aumale.
M. Henri Rochefort se trouvait dans la salle.
The New York Herald, June 25, 1890
Lien : Gallica
Mme. Bernhardt at Her Majesty’s.
Mme. Bernhardt’s dose of chloral.
Sensational but Unfounded Report That the Great Actress Nearly Poisoned Herself.
[By the Herald‘s special wire.]
London, June 24.
Quite a sensation was caused in London to-day by the following paragraph which appeared in an evening paper :—
When the curtain fell on
Joan of Arclast night at 12.30 Mme. Sarah Bernhardt returned to the Savoy Hotel, where she is staying, and retired to bed. Unable to sleep, she took an overdose of chloral, about one hundred and twenty grains, swallowing the contents of the whole bottle. She soon felt the effects of this tremendous dose, and called for assistance. This was about four o’clock this morning. Dr. Vintras, physician to the French Embassy, was immediately summoned, and administered the necessary remedies. Had aid come a few minutes later the world would never have seen the great tragedienne again. When he left her at eight o’clock this morning, Dr. Vintras pronounced her out of danger. Mme. Bernhardt was late this afternoon in a fair way to complete recovery, and she is determined to make a great effort to fulfill her engagement this evening.
A Herald representative called at the Savoy Hotel, and as the result of his inquiries, we are enabled to give an emphatic denial to the above sensational report. The facts of the matter are these.
Mme. Bernhardt returned from the theatre at a late hour last night in a highly excited and nervous condition, which is not to be wondered at after so long a performance before a comparatively strange audience. She was unable to sleep, and passed a very bad night, and this morning she felt as people usually feel after a sleepless night coming on top of excessive fatigue. The whole sensational story published is a myth, and Mme. Bernhardt’s condition is so little serious that she has not even seen a medical man.
She appeared in Jeanne d’Arc
this evening.
[Page 2.]
Mme. Bernhardt is anxious to explore Africa, and offers to accompany Mr. Stanley on his next expedition. Africa, however, is no place for the eminent tragedienne. How would she like the idea of undergoing starvation and growing thin. Such, however, is the ordinary fate of African explorers.
Le Siècle, 26 juin 1890
Extrait de la rubrique des Théâtres.
Lien : Retronews
Les dépêches de Londres annoncent que les débuts de Mme Sarah Bernhardt dans Jeanne d’Arc ont eu lieu, au Théâtre-Royal, devant une salle comble. Mme Sarah Bernhardt a obtenu le plus vif succès.
Bien que ce drame ne soit pas de nature à plaire à des Anglais, les journaux d’outre-Manche estiment que dans la version de M. Barbier se trouvent certains passages qui flattent la vanité britannique, et que jamais, du reste, la comédienne n’a montré plus de talent.
Bien entendu, Mme Sarah Bernhardt n’a pu échapper aux rigueurs de l’interview. Comme un journaliste lui demandait ce qu’elle pensait de Stanley [l’explorateur qui partit en Afrique à la recherche du docteur Livingstone en 1871], elle aurait répondu qu’elle brûlait pour lui d’une passion véritable, mais d’une passion purement artistique
. L’Evening News nous apporte, du reste, les paroles prononcées par la divine Sarah
, comme on l’appelle là-bas :
J’admire Stanley à l’égal du plus grand des hommes… Je l’adore, savez-vous ? J’ai de lui toutes les photographies que j’ai pu me procurer, de face, de profil, de trois-quarts. Je ne me tiens pas de joie à l’idée de pouvoir l’accompagner dans une exploration au cœur de l’Afrique. Si seulement il me le demandait ! Je serais très heureuse de partir avec lui. Oui, j’irais, j’affronterais tous les périls qu’il a affrontés ; j’en serais enchantée !
Et l’Evening News demande ce que va penser miss Tennant de ce projet ? Miss Tennant est, on le sait, la fiancée de M. Stanley.
Puisque nous en sommes à Mme Sarah Bernhardt, reproduisons la dépêche suivante du New-York Herald :
Londres, 21 juin. — Un représentant du New-York Herald s’est rendu à Savoy Hôtel, où est descendue Mme Sarah Bernhardt. Le récit d’après lequel elle aurait pris une grande quantité de chloral est absolument faux.
Mme Sarah Bernhardt revint du théâtre, hier soir, dans un état de grande excitation, qui n’a rien d’étonnant après une telle représentation. Elle ne put dormir et passa une mauvaise nuit.
Ce matin, elle se sentit très fatiguée, comme tout le monde peut l’être après une nuit sans sommeil. Toute l’histoire du chloral est un mythe et l’état de la tragédienne est tel qu’elle n’a besoin de voir aucun médecin.
De fait, Sarah Bernhardt a joué hier soir dans Jeanne d’Arc.
The New York Herald, June 28, 1890
Lien : Gallica
Mme. Sarah Bernhardt
Suddenly Loses the Use of Her Voice and Is Carried Fainting from the Stage.
[By the Herald‘s special wire.]
London, June 27.
La Voix d’Or.
Her Majesty’s Theatre is in bad luck again, and the audience which this evening taxed even the ample accommodation of the great house in the Haymarket was doomed to suffer disappointment. No sooner had Mme. Bernhardt made her entrance, than it was noticed that she was not in her usual voice. Her intonation, usually so clear that its lowest tones can be heard distinctly in the back most recesses of the pit, was weak and indistinct. If any among the audience grew anxious at these symptoms, they had not long to wait before their apprehensions were realized.
Mme. Bernhardt had only been on the stage some ten or fifteen minutes when she was observed to totter, and immediately afterwards she was seen being half carried, half assisted away by two ladies of the company as the drop fell. The audience seem to have suspected nothing more than a fainting fit, and waited quietly for twenty minutes for the play to proceed.
Then the patience of the gods
was exhausted, and murmurs and calls became frequent. These were hushed at the appearance before the footlights of M. Mayer, who claimed the indulgence of the audience in making the announcement that Mme. Bernhardt had completely lost the use of her voice for that evening at all events. A medical man, he said, was in attendance and there was no reason to hope she would be able to continue. Thereupon, the occupants of the stalls and boxes made for their carriages without more ado, and the theatre was soon empty. At a late hour to-night, Sir Morell Mackenzie was summoned to the Savoy Hotel, and remained long in attendance on his distinguished patient.
Turning the table on Mr. Irving.
Mr. Irving will occupy a novel and pleasant position in London to-night ; he will be guest instead of host in the old Beefsteak clubroom that is part of the Lyceum Theatre. Mr. Daly, keeping up the hospitable tradition of the Irving management, will give a series of little suppers after the play in the historic room where Mr. Irving has so often played the genial host. Both Mr. Irving and Miss Terry have accepted Mr. Daly’s invitation, and among other guests Mme. Sarah Bernhardt, Miss Ada Rehan and a few distinguished litterateurs and friends of both Mr. Daly and Mr. Irving will be present.
The New York Herald, June 29, 1890
Lien : Gallica
Mme Bernhardt’s Throat.
Mme. Sarah Bernhardt, who as telegraphed to you yesterday, called in Sir Morell Mackenzie to see her last night, was found to be suffering from a severe congestion of the vocal chords.
Le Gil Blas, 30 juin 1890
Extrait des Propos de Coulisses.
Lien : Gallica
Her Majesty’s Theatre est de nouveau en guigne.
Vendredi soir, madame Sarah Bernhardt la voix d’or
comme on l’appelle là-bas, avait à peine fait son entrée dans Jeanne d’Arc, qu’il était visible qu’elle ne jouissait pas de ses moyens habituels ; la voix était faible et indistincte. Enfin, dix minutes après, on remarqua que notre tragédienne chancelait, et immédiatement elle sortit de la scène soutenue par deux actrices. Et le rideau tomba.
On ne crut d’abord qu’à un évanouissement et l’on attendit assez patiemment, près d’une demie heure durant, mais on finit par perdre patience, et M. Mayer parut annonçant que madame Sarah Bernhardt, pour le moment, était complètement aphone et qu’elle ne saurait continuer.
Alors chacun fit tranquillement demander sa voiture, et le théâtre fut bientôt vide.
Tard dans la soirée, le docteur Mackenzie s’est rendu à Savoy-Hotel, où il resta longtemps auprès de la célèbre patiente.
The New York Herald, July 2, 1890
Lien : Gallica
At the matinee to be held at the Criterion to-morrow in aid of the poor of Camberwell, Mme. Sarah Bernhardt has kindly consented to give a recitation. In addition to the Duchess of Teck, the Duchess of Edinburgh and her daughters have signified their intention of being present.
The New York Herald, July 3, 1890
Lien : Gallica
The matinee to take place at the Criterion Theatre to-day in aid of the poor of St. Luke’s, Camberwell, will be rendered additionally attractive by the presence of Mme. Sarah Bernhardt, who has consented to give a recitation. The Princess Mary Adelaide and the Duchess of Edinburgh have signified their intention of being present.
The New York Herald, July 5, 1890
Lien : Gallica
In playing the role of Adrienne Lecouvreur
[drame d’Ernest Legouvé et Eugène Scribe (1849) repris par Sarah Bernhardt à la Gaîté-Lyrique en 1880] to-night at Her Majesty’s Mme. Bernhardt showed no signs of illness or fatigue. In the stronger scenes the actress surpassed herself. To-morrow she appears in La Dame aux Camelias
[drame d’Alexandre Dumas fils (1852) repris par Sarah Bernhardt à la Gaîté-Lyrique en 1880].
Le Ménestrel, 6 juillet 1890
Extrait des Nouvelles diverses.
Lien : Gallica
Nouvelles de Londres. — […] Après l’insuccès relatif de l’excellente troupe du Gymnase, tout à fait dépaysée dans un cadre aussi vaste, Mme Sarah Bernhardt pouvait seule ramener la foule dans cette salle malheureuse de Her Majesty’s. La tentative pourtant était des plus hardies : jouer Jeanne d’Arc en français, à Londres ! La presse locale s’est tirée d’embarras en critiquant la pièce de M. Jules Barbier, sans nullement toucher la question historique. Malgré ces réserves de la critique, la grande artiste, bien qu’à peine remise de sa récente indisposition, a su vite conquérir son public et s’est fait rappeler à plusieurs reprises. L’exécution de l’intéressante partition de Gounod, confiée à un orchestre et à des chœurs suffisants, est tout à fait convenable.
The New York Herald, July 7, 1890
Lien : Gallica
Mme. Sarah Bernhardt, who relinquished Jeanne d’Arc
rather sooner than was originally intended, will appear this week at Her Majesty’s Theatre in Adrienne Lecouvreur,
La Dame aux Camelias,
and La Tosca
[drame de Victorien Sardou créé par Sarah Bernhardt à la Porte-Saint-Martin en 1887].
The New York Herald, July 8, 1890
Lien : Gallica
At the Criterion matinee there was no one at the stage door to receive Mme. Bernhardt. She went home angry. On the next day the Shaftesbury management was prepared to welcome Madame in full state, but she did not arrive. The Marlowe benefit did very well, nevertheless. Mme. Bernhardt’s Adrienne is just as fine a performance as ever, and soon she will be seen in La Tosca.
The New York Herald, July 13, 1890
Lien : Gallica
Mr. Marcus Mayer, who has represented Mr. Henry E. Abbey in many ticklish negotiations with Mme. Patti, Mme. Sarah Bernhardt, Miss Mary Anderson, Mrs. Langtry, Mr. Henry Irving and other great footlight artistes, has now made a bid for himself as a star of even greater magnitude.
While talking in San Francisco with Mr. Williamson, the Australian manager, Mr. Mayer said he could be in Paris in fifteen days. Mr. Williamson said it was not possible, and a bet was thereupon made that Mayer could not reach Paris to dine at the Café Anglais on July 24, the dinner to be served for twenty-four, and repeated for twenty-four nights, the guests to be prominent dramatic people. If Mr. Mayer is not at the Café Anglais on July 24 between five and half past, he loses ; if he is there in time Mr. Williamson will have the pleasure of paying about $15,000 for the twenty-four dinners.
Mr. Mayer will sail either on the Saale or the City of New York on July 16. Lots of money is staked on the result.
L’Union Libérale, 13 juillet 1890
Extrait des Nouvelles théâtrales. Représentation à Nantes.
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt
Nous pouvons espérer voir à Tours, comme cela avait été indiqué, Mme Sarah Bernhardt. Voici, en effet, ce que nous lisons dans un journal de Nantes :
Nous allons enfin avoir les deux représentations, si longtemps attendues, de Mme Sarah Bernhardt.
On n’a pas oublié les circonstances qui empêchèrent une première fois, au mois de mai, la célèbre artiste de tenir ses engagements et de faire en province la tournée arrêtée.
Une maladie grave, qui la frappa au moment même où elle interrompait ses représentations à la Porte-Saint-Martin, et qui devait la retenir un mois à la chambre, força MM. Abbey et Grau, ses impresarii, à ajourner à une époque indéterminée les soirées promises.
Mme Sarah Bernhardt à peine rétablie, il lui fallut se rendre à Londres où l’appelait un engagement préalablement signé avec M. Mayer, qui la liait pour le mois de juin, et ce fut en vain que M. Simon, administrateur de la troupe, demanda au directeur anglais de reculer ses représentations jusqu’en juillet afin de permettre à la tragédienne, de faire en France la tournée convenue : M. Mayer exigea l’exécution stricte des engagements.
Voilà comment il nous a fallu attendre si longtemps le plaisir d’applaudir Mme Sarah Bernhardt. Aussitôt libre, elle s’empresse de tenir sa promesse, et nous la verrons à la Renaissance, le samedi 19, dans Jeanne d’Arc et le dimanche 20 dans la Tosca.
Le Figaro, 16 juillet 1890
Extrait de la Correspondance anglaise, par T. Johnson. Fin du séjour anglais.
Lien : Gallica
Je n’ai pas à vous parler de la Esmeralda [opéra en quatre actes de Louise Bertin (1836), livret de Victor Hugo d’après son roman Notre-Dame de Paris (1831)] dont le succès a été si grand samedi à Covent-Garden [opéra de Londres] ; j’ajouterai cependant au compte rendu de Parisis que la mise en scène est merveilleuse, que M. Jean de Reszké et Lassalle n’ont jamais eu de rôles mieux appropriés a leur talent, que Mme Melba-Esmeralda a été de tous points ravissante, et que Mlle Pinkert, déjà très applaudie dans le page de Roméo et Juliette, a représenté Fleur de Lys avec un charme exceptionnel. On doit également rendre justice aux chœurs absolument remarquables et à l’orchestre d’une correction irréprochable sous le bâton de M. Randeggu. Vendredi, nous aurons l’Hamlet en français et la saison de clôture par Carmen, toujours en français, par MM. J. de Reszké, Lassalle et Mlle Zélie de Lussan.
Les représentations françaises à Her Majesty’s théâtre se sont terminées par la Tosca. Jamais Mme Sarah Bernhardt n’a été aussi merveilleuse que dans ce drame de M. Sardou on peut, comme certains critiques anglais, ne pas aimer la pièce, mais il est impossible de ne pas admirer l’incomparable artiste, dont le triomphe a été sans égal. Pour parer à tout événement, M. Mayer avait fait venir de Paris M. Berton, prêt à reprendre son rôle de Scarpia, tenu à Londres par M. Garnier, mais cette précaution a été inutile ; on doit des éloges à M. Dumény et à Mme Méa qui ont dignement secondé l’éminente tragédienne.
Parmi les concerts de la semaine, j’ai à citer celui de Mlles Douste de Fortis ; ces deux artistes, malgré leur jeunesse, ont le pouvoir de remplir le Princess’s Hall. J’ai connu, il y a quelque dix ans, Mlle Jeanne Douste, c’était à cette époque un phénomène. Je ne dois pas dissimuler que je la préfère aujourd’hui qu’elle est devenue une pianiste de premier ordre ; les deux sœurs sont d’ailleurs aussi appréciées à Londres qu’à Paris où leurs concerts sont également très suivis, et je suis certain que leurs nombreux amis de France seront heureux d’apprendre qu’en Angleterre leur succès va sans cesse augmentant, ce qui n’est pas toujours la règle invariable.
Extrait du Courrier des Théâtres.
Mme Sarah Bernhardt vient de revenir à Paris.
Le Journal des débats, 19 juillet 1890
Extrait de la rubrique Théâtres et concerts. Retour d’Angleterre, annonce d’une représentation de Jeanne d’Arc à Bordeaux.
Lien : Gallica
Mme Sarah Bernhardt, de retour de Londres, sera à Bordeaux lundi prochain [21 juillet], où elle donnera au Grand-Théâtre une représentation de Jeanne d’Arc.
La réplique lui sera donnée par M. Philippe Garnier et plusieurs artistes de la Porte-Saint-Martin.
Le Figaro, 21 juillet 1890
Extrait du Courrier des Théâtres, par Georges Boyer. Incident de coche, au retour de Londres ?
Lien : Gallica
On a raconté un incident auquel Mme Sarah Bernhardt a été mêlée, nous avons demandé la vérité à la grande comédienne et voici ce qu’elle nous télégraphie :
Un voyageur énervé de la lenteur du cocher à descendre mes cinquante colis s’est exprimé vivement sur cette quantité de malles. Un artiste présent a relevé le propos, une querelle s’en est suivie, laquelle querelle commencée à Angers s’est terminée à Nantes, les deux adversaires prenant le train. Mon nom inscrit sur les malles a été le point de départ de la querellé, c’est pourquoi je suis désolée, car je suis la cause involontaire de ces ennuis. Les deux querelleurs se sont serré la main et tout est calmé.
Le Figaro, 23 juillet 1890
Article (parodique ?) d’Albert Millaud.
Lien : Gallica
Tout le monde lu avec intérêt l’anecdote des malles de Sarah Bernhardt [Figaro du 21 juillet], anecdote dans laquelle le charme de la délicieuse artiste a triomphé une fois de plus. Bien simple, ce roman. Un monsieur se fâche parce que les cinquante malles de la tragédienne retardent l’omnibus de la gare ; Sarah sourit, décline son nom, et le monsieur devient son ami. Je ne crois pas que, depuis les Trois Mousquetaires et Monte-Cristo, il y ait eu quelque chose de plus émouvant. Aussi avons-nous saisi la balle au bond et sommes-nous allé interviewer Sarah, ainsi qu’il est d’usage à présent, convaincu que nous rapporterions de notre entretien une mine de ravissantes indiscrétions.
Sarah nous a reçu avec le charme dont il est parlé ci-dessus :
— Je ne suis pas comme Boulanger, nous a-t-elle dit.
— Madame, ai-je fait, tout Paris, toute l’Europe s’est émue en apprenant qu’un monsieur avait pris la mouche pour vos cinquante malles. Était-ce bien de cinquante malles qu’il s’agissait ?
— Non, monsieur, répond Sarah, il y en a seulement 48.
— Pouvez-vous me les décrire ? Le public est si friand de ces détails.
— Volontiers. Vingt de ces malles sont en bois, à trois compartiments chacune, et mesurent 1 mètre 20 sur 80 centimètres de hauteur. Ce sont des malles pour mes robes de prix. J’ai ensuite 14 autres malles pour mes jupons, mon linge, mes chaussures et pour mes robes de moindre valeur. Ces malles sont en osier, recouvertes de toile cirée.
— Sont-elles également à trois compartiments.
— La plupart, mais il y en a où les compartiments sont eux-mêmes divisés en deux, trois et même quatre sections, pour contenir les menus objets, tels que bottines, ustensiles de coiffure perruques, etc.
— Et les chapeaux ?
— J’ai trois malles spéciales, tout en hauteur, contenant des supports sur lesquels se tiennent les chapeaux. De cette façon, je les conserve frais ce n’est pas que ce soit commode, mais ça tient de la place.
— Je pense qu’à la gare d’Angers il n’a pas été possible de les peser d’un seul coup ?
— On les a pesées en cinq fois. Total général 2.700 kilos.
— Vous avez donc eu du surcoût.
— Je le pense, n’ayant droit qu’à 30 kilos.
— Je ne sais pas si je ne vais pas être indiscret en osant vous demander quel numéro portait votre bulletin pour Nantes ?
— Le n° 17. Chose curieuse ! la gare d’Angers ne possédait pas 50 étiquettes avec le n° 17. Il a fallu en faire une vingtaine à la main et même étiqueter quelques colis à la craie.
— C’est palpitant.
— Venez me voir souvent. J’ai toute une collection de petites histoires dans ce genre-là et je vous fournirai beaucoup de renseignements comme ceux-ci.
— Quelle joie, madame ! Vous êtes la Providence du reportage et de l’interview. Je m’attache à vos pas.
Le Phare de la Loire, 23 juillet 1890
Lien : Retronews
Détail rétrospectif sur le voyage de Sarah Bernhardt à Nantes et qui fait peu d’honneur à la galanterie de certains voyageurs.
Samedi dernier [19 juillet], dans l’après-midi, la troupe de Sarah Bernhardt qui venait de jouer à Angers, arrivait dans l’omnibus à la gare de cette ville quand un voyageur, impatienté des colis que le garçon descendait de l’omnibus, s’écria : Avez-vous bientôt fini avec tous ces cabotins ?
M. Garnier, l’un de ces cabotins, alla à lui et le souffleta. L’autre riposta et une bagarre s’ensuivit. Sarah Bernhardt voulut s’en mêler, elle fut bousculée et renversée à terre. Le commissaire de surveillance arriva et fit monter Sarah Bernhardt et M. Garnier dans un compartiment. L’agresseur voulut les suivre et on eut beaucoup de mal pour le faire monter dans un autre compartiment.
Il s’est calmé sans doute en chemin, car nous n’avons pas entendu dire qu’il y ait eu d’incident à Nantes à l’arrivée du train.
Le Petit Provençal, 28 juillet 1890
Jeanne d’Arc à Montpellier.
Lien : Retronews
La représentation de ce soir dimanche [27 juillet], organisée au Grand-Théâtre [de Montpellier], avec le concours de Mme Sarah Bernhardt et la troupe de la Porte-Saint-Martin, a réussi au delà des prévisions. La pièce elle-même, Jeanne d’Arc, est fort remarquable et les interprètes se sont montrés supérieurs à tous les points de vue.
Le Gil Blas, 30 juillet 1890
Extrait des Propos de Coulisses. Jeanne d’Arc à Montpellier.
Lien : Gallica
Télégramme de notre correspondant de Montpellier.
Sarah Bernhardt a joué hier soir [27 juillet] Jeanne d’Arc, devant un public nombreux qui n’avait pas craint d’affronter une température caniculaire. Est-ce à la chaleur qu’il faut attribuer les incidents tumultueux qui ont agrémenté la représentation ou bien plutôt au vent d’anarchie qui souffle depuis quelques jours à Montpellier ?
Toujours est-il que le public s’apercevant qu’on faisait des coupures au quatrième acte, a protesté avec énergie et a réclamé à grands cris le tableau du sacre qui n’est pas représenté en province, à cause de la figuration et des décors. On a dû baisser le rideau. Un artiste a essayé vainement d’expliquer le fait, mais il a été hué par le public qui ne voulait rien entendre. Le tapage n’a cessé que grâce à Sarah qui, en quelques mots charmants, a prié le public de laisser continuer la pièce.
La voix d’or
a produit plus d’effet que toutes les explications, et la représentation s’est terminée sans encombre à une heure fort avancée.
Le Soleil, 2 août 1890
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt à Lyon
Lyon, 31 juillet.
Ce matin à sept heures, Mme Sarah Bernhardt est arrivée, ainsi que sa troupe, en gare de Perrache, par l’express, venant d’Avignon. Détail curieux : ses bagages sont tellement nombreux qu’ils n’ont pu trouver place dans un seul wagon.
L’artiste a remporté un grand succès ce soir dans Jeanne d’Arc.
Vert-Vert, 8 août 1890
Extrait des Nouvelles. Répétitions de Cléopâtre.
Lien : Retronews
On va commencer à s’occuper, à la Porte-Saint-Martin, de la Cléopâtre de MM. Victorien Sardou et Émile Moreau, dont Sarah Bernhardt doit créer le principal rôle.
La pièce est complètement terminée ; les costumes et les décors sont commandés. Mais il n’est pas encore possible de prévoir à quelle époque pourra avoir lieu la première représentation de cet ouvrage.
Vert-Vert, 16 août 1890
Extrait des Nouvelles. Préparation de la tournée internationale.
Lien : Retronews
M. Abbey, l’imprésario américain, est actuellement à Paris, où il est venu s’entendre avec Mme Sarah Bernhardt, au sujet de la tournée que doit faire notre grande tragédienne, l’année prochaine en Amérique ; tournée dans laquelle elle jouera très probablement la Cléopâtre de M. Émile Moreau et… Victorien Sardou, qu’elle créera au mois d’octobre à la Porte-Saint-Martin.
Le Figaro, 22 août 1890
Article de X., extrait de la rubrique, la Vie Parisienne : Paris l’été. Rentrée théâtrale de Sarah Bernhardt dans Cléopâtre.
Lien : Gallica
Cléopâtre
C’est enfin chose décidée, et quoiqu’en aient pu dire certains reporters trop pressés, qui ont pris l’avance, décidée et signée, depuis hier seulement.
Nous aurons, cette année, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, la Cléopâtre de Victorien Sardou, et ce sera le grand événement dramatique de la saison, car le rôle de Cléopâtre doit être la dernière création de Sarah Bernhardt, avant son départ pour la tournée de deux ans qu’elle doit entreprendre sous la direction de MM. H. Abbey et Maurice Grau. Cette tournée, qui doit commencer au mois de janvier 1891, pour finir au commencement de l’année 1893, comprendra les deux continents américains Nord et Sud, l’Australie, les grandes Indes, une partie de l’Asie… C’est plus qu’un tour du monde.
À l’origine, Cléopâtre devait être jouée après Jeanne d’Arc ; et les répétitions des trois premiers actes, commencées au mois de février dernier, allaient leur train, sous la direction de M. Émile Moreau, le collaborateur de Victorien Sardou, tandis que celui-ci, enfermé chez lui, écrivait les trois derniers, tout en pestant contre la nécessité qui le tenait éloigné de l’avant-scène, ce champ de bataille où il est tacticien sans rival. Il fallait bien procéder ainsi, puisque la grande artiste, liée par des engagements antérieurs, devait partir le 15 juin pour New-York, afin de commencer la série des représentations dont nous parlions tout à l’heure.
L’homme propose et… la coqueluche dispose : un beau matin, l’auteur de Patrie a été pris de ce mal…
Dont la garde qui veille aux barrières du Louvre
Ne défend pas nos rois.
Il dut s’aliter,et prendre un repos forcé de plusieurs mois repos bien en dehors des habitudes d’un homme dont le travail est incessant et dont l’activité est fébrile mais quoi ! il n’y avait pas à lutter. On interrompit alors les répétitions commencées, et force fut bien de remettre à plus tard les représentations de Cléopâtre.
Remettre Cléopâtre à la saison prochaine, cela paraissait tout simple, n’est-ce pas ? mais c’était plus facile à dire qu’à faire et les traités passés, et les conventions avec les théâtres d’Amérique, les unes succédant aux autres, sans interruption, appuyées de dédits considérables et qui ne plaisantent pas, — cinquante mille francs, par ci ; — cent mille francs, par là ; il y en avait pour plus d’un million !
Que faire ? Renoncer à jouer Cléopâtre à Paris ? Renoncer à un rôle admirable, à une création dès longtemps caressée et dont la grande artiste veut faire la suprême expression de son talent dramatique : quel chagrin !
Quel crève-cœur de ne pas demander au public parisien, le plus connaisseur et le plus lettré des publics, la consécration du succès, cette consécration que lui seul au monde peut et sait donner !
La grande artiste avait un tel désir de jouer Cléopâtre quand même, les trois premiers tableaux de l’œuvre inachevée l’avaient tellement séduite, l’emballement était tel, qu’elle offrit de payer la bagatelle de trois cent mille francs de dédit pour obtenir un répit de quelques mois. L’Amérique fut insensible. Ce retard eût amené des difficultés et des procès sans nombre. Seul, un cas de force majeure pouvait en créer la possibilité.
Ce cas de force majeure, le hasard, là Providence — disons, si vous le voulez, la chance — c’est une sorte de transaction entre les deux — le fit naître sous forme de maladie.
La grande artiste dont la bonne santé est proverbiale, dont l’énergie résiste à toutes les fatigues, dut prendre le lit, vers la fin du mois de mai, terrassée par le mal ; un mal terrible qui faillit lui coûter la jambe droite ; il est vrai que comme compensation, un impresario lui avait offert un bon prix de cette jambe, au cas où le chirurgien eût dû en pratiquer l’amputation. — Il se proposait d’embaumer, avec soin, le membre précieux et de le promener à travers le monde, ni plus ni moins, révérence parler, que la carcasse du brigand Cartouche, qui fait le plus bel ornement des foires. — Cette alléchante proposition ne séduisit pas autrement Sarah Bernhardt, qui préféra conserver sa jambe, et la conserva en effet, grâce aux soins dévoués de l’habile chirurgien Lucas Championnière.
Aujourd’hui il n’y paraît plus, elle est mieux portante que jamais, et ce repos forcé de plusieurs mois lui a, comme elle dit plaisamment elle-même, donné mieux qu’un coup de fer à la minute : c’est une remise à neuf complète. Or, voyez que lorsqu’on est chanceux, on ne l’est pas à demi, voilà que sa maladie a été un mal pour un bien — ce retard que ni prières ni offres d’argent n’avaient pu lui obtenir, sa maladie le lui a donné — elle n’aurait pu commencer ses représentations d’Amérique que trois mois après l’époque convenue, c’était un trouble complet dans l’ordre de ces représentations échelonnées, un changement dans leur date et leur économie, d’où là possibilité, la nécessité même de retarder de plusieurs mois et de remettre à janvier 1891 le départ primitivement fixé à juin 1890.
Aujourd’hui, tout est convenu, arrêté, signé, et nous aurons la première représentation — une première à sensation — de Cléopâtre dans les premiers jours d’octobre prochain. Mais, quel que soit le succès de la nouvelle œuvre de Victorien Sardou, sa carrière ne pourra, quand même, dépasser les premiers jours de janvier 1891. Le 8 janvier, quoi qu’il arrive, la grande artiste s’embarque, et en route pour New-York, où ses représentations commencent vers le 20 du même mois. All right ! ! !
Du drame de Victorien Sardou, nous pourrions vous dire bien des choses ; peut-être même pourrions-nous, si nous n’étions pas discret, vous raconter par le menu cette œuvre tout à fait curieuse et l’une des plus complètes qui soient sorties de la plume du maître, qui, d’ailleurs, se loue beaucoup de l’utile collaboration d’Émile Moreau. Nous pourrions vous dire la part de chacun des collaborateurs, et aussi celle du vieux William (celle-ci est mince, tout au plus l’emprunt de moitié d’un acte). Mais le maître n’aime pas qu’on parle trop tôt de ses œuvres, il préfère et avec raison les comptes rendus du lendemain à ceux de la veille, et nous garderons close la bouche qui nous démange.
Nous pouvons bien dire, toutefois, que Cléopâtre est en cinq actes et six tableaux, que c’est le drame de l’Amour, et que les aventures de la célèbre reine d’Égypte fournissent un cadre admirable pour le metteur en scène, d’autant mieux que les milieux traversés par l’action sont d’un grand pittoresque et d’une grande diversité.
C’est à Tharse, la ville médique, sur les bords du Cycnus, que commence le drame, et l’on verra arriver Cléopâtre sur le fameux navire aux cordages d’argent et aux voiles de pourpre, si compendieusement décrit par Plutarque — c’est au lendemain de la bataille d’Actium qu’il se termine — c’est dire que le spectateur sera promené de merveilles en merveilles, à travers l’Asie-Mineure et l’Égypte.
Cléopâtre s’intitule drame, c’est vraiment tragédie-féerie qu’il faudrait dire, car l’œuvre de Victorien Sardou est entourée d’une mise en scène féerique, qui de beaucoup doit dépasser, dit-on, celle de Théodora, qui a partout laissé de grands souvenirs. Depuis six mois, décorateurs et costumiers travaillent, et c’est à grand-peine si l’on pourra arriver au jour dit.
C’est Thomas qui dessine les costumes, il y en a plusieurs centaines, et quels costumes ! — rien d’Aida, je vous assure. — Thomas veut faire une Égypte antique aussi près du réalisme que possible, et nul mieux que lui, qui a habité l’Égypte et la connaît à fond, n’est à même de réaliser ce rêve. — Quant aux décors, ils ont été distribués à Rubé, Lavastre, Chaperon, Carpezat, Jambon, Lemeunier, Amable — les premiers de nos peintres décorateurs, l’élite de l’École française ; j’ai vu les maquettes, et puis vous affirmer de visu que, comme disait le feu père Duchêne, c’est b…ent beau.
Il y a surtout un certain décor du 3e tableau, une Terrasse du Palais de la Reine, d’où le regard embrasse, à perte de vue, les plaines immenses de Memphis, qui est tout à fait extraordinaire. Si l’exécution reproduit — et je n’en doute pas, connaissant l’habileté de Rubé et de Jambon — l’effet que dessine la maquette, je crois qu’on n’aura jamais vu pareil effet décoratif.
C’est au moyen d’un procédé tout à fait nouveau au théâtre que cet effet est obtenu : — le décorateur supprime les châssis et les bandes d’air et remplace tout cela, voire même le voile du fond, par une rotonde de Panorama ininterrompue, qui enveloppe toute la scène et donne à la perspective une étendue incommensurable.
La partie musicale de Cléopâtre, car il y a une partie musicale, bien qu’il n’y ait musique que dans la coulisse et pas d’orchestre dans la salle, a été confiée à un jeune compositeur — prix de Rome M. Xavier Leroux, l’élève favori de J. Massenet.
C’est Massenet lui-même qui l’a présenté et recommandé à Sardou. Prenez-le de confiance, lui a-t-il dit, il est aussi fort que moi.
— Est-il aussi modeste et aussi malin ?
a répondu Sardou.
Et maintenant, Parisiens, mes frères, vous êtes prévenus, la première de Cléopâtre sera donnée le 6 octobre — la dernière le 6 janvier. Ensuite vous ne reverrez plus la grande artiste avant 1893.
La Petite République, 7 janvier 1891
Représentation de Jeanne d’Arc par Sarah Bernhardt pour la veuve Davyl.
Lien : Retronews
Un Groupe de journalistes organise, avec M. Duquesnel [directeur du théâtre de la Porte-Saint-Martin], une grande représentation à la Porte-Saint-Martin au bénéfice de la veuve de Louis Davyl [décédé à Paris le 16 août 1890], l’auteur de la Maîtresse légitime [comédie de 1874].
Cette représentation sera donnée la veille du départ de Mme Sarah Bernhardt, qui fera, par une œuvre de bienfaisance, sa représentation non d’adieux, mais d’au revoir.
L’éminente tragédienne a l’intention de jouer un acte de Rome vaincue, un acte de Théodora, un acte de Jeanne d’Arc et un acte de Macbeth. On parle également de Chez l’Avocat, la spirituelle comédie de Paul Ferrier, qu’elle a créée avec Coquelin aîné et qu’elle jouerait avec lui.
Un intermède, entre deux pièces, pour lequel on parle de Mmes Rauss, Caron, et de MM. Lassalle et de Reszké.
Notre confrère Armand Silvestre fait, pour la circonstance, une pièce de vers qui sera dite par Mme Worms-Baretta. On sait que Mme Baretta fut la créatrice de la Maîtresse légitime à l’Odéon.
[Note : la représentation ne put finalement pas être organisée avant le départ de Sarah Bernhardt, et fut ajournée.]
Vert-Vert, 11 janvier 1891
Extrait des Nouvelles. Départ de Sarah Bernhardt pour New York.
Lien : Retronews
Demain dimanche [11 janviers], à la Porte-Saint-Martin, Cléopâtre sera jouée, irrévocablement, pour la dernière fois en matinée.
Les représentations de Sarah Bernhardt prendront fin définitivement vendredi 16 courant.
La grande artiste doit quitter Paris le vendredi 23, et s’embarquera, avec sa troupe, sur le transatlantique la Champagne, le samedi 24, en destination de New-York, où elle doit donner, le 5 février, sa première représentation.
On sait que le théâtre de la Fifth Avenue, où la troupe française devait jouer, a été détruit par un incendie il y a quelques jours à peine, mais M. Henry Abbey, qui est arrivé à New-York samedi dernier, vient de télégraphier à M. Maurice Grau pour lui annoncer qu’il avait pu louer un nouveau théâtre, et que les représentations très attendues de Sarah Bernhardt n’auraient aucun retard à subir et commenceraient exactement au jour annoncé.
Lorsque le théâtre de la Fifth Avenue a brûlé, mistress Davenport y jouait, précisément, la Cléopâtre de Victorien Sardou et Émile Moreau, avec un très beau matériel de décors et costumes copiés sur l’admirable mise en scène de la Porte-Saint-Martin. De tout ceci, il ne reste plus un fil. Tout a été consumé et détruit.
Mme Sarah Bernhardt doit jouer ses principaux rôles à succès : Cléopâtre d’abord, sa dernière création ; puis la Tosca, Théodora, Jeanne d’Arc, la Dame aux camélias, etc., etc. Les représentations données à New-York dureront cinq semaines environ.
Le Figaro, 12 janvier 1891
Extrait du Courrier des théâtres. Dates en Amérique.
Lien : Retronews
On a dû faire relâche, avant-hier samedi, au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Vers sept heures du soir, Mme Sarah Bernhardt, très grippée depuis la veille, faisait aviser la direction qu’elle ne pouvait jouer le soir, et force fût donc de mettre une bande sur l’affiche et de rembourser la location qui était considérable. Hier dimanche, et aujourd’hui lundi, relâche, encore, deux jours, de repos ayant été jugés nécessaires, de l’avis des médecins, avant que la grande artiste pût reprendre son service régulier. Mais demain mardi, sans remise, réouverture du théâtre et 93e représentation de Cléopâtre.
Le drame de Victorien Sardou et Émile Moreau sera joué jusqu’à lundi prochain, 19 courant, 100e et dernière, c’est-à-dire qu’il aura encore huit représentations — les dernières données à Paris par Sarah Bernhardt, avant son départ pour l’Amérique.
Dimanche prochain, Cléopâtre sera jouée, une fois encore, en matinée, en remplacement de celle qui n’a pu être donnée hier.
Nous avons dit que Sarah Bernhardt s’embarquait sur le transatlantique la Champagne, le samedi, 24 janvier ; en destination de New-York, avec une troupe de quarante artistes, environ, et que sa première représentation était fixée au 5 février.
Le séjour à New-York durera cinq semaines, soit jusqu’au 14 mars, avec un effectif de 35 représentations — puis, la suite de l’itinéraire pour l’Amérique du Nord est ainsi fixé :
- Washington : jusqu’au 21 mars ;
- Philadelphie : 28 mars ;
- Boston : 4 avril ;
- Montréal : 11 avril.
La troupe arrivera à San-Francisco le 24 avril, et s’embarquera le 2 mai pour l’Australie. Nous donnerons prochainement l’itinéraire complet de ce voyage autour du monde, qui ne durera pas moins de deux années.
The New York Herald, January 17, 1891
Lien : Gallica
In an interview published by the Écho de Paris, Mme. Sarah Bernhardt states that in her coming professional tour she is to receive 3,000 fr. for each performance and one-third of the receipts, which she estimates will bring her, in an equal sum for each performance. In addition to this she is paid 1,000 fr. a week to cover her hotel bills.
Le Figaro, 24 janvier 1891
Extrait du Courrier des théâtres. Départ de la troupe de Sarah Bernhardt.
Lien : Gallica
Hier vendredi Mme Sarah Bernhardt et sa troupe, composée de quarante personnes, y compris les domestiques, a quitté Paris.
La troupe est partie de la gare Saint-Lazare à huit heures du matin. Mme Sarah Bernhardt a pris l’express de une heure, pour le Havre. Le départ s’effectuera ce matin à huit heures, sur le paquebot la Champagne.
Les voyageurs emportent avec eux 250 colis, sans compter les décors complets de la Tosca, de Cléopâtre et de Théodora, qui ne pèsent pas moins de 50,000 kilogrammes. Le prix du voyage de Paris à New-York s’élève à la somme rondelette de 40,000 francs.
Sur le quai du départ, M. Jules Barbier a remis à Mme Sarah Bernhardt les vers suivants :
Étoile d’or, sous d’autres cieux,
Dans les immensités profondes,
Porte les bonds capricieux
De ta course à travers les mondes !
Mais reviens briller à nos yeux,
Lasse d’orbites vagabondes,
Comme les astres radieux,
Aux longues chevelures blondes.
Le Gil Blas, 25 janvier 1891
Extrait des Propos de Coulisses. Itinéraire de la tournée.
Lien : Retronews
C’est aujourd’hui que madame Sarah Bernhardt doit quitter Paris pour sa grandissime tournée.
Depuis plusieurs jours la maison, pleine de malles, présentait l’aspect le plus bizarre.
Partout de grandes malles, neuves, rayées jaune et brun, avec un énorme S. B. au milieu. Chaque malle, numérotée, porte cette inscription :
Sarah Bernhardt
Theatre Star
New-York
Star est le nom du théâtre où tragédienne est attendue.
Et le hasard, qui parfois joue sur les mots, veut que l’on comprenne : Sarah Bernhardt, étoile dramatique.
Après Cléopâtre, la grande artiste jouera peut-être François Ier, drame nouveau écrit pour elle, par un auteur italien Jacosa.
Elle arrivera le 1er février, jouera le lendemain.
Je jouerai — dit-elle — à New-York cinq semaines, du 9 février au 14 mars. Puis une semaine dans chacune de ces villes : Washington, Philadelphie, Boston, Montréal, Détroit, Indianapolis, Saint-Louis et Denver. Je débuterai à San-Francisco le 24 avril.
Le 2 mai départ pour l’Australie, pour environ trois mois :
J’arrive à Melbourne le 1er juin, puis Sydney, Adélaïde et Brisbane, terminant le 31 août, et, dès le lendemain, notre voyage recommence, prenant le vapeur pour San-Francisco, où je rouvre le 28 septembre. Puis le Sud, le Mexique, la Havane et je reviens à New-York le 1er mars, et si le Sud est alors plus florissant qu’aujourd’hui, nous y jouerons en juin, juillet, août, septembre et octobre, la République Argentine, l’Uruguay et le Brésil compris. En janvier 93, je suis engagée à Londres, de là à Saint-Pétersbourg et les principales villes de l’Europe, espérant être de retour fin 93.
La troupe se compose de vingt-cinq à trente acteurs et actrices, sans compter l’aspic !
The New York Herald, January 25, 1891
Mme. Sarah Bernhardt’s Message for Americans.
Le Havre, Jan. 24, 1891.
(From our special correspondant.)
I saw Mme. Sarah Bernhardt on board La Champagne, just before the steamer sailed for New York. Mme. Bernhardt said : —
Yes, I was rather indisposed early in the week, but I am quite myself again now and am eager to be off. I adore travel on land or sea, though I am always sick on the ocean. And then I am eager to see how the New Yorkers, with their keen taste for dramatic art, will appreciate the first representation of La Dame de Choland,
by the Italian dramatist, Joseph Giacosa. This will not be the first time that I have tried a new piece in New York before bringing it out elsewhere. You know I played in La Dame aux camélias
at Paris, after New York.
Then I have my Jeanne d’ Arc
to bring out. M. Grau says it will be a failure. But I don’t agree with him. Jeanne personated by a Frenchwoman must differ from what the Americans have seen. Then the piece is so suited to young girls. They will make it a success, I am sure.
What message have I for the Americans ? Tell them I have none but the happiest souvenirs of the United States and that I shall land there with feelings of sincerest pleasure.
[Dans l’édition du 1er février.]
A Marvelous Trousseau.
As regards dress there is nothing which for years past has issued from the ateliers of Paris like the dresses which Mme. Sarah Bernhardt has carried off with her to America. Never before has such money been spent. I do not ordinarily give stage costumes, but Mme. Bernhardt’s are more than that. They are the costumes which she counts upon to last her nearly two years.
[Dans l’édition du 2 février.]
Mme. Sarah Bernhardt Behind Time.
Mr. Henry E. Abbey and several French friends, who started down the Bay on an excursion steamer in the hope of welcoming Mme. Sarah Bernhardt, were disappointed, and returned in the evening.
The New York Herald, February 7, 1891
Mme. Bernhardt in New York.
She Scores a Triumph In La Tosca
and Produces Some Strange Effects On the Audience.
New York, Feb. 6, 1891.
Mme. Sarah Bernhardt scored a triumph at her opening performance at Madison Garden Theatre in La Tosca
last night. Among those in the audience who seemed most deeply interested by the famous knife-scene in the fourth act, was Mr. Charles A. Dana, who actually shed tears ; General William Cutting became so excited that he cheered at the top of his lungs ; Marshall P. Wilder for an instant went into cold shivers ; and several women tore their programmes to shreds in their excitement, and mingled with their applause nervous little hysterical sobs.
In short, a dash of really good acting seems to be highly appreciated after the monotonous mediocrity and insipid dulness of the efforts of the native American authors and artists.
Mme. Sarah Bernhardt, by the way, has been obliged to change her hotel, because the wailers persistently served iced water in those hideously irrepressible while China pitchers, so familiar to guests in American hotels.
The New York Herald, February 8, 1891
Mme. Bernhardt Denounces the Mistakes of Modern Realism
Mme. Bernhardt on the Real and Ideal in Dramatic Art.
Mme. Sarah Bernhardt will greet the American public to-morrow, Sunday, through the medium of the New York Herald, with a letter upon the real and the ideal in dramatic art. She denounces the mistakes ,of modern realism, and sets forth what may be called her artistic credo. Sarah draws a parallel between the drama they are writing in Paris about the murderers Eyraud and Gabrielle Bompard, and Shakespeare’s Macbeth and Lady Macbeth, and points out that the passions governing the four personages are the same. She says : —
The two men were dominated by love, the two women by ambition. The women conceived the crime, they thought it out and directed the brutes who had no other thought than to obey and kill. The passion, its results, its deductions, its punishment, are all brought together in the two plays ; but in one it is terrible and sublime, and in the other it is repellant and vulgar. No, we want no realism, I we hold a mirror in which all things are reflected, but in which no truth abides. We help you to endure what there is wearisome in life ; to teach the truth of truths, we have priests ; to console us for death, we have God.
Sarah Bernhardt.
Journalistic Compliment to the Herald.
The Courrier des États-Unis to-day pays the Herald the compliment of translating into French and publishing a column of the Herald’s criticism of Mme. Sarah Bernhardt’s Tosca
on the opening night of her New York engagement.
The New York Herald, February 18, 1891
Mme. Sarah Bernhardt on The Stage.
The following highly interesting and typical article on the present tendencies of the stage was specially written for the American edition of the New York Herald by Mme. Sarah Bernhardt, and appeared in the issue of that paper dated the 8th inst.
We give the original French text, as Mme. Bernhardt’s graceful, yet forcible, language could only lose by translating :
The Real and the Ideal.
J’ai fait un beau rêve alors que j’étais jeune fille.
Je voyais un temple immense, soutenu par des colonnes d’or ; orné de fleurs toujours vivaces aux doux parfums.
Ce temple était surmonté d’un groupe de marbre. C’était une belle statue représentant l’Idéal, qui abritait sous ses grandes ailes la Triste Vérité.
Dans ce temple du plaisir, on enseignait aux fidèles que tout bien porte sa joie, que tout mal porte sa peine.
Molière, Shakespeare, Longfellow, Victor Hugo, flétrissaient et glorifiaient tour à tour les faiblesses et les passions humaines.
La moralité des faits s’imposait sans fatigue. Le public, transporté par un beau langage, se retirait, ému, charmé, terrifié et toujours enseigné.
Hélas ! hélas ! Que loin est mon rêve ! L’Idéal s’enfuit à tire-d’aile, chassé par la Vérité, qui elle-même succombera sous le Réalisme !
La nouvelle école est persuadée qu’elle fait vrai parce qu’elle fait laid. On écrit en ce moment en France un drame sur les assassins Eyraud et Gabrielle Bompard ; mais le génie de Shakespeare les avait devinés, ces deux misérables, en créant Macbeth et Lady Macbeth.
Les passions qui agitent ces quatre personnages sont les mêmes.
Macbeth, ce taureau, poussé par sa femme, assassine le roi pour voler un trône.
Eyraud, cette brute, poussé par sa maîtresse, assassine l’huissier pour voler l’argent.
Les deux hommes sont fous d’amour, les deux femmes sont ambitieuses ; elles conçoivent le crime, elles sont la pensée, la volonté du mâle abruti qui n’a de force que pour obéir et tuer.
La Justice, dans Shakespeare, est représentée par Macduff ; et par le bourreau pour l’assassin de Gouffé.
Le grand auteur anglais nous montre Lady Macbeth tuée par le remords, l’auteur français nous montrera Gabrielle Bompard pleurant son crime sur des chaussons de lisière.
Les passions, le but, les déductions, le châtiment, tout se ressemble dans ces deux drames vécus ; mais l’un est effrayant et sublime, l’autre est répugnant et banal.
Oh ! non, non, pas de réalisme ! À quoi bon ? Le théâtre sera toujours la fiction ; le château fort dans lequel on retient le prisonnier captif sera toujours en carton ; le poignard rentrera toujours dans sa gaine ; le sang qui coule de la blessure sera toujours du carmin délayé dans de l’eau.
Oh, non ! Pas de réalisme ! restons les apôtres du Rêve. Nous tenons le miroir ou tout se reflète mais où rien ne survit, nous aidons à supporter les lenteurs de la vie, notre part est assez belle !
Pour enseigner la Vérité des Vérités il y a les prêtres, pour consoler de la mort il y a Dieu.
Sarah Bernhardt.
New York, 1891.
Madame Sarah Bernhardt Poisoned.
The Popular Tragedienne Suffers from a Severe Attack of Cholera Due to Canned Mushrooms — She Will Avoid Them in Future — Mysterious Visits from Inspector Byrnes.
New York, Feb. 17.
Theatrical people are gossiping about Inspector Byrnes’ visits to Mme. Sarah Bernhardt during the past few days, and wondering what was the occasion. Then the gossip increased a hundredfold yesterday, when it was announced that Sarah was very ill, and under the care of two physicians. Canned mushrooms were the cause of the illness. After eating some at the Hoffman House on Sunday, the actress was attacked with cholera, and Dr. Gibier was summoned. He prescribed, but she suffered greatly until midnight, and all yesterday afternoon was confined to bed and no one allowed to visit her. The physicians even advised her to postpone the opening performance of Cleopatra,
but Sarah refused to disappoint the public, and appeared, though still suffering from the effects of the attack.
The performance was, of course, an event of unusual interest ; but the personal success of the actress was less complete than usual, and by many the piece was voted tedious. After the performance, Mme. Bernhardt said that the illness had almost brought her to death’s door, and it is not likely she will again partake of food preserved in a tin.
In regard to inspector Byrnes’ visits, the general impression is that Mme. Bernhardt is trying to recover some lost property.
The New York Stage.
Mme. Sarah Bernhardt Plays La Tosca
to a House Full of Professionals.
New York, Feb. 7, 1891.
(A New York Dramatic Critic.)
The return of Sarah Bernhardt to New York, after four years’ absence, has put all else in the shade. And yet had Sarah not arrived there would have been enough to interest us in the theatres this week. […]
The cable will already have informed you of the triumph of Sarah Bernhardt in La Tosca.
The house (which was largely made up of actors and actresses) was rather cold at first, and evidently bored by the long-winded speeches of the minor characters in Sardou’s play ; but Sarah’s grace and vivacity in the church scene soon broke the ice. Her agony and frenzy in the torture scene created a sensation ; and her tragic intensity in the culminating scene with Scarpia evoked a demonstration such as I do not think she has yet known in even her career.
The papers, with the one exception of the Tribune, which damned Sarah and the play on principle—before the production—unite in paying tribute to the great artist’s genius. She was at her very best on the first night—in fact, she played with more intensity and charm than I have ever seen her play.
M. Duquesne made an admirable Scarpia. I preferred him to Berton. M. Fleury, a recruit from the Conservatoire, impersonated Mario with tact and intelligence, and M. Angelo was passable as Angelotti.
Sarah, by the way, has lost two of the asps she brought with her. They died of cold. She has still her boarhound Myrta and her pet dog Chouette to console her, however. […]
The New York Herald, February 21, 1891
Secret of Mme. Bernhardt’s Confabs With Inspector Byrnes.
Mme. Bernhardt Threatened.
An explanation, other than that connected with Mme. Sarah Bernhardt’s supposed recognition of M. Macé-Berneau in the stalls of the Garden Theatre, is now offered to account for her repeated interviews with Inspector Byrnes.
It is now stated that she called in the assistance of the inspector in order to obtain protection from M. Garnier, who formerly acted with her at the Porte-Saint-Martin, and who accompanied the tragédienne on her last American tour.
M. Garnier, it appears, heard of certain unpleasant things said about him by Mme. Bernhardt on board the steamer, and at once declared that he would follow her to America and inflict personal Punishment on her en pleine scène.
Mme. Bernhardt was informed by cable of Garnier’s departure from Europe, and of his hostile intentions.
Hence the confabs with Inspector Byrnes.
[Dans l’édition du 2 mars.]
The Bernhardt-Garnier Affair.
The latest explanation of Mme. Sarah Bernhardt’s recent conferences with inspector Byrnes is that the actress imagined herself hounded by M. Philippe Garnier, the French actor, and required the protection of the police. M. Garnier, so the story goes, has for a long time exercised a mysterious power over the actress, the result being that Mme. Sarah was terribly afraid, believing that he would kill her on the first opportunity.
Garnier arrived on the Normandie the 14th inst., and was met by detectives, who urged him to return to France at once. He seemed willing to comply, but three days later he appeared at the Madison Square Garden Theatre and frightened Mme. Bernhardt almost to death. The actress thenceforth was always accompanied by and a manservant, and her peace of mind was not restored until she was assured that M. Garnier had abandoned the idea for hypnotizing her, and had sailed for France on the Normandie on February 20.
The New York Herald, February 24, 1891
Mme. Bernhardt Defends Her Interpretation of Cleopatra, and Criticises that of Miss Fanny Davenport.
In a letter to the Herald, published to-day, Mme. Sarah Bernhardt defends her interpretation of Cleopatra, which has been criticized by Miss Fanny Davenport, and says that both M. Sardou and M. Moreau regard her as the ideal Cleopatra.
I play the part exactly as I played it in Paris,
she continues, and my views as to the conception of the part are opposed to Miss Fanny Davenport’s. Cleopatra was the type of love and witchery, and in Plutarch’s portrait of her I see no trace of the virago or violent Amazon whom Miss Fanny Davenport pictures.
The New York Herald, February 26
The New York Stage
New York, Feb. 13, 1891.
(A New York Dramatic Critic.)
Mme. Sarah Bernhardt is drawing crowded houses at the Garden in La Tosca.
In a letter which Mrs. Agnes Booth, the leading actress in America, has just addressed to the Herald, a splendid tribute is paid to the French artiste’s genius.
The New York Herald, March 7, 1891
Mme. Bernhardt’s American Tour.
Too Much Talk and Not Enough Action in Cleopatra
for a New York Audience. — The Tragédienne poorly supported.
New York, Feb. 22, 1891.
(A New York Dramatic Critic.)
Sarah Bernhardt made her first appearance here on Monday in Cléopâtre.
Much curiosity had been aroused as to the play, and when the curtain rose on the first act the house (the Garden Theatre) was crowded, and every seat for the week had been sold.
You know the play and you know how Sarah acts in it, so all I need do is to tell you how the New York public greeted them.
As to the drama, it bored the audience terribly ; and, to make things worse, there were so many tedious hitches on the stage that it was nearly one o’clock before the curtain fell on the last act and Sarah withdrew with her snakes and her Mark Antony.
The snakes were pretty creatures just arrived from Philadelphia. They attracted a great deal of attention. So did Sarah. But on Monday the actress was at her worst. She had been poisoned at the Hoffman House the day before by some mushrooms which she ate at dinner, and had hardly recovered from a sharp attack of cholera nostras which resulted. This, with the insufferably hot and stuffy weather, had affected her performance.
It had not the usual charm and passion. In fact, Sarah was not herself, and the house did not applaud her with nearly as much enthusiasm as a week before, when she appeared in La Tosca.
The critics next day were divided. Some praised her quand même, some slated
her, and others, like the Herald, steered a middle course.
Not Enough Action.
On Tuesday night I saw the play again. Sarah did better, and the audience was warmer. But the part of Cleopatra is one of her worst, and the drama will never become popular here. The New Yorkers cannot stand long dreary talk in plays. They prefer action. Of this there is not much in Cléopâtre,
which to us seems tame and dull and rather foolish.
The smallness of the stage at the Garden Theatre did not allow all the elaborate effects which helped the play in Paris to be used in the production. The incidental music by Leroux was murdered, and the actors who supported Sarah Bernhardt were ill-cast.
M. Darmont, who essayed the part of Antony, was weak. His ultra-modern air, his slender legs, his shape, his hair, his gesture suggested the boulevard too strongly. M. Duquesne, who might have made a better hero, was thrown away on the role of Demetrius, and the rest of the company was painfully incompetent.
Despite the cool reception of the play on Monday last, it will be given all next week. After that, to close the month of Sarah’s stay in New York, we may see Fédora
and La Dame aux camélias.
Théodora
and Jeanne d’Arc
will not be tried till the return of the French actors from Australia.
The New York Herald, March 12, 1891
Mme. Bernhardt Adopts a Little Girl.
Mme. Sarah Bernhardt has adopted a little girl, a daughter of a foster-brother of the actress, and named Regina Emanuel Sarah. When very young Mme. Bernhardt had for a nurse a woman whose surname was Emanuel. This nurse had a son François, who was frère de lait to Mme. Bernhardt. Early in life François removed to America and settled in New York, where he married and raised a family, among the children being the girl named Regina. When Mme. Bernhardt arrived here on her last tour she heard that François was in New York, and, making inquiries, soon found Regina and adopted her. Mme. Bernhardt says she will educate the child at the best school in France, and will send her there in April in charge of a nurse. Meanwhile Regina goes shopping in the carriage of her new mother daily.
The New York Herald, March 18, 1891
The Drama in New York.
Close of Mme. Bernhardt’s Brilliant Engagement — She Takes Tea with Gotham’s Social Leaders.
New York, March 7, 1891.
(A New York Dramatic Critic.)
Sarah Bernhardt brings her brief but very brilliant engagement at the Garden Theatre to a close to-night, when she will play the part of Marguerite Gauthier in La Dame aux camélias
for the fourth time this week.
On Monday she scored a great success in Fédora,
and this in the face of serious drawbacks which caused the actress and her managers a good deal of uneasiness. The public did not notice any hitch in the performance. But behind the scenes things went less smoothly. The Loris Ipanoff, M. Duquesne, was almost new to his part, and had only rehearsed it twice with Sarah. Fédora herself was very nervous. With her usual self-control, however, she went on as if there was no fear of failure, and played the last three acts ! of the drama with such marvelous intensity that the house fairly rose at her.
From New York Sarah goes to Boston, and thence to Philadelphia. Her stay here has been one long triumph, only interrupted by the temporary chill produced by the monotony of Sardou and Moreau’s Cléopâtre,
The Garden has been crowded every night and stalls have been sold at fancy prices. There has not been a sign of any falling-off in Sarah’s powers. Her art is as perfect as ever.
On Tuesday, besides playing Fédora
in the evening, Sarah gave a reading as a preface to a lecture on The Court of the Tuileries,
by M. Wisner, at Hard-man Hall. Thence she proceeded to a matinee performance at the Garden, where she acted in André Theuriet’s pretty play of Jean-Marie,
and later on took tea with Mrs. Cleveland, Mrs. Chapin, Mrs. William Sloane and other ladies interested in the Orthopedic Hospital, on behalf of which the performance had been organized.
Mme. Bernhardt in Washington.
She Plays La Tosca
Before a Brilliant Audience at the Grand Opera House.
New York, March 17.
Mme. Sarah Bernhardt began a week’s engagement at Albaugh’s Grand Opera House, Washington, yesterday, appearing in the title-role of La Tosca.
The house was filled with a brilliant audience, among those present being Sir Julian Pauncefote and family, Miss Blaine, Assistant-Secretary of State Wharton and party, Mavroyeni Bey (the Turkish Minister), Dr. Guzman (the Nicaraguan Minister), Governor and Mrs. McReary, Mrs. Frederick Bancroft and Colonel and Mrs. Heath.
The New York Herald, March 25, 1891
The New York Stage.
New York, March 14, 1891.
(A New York Dramatic Critic.)
Sarah Bernhardt is playing to huge houses in Boston. The receipts there for this week, I hear, are over thirty thousand dollars. At the Garden Theatre she drew, roughly, $120,000 in four weeks and three days : while the bookings in Washington, which Sarah will visit soon, are already said to exceed twenty-five thousand dollars. This is almost as much as a Patti would draw, and infinitely more than any actress or actor but Sarah could bring into the managerial tills.
Cable Flashes.
Mr. Henry E. Abbey and wife started for Australia yesterday. Mr. Abbey goes to arrange for Mme. Sarah Bernhardt’s appearance.
The New York Herald, April 1, 1891
Notes from the New York Stages
Mme. Sarah Bernhardt to Face the Parsons.
New York, March 21.
(A New York Dramatic Critic.)
Sarah has been charming the good people of Washington since Monday last. On the 31st she opens at Norwich, Conn., where the ministers and elders are preparing to bombard her with sermons.
The New York Herald, April 15, 1891
The New York Stage
Mme. Sarah Bernhardt Successfully Boomed by the Norwich Clergy.
New York, April 4.
(A New York Dramatic Critic.)
Mme. Bernhardt’s Movements.
Sarah Bernhardt paid New York a flying visit on Monday afternoon, when she played Fédora
at Palmer’s for the benefit of the Bacteriological Institute of Dr. Gibier. She bad all her accustomed success, and the same evening appeared at the Hyperion, in New Haven, Conn., where she won fresh laurels.
Thence she went further East—to New London and Norwich. At the Broadway Theatre in this last little town she bad a particularly hearty reception. The clergy of the place had, as you know, denounced her and her plays from their pulpits ; but the only result of their fanatical proceedings was that the theatre was packed with their parishioners.
On reaching the Norwich station found that the crowd which was massed on the platform and round about the building had the friendliest intentions. She played Fédora
that evening to an audience of enthusiasts. She was recalled six or eight times and applauded à tout rompre. I was assured that among those who watched her acting with most pleasure was one of the very minister who had been fiercest in denouncing her.
Allons !
said Sarah at the close o the play, les Norwichois sont bien gentils !
Next morning she went on towards Montreal, where in a few days she will produce Jeanne d’Arc,
for the first time in America.
The New York Herald, May 1, 1891
Mme. Bernhardt Experiences a New Sensation.
Mme. Sarah Bernhardt has discovered a new sensation. For years she has wished to see a prize-fight. Yesterday she went to the Cremorne Theatre in San Francisco and witnessed a lively exhibition of manly art.
The New York Herald, May 3, 1891
American News in Brief.
Mme. Sarah Bernhardt left San Francisco yesterday for Australia.
The New York Herald, May 24, 1891
The Temps has received a telegram announcing the arrival of Mme. Sarah Bernhardt at Auckland. She and all the members of her company are reported to be in excellent health.
The Sydney Morning Herald, May 27, 1891
Débarquement à Sydney.
Lien : Trove
The R.M.S. Monowai, from San Francisco, arrived early yesterday morning [Tuesday, May 26], and was berthed at the U.S.S. Company’s wharf, foot of Margaret-street.
Included in her passenger list was Madame Sarah Bernhardt, the celebrated French actress ; Major Dane, the well-known lecturer ; the Hon. J. B. Patterson, late of the Victorian Government ; and Mr. A. Wilson, Victorian Engineer of Ports and Harbours.
Madame Bernhardt was welcomed in the steamer’s saloon by the reception committee.
The Argus (Melbourne), May 30, 1891
Lien : The Greatest Living Tragedienne
; programme de la semaine) Trove
The Greatest Living Tragedienne.
Sarah Rosine Bernhardt.
By Edward J. Hart.
In all ages the world has displayed a fitful tendency to place some creator or exponent amongst the followers of the various arts and sciences on a pedestal, and there regard its idol with an admiration which is near akin to worship. […]
New Princess’s Theatre. — Under the direction of Messrs. Williamson, Garner, and Co. Treasurer : Mr. H. Musgrove. Curtain rises at 7.45 precisely. The Sarah Bernhardt Season.
Madame Sarah Bernhardt, under the direction of Messrs. Henry E. Abbey and Maurice Grau.
Madame Sarah Bernhardt will be supported by a complete company of French artists, and during the season of 24 nights and 4 matinees will appear in a round of the mos famous characters of her repertoire.
- This (Saturday) evening, May 30th, 1891, at 7.45 : La Dame aux camélias […] ;
- Monday (June 1st) : La Tosca ;
- Tuesday : Fedora ;
- Wednesday : La Tosca ;
- Thursday : Fedora ;
- Friday : La Tosca ;
- Saturday matinee : La Dame aux camélias.
[June 1st issue :]
- Saturday, special matinee performance at 2 O’Clock : La Dame aux camélias.
- Saturday night : La Tosca ;
- Monday, June 8 : Cleopatra.
[June 9 issue :]
- Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday : Cleopatra.
- Saturday, June 13, afternoon and evening : Cleopatra.
[June 13 issue (p. 12) :]
Last 12 nights of the Sarah Bernhardt Season. Saturday, June 13, afternoon at 1.30, evening at 7.30, the magnificent spectacular production of Cleopatra.
Programme for next week :
- Monday, June 15 : Adrienne Lecouvreur ;
- Tuesday, June 16 : Frou-Frou ;
- Wednesday, June 17 : Jeanne d’Arc (Joan of Arc) ;
- Thursday, June 18 : Adrienne Lecouvreur ;
- Friday, June 19 : Frou-Frou ;
- Saturday, June 20 (Matinee) : Jeanne d’Arc ;
- Saturday, June 20 (Evening) : Camille [La Dame aux camélias] ;
- Monday, June 22, and the following evenings : Theodora.
The New York Herald, June 7, 1891
Sarah Bernhardt on Shipboard.
A private letter from Honolulu tells how Sarah Bernhardt amused her companions on the way to Australia. First she tried to shoot gulls from the stern of the vessel, but handled the gun so carelessly that the shots produced more fright among the people around her than among the gulls. Next she mounted the rigging, and, though the ship was tossing in a heavy sea, recited a long poem of Victor Hugo’s to the end.
The New York Herald, July 18, 1891
Mme. Sarah Bernhardt has signed an engagement for 1892 with Messrs. Abbey, Schœffel and Grau, to play throughout the United States, appearing in New Orleans, Augusta, Savannah, Charleston, and other cities.
The Argus (Melbourne), June 18, 1891
Longue analyse critique de la pièce et de la représentation.
Lien : Trove
Madame Bernhardt as Jeanne d’Arc.
The marvellous history of the peasant girl of Domrémy has been a source of inspiration to a crowd of historians, biographers, poets, sculptors, painters, and dramatists. The books which have been written about her, from the anonymous Mystère du Siège d’Orléans published in the 15th century, and containing 25,000 verses, down to Schiller’s noble tragedy, which did so much to inflame the courage of the Germans in fighting for their independence at the commencement of the present century, not to speak of Robert Southey ponderous epic, and the still later works of Michelet, Lamartine, Henri Martin and M. Wallon would suffice to fill a small library. Sculptors like Rude, Gois, the Princess Marie of Orleans, Foyatier, Chapu, and Frémiet have idealised her form and features in marble, and Saint-Evre, Ingres, P. C. Comte, Paul Delaroche, and Eugène Devéria have depicted some of the most remarkable incidents of her remarkable life on canvas. Verdi made them the theme of his opera, Giovanni d’Arca,
and she has been brought upon the stage in France as the heroine of D’Avrigny’s five act tragedy of Jeanne d’Arc in Rouen,
of a tragedy by M. Soumet, of a four act opera by M. A. Mermet, and of a historical drama in five acts by Daniel Stern ; while in England we have had a Joan of Arc
by Fitzbett, another by T. J. Serle, a third by Alfred Bunn, and a fourth by Tom Taylor, with Mrs. Rousby as Joan.
After the Franco-German war and the loss of Lorraine the memory of Jeanne d’Arc, a native of that province, became more than ever endeared to her countrymen and countrywomen, and popular homage almost took the form of a cult, because the Maid of Orleans was regarded as symbolising the purest and loftiest spirit of patriotism, and, as representing, that undaunted enmity to a foreign invader, and that invincible determination to regain possession of a lost territory which animated Frenchmen in their warfare against our own Henrys, and which are still vital in France as against her victorious neighbour. The war had only closed two years when M. Jules Barbier placed the national heroine once more upon the stage in the drama which was produced last night at the Princess’s theatre ; and the motives for its original production at the Gaîté, in Paris in 1873, constitute such an interesting morceau of contemporary history as to be worth relating. Offenbach, the composer, a naturalised German, was then the director of that theatre, and an impression had got abroad that his operettas had contributed in no unimportant degree to emasculate the public mind, and to aid in that corruption of morals which had been brought about under the Third Empire. Some of the journals of the boulevards which had applauded his musical buffooneries to the echo suddenly turned round upon him, and insinuated that the Battle of Sedan had been lost because the Grande Duchesse
had been performed at the Variétés. The press demanded something serious, and although Offenbach knew the character of his audiences much better than they did themselves and perceived that this was only a passing spasm of austerity, he resolved to bow to the will of his patrons, even although as he anticipated, and as did not happen to be the case, he might lose money by the experiment. So M. Jules Barbier was commissioned to write a patriotic drama in verse on the subject of Jeanne d’Arc, and M. Gounod was requested to compose some music for it, which should have the impressive character of an oratorio. On the first night of its production it only met with a succès d’estime, except among the occupants of the galleries, who followed the piece with attention, rewarded the best passages with applause, and seemed to be irritated by the coldness of the rest of the audience. [L’auteur a manifestement lu l’article de Francisque Sarcey, dans le Temps du 6 janvier 1890.] Gradually, however, the people in the boxes and parterre were won over, enthusiasm succeeded to a difference, the receipts rose to a maximum and then, all of a sudden, it was announced on the nineteenth audit that the piece must be withdrawn, because Mdlle. Lia Félix, who played Jeanne, had lost her voice. She had done nothing of the kind. Her voice was as fresh and strong as ever, but Offenbach wanted to produce his Orphée aux Enfers
and to draw from it his royalty as composer, and so Jeanne d’Arc
was laid upon the shelf, to be revived again on the 3rd of January, 1890, at the Porte St. Martin, with Madame Bernhardt as the Maid of Orleans.
In the present drama the only material departure from the facts of history has been made by M. Barbier in giving his heroine a lover, for which he may plead as his apology the example of Schiller, the only difference being that the German poet makes her in love with a young Englishman named Lionel, whereas the French dramatist causes her to be enamoured of one of her early play mates, a peasant named Thibaut, which is the much more probable incident of the two. The opening scene of the first act takes place in the cottage at Domrémy, where the family are seated at their evening meal. Some peasants rising from their homes, which have been given over to pillage and the torch by the enemy pass the open door at the back, and are offered shelter at the intercession of Jeanne, who listens with rapt attention to the narrative of their sufferings by an old man of the party. Her father is troubled by the strange interest his daughter takes in these things, and confers with the wife upon the desirability of marrying Jeanne to Thibaut, so that household cares may distract her thoughts from reveries and from communion with what he believes to be evil spirits. Thibaut arrives and presses his suit ; and to him she reverses the mysterious voices which imperatively command her to proceed to see the King, and to drive the invading English out of France. Left alone at the close of the act, the fair mystic takes a sword from the table, feels herself exalted and inspired by spiritual presences, and kneels in prayer, while a vision of saints appears to comfort and sustain her.
The second act conducts us to the court of Charles at Chinon, where the king is idling a way his time with his mistress Iseult, and an obsequious courtier, De Thouars, heedless of the remonstrances of his faithful friend, La Hire. Jeanne arrives, transforms Iseult from an enemy into an ally, and acquires such an ascendency over the king that he resolves to place himself at the head of his troops, and, led by the peasant girl of Domrémy, he hastens to the relief of Orleans, beleaguered by the English.
The third act passes under the walls of that city Dunois, La Hire and Xaintrailles hold a council of war, in which they resolve not to assault the city, but Jeanne is for doing so upon the instant, for Dieu le veut, and after a solemn prayer she unfurls the oriflamme of France and advances impetuously to the charge, followed by the enemy.
A tableau which occurs in the drama as played in Paris, representing the coronation of Charles the Seventh in the choir of that glorious cathedral at Reims has been necessarily omitted here ; and the action of the piece passes on, in the fourth act to the interior of a prison at Rouen where Jeanne is seen wrapped in a mantel and sleeping on straw pallet, while some English soldiers, her warders, are drinking and gambling by torchlight. One of these describes the ruse by which she was captured, and gives it as his opinion that Tous les moyens sont bons avec l’enfer. Warwick and Loiseleur enter, awaken the prisoner, and endeavour to extort from her a confession of her commerce with the powers of evil. This she indignantly refuses to sign, and the local justices are called in of whom Jean d’Estivet is the president. Jeanne still continues obdurate, denies that she is a wicked sorceress, and is informed that, for her impenitence, she will be burnt alive. For a moment her courage fails her, and she shrinks appalled from the prospect of such terrible form of death, but recoils with still greater horror from Warwick’s effort to embrace her. Finally she takes refuge with two monks, who appear from the back of the stage, and the act closes.
When the curtain rises it is upon the antique market place of the picturesque old city of Rouen, where a scaffold has been erected, and is surrounded by an expectant crowd. Warwick and
Loiseleur enter and take their places on the scaffold. The victim then appears, and Jean d’Estivet reads the sentence of excommunication and expulsion from the church, to which Jeanne replies by a fervent prayer for the forgiveness of her enemies and by entreating that one mass at least may be said for the repose of her soul. Some one offers her a hastily constructed cross, and the soldier who throws the first faggot at the pyre falls back dead. The fire is supposed to be kindled, Jeanne’s face is transfigured, and as she bows her he did in death an angelic choir intones the words, Daughter of God, depart.
It will be of interest to many to learn the lessons which induced Madame Bernhardt to study the character of Jeanne d’Arc. While spending her villeggiatura, in the country, in the month of August, Madame received a letter from a lady, the mother of two daughters and a son who complained that her children had never had an opportunity of seeing the illustrious actress on the boards because her repertoire was composed of pieces un peu trop vives. Why cannot you play something that all the world may witness ?
asked her fair correspondent Why not play
added the lady. Now, it had been Madame Bernhardt’s wish for years to do so and her resolution was soon taken. She selected the drama of M. Barbier for that purpose, because it is dramatic, and because it follows the historical legend step by step, so closely, indeed, that its author has piously collected all the responses attributed to Jeanne d’Arc, and has made her speak her own words wherever possible. Then again there is such an accent of truth throughout the dialogue, and especially in the scene with Warwick, Jeanne d’Arc ?
which I can never play,
observes Madame Bernhardt without feeling the tears come into my eyes.
Besides which the actress had a kindly feeling for Jules Barbier. In the old days, when I was only earning £4 a month, he was the first author who ventured to entrust me with a part. It was in a little two act piece called
La Loterie du Mariage.
It was my first creation, and I have never forgotten it.
Questioned respecting her views of the character of Jeanne d’Arc, Madame Bernhardt replies : I adore my country, and to me Jeanne resembles the purest personification of it. I assure you, one must come to the other end of the world in order to find out how much one loves that little corner of the earth called France ; that dear country which, although one cannot carry it on the soles of one’s boots, is always vital to us, at the bottom of our hearts. Every nation has its heroes, but they all resemble each other. Jeanne d’Arc resembles only herself. She is to us, and to us alone, the natural heroine, the French saint ; nor am I acquainted with any figure in history more beautiful more touching, more heroic. It is not necessary to be either a Frenchwoman or an artiste in order to feel at once attracted and frightened by the idea of representing cette grande inspirée, to whom we owed the salvation and the very existence of our country.
When asked what is her conception of Jeanne d’Arc is a human personality, Madame Bernhardt replies : I am neither a philosopher nor a historian, I am simply a dramatic artiste, and I can only look at Jeanne d’Arc under her theatrical aspect To me she appears a mysterious figure, but before all things inspired and mystical. She is a sort of hallucinée, an ecstatic, who marches straight-forward towards a fatal end, guided by a will to which she offers no resistance. A warrior, she nevertheless has a horror of blood and does not draw a sword. It is standard in hand that she leads the soldiers to victory. Then when she has achieved her end, and her divine mission has been accomplished, the woman re asserts herself the figure is transformed and the human re appears. It seems to me that Jeanne d’Arc is a personage of mystery much more than a heroine of the drama. It is in this light that I look upon her, and this is how I endeavour to represent her.
Such is the key note of the strain of music which falls from Madame Bernhardt’s lips while portraying the character of the Maid of Orleans in the first act. It is as varied in character as the instruments in a well-balanced orchestra. Sometimes, in moments of mystic reverse and while listening to the voices which speak to her from the unseen world, it is like the low breathings of a flute, and sometimes its tones have the spirit stirring resonance of a trumpet. In prayer, it is tender, pleading, and subdued by a sort of reverential consciousness that she is standing in the presence of an army of saints, but in the day of battle and the hour of peril it rings out with a vehemence and a power that thrill like bugles sounding, for a charge of cavalry. And the nature of the actress undergoes a complete change, just as her face seems to be transfigured when the inspiration comes upon Jeanne. In her father’s cottage she is all simplicity, sweetness and filial obedience, but when before the city of Orleans Madame Bernhardt seems to have been listening to the noble words of Henry the Fifth [by William Shakespeare] before Harfleur :
But when the blast of war blows in our ears,
Then imitate the action of the tiger ;
Stiffen the sinews, summon up the blood,
Disguise fair nature with hard-favour’d rage ;
Then lend the eye a terrible aspect.
During the whole of the second act in which Jeanne makes a patriot of the Kings mistress, and rouses the effeminate monarch to a sense of his royal duties, you feel how just as the exclamation of Loys : Sa voix est comme un charme ; and when, at the end of that act she raises the cry of the crusade, Dieu le veut ! the effect is electrical. There is nothing theatrical or conventional in her declamation or her acting. She moves and speaks as one who is walking in a dream, and holding converse with ministering spirits in the air ; and in a word she realises your ideal of the inspired mystic who breathed a new life into the rulers and armies of her country. But to enumerate all the beauties of the performance would be to quote the greater part of the dialogue Madame Bernhardt has to deliver. Enough to say, that the culminating point of the drama was at the end of the fourth act, when she resists and repulses Warwick with such a torrent of scorn and opprobrium, and proclaims so eloquently her unswerving faith in the future of her beloved country, exclaiming :
Noyez-le tout entier dans le sang et les larmes !
Reculez sa frontière, ivres de vos succès !
La France renaîtra dans le dernier Français !
This called forth a prodigious display of enthusiasm, and Madame Bernhardt was called before the curtain four times by the excited audience.
The cast is a long one, and the parts are well distributed. Mdlle. Méa possesses all the requisites, physical and otherwise, for the adequate portrayal of such a character as Agnes Sorel, who is re-christened Iseult in the drama, and her dialogue with the King when she has convinced herself of the sincerity of Jeanne d’Arc and the reality of her mission was given with great dramatic fire. The bluff and burly La Hire, so frank of speech and fearless in conduct finds an excellent representative in M. Duquesne. Jeanne’s parents are carefully and effectively played by Madame Marie Grandet and M. Angelo respectively. M. Rebel made Warwick sufficiently repulsive and MM. Dermont, Fleury and Munie contributed to the general smoothness of the performance.
Some of the incidental music composed for the drama by M. Gounod was given with nice feeling and effect by the orchestra. It comprises a prelude, half rustic and half religious in its character ; a lovely due of the saints who inspire and counsel Jeanne d’Arc in which an organ mingles with the orchestra ; a quaint chanson sung by Madame Seyler and a funeral march accompanying the execution of the Maid, which is impressively mournful and solemn.
This evening, Adrienne Lecouvreur will be played for the second and last time ; and Jeanne d’Arc
is to be repeated at a matinee on Saturday.
[June 22 issue (p. 8) :]
Last 5 nights of the Sarah Bernhardt Season. […]
Monday [June 22], Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday [June 26], and also Thursday at 1.30 pm., for the final performance of Madame Sarah Bernhardt : Theodora.
Evening Journal (Adelaide), June 29, 1891
Lien : Trove
Theatre Royal. Sole Lessee and Manager Mr. Wybert Reeve. Resident Treasurer : Mr. H. J. Whittington. Bernhardt Season, for six nights only.
Madame Sarah Bernhardt, under the direction of Messrs. Henry E. Abbey and Maurice Gray, and supported by a company of French artists, commencing to-night (Monday), June 29th. The distinguised presence of their Excellencies the Earl of Kintore, G.C.M.G., and the Countess of Kintore and Suite.
The following will be the repertoire :
- Monday [June 29] : Camille [La Dame aux camélias] ;
- Tuesday : La Tosca ;
- Wednesday : Fedora ;
- Thursday [July 2] : Jeanne d’Arc ;
- Friday : Adrienne ;
- Saturday : Frou-Frou ;
- Grande matinee Wednesday, July 1 : La Tosca.
Doors open at 6.30, curtain rises at 8.
La Grande Tragédienne. Madame Sarah Bernhardt. — This famous actress arrived at the Semaphore with her company at 6 am. on Monday. Madame Bernhardt went to town. and is staying at the South Australian Club Hotel. She drove up the Port-road , to Adelaide in a carriage with Mrs. Abbey and some of her attendants. She had a crowded house in Melbourne on Friday, the last night she performed, when she played in Theodora,
and was overwhelmed with floral offerings and applause. Baron Von Mueller and a number of leading Melbourne citizens attended her to the train, and at the Spencer-street Station there was a great crowd to see her off. No arrangements have been made for Madame to return to Australia after this tour. At the conclusion of the season in Adelaide she plays nineteen nights in Sydney, and then appears in Brisbane, after which she will go home via San Francisco.
Madame Sarah Bernhardt. — By the Oroya, which is expected to reach Largs Bay this morning, Madame Sarah Bernhardt and her company will arrive. The distinguished actress has taken apartments at the South Australian Club Hotel. Madame Bernhardt will this evening begin her six nights’ season at the Theatre Royal. Her opening piece, Camille,
[La Dame aux camélias] will be played in the presence of the Earl and Countess of Kintore and suite. Attention is drawn to the announcement that ticketholders can enter the reserved stalls by way of the dress-circle ; that dress-circle and reserved stall ticketholders should be in their seats before 7.45 to prevent inconvenience to themselves ; that persons wishing to go into the gallery and the unreserved stalls will be admitted from 6.30 to 7.30 ; that no money will be taken at the doors until fifteen minutes to 8 o’clock, and only then providing there is room ; and that carriages, should set down with horses facing west and take up facing east under the direction of the police. Arrangements have been made by the City Council for a special cabstand in Hindley-street during the season.
Madame Sarah Bernhardt. —
Madame Sarah Bernhardt. A sketch of her career — During this week Adelaide playgoers, or such of them as can be accommodated within the all too narrow limits of the Theatre Royal, are to enjoy the high privilege of witnessing the performances of the most brilliant and distinguished living actresses.
Madame Sarah Bernhardt. — By Telegraph. Melbourne, June 28. Madame Sarah Bernhardt and her company left yesterday for Adelaide per the Oroya. The lady expresses her intention of revisiting Australia. It is understood that she will undertake a second season in two years’ time.
[July 2 issue :]
In answer to numerous enquiries, the Management beg to state that there will be a Second Grand Matinee given by Madam Bernhardt on Saturday Next [July 4], when the celebrated drama of Jeanne d’Arc will be repeated.
Evening Journal (Adelaide), July 3, 1891
Madame Bernhardt at the Theatre Royal : Jeanne d’Arc.
A full but not overcrowded house witnessed last night the performance of Jeanne d’Arc
by Madame Bernhardt and her company. We think that the management
made a mistake in presenting here such a piece without the stage accessories which made its revival last year at the Porte-Saint-Martin Theatre such a brilliant success. The scenery at the Theatre last night was so bad that it would have been better to have dispensed with scenery altogether, and there was no attempt to render the beautiful music which one of the greatest artists of the day composed specially for this piece. We mention this lest it should be supposed that an Adelaide audience is completely ignorant of what is going on in the world of literature and art. The costumes worn by the actors, and especially those worn by Madame Bernhardt, showed signs, of a most careful study of mediæval millinery, but the dresses had evidently in some cases done duty a great many times previously. We may also indicate in connection with this matter that the oriflamme
was decidedly shabby. And shaky in appearance, and that to represent the headdress of a lady in the days of Charles VII. something more is requisite than a cylinder clumsily wrapped in muslin.
As for the play itself it is the work of Jules Barbier, a competent but not particularly eminent playwright. His best work is perhaps Le Pardon de Ploërmel.
Jeanne d’Arc
was performed for the first time in 1873 at the Gaiety Theatre in Paris, when the leading part was taken by a sister of Rachel. In 1890 it was, as we have mentioned before, revived at the Porte-Saint-Martin with Madame Bernhardt in the title-role. Madame Méa and Madame Grandet we believe on that, occasion sustained the same parts that they appeared in last night. The names of most of the other members of the company are new to us, but their acting last night was excellent. Madame Méa and Monsieur Duquesne were especially good, and Monsieur Munie made the most that could be made out of such an insignificant part as that of Siward.
We understand that Monsieur Munie is a pupil of Coquelin’s. He has evidently been an apt scholar in dramatic learning.
Of the plot of the play we have already given an account. It is not a very powerful play, but it contains some beautiful passages, and was a relief after La Tosca
and Fedora.
We were glad to have a fresh proof of Madame Bernhardt’s wonderful versatility. Her representation of the simple village girl was as perfect as her representation of such a tempestuous woman as La Tosca,
and she made the audience see how Jeanne’s character develops day by day ; how superstition becomes enthusiasm ; how a gentle, timid woman, who at first shrinks from the mere sight of blood, becomes an Amazon, and puts the bravest soldiers to flight ; and how in spite of her natural dread of a painful death she is able to advance to the stake with the resignation of a martyr. In the first act her manner was very subdued. Jeanne is still the ignorant peasant maiden trying to think, things out for herself, and only conscious of the fact that something divine is prompting her to devote her life to her country. Her delivery of the passage beginning C’est étrange ! d’où vient cette force inconnue ?
was inexpressibly beautiful, and we recommend every
one who can attend the matinee on Saturday to watch carefully Madame Bernhardt’s face as she repeats these lines. By her intonation and facial expression she makes manifest the miraculous change which is supposed to have taken place in the character of Jeanne, and converted an ignorant peasant into a noble heroine. The audience, which was somewhat cold at first, were roused to enthusiasm by this, and on the fall of the curtain Madame Bernhardt was recalled several times. The applause of the spectators was, if possible, still more pronounced at the conclusion of the second act where Jeanne inspires even a dissolute King with her own patriotism, and she exclaims : Nous délivrerons la patrie ! Dieu le veut !
This and the passage where she rejects the infamous proposals of Warwick were the grandest exhibitions of her histrionic skill in this play, though many might perhaps be more affected by her delineation of the beatific expression which illumines the face of Jeanne as just before the moment of her death she fancies she sees Paradise opened and hears angelic voices summoning her.
Adrienne Lecouvreur
will be performed to-night.
[July 6 issue (p. 3) :]
Madame Bernhardt leaves for Melbourne by the express train to-day.
Le Monde illustré, 18 juillet 1891
Lien : Illustration du débarquement à Sydney) Retronews
L’arrivée de Mme Sarah Bernhardt en Australie.
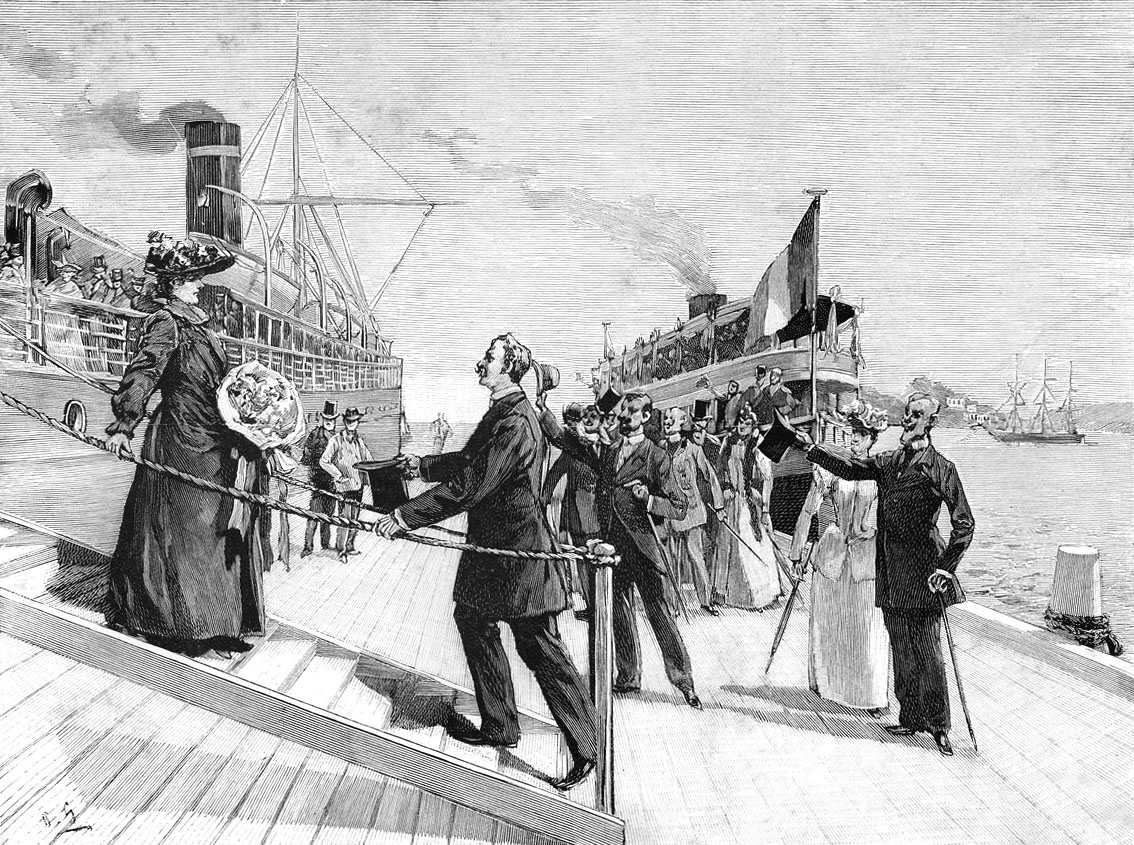
L’illustre tragédienne poursuit à travers le monde sa tournée triomphale, et c’est dans les derniers jours de mai qu’elle est arrivée à Sydney, où les Australiens avaient frété un bateau à vapeur, pour aller à sa rencontre.
Le ministre des finances du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, le directeur général des Postes et un grand nombre de notabilités avaient tenu à honneur de recevoir l’artiste française, et de se joindre au comité français désireux de rendre hommage à une célèbre compatriote. C’est le docteur de Lambert, président de ce comité, qui a souhaité la bienvenue à la voyageuse et qui lui a présenté ses collègues. Il faut lire le récit de cette réception dans les feuilles locales,pour se faire une juste idée de l’enthousiasme dont ont fait preuve Australiens et Français. Chacun de s’extasier sur l’air gracieux et avenant de Mme Bernhardt, sur sa beauté paraissant dans sa fleur, sur la délicieuse couleur de ses cheveux dont Véronèse a orné la tête de ses belles patriciennes, sur ses admirables yeux noirs remplis d’éclairs, sur son nez irréprochable et d’un si superbe caractère, sur son teint éblouissant, sur son apparence d’extrême jeunesse enfin, que les dames présentes à la réception ne cessaient de célébrer par des murmures d’admiration et par des louanges flatteuses. Discours, bouquets, ovations de toutes sortes, rien n’a été épargné pour accueillir dignement the french actress
et on lui a même fait les honneurs de la Marseillaise, ni plus ni moins qu’au président de la République en personne.
C’est dans la Dame aux Camélias qu’elle a débuté à Sydney. On a voulu dételer ses chevaux à la sortie, et la recette a atteint 21.250 francs, un chiffre inédit encore en Australie.
The Daily Telegraph (Sydney), July 21, 1891
Jeanne d’Arc à Sydney.
Lien : Trove
Her Majesty’s Theatre. — (Sole Lessee and manager, Mr. George Rignold) : The Sarah Bernhardt Season, of eight nights only.
Mr. J. C. Williamson has the honor of announcing that through the courtesy of Mr. George Rignold he has enabled to secure Her Majesty’s Theatre for the Sydney Season of Madame Sarah Bernhardt. Under the direction of Messrs. Henry E. Abbey and Maurice Grau, and supported by a Complete French Company.
- This (Tuesday) evening, July 21, will be presented for the first time in Sydney : Jeanne d’Arc, drame légende in 5 acts by Jules Barbies [sic]. Musique by M. Gounod. Jeanne d’Arc : Mme. Sarah Bernhardt.
- To-morrow, Wednesday evening, July 22, will be produced for the first time on any stage : Pauline Blanchard. […] Mme. Sarah Bernhardt will create the character of Pauline Blanchard.
- Thursday, July 23, for the last time : Fedora. […]
- Friday, July 24, for the first time this season : Adrienne Lecouvreur. […]
- Saturday afternoon, July 25, second grand special matinee : La Dame aux camélias
- Saturday, July 25, for the last time, Frou-Frou […]
Furniture and appointments by Messrs. Wallach Bros. Floral decorations by Messrs. Searl and sons. Early doors to upper circle and gallery only at 6.40. Doors open à 7.10 for general admission.
Prices of admission for the Bernhardt season : Seats in Vice-Regal box : 21s. — Dress circle and reserved stalls : 10s. — Stalls (unreserved) : 5s. — Family circle : 4s. — Gallery : 2s. — Early doors to Family circle and gallery, 1s extra. Tickets for the early doors can be purchased at the box office during the day.
Business manager for Mr. Williamson : G. L. Goodman.
Special arrangements have been made by the commission to run trams to all parts of the suburbs after the performance.
The Daily Telegraph (Sydney), July 22, 1891
Critique. The success belongs to the actress, and to her alone.
Lien : Trove
Sarah Bernhardt in Jeanne d’Arc
Sarah Bernhardt has appeared as the modest, virtuous, spotless Joan of Arc. Nay, more, she has brought the maid of Domrémy to life. The saviour of her country lives again in the actress. The character, as depicted by M. Barbier and as impersonated by Mme. Bernhardt, is absolutely irreproachable. And therein lies its only recommendation.
It is occasionally theoretical, it is sometimes dramatic. But, on the whole, it does not interest. The repeated applause of last night’s audience seemed to indicate that Mme. Bernhardt’s Jeanne d’Arc had filled an aching void. Enthusiasm reigned supreme throughout the evening. This effect was the result of the memory of the character itself and of the individuality, ability and charm of the actress. For Jeanne d’Arc
is a wretched specimen of a play. It is wanting in action, its story is inconsequent ; its characters, with one exception, are insignificant. It is a musical panorama rather than a play.
It would be wrong to say that it swayed last night’s house, but the deficiencies of the piece were amply atoned for by the strange fascination of the actress. Its undramatic nature was lost sight of in the consideration of the actress. The impersonation of this Jeanne d’Arc is an uphill game. It is a fight from first to last. The entire burden of the piece rests on the shoulders of the principal player. Put an actress of less grace, of less power, of less influence into the part, and the play would be rightly voted as exceedingly dull. Mme. Bernhardt, if she cannot actually infuse absorbing interest into it, prevents it, at least, from becoming deadly dull. She dwells almost entirely on the mystic side of the character. Her Jeanne has the impress of inspiration. She walks, and looks, and speaks as one in an ecstasy. Her prayers come from the heart. Jeanne’s divine mission is stamped in Mme. Bernhardt’s expression, in her gesture, in her voice. The success belongs to the actress, and to her alone. She mostly stirred the spectators last night by Jeanne’s invocation to the French at the end of the second not. Her magnificent denunciation of Warwick, at the conclusion of the fourth act, also drew forth round after round of applause, but the first act is the only one in which, from an artistic point of view, there is a chance for the interpreter of the character. There is little for the actress to do, but how exquisitely does Mme. Bernhardt do that little !
Jeanne d’Arc has only to sit at a spinning-wheel, to tend some persecuted travellers, to show her obedience to her parents, and to forego earthly love because of the celestial voices
which bid her save her country. In the theatrical meaning of the word there is no action in this, but Mme. Bernhardt imparts a world of meaning to it. Her very appearance creates a feeling of respect, which borders on adoration. Her refusal of her lover convinces audience and peasant alike. The heavenly voices
call her. She is impelled by them in her every movement. Jeanne is called upon to surrender father, mother and lover for her country’s salvation. As she listens to the ringing of the bells, and then to the voices
which call her forth, Jeanne’s face has to tell the tale of the struggle between earthly happiness and stern, cold duty, the reward of which is not to lie in this world. The change, as conveyed by Mme. Bernhardt, is marvellous, a few minutes before Jeanne had been engaged in a physical struggle with a brutal English soldier. The struggle now is mental. Jeanne’s parting from her parents and her home, her gliding out into the uncertain darkness of the night, the immensity of her worldly sacrifice, afford Madame Bernhardt an opportunity for the expression of great pathos. Her acting at this moment is infinitely touching. It is, as a specimen of dramatic art, her best scene, although those which follow, being more easily understood, evoked the greatest applause last night, Jeanne’s quiet rebuke of Iseult, the king’s indolent favorite, her detection of the king who pretends to be only a courtier, and her stirring prayer to the people at the conclusion of the act were admirably rendered by Mme. Bernhardt.
The third act calls for little but dignity, reserve and the pious delivery of more prayers and monitions. But the actress managed to instill it with vigor and to carry it to success.
In the fourth act, as related by us yesterday, Jeanne has to resist the base proposals of the monk, Loiseleur, and to denounce the still deeper villainy of Warwick. Tho actress has to be pathetic as one moment, fired with righteous indignation and patriotic fervor the next. In the expression of both phases of the character at this point Mme. Bernhardt excels. Her splendid playing once more created enormous applause and several calls.
The final act is little more than a mournful procession. There is no acting, so to speak, to be done in it. Jeanne has only to walk on, utter a few sentences, and then ascend the funeral pyre. The part, in this scene, is not much more than a pantomime one. But, wanting as it is in words, it will never want for expression so long as Mme. Bernhardt plays in it. Her Jeanne is a veritable martyr. She has been true to her faith, steadfast to his mission. She has fulfilled her sacred duty, and she is ready to complete the joyous task. She meets her fate heroically, with the idea that a power above will reward her for her trials on earth.
Such is the character as interpreted by Sarah Bernhardt. The actress played at her very best last night. Indeed, her acting has never before been marked by so much attention to detail, as evident a desire to please us during the present season. And, fortunately, the purity, the sweetness and the capacity of her incomparable voice remain as perfect as ever. Her voice has won her many a triumph. It has never assisted in a tougher fight than that of M. Barbier’s Jeanne d’Arc. A harsh voice, a discordant note, and the glamour of the part would be destroyed. To listen to her voice in this character is to listen to music. It seems a thousand pities that Mme. Bernhardt has not a better play in which to act this historical, beautiful, and highly impressive character. Her Jeanne d’Arc is an ideal performance, but it is only so within narrow limits. The actress does wonders for the part, but the part is not worthy of the actress. The play is faulty in the extreme, its central character is incomplete, and M. Gounod’s music is distracting instead of being advantageous and interesting. It is, no doubt, excellent in its way, but it frequently breaks in upon the attention of the audience. It will thus be gathered that to Sarah Bernhardt, and to her only, is due the credit of whatever success attends Jeanne d’Arc.
In Paris and in London she had the help of capital scenery. There is nothing particularly captivating in the scenery by which she is surrounded here. But she has the genius which can illuminate a dull piece, she has the power which enthralls and she possesses a singularly fascinating presence and a voice which is most melodious.
Mme. Bernhardt will appear to-night, for the first time on any stage, as Pauline Blanchard in a drama of that name which has been written for her by a new French author.
[Dans la même édition, de nombreux courriers de lecteurs en répondent à un article de J. R. Ashton, publié dans l’édition du 20 juillet, sur l’art et ses relations avec la religion et la morale en rapport avec Sarah Bernhardt.]
[Annonce des trois dernières dates :]
Her Majesty’s Theatre. — Last nights of the Sarah Bernhardt Season. The directors beg to announce the following programme :
- Monday [July 27] : Jeanne d’Arc ;
- Tuesday : Pauline Blanchard ;
- Wednesday : Adrienne Lecouvreur.
[July 30 issue (Nouvelles programmation au Théâtre Royal de Sydney après l’annulation du voyage à Brisbane) :]
Theatre Royal. — Important announcement. Supplementary season of Madame Sarah Bernhardt. Mr. J. C. Williamson has much pleasure in announcing that arrangements have been completed whereby in deference to the desire of Madame Sarah Bernhardt she will be enabled to make in this city her farewell appearance in Australia.
A special season of nine nights only will be inaugurated at this theater, commencing this (Thursday) evening, July 30, when will be given for the first time in Sydney, the most important production of the Bernhardt tour : Theodora.
- Thursday [July 30], Friday, Saturday matinee, Saturday evening : Theodora.
[August 1 issue :]
- Monda [August 3] : Theodora ;
- Tuesday [August 3] : Theodora ;
- Wednesday [August 5] : La Tosca ;
- Thursday [August 6] : Pauline Blanchard ;
- Friday [August 7] : La Tosca ;
- The final performance will be the last grand special matinee, Saturday afternoon, August 8 : Fedora ; and Saturday night : La Dame au camélias.
The Daily Telegraph (Sydney), August 10, 1891
Dernière à Sydney et bilan de la saison australienne.
Lien : Trove
Sarah Bernhardt. Close of the season. — The illustrious French actress made her last appearance in Australia on Saturday evening before an enthusiastic audience. In the afternoon she had repeated her fine performance of Fedora. For her farewell impersonation she chose Marguerite Gautier in La Dame aux camélias.
The applause and excitement culminated in the last act, which Madame Bernhardt played magnificently, bringing once more to this perfect portrayal of character all the resources of her art. Her death scenes, always exquisitely studied, contain nothing better than this. Her death as Marguerite would alone place her in the front rank of dramatic artists, even though she had done nothing else throughout her long career. The last act of La Dame aux camélias,
as interpreted by Sarah Bernhardt, is but one of many examples furnished by this gifted, versatile and experienced player of the art of acting in its highest form. It riveted the attention of every spectator in the theatre on Saturday night. The applause which rained on the artist when the curtain fell on its pathetic close was not only the outcome of good feeling naturally prevalent at the farewell performance of one of the world’s first artists. It was also the expression of admiration at a superb artistic achievement. Mme. Bernhardt modestly bowed her thanks, but the applause continued. The curtain being again lowered, Mr. J. C. Williamson stepped to the front and begged the audience to retain their seats. A few seconds later Mme. Bernhardt was discovered, surrounded by the members of the company and by many well-known actors and actresses of the Australian stage. Floral tributes in great number were thrown and handed to her. There was a waving of the French flag, the audience cheered, and the artist remained bowing her acknowledgments. The curtain was lowered again and again, but the applause did not cease. At length M. Henri Kowalski stepped forward and briefly thanked the audience and the Australian public, on behalf of Madame Bernhardt, for the kindly reception given to her in this country. With a final cheer for the accomplished and distinguished actress, this memorable evening of excitement and congratulation ended.
It may be useful to record the particulars of Mme. Bernhardt’s visit to Australia. She arrived in Sydney from San Francisco on Tuesday, May 26, by the Monowai.
Leaving this city on the next day by special train, she reached Melbourne on the Thursday afternoon. Her first appearance on the Australian stage was made on Saturday, May 30, 1891, when she played Marguerite Gautier in La Dame aux camélias,
at the Princess Theatre, in the last mentioned city. She subsequently acted in the following order these characters : — Floria Tosca in Victorien Sardou’s drama La Tosca ;
Fédora is the same writer’s play of that name ; the title role in Sardou and Morcau’s Cléopâtre ;
Adrienne Lecouvreur in Scribe and Legouvé’s play ; Gilberte in Meillac and Halévy’s Frou-Frou,
Jeanne d’Arc in Jules Barbier’s legendary drama
of that name ; and finally, Theodora in Sardou’s drama. The Melbourne engagement of 24 nights and four matinees concluded on June 26.
During the following week, commencing on Monday, June 29, Madame Bernhardt played for six nights and one matinee at the Theatre Royal, Adelaide. She came by special trains from Adelaide to Sydney, arriving here on the afternoon of Wednesday, July 8. She opened here on the evening of that day, appearing at Her Majesty’s Theatre, which had been taken over from Mr. George Rignold for the occasion, in La Dame aux camélias.
She then played all the parts in which she had been previously seen in Melbourne, and in almost the same order. In addition, she created
the part of Pauline Blanchard in the production, for the first time on any stage, of M. A. Darmont’s drama of that name on Wednesday, July 22. Madame Bernhardt’s original season in Sydney was for only 19 nights. It was intended on the expiration of that engagement that she should visit Brisbane for a week. But she objected to the fatigue of the journey, and, in deference to her wishes but against his own judgment, Mr. Williamson, who had the control of the dates, consented to the actress remaining in this city for the remainder of her stay in the colonies. She was therefore transferred to the Theatre Royal, where she opened in Theodora
on Thursday, July 30. She gave nine evening performances and two matinees at the Royal, her total representations in Sydney amounting to 32 as against 23 in Melbourne.
The prolongation of the season here was naturally detrimental to the financial side of the undertaking. For the original subscription seats for the last night at Her Majesty’s Theatre were transferred to the Theatre Royal, and it was naturally impossible to have season tickets for the latter house. Tho season in Sydney was long drawn out and the process was a weakening one. Again, the repetition on two occasions of that gruesome piece Pauline Blanchard
did not tend to attract the public. It was an ill-advised stop. The first performance of that piece was enough. Still, despite these serious drawbacks, the season here was so far satisfactory that the management will make money by it. This result redounds to the credit of the city, for it proves that when a great attraction is presented to us it can be liberally supported.
The receipts of the season in Melbourne were nevertheless in excess of those in Sydney. Her Majesty’s Theatre, although often full, never containing the same amount of money as that taken in the Princess Theatre, Melbourne. Had the original programme been adhered to, the managers, at a rough calculation, would have been some £2000 extra in pocket, for the receipts for the first 19 nights would have been as large as they were for the entire 28 nights, and there would have been the Brisbane takings in addition. Mr. Williamson in his future arrangements with star
artists will, doubtless, take to heart the lesson to be learnt from the Bernhardt visit, which is that good nature should not be allowed to interfere with business.
It would be ungracious to conclude this notice of Mme. Bernhardt’s visit without a special word of recognition to the spirited men to whom we are directly indebted for pleasure and profit of witnessing the performances of the great artist. Mr. Henry E. Abbey the American impresario, and Mr. J. C. Williamson, the leading manager of Australia, are to be congratulated, not only on their success, but on the courage and enterprise which they have conspicuously shown in this instance. The expense and consequent risk of such an undertaking would seem fabulous to the outside public. Mme. Bernhardt receives a large fee for each performance, her extensive company has to be paid for, and the expenses of transport are enormous. Heavy rental of theatres, cost of production, and other incidental items have to he provided. When it is considered that Madame Bernhardt has played here to comparatively low prices — the average being less than half of those to which she plays in London — and when the heavy loss of time spent in traveling be reckoned, it will he gathered that the managerial profit cannot be large, while the risk is great. As stated, the managers will not lose by Madame Bernhardt’s visit ; but those who have gained most by the tragedienne’s recent season are the Australian public, who have been privileged to see a world-famous actress in the zenith of her power and under most advantageous conditions. The credit of the visit belongs to Mr. Abbey and to Mr. Williamson, who are both to be congratulated, not only on the result of their efforts, but on their enterprise.
It is to be hoped, now that the financial as well as the artistic success of Madame Bernhardt in Australia has been established, that the other great artists of the theatrical world will continue to visit us. As for Madame Bernhardt, we feel that we but echo the wish of the Australian play-going public when, in Byron’s well-known words, we say :
Fare thee well ! and if for ever,
Still for ever, fare thee well !
The New York Herald, July 25, 1891
Mme. Bernhardt’s Nationality.
Amazing Statement That the Great French Actress Is American Born.
New York, July 24.
An amazing and well-nigh incredible story regarding Mme. Sarah Bernhardt comes from Porland, Oregon. The Herald correspondent there telegraphs that Mr. J. H. Keables, residing at Pendleton, has just discovered that he is Mme. Sarah Bernhardt’s nephew. On Wednesday he received a letter from his mother, Mrs. L. E. Bell, now living at White River, Tulare County, California, informing him that her niece, Mary Nunn, living in Iowa, recently received a letter from Mme. Bernhardt, in which the actress revealed she was Mrs. Bell’s younger sister, who ran away from home in New York State thirty-nine years ago.
According to Mr. Keables, Mme. Bernhardt was then ten years old, and remarkable for her violent temper. Her true name is Sara King, and her birthplace America. Her father, Kingsley King, was of French and Jewish descent and a plasterer by trade. He lived at Rochester, New York State. Sara was an orphan, and she and the other children lived with her aunt, the father’s sister, Mrs. Mary Finefield, in Rochester.
One day a remark displeased her, and she left the house. This was not unusual, and no attention was paid to it. She returned not, bowever, and her fate has been a mystery. For thirty-nine years she was mourned as dead, and the surprise which her disclosure occasioned may be imagined.
If the story be true, Mme. Bernhardt cannot be called a French actress, as there is abundant proof she has several relatives here, including two sisters and a brother.
[Dans l’édition du 27 juillet.]
Sarah and Katy.
The story that Mme. Sarah Bernhardt is not a Parisienne, but a Rochesterienne, and that her name is not Bernhardt, but King, is perhaps a little improbable. That a girl should run away from Rochester is not at all incredible, but that a Rochester girl should, merely by living in Paris, acquire a perfect French accent, and several undoubted sisters, is, to say the least, unusual.
Instead of believing that Mme. Bernhardt is Sara King, it is simpler to suppose that she is the once famous Katy King, the deceased daughter of an eminent pirate, who appeared to Robert Dale Owen, Mme. Blavatsky, and many other believers in spiritualism. Mme. Bernhardt has something diaphanous and spiritual in her appearance, and she would doubtless much prefer to be the daughter of an English pirate rather than the daughter of a Rochester plasterer. If she herself will confess that she is Katy King, she may induce people to believe her, but the world will never, if it can help itself, believe that she is Sara King, of Rochester, N.Y.
[Dans l’édition du 29 octobre.]
A statement was recently made by some of the newspapers in the United States to the effect that Sarah Bernhardt was born in America ; but it was contradicted by the actress herself as soon as it was reproduced in France. A publication styled L’Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux (a sort of French Notes and Queries) now gives an extract from the register of her birth. She is inscribed as née Rosine Bernhardt, born in Paris, at 5 rue de l’École de Médecine, on October 22, 1844, and the daughter of Dame Julie Bernhardt, dressmaker, aged twenty three years, a native of Berlin, living at 22 rue de la Michodière, and of a father not named.
When Mme. Bernhardt was admitted to the Conservatoire she produced the above record.
The New York Herald, September 13, 1891
Mme. Bernhardt in her new Role.
Mme. Sarah Bernhardt appeared in San Francisco last night for the first time in America in M. Auguste Darmont’s new play Pauline Blanchard,
and scored a big success, the mad scenes being superbly acted.
The first scene of the play opens in a farmhouse in Burgundy, belonging to Pauline’s father. The news has just come that Marchal has been elected Mayor instead of Blanchard. Francois, the son of Marchal, and Pauline are in love, but old Blanchard declares his daughter shall never wed the son of his enemy, and must become the wife of Cadet, a stupid fellow. While swearing eternal fidelity to her lover, Pauline hears her father coming. She hides François in a closet. When the room is clear Francois tries to escape, but finds all the doors and windows locked. In his despair he goes to Pauline’s bedroom and proposes to end the dilemma by leaping out of the window.
In the next act, François, hoping to stop the marriage, tells his father Pauline is his mistress. Blanchard, however, goes on with the marriage, and forces Pauline to consent.
The succeeding acts depict Pauline crazy. Having run away from home, she does her best to persuade François to protect her ; but, influenced by his mother, he gives her up. In the sixth act Cadet and Pauline meet, and the wife cats her husband’s throat with a sickle. A raving maniac, she survives the tragedy only a short time.
The New York Herald, October 10, 1891
Mme. Bernhardt’s Receipts.
Mme. Sarah Bernhardt has broken the record of large theatrical receipts in Chicago, her total for the past week having exceeded by $29,000, the highest ever taken either by Mme. Patti or by Mr. Henry Irving during a single week at the same house.
The New York Herald, October 18, 1891
La Comtesse de Challant,
the new drama by M. Giacosa, which Mme. Sarah Bernhardt has bought for America, was produced on Thursday at the Carignan Theatre at Turin. The principal role was played by Signora Dusa, the great Italian actress, but the piece was not an unqualified success.
The New York Herald, November 15, 1891
La Tosca.
At the Standard Theatre last night, apart from the performance of Mme. Sarah Bernhardt, who played the part of Floria in La Tosca,
with her usual charm, the interest centered in M. Darmont’s assumption of the role of the fiendish Scarpia. That he performed the task well was the general verdict, though not perhaps with Paul Benton’s finish or force.
The New York Herald, November 18, 1891
The New York Stage.
Mme. Sarah Bernhardt’s Jeanne d’Arc at the Standard Theatre. — Great Acting Saves the Piece.
New York, November 6, 1891.
(A New York Dramatic Critic.)
The re-appearance of Mme. Sarah Bernhardt on the New York boards on Wednesday [November 4] night course drew a crowd to the ugly and uncomfortable Standard Theatre.
The play was Jules Barbier’s Jeanne d’Arc,
a bad choice. For the legend
which created so much stir two years ago in France is undramatic and ill suited to display the stronger points of the great actress. If success or failure had depended on the play the house would have been thinned at least an hour before Jeanne went to the stake.
But the programme mattered less than the performance. And, so far as the public was concerned on Wednesday night, the whole performance was summed up in Mme. Bernhardt.
Putting Forth All Her Strenght.
She was hardly herself in the earlier scenes of the play. She had grand moments, glorious flashes, but it was not till she reached the fifth act that she put forth her whole strength, and, by one of the most splendid efforts even she has shown us, stirred an unusually cold audience to enthusiasm.
The quiet and simplicity which marked her acting in the scenes which preceded her mystic call were a surprise to some of us. But mysticism palls on one after a time.
It seemed to pall on Sarah. And it was not until the magnificent tirade which ends the second act that she really touched the heart of her audience.
The cathedral scene, with all its pomp and splendor, made no impression. But Sarah’s opportunity came in the fifth act, when she confronted the foes who strove to wring a confession from her, and appealed from man’s inhumanity to Divine justice. There was no mistaking the effect she produced in this scene. The house rang with applause, and Mme. Bernhardt had to bow repeated acknowledgments.
The New York Herald, November 29, 1891
Mme. Sarah Bernhardt made her first appearance in New York last night as Pauline Blanchard. The press agree that it is one of the finest efforts of her life.
The New York Herald, December 5, 1891
Mme. Bernhardt Makes a Great Hit.
Mme. Sarah Bernhardt made a great hit at the New York Standard Theatre last night in the first performance of Mr. Giacosa’s play La Dame de Challant.
The actress was recalled a dozen times. The play has been given judicious endorsement by the press, and Mme. Bernhardt acting is enthusiastically praised.
The audience was a distinguished one, and hardly a person left his seat till the close, though the performance lasted till midnight.
The New York Herald, December 6, 1891
Mme. Bernhardt Waves Adieu to Her Son.
Mme. Sarah Bernhardt was on the deck of the French steamer La Champagne just before she sailed to-day, and afterwards waved adieus to her son Maurice, who, in company with M. Giuseppe Giacosa, author of La Dame de Challant,
left for France on the Trans-atlantique Company’s liner.
The New York Herald, December 14, 1891
Mlle. Forgue, the young actress who succeeded Mme. Sarah Bernhardt in the role of Jeanne d’Arc at the Porte-Saint-Martin, died yesterday morning in her twenty-fourth year.
The New York Herald, December 15, 1891
Mme. Bernhardt Scores Again.
Mme. Sarah Bernhardt drew an immense audience, composed chiefly of French people, last night to the Casino, where she played M. Theuriet’s Jean Marie
for the benefit of the French Benevolent Society. The officials of the society and others surged on the stage, and overwhelmed her with flowers. M. Paulus was to have been invited to aid in the entertainment, but Mme. Bernhardt declared that if he appeared she wouldn’t, so his name was omitted from the programme.
The New York Herald, December 22, 1891
Close of Mme. Bernhardt’s Engagements.
Mme. Sarah Bernhardt ends her present engagement at the Standard Theatre to-night, where she will repeat her strong and admirable performance of the heroine in Pauline Blanchard.
On Sunday night she will act in Jeanne-Marie
at the Casino for a benefit. Next morning she starts for Philadelphia.
The New York Herald, December 28, 1891
Lien : Gallica
Sarah Bernhardt’s Closing Performances and Future Arrangements.
Sarah Bernhardt closed her engagement at the Standard Theatre on Saturday, when she treated us to a remarkable performance of MM. Darmont and Humblot’s rustic play of Pauline Blanchard.
On Sunday Sarah played in Jean-Marie,
at the Casino, for the benefit, of a local French charity, and on Monday she started on another long provincial tour. She is at present in Philadelphia, and will not return to New York till May, when she hopes to open the New Fifth Avenue Theatre.
The New York Herald, July 28, 1892
Mme Bernhardt’s Earning Capacity.
The London correspondent of the Liverpool Post says : Sarah Bernhardt, during her season at the Royal English Opera House, realized over £6,000. I believe her share was a fourth of the drawings, and as these averaged about £100 every performance, the sum can be easily reckoned. She played about nine weeks in all, and at £600 a week the total would be £5,400, but she had a good many day performances, and these would bring the grand total up to nearly £7,000.
La Minerve, 7 avril 1891
Extrait de la rubrique : À travers la ville. Sarah Bernhardt à Montréal.
Lien : BAnQ
La grande tragédienne Sarah Bernhardt est arrivée à Montréal hier matin. Elle a donné sa première représentation hier soir à l’Académie de Musique. Elle a joué Fédora. Il y avait foule.
Extrait de la Chronique.
Allez où vous voudrez, dans les salons, dans les cercles, dans les maisons bourgeoises, partout, vous entendrez parler de Sarah Bernhardt.
On en parle tellement que beaucoup de gens en sont agacés. […]
[Représentations de Sarah Bernhardt à l’Académie de musique de Montréal : — 6 avril, Fédora ; — 7 avril, Jeanne d’Arc ; — 8 avril, la Tosca ; — 9 avril, Camille ; — 10 avril, la Tosca ; — 11 avril en matinée, Jeanne d’Arc, en soirée, Frou Frou.]
La Minerve, 8 avril 1891
Jeanne d’Arc à Montréal.
Lien : Jeanne d’Arc à Montréal) BAnQ
Madame Sarah Bernhardt dans Jeanne d’Arc
Ça n’est pas dans les habitudes de la Minerve d’ouvrir ses colonnes aux faits du théâtre, où ses lecteurs devront se dire qu’une fois n’est pas coutume en la voyant aujourd’hui faire exception jusqu’au point de consacrer à la grande tragédienne et à sa représentation d’hier soir, un article même de rédaction. Mais nous ne pouvions laisser passer, sans la saisir bien vite, l’occasion de dire à cette étoile du théâtre des deux mondes tout le bien que nous pensons de son talent, quand délaissant un peu le romantique et le romantique à outrance où elle a cueilli à la vérité de splendides lauriers de succès, elle nous apparaît dans une pièce aussi classique que Jeanne d’Arc et s’y élève au degré de distinction et de gloire où tout son auditoire, ravi, l’acclamait, hier soir, au théâtre de l’Académie de Musique.
Elle ne vieillit pas Sarah, cette reine de la scène, et on la retrouve encore avec cette pure diction, ce jeu énergique et vigoureusement soutenu, que déjà l’on admirait chez elle lorsqu’elle passa par notre pays, il y a maintenant quelque dix ans. Les années qui, parfois, altèrent le talent, ne peuvent rien contre le génie, et chacun sait que madame Bernhardt à véritablement le génie de sa profession. C’était plaisir de la voir hier soir : on eut dit qu’elle se retrouvait parmi de vieux amis, devant la salle comble qui se pressait au pied de la scène pour la voir et l’entendre, et lorsqu’à maintes reprises, aux applaudissements réitérées de la foule, elle vint saluer et recueillir les salves de bravos qui soulignaient si chaleureusement ses succès.
Le drame historique de Jeanne d’Arc, fait spécialement pour madame Sarah Bernhardt, par le poète Jules Barbier, est assurément et sans contesté une des plus belles pièces du répertoire de l’éminente tragédienne. Le poète s’est surpassé, cherchant à s’élever à la hauteur du talent de celle qui devait l’interpréter et la puissante actrice, entrant parfaitement dans son rôle, y fait découvrir des ressources, des richesses auxquelles l’auteur lui-même n’avait peut-être pas songé. L’un avec l’autre et l’un par l’autre, va sans dire qu’ils se complètent et se perfectionnent on ne peut mieux. Il n’est pas besoin d’ajouter de la musique que l’on entend dans Jeanne d’Arc qu’elle est excellente aussi ; il suffit de mentionner le fait qu’elle est de Gounod pour que chacun sache ce qu’elle doit être. Aussi nous n’étonnerons personne en disant que Jeanne d’Arc a été une pièce à succès de la scène de Paris et ce n’était pas du tout une réputation surfaite celle qui l’a précédée ici et qui a fait accourir en si grand nombre les amateurs pour voir représenter, hier soir, ce drame magnifique par l’incomparable Sarah.
Ah ! si l’on pouvait l’aimer davantage la bonne Lorraine, madame Bernhardt nous la rend si bonne, si grande, si belle, que nous l’aimerions encore plus. Avec quelle puissance elle nous tire des brumes de la légende historique cette noble figure des siècles passés et nous la met en un relief complet qui nous permet de la contempler et de savourer à loisir tout le bonheur de cette aimable intimité.
M. J. Barbier connaissait le sujet et il à fait pour madame Sarah Bernhardt une Jeanne d’Arc un peu spéciale c’est vrai, mais telle aussi qu’elle la personnifie admirablement. Ce n’est plus, à de rares exceptions près, la Jeanne d’Arc de Casimir Delavigne que met en scène Barbier. On ne voit plus simplement cette naïve fille des champs, à qui l’illumination, les extases même ont laissé toute son ingénuité ; la vierge de Domrémy — et c’est le reproche qu’on en pourrait faire à l’auteur, si réellement il y a là matière à reproche — le vierge de Domrémy, sous l’influence de ses inspirations vives et spontanées, est devenue, non plus une hallucinée, comme ont pu le craindre un instant ses parents et amis, car elle conserve toujours, dans ses fougueux emportements, un jugement droit, un cœur pur, une âme forte, mais elle est devenue une sorte d’hystérique dont les nerfs semblent mener la volonté, tandis qu’en réalité c’est cette volonté inébranlable qui domine tout l’être, lui communique cette émotion, cette agitation continue dont il semble frappé.
Quoi qu’il en soit, nerveuse mais énergique pour se plier mieux au tempérament de madame Bernhardt, ou douce mais résolue, comme l’histoire nous l’a toujours dépeinte, l’héroïne de Vaucouleurs est toujours sympathique aux fils de la France, mais elle ne saurait l’être plus certes, que Sarah Bernhardt la sait rendre dans le rôle tel qu’on le lui à confié.
Voyons un peu la marche du drame de M. Barbier. Le rideau se lève, au premier acte sur une scène bien belle. C’est l’intérieur de la maison de Jacques, père de Jeanne… [Nous retranchons le long et laborieux résumé de la pièce.]
En somme, une excellente pièce, interprétée par une artiste qui l’a comprise et scrutée jusqu’au fond, qui la rend avec une intelligence complète et un goût parfait, en faut-il plus pour composer un succès absolu ? Madame Bernhardt a clairement prouvé que non.
Le Monde Illustré (Montréal), 11 avril 1891
Article d’Adolphe Adorer. Illustrations de Jeanne d’Arc à Montréal.
Lien : BAnQ
Madame Sarah Bernhardt. — Cette éminente tragédienne, qui remplit en ce moment les deux continents du bruit de son nom, se fait entendre tous les soirs de cette semaine à l’Académie de Musique, et jouera Fédora, la Tosca, Camille, Frou Frou et Jeanne d’Arc, l’immortel drame de Jules Barbier.
L’éloge de Mme Sarah Bernhardt n’est plus à faire ; s’il y à quelque part une sixième partie du monde, cette rivale de Rachel n’y est pas moins célèbre que dans les cinq déjà connues, certainement. Jamais nom n’a atteint une plus grande popularité, et jamais tragédienne n’a rendu avec plus de vérité la tendresse et l’amour, la puissance et l’humilité, la haine et la colère. Son art pour elle, c’est le tout de sa vie, c’est le but unique où tendent les forces de son intelligence.
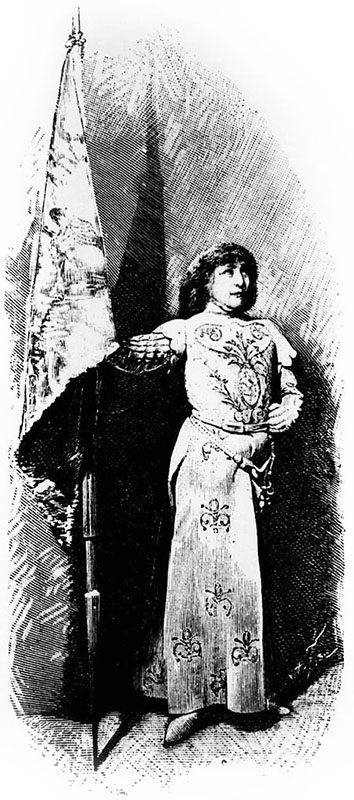
Notre gravure la représente tenant l’oriflamme. Jeanne a été victorieuse : son roi est couronné. Elle est radieuse : vêtue de blanc (les brodequins, les chausses, la longue tunique, serrée à la taille, tout est blanc), elle porte au côté gauche la longue épée et sa main s’appuie sur elle. De la main droite, elle tient haut et ferme l’oriflamme… Tout à l’heure, le couronne sera placée sur le front de son roi et elle remercie son Dieu, mais déjà elle laisse voir quelques sombres craintes pour l’avenir. Mme Sarah Bernhardt, tendre ou pathétique en d’autres passages, est, à ce moment, délicieusement poétique. Il semble qu’elle veuille prendre en elle l’âme de la France et l’offrir à Dieu.

Jeanne d’Arc.— Le greffier lisant à Jeanne d’Arc dans sa prison la sentence de mort.
Notre seconde gravure représente Jeanne d’Arc dans sa prison ; un vil grabat, recouvert d’une paille flétrie, a servi de couche à la prisonnière… On vient de la réveiller pour lire la sentence. Jeanne est debout, vêtue d’une longue tunique masculine, qui, après les mois passés en prison, est usée sur les bords. Elle écoute la sentence que lit le greffier, elle dément ses affirmations perfides, en s’écriant à plusieurs reprises : Non ! non ! non !
… Auprès d’elle, les docteurs qui ont concouru à l’arrêt, Warwick qui l’a exigé et les soldats brutaux qui ont gardé la chaste héroïne.

Jeanne d’Arc.— Le bûcher sur la place du Vieux-Marché à Rouen.
L’arrêt est exécuté. Le bûcher a été dressé sur la place étroite du Vieux-Marché. Les maisons aux toits pointus, aux fenêtres ogivales, se pressent les unes contre les autres. Au fond, on aperçoit la vieille église gothique, avec ses arceaux légers, ses ornements multiples.
Sur la place, on a établi à droite et à gauche deux estrades, l’une pour les prêtres, l’autre pour le tribunal et Warwick ; des barrières solides empêchent la foule d’approcher. Il est donné lecture de l’ordonnance de mort. Jeanne, qui a repris les vêtements de son sexe, une longue robe blanche, est montée sur le bûcher. Les flammes crépitent et la fumée s’épaissit. Jeanne demande une croix que lui tend le prêtre :
Du Christ avec ardeur Jeanne baisait l’image,
a dit Casimir Delavigne… Devant tant d’héroïsme et tant de grâce le peuple commence de s’émouvoir. Les hommes d’armes, eux-mêmes, sont comme tremblants et inquiets. Un seul d’entre eux, plus dur que les autres, veut apporter lui-même du bois au bûcher : il tombe foudroyé…. La fumée entourera bientôt le bûcher et la sainte. Le crime est commis ; l’impiété est consommée. Et l’on entend encore la douce voix de Jeanne qui, faiblement, adresse un dernier cri d’amour vers les siens, vers sa patrie, vers Dieu qui lui tend les bras.
L’Indépendant Rémois, 12 mai 1891
Concours de poésie Jeanne d’Arc à Épernay, présidé par Jules Barbier.
Lien : Retronews
Académie champenoise. — Dimanche dernier [10 mai], à 2 heures de l’après-midi, ont eu lieu au théâtre la fête littéraire et artistique de l’Académie champenoise, à laquelle assistait un public nombreux et choisi.
Beaucoup d’artistes ayant concouru au tournoi littéraire en l’honneur de Jeanne d’Arc, étaient venus recevoir leurs prix et prendre part à la fête.
M. Jules Barbier, officier de la Légion d’honneur, auteur dramatique, présidait la solennité. Son allocution toute patriotique sur Jeanne d’Arc fut très goûtée du public et plusieurs fois couverte d’applaudissements.
La proclamation des récompenses par M. Camille Schwingrouber fut écoutée attentivement et chaque lauréat salué par des bravos. Quelques-uns de ceux présents donnèrent lecture de leurs poésies sur la trilogie de Jeanne d’Arc ; l’assistance put ainsi apprécier leur talent et juger du droit qu’ils avaient à ces récompenses.
Citons une brillante allocution de M. Armand Bourgeois, président de l’Académie, et nous passerons à la partie musicale de la fête :
En première ligne se place un lauréat du concours, savant pianiste, qui rendit avec beaucoup d’expression sa composition : Marche funèbre de Jeanne d’Arc allant au bûcher
, puis plusieurs morceaux joués de main de maître.
Une rêverie pour violon, exécutée par M. Gustave Julien, fut détaillée avec infiniment de goût et tint le public sous le charme.
La jeune artiste dont M. Bourgeois s’était assuré le concours, Mlle Marguerite Naudin, de Paris, est une enfant de 12 ans qui possède une voix étonnante. Elle chante avec une méthode, une expression et un naturel au-dessus de tout éloge. De plus, elle est charmante et a, sans paraître s’en douter, conquis les sympathies et l’admiration de tous.
Mlle Blanche Roger a une voix étendue, très agréable,qu’elle conduit admirablement ; les applaudissements ne lui ont pas fait défaut, non plus qu’à M. Froment, qui a chanté avec elle le duo de la Cigale et la Fourmi et celui de Gilette de Narbonne.
N’oublions pus de nommer notre excellente Musique municipale et de lui adresser les plus sincères félicitations pour la manière dont elle a exécuté les morceaux du programme.
La fête avait duré jusqu’à près de 6 h., mais le temps n’avait paru long à personne.
Un banquet, présidé par M. J. Barbier, eut lieu à l’hôtel Dombios et termina la journée d’une façon satisfaisante.
La France militaire, 22 mai 1891
Lien : Retronews
Concours littéraire
L’Académie champenoise, société littéraire et artistique de la ville d’Épernay (Marne), dont la devise est : France — Jeanne d’Arc
, avait donné pour son concours annuel littéraire de 1891 le sujet patriotique suivant : Trilogie de Jeanne d’Arc (Orléans, Reims, Rouen).
De nombreux littérateurs ont pris part au concours, qui a eu lieu sous la direction de M. Bourgeois, président de l’Académie champenoise.
M. Jules Barbier, auteur dramatique, était président du jury.
Longue est la liste des lauréats. Couronnes, médailles, diplômes artistiques ont été distribués lors de la fête annuelle, qui a eu lieu à Épernay pour célébrer l’héroïne française, dans le même temps où M. Carnot, président de la République française, rehaussait par sa présence les fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans ; et, dans l’impossibilité où nous nous trouvons de donner tous les noms des vainqueurs au tournoi patriotique et littéraire, nous mentionnerons toutefois celui d’un de nos collaborateurs, M. A. Garçon, dont le nom figure en bonne place dans le palmarès parmi ceux qui ont traité avec succès le sujet mis au concours.
L’Indépendant du Cher, 23 mai 1891
Lien : Retronews
Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc, la Patronne des envahis, comme l’a appelée Déroulède, est plus que jamais à l’ordre du jour depuis nos désastres de 1870.
La ville de Bourges, dans un sentiment qui l’honore, s’est mise à l’unisson de ce grand mouvement national en donnant le nom de cette héroïne à l’une des nouvelles rues avoisinant l’hôpital militaire et s’ouvrant sur le côté gauche du boulevard de la Liberté.
Aussi, croyons-nous être agréable à nos lecteurs en leur donnant, d’après le Journal de la Marne, la reproduction d’une poésie récompensée au grand concours littéraire qui a eu lieu le 10 du courant à Épernay, sous la présidence de M. Jules Barbier, l’illustre auteur dramatique, à l’occasion de l’érection d’une statue équestre de Jeanne d’Arc à Reims. M. Lucien Jeny, notre concitoyen, a obtenu à ce concours, où le jury avait reçu plus de 400 envois littéraires.
La Démocratie du Cher, 24 mai 1891
Lien : Retronews
Jeanne d’Arc n’a pas de chance.
Elle a été calomniée par les Anglais, brûlée par la sainte Église catholique et romaine, chantée par Casimir Delavigne et Jules Barbier. M. Baron l’a comparée à la Vosgienne Mina, par lui créée. Aujourd’hui, M. Lucien Jeny adresse à la Pucelle, par le canal de l’Indépendant, des vers qui déshonoreraient un mirliton, et qui semblent ignorer l’existence du nommé Lyrisme tout comme M. Lerasle ignorait, à vingt ans, l’existence de l’ustensile dénommé : globe terrestre, et comme les huit avocats do la droite du Conseil municipal ignoraient, il y a quinze jours, l’existence de l’ustensile dénommé : compendium.
Jeanne d’Arc
La Dépêche, 1er août 1891
Encart publicitaire.
Lien : Retronews
Un mot de Sarah Bernhardt
Si je personnifie à ce point Jeanne d’Arc ;
Si je vous apparais jeune et belle, et si l’art
Me transfigure, — il est juste que je l’avoue,
Grâce à Félix Eydoux je délaisse tout fard ;
Le Savon Mikado fleurit seul sur ma joue.
Fabricant, Félix Eydoux, Marseille.
Représentant à Toulouse, Paul Dereix, 55, rue Roquelaine ; vendeurs en gros, à Agen. J. Mazarin et J. Baron.
Vert-Vert, 16 décembre 1891
Décès d’Albertine Forgue.
Lien : Retronews
Aujourd’hui mardi [15 décembre], à midi, ont été célébrées, en l’église Notre-Dame de Clignancourt, les obsèques de Mlle Albertine Forgue, artiste dramatique, qui a succombé, dans la journée de dimanche [13 décembre], aux suites d’une maladie de poitrine.
Mlle Forgue, qui était âgée de vingt-trois ans à peine, avait remporté, il y a quelques années, un premier prix de tragédie au Conservatoire. Elle entra de là à l’Odéon, où elle ne fit que débuter. Elle joua ensuite au Théâtre-Libre ; remplaça Sarah Bernhardt, à la Porte-Saint-Martin, dans le rôle de Jeanne d’Arc ; créa la Lucienne de M. L. de Gramont, aux Menus-Plaisirs, et fut, pendant quelque temps, pensionnaire du théâtre du Parc, à Bruxelles.
L’inhumation a eu lieu au cimetière de Saint-Ouen.
La Minerve, 30 décembre 1891
Nouvelle semaine de Sarah Bernhardt à Montréal.
Lien : BAnQ
Montréal. — La première de Sarah Bernhardt, hier soir, n’a pas été un grand succès au point de vue du nombre, beaucoup de fauteuils étant vides, si l’on excepte ceux de l’orchestre qui étaient remplis. La grande tragédienne n’a rien perdu de son incomparable talent. Sa voix a conservé toute sa richesse, toute sa flexibilité, et elle sait dire chaque chose, exprimer chaque sentiment avec un art qui atteint la perfection.
Pauline Blanchard qui paraissait ici pour la première fois sur les planches, est l’œuvre d’un débutant, M. Darmont, qui est en même temps l’un des principaux acteurs de la pièce. En voici l’analyse : […] Madame Sarah Bernhardt, qui meurt de congestion cérébrale, et qui sait si bien mourir, donne à son personnage un caractère de passion, qui fait parfois frémir. Quant à la note morale, elle fait malheureusement défaut comme dans la plupart des pièces mordernes.
[Annonce des Amusements :]
Académie de Musique, semaine de décembre, commençant le 29 : Mme Sarah Bernhardt, sous la gérance de MM. Abbey, Schœffel et Grau.
Répertoire :
- Mardi 29 décembre : Pauline Blanchard ;
- Mercredi 30 : La Tosca ;
- Jeudi 31 : Adrienne Lecouvreur ;
- Vendredi 1er janvier 1892 : Cléopâtre ;
- Samedi 2 (matinée et soirée) : Cléopâtre.
Prix : $3,00, $2,50 et $2,00. La vente des sièges commencera chez Northeimer, jeudi, décembre 24.
Vert-vert, 4 mars 1892
Tournée en Amérique.
Lien : Retronews
On écrit de New-York au au Temps qu’à Saint-Louis on a refusé l’entrée de tous les hôtels à Mme Sarah Bernhardt, à cause de la ménagerie qu’elle traîne derrière elle. La grande artiste a dû coucher dans son sleeping-car.
Vert-vert, 25 avril 1892
Retour d’Amérique.
Lien : Retronews
Au cours de sa grande tournée d’Amérique, Mme Sarah Bernhardt, se trouvant dans le Texas, eut la fantaisie de s’offrir les émotions d’une grande chasse au bison.
Mais il n’en reste plus à plusieurs malles à la ronde ; comment faire pour satisfaire la capricieuse tragédienne ? On fit jouer le rôle du bison à un taureau noir, aux longs crins, que l’on excita préalablement.
Sarah arrive, voit la bête et ne peut se défendre d’un frisson. Mais bien vite remise, elle épaule, vise, fait feu, et abat l’animal.
On craignit qu’elle ne devint folle de joie ; mais quelle déception plus tard, lorsqu’un bavard de la troupe lui dévoila la supercherie ! Elle en pleura.
[Édition du 26 avril :]
Une dépêche de New-York, du 23 avril, annonce que la Bretagne est partie pour la France, ayant à son bord Mme Sarah Bernhardt.
Vert-vert, 4 mai 1892
Retour à Paris.
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt est arrivée hier à Paris. Interrogée par un de nos confrères sur les événements du 1er mai, elle a dit :
… Là-bas, à New-York, on était bien tranquille, car l’on y considère la fameuse journée comme une
balançoire
et la population saurait, au besoin, se défendre elle-même contre toute tentative anarchiste.
Mme Sarah Bernhardt retournera en Amérique l’année prochaine ; elle a promis d’aller donner quelques représentations à l’Exposition de Chicago.
En terminant, elle a démenti l’aventure de chasse dont le Globe Democrat de Saint-Louis l’a faite l’héroïne ; elle n’a tué au Texas aucun taureau, et le récit du Globe n’est qu’une plaisanterie.
[Édition du 5 mai :]
Mme Sarah Bernhardt, après un repos de quinze jours à Paris, ira passer un mois à Londres où elle donnera des représentations de son répertoire.
Il est question ensuite d’une tournée de quelques mois en Europe.
[Édition du 10 mai :]
Londres. — Le 28 mai prochain, nous aurons les représentations de Mme Sarah Bernhardt au Shaftesbury Theatre, où on jouera, tout d’abord Cléopâtre.
[Édition du 17 mai :]
Mme Sarah Bernhardt a accepté de donner le concours de son talent à la représentation de gala donnée le 19 mai, à l’Opéra, au bénéfice des Ambulances urbaines et de la disette en Russie [pour jouer la scène de la déclaration du 2e acte, de Phèdre].
Sollicitée, au nom de l’ambassade, par M. d’Adler, l’aimable chancelier du consulat de Russie, elle s’est engagée par le charmant billet suivant qu’elle lui a remis : Je dis : oui, et je dis : merci d’avoir pensé à moi !
[Édition du 27 mai :]
Nous avons annoncé que les nouveaux directeurs de l’Odéon monteraient, l’hiver prochain, Pauline Blanchard, le drame de MM. Jules Case, Humblot et Darmont.
MM. Marck et Desbeaux se rendront à Londres le mois prochain pour assister aux représentations de cette pièce dont le rôle principal, créé par Mme Sarah Bernhardt, sera joué à l’Odéon par Mme Segond-Weber, qui ira également à Londres afin de prendre les précieux conseils que la grande artiste a bien voulu lui promettre.
[Édition du 30 mai :]
Londres. — Cléopâtre a été un énorme succès ; Sarah Bernhardt a été rappelée plusieurs fois, elle a reçu de nombreux bouquets ; au troisième acte, on lui a fait une ovation, ainsi qu’à Albert Darmont, un jeune premier qui s’est révélé comme un artiste de grand talent.
Vert-vert, 16 juin 1892
Sarah Bernhardt à Londres.
Lien : Retronews
Londres. — Mme Sarah Bernhardt a continué, hier soir, la série de ses représentations au Royal English Opera, en jouant la Tosca.
Elle a été rappelée après chaque acte. Son succès a été très grand.
[Édition du 17 juin :]
Mme Sarah Bernhardt vient de lire une pièce en un acte, écrite en français, par M. Oscar Wilde, l’auteur anglais bien connu. La grande tragédienne a accepté avec plaisir d’en jouer le principal rôle.
L’acte de M. Oscar Wilde s’appelle Salammbô. Il sera représenté d’abord à Londres, avant le départ de Mme Sarah Bernhardt. [Note : La pièce Salomé fut mise en répétition dans le courant du mois mais ne passa pas la censure et son interdiction de représenter les figures bibliques.]
[Édition du 18 juin :]
Pauline a obtenu un grand succès, devant une salle comble. Sarah Bernhardt a été applaudie à outrance.
Sur ses conseils, le rôle de Pauline sera joué à Paris, à l’Odéon, par Mlle Weber, qui doit arriver demain.
Le rôle de Blanchard, très bien joué par Munie, sera interprété à Paris par Cabel.
[Édition du 19 juin :]
Dernière incarnation de Mme Sarah Bernhardt. La grande tragédienne, avant de finir son engagement à Londres, jouera dans la comédie d’un auteur anglais.
Le clou
de la pièce sera l’apparition de Sarah Bernhardt avec des cheveux bleus, son rôle exigeant ladite nuance.
[Édition du 20 juin :]
On écrit de Londres au Gaulois :
Pauline Blanchard a été vivement critiqué par la presse anglaise. C’était à prévoir. Il y a dans la pièce de MM. Albert Darmont et Humblot des scènes de vie réelle que devaient difficilement accepter les Anglais. Je ne puis aujourd’hui que vous confirmer ce que je vous télégraphiais hier : il y a des beautés de premier ordre dans Pauline Blanchard au point de vue dramatique, et je ne doute pas du succès de la pièce lorsqu’elle sera donnée à l’Odéon, si les auteurs veulent bien se résoudre à des coupures indispensables.
Il y a, en effet, quelques longueurs qui rendent, par moments, le drame languissant. J’ai appris aujourd’hui, de la bouche de Sarah Bernhardt, qu’elle avait failli être tuée hier, en entrant en scène, au troisième acte.
Au troisième acte, nous sommes chez la tante de Pauline Blanchard. C’est là que Pauline, fuyant le foyer conjugal, vient se réfugier. Il fait un orage effroyable, les éclairs et les coups de tonnerre se succèdent. Elle entre en scène au même instant où on entend la foudre tomber. C’est une machine électrique placée dans la coulisse, qui rend la détonation de la foudre. Hier, le bruit a été celui d’un coup de canon. La machine avait eu une détonation formidable, et Mme Sarah Bernhardt, qui passait non loin de la machine, a reçu une forte secousse dans la poitrine. Elle aurait pu tout aussi bien être frappée à la tête.
La grande tragédienne était, ce matin, un peu souffrante. Mais elle est déjà remise, et a répété, cet après-midi, pour la première fois, l’acte de M. Oscar Wilde, dont le titre n’est pas Salammbô, comme je vous l’ai écrit par erreur, mais Salomé.
Il m’a été donné d’assister à cette première répétition, qui n’a été qu’une lecture, les acteurs ne sachant pas encore leur rôle.
La pièce est intéressante, peut-être à tendances un peu trop… mystiques. Mais, chut… pour le moment, car j’ai promis le silence jusqu’à la première représentation, qui n’aura pas lieu avant quinze jours.
Salomé, c’est naturellement Sarah Bernhardt. La grande actrice est très éprise de son rôle, et elle espère bien faire encore une belle création.
[Édition du 26 juin :]
Les représentations françaises données au Royal English Opera par Mme Sarah Bernhardt, obtiennent un si grand succès que les directeurs MM. Abbey et Grau ont décidé de prolonger de deux semaines au moins l’engagement de la grande artiste et de sa vaillante troupe.
Personne ici ne s’en plaina.
Mme Sarah Bernhardt fera toutefois bien de ménager ses forces. Elle répète toute la journée, joue le soir, et deux fois par semaine elle joue et l’après-midi et le soir, sans prendre aucun repos, malgré les sollicitations de ses amis et de ses directeurs.
Elle a pu s’apercevoir, hier, des conséquences de ce surmenage.
Après avoir répété Fédora dans la journée, elle a joué, le soir, la Dame aux camélias, et j’ajoute qu’elle l’a jouée d’une façon tout à fait géniale.
Lorsqu’elle a quitté la scène, après le cinquième acte, elle est tombée raide en proie à une attaque de nerfs. Le directeur et quelques amis se sont empressés autour d’elle. Il a fallu une heure au moins pour la calmer, et elle est rentrée extrêmement souffrante chez elle.
Elle a tenu néanmoins, par un effort de volonté, à jouer en matinée la Dame aux camélias.
Vert-vert, 7 juillet 1892
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt est rentrée hier à Paris, retour de Londres, où elle vient d’obtenir d’éclatants triomphes.
La grande artiste restera à Paris jusqu’en septembre, époque à laquelle elle fera une nouvelle tournée à travers l’Europe. Elle commencera par Bruxelles, où elle jouera à la Monnaie.
[Édition du 24 juillet :]
Mme Sarah Bernhardt donne, aujourd’hui, à Londres, ses deux dernières représentations de la saison. En matinée, la Dame aux camélias ; le soir, la Tosca.
[Édition du 26 juillet :]
Londres. — La dernière représentation de Sarah Bernhardt a eu lieu dans la Tosca, ainsi que vous l’avez annoncé.
L’enthousiasme du public était vraiment extraordinaire. On l’a rappelée après chaque acte et, après le baisser du rideau sur le dernier, on l’a obligée jusqu’à dix fois à reparaître en scène.
Ce triomphe, car c’en est un, est sans précédent. Les fleurs, les cadeaux emplissaient sa loge, et, quand notre grande artiste a quitté le théâtre, une foule énorme l’attendait à la sortie pour l’applaudir encore et lui crier : Au revoir !
Grâce au concours de Sarah Bernhardt et de M. Darmont, qui a eu sa grande part du succès de ces représentations, la saison a été superbe et la direction Abbey mérite les félicitations du public et de la presse.
[Édition du 27 juillet :]
Mme Sarah Bernhardt est revenue de Londres après avoir donné soixante et une représentations. Elle va se reposer pendant un mois à Paris.
Elle repartira ensuite pour la nouvelle tournée dont nous avons parlé.
Elle jouera la Dame aux camélias, la Tosca, Phèdre, Cléopâtre, Théodora, Jeanne d’Arc, Léa, Pauline Blanchard, et aussi une pièce nouvelle, Marie Stuart, due à la collaboration de MM. Walter Pollock, directeur de la Salutary Review, et Richard Davey, rédacteur de la même revue.
Elle espère pouvoir rentrer à Paris dans les derniers jours du mois de février prochain.
[Édition du 30 juillet :]
Le correspondant du Liverpool Post à Londres croit savoir que, pendant les quelques mois qu’elle a donné des représentations au Royal English Opera, Mme Sarah Bernhardt a réalisé un bénéfice de plus de 6.000 livres (150.000 francs).
Sa part aurait été de 100 livres par représentation, soit 600 livres par semaine, pour les seules représentations du soir, ou 5.400 livres pour neuf semaines.
En ajoutant à cette somme un certain nombre de centaines de livres pour les représentations en matinée, on arriverait à un total certainement supérieur à 6.000 livres.
[Édition du 31 juillet :]
Du Daily Chronicle. — Avant de quitter Londres, Mme Sarah Bernhardt a visité l’hôpital français et a écrit ces quelques lignes dans le registre des visiteurs :
Mon cœur s’emplit de chagrin en pénétrant dans ce triste endroit, mais aussi de fierté en voyant que, partout où se trouvent des Français, la charité vient en aide à ceux qui souffrent.
En sortant de l’une des salles, Mme Sarah Bernhardt remit à la sœur supérieure sa bourse contenant trente-deux livres sterling, en lui disant tout bas :
— Pour vos pauvres malades.
Le Cri-Cri, 1er août 1892
Départ de Londres, un mois de repos à Paris.
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt a quitté Londres mardi matin [26 juillet], par la gare de Charing-Cross, à dix heures trente. Sa troupe est partie en même temps qu’elle.
Mme Sarah Bernhardt est arrivée à Paris dans la soirée. Elle y restera un mois dans un absolu repos. Puis elle ira donner une série de représentations en Belgique, en Hollande, à Vienne et en Russie.
Le Figaro, 4 août 1892
Repos dans le Finistère.
Lien : Retronews
On sait maintenant où Mme Sarah Bernhardt est allée chercher le repos.
C’est dans une petite localité du Finistère, à Benodet.
Elle y restera un mois.
La Patrie, 22 août 1892
Lien : Retronews
Nous avons dit que Mme Sarah Bernhardt était en ce moment en Bretagne, où elle pêche tranquillement à la ligne.
Veut-on savoir quels sont les projets de la grande artiste ?
Ses projets ? Elle rentre à Paris pour repartir en Belgique et à toute sa grande tournée d’Europe — l’Allemagne seule exceptée — qui se terminera au mois de mai par la season de Londres.
Et puis, l’autre hiver, Paris : toute à Paris, où elle espère créer quelques pièces de Sardou où d’autres peut être. Mais pour cette saison, ni pièce ni théâtre.
L’arrangement a été bien près de se conclure avec la Comédie-Française, qui a des pièces — au moins des vieilles, et alors nous avions Sarah cet hiver. Mais Sarah ne voulait promettre qu’un an et la Comédie en voulait trois.
Nous n’aurons pas Sarah.
L’Éclair, 2 septembre 1892
Choléra à Anvers.
Sarah Bernhardt et le choléra. Bruxelles, 31 août. — Un journal de Bruxelles a interviewé Mme Sarah Bernhardt et lui a demandé si l’épidémie cholériforme d’Anvers ne l’effrayait pas :
— Moi, craindre le choléra ? répondit-elle, mais ce n’est pas une maladie, et je nie le choléra. Peut-être y aura-t-il peu de monde à ma représentation d’Anvers, mais les quelques personnes qui y assisteront ne penseront pas au choléra lorsqu’elles seront au théâtre ; je les sauverai peut-être de cette prétendue maladie.
La Presse, 3 septembre 1892
Première de Cléopâtre à Bruxelles.
Lien : Retronews
La première des neuf représentations de Cléopâtre que Sarah Bernhardt doit donner à Bruxelles [au théâtre des Galeries-Saint-Hubert], a eu lieu jeudi soir [1er septembre]. La salle était comble malgré la chaleur. La grande artiste a été l’objet d’ovations, après le quatrième acte, et la fin du drame a été un véritable triomphe pour elle. On l’a couverte de fleurs.
Le Matin, 4 septembre 1892
Dates supplémentaires.
On nous écrit de Bruxelles que Mme Sarah Bernhardt, qui ne devait jouer, aux Galeries, que Cléopâtre et Phèdre, se trouve, de par le succès qu’elle a obtenu, forcée de donner quelques représentations supplémentaires de la Tosca, de Fédora, de Jeanne d’Arc et de la Dame aux camélias.
La Petit Parisien, 4 septembre 1892
Bruxelles. — Mme Sarah Bernhardt jouera encore Cléopâtre aujourd’hui [samedi 3 septembre] et demain dimanche.
[Elle donne :]
- Lundi : La Tosca ;
- Mardi : Théodora ;
- Mercredi [7 septembre] : Jeanne d’Arc ;
- Jeudi : Phèdre ;
- Vendredi : La Dame aux camélias.
Le Figaro, 7 septembre 1892
Lien : Retronews
Lettre de Belgique. — Au théâtre des Galeries, première représentation de la tournée Sarah Bernhardt. Depuis jeudi, la grande tragédienne attire la foule, qui lui décerne les ovations habituelles. La série, commencée par Cléopâtre, se continue par la Tosca, Fédora, Jeanne d’Arc, Phèdre et la Dame aux camélias.
Sarah jouera à Anvers, à Liège, à Gand, à Lille et à Roubaix, avant de gagner la Hollande, le Danemark, la Suède et la Norvège.
Le Matin, 8 septembre 1892
Sarah Bernhardt à Charleroi.
Lien : Retronews
Charleroi, 7 septembre. — La société royale des ex-sous-officiers de l’armée belge à Charleroi vient de prendre l’initiative d’une grande fête au profit des victimes de la catastrophe de Frameries.
Mme Sarah Bernhardt a reçu hier une délégation de la société et lui a promis son concours pour jouer la Dame aux camélias en matinée, vendredi prochain, à Charleroi.
[Édition du 10 septembre :]
Charleroi, 9 septembre. — Il y avait une foule énorme à l’Éden-Théâtre pour la matinée donnée par Mme Sarah Bernhardt au bénéfice des victimes de la catastrophe de Frameries.
La recette, qui sera intégralement versée aux familles des victimes, s’élève à 5,500 francs.
Une touchante manifestation a marqué le troisième acte : un porion et une herscheuse, en costume de travail, ont remis à la grande tragédienne une gerbe de fleurs.
La représentation s’est terminée au milieu d’un enthousiasme délirant.
La Cocarde, 11 septembre 1892
Bruxelles, 10 septembre. — Une centaine d’américains descendus au Grand Hôtel ont fait hier matin une ovation enthousiaste à Sarah Bernhardt. Ayant appris qu’elle devait se rendre à Charleroi, où une représentation de la Dame aux camélias était donnée au profit des victimes de la catastrophe de l’Agrappe, ils se sont pourvus de fleurs et ont attendu l’artiste dans la cour de l’hôtel. Ils l’ont accueilli par des hourras prolongés, jetant des bouquets sur son passage et dans la voiture qui la conduisait à la gare.
Le Temps, 14 septembre 1892
Lille, Anvers, Gand, Roubaix.
Lien : Retronews
On nous télégraphie de Lille que Mme Sarah Bernhardt a joué, hier, au Grand-Théâtre, la Dame aux camélias. On avait affiché Cléopâtre, mais la grande tragédienne, retour d’une représentation de charité à Charleroi, a vu tous ses bagages retenus à la frontière pour cause de désinfection.
Mme Sarah Bernhardt jouera, ce soir, à Liège [13 septembre] ; demain, à Anvers [14 septembre] ; jeudi, à Gand [15 septembre] ; vendredi, à Roubaix [16 septembre] ; puis elle gagnera la Hollande.
[Édition du 25 septembre :]
Mme Sarah Bernhardt va retourner à Bruxelles donner en matinée, le 2 octobre, au théâtre de la Monnaie, une représentation de Phèdre.
Elle donnera probablement une seconde représentation, composée de la Dame aux camélias.
[Édition du 30 septembre :]
Mme Sarah Bernhardt part aujourd’hui pour Bruxelles, où elle va jouer, comme nous l’avons dit, Phèdre, dimanche, en matinée, au théâtre de la Monnaie.
Mardi, elle jouera le soir la Dame aux camélias.
Vert-Vert, 5 octobre 1892
Sarah Bernhardt à Vienne.
Lien : Retronews
Extrait des Nouvelles.
Les journaux autrichiens annoncent la prochaine arrivée, à Vienne, de Mme Sarah Bernhardt, accompagnée de sa troupe.
La grande artiste se propose de donner dix représentations au Carltheater. Elle jouera, entre autres, Marie Stuart et Jeanne d’Arc.
Les représentations commenceront le 26 octobre.
Le Temps, 21 octobre 1892
Lien : Retronews
Notre correspondant de Vienne nous télégraphie que Mme Sarah Bernhardt a joué quatre fois de suite la Cléopâtre de Sardou, qui n’avait jamais été représentée à Vienne. Le succès de l’artiste et celui de la pièce ont été très grands. La troupe va se rendre à Prague.
[Édition du 24 octobre :]
Vienne. — Mme Sarah Bernhardt a terminé, hier, la série de dix-neuf représentations qu’elle devait donner à Vienne. Elle a joué Fédora au bénéfice de la Caisse des sauveteurs volontaires, à laquelle elle avait déjà fait une offrande de 500 francs.
La représentation a été interrompue par une panique qui s’est produite au premier acte. Pendant quelques instants, la salle fut envahie par un nuage de fumée. Les spectateurs, aussitôt, se précipitèrent vers les issues. Mme Sarah Bernhardt, qui se trouvait en scène, s’adressa au public pour lui recommander le calme et l’assurer qu il n’y avait aucun danger. Un conduit électrique avait pris feu. La représentation, après cette alarme, put tranquillement continuer.
Journal des débats, 27 novembre 1892
Saint-Pétersbourg.
Lien : Retronews
Saint-Pétersbourg. — Jeudi, au Petit-Théâtre, on a donné Phèdre, au bénéfice de Mme Sarah Bernhardt. La salle était comble et le succès de la tragédienne a été considérable.
Le Temps, 1er décembre 1892
Jeanne d’Arc à Saint-Pétersbourg, soutient de la Ligue de l’affranchissement des femmes d’une candidature de Sarah Bernhardt aux législatives.
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt vient de terminer par une représentation gratuite offerte aux élèves des écoles publiques de Saint-Pétersbourg la série de ses représentations au Petit-Théâtre.
La grande tragédienne a retrouvé son succès habituel auprès du public pétersbourgeois, qui a pu l’applaudir dans tous ses rôles de prédilection : Adrienne Lecouvreur, la Dame aux camélias, Froufrou, Cléopâtre et Phèdre.
Les deux représentations de Jeanne d’Arc ont donné lieu à des manifestations francophiles : du début de la pièce à la fin, tous les passages patriotiques ont été soulignés par des applaudissements nourris. Au troisième acte, l’enthousiasme n’a plus connu de bornes : les spectateurs, debout, les bras tendus vers la scène, ont à plusieurs reprises arrêté la marche de la pièce par leurs acclamations et leurs hourras.
Mme Sarah Bernhardt se rend a Moscou ; elle ira ensuite à Odessa et a Kiev, où elle doit donner une série de représentations.
[Édition du 23 décembre :]
Mme Sarah Bernhardt, revenant de Russie, arrivera à Vienne le 2 janvier et donnera, jusqu’au 7, une série de représentations au théâtre sur la Wien. Elle est actuellement à Kiev. De Kiev, elle ira à Odessa et d’Odessa en Autriche.
Quand elle aura fini la série de représentations qu’elle compte, donner à Vienne, elle se rendra en Italie.
[Édition du 26 décembre :]
Nous avons dit que la Ligue de l’affranchissement des femmes avait décidé de soutenir aux prochaines élections législatives la candidature de Sarah Bernhardt. Voici, à ce sujet, la lettre que la secrétaire de cette ligue vient d’adresser au syndicat des artistes dramatiques :
Citoyen secrétaire,
La Ligue de l’affranchissement des femmes me charge de vous dire qu’elle a proposé à Sarah Bernhardt de soutenir sa candidature aux élections de 1893, surtout pour combattre le préjugé encore répandu aujourd’hui, à savoir que les femmes de théâtre ne valent pas les femmes dites du monde. Elle espère donc que le syndicat des artistes dramatiques siégeant à la Bourse du travail voudra bien lui prêter son concours en répandant l’idée dans la corporation.
Agréez, etc.
La secrétaire générale de la Ligue,
Astié de Valsayre.
Le Monde artiste, 1er janvier 1893
Extrait des Notes et informations. Polémique à Saint-Pétersbourg.
Lien : Gallica
Sarah Bernhardt en Russie. — La tournée que vient de faire la grande tragédienne pourrait bien s’appeler la campagne de Russie, car elle a donné des résultats artistiques assez piteux, pour ne pas dire désastreux. Les Russes ont été froids, très froids, et la presse, tout en constatant l’admirable technique de l’actrice, a franchement critiqué son peu de naturel, son manque d’inspiration, son art artificiel.
Un incident assez comique a marqué la fin de son séjour. C’était l’anniversaire de la naissance de la tzarine et, à cette occasion, les trois théâtres impériaux ont coutume de donner une matinée à laquelle ils invitent gratis les enfants des écoles. S’inspirant de cet exemple, madame Sarah Bernhardt voulut donner, elle aussi, sa représentation gratuite, et elle choisit comme spectacle… la Dame aux camélias ! Ou les enfants étaient petits, et, ne sachant pas encore le français, ils ne devaient rien comprendre, ou ils étaient grands et comprendraient trop. Bref, la municipalité se trouva fort embarrassée de cette générosité intempestive. En fin de compte, on se décida à partager les billets, non plus entre les élèves des écoles de la ville, mais entre leurs maîtres : encore eut-on soin d’exclure les professeurs femmes, qu’un tel spectacle pouvait choquer.
On en rit encore à Saint-Pétersbourg et ailleurs.
[L’information fut rapidement démentie par un communiqué de la comédienne adressé au Gil Blas, qui avait reproduit l’article dans son édition du 3 janvier.]
Le Matin, 6 janvier 1893
Démenti de Sarah Bernhardt.
Lien : Retronews
Nous recevons la dépêche suivante :
À monsieur le directeur du Matin, Vienne, 5 janvier. — Monsieur. — J’adresse au Gil Blas une dépêche rectificative à propos d’un très vilain écho paru dans Son numéro du 3 janvier. Je vous saurai gré d’insérer cette dépêche que je vous expédie en même temps. — Veuillez agréer mes remerciements. Sarah Bernhardt.
[Le Gil Blas avait reproduit l’article du Monde artiste du 1er janvier sur une représentation de Sarah Bernhardt à Saint-Pétersbourg.]
Démenti au Gil Blas.
Monsieur le directeur du Gil Blas. — Dans votre numéro du 3 janvier, il vous plaît de prendre un écho au Monde artiste. Je donne le démenti le plus formel à celui qui a écrit cet écho.
J’ai offert aux écoles de Saint-Pétersbourg, pour la fête de l’impératrice [Marie Fedorovna, épouse du tsar Alexandre III], une représentation de Jeanne d’Arc et non de la Dame aux camélias. Cette représentation, donnée devant deux-mille écoliers et écolières, a été l’occasion d’un triomphal succès pour Jules Barbier.
Après la chute du rideau, notre compagnie a dû reparaître trente-sept fois devant un public affolé, enthousiaste et reconnaissant. Je suis restée cinq minutes sans pouvoir parler. Après le vers fameux : La France renaîtra dans le dernier Français
, le cri de : Vive la France !
a été répété mille fois par mille bouches, et notre petite compagnie a vécu quelques minutes de fière et poignante émotion.
Enfin, le conseil municipal de Saint-Pétersbourg m’a honorée d’un vote de remerciement public et m’a expédié à Moscou une lettre officielle très flatteuse et très reconnaissante.
Voilà la vérité, monsieur. Elle ne ressemble en rien, vous le voyez, à l’histoire perfide et mensongère du Monde artiste.
Quand à notre succès, il a été si grand, au point de vue artistique et pécuniaire, que je n’ose m’en attribuer le mérite, et je crois que la sympathie momentanée du peuple russe pour tout ce qui est français est pour beaucoup dans notre triomphant séjour en Russie.
J’ai voulu rectifier une fois pour toutes et en bloc les insertions stupides du Monde artiste. Comme les grands journaux puisent parfois à cette source douteuse, je tiens à ce que le public sache bien que ce petit, tout petit journal a menti, ment et mentira, alors qu’il s’agit d’un artiste ou d’une célébrité réfractaire à l’abonnement.
Veuillez, monsieur, inscrire cette lettre rectificative et croire à mes meilleurs sentiments.
Sarah Bernhardt.
Le Temps, 6 janvier 1893
Vienne.
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt a ouvert, le 2 janvier, devant un public fort élégant, la série des représentations qu’elle donnera au Theater an der Wien, à Vienne. L’artiste française a obtenu le plus grand succès dans Fédora.
[Édition du 17 janvier :]
Rome. — Sarah Bernhardt viendra, cette année aussi, faire une tournée artistique en Italie ; elle sera à Rome vers la fin du mois. Elle donnera une huitaine de représentations au théâtre National. Les principales nouveautés que la célèbre artiste nous fera entendre seront : la Comtesse de Challant, de M. Giacosa, et Cléopâtre, de Sardou, pièces nouvelles pour Rome.
Le Temps, 30 janvier 1893
Extrait de la Chronique théâtrale de Francisque Sarcey, sur la première de la Fille à Blanchard à l’Odéon avec Mlle Segond-Weber ; critique de cette pièce facile et factice
, taillée sur mesure pour servir Sarah Bernhardt.
Lien : Retronews
La Fille à Blanchard n’a guère réussi. Vous connaissez la genèse de cette pièce. Mme Sarah Bernhardt a besoin, pour ses tournées à travers tous les mondes, de drames faciles à emporter, qui n’exigent ni décors somptueux et compliqués, ni figuration nombreuse, ni même des acteurs de premier ordre lui donnant la réplique. Ce qu’il lui faut avant tout, c’est une pièce où tous les effets qu’elle est habituée de produire soient distribués avec art ; le moins de dialogue possible ; à quoi bon le dialogue, puis que la représentation se doit donner le plus souvent devant des publics qui ne comprennent pas le français. Une action très simple, tenant de la pantomime, avec des scènes ménagées pour les attitudes, les mouvements et les cris de la grande actrice : scène de terreur, scène de pitié, scène de tendresse, scène de désespoir, scène de folie. Point d’explications oiseuses ; à quoi serviraient-elles ? on est venu pour se repaître du visage et pour entendre la voix d’or de Mme Sarah Bernhardt. Le reste ne compte pas.
C’est sur ce patron qu’a été composée la Fille à Blanchard. Rien de plus simple que ce mélodrame rustique.
Pauline Blanchard est fiancée au beau François, fils de M. Marchal. Les deux jeunes gens s’adorent ; ils vont se marier, quand on apprend que Blanchard, le père Blanchard, qui était maire du pays, vient d’être destitué et que l’on a nommé à sa place Marchal, le père de François. Là-dessus, Blanchard s’emporte et déclare que jamais sa fille n’épousera le fils de l’homme qui lui a joué ce tour. Marchal est un paysan fort têtu. Mais sa fille est aussi têtue que lui. On veut lui imposer Simon comme mari ; elle refuse Simon ; on la tuera plutôt : scène de colère et de dignité.
Au second acte, nous sommes à la mairie : le père Blanchard y traîne sa fille, qui a juré qu’elle répondrait non. Mais au moment où le maire lui pose la question sacramentelle, son père lui serre le bras de si terrible façon qu’un oui navré tombe de ses lèvres, et elle s’évanouit : scène de faiblesse.
Au troisième acte, nous sommes chez une pauvre paysanne, la tante de Pauline, dont il a été vaguement question dans les deux premiers actes. Elle fait chauffer la soupe, tandis qu’au dehors se déchaîne un orage épouvantable. Tout à coup la porte s’ouvre et, à la lueur des éclairs, on aperçoit Pauline, qui entre effarée, ruisselante d’eau, la robe (sa robe de mariée) collée au corps par la pluie. Elle s’est sauvée de la maison pendant le repas de noces ; elle vient demander asile à sa tante : scène de douleur et de désespoir.
Au quatrième acte, Pauline est couchée sur son lit, dans un grenier où l’a reléguée sa tante. Elle a la fièvre, elle pleure, elle se tortille en diverses façons pour marquer son chagrin. Sa tante lui insinue qu’elle ferait bien mieux de revenir chez son père, où son mari l’attend. Non ; elle ne trahira pas François ; elle compte sur François. Mais pourquoi François ne vient-il pas ? Oh ! qu’il est long à venir. Elle se tord les bras. Ah ! le voilà ! Scène d’amour éperdue.
Mais François n’est plus si décidé ; il a réfléchi. S’en aller, comme cela, avec Pauline, loin, bien loin et pour toute la vie, cette perspective l’effraye. Il conseille à Pauline de réintégrer le domicile conjugal. Crise de larmes, suivie d’une scène de folie. Pauline jette des phrases incohérentes en faisant des gestes tumultueux.
Au cinquième acte, elle est revenue chez le père Blanchard, où demeure son mari qui l’y attendait. Elle n’est plus folle, et cependant elle n’a pas toute sa raison. Elle s’acquitte des soins du ménage, elle veille à la ferme ; mais au premier mot qui lui rappelle son amour d’autrefois, la voilà partie. Elle n’est pour le moment que triste, avec un parler inconscient et enfantin : scène de mélancolie.
Son mari, qui ne l’est encore que de nom, ménage cette sensibilité exquise : jamais il ne lui parle qu’avec une extrême douceur. Un jour pourtant, il finit par s’emporter. Il aime Pauline et il trouve exorbitant que toutes les nuits elle pousse en dedans le verrou de sa chambre. Il s’oublie à lui presser la taille de ses deux mains ; sur quoi, la voilà qui se détraque ; nouvelle scène de folie, mais furieuse cette fois ; elle saisit une serpe et en coupe le cou de l’insolent.
Il vous est facile de voir à ce récit que la pièce avait été faite exprès pour Mme Sarah Bernhardt et sur mesure. C’est le châtiment des grands artistes, qui renoncent à l’art vrai pour l’argent, à la gloire pour la popularité. Mme Sarah Bernhardt est tombée d’abord de Racine à Sardou ; mais encore y avait-il dans les drames que Sardou a écrits pour elle, avec l’arrière-pensée d’exhiber les diverses faces de son talent, un grand sens du théâtre ; c’étaient encore des fresques superbes. De la fresque, Mme Sarah Bernhardt est, par un progrès inévitable, descendue à la grossière enluminure. Il n’y a plus, dans la Fille à Blanchard, ni étude de caractère, ni analyse de passion, ni même déploiement de mise en scène. Il ne reste que de la gesticulation à l’usage d’une artiste incomparable.
On m’assure que la Fille à Blanchard jouée à Londres par la créatrice du rôle y obtint un succès immense. C’est là que les directeurs de l’Odéon virent la pièce ; ils furent séduits par le jeu de Mme Sarah Bernhardt ; ils avaient sous la main Mlle Segond-Weber qui pétillait de montrer qu’elle était capable, elle aussi, de réussir dans un rôle où avait triomphé la grande tragédienne.
La pièce n’était pas bonne ; elle s’en rendait bien compte. Mais c’est une erreur commune aux artistes de croire qu’il y a des rôles excellents dans les pièces détestables. Elles se sentent chatouillées dans les fibres de leur vanité la plus intime quand elles peuvent, le drame ne comptant plus, tirer à soi toute la gloire du succès. Leur idée de derrière la tête, c’est que le public est ravi de les voir, elles, toutes seules, évoluant sur la scène et disant n’importe quoi, que cette contemplation lui suffit et vaut les dix francs qu’elle lui coûte.
Mme Segond-Weber fut donc enchantée, lors qu’on lui proposa de jouer Pauline Blanchard. Il y avait dans ce rôle toute la gamme des sentiments humains ; toute la lyre, comme dit la Sapho de Daudet. L’échec, qui n’est malheureusement pas discutable, a dû lui être fort cruel. Elle a toujours ce profil charmant, d’une correction et d’une élégance athénienne qui nous a toujours ravis, cet œil lumineux, ces beaux bras et cette démarche aisée, dont la séduction est irrésistible ; la voix, dans les notes graves, est toujours d’une puissance merveilleuse. Mais, quoi ! elle manque de sensibilité vraie et profonde. Vous pouvez la presser et la tordre, vous n’en exprimerez pas une goutte de tendresse ; tout chez elle est voulu et factice.
Elle a eu de beaux moments, de très beaux moments, mais qui tiennent de l’art du clown plus que de celui du comédien. Ainsi il y a au quatrième acte un escalier, qui monte de la salle d’en bas à la chambre à coucher. Dans un mouvement de passion, elle le descend d’une allure si précipitée, si vertigineuse, qu’un cri d’effroi s’échappe des poitrines. Quand elle vient d’égorger François, elle en remonte quelques marches, d’un pas chancelant, tombe en arrière, et descend la montée sur la tête. Nous en avons tous eu la chair de poule.
Je ne voudrais pas condamner absolument ces effets. Mme Dorval en a donné, dans Chatterton, un exemple demeuré célèbre, lorsqu’elle s’est laissé glisser sur une rampe, au risque de se casser vingt fois le cou. Mais les frères Griffith, qui n’ont pas la prétention d’être d’admirables comédiens, en font autant aux Folies-Bergère. Ils font même beaucoup mieux. Car l’un d’eux se promène sur le balcon du théâtre, et, durant tout le parcours, il fait vingt fois semblant de tomber et se rattrape toujours avec une incroyable adresse. Je ne demande pas mieux qu’on applaudisse, sur un vrai théâtre, à ce tours de force et d’agilité ; mais je désire qu’on les estime juste ce qu’ils valent, et ils valent, en vérité, fort peu de chose. […]
Le Temps, 18 février 1893
Sarah Bernhardt à Nice.
Lien : Retronews
On nous télégraphie de Nice que Mme Sarah Bernhardt a commencé, hier, par la Dame aux camélias, une série de huit représentations. Mme Patti assistait à la première soirée. La Traviata, nous dit notre correspondant, applaudissait Marguerite Gautier.
[Édition du 9 mars :]
Les journaux de Lyon racontent que Mme Sarah Bernhardt s’est rendue au bal organisé par les étudiants de cette ville.
La grande artiste, ayant dû abréger sa visite, a voulu laisser aux pauvres une trace de son passage.
Elle a adressé, comme prix de sa loge, un billet de mille francs au président de la commission du bal.
[Édition du 22 mars :]
Mme Sarah Bernhardt est de retour à Paris ; elle repart dans dix jours pour une nouvelle tournée dans l’Amérique du Sud ; mais, avant son départ, elle paraîtra dans une représentation unique donnée au bénéfice de la Pouponnière, où elle jouera, avec toute sa troupe, la tragédie de Phèdre. Cette belle représentation aura lieu, dans la soirée du mardi 28 mars prochain, au théâtre du Vaudeville.
[Édition du 23 mars :]
Bucarest. — Mme Sarah Bernhardt annonce son arrivée pour la semaine de Pâques. Sa première représentation aura lieu le 1er avril.
[Édition du 30 mars :]
La représentation de Phèdre qui a été donnée, hier soir, au Vaudeville, au bénéfice de la société maternelle la Pouponnière, n’a été qu’une longue ovation pour Mme Sarah Bernhardt, si belle et si dramatique dans le rôle de la femme de Thésée.
[Édition du 4 avril :]
Mme Sarah Bernhardt a lu, hier soir, chez la princesse de Léon, plusieurs poésies extraites de deux poèmes du comte Robert de Montesquiou-Fézensac : les Chauves-Souris et le Chef des odeurs suaves. Notre collaborateur M. Anatole France a fait connaître, il y a quelque temps, à nos lecteurs, ces poèmes ; il a dit leur valeur et leur saveur. Auteur et interprète ont été, hier soir, longuement acclamés par un auditoire restreint et d’élite.
[Édition du 5 avril :]
Mme Sarah Bernhardt a quitté Paris hier soir, se rendant en Orient. Elle ira d’abord en Hongrie, à Budapest, en Roumanie, à Bucarest, et de là à Constantinople, puis en Grèce.
Ensuite, elle part pour l’Amérique du Sud.
À son retour, au mois de septembre 1893, elle rentrera au Vaudeville ; elle se fera entendre, pour la première fois, soit dans Andromaque, où elle a l’intention de jouer non le rôle d’Andromaque, mais celui d’Hermione, soit dans une pièce nouvelle.
Ensuite, elle interprétera une pièce à costumes, mais sans grande mise en scène, de M. Victorien Sardou. L’auteur académicien lui a lu, hier, deux scénarios.
[Édition du 30 avril :]
Mme Sarah Bernhardt est attendue prochainement à Athènes. Elle donnera une série de représentations et débutera, le 21 avril (v. s.), par la Dame aux camélias. Elle jouera ensuite la Tosca, Froufrou et Adrienne Lecouvreur.
[Édition du 13 mai :]
Mme Sarah Bernhardt doit débarquer aujourd’hui à Marseille, de retour d’Athènes. L’impresario Maurice Grau a quitté, hier soir, Paris pour aller à sa rencontre.
[Édition du 18 mai :]
Montpellier, 17 mai. — Mme Sarah Bernhardt a joué, hier, Phèdre devant une salle comble. On avait des appréhensions parce, que, il y a cinq ans, elle fut sifflée dans Pierrot assassin. Le public protestait ainsi contre l’exagération du prix des places. Hier, elle a obtenu un succès énorme et s’est vue rappelée à diverses reprises.
[Édition du 23 mai :]
Notre correspondant d’Athènes nous a envoyé, il y a quelques jours, des renseignements rétrospectifs sur le séjour de Mme Sarah Bernhardt à Athènes qui sont assez curieux :
Elle a paru comme un météore sur le ciel d’Athènes où elle a jeté le plus vif éclat. Pendant quelques jours on n’a parlé que d’elle, de sa voix d’or, de son génie, de ses caprices, de ses bijoux, de ses costumes, de ses visites au tombeau d’Aristide Damala, aux monuments, à Eleusis. Elle a relégué au second plan la politique, l’emprunt, M. Tricoupis et tous les embarras financiers.
Tous ont voulu la voir, l’entendre, l’applaudir, au moins une fois. Les prix des stalles, des fauteuils d’orchestre, une simple chaise au paradis ont atteint des proportions fabuleuses. Il est des gens qui se croient vos obligés pour toute leur vie, parce que vous avez pu leur procurer un billet d’entrée ou une place dans votre loge. On applaudissait à tout rompre, comme lorsque Flaminius annonçait aux Grecs réunis aux jeux olympiques, que Rome assurait la liberté de la Grèce. Son séjour à Athènes a été une longue ovation. Jamais souveraine n’a été plus fêtée, plus applaudie, plus gâtée. Le souvenir d’Aristide Damala n’a pas été, sans doute, étranger à cette manifestation d’enthousiasme, mais c’est surtout l’artiste que l’on applaudissait. Cela tenait, tout simplement, au délire.
Les hommes les plus graves n’ayant pu trouver place au parterre étaient allés l’applaudir du paradis et j’ai entendu des professeurs de l’Université féliciter la France d’avoir donné le jour à cette incomparable artiste. Et pas une note discordante, bien que les Athéniens soient un peu sceptiques et gouailleurs et qu’ils aient l’enthousiasme difficile.
Le jour de son départ, malgré une pluie battante, on lui a fait encore une ovation, moins grandiose que celle de la veille, à une heure du matin, lorsqu’au sortir du théâtre, plusieurs milliers de personnes allèrent l’acclamer sous le balcon de l’hôtel de la Grande-Bretagne. On lui demandait même — et c’est bien athénien — de faire un discours. Elle s’est bornée à remercier avec la grâce qu’elle sait déployer à l’occasion, mais n’a parlé ni de Phidias, ni de Sapho, ni d’Euripide, ni d’Eschyle.
Les feuilles d’Athènes ont été à la hauteur du public. Pendant cinq jours Sarah Bernhardt y a tenu beaucoup plus de place que les questions poignantes du jour.
[Édition du 26 mai :]
Le théâtre de la Renaissance a trouvé acquéreur : c’est Mme Sarah Bernhardt qui s’y installera, l’hiver prochain, sous la direction de M. Maurice Grau.
Le bail est fait pour une longue durée. L’intention de M. Maurice Grau est de faciliter à Mme Sarah Bernhardt l’accomplissement d’un projet qu’elle chérissait depuis longtemps : c’est d’avoir son théâtre à elle
, à Paris, à l’exemple d’Irving, le grand tragédien anglais.
Il est trop tôt de parler des projets de Mme Sarah Bernhardt et de ceux de son très habile imprésario ; mais nous pouvons affirmer que l’artiste jouera des chefs-d’œuvre classiques et qu’elle fera appel à tous les grands poètes, à tous les grands auteurs pour donner un corps à son rêve artistique.
[Édition du 28 mai :]
Bordeaux, 27 mai. — La troupe de la tournée Sarah Bernhardt, qui vient de donner hier et avant-hier deux représentations ici avant son départ pour l’Amérique, est partie ce matin, à onze heures, pour Pauillac, où elle va prendre passage à bord du paquebot Potosi, de la Pacific steam navigation company.
Mme Sarah Bernhardt, qui a retenu son passage sur le même paquebot, est partie ce matin pour Paris, où elle ne séjournera que peu d’heures. Elle tenait à faire ses adieux à quelques personnes. Elle rattrapera le paquebot à son escale de Lisbonne.
[Édition du 30 mai :]
Nous avons annoncé que Mme Sarah Bernhardt allait, au mois de septembre, à son retour d’Amérique, prendre la direction du théâtre de la Renaissance.
Comme nous causions, hier, de ce projet avec son camarade et ami M. Coquelin et que nous lui demandions s’il ne trouvait pas un peu exigu le théâtre choisi par Mme Sarah Bernhardt, il nous a répondu : Un théâtre, voyez-vous, n’est jamais trop petit, surtout pour y jouer la comédie et le drame intime.
Ajoutons que le prix des places de la Renaissance ne sera pas augmenté et restera le même que celui qui est actuellement en vigueur. La majoration de la location n’existera plus ; peut-être même payera-t-on moins cher à la location qu’au bureau. La claque sera sans doute supprimée, ainsi que le trou du souffleur. Le souffleur se tiendra dans les coulisses.
Le théâtre ouvrira, fin septembre, avec la pièce que M. Jules Lemaître a tirée du roman qu’il a publié dans le Temps et qui a pour titre les Rois.
Le Ménestrel, 15 octobre 1893
Extrait des Nouvelles diverses : festival russe à Paris.
Lien : Gallica
Voici le programme du festival russe qui a lieu aujourd’hui dimanche, sous la direction de M. Colonne, pour la réouverture des concerts du Châtelet :
Première partie. — Symphonie en si mineur, allegro, andante et finale (Borodine) ; Cavatine pour violon (César Cui), exécutée par M. Marsick ; le Rêve du prisonnier (Rubinstein) et la sérénade de Don Juan (Tchaïkovski), chantés par M. Saléza ; deux airs de ballet de Feramors (Rubinstein) ; Prélude (Rachmaninov) et Basso ostinato (Arenski).
La Fraternelle, chant en l’honneur de la nation russe, couronné au concours de l’Écho de Paris, poème de M. Marc Libérat, musique de M. Gabriel Pierné — Mlle Delna et les chœurs du concert Colonne et des Enfants de Paris.
Deuxième partie. — Antar, poème symphonique (Rimski-Korsakov) ; l’Hiver (César Cui) et Aubade (Kolatscheffski), chantés par Mme Marthe Duvivier ; l’Extase (Rubinstein) et Ah ! qui brûla d’amour (Tchaïkovski), chantés par Mlle Bréval ; la Vie pour le Tsar, air de Soussarine (Glinka), chanté par M. Soulacroix.
Jeanne d’Arc, drame en vers de M. Jules Barbier (scène de la prison), jouée par Mme Sarah Bernhardt, MM. Darmont et Angelo.
L’Écho de Paris, 18 octobre 1893
Article sur le Festival Russe de l’Écho de Paris.
Nos lecteurs verront par les citations que nous faisons ci-dessous que la presse a été unanime à constater l’immense succès obtenu par le Festival russe de l’Écho de Paris. Nous remercions bien chaleureusement tous nos confrères de la sympathie qu’ils nous ont témoignée et des éloges si mérités qu’ils ont faits des artistes éminents quinoas ont prêté leurs concours.
Le Figaro.
De M. Charles Parcours :
Cette fête musicale, qui ouvrait la saison des concerts, a été de tout point réussie. La salle était comble : le nombre des invitations adressées à l’élite de la société parisienne, à la presse, aux abonnés des concerts Colonne, s’élevait à près de deux mille.
Au premier étage, trois loges de face avaient été réunies sous une sorte d’auvent de fleurs et de draperies : elles étaient occupées par M. de Mohrenheim et tout le personnel de l’ambassade russe.
Le concert a commencé par l’exécution de trois morceaux de la Symphonie en si mineur, d’Alexandre Borodine : allegro, andante, finale. Cette symphonie, connue à Paris, est une œuvre des plus originales et d’une extrême richesse d’invention ; l’andante, délicieuse rêverie dont le rythme est formé alternativement d’une mesure à cinq temps et d’une mesure à quatre temps, a produit une profonde impression.
M. [Albert] Saléza a chanté ensuite le Rêve du prisonnier, de M. Rubinstein, et la
Sérénadede Don Juan, de M. Tchaïkovski. Le jeune chanteur, dont la voix est puissante et si sympathique, a dit ces pièces avec une chaleur qui a enlevé le public et lui a valu plusieurs rappels.Dans l’œuvre immense de M. Rubinstein, on avait choisi en outre un fragment du ballet de Feramors, qui a été exécuté par l’orchestre avec une délicatesse exquise.
[…] La première partie du concert se terminait par l’exécution de la Fraternelle, chant en l’honneur de là nation russe, couronné au récent concours ouvert par l’Écho de Paris, dont la poésie de haute allure est de M. Marc Libéral et la musique de M. Gabriel Pierné.
C’est une composition large, sonore, d’un bel élan, où s’entremêlent des fragments de l’hymne national russe et de la Marseillaise. Mlle Delna en a chanté les soli avec toute l’ampleur de sa magnifique voix ; les chœurs des concerts Colonne et des
Enfants de Parislui ont donné un formidable éclat. Le public a fait une ovation au compositeur, à la chanteuse, aux chœurs et à l’orchestre.[…] Un bel air de la Vie pour le tsar, de Glinka, a permis à M. Soulacroix de déployer de nouveau toutes les sonorités de son incomparable organe ; puis, le concert étant terminé, l’orchestre a attaqué l’hymne national russe.
Tout le monde s’est aussitôt levé et le chant a été écouté debout. L’exécution de la Marseillaise l’a suivi, et les manifestations de l’enthousiasme du public ont redoublé.
Les exécutants se sont retirés, et, en un instant, la scène a été débarrassée des pupitres et des chaises.
Alors est apparue Mme Sarah Bernhardt, dans le costume de Jeanne d’Arc, et elle a dit avec une admirable maestria la scène de la prison, du drame de M. Jules Barbier. Les vers patriotiques du poète et la déclamation enflammée de la grande artiste ont entraîné le public dans un élan irrésistible, et la séance s’est terminée par un triomphe.
Le Gaulois.
[…] Enfin le festival sa terminait par une scène du beau drame de M. Jules Barbier, celle de la prison de Jeanne d’Arc, jouée par Mme Sarah Bernhardt. La grande tragédienne a été admirable sous les traits de l’héroïne de Vaucouleurs.
Le choix de ce morceau était d’autant plus heureux qu’il contenait de nombreuses allusions que le public n’a pas laissé échapper. Quand Mme Sarah Bernhardt, d’une voix vibrante, le visage transfiguré, a dit ce vers :
La France renaîtra dans le dernier Français,
tous les spectateurs se sont tournés vers la loge de l’ambassadeur. À ce moment, toutes les mains battaient à l’unisson des cœurs.
Le Journal des Débats.
[…] Mais, malgré tout l’intérêt que pouvaient offrir les œuvres des plus célèbres compositeurs russes, on n’en attendait pas moins impatiemment le dernier numéro du programme, la
scène, la prison de la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier, que devait réciter l’éminente tragédienne Mme Sarah Bernhardt, revenue enfin dans son cher Paris. Tout Paris aussi lui a fait une ovation frénétique, hier, lorsqu’elle a dit avec un lyrisme véritablement enflammé les dernières tirades de sa scène.Le public était, du reste, électrisé dès l’ouverture du concert. L’hymne russe et la Marseillaise, joués à la fin de la matinée, ont été écoutés religieusement par tous les auditeurs debout. C’était un imposant spectacle qui a ému plus d’un assistant.
Le Soleil.
Pour rehausser l’éclat de cette cérémonie, Mme Sarah Bernhardt a dit la grande scène de la prison de Jeanne d’Arc ; de Jules Barbier. Elle l’a dite avec cette fougue, cette chaleur, cet art qui est tout en elle et dont on est toujours heureux de recueillir les manifestations.
Le Radical.
Pour terminer, Mme Sarah Bernhardt s’est montrée une fois de plus incomparable tragédienne en interprétant la scène de la prison de Jeanne d’Arc.
La République française.
Cette journée très artistique s’achève par la rentrée de Mme Sarah Bernhardt qui nous a joué, avec le grand art tragique qu’elle seule possède, l’acte de la prison de la Jeanne d’Arc de Jules Barbier.
Le Temps.
Alors est apparue Mme Sarah Bernhardt, dans le costume de Jeanne d’Arc ; elle a dit la scène de la prison du drame de M. Jules Barbier. Les vers patriotiques du poète et la déclamation enflammée de la grande artiste ont entraîné le public dans un élan irrésistible, et la séance s’est terminée par un triomphe.
La Liberté.
À la suite du concert, Mme Sarah Bernhardt est venue jouer en costume la scène de la prison de Jeanne d’Arc, de M. Jules Barbier. La grande artiste a fait vibrer tous les cœurs, lorsque, dans un élan patriotique, Jeanne entrevoit dans l’avenir le relèvement de la France et son triomphe sur ses ennemis.
Paris.
Je laisse à penser quel accueil enthousiaste a été fait à Mme Sarah Bernhardt dans la scène de la prison, de Jeanne d’Arc. On ne pouvait clore plus dignement ce magnifique programme qu’en nous faisant entendre cette voix d’or qui est aussi une musique, et qui nous a ravis comme elle nous ravira encore.
La France.
Mme Sarah Bernhardt, dans la scène de la prison de Jeanne d’Arc, a obtenu un véritable triomphe ; enfin la Marseillaise et l’Hymne russe, exécutés par l’orchestre Colonne, ont mis le comble à l’enthousiasme du public qui a acclamé à différentes reprises l’ambassadeur de Russie et sa famille, présents à cette solennité.
Le National.
Après l’hymne russe, respectueusement écouté debout par toute la salle et suivi de la Marseillaise, le rideau s’est relevé sur l’acte de la prison de la Jeanne d’Arc de M. Jules Barbier, qui était resté dans notre souvenir comme un des plus sublimes élans de l’inspiration dramatique de Mme Sarah Bernhardt. Hier, sans le secours de la mise en scène, — pas une toile de fond ! — l’admirable artiste nous a tous patriotiquement et profondément émus.
Le Courrier du Soir.
Le ténor Saléza a été applaudi dans le Rêve du prisonnier, une mélodie déjà ancienne. Soulacroix a fait vibrer sa belle voix dans un air de la Vie pour le tsar, et Mmes Bréval et Duvivier ont chanté avec vigueur et sonorité divers morceaux, notamment l’aubade de Kolatscheffski, et Pourquoi… de Tchaïkovski. Enfin Mme Sarah Bernhardt rehaussait par son concours l’éclat de cette fêle lyrique. Elle a été couverte de fleurs après la scène de la condamnation de Jeanne d’Arc.
L’ambassadeur de Russie, M. de Mohrenheim, et nombre de notoriétés politiques étaient présents et la salle était une des plus belles qu’on ait vues avec quantité de jolies femmes.
Le Figaro, 5 novembre 1893
Interview de Sarah Bernhardt au lendemain de la tournée, par d’Alberty (pseudonyme de Clément Bertie-Marriott).
Lien : Retronews
Sarah Bernhardt
La veille d’une première
Depuis cinq minutes, j’attendais dans grand atelier du rez-de-chaussée : fantasque fouillis de tapis d’Orient, de peaux de bêtes, de bronzes bizarres, d’idoles mexicaines, de toiles sur chevalet, de guirlandes de fleurs enrubannées, de vases égyptiens, de plantes envahissantes, éclairé d’une lueur d’incendie par les grandes flammes qui s’envolaient de l’âtre. Un singe, dans une large volière, tournoyait sur un perchoir mobile en s’arrêtant de temps à autre pour me regarder d’un air triste et narquois. Soudain, l’écho d’une voix chaude et vibrante arriva jusqu’à moi.
— Bonjour, Cléopâtre ! Qu’as-tu fait de Marc-Antoine ? Ah ! qu’elle est belle, mon adorée !
Puis, deux hommes passèrent dans la pièce à côté, causant bruyamment :
— Vous savez, moi, je n’entre pas là-dedans.
— Mais n’ayez donc pas peur.
Puis ils disparurent derrière les tentures. Un instant après, une soubrette vint me trouver :
— Si monsieur veut monter ?
Me voici au premier étage dans un bureau confortable, mais d’un aspect sévère qui contraste avec la salle prestigieuse que je viens de quitter. L’élégante silhouette d’une femme drapée de vert foncé et surmontée d’une chevelure chère au Titien, étrangement ébouriffée, me tendit la main.
— Tout ce que vous voudrez, me dit-elle, mais avant il faut que je vous fasse faire la connaissance de mes amis. Venez voir.
En m’approchant de la fenêtre ouverte, je vis au fond de la cour une cage à gros barreaux de fer derrière lesquels était assis un superbe jaguar à peau mouchetée dont les yeux brillaient comme des escarboucles.
— Cléopâtre, ma chérie, tu voudrais bien sortir, n’est-ce pas ? Tout à l’heure, oui, mon trésor !
Et le jaguar écoutait cela en dressant ses oreilles pointues et en se frottant les mâchoires contre les grilles de sa prison pendant que dans l’autre coin le mâle, Marc-Antoine, s’étirait dans un coin.
— C’est une plaisanterie, vous ne laissez pas sortir ces animaux-là ?
— Si, si, le soir, quand nous sommes en famille. Alors ils se roulent sur les tapis et nous jouons avec eux comme avec de jeunes chats. Voyez-vous, plus je vais, plus j’aime les bêtes. C’est si bon quand on ne leur fait pas de mal — tout le contraire des hommes. Si je m’écoutais, j’irais demander au directeur du Jardin d’Acclimatation de me louer un chalet au milieu de tous ses animaux. Mais si j’étais là-dedans je n’en sortirais plus et aujourd’hui le théâtre, mon théâtre, me réclame plus que jamais. À propos, ce doit être à ce sujet que vous désirez me voir ?
— Pas précisément, c’est de vous que je voudrais entretenir les lecteurs du Figaro.
— Asseyez-vous donc, là, au coin du feu, je ne demande pas mieux que de causer. Cependant je dois vous prévenir que je ne fais rien d’extraordinaire, je travaille toujours et sans relâche.
Mes voyages m’ont fait le plus grand bien. Je me porte trois fois mieux qu’avant. J’ai remarqué du reste qu’il en est de même pour tous les gens qui voyagent dans de bonnes conditions. Ensuite les voyages m’ont rendue meilleure. Il fait bon voir le monde comme il est. C’est magnifique, plus jamais on ne m’entendra en dire du mal. Je suis fière de faire partie d’un ensemble aussi merveilleux.
Enfin j’ai des idées plus nettes et plus larges sur une foule de choses, et particulièrement sur tout ce qui se rattache à mon art.
— Que pensez-vous du théâtre à l’étranger ?
— En Amérique et en Angleterre il y a d’excellents comédiens, mais il me semble que la moyenne de talent — qu’il s’agisse des auteurs ou des artistes, — est plus élevée en France qu’au dehors. Malheureusement notre supériorité sous ce rapport est bien amoindrie par de mauvaises habitudes et une mise en scène négligée.
En Angleterre et en Amérique la mise en scène est mille fois mieux comprise qu’à Paris. Remarquez bien que ce n’est pas une question de décors compliqués ou coûteux, mais bien le souci constant d’une multitude de petits détails qui donnent de la vie et l’illusion de la réalité, de telle sorte que ce qui se passe sur les planches devient véritablement conforme à ce que l’on voit sur terre.
Irving n’est pas seulement un grand artiste mais encore un metteur en scène de premier ordre. Dans son théâtre, il y a des effets de lumière appropriés à l’heure de la journée où se passe l’action, des feuilles d’arbres qui frissonnent avant l’orage, des routes où les voitures sont cahotées, le sifflet d’une locomotive lointaine, des crieurs de journaux, des gamins qui n’ont rien à voir dans la pièce, traversent la scène et s’arrêtent pour regarder, que sais-je encore ? mille petits riens qui plaisent et complètent le tableau. Tous les sens du spectateur sont éveillés par ces détails ; il ressent l’impression d’un drame vécu. Ne voyons-nous pas tous les jours dans la vie réelle des scènes comiques ou tragiques où l’action est interrompue par l’entrée d’un valet, d’une bonne ou d’un passant indifférent ?
— À propos de mise, en scène, que pensez-vous du Théâtre-Libre?
— Je n’en pense rien. Je vous avoue que je n’y ai jamais mis les pieds. Mais […] contre la routine dans laquelle le théâtre s’enlise chez nous me paraît louable et mérite d’être encouragé : il en restera toujours quelque chose de bon.
— Tout de même, vous devez être bien contente d’être rentrée à Paris.
— Oh oui, certes, et je compte bien ne pas en bouger d’ici quatre ans. J’ai d’excellents amis en Amérique, je leur rends bien la sympathie qu’ils me témoignent. La conscience de faire partie de leur vie artistique est pour moi une délicieuse sensation, et puis quatorze ans de vagabondage m’ont rendu cosmopolite. Maintenant, je me plais partout, quoique nulle-part mieux qu’à Paris. Ici, deux choses me séduisent : la première est de me retrouver en France — et je crois avoir ce sentiment-là en commun avec tous les Français qui reviennent de l’étranger ; — la seconde est le charme incomparable qui se dégage de Paris. Les rues ont toujours un air de fête, les boutiques une tenue d’Exposition internationale, les passants de toutes les classes ont une distinction aimable, ils sont, gais sans être bruyants, coquets sans prétention. La ville est faite à l’image de sa population. Elle est alerte et accorte comme pas une autre. On s’y amuse en regardant les autres s’amuser, l’air est rempli
De ces plaisirs légers qui font aimer la vie.
Depuis que je suis revenue, mon théâtre me fatigue énormément, mais je suis heureuse.
— Ne trouvez-vous pas que les fonctions de directrice sont bien assujettissantes, bien énervantes pour une artiste aussi consciencieuse que vous? Ne préféreriez-vous pas consacrer tout votre temps à vos rôles ?
— Oh ! je vous en prie, ne m’appelez pas directrice, ne parlez pas de mes fonctions. Dieu merci, je n’ai pas de ces ennuis-là, je vous avouerai même que je ne tiens pas à gagner de l’argent dans cette aventure et que je me contenterai d’y toucher mon cachet comme artiste. Grau et Abbey m’ont prise au mot, un jour où je leur déclarais que je voudrais rejouer à Paris, dans un théâtre qui serait bien à moi tout en étant administré par eux.
J’ai la conviction qu’ils ont pris cette nouvelle affaire plutôt pour m’être agréable qu’avec l’idée d’y gagner des millions. Voilà des hommes comme il y en a peu. Avec une incroyable entente des affaires de théâtre ils ont des vues et des idées d’une largesse de grands seigneurs. Pour eux le commerce est un véritable jeu, dans lequel ils font preuve d’un courage et d’une loyauté à toute épreuve. Leur parole vaut si bien leur signature que je voyage avec eux sans l’ombre d’un traité écrit. Et ils n’épargnent aucune dépense pour me rendre la vie aimable.
Il est difficile de donner une idée à des Parisiens du luxe du train spécial que j’ai à ma disposition dans ces voyages. Il n’y a pas d’impératrice, si puissante qu’elle soit, qui voyage comme moi. Figurez-vous un magnifique train, comme il en existe maintenant partout en Amérique, connu sous le nom du Sarah Bernhardt
, composé de chambres à coucher, cabinets de toilette, salons, salle à manger, fumoir, cuisine, caves, le tout meublé comme un palais, éclairé d’un bout à l’autre par l’électricité, aménagé, agencé, achalandé mieux que la plupart des hôtels de premier ordre. Dans le salon il y a un piano, une bibliothèque, des fleurs ; le soir on fait de la musique, on danse, on soupe, sans se préoccuper du train qui file à toute vapeur, sans la moindre secousse.
Tout est prévu, arrangé des mois à l’avance dans chaque ville où nous nous arrêtons. Cela tient du prodige.
Grau est le Napoléon des imprésarios. Il y a des années où il est engagé dans cinq ou six affaires comme la mienne. Peu lui importe de perdre sur deux ou trois de ces affaires pourvu qu’il gagne sur les autres. Il nous est arrivé de jouer dans des villes où, pour une raison ou pour une autre, la recette ne couvrait pas les frais. Grau s’en moquait comme un poisson d’une pomme. S’il en exprimait une contrariété, elle était toujours inspirée par la crainte de l’effet moral que cette salle à moitié remplie avait pu produire aux artistes. Il n’y a que l’Amérique pour produire des hommes de cette trempe-là en affaires.
— Et après vos quatre ans de Paris ?
— Je recommencerai encore une fois. J’irai revoir les endroits par où j’ai déjà passé.
— Il vous serait difficile de trouver une ville où vous n’avez pas été !
— Je n’en suis pas encore là. Par exemple, je n’ai pas encore été aux Indes et j’en meurs d’envie.
— Vous croyez que le répertoire français plairait aux Indiens ?
— Je n’en sais rien, c’est possible, en tous cas, il y a des Anglais là-bas, ceux-ci sont mes bons amis. Mais si je ne jouais pas, je voyagerais pour mon plaisir, une fois n’est pas coutume. Si jamais je fais des économies, ce sera pour m’offrir cette excursion-là.
— Des économies ! Vous devez être plusieurs fois millionnaire depuis que l’étranger vous couvre de dollars, de piastres et de livres sterling.
— Détrompez-vous, je dépense tout ce que je gagne. Que voulez-vous ? je n’ai pas d’autre excuse pour courir le monde. Autrement, je serais obligée d’avouer que ces courses échevelées d’un bout à l’autre de l’univers m’amusent au delà de toute expression.
— Vous pourrez dire que vous avez fait du chemin, de plus d’une façon, depuis vos débuts dans les Deux Pigeons. Il me paraît curieux de vous demander à quoi vous attribuez votre vocation.
— C’est à l’église et à l’église seulement que je dois d’être au théâtre. Toute enfant, mon imagination était frappée par les chants d’église, le recueillement des assistants, la mysticité des cérémonies, le silence solennel avec lequel on écoutait le prédicateur. Ma jeunesse a été grisée par le cadre radieux dans lequel est célébrée la gloire de Dieu. Quand l’orgue faisait entendre sa note éclatante comme une fanfare, il me semblait que mon âme s’envolait dans un tourbillon d’idéal. Dans ces moments-là, je me sentais transfigurée, il me semblait que j’allais monter au ciel — comme cela, tout de suite, devant tout le monde. J’avais une envie folle de me faire religieuse et plus tard j’ai été sur le point d’entrer dans un couvent. Je le désirais ardemment et comme tout ce que je désire ainsi arrive tôt ou tard, je suis encore surprise de n’avoir pas été nonne. […] que j’avais une jolie voix et une façon intelligente de réciter la poésie, je me voyais à la place du curé déclamant dans une cathédrale devant une foule électrisée. De là à jouer la tragédie dans un grand théâtre il n’y avait qu’un pas. Je puis dire que je l’ai franchi sans m’en douter.
Après cet aveu inattendu j’ai tiré l’échelle, non pas celle de Jacob, mais la mienne.
L’Univers, 4 octobre 1894
Article sur le Festival Jeanne d’Arc au jardin d’acclimatation.
Lien : Retronews
Jardin Zoologique d’Acclimatation
Le Jardin d’Acclimatation annonce, pour dimanche prochain, 7 octobre, à 3 heures, la première grande audition musicale de sa saison d’hiver 1894-1895.
Ces concerts, dont la réputation n’est plus à faire, sont placés sous la direction de M. Louis Pister, et comprendront l’exécution des œuvres classiques des grands maîtres anciens et modernes. Les œuvres des jeunes compositeurs y auront également leur place.
Voici le programme de la première audition :
Festival Jeanne d’Arc
Première partie : Jeanne d’Arc, ouverture (Verdi). — Jeanne d’Arc, suite d’orchestre : vision et Dieu le veut ; prière de Jeanne d’Arc (Gounod). — Jeanne d’Arc, air des Adieux
, chanté par Mme Auguez de Montalant (Tchaïkovski). — Jeanne d’Arc, marche du Sacre : orgue, M. Lippacher (Ch. Lenepveu).
Deuxième partie : Jeanne d’Arc, messe : vision, par tous les violons ; orgue, M. Lippacher (Gounod). — Jeanne d’Arc, ballet (marche funèbre d’une marionnette) (Gounod). — Jeanne d’Arc : I, Carillon ; II, Ronde lorraine, chantée par Mme Auguez de Moutalant ; III, Angelus, chanté par Mme Auguez ; IV, Ballade de la guerre, chantée par Mme Auguez ; V, Danse des Morisques (B. Godard). — Jeanne d’Arc (le supplice) marche funèbre (Gounod). — Jeanne d’Arc, apothéose (Widor).
La grande salle des fêtes du Palais d’hiver et le Palmarium seront éclairés à l’électricité.
Le Petit-Temps, 7 décembre 1894
Sarah Bernhardt joue Jeanne d’Arc au Cercle catholique.
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt chez les étudiants catholiques
Les étudiants catholiques donnaient, cet après-midi [jeudi 6 décembre], une matinée au profit de l’œuvre de la Mie-de-Pain
fondée par eux en 1891, avec le concours d’apprentis et de jeunes ouvriers.
Cette œuvre a distribué l’année dernière, pendant quarante jours, 325 soupes par jour, près de 9.000 bons de pain et 1.500 vêtements.
Ses ressources sont tirées de l’assistance individuelle, oboles des étudiants, cotisations des apprentis, collectes entre particuliers.
Afin de pourvoir aux nécessités de l’hiver qui commence, étudiants et apprentis ont organisé cette matinée d’aujourd’hui pour laquelle aucun billet ne restait disponible il y a deux jours et qui a réuni dans les salons du Cercle catholique l’assistance la plus élégante.
Les meilleurs artistes de Paris avaient généreusement prêté leur concours à cette représentation de charité.
C’est Mlle Marie Clément qui exécute une rêverie de Schumann et un scherzo de Chopin. Mlle Verdeuil, de l’Odéon, qui dit les Petits Gueux de Richepin, le Bon Gîte de Déroulède et la Ballade des Épées d’Henri de Bornier. M. Pierre Laugier, de la Comédie Française ; Mmes Deschamps-Jehin, de l’Opéra, qui se fait applaudir dans l’arioso du Prophète et dans le Noël païen de Massenet ; M. Mouliérat, avec la ballade du Roi d’Ys et le lied d’Ossion dans Werther ; Mlles Reichenberg et Truffier qui jouent le Blanc et le Noir ; qui donc encore ? M. Soulacroix, M. Grenet-Dancourt, Mlle Hardel, Mlle Loventz, Mlle Dantin.
Sarah Bernhardt, l’admirable tragédienne, dans le quatrième acte de Jeanne d’ Arc, a été acclamée par des bravos enthousiastes, d’autant plus répétés, que les étudiants tenaient à décliner publiquement toute responsabilité dans les attaques dirigées à cette occasion contre Mme Sarah Bernhardt.
Un journal [La Libre Parole du 5 décembre], en effet, a publié, hier, une prétendue protestation signée : un membre du cercle catholique
contre la présence de Mme Sarah Bernhardt, à laquelle on reprochait d’appartenir à la religion juive. Nous avons cherché l’auteur de cette lettre et nous ne l’avons pas trouvé.
— Faut-il vous assurer, monsieur, nous répondent les jeunes gens que nous interrogeons, faut-il vous assurer que cette lettre est apocryphe et quelle n’émane d’aucun membre du cercle ? Voyez dans la salle : vous trouverez les présidents des principales œuvres catholiques de Paris. C’est la seule réponse que nous voulions opposer à ses attaques violentes qui, d’ailleurs, n’atteignent pas plus l’admirable artiste qu’elles ne touchent le cercle.
On a prétendu que Mme Sarah-Bernhardt est juive. Le fut-elle, nous vous avouons, nous vous déclarons que nous n’aurions vu là aucun empêchement et que nous n’aurions pas hésité une seconde pour cela à solliciter le précieux concours de Mme Sarah-Bernhardt. Nous ne savons pas à quelle religion appartiennent les malheureux auxquels nous sommes fiers de tailler la soupe.
Devons-nous être plus exigeants lorsque Mme Sarah Bernhardt veut bien s’associer si largement à notre œuvre.
D’ailleurs, et à supposer que ce point ait une importance, Mme Sarah Bernhardt est catholique ; je pourrais précisément vous montrer dans l’assistance une dame qui a été élevée avec elle dans un couvent de Versailles et c’est M. l’abbé Joubert qui a préparé à la première communion celle qui devait être l’illustre tragédienne.
Avant que Sarah Bernhardt paraisse en scène, un étudiant donne lecture d’une lettre de M. Terrat, président du cercle, désavouant au nom du comité directeur et au nom de tous les étudiants, la lettre anonyme dont nous avons parlé.
Le quatrième acte de Jeanne d’Arc n’est qu’une longue ovation pour Sarah, qui est rappelée sept ou huit fois, applaudie, acclamée, remerciée.
Elle veut bien nous recevoir en sortant de scène et nous lui faisons part de la conversation, plus haut rapportée, avec un étudiant :
— Eh ! qu’importe, répond fébrilement Sarah, qu’importe que je sois juive ou non ? Je n’ai jamais voulu répondre aux mises en demeure qui m’ont été faites. Mais, enfin, si la chose vous intéresse, non, je ne suis pas juive, j’ai fait ma première communion au couvent de Grandchamp [établissement pour jeunes filles fondé à Versailles par les sœurs Augustines].
À la sortie, on acclame encore et on remercie la tragédienne.
Le Petit-Temps, 11 décembre 1894
Lien : Retronews
Mme Sarah Bernhardt et le Cercle catholique des étudiants
Lorsque nous avons rendu compte de la matinée donnée la semaine dernière au Cercle catholique de la rue du Luxembourg en faveur de l’œuvre de la Mie de pain
, nous avons fait allusion à une lettre insérée la veille par un journal du matin et attaquant avec une égale violence Mme Sarah Bernhardt et le comité directeur du cercle.
Cette lettre était simplement signée : Un membre du Cercle catholique.
D’après les déclarations qui nous furent faites alors par M. Terrat, président du cercle, par M. l’abbé Fonssagrives et parce nombreux étudiants, nous écrivîmes que cette lettre paraissait être apocryphe et qu’en tout cas, si elle émanait d’un membre du cercle, on en avait recherché vainement l’auteur.
Deux jours après, nous recevions la lettre suivante :
À M. le rédacteur en chef du journal le Temps.
Monsieur,
J’ai eu l’agréable surprise, en parcourant votre édition du Petit Temps du jeudi 6 du courant, de constater que votre journal partageait désormais avec le Matin le privilège d’être l’organe officiel du Cercle catholique. J’ai pensé qu’à ce titre vous deviez tenir à honneur d’être bien informé.
Or il s’est glissé dans votre article sur la représentation donnée hier soir au Cercle catholique, une inexactitude que je veux relever. La lettre parue la veille dans la Libre Parole est, dit-on, apocryphe, et n’a jamais été écrite par un étudiant du cercle. Évidemment, votre correspondant était le seul à ignorer mon nom, que je n’ai pourtant jamais songé à cacher, et qui, dès hier matin, était au cercle sur toutes les lèvres. C’est pour lever complètement les doutes de ceux qui auraient pu en conserver, que je vous envoie ces quelques lignes. J’attends de votre courtoisie bien connue l’insertion intégrale de ma lettre.
Veuillez agréer, monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Louis Delsol.
Membre du Cercle catholique.P.-S. — Je tiens à vous avertir que j’envoie communication de la présente lettre à la Libre Parole, pour y être également insérée.
Paris, le 7 décembre 1894.
L’incident vaut-il qu’on s’y attarde ? Nous n’avions pas publié cette communication parce que, n’ayant jamais nommé M. Delsol que nous n’avions pas l’honneur de connaître, nous n’avions aucune réparation à lui accorder ni aucune satisfaction à lui offrir.
Il lui a fallu deux jours et plus de réflexion pour qu’il revendiquât la paternité d’une lettre anonyme et il paraît s’étonner que nous n’ayons pas tout de suite deviné que cette lettre était de lui.
Notre perspicacité ne va pas aussi loin.
Cet incident a eu ses conséquences.
D’abord, M. Delsol s’étant publiquement déclaré avant-hier matin l’auteur de cette lettre anonyme, a été radié de la liste des membres du Cercle catholique, par décision du bureau directeur.
De plus, il a reçu aujourd’hui la visite de MM. Geoffroy et Breittmayer, qui sont venus, au nom de M. Maurice Bernhardt [le fils de Sarah Bernhardt, âgé de 30 ans], lui demander réparation.
[Précision apportée dans le XIXe siècle du lendemain :
Les deux témoins de M. Bernhardt se sont rencontrés avec M. Delsol qui, pour bien indiquer qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser Mme Sarah Bernhardt, a écrit une lettre d’excuse à la grande artiste.
Vert-Vert, 23 décembre 1894
4e acte de Jeanne d’Arc avec Sarah Bernhardt à l’Ambigu.
Lien : Retronews
La matinée donnée à l’Ambigu [vendredi 21 décembre, à 1 h. 1/2], au profit de l’Œuvre du vaccin du croup, a été des plus brillantes.
Mlle Bartet, de la Comédie-Française, dans un à-propos de M. Redelsperger ; Mlle Horwitz, de l’Opéra-Comique ; MM. Coquelin cadet, Raphaël Duflos, ont été longuement applaudis. Mlle Marcilly a dit avec autant de charme que de talent l’invocation, de M. Legendre, et le Jardinier et son Seigneur, de La Fontaine.
Une véritable ovation a été faite à Mme Sarah Bernhardt, qui s’est surpassée dans Jeanne d’Arc [avec les pensionnaires de son théâtre, dont MM. Darmont, Piron, Deschamps, Lacroix, Castelli et Cauroy], et à Mme Réjane, exquise dans un monologue de Meilhac. […]
La France militaire, 13 septembre 1895
Sarah Bernhardt lit la Jeanne d’Arc de Maurice Douay.
Lien : Retronews
Jeanne d’Arc, œuvre toute récente du poète Maurice Douay, maître de conférences au collège Sainte-Barbe, termine, avec Turenne et Vercingétorix, une trilogie nationale, inspirée par le plus ardent patriotisme, très vibrante, et dont les vers sont d’excellente facture.
La Société d’encouragement au bien a décerné son premier prix de poésie à chacune de ces œuvres, et le lauréat vient d’obtenir pour sa Jeanne d’Arc l’honneur insigne d’être interprétée par Mme Sarah Bernhardt.
Éditeurs : Tresse et Stock.
Le Petit Journal, 29 avril 1901
Extrait de la Chronique du lundi : anecdote sur Sadi Carnot.
Lien : Retronews
[…] Chez nous, les présidents de la République, pour lesquels l’étiquette n’existe guère, vont où bon leur semble, suivant en cela, d’ailleurs, la coutume de nos rois et empereurs qui usaient, à cet égard, de la plus grande liberté. Toutefois, il ne semble pas, jusqu’à M. Loubet, qu’ils aient abusé des théâtres secondaires, se contentant le plus souvent des représentations des thèmes subventionnés.
M. Thiers, lui, n’allait jamais qu’à la Comédie-Française et à l’Opéra ; parfois, mais rarement, à l’Opéra-Comique. — Le maréchal de Mac-Mahon se tint à peu près dans la même réserve ; il n’en sortit qu’une fois pour assister, à l’Odéon, à la troisième représentation de l’Hetman, le drame en vers de Paul Déroulède ; — Le président Grévy allait peu au théâtre, et se confinait presque exclusivement dans les représentations classiques de la Comédie-Française. — Le président Sadi Carnot ne dérogea qu’une fois pour aller à la Porte-Saint-Martin assister à une représentation de la Jeanne d’Arc de Jules Barbier, jouée par Sarah Bernhardt. — Le président Félix Faure ne manquait pas une première représentation des théâtres subventionnés, et n’allait guère dans les autres. — M. Loubet se prodigue plus volontiers, il aime le théâtre, et va où bon lui semble ; en famille, faisant louer une avant-scène la veille, ainsi qu’il fit, mardi dernier, pour les Variétés. […]
Le Figaro, 4 septembre 1901
Jeanne d’Arc avec Sarah Bernhardt pour la venue du Tsar.
Lien : Gallica
À l’occasion du voyage du Tsar en France, le Comité de l’Œuvre des dispensaires antituberculeux, dont le président est M. le docteur Bonnet-Léon et le secrétaire général notre confrère M. Albert de Ricaudy, organise à Paris une représentation de gala pour laquelle le haut patronage de S. M. I. l’impératrice de Russie a été sollicité.
Mme Sarah Bernhardt a accepté de jouer pour la circonstance la Jeanne d’Arc de Jules Barbier.
Le Temps, 6 septembre 1901
Lien : Gallica
On a parlé d’une représentation de gala qui serait donnée par le comité de l’Œuvre des dispensaires antituberculeux.
Le docteur Bonnet-Léon, président de l’œuvre, et M. de Ricaudy, secrétaire général, ont choisi le théâtre Sarah-Bernhardt, et le spectacle donné le 20 septembre serait la Jeanne d’Arc de Barbier, musique de Gounod, réduite en trois actes.
Les billets pour cette représentation seraient rigoureusement personnels.
Mme Sarah Bernhardt jouerait le rôle de Jeanne d’Arc et l’un des décors serait précisément une reproduction fidèle de la cathédrale de Reims.
Le Figaro, 13 septembre 1901
Lien : Gallica
Ainsi qu’il était présumable, la direction du théâtre Sarah-Bernhardt rectifie la note communiquée aux journaux par M. de Ricaudy et que nous avions insérée parce qu’il s’agissait d’une œuvre de bienfaisance. Il n’a pu être question d’une représentation de Jeanne d’Arc avec Mme Sarah Bernhardt le 20 septembre, par la simple raison que la grande artiste partait en tournée et que des engagements déjà anciens doivent la tenir éloignée de Paris à cette date.
Le Figaro, 23 mars 1902
Jeanne d’Arc de Rostand.
Lien : Gallica
Jeanne d’Arc !
À l’invincible attrait qu’exerce cette admirable figure, M. Edmond Rostand n’a pas échappé. Cette nouvelle nous arrive que le poète de Cyrano et de l’Aiglon travaille à une grande pièce dont la Pucelle d’Orléans serait l’héroïne. On en chuchote même le titre : le Procès de Jeanne d’Arc…
Cette nouvelle œuvre sera, si nous comptons bien, la seizième ou la dix-septième pièce que l’admiration des auteurs dramatiques ait vouée à la noble fille. Nous sommes loin des petits vers badins de Voltaire.
Le Petit Journal, 24 mars 1902
Un Procès de Jeanne d’Arc de Rostand pour Sarah Bernhardt.
Lien : Retronews
On annonce que M. Edmond Rostand, actuellement en villégiature hivernale à Cambo, dans les Pyrénées, travaille à une pièce en vers, le Procès de Jeanne d’Arc, et que le principal rôle est destiné à Mme Sarah Bernhardt. Rappelons à ce sujet que la grande tragédienne a déjà joué, à la Porte-Saint-Martin,une Jeanne d’Arc de Jules Barbier, pour laquelle Gounod avait écrit une importante partition symphonique.
La Patrie, 29 décembre 1903
Plusieurs Jeanne d’Arc en préparation.
Lien : Gallica
On signale plusieurs Jeanne d’Arc en préparation pour 1904.
D’abord celle de M. Rostand ; ensuite celle de M. Moreau, que Mme Sarah Bernhardt a failli jouer et que M. Porel montera peut être ; enfin, une Jeanne d’Arc tirée de la curieuse étude de M. Anatole France. Sans compter les autres qui se préparent dans l’ombre !
Le Gil Blas, 13 novembre 1904
Extrait du Courrier des Théâtres : Le Procès de Jeanne d’Arc d'Émile Moreau au théâtre Sarah-Bernhardt.
Lien : Gallica
Au Théâtre Sarah-Bernhardt. — Après Par le fer et par le feu, et avant le retour de Mme Sarah-Bernhardt, on jouera le Procès de Jeanne d’Arc, de M. Émile Moreau, avec Mme Suzanne Desprès dans le rôle de Jeanne d’Arc.
Le Gil Blas, 14 novembre 1904
Extrait du Courrier des Théâtres.
Lien : Gallica
Nous recevons la dépêche suivante :
Budapest, 13 novembre 1904.
Je vous serai très obligée de rectifier la nouvelle fausse donnée par votre correspondant. Je ne dois pas monter la Jeanne d’Arc, de M. Moreau, devant plus tard jouer une Jeanne d’Arc de M. Rostand. Du reste, la Jeanne d’Arc de M. Moreau appartient au Vaudeville, non au Théâtre Sarah-Bernhardt, et c’est Mlle Suzanne Desprès qui doit créer cette œuvre. Les recettes de Par le fer et par le feu permettent à mon théâtre d’attendre mon retour. Faites, je vous prie, mon cher ami, passer cette note ce soir même et croyez à mes sentiments affectueux.
Sarah Bernhardt.
Le Gil Blas, 8 décembre 1904
Extrait du Courrier des Théâtres.
Lien : Gallica
Au Vaudeville. — M. Porel vient d’engager Mlle Marthe Mellot pour jouer cette saison, sur son théâtre, le rôle de Jeanne d’Arc, dans le Procès de Jehanne, pièce en quatre actes, de M. Émile Moreau, annoncée dans son programme à ses abonnés.
Le Soir, 4 février 1905
Lien : Retronews
C’est décidément Mme Sarah Bernhardt qui créera, et cela dans son théâtre, le Procès de Jeanne d’Arc, de M. Émile Moreau.
[Note : Émile Moreau venait de perdre sa fille Jeanne le 1er janvier 1905, âgée de 32 ans.]
Sur les Boulevards Les représentations de Jeanne d’Arc dans le théâtre populaire
Texte de Venita Datta, extrait de l’ouvrage Clio. Histoire‚ femmes et sociétés (2006).
Lien : Sur les Boulevards
Résumé. — Dans cet article, nous nous proposons d’examiner la représentation de Jeanne d’Arc au théâtre de boulevard, à partir des deux pièces de la fin de siècle les plus connues sur le sujet : Jeanne d’Arc
: l’une de Jules Barbier (avec une musique de Gounod, montée en 1890 au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, avec Sarah Bernhardt dans le rôle de Jeanne), l’autre étant le Procès de Jeanne d’Arc d’Émile Moreau (représentée au Théâtre Sarah-Bernhardt en 1909, Sarah Bernhardt incarnant une nouvelle fois la Pucelle). Grâce à son talent, Sarah Bernhardt contribue à la fois à la commercialisation de la légende johannique et à favoriser un certain consensus autour de Jeanne. À travers ces deux pièces, les auteurs républicains et leur célèbre collaboratrice tentent de créer une image de Jeanne, la sainte patriotique
, image au-delà de la politique
, qui puisse être associée à la République aussi bien qu’à l’Église catholique. Mais le consensus autour de Jeanne est fragile. Sous l’unité de surface, apparaissent une série de querelles, non seulement sur la politique et l’identité nationale, mais aussi sur le genre, la culture de masse, le théâtre, et sur Sarah Bernhardt elle-même.