Documentation : Vraie Jeanne, I (1890-1893)
La Vraie Jeanne d’Arc, t. I 1890-1893
Le Monde 8 décembre 1889
Après avoir présenté l’ouvrage de Lanéry d’Arc sur les Mémoires consultatifs, Marius Sepet annonce la parution prochaine d’un ouvrage poursuivant la même voie : la Pucelle devant l’Église de son temps, du père Ayroles, qu’il espère sans concession au rationalisme, mais sans excès fidéiste
.
Lien : Gallica
Nous apprenons que le R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, auteur déjà d’un ouvrage qui a ses qualités et ses défauts : Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France (librairie Gaume, in-12), se propose d’entrer dans la même voie avec plus de largeur encore. Il prépare une série de travaux de vulgarisation des sources de l’histoire de la Pucelle, qui sera prochainement inaugurée par un volume intitulé : La vraie Jeanne d’Arc, la Pucelle devant l’Église de son temps. Si,comme nous l’espérons, le P. Ayroles se tient près des faits et des textes, interprétés et commentés selon les règles d’une théologie et d’une philosophie vraiment scientifiques, sans concession au rationalisme, mais sans excès fidéiste, il contribuera beaucoup par ses publications à la glorification raisonnée de l’illustre vierge, dont la mission a témoigné si hautement de la faveur particulière de Dieu pour la France.
Marius Sepet.
L’Univers 10 décembre 1889
L’historien Lecoy de La Marche (qui signe d’Assigny à cause des ses fonctions aux Archives) commente la présentation de la Vraie Jeanne d’Arc qui paraîtra bientôt. Il se réjouit particulièrement que le contenu des Mémoires des théologiens, que Quicherat avait délibérément omis dans sa publication, soit enfin révélé au grand public.
Cette exclusion a eu des effets très fâcheux : elle a contribué à faire croire que l’Église n’avait pas élevé la voix, n’avait pas combattu pour la vierge inspirée.
Lien : Retronews
Les documents théologiques relatifs à Jeanne d’Arc
Je signalais dans un de mes derniers courriers la publication faite par M. Lanéry d’Arc des pièces du procès de la Pucelle, omises par Quicherat, pièces consistant en mémoires consultatifs, rédigés par les principaux théologiens du temps, et empruntant un nouvel intérêt au projet de canonisation qui a surgi si heureusement de nos jours. Voilà qu’un nouveau zélateur de la gloire de notre future sainte nationale entreprend de vulgariser, sous une forme plus claire, plus concise et en bon français, ces pièces, d’une importance capitale, trop souvent écrites en mauvais latin. Le P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, qui nous a déjà donné,il y a quatre ans une étude intitulée : Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France, nous annonce maintenant, la publication plus savante dont je veux parler, sous le titre suivant, un peu long peut-être : La vraie Jeanne d’Arc. La Pucelle devant l’Église de son temps. Documents nouveaux. Ce sera un gros volume in-4, de 900 pages au moins. L’auteur le met d’avance en souscription à la librairie Gaume.
Parmi les innombrables travaux qu’a inspirés jusqu’à présent notre glorieuse héroïne, on n’en voit pas un seul qui tende plus directement à ce but si désirable : détromper l’opinion publique, ou du moins l’opinion des gens prévenus par la lecture de nos plus mauvais historiens, sur le rôle joué par l’Église dans le procès de Jeanne d’Arc.
[L’extrait qui suit est sans doute tirée d’une présentation de l’ouvrage que l’éditeur comptait financer par souscription. Cette présentation est reproduite plus amplement dans l’édition du 23 décembre.]
Qui sait que, par ses grands docteurs, l’Église a suivi la Pucelle depuis son apparition sur la scène jusqu’au jour où la sentence de Calixte III la vengeait de l’ignominie de la plus inique des sentences ? Ce que l’on sait de l’intervention de l’Église auprès de Jeanne, c’est qu’approuvée par les docteurs de Poitiers, la Pucelle fut condamnée par un évêque et par l’Université de Paris ; on mentionne en courant la réhabilitation par Rome.
On se garde bien d’insister sur ce dernier acte et sur le premier, et l’on pense atteindre l’Église en lançant contre les docteurs-bourreaux des anathèmes d’ailleurs fort mérités. Il y a double injustice : injustice de confondre avec l’Église des docteurs et une corporation qui en ce moment, ourdissaient contre le centre de l’unité, contre la Papauté, des attentats aussi criants que ceux qu’ils exécutèrent contre la libératrice ; injustice de laisser dans l’oubli les célèbres personnages qui approuvèrent Jeanne ou défendirent sa mémoire. Leurs écrits éclairent merveilleusement les pages de sa miraculeuse histoire ; ils y font resplendir ce soleil du surnaturel, sans lequel la vierge guerrière reste enveloppée de tant de ténèbres ; ils en éclairent les points les plus obscurs.
N’est-ce pas la raison pour laquelle la libre-pensée dédaigne ces travaux et leurs auteurs, et s’efforce de les ensevelir dans l’oubli ? Les amis de Jeanne doivent beaucoup à Quicherat : sous le titre de Double procès de condamnation et de réhabilitation, il a donné une collection de documents indispensables à quiconque veut étudier sérieusement la Pucelle. Mais le célèbre paléographe avait le malheur de ne pas croire ; il a mieux aimé laisser un immenses vide dans la reproduction du procès de réhabilitation que de donner les mémoires des docteurs qui en font partie intégrante. Il n’aurait pas pu les éditer sans renverser la conception qu’il se forgeait de l’héroïne, et les idées si étranges émises dans son ouvrage : Aperçus nouveaux sur Jeanne d’Arc.
Je ne sais si l’omission regrettable de Quicherat a eu réellement pour cause l’arrière-pensée que lui prête ici le R. P. Ayroles. Il faut peut-être l’attribuer tout simplement au motif allégué par le maître lui-même : l’étendue excessive que la publication intégrale des mémoires en question eût donnée à son travail, formant déjà, sans eux, la matière de cinq gros volumes, somme de texte un peu effrayante pour la Société de l’histoire de France, qui s’était faite l’éditeur du Procès. D’ailleurs, Quicherat se mettait généralement peu en peine d’accorder les documents qu’il publiait avec ses croyances personnelles, ou plutôt avec son incroyance. Sous ce rapport, il a donné à différentes reprises la preuve de sa bonne foi. Et même dans ces cinq volumes de textes, sans chercher plus loin, combien de pages viennent, à l’encontre des théories malheureuses exposées dans les Aperçus !
Mais cette exclusion, quelle qu’en ait été la raison véritable, n’en a pas moins eu des effets très fâcheux : elle a contribué pour sa part à faire croire que l’Église n’avait pas élevé la voix, n’avait pas combattu pour la vierge inspirée. L’ouvrage qui nous est annoncé partagera avec celui de M. Lanéry d’Arc l’honneur d’avoir rétabli la vérité sur ce point essentiel. Bien qu’il ne reproduise pas toute la teneur des mémoires dont il se compose, qu’il abrège ou supprime certains passages surchargés de citations de livres sacrés ou profanes, qu’il ne donne de certains autres qu’une simple analyse, il sera encore d’un grand secours aux érudits eux-mêmes, surtout à ceux qui ne posséderont pas l’édition latine pu qui n’auront pas le moyen d’y recourir. Un bon résumé est souvent plus utile et plus instructif qu’un texte diffus.
Après cela, il ne restera plus qu’un livre à faire sur Jeanne d’Arc : c’est ce que j’appellerai son histoire posthume, prolongée jusqu’à nos jours. Les variations de l’opinion publique à son sujet sont le meilleur criterium du niveau moral et intellectuel de chaque siècle, de chaque génération ; leur exposé peut donc servir, non seulement à la gloire de la future Sainte, mais à l’appréciation vraie de l’état des esprits et de la société dans les temps qui ont suivi son apparition sur la terre. Ce livre, complément nécessaire de tous ceux qui ont été composés sur sa vie et sa mission, j’en ai déjà esquissé la trame ailleurs. À qui sera-t-il donné de l’exécuter entièrement, avec la largeur de vues et les vastes proportions que réclame un pareil sujet ?
D’Assigny.
L’Univers 23 décembre 1889
Reproduction d’un texte de présentation de la Vraie Jeanne d’Arc, probablement celui diffusé par l’éditeur. En effet l’ouvrage allait être vendu par souscription, financement adopté pour les livres coûteux (la réclame annonce 900 pages) et n’intéressant qu’un public restreint.
Lien : Retronews
Sous ce titre : La vraie Jeanne d’Arc, la Pucelle devant l’Église de son temps, documents nouveaux, le R. P. J.-B.-J. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, auteur de Jeanne d’Arc sur les autels, va publier à la librairie Gaume un volume in-4° de 900 pages, dont l’exposé suivant indique l’importance et l’intérêt :
Le nom de Jeanne d’Arc est entouré d’une popularité qui est une de nos espérances. Ce n’est pas sans un dessein particulier de la Providence que la figure de la libératrice, restée en partie voilée depuis le bûcher de Rouen, reparaît avec un éclat qu’elle eut seulement aux jours de sa glorieuse carrière.
Dans les âges anciens, au moment des grands périls, nos pères allaient à Saint-Denis décrocher l’oriflamme nationale, et marchaient au combat les yeux fixés sur la célèbre bannière. Ainsi firent-ils à la veille de la victoire de Bouvines. N’est-il pas permis de penser qu’à la place de l’oriflamme qui a péri, le Ciel veut que nos regards s’attachent à un signe plus national et plus vivant : Jeanne la Pucelle ?
Il y a quatre ans paraissait un volume consacré à mettre cette pensée en lumière, sous le titre de Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France. Il a fait tressaillir bien des cœurs. L’auteur, le R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, n’a cessé depuis lors d’étudier la céleste envoyée. Il pense que, malgré sa popularité et les productions si nombreuses auxquelles elle a donné lieu, la libératrice reste mal connue, et qu’elle le sera tant que ne seront pas vulgarisées les sources de sa divine histoire. Il en est de fort importantes qui sont encore inexplorées ; bien des documents de grande valeur ne sont pas même édités. Tels sont les travaux faits sur Jeanne par les grands théologiens de son temps.
Qui connaît ces travaux ? Qui sait que, par ses grands docteurs, l’Église a suivi la Pucelle depuis son apparition sur la scène jusqu’au jour où la sentence de Calixte III la vengeait de l’ignominie de la plus inique des sentences ? Ce que l’on sait de l’intervention de l’Église auprès de Jeanne, c’est qu’approuvée par les docteurs de Poitiers, la Pucelle fut condamnée par un évêque et l’Université de Paris ; on mentionne en courant la réhabilitation par Rome. On se garde bien d’insister sue ce dernier acte et sur le premier, et l’on pense atteindre l’Église en lançant contre les docteurs-bourreaux des anathèmes d’ailleurs fort mérités. Il y a double injustice : injustice de confondre avec l’Église des docteurs et une corporation qui, eu ce moment, ourdissaient contre le centre de l’unité, contre la Papauté, des attentats aussi criants que ceux qu’ils exécutèrent contre la libératrice ; injustice de laisser dans l’oubli les célèbres personnages qui approuvèrent Jeanne ou défendirent sa mémoire. Leurs écrits éclairent merveilleusement les pages de la miraculeuse histoire ; ils y font resplendir ce soleil du surnaturel, sans lequel la vierge guerrière reste enveloppée de tant de ténèbres ; ils en éclairent les points les plus obscurs.
N’est-ce pas la raison pour laquelle la libre-pensée dédaigne ces travaux et leurs auteurs et s’efforce de les ensevelir dans l’oubli ? Les amis de Jeanne doivent beaucoup à Quicherat ; sous le titre de double procès de condamnation et de réhabilitation, il a donné une collection de documents indispensables à quiconque veut sérieusement étudier la Pucelle. Mais le célèbre paléographe avait le malheur de ne pas croire ; il a mieux aimé laisser un immense vide dans la reproduction du procès de réhabilitation que de donner les mémoires des docteurs qui en font cependant partie intégrante. Il n’aurait pas pu les éditer sans renverser la conception qu’il se forgeait de l’héroïne et les idées si étranges émises dans son ouvrage : Aperçus nouveaux sur Jeanne d’Arc.
C’est cet aspect culminant dans l’histoire de Jeanne d’Arc, si important pour qui conque aime l’Église, que le P. Ayroles s’efforce de mettre pleinement en lumière dans un nouveau volume. Il fait connaîtra les personnages ecclésiastiques qui, comme approbateurs, ennemis et surtout apologistes, interviennent dans cette épopée et dans ce drame, depuis Poitiers jusqu’à la réhabilitation, et au delà encore.
Pour vulgariser des œuvres sans lesquelles on connaîtra mal la libératrice, il les traduit du latin en français. Quelques-unes, sont surchargées de longueurs, de citations sacrées et profanes, en opposition avec notre méthode et nos procédés, il se contente d’analyser ces parties, d’en donner parfois l’indication ; mais il reproduit, sans craindre de se répéter, l’application à Jeanne de principes trop longuement établis. Le tout est exposé dans un ordre régulier et chronologique, et forme l’ensemble de l’ouvrage qui a pour titre : La vraie Jeanne d’Arc. La Pucelle devant l’Église de son temps. Documents nouveaux. Nouveaux, ils le sont, certes ; plus de la moitié du livre se compose de pièces inédites, quelques-unes nullement signalées ; le reste, de notices empruntées à de nombreux ouvrages fort peu lus, soit parce qu’ils sont en latin, soit parce qu’ils sont rares, anciens, et traitent de personnages trop oubliés. Des hommes de savoir, après avoir lu le manuscrit, l’ont appelé un monument élevé à la gloire de la Pucelle.
L’Univers 13 janvier 1890
Reproduction d’une lettre d’encouragement et de remerciement de Mgr Cabrières, évêque de Montpellier pour le livre à paraître.
Note. — Ce sera l’une des quatre lettres d’approbation d’évêques, en tête de l’ouvrage.
Cabrières présage qu’en rétablissant l’image de Jeanne d’Arc et en exposant le surnaturel de sa mission, l’ouvrage favorisera sa canonisation et rappellera la France à sa foi.
Lien : Retronews
Nous avons déjà annoncé [les 10 et 23 décembre précédents] la prochaine publication par la maison Gaume d’un nouveau et remarquable travail de R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, sur Jeanne d’Arc : La Vraie Jeanne d’Arc, la Pucelle devant l’Église de son temps ; à l’occasion de cet ouvrage, qui forme un volume in-4 de 900 pages, le R. P. Ayroles a reçu de Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, la lettre suivante :
Mon Révérend Père,
Vous voilà donc sur le point de présenter au public chrétien la vraie Jeanne d’Arc ! C’est un acte nécessaire et méritoire car depuis plusieurs années, on a essayé de montrer la vierge lorraine, l’envoyée de Dieu, son ambassadrice et sa messagère auprès de notre nation, sous des traits et avec des couleurs qui ne répondaient ni à la vérité de l’histoire ni au caractère prodigieux d’une telle mission.
Parmi les auteurs récents qui ont le mieux parlé de la Pucelle d’Orléans, avec le plus de respect et d’enthousiasme, beaucoup, si ce n’est tous, hésitent à accepter la seule explication plausible du rôle extraordinaire que Jeanne d’Arc a joué dans la délivrance de notre pays et dans le rétablissement de la monarchie. Pour moi ce rôle tient du miracle et plus j’ai étudié les sources auxquelles on peut demander des informations authentiques sur la vie et la mort de la sainte héroïne, plus je me suis convaincu que le bras de Dieu avait été comme visiblement son appui et son se cours. Je considère que Jeanne est, en elle même et dans l’accomplissement de son œuvre, un miracle si incontestable que, dans mon opinion, ce sera là, un jour, l’un des plus puissants motifs qui détermineront le Saint-Siège à permettre à la France d’honorer d’un culte public et religieux la vaillante guerrière de Domrémy.
Il est donc bien utile et il est louable, mon révérend Père, de publier intégralement les mémoires théologiques, composés au quinzième siècle par les docteurs les plus renommés relativement à la mission de Jeanne d’Arc. C’est faire voir que, en ce temps, s’il y eut des clercs, assez aveuglés par le prestige du roi d’Angleterre pour calomnier avec lui le caractère et la vertu de la Pucelle d’Orléans, il y eut aussi dans l’Église des hommes de foi, de science et de courage qui la défendirent contre les accusations ineptes et odieuses, dont elle fut l’objet ; c’est répondre à l’instinct unanime qui porte aujourd’hui tous les Français, quelles que soient d’ailleurs leurs croyances ou leurs sympathies politiques, à vouloir honorer Jeanne d’Arc par des hommages exceptionnels.
Il semble que la glorification de la sainte héroïne marquera pour notre patrie bien-aimée l’ouverture d’une ère de paix et de prospérité. Votre compagnie se montre bien française en consacrant tant d’études et d’efforts a répandre de plus en plus la connaissance des merveilles que Jésus-Christ a daigné opérer par ses fidèles servantes, Jeanne d’Arc et la Bienheureuse Marguerite-Marie, dans l’intérêt d’une nation, si fière, pendant longtemps, d’être appelée la
fille aînée de l’Église Romaine.Pour moi, mon révérend Père, je suis fidèle à l’une des plus nobles traditions de mes prédécesseurs sur le siège de Maguelone ou de Montpellier, en essayant de promouvoir, dans l’humble mesure où cela m’est permis, la conviction que Jeanne a été suscitée de Dieu pour garder à la France son unité, l’intégrité de son territoire, et pour lui assurer dans l’avenir, la possession légitime du rang auquel elle était destinée pour le bien des autres peuples de l’Europe.
Agréez, s’il vous plaît, mon révérend Père, mes dévoués et respectueux hommages.
✝ F. Marie Anatole,
Évêque de Montpellier.
Bulletin de l’Institut catholique de Paris janvier 1890
Article pour la souscription de la Vraie Jeanne d’Arc, insérée dans le numéro de janvier 1890 (paraissant le 25).
Lien : Gallica
Gaume et Cie […] En souscription : La Vraie Jeanne d’Arc […] par le père J.-B.-J. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, auteur de Jeanne d’Arc sur les autels. 1 vol. in-4 : 15 fr. Prix pour les souscripteurs inscrits avant le 25 février : 10 fr.
Le nom de Jeanne d’Arc est entouré d’une popularité… [Texte de l’éditeur, voir l’Univers, 23 décembre 1889.]
Nota. — Les noms des souscripteurs seront joints au présent volume. Cette inscription donnera droit à un prix de faveur sur les volumes qui suivront sous le titre premier de Vraie Jeanne d’Arc. Le P. Ayroles se propose d’y vulgariser les sources de l’histoire de la Pucelle, et de montrer comment la libre-pensée les altère, les cache et les obstrue.
Revue catholique des institutions et du droit février 1890
Extrait de la Chronique du mois d’Albert Desplagnes qui annonce la parution en mars de la Vraie Jeanne d’Arc, dont il a pu lire les 200 premières pages.
Voir : Comptes-rendus de Desplagnes
Source : Revue catholique des institutions et du droit, 18e année, 1er semestre, 2e série, 3e volume, p. 189-190.
Pendant que les évêques poursuivent cette œuvre patriotique de Jeanne d’Arc, un religieux éminent, le R. P. Ayroles, qui a déjà vaillamment travaillé pour cette grande mémoire, prépare un nouveau livre destiné à nous faire connaître notre sainte protectrice. Nous avons été assez heureux pour pouvoir lire les 200 premières pages de cette œuvre magistrale, qui paraîtra en mars. Le R. P. Ayroles va doter la France d’un livre des plus précieux : La vraie Jeanne d’Arc, la Pucelle devant l’Église de son temps, documents nouveaux.
Nous verrons que notre âge connaît bien peu et bien mal l’époque où à paru Jeanne, et qu’on ne sait presque rien des causes qui ont amené son martyre.
Revue catholique des institutions et du droit mars 1890
Mention de l’ouvrage du père Ayroles à paraître dans le compte-rendu de l’ouvrage d’Eugène Jarry : La vie politique de Louis de France, duc d’Orléans, 1372-1407.
Source : Revue catholique des institutions et du droit, 18e année, 1er semestre, 2e série, 3e volume, p. 284-286.
Lien : Gallica
[…] Ce beau et bon livre doit être lu avant l’Histoire de Charles VII par M. de Beaucourt et le magnifique volume du R. P. Ayroles sur Jeanne d’Arc, qui va paraître dans un mois. Ces trois grandes études contiennent un tableau complet de 1372 à 1458, une des époques les plus étonnantes, les plus intéressantes et les plus importantes de notre histoire.
La Croix 23 mars 1890
Annonce (communiqué de l’éditeur) de la parution prochaine de la Vraie Jeanne d’Arc ; l’on s’étonne que tant de documents et d’une telle importance aient pu demeurer, jusqu’à ce jour, inédits
.
Vente par souscription : coût 15 francs, 10 pour ceux qui auront souscrit avant le 25 mars.
Lien (Retronews) : 23 mars, 25 mars, 26 mars
Annonce quasi identique dans l’Univers du 24. [Voir]
Gaume et Cie éditeurs, rue de l’Abbaye, 3, Paris. — La Vraie Jeanne d’Arc, la Pucelle devant l’Église de son temps. 1 vol. petit in-4°, 15 fr.
Sous ce titre, va paraître (nous avons la joie de l’annoncer à nos lecteurs) un livre nouveau du R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus : c’est un vrai monument élevé à la gloire de la Vierge de Domrémy.
On s’étonne que tant de documents, de la plus haute gravité et de l’intérêt le plus attachant, aient pu demeurer, jusqu’à ce jour, inédits. Au R. P. Ayroles, il est donné de les mettre, le premier, en pleine lumière ; et c’est déjà une belle récompense du service rendu à la cause de Jeanne par la publication du livre Jeanne d’Arc sur les autels. Nous ne craignons pas de dire que le second travail aidera, plus encore que le premier, à la canonisation de la Pucelle.
Il est, comme le précédent, édité par la maison Gaume, que son zèle traditionnel pour toutes les œuvres saintes signalait au choix de l’auteur. S’inspirant de ce zèle, M. Gaume a préféré le format in-4°, qui permet d’enclore en un seul volume les matériaux de trois volumes in-8°, sans préjudice pour la netteté et l’élégance de l’œuvre typographique. L’acheteur y trouve son profit, et l’importance exceptionnelle des documents exigeait, ce semble, un grand format.
Le volume, de 900 pages au moins, est du prix de 15 francs : il sera livré, au prix de 10 francs, à ceux qui auront souscrit avant le 25 mars. Il suffit d’adresser la demande à M. Gaume, éditeur, rue de l’Abbaye, 3, à Paris.
L’Univers 24 mars 1890
Annonce (communiqué de l’éditeur) très similaire à celle parue dans la Croix, de la veille.
Lien : Retronews
La vraie Jeanne d’Arc… — Nous rappelons que sous ce titre, va paraître un livre nouveau du R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus : c’est un vrai monnaient élevé à la gloire de la vierge de Domrémy.
Ce sont des documents de la plus haute gravité et de l’intérêt le plus attachant, que le R. P. Ayroles met ainsi, le premier, en pleine lumière. Ce second travail de l’auteur de Jeanne d’Arc sur les autels aidera, non moins que le premier, à la canonisation de la Pucelle.
Le volume est, comme le précédent, édité par la maison Gaume ; il est dans le format in-4, qui permet de renfermer en un seul volume les matériaux de trois volumes in-8, sans préjudice pour la netteté et l’élégance de l’œuvre typographique. L’acheteur y trouve son profit, et l’importance exceptionnelle des documents exigeait, ce semble, un grand format.
Le volume, de 900 pages au moins, est du prix de 15 francs : il sera livré, au prix de 10 francs, à ceux qui auront souscrit avant le 25 mars. Il suffit d’adresser la demande à M. Gaume, éditeur, rue de l’Abbaye, 3, Paris.
Le Gaulois 31 mars 1890
Semaine sainte : article de Léo Taxil sur la ressemblance entre Jeanne d’Arc et la Passion du Christ, inspiré du père Ayroles.
Note. — Léo Taxil, aidé de l’abbé Paul Fesch, venait de faire paraître le Martyre de Jeanne d’Arc, une nouvelle édition commentée du procès de condamnation (Paris, Letouzey et Ané, 1890 XII et 526 p.).
Lien : Retronews
Jeanne d’Arc et la Passion du Christ. — En cette Semaine Sainte et au moment où le nom aimé de Jeanne d’Arc provoque partout le réveil national, en même temps qu’il reçoit l’ardent hommage de la vénération des catholiques, il est bon de rappeler les ressemblances frappantes qui existent entre la Passion du Christ et l’épopée douloureuse de l’héroïque vierge française.
D’autres l’ont dit avant nous — notamment le cardinal Pie et le R. P. Ayroles — la sainte fille de Domrémy fut, par son histoire, par si vie et surtout par son martyre, la reproduction merveilleuse du Sauveur.
[La suite est un parallèle sur divers points : la sainte famille, l’irruption dans la vie publique, la trahison, le procès…]
Le procès de Rouen est l’image saisissante du procès de Jérusalem. Jamais Jeanne d’Arc ne fut plus grande que devant ses juges. Comme son divin fiancé, — a dit très justement le P. Ayroles, — elle est agneau et lion : agneau, quand elle dévoile le fond de son âme ; lion, quand elle rend témoignage à la divinité de sa mission.
[…]
Revue catholique des institutions et du droit avril 1890
Citation du père Ayroles, dans la Chronique du mois d’Albert Desplagnes, qui défend la primauté de Domrémy pour accueillir le principal monument national à élever à Jeanne, celle dont nous attendons un nouveau secours
.
Source : Revue catholique des institutions et du droit, 18e année, 1er semestre, 2e série, 3e volume, p. 284-286.
Lien : Gallica
Nous avons, le mois dernier, parlé assez longuement de Jeanne d’Arc et du mouvement providentiel qui s’accentue pour honorer notre libératrice. Nous ne voudrions pas laisser se propager une erreur en ce qui concerne notre sentiment.
Nous croyons que Domrémy doit avoir, de préférence à tout autre lieu, le principal monument national à élever à Jeanne. C’est là qu’elle est née, qu’elle a vécu 17 ans, qu’elle a été formée par les saints pour sa mission. Nous sommes donc fort heureux de voir l’ardeur de ce village béni pour la mémoire et la gloire de la Pucelle. Le lieu seul où ce monument devrait être emplacé à Domrémy a motivé nos réflexions du mois dernier. Quant aux droits de Domrémy, nous les avons toujours défendus. Nous croyons que la France comprend et aime assez sa libératrice pour que plusieurs monuments en son honneur s’élèvent en même temps. L’ardeur des luttes actuelles démontre seulement la force du sentiment national et l’amour de la France pour celle dont nous attendons un nouveau secours.
Nous devons ajouter un mot. En parlant de Jeanne, nous avons souvent employé le mot de sainte. Il est bien entendu qu’en nous exprimant ainsi, nous n’entendons en rien préjuger la décision de l’Église, à laquelle nous sommes absolument soumis.
C’est à l’Église romaine que les annales du genre humain doivent le plus beau de leurs joyaux, Jeanne la Pucelle.
C’est ainsi que s’exprime le R. P. Ayroles dans son beau livre qui va paraître. L’Église romaine, seule aussi, pourra proclamer la sainteté de notre libératrice et permettre à la France de prier publiquement celle que nous vénérons et vers qui nous pousse l’irrésistible élan de la conscience nationale.
A. Desplagnes,
Ancien Magistrat, Chevalier de Pie IX.
Courrier du Puy-de-Dôme 3 avril 1890
Un article sur Jeanne d’Arc et la Passion, cite le père Ayroles. L’emprunt est beaucoup plus important que ne le laisse croire la citation et s’apparente d’avantage à du plagiat : celui du livre II, chapitre V de Jeanne d’Arc sur les autels (p. 119-154) intitulé : La Pucelle, reproduction de l’Homme-Dieu, surtout dans le martyre
Lien : Retronews
Exemple. L’article :
Venez à moi les pauvres et les souffrants !disait le Christ, —Je n’ai jamais eu le cœur, disait la Pucelle, d’écarter de moi les pauvres et les malheureux, car c’est pour eux que je suis née.
Ayroles (p. 123) :
Venez à moi, les pauvres et les souffrants, disait Jésus.Je n’ai jamais eu le cœur, disait Jeanne, d’écarter de moi les pauvres et les malheureux ; car c’est pour eux que je suis née.
L’Univers 19 avril 1890
Très long compte-rendu de l’ouvrage du père Ayroles par l’historien médiéviste Lecoy de La Marche (alias d’Assigny) : il en a saisi l’importance et la substance, qu’il analyse à merveille.
Le fantôme de l’héroïne païenne, évoqué par les beaux esprits de la Renaissance ; l’ombre encore plus odieuse de la paysanne vulgaire et pervertie, inventée par le génie satanique de Voltaire ; la légende ridicule de la patriote laïque et démocratique, créée de toutes pièces par les libre-penseurs de notre époque, tout cela s’évanouit, tout cela disparaît.
Il a, en particulier, parfaitement saisi les deux dimensions de la sentence de 1456, qui casse la condamnation de 1431 et proclame l’innocence de Jeanne :
L’Église prononça l’annulation du premier procès et la réhabilitation solennelle de l’héroïne.
En une seconde partie plus courte, il s’emporte contre un autre ouvrage (Ernest Lesigne, La Fin d’une légende, 1889) soutenant que Jeanne ne brûla pas à Rouen mais poursuivit sa carrière sous le nom de Jeanne des Armoises.
Il est possible que l’écrivain dont je parle soit de bonne foi, et alors il aurait simplement besoin de suivre quelque temps les cours de l’École des chartes. Mais il peut se faire aussi que son ignorance apparente recouvre un parti pris de dénigrer les gloires les plus pures de la France chrétienne : dans ce cas, sa tentative serait sans excuse, et son état moral sans remède.
Lien : Retronews
I. — La Vraie Jeanne d’Arc
Si une œuvre humaine pouvait faire faire un pas de plus à la cause si populaire de la béatification de Jeanne d’Arc et ajouter de nouvelles lumières à celles qu’a déjà réunies, pour l’instruire, la Sacrée Congrégation des Rites, c’est assurément le volumineux ouvrage du R. P. Ayroles, dont j’annonçais dernièrement la publication prochaine et qui vient enfin de paraître. Cette grande cause avait en quelque sorte subi une première fois, de 1452 à 1456 la redoutable épreuve d’un examen théologique. À peine rentré en possession de la ville de Rouen, où avait été rendue l’inique sentence de Pierre Cauchon, l’âme damnée du parti anglais, Charles VII, loin d’oublier, comme on l’a dit, redit et rabâché, celle à qui il devait, après Dieu, la restauration de sa légitime royauté, ordonna immédiatement la révision du procès de condamnation et l’instruction d’un contre-procès destiné à remettre en honneur la mémoire de la libératrice de la France.
L’enquête fut entreprise avec une ardeur sans pareille par le frère Jean Bréhal, dominicain, et bientôt le cardinal d’Estouteville, légat du Pape, porta l’affaire devant le tribunal suprême de l’Église, qui finalement prononça l’annulation du premier procès et la réhabilitation solennelle de l’héroïne. À cette occasion furent rédigés, par les plus éminents théologiens du temps, des mémoires, des consultations, des rapports, contenant l’examen approfondi de la vie publique et privée de la Pucelle, de ses actions et de leur mobile, de ses sentiments intimes et de ses moindres pensées.
Le résultat fut véritablement foudroyant : les bourreaux de Jeanne (ceux, du moins, que la justice divine n’avait pas encore frappés) se virent convaincus de prévarication, réduits au silence, confondus. Ce ne fut pas seulement une réhabilitation ; ce fut comme une première proclamation par l’Église de l’éclatante sainteté de la victime. Dès ce jour, les peuples la proclamèrent, elle aussi, bienheureuse ; et je dis à dessein les peuples, car les hommages qu’elle reçut lui vinrent non seulement de la France, mais de l’Italie, de l’Allemagne, et de l’Angleterre elle-même. J’ai raconté ailleurs, quoique en abrégé, les débuts enthousiastes du culte privé rendu à sa mémoire et les étranges vicissitudes de cette carrière posthume, presque aussi agitée que sa vie terrestre.
On peut dire que tout ce grand mouvement séculaire, dont nous voyons aujourd’hui l’épanouissement, a sa source dans la sentence solennelle rendue par le Pape Calixte III, bien qu’avant ce moment et depuis le jour même de sa mort, Jeanne n’ait pas cessé d’être vénérée par quelques fidèles. Cette glorification officielle est donc l’heureux gage de la consécration définitive qui attend son nom ; c’est pourquoi, il est permis de le dire sans témérité et sans rien préjuger, quiconque travaille à mettre la première en lumière contribue puissamment à hâter le jour de la seconde.
Or, le R. P. Ayroles n’a pas seulement voulu faire connaître au plus grand nombre des lecteurs français, par des traductions ou des analyses, ces précieuses consultations théologiques, si injustement laissées de côté par l’éditeur des deux procès de la Pucelle (qu’il appelle le directeur de l’école des Chartes, je ne sais trop pourquoi, car Jules Quicherat était loin de posséder ce titre à l’époque où il publiâmes cinq volumes, et cette savante école n’a officiellement rien à voir dans ses procédés ni dans ses théories personnelles). Il y a joint, à bon droit, tous les mémoires, toutes les dépositions émanées des théologiens du quinzième siècle, en dehors du procès de réhabilitation, et dont plusieurs étaient demeurés également dans l’ombre. Son premier livre est consacré aux traités qui ont précédé la mort de Jeanne et à leurs auteurs respectifs ; il a une importance capitale, en ce qu’il permet d’apprécier la valeur de ces différents témoignages, favorables ou non, et de faire équitablement la part des responsabilités ou des influences dans l’issue de la mission de l’envoyée céleste.
Le second livre est consacré aux pseudo-théologiens, bourreaux de Jeanne. Il expose ce qu’ils furent dans l’Église et dans l’État, comment ils procédèrent vis-à-vis de la libératrice. […] Les quatre suivants sont consacrés à la réhabilitation. Le troisième fait connaître les débuts, les premiers ouvriers, les premiers travaux ; le quatrième est réservé aux mémoires de quelques évêques justement célèbres, que l’on trouve dans l’instrument du procès de réhabilitation ; le cinquième, à la récapitulation que fit Bréhal des nombreuses consultations écrites, ou orales qu’il avait pour la plupart provoquées. Le sixième présente l’histoire du procès de réhabilitation ; il dit ce que furent les délégués de Calixte III, leurs travaux, le sommaire de la procédure ; il relate la sentence, et tire pour l’histoire de Jeanne quelques conclusions qui semblent acquises par les travaux précédents. Un rapide coup d’œil sur Jeanne devant l’Église depuis la réhabilitation, surtout de nos jours, termine le volume.
[La Vraie Jeanne d’Arc, t. I, introduction, p. XII-XIII.]
Un des grands mérites de ce plan est, on le voit, de ne pas séparer les œuvres des personnes, de placer, à côté de chacun des textes, le portrait moral de l’auteur et de déterminer aussi le degré d’autorité ou de confiance que nous devons accorder à ces divers témoignages. Assurément tant de mémoires sur la même question devaient se répéter souvent et ils se répètent en effet ; là était l’écueil pour un écrivain de nos jours qui sait à quoi s’en tenir sur les goûts et les exigences de son public. Toutefois l’élément biographique, introduit ici avec beaucoup d’art, interrompt suffisamment la monotonie des raisonnements scolastiques et le tout se lit d’un bout à l’autre sans fatigue, il faut même dire avec un charme croissant.
Quel cœur catholique et français ne se sentirait battre, en voyant enfin la grande figure de Jeanne replacée sur son véritable piédestal, qui est celui de la sainteté et dans son milieu surnaturel ? Il nous sera donc permis, désormais, de l’admirer dans tout son éclat, dans toute sa pureté primitive. Le fantôme de l’héroïne païenne, évoqué par les beaux esprits de la Renaissance ; l’ombre encore plus odieuse de la paysanne vulgaire et pervertie, inventée par le génie satanique de Voltaire ; la légende ridicule de la patriote laïque et démocratique, créée de toutes pièces par les libre-penseurs de notre époque, tout cela s’évanouit, tout cela disparaît : il ne reste devant nous que l’humble enfant des champs, petite et faible par elle-même, mais grande et forte par Celui qui l’envoie ; la candide paroissienne de Domrémy, qui ne sait pas au juste ce qu’on entend par l’Église militante et ne connaît que l’église de son village, mais qui néanmoins en appelle au Pape comme à son juge suprême ; la pieuse bergère qui charme et attire sans le vouloir, à l’exemple de saint François d’Assise, les petits oiseaux du bon Dieu, mais qui plus tard commanda fièrement les armées au nom du Roi du ciel et conserva dans les camps l’habitude de communier tous les huit jours ; pour tout dire, la catholique fidèle, orthodoxe, dévote, et, mieux encore, la vierge inspirée, enveloppée constamment d’une atmosphère mystique, en un mot la sainte.
Telle est la physionomie réelle qu’ont reconnue et décrite les juges, les plus éclairés, et en même temps les plus défiants, les plus difficiles qui fussent au monde ; telle est celle qui sa dégage de la lecture de ces pages émouvantes, et qui seule restera dans l’histoire, le jour où l’histoire ne sera plus une conspiration permanente contre l’éternelle vérité.
Mais, si le livre dont je parle a cette double utilité de fournir aux promoteurs de la canonisation de nouveaux arguments et de restituer à tous les amis de la future bienheureuse un portrait authentique, il est encore appelé à rendre un autre service, plus important peut-être, ou du moins plus urgent. Il réfute d’une manière invincible cette calomnie absurde, incessamment répétée autour de bous, qui veut que Jeanne d’Arc ait été condamnée et suppliciée par l’Église. À qui revient, en effet, l’honneur d’avoir vengé sa mémoire et proclamé ses mérites ?
Au Pape, chef de l’Église. Quels sont les auteurs des mémoires les plus favorables à sa cause ? C’est un Regnault de Chartres, archevêque de Reims, ennemi déclaré du schisme ; un Ciboule, chancelier de Notre-Dame de Paris, camérier de Nicolas V et partisan résolu du vrai Pape ; un Jean Bochard, évêque d’Avranches, adversaire des nominaux, c’est-à-dire les dignitaires les plus haut placés et les plus connus par leur attachement à l’Église romaine. Quels sont, d’autre part, ses calomniateurs, ses persécuteurs les plus farouches ? Un Pierre Cauchon, ex-cabochien, ancien proscrit, affidé des Bourguignons et des Anglais, réputé pour sa perfidie, sa cruauté et ses opinions suspectes ; un Courcelles, digne précurseur de Luther et de Calvin, auteur principal des décrets du concile de Bâle et de la Pragmatique sanction dictée à Charles VII ; un Loyseleur, qui figura, lui aussi, à cette assemblée schismatique et fut privé de ses bénéfices ; un Érard, gallican enragé ; enfin la plus grande partie de l’Université de Paris, enrôlée également dans la faction étrangère et, chose plus triste encore, dans les rangs de l’opposition religieuse, l’Université, âme du brigandage de Bâle
*, comme l’auteur le démontre longuement et victorieusement ; c’est-à-dire les prélats et les clercs qui se plaçaient eux-mêmes en dehors du giron de l’Église, qui combattaient le Pape de Rome. Cette coïncidence n’est-elle pas frappante ? Et ne dit-elle pas, mieux que tous les raisonnements, combien la cause de Jeanne était intimement liée à la cause catholique, combien l’Église orthodoxe l’avait à cœur, combien, au contraire, les hérésiarques et les séparatistes lui étaient hostiles, par instinct et par principe ?
* Le concile de Bâte, dont l’autorité a suscité de vives controverses, ne peut mériter ce qualificatif qu’après sa translation à Ferrare. (Note de la rédaction.)
L’Université de Paris, en particulier, joua dans cette odieuse affaire un rôle prédominant, et ce n’est pas là une des moindres taches qui déshonorent sa glorieuse histoire. M. de Beaurepaire et Jules Quicherat lui-même l’avaient déjà reconnu :
L’idée de faire succomber Jeanne devant un tribunal ecclésiastique se produisit spontanément, non pas dans les conseils du gouvernement anglais, mais dans les conciliabules de l’Université.
[Quicherat, Aperçus nouveaux, 1850, p. 96.]
Le premier coup dirigé contre la Pucelle vint de l’Université, et, par la rapidité avec laquelle il fut porté, on peut juger que cette corporation puissante n’avait point eu besoin d’être excitée par les menaces des Anglais, pas même par les exhortations de Cauchon, auquel, il faut bien le dire, quelques mois après, elle osa bien reprocher sa lenteur dans les négociations engagées pour obtenir la remise de la Pucelle.
[Beaurepaire, Recherches sur le procès de condamnation, 1869, p. 67.]
Et le R. P. Ayroles, fort de l’appui de ses documents, ajoute à son tour :
Dans le drame de Rouen, tout se fait au nom de l’Université de Paris. Luxembourg et Philippe de Bourgogne ne livrent leur prisonnière que sur ses sommations réitérées. Elle se plaint de la lenteur que l’on met à juger la captive ; elle se propose elle-même pour instruire la cause ; les plus éminents de ses membres dirigent les interrogatoires ; c’est à son jugement que sont déférés les prétendus aveux de l’accusée. La condamnation s’appuie sur les qualifications et l’avis doctrinal de l’Université de Paris ; l’Université de Paris est constamment en cause dans le récit menteur des scènes de Rouen, dont la cour d’Angleterre inonda l’Europe.
[La Vraie Jeanne d’Arc, t. I, introduction, p. VI.]
Oui, (s’écrie-t-il ailleurs avec l’accent d’une sainte indignation), l’Université a condamné la libératrice de la France ; mais c’est lorsque, depuis cinquante ans, par la prolongation du grand schisme, elle s’efforçait d’annuler et, par suite, de faire disparaître la libératrice du genre humain, la Papauté. L’épouvantable déchirement venait à peine de finir : Martin V cicatrisait les plaies de l’Église ; et l’Université, tout en allumant le bûcher de Rouen, se disposait à recommencer la scission, à rouvrir des blessures mal fermées. Elle a livré au pouvoir séculier la miraculeuse apparition du Christ-Roi, qui est la Pucelle ; c’eût été le sort du Vicaire de Jésus-Christ, d’Eugène IV, si l’on avait exécuté les décisions qu’elle inspirait. […] Rien de plus important que de mettre en lumière ce point capital*.
[La Vraie Jeanne d’Arc, t. I, introduction, p. 88.]
* Outre la réserve formulée ci-après par notre collaborateur, il convient aussi de faire remarquer ici que l’Université était alors sous la main de l’Angleterre, qui y avait introduit une tournée de docteurs de ses partisans. (Note de la Rédaction.)
Il serait néanmoins injuste d’englober dans cette réprobation méritée l’Université tout entière. Loin de moi, certes, la pensée d’excuser son évidente complicité avec les bourreaux. Il faut pourtant admettre des exceptions, et c’est d’après les éclaircissements fournis par l’auteur lui-même que je me permets de les signaler à son indulgence. Guillaume Bouillé, qui démontra la fausseté des accusations de Pierre Cauchon ; Jean de Montigny, Ciboule, qui conclurent en faveur de Jeanne, appartenaient à ce docte corps. Gerson, qui, sur le point de mourir, et aussitôt après la délivrance d’Orléans, consacra les derniers efforts de sa plume défaillante à l’éloge convaincu de la Pucelle et de son œuvre, est revendiqué par l’Université comme son plus illustre fils. Il se sépara ouvertement de sa mère dans cette mémorable circonstance. La célèbre institution racheta donc en partie sa faute par l’empressement que mirent plusieurs de ses membres à la prévenir ou à la réparer.
Non seulement l’Université, anglaise d’esprit et de cœur, était alors l’ennemie de l’Église catholique, et celle-ci ne doit nullement endosser la responsabilité de ses torts ; mais l’Inquisition même, ce bouc émissaire de toutes les iniquités d’Israël, ne saurait être ici mise en cause sans une insigne mauvaise foi. Les juges de Rouen ne se sont pas conformés le moins du monde, comme on l’a prétendu, à la procédure canonique* ; ils l’ont violée d’un bout à l’autre ; les vices de forme abondent dans le procès tout autant que les injustices du fond. Pierre Cauchon a positivement détourné l’inquisition de son but et de sa voie ordinaire. Les Anglais, qui avaient soif de leur proie, ne se donnèrent pas la peine d’exiger une sentence en règle ni de la prononcer eux-mêmes, et, par le fait, Jeanne a été jetée dans le bûcher sans qu’aucun jugement l’ait condamnée à ce supplice
.
* M. l’abbé Morel avait déjà rétabli la vérité sur ce point dans deux articles publiés par l’Univers en 1859.
Ainsi, l’Église en corps n’a jamais condamné ni brûlé Jeanne d’Arc, et le soi-disant tribunal ecclésiastique devant lequel on la traîna fut irrégulier dans ses opérations comme dans sa constitution même, car l’accusée ne se trouvait aucunement sous la juridiction de l’évêque de Beauvais.
Tout, dans cette monstrueuse comédie, est étranger à la véritable Église et contraire à sa jurisprudence ; l’Église proprement dite n’est intervenue que pour reconnaître et proclamer les rares mérites de la victime. Mais, en revanche, tout est le fait de ses plus perfides adversaires, c’est-à-dire des ancêtres directs de la Révolution. Silence donc aux laïcisateurs ! Silence aux dignes héritiers des bourreaux ! Qu’ils nous laissent en paix honorer nos morts et vénérer les martyrs qu’ils ont faits. Ils ont leur saintes ; qu’ils les gardent. Nous ne songeons pas à leur disputer la cendre de Mme Roland, ni même celle de Charlotte Corday, l’ange de l’assassinat : qu’ils nous abandonnent la mémoire de Jeanne d’Arc, l’ange de la délivrance nationale !
II. — La Fausse Jeanne d’Arc
Qui pourrait croire que, dans un temps où se produisent des travaux aussi approfondis que celui dont je viens de parler, à une époque où se dessine de tous les côtés et dans tous les camps un immense courant d’opinion en faveur de Jeanne d’Arc, il se trouve des écrivains assez hardis ou assez arriérés pour ressusciter si vieille supercherie de la fausse Pucelle et confondre volontairement la vierge de Domrémy avec l’aventurière connue sous le nom de Jeanne des Armoises ? Que des contemporains, que des gens qui pleuraient la disparition de l’héroïne et croyaient à tout moment la voir revenir, comme les vieux grognards de l’Empire attendaient le débarquement de l’exilé de Saint-Hélène, se soient laissés séduire par des vaines apparences, par une ressemblance étonnante, et se soient attachés un moment à la fortune de cet imposteur en jupons, passe encore : ils ignoraient comment la chose devait tourner ; le dénouement de la comédie ne les avait pas encore éclairés.
Mais qu’un homme vivant en plein dix-neuvième siècle, quand cette incroyable erreur a été reconnue depuis plus de quatre cents ans et tirée au clair, à plusieurs reprises, par la critique moderne, vienne la donner comme la vérité ; qu’il présente son paradoxe comme une découverte, au nom de la science et de l’érudition ; qu’il intitule bravement son livre la Fin d’une Légende, et que par cette légende il entende la vie authentique de la vraie Pucelle, attestée par les preuves matérielles les plus incontestables, telles que les pièces origina les ds ses deux procès et le témoignage de ses adversaires mêmes, voilà qui dépasse tout à fait l’imagination. Telle est pourtant la fantaisie que vient de se permettre M. Ernest Lesigne, un nouveau venu dans la carrière historique, cela se voit bien*.
* La Fin d’une légende, vie de Jeanne d’Arc (de 1409 à 1440), Paris, Bayle, 1889, in-12.
Parce que des parents ou des amis de Jeanne l’ont reconnue, par méprise, ou ont feint de la reconnaître, par calcul, dans la dame des Armoises, qui ne lui ressemblait, du reste, que physiquement ; parce que des bourgeois d’Orléans, imités par d’autres naïfs ou d’autres intéressés, ont rendu à cette intrigante des honneurs éphémères ; parce qu’il existe des textes, bien connus d’ailleurs, prouvant par le menu ces faits singuliers et d’autres semblables, cet apprenti, qui ne doute de rien, s’est figuré que la libératrice n’avait jamais été brûlée à Rouen, qu’elle s’était mariée, qu’elle avait traîné le reste de ses jours dans une obscurité, dans un abandon d’elle-même démentant à la fois son passé et sa mission ; et il a prétendu nous faire croire ces billevesées, osant parler, à propos de la très véridique et très glorieuse fin de l’innocente victime des Anglais, des Contes de la mère l’Oie !
M. Lesigne n’a oublié qu’une chose : c’est de s’enquérir de la suite des aventures de la fausse Pucelle. Il aurait appris, par des textes non moins connus et non moins authentiques, que cette femme, conduite malgré elle devant Charles VII et questionnée par lui, n’avait pu lui dire quel secret lui avait été révélé autrefois par Jeanne, qu’alors elle s’était jetée à ses pieds en confessant son imposture, et que toutes ses dupes avaient reconnu leur erreur. Il aurait encore découvert (mais ce détail est plus ignoré du public, ayant été récemment signalé d’après une lettre de rémission du roi René), qu’elle avait continué à exercer le métier des armes, qu’elle s’était fait mettre en prison, à Saumur, pour divers délits, mais principalement pour s’être fait appeler par longtemps Jehanne la Pucelle
, et qu’enfin, bannie de l’Anjou, elle avait été ensevelir ailleurs sa honte et ses remords*. Par conséquent, les deux Jeanne faisaient bien deux personnages différents ; nul ne s’y trompait plus, et rien n’autorise à confondre aujourd’hui, rétrospectivement, deux individualités que les actes contemporains ont soin de distinguer, qui n’ont en, d’ailleurs, ni le même nom ni la même vie, ni le même commencement ni la même fin.
* On trouve le récit détaillé de tous ces faits dans le Roi René, par M. Lecoy de La Marche, t. I, page 308 et suiv.
Il serait inutile d’entretenir plus longuement le lecteur de cette bizarre publication. Elle ne méritait d’être citée ici qu’à titre de curiosité, et pour montrer à quel point sont sujets à s’illusionner ceux qui abordent sans préparation suffisante les études historiques. Il est possible, en effet, que l’écrivain dont je parle soit de bonne foi, et alors il aurait simplement besoin de suivre quelque temps les cours de l’École des chartes. Mais il peut se faire aussi (et quelques-unes de ses expressions le donneraient à penser) que son ignorance apparente recouvre un parti pris de dénigrer les gloires les plus pures de la France chrétienne : dans ce cas, sa tentative serait sans excuse, et son état moral sans remède.
D’Assigny.
L’Univers 5 mai 1890
Encart publicitaire pour la Vraie Jeanne d’Arc en dernière page.
Liens (Retronews) : 5 mai, 6 mai, 8 mai, 10 mai.
Ailleurs :
- Le Figaro, 5 mai 1890 : ci-dessous.
- Le Monde, 5, 8 et 10 mai 1890 : Gallica, Gallica, Gallica
Gaume et Cie, éditeurs, 3, rue de l’Abbaye, Paris. La Vraie Jeanne d’Arc. La Pucelle devant l’Église de son temps. Documents nouveaux. Par le père J.-B-J. Ayroles, de la Compagnie de Jésus. Un volume in-4°, 15 francs.
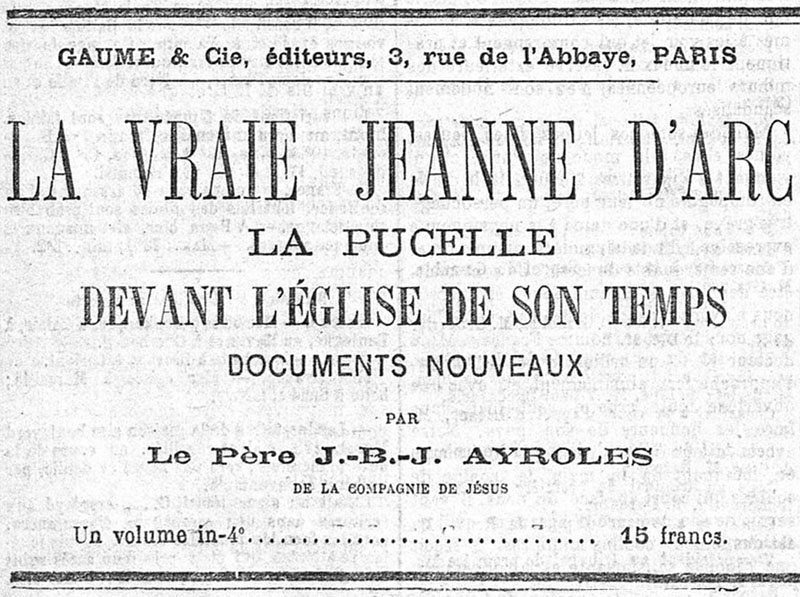
Le Figaro 5 mai 1890
Encart publicitaire pour la Vraie Jeanne d’Arc en dernière page.
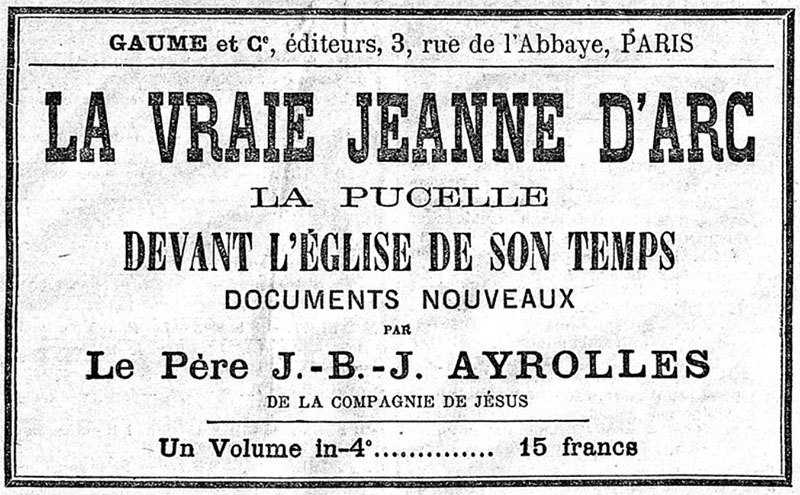
[La faute d’orthographe à Ayrolles
ne sera pas corrigée dans les éditions des 7 et 9 mai.]
L’Indépendant du Cher 6 mai 1890
Extrait de la Causerie littéraire de F. de Bruneval, sur les récents ouvrages consacrés à Jeanne d’Arc.
Liens : Retronews.
[Ouvrages passés en revue : La Piuzela d’Orthieux, édition d’un récit contemporain en langue romane de la mission de Jeanne d’Arc. — Mlle Foulques de Villaret, Identification des nom et surnom du page de Jeanne d’Arc. — Léo Taxil et l’abbé Paul Fesch, Le martyre de Jeanne d’Arc, nouvelle traduction du procès de condamnation, trop académique, partant un peu ennuyeux
.]
Un père jésuite, le R. P. Ayroles, a publié tout récemment un gros volume in-quarto sur le procès de Jeanne d’Arc. Celui-là n’est pas ennuyeux, tout en se jetant en plein dans les questions théologiques du procès. Nous reviendrons un de ces jours sur son remarquable ouvrage, un des monuments historiques les plus originaux de ce temps.
[Suit un compte-rendu de l’ouvrage du capitaine Paul Marin, Jeanne Darc tacticien et stratégiste.]
L’Autorité 8 mai 1890
Encart publicitaire.
L’Autorité est un quotidien bonapartiste fondé et dirigé par Paul de Cassagnac depuis 1886.
Liens : Retronews.
[Identique à ceux parus dans l’Univers et dans le Figaro.]
Revue catholique des institutions et du droit juin 1890
Analyse approfondie et dithyrambique de la Vraie Jeanne d’Arc par J-M.-A
, présentant le plan général de l’ouvrage et exposant ses idées principales, chapitre par chapitre.
Ce livre est donc remarquable à tous les points de vue. […] Nous voudrions reproduire quelques pages, quelques phrases au moins de l’auteur. Mais nous n’avons pu choisir dans tant de pages que nous voudrions donner, et nous avons dû renoncer à ces citations où nous n’aurions pu nous limiter.
Pierre Lanéry d’Arc lui reprochera cependant cette remarque (Livre d’Or, 1894, n° 1240) :
Quicherat, le premier, en 1840, a publié une partie des textes latins. Mais quelle utilité ces volumes ont-ils pour le public ?
Source : Revue catholique des institutions et du droit, 18e année, 1er semestre (janvier-juin 1890), 2e série, 4e volume, p. 531-543.
531La Vraie Jeanne d’Arc
I
Voici un maître-livre. Le récent ouvrage du Père Ayroles, paru depuis les premiers jours de mai, est grand pour l’Église, la France et l’histoire, sur laquelle il jette un jour éclatant pendant des temps restés assez obscurs ; il est grand pour notre libératrice, qu’il fait connaître merveilleusement, surtout par ce qu’en ont pensé, dit et écrit les hommes les plus remarquables, les savants les plus recommandables de son époque.
Le Père Ayroles nous avait, il y a quatre ans, exposé sa pensée dans son premier ouvrage intitulé Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France. Dieu nous montre dans la plus illustre des filles de France un signe national et vivant, et la conscience des peuples demande à l’Église 532de la proclamer Sainte. Le savant religieux, qui n’a cessé d’étudier la céleste Envoyée de 1429, a vu que, malgré sa popularité et l’affection dont notre siècle l’entoure de plus en plus, elle reste mal connue et qu’elle le sera tant que les sources de son histoire miraculeuse ne seront pas vulgarisées. Il y a trop de gens voulant tromper la France et le monde sur la Pucelle ; il y a trop de savants libres-penseurs, gallicans, faux-Français, qui cherchent à dénaturer, à cacher, à obscurcir cette merveilleuse épopée du XVe siècle, dont nul autre peuple que nous n’a vu la pareille. Le surnaturel offusque et blesse tant d’hommes ! Il ne faut pas s’étonner qu’on veuille le supprimer là où il est le plus éclatant. Depuis des siècles les hérésiarques ont épuisé leurs forces pour chercher à démontrer que Jésus-Christ était un simple philosophe. Ne soyons pas surpris que des escouades d’historiens aient entassé des volumes pour essayer de prouver que Jeanne d’Arc n’a jamais eu de mission divine.
Le Père Ayroles a donc commencé une œuvre considérable : publier les sources de l’histoire de Jeanne, de façon que le public, aussi bien que quelques savants privilégiés, puisse voir et juger la vraie Jeanne d’Arc.
Le magnifique volume, édité aujourd’hui par M. Gaume, ne sera, dans le plan de l’auteur et dans notre plus ferme espoir, que le premier d’une série de trois ou quatre : il forme toutefois à lui seul, un ouvrage complet et indépendant. Son titre, comme son vrai sujet, est : La Pucelle devant l’Église de de son temps.
On a exploité, contre Jeanne et contre l’Église, la poursuite et la condamnation de la Pucelle par un Évêque et un tribunal de prêtres. C’était l’Église
, s’écrient la libre-pensée et la fausse histoire. C’est ce qu’il faut savoir avant de le dire.
Nous disons, nous, qu’avant le livre du Père Ayroles, si les personnes instruites savaient fort bien à quoi s’en tenir sur ce point, le public pouvait l’ignorer absolument. Quels sont les hommes qui ont vendu, acheté, condamné et brûlé la Libératrice de la France ? Qu’étaient-ils ? Étaient-ils l’Église ? Qu’ont-ils fait et que faut-il penser d’eux ? Qu’est-ce que l’Église du XVe siècle, qu’est-ce que ses représentants 533les plus illustres et les seuls autorisés ont pensé et écrit de Jeanne ?
Le Père Ayroles, le premier, nous expose ces divers points, et ce, non pas par des hypothèses, des probabilités. Il nous donne la traduction complète ou résumée de tout ce qui a été écrit au XVe siècle par ces hommes illustres et revêtus d’autorité.
Le jeune prêtre, qui devait être le grand Cardinal de Poitiers, écrivait de Jeanne en 1844 :
Chose admirable et providentielle : l’événement le plus extraordinaire, le plus surnaturel qui figure dans les annales humaines, est en même temps le plus authentique et le plus incontestable. Ce n’est pas seulement la certitude historique, c’est la certitude juridique qui garantit jusqu’aux moindres détails de cette vie merveilleuse.
Ce sont plus de 120 témoins qui déposent en justice de ce qu’ils ont vu et entendu ! Ce sont des greffiers qui écrivent tous les détails de deux longs procès ! Ce sont des théologiens, des savants qui, consultés officiellement par le Pape et le Roi, exposent les faits dans des mémoires scientifiques et donnent les conclusions qu’il en faut tirer.
Il n’y a nul fait, au monde, aussi clair, aussi certain, aussi indubitablement établi que la vie entière de Jeanne, parce que nul fait n’a pour preuves des documents de cette espèce, aussi nombreux, aussi complets, aussi concordants, aussi autorisés.
Ce sont ces documents que le Père Ayroles vulgarise et fait connaître au public, qui, depuis cinq siècles, n’a pu encore les juger.
On ne peut comprendre un fait pareil. L’histoire de Jeanne est, à coup sûr, ce qu’il y a de plus extraordinaire, de plus merveilleux dans nos annales-françaises. C’est en même temps le fait qui nous intéresse le plus et celui qui est le mieux établi par des documents certains. Or, l’histoire qui a publié des monceaux d’études sur des points accessoires, n’a pas encore, depuis 1456, publié en langue vulgaire ces sources uniques. Quicherat, le premier, en 1840, a publié une partie des textes latins. Mais quelle utilité ces volumes ont-ils pour le public ? Ils ne contiennent qu’une partie des 534documents et en une langue inaccessible à la masse des lecteurs.
Le Père Ayroles a la pensée de publier tout cela, en français, pour le grand public, pour tous les lecteurs. Il ne veut pas s’attacher à la lettre, à la traduction stricte, qui a peu d’intérêt. Il veut donner le sens rigoureux, la substance, l’essence de tout. Les documents sont fort longs et se répètent souvent. Il n’en donne que le principal, ce qui a réellement de l’intérêt ; il est facile, avec les renvois, de recourir au texte si l’on veut approfondir quelque détail particulier.
Un exemple fera juger de l’utilité des documents que l’histoire vulgaire a laissés jusqu’à ce jour dans l’oubli. La question des révélations faites à la jeune fille est capitale et renferme toutes les autres. Quel historien l’a traitée ? Or, cette question est étudiée à fond dans les mémoires de théologiens que Quicherat a cru devoir négliger comme inutiles à l’histoire ! Elle ne l’est que dans ces documents.
II
L’œuvre du Père Ayroles est vaste. Il faut d’abord donner une idée de l’ensemble. Nous ne parlons que du volume publié.
Dès l’apparition de la Pucelle, en 1429, la chrétienté tout entière a observé avec admiration cette radieuse Envoyée qui, au nom du Roi des cieux, accomplissait en quelques mois de pareils miracles. Durant toute la période glorieuse, on écrivit sur la Pucelle en France, en Italie, en Allemagne. La traduction ou le résumé de ces divers écrits et l’histoire de leurs auteurs forment le Livre I.
Le livre II est consacré aux pseudo-théologiens bourreaux de Jeanne. L’Université de Paris, qui se donne toute aux ennemis de la France et du Pape, qui fut l’instrument le plus puissant des Anglais et du schisme, a joué là le rôle principal. Ce livre II est, à lui seul, un traité historique des plus remarquables, des plus saisissants et des plus nouveaux. Nous connaissons, peu de livre d’histoire aussi plein de faits et d’enseignements. Les plus instruits y apprendront bien 535des choses qu’ils ne soupçonnent pas sur l’histoire de la célèbre Université.
Le livre III expose les premiers travaux de la réhabilitation et en fait connaître les premiers ouvriers.
Le livre IV contient les mémoires d’évêques et de théologiens que M. Quicherat avait négligés comme inutiles.
Le livre V est consacré à la récapitulation ou mémoire que fit Jean Bréhal, lequel, en qualité d’inquisiteur, eut la part principale à la procédure de réhabilitation.
Le livre VI et dernier expose l’histoire du procès de réhabilitation, les travaux des délégués de Calixte III, le jugement, et enfin il contient un résumé de la situation de Jeanne d’Arc devant l’Église, depuis la sentence de réhabilitation, notamment à notre époque.
III
Telles sont les grandes divisions de l’ouvrage. Disons un mot de chaque partie.
Livre Ier. — Le premier chapitre traite des docteurs et de la sentence de Poitiers. Il montre la situation désespérée de Charles VII en 1429, les informations faites par les théologiens de Poitiers ; il fait connaître ces docteurs.
Les chapitres II et III sont consacrés aux traités de Gerson et de l’archevêque Jacques Gélu sur la Pucelle, au rôle de ces deux hommes, à leur caractère. Ce sont des pages historiques d’une haute valeur.
Vient ensuite, dans le chapitre IV, l’écrit découvert en 1883, le Breviarium historiale, œuvre d’un clerc français vivant à Rome sous Martin V. Cet écrit est de 1429 et des plus précieux.
Henri de Gorkum théologien allemand, et son écrit de 1429 sur la Pucelle, remplissent le chapitre V.
Le chapitre VI donne deux écrits de 1429, d’un clerc de Spire, dont le nom est resté ignoré.
Le chapitre VII expose l’opinion du clergé français resté fidèle au roi, en ce qui concerne la Pucelle. Cette opinion est énergiquement exprimée dans des prières qu’on récitait 536dans les églises, dès la fin de mai 1430, pour la délivrance de la prisonnière vendue aux Anglais. Là est commentée la lettre du chancelier Regnault de Chartres, qu’on a peine à comprendre après tout ce qu’avait vu ce prélat.
Livre II. — On connaît bien peu, même dans le public instruit, le rôle de l’Université de Paris à l’égard de la France et de la Papauté.
Son rôle pendant le grand schisme a été déplorable. Créée par le pape et le roi, elle a, au XIVe et au XVe siècles, trahi et abandonné l’un et l’autre pour suivre la voie de l’orgueil et de l’intérêt. Voulant opprimer et soumettre le Saint-Siège, en faire son instrument obéissant, elle a fait ou soutenu des antipapes. Prétendant régenter le roi, elle s’allia avec ceux qui détenaient le pouvoir et se fit la complice des pires révolutionnaires. Elle fit l’apologie de l’assassinat du duc d’Orléans, elle se mêla aux Cabochiens. Elle prit une grande part au honteux traité de Troyes, et se vendit corps et âme aux Anglais.
Cette Université qui, à d’autres époques, a donné des hommes remarquables à l’Église et à l’État, s’est faite, en ces temps troublés, l’ennemie de la France, de la monarchie nationale et du Pape ; elle s’est faite de même et par les mêmes raisons l’ennemie acharnée de Jeanne, et c’est elle en réalité qui a fait et soutenu le monstrueux procès de Rouen.
Plusieurs chapitres démontrent tout cela avec abondance et clarté.
Vient ensuite l’histoire des principaux bourreaux de la Pucelle : Cauchon, Thomas Courcelles, Érard, Beaupère, Midy, Jacques de Touraine. Gérard Feuillée, Pierre Maurice, d’Estivet, Loyseleur. Tous, lancés par l’Université de Paris, ont commis de véritables infamies, dignes des tribunaux criminels de la Terreur. Loin de représenter l’Église, ils n’étaient que des révoltés contre son autorité. Il faut voir dans ce livre les diverses lettres de l’Université au roi d’Angleterre, à Cauchon, au duc de Bourgogne ; on jugera de son esprit et de la part prise dans le crime de Rouen par le trop célèbre corps.
537C’est dans les chapitres V et VI qu’il faut lire quelle part l’Université prit au brigandage juridique de Rouen, et quels monstres furent les tortionnaires coupables du long martyre de Jeanne.
Le Père Ayroles montre ensuite (chap. VII) que l’Université, âme de ce qui s’était passé à Rouen, fut de même l’auteur principal du brigandage appelé quelquefois le concile de Bâle. Les meneurs de Bâle et de Rouen furent les mêmes hommes, des ennemis déclarés de Rome et de la France, les précurseurs de Luther et de toutes les impiétés qui ont suivi.
La Pucelle fut poursuivie, condamnée et martyrisée, malgré l’admiration de la chrétienté entière, par les mêmes hommes qui allaient tenter à Bâle de rouvrir le grand schisme, et prononcer contre le pape Eugène IV une condamnation semblable à celle qu’ils avaient infligée à la sainte libératrice de la France.
Toute cette partie de l’ouvrage est, on peut dire, la principale, puisqu’elle établit des faits peu connus et niés ou défigurés par toute une école. L’auteur l’a traitée magistralement et son exécution des coupables est sans recours. Nous appelons sur ce livre II l’attention de tous les lecteurs.
Livre III. — La réhabilitation ou plutôt les premiers travaux de cet acte de justice remplissent ce livre. L’auteur fait connaître en détail le mérite et les causes d’illustration des premiers ouvriers appelés à ce grand procès, et tout d’abord de Bouillé, mandataire de Charles VII. Il montre quels ouvriers d’imposture furent les Courcelles, les Érard, les Beaupère, les Loyseleur, qui, dès la mort de Jeanne, allèrent à Bâle répandre leurs calomnies sur la sainte fille qu’ils avaient assassinée juridiquement. Le mémoire de Bouillé est résumé en cinq chapitres des plus intéressants.
Charles VII n’avait pas perdu de temps. Entré à Rouen le 20 novembre 1449, il avait, le 15 février suivant, donné mission à Bouillé pour étudier l’affaire. Mais le roi ne pouvait lui-même casser un jugement ecclésiastique, et le pape seul avait autorité à cet égard. En 1451, le cardinal d’Estouteville 538arrivait en France, comme légat de Nicolas V, avec mission pour l’affaire, et de concert avec Jean Bréhal, inquisiteur général, il commença, le 2 mai 1452, la vaste enquête où tant de témoins furent entendus, et où tant de grands théologiens donnèrent leur avis, toujours en de longs et savants mémoires, que nous possédons et qui, à eux seuls, sont un monument incomparable pour établir la vérité sur la merveilleuse existence de notre libératrice.
L’âme de ce procès fut Bréhal, un grand dominicain qui, plus que tous autres, a contribué à étendre et à conserver cette procédure si précieuse.
Le P. Ayroles résume ou reproduit les premiers avis de théologiens, le sommaire de Paul Pontanus, le mémoire de Théodore de Lellis et celui de Robert Ciboule, le traité de Jean de Montigny. L’auteur a pris pour cela un parti excellent. Il donne la traduction exacte de toutes les parties essentielles de ces écrits, et il résume le reste, en indiquant toujours ce qui est traduit et ce qui est résumé. C’était le seul moyen de vulgariser ces documents inconnus du public et même des savants, et qui ont cependant un intérêt capital, aujourd’hui plus que jamais.
Livre IV. — Ce livre contient les mémoires de plusieurs savants évêques consultés sur la réhabilitation. On trouve le mémoire de Thomas Basin, évêque de Lisieux, d’Élie de Bourdeilles, un des plus saints prélats de France, de Martin Berruyer, évoque du Mans, de Jean Bochard, dit de Vaucelles, évêque d’Avranches.
Chacun de ces mémoires examine avec une science, une liberté et dans des détails extraordinaires les actes de la Pucelle, ses apparitions, ses prophéties, ses paroles. On ne peut comprendre, en lisant ces documents, comment Quicherat a pu croire et dire qu’ils étaient inutiles à l’histoire.
Livre V. — Ces mémoires ne furent pas les seuls composés pour la grande cause. Il y eut beaucoup d’avis de docteurs qui répondirent oralement. Il fallait présenter un ensemble des opinions ainsi recueillies, et la commission apostolique chargea de ce travail l’Inquisiteur Jean 539Bréhal. De là est née la Recollectio, ou récapitulation de Bréhal, le plus complet des mémoires apportés au procès. Ce mémoire, traduit ou résumé, remplit à lui seul le livre V.
On peut dire que l’ensemble de ces écrits constitue le plus admirable monument pour le procès actuellement ouvert à Rome sur la béatification de Jeanne. Il n’est pas de saint qui ait été étudié et jugé à fond par un ensemble aussi imposant de savants contemporains de sa vie. Les plus recommandables représentants de l’Église de son temps ont laissé, sur notre libératrice, des documents historiques, juridiques et théologiques qu’on ne peut comparer à aucun autre dossier.
Le plan du P. Ayroles est très logique, comme on le voit. Après avoir exposé l’œuvre des juges qui ont condamné Jeanne, il a révélé au public la valeur morale de ces hommes, leur vie, leurs actes. Il a ensuite exposé la vie, les actes et les écrits des docteurs qui ont provoqué la réhabilitation. Le lecteur peut juger sans peine cette grande cause nationale, où sont contenus en germe l’avenir et les conditions de grandeur de la France.
Livre VI. — On trouve dans ce livre le procès de réhabilitation, le jugement et des notices sur les juges.
Charles VII avait, nous l’avons vu, chargé Bouillé de chercher les éléments de la réhabilitation. Mais le Pape seul pouvait agir avec autorité, et il fallait en outre que la révision fût demandée par la famille de la victime, ce qui fut fait en 1455. Peu après cette demande, tous les docteurs consultés ayant répondu favorablement, Nicolas V et, après lui, Calixte III instituèrent la commission de jugement. Le rescrit pontifical révèle le respect préalable qu’on garde pour le jugement épiscopal de 1431.
Les commissaires n’ont agi qu’en vertu des pouvoirs à eux donnés par le Pape. C’étaient Jean Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, président, Guillaume Chartier, évêque de Paris, et Richard de Longueil, évoque de Coutances. Bréhal était inquisiteur et joint, en cette qualité, à la commission papale.
540Ce second procès est trois fois plus étendu que le premier, par suite des documents qu’il a occasionnés. L’historique de la requête présentée par la famille d’Arc est du plus, haut intérêt. Tous les actes de procédure démontrent, comme les mémoires, avec quel soin, quel respect de la vérité, ont procédé les commissaires apostoliques.
Les quatre enquêtes faites de 1451 à 1455 [1452 à 1456] sont des documents uniques, et ils forment la base de l’histoire de Jeanne d’Arc. Nulle histoire au monde, nulle biographie, ne peuvent se prévaloir de titres si respectables, et n’ont de semblables assises. Les 34 témoins entendus au lieu d’origine, et qui tous, déposent de ce qu’ils ont personnellement vu et entendu, constituent une histoire sans pareille de Jeanne jusqu’à son départ de Vaucouleurs. Tous les autres témoins (près de cent) disent de visu aussi, son histoire pendant les années 1429-1431.
Le chapitre VI, l’avant-dernier du livre VI, est comme une synthèse de l’ouvrage entier. Le P. Ayroles, en parcourant rapidement l’existence de Jeanne, montre quelle lumière ont jetée sur elle les mémoires théologiques. Ce chapitre est l’une des parties essentielles de son immense et splendide travail.
Le chapitre VIII et dernier est un aperçu de la vie posthume de la Pucelle à travers les âges. Pourquoi cet astre a-t-il paru voilé pendant quatre siècles ? pourquoi apparaît-il de nos temps, et non à une autre époque, avec un pareil éclat ? Le P. Ayroles a écrit, à ce sujet, quelques pages inspirées qui laisseront dans l’esprit et le cœur de tout lecteur catholique une bien vive impression. Nous ne pouvons pas en donner une idée suffisante, et nous renvoyons le lecteur à ce qu’a écrit le savant religieux dont le cœur est bien le plus catholique et le plus français qu’on puisse imaginer.
Le livre VII se compose de pièces justificatives, de documents, et de deux tables, l’une par ordre de matières, l’autre alphabétique, contenant les noms principaux et les faits essentiels dont il est fait mention dans l’ouvrage.
Enfin, des lettres et approbations de plusieurs évêques 541et la liste de souscripteurs ont été placées au commencement du volume, avant l’introduction.
Tel est ce grand travail. Le plan du P. Ayroles est de rendre au public français la Vraie Jeanne d’Arc, défigurée ou cachée jusqu’à nos temps par la libre-pensée, cette fille des faux docteurs de l’Université de Paris de 1431. Il nous montre aujourd’hui la Pucelle devant l’Église de son temps ; ce volume, bien que formant un ouvrage complet, n’est que le premier d’une série. Le prochain volume, que nous aurons peut-être à la fin de 1891, sera l’histoire vraie de la Paysanne et l’Inspirée. Les 17 premières années de Jeanne, toute son existence à Domrémy et à Vaucouleurs, les apparitions, les origines de sa mission, tout cela nous sera rendu d’après les témoignages entendus au XVe siècle.
L’éminent religieux a posé la première pierre de l’édifice qu’il a consacré à la libératrice. Cette pierre, assise sur la vérité, sur des documents sans pareils, est indestructible. Nous avons lu ce volume si considérable avec un intérêt et un charme qui ne font que croître à mesure que la vérité est déployée, et que la céleste figure de l’envoyée de Dieu apparaît plus vivante et plus radieuse. On assiste aujourd’hui comme à une renaissance, à une résurrection ou plutôt à une nouvelle apparition de Jeanne. Nul, autant que le P. Ayroles, n’a contribué à écarter d’elle les voiles qui la cachaient à la France. Les uns l’appellent une étoile découverte ; d’autres penseront que Dieu nous laisse voir une sainte dont une mission nouvelle correspond aux malheurs actuels de notre nation.
Mgr l’Évêque du Puy a exprimé avec une grande justesse, dans une lettre, la pensée et les impressions qu’inspirent les écrits du R. P. Ayroles sur Jeanne d’Arc.
On a beaucoup parlé, (dit Sa Grandeur), de la philosophie de l’histoire, et plusieurs se sont appliqués à en déterminer les lois, à en chercher la démonstration dans les faits concrets qui sont de son domaine. Le P. Ayroles a mieux fait, et en cela il a le mérite de la nouveauté, il a écrit la théologie de l’histoire. La grande idée que Bossuet avait appliquée à l’histoire universelle, le savant religieux l’a apportée dans ce grand épisode 542de notre vie historique où l’intervention de la Pucelle sauva notre patrie.
Cette appréciation, qui s’appliquait au livre précédent du R. P. Ayroles, est également exacte pour l’ouvrage actuel, qui, par la production de si nombreux et si importants documents inconnus du public, démontre la parfaite concordance de la théologie de l’histoire exposée par l’auteur avec les faits d’une existence aussi merveilleuse que juridiquement établie.
Un des grands caractères de ce livre est d’être substantiel, d’apprendre beaucoup, de révéler un nombre considérable de pièces, de faits, d’événements, de situations. Quelque étendu qu’il soit, il n’a pas une ligne inutile. Il fait au contraire désirer des renseignements nouveaux ; il fait penser, il ouvre des horizons.
Nous devons ajouter que l’éditeur a voulu que la forme de l’ouvrage répondît au fond. M. Gaume a fait un magnifique volume dont l’exécution typographique est des plus réussies. Ce livre est donc remarquable à tous les points de vue.
Nous voudrions, autrement que par une simple analyse et par l’expression de notre pensée, faire connaître ce grand ouvrage. Nous voudrions reproduire quelques pages, quelques phrases au moins de l’auteur. Mais nous n’avons pu choisir dans tant de pages que nous voudrions donner, et nous avons dû renoncer à ces citations où nous n’aurions pu nous limiter.
Nous ne doutons pas que toute la France catholique veuille lire cette œuvre qui explique et suit si bien le grand mouvement produit autour du nom de notre chère libératrice. Pourquoi ce nom, presque indifférent il y a encore quelques années, soulève-t-il à cette heure tant d’enthousiasme ? Demandez à la libre-pensée, qui, elle aussi, est si émue à ce nom, demandez-lui la raison de ce fait étrange ! Elle ne saurait vous répondre.
Mais cette réponse, le P. Ayroles vous la donnera, et si vous êtes déjà ému et enthousiasmé du nom de la Pucelle, vous le serez bien plus encore lorsque vous aurez vu et compris les raisons de cette impression. Vous vous rendrez compte alors de cette aurore qui apparaît à l’horizon, à une 543heure plus obscures de notre histoire, d’ans une crise qui laisse les plus fermes esprits dans une douloureuse incertitude sur l’avenir de la France.
J -M.-A
Études juin 1890
Long compte-rendu de la Vraie Jeanne d’Arc, par le père Étienne Cornut. Celui-ci insiste sur la publication des Mémoires des théologiens, négligés par Quicherat, publiés par Ayroles et explique en quoi ils éclairent certains points qui font débat (comme l’étendue de la mission de Jeanne).
En ce qui concerne la responsabilité de l’Université de Paris, le père Cornut est entièrement convaincu par la démonstration :
De vrai, jamais l’Université n’a reçu plus directement un coup plus grave, et les historiens à venir devront compter avec ces documents. Ils auront quelque peine à justifier leur cliente.
Source : Études religieuses, etc., 27e année, tome 50 (mai-août 1890), p. 177-193.
Jeanne d’Arc
La vogue est à Jeanne d’Arc ; ce mouvement des esprits. vers la bonne Lorraine n’est pas pour nous déplaire. C’est avec joie que nous voyons l’évêque de Domrémy et l’évêque de Vaucouleurs rivaliser d’activité pour élever des monuments à l’héroïne. De leur côté les érudits et les savants fouillent nos bibliothèques, et les textes qu’ils en tirent rendent plus belle et plus vivante cette originale figure de sainte et de guerrière.
Les littérateurs, biographes ou poètes, popularisent le nom de la Pucelle en multipliant les écrits où il rayonne. Des mains d’artiste, parfois des mains royales impriment ses traits sur la toile, sur le bronze et sur le marbre. Les voix les plus éloquentes prononcent son panégyrique, des panoramas font assister aux principales scènes de cette vie merveilleuse, et le théâtre, à l’affût des préoccupations et des préférences du public, cherche dans ce sujet éminemment national un succès bruyant et de bonnes recettes. Mais Sarah Bernhardt jouant Jeanne d’Arc nous paraît odieusement grotesque ; ceux qui l’applaudissent n’ont pas le sens de l’art et des convenances. La vierge eût écarté la comédienne avec le plat de sa chaste épée.
Les causes de cet enthousiasme sont évidentes et légitimes. C’est d’abord une angoisse instinctive. Malgré son insouciance, le pays songe encore, avec honte et remords, aux provinces perdues, au patriotisme qui meurt, aux divisions des partis, aux symptômes de décadence et de dissolution qui se montrent de toutes parts, enfin à l’extinction de cet esprit chevaleresque et chrétien qui a fait la force du passé et permis à la France de sortir des plus redoutables épreuves.
Au milieu de nos laideurs et de nos défaillances, la beauté de l’héroïne rayonne comme une aurore de jeunesse et de foi dans le souvenir d’un vieillard. N’est-ce pas aussi une lueur d’espérance ? Au quinzième siècle la France était déchirée, vaincue et agonisante plus qu’aujourd’hui ; tout était perdu sans un miracle. Nous ne le méritons guère, sans doute, à juger par les apparences ; mais qui nous dit qu’il ne s’élève pas du fond de quelque solitude des prières capables de fléchir le cœur de Dieu ?
L’enthousiasme pour Jeanne d’Arc peut avoir ses illusions et ses dangers. Au lieu de mettre à profit les enseignements de cette divine histoire, on risque de se contenter d’une admiration stérile et de croire avoir fait assez pour la patrie en applaudissant la libératrice. Il faudrait imiter ses vertus chrétiennes. On risque aussi de défigurer la vérité pour la plier aux passions des partis. Le rationalisme ne veut voir dans la guerrière qu’une personnification de la patrie, une manifestation de l’esprit national, la réaction instinctive contre d’odieux envahisseurs ; les démocrates se servent de la fille du peuple pour déclamer contre la royauté et la noblesse ; les impies exploitent sa mort contre l’Église et le clergé. Pour tous ceux-là, quand on va au fond de leur phraséologie, Jeanne est une énigme que les contemporains n’ont pu comprendre et que la postérité renonce à expliquer. Les catholiques seuls ont le dernier mot de cette vie et de cette mission. Les vertus, les exploits, les succès, le martyre et la gloire de la Pucelle leur appartiennent ; qu’ils ne se les laissent point ravir.
I
Le livre récent du P. Ayroles a pour but de dégager et de faire resplendir à tous les regards la vraie Jeanne d’Arc, en projetant sur elle toutes les lumières de l’histoire et de la théologie. Cette incomparable épopée y gagne en simplicité, en clarté et en grandeur. La Pucelle, que nous font connaître les docteurs scolastiques et que réhabilite l’Église de son temps, est à la fois plus humaine et plus céleste, plus ingénue et plus héroïque, plus émouvante surtout que les inventions qu’on voudrait lui substituer. Le latin barbare des procès est plus dramatique que la tragédie de Schiller, et l’histoire l’emporte sur la poésie.
Ce livre n’est pas une Vie de Jeanne d’Arc. On y suppose les principaux faits connus du lecteur. C’est avec raison. Qui ne retrouve dans sa mémoire ces attachants récits ? Ils débutent par les scènes de Domrémy où nous voyons la pieuse enfant grandir près de l’Église et souffrir de la grande pitié qui est au royaume de France
; puis, sur l’ordre réitéré de ses Voix, elle se rend à Vaucouleurs, à Chinon et à Poitiers. On l’examine avec défiance, et sur l’avis unanime des sages le dauphin Charles se décide à l’employer.
Alors commence une campagne miraculeuse où l’étendard de Jeanne va de victoire en victoire, et dont les grandes étapes sont Orléans, Jargeau, Patay, Reims. La villageoise étonne les soldats, non seulement par sa dextérité à manier les chevaux les plus fougueux, mais par sa rapide intelligence de la tactique et des choses de la guerre. Toujours la première à l’attaque, la dernière à la retraite. Sa grâce virginale, le bon sens pittoresque de son langage, sa douceur pour les petites gens, par-dessus tout ses vertus de sainte, lui donnent un ascendant irrésistible. Elle bannit des camps le pillage, la luxure et le blasphème. Puis tout s’obscurcit, et cette course brillante se termine par la captivité de Compiègne.
Dans la prison se déroule un nouveau drame plus poignant et plus glorieux. Jeanne faisant face à ses juges, les déconcertant par la profondeur de ses réponses et la fierté de sa résistance, nous arrache plus de larmes et plus d’admiration que la guerrière entrant hardiment au milieu des Anglais. Les flammes du bûcher de Rouen l’illuminent d’un plus bel éclat que les cierges dont étincelait la vieille basilique de Saint-Rémi au jour du sacre.
Trois procès fameux se rattachent à cet ensemble d’événements familiers à tout Français à Poitiers, c’est le roi de France qui ouvre à Jeanne la carrière glorieuse ; à Rouen, c’est l’Université de Paris qui se fait bourreau ; vingt ans plus tard, c’est le Pape qui révise et casse l’inique sentence et réhabilite la Pucelle en face de l’Église et du monde. À chacun sa responsabilité.
Pendant longtemps l’histoire de Jeanne, qui devrait être le premier livre de lecture des jeunes Français, a été peu et mal connue. Grand-pitié, disait Pasquier dans ses Recherches, jamais personne ne secourut la France si à propos et si heureusement que cette pucelle, et jamais mémoire de femme ne fut si déchirée.
On verra pourquoi.
Notre siècle veut réparer cette ingratitude. Vers 1840, la Société de l’Histoire de France avait confié à Jules Quicherat le soin d’éditer le double procès. Il s’en acquitta avec zèle et science ; six [cinq] volumes parurent de 1840 à 1849. C’est un service inappréciable. Malheureusement le paléographe méconnut la valeur d’un grand nombre de Mémoires composés par les meilleurs théologiens et canonistes du temps, et annexés au procès de réhabilitation. Il se contenta donc d’en publier quelques fragments. Nous avions le droit de le déplorer, car ces traités placent la figure de Jeanne dans sa vraie lumière, le surnaturel
, et discutent avec beaucoup de profondeur les accusations dirigées contre elle.
C’est principalement cette lacune que le P. Ayroles s’est proposé de combler. Donner en entier le texte de tous ces Mémoires dans le latin original ou dans une traduction française, c’était s’adresser à un petit nombre de lecteurs instruits et courageux, mais écarter le grand public. L’auteur a pris un moyen terme il traduit les passages principaux et analyse fidèlement le reste, sans se priver de lumières venues d’ailleurs et parfois d’un bref commentaire. Son rêve serait de mettre à la portée de tous les sources de l’histoire et de dispenser les travailleurs à venir de compulser des monuments encore inédits, coûteux et rares, ou, ce qui est pis encore, des collections estimables, mais gâtées. par le naturalisme rationaliste.
II
On se figure aisément l’accueil que reçut Jeanne à Chinon. Tout semblait désespéré ; les Anglais étaient vainqueurs et maîtres ; personne n’obéissait au roi de Bourges, et ses officiers, comme La Trémouille, exploitaient sa faiblesse au profit de leurs vices et de leur cupidité. Quel secours pour une pareille détresse ! Des diplomates et de vieux capitaines pouvaient-ils s’abandonner à la conduite de cette paysanne de dix-huit ans qui ne savait A ni B
et n’avait jusque-là guidé que son troupeau ? Les clercs n’étaient pas les moins incrédules. La vie de Jeanne fut sévèrement scrutée par de savants personnages qui, tout en admettant la possibilité d’une mission et en la désirant, étaient plus portés à la méfiance qu’à la crédulité. Charles VII fut personnellement convaincu par la révélation d’un secret connu de lui seul et qui touchait probablement à la délicate question de sa naissance et à la légitimité de ses droits héréditaires à la couronne de France. Enfin la lumière se fit ; refuser plus longtemps les services de Jeanne eût été une injure à Dieu et une trahison contre la patrie. Le prince fit partir la jeune guerrière avec des compagnons de bonne renommée. L’un d’eux, le chevalier d’Aulon, lui rendra plus tard un magnifique témoignage : En sa présence et autour d’elle, dit-il, un calme et des pensées célestes remplissaient l’âme ; c’était comme un paradis.
[Citation qui n’est pas chez Ayroles.]
Le P. Ayroles donne d’intéressants détails sur ces premiers examinateurs de Chinon et de Poitiers. Tous proclamèrent qu’on ne trouvait rien dans la personne, les paroles, les actes et les promesses de la jeune fille, qui ne fût humilité, dévotion, chasteté, douceur et simplesse.
Le procès de condamnation est d’une importance souveraine. Ses actes, quoique rédigés par des ennemis sans scrupules et sans pitié, suffisent pour justifier l’accusée et faire éclater ses vertus héroïques. Le P. Ayroles, toujours appuyé sur les mémoires authentiques, le droit des gens et le droit canon, établit la nullité, l’illégalité et l’iniquité de la procédure ; il remet la plus lourde partie de ce crime sur les épaules des vrais coupables. Libres-penseurs et ignorants l’attribuent volontiers à l’Église ; rien n’est plus faux, et la probité historique la plus élémentaire en devra convenir : les vrais accusateurs, les vrais bourreaux de Jeanne d’Arc furent les théologiens de l’Université de Paris.
Jules Quicherat l’avait déjà dit :
L’idée de faire succomber Jeanne devant l’Église se produisit spontanément, non pas dans les conseils du gouvernement anglais, mais dans les conciliabules de l’Université.
M. Robillard de Beaurepaire écrit de son côté :
Le premier coup qui fut dirigé contre la Pucelle vint de l’Université, et par la rapidité avec laquelle il fut porté, on peut juger que cette corporation puissante n’avait point eu besoin d’être excitée par les menaces des Anglais, pas même par les exhortations de Cauchon, auquel, il faut bien le dire, quelques mois après, elle osa bien reprocher sa lenteur dans les négociations engagées pour obtenir la remise de la Pucelle.
Les insulaires n’eurent qu’à seconder ces fureurs et à solder les dépenses.
D’où venait cette animosité des théologiens prévaricateurs ? Des tendances anglaises et schismatiques de la majorité des docteurs parisiens. Ils en voulaient à Jeanne de heurter violemment et directement leur orgueil et leur intérêt, de vouloir anéantir du même coup, au nom du roi du ciel et en se réclamant du Pape, la domination anglaise et la réputation de l’Université. Parmi les noms à jamais flétris dans ce procès citons les suivants : Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, prélat diplomate et ambitieux ; Thomas de Courcelles, son bras droit et plus tard l’âme du brigandage de Bâle ; Érard, Nicolas Midi, qui résuma en douze articles les accusations contre Jeanne ; le promoteur d’Estivet et le dominicain Le Maître, représentant de l’Inquisition. Grâce au P. Ayroles, nous avons désormais sur chacun d’eux des renseignements précis qui amoindrissent singulièrement leur témoignage.
La Pucelle, trahie peut-être, était prisonnière de Jean de Luxembourg, duc de Ligny. Pierre Cauchon le décida par sophismes à la vendre aux Anglais. Les États de Normandie votèrent dix mille livres tournois pour ce payement. Elle valait bien cette rançon de roi !
C’était l’Université qui avait autorisé et poussé Cauchon à requérir la prisonnière pour lui faire son procès. A Rouen, tout se fait par elle ; ses hommes les plus en vue mènent tout, animent tout ; l’assassinat judiciaire s’exécute sous sa haute approbation. Qu’on n’objecte pas Gerson et le traité où il démontre la divinité de la mission de Jeanne, et où se trouvent ces remarquables paroles :
Un premier miracle n’amène pas toujours ce que les hommes en attendent. Aussi, ce qu’à Dieu ne plaise, quand même l’attente de la Pucelle et la nôtre seraient frustrées dans leurs espérances, il ne faudrait pas en conclure que ce qui a été accompli est l’œuvre du démon, ou ne vient pas de Dieu. Notre ingratitude, nos blasphèmes, une autre cause, pourraient faire que, par un secret mais juste jugement de Dieu, nous ne vissions pas la réalisation de tout ce que nous attendons. Puisse sa colère n’être pas provoquée sur nous et sa miséricorde faire tout aboutir à bien.
Gerson, resté Français, était alors détesté par ses confrères de Paris tout dévoués aux Bourguignons ; il n’avait échappé au massacre qu’en fuyant la capitale. Il est donc bien loin de représenter l’Université.
L’attitude de Jeanne devant ses juges démontre une assistance divine. A tout moment, elle déconcerte la mauvaise foi. Il y a là un mélange inexplicable d’inspiration et d’ignorance, de fierté et de timidité, de nature et de grâce.
Telle est la force de cette histoire, — dit Michelet, — telle sa tyrannie sur le cœur, sa puissance pour arracher les larmes ! Bien dite ou mal contée, que le lecteur soit jeune ou vieux, qu’il soit, tant qu’il voudra, affermi par l’expérience, endurci par la vie, elle le fera pleurer.
C’est surtout vrai de la captivité et de la mort. Êtes-vous en état de grâce ?
lui demande brutalement un de assesseurs. Si je ne suis pas en état de grâce, que Dieu m’y mette ; si j’y suis, que Dieu m’y conserve.
À cette réponse, les théologiens pâlissent. Celle qui l’a faite est une villageoise ; elle a dix-neuf ans, elle ne sait ni lire ni écrire, elle est à peine capable de réciter le Pater, l’Ave, le Credo : ils sentent passer le souffle de Dieu ! La plaisanterie et la rondeur militaire ne font point défaut. Au milieu de ces loups dévorants l’humble agneau ne se préoccupe guère que de sa pureté. C’est un spectacle d’une angélique candeur, auquel ses bourreaux ne comprennent rien.
Le but du P. Ayroles n’était pas de nous faire assister à ce drame émouvant, que nul poète ne rendra jamais dans sa naïve sublimité. Il s’attache à prouver, et il y réussit abondamment, que dans ce procès de condamnation tout fut entaché de nullité. M. J. Quicherat, dans ses Aperçus nouveaux, soutient que Pierre Cauchon avait observé les règles de la procédure ecclésiastique ; le contraire ressort de tous les Mémoires. Défaut de juridiction, juste récusation d’un juge qui est un ennemi mortel, tumulte dans l’assistance, passion et mauvais vouloir dans les interrogatoires, menace à quiconque montre quelque faveur pour l’accusée, défaut de tout conseil de défense, le sous-inquisiteur associé malgré lui et tardivement au juge provincial, abus évident de l’ignorance de la jeune fille : ce ne sont là que quelques-uns des vices de procédure qui seront relevés plus tard. On en a compté jusqu’à vingt-sept qui entraînent de plein droit la nullité.
Toutes les charges, hâtivement et perfidement résumées en douze articles, furent soumises à la Faculté de théologie de Paris, qui les frappa de censures et de peines terribles. On y reproche principalement à Jeanne ses visions et sa prétention à une mission divine, sa dévotion à saint Michel, à sainte Marguerite et à sainte Catherine, l’habitude de porter des armes et des habits d’homme, l’abus des prophéties, le signe secret donné au dauphin et son obstination à ne pas le révéler, la certitude où elle prétend être de son salut, l’amour du sang, la désobéissance à ses père et mère, l’impiété, le désespoir et la tentative de suicide qui en fut la suite, le refus de se remettre à la décision de l’Église militante, etc.
Ce qu’on voulait, c’était une rétractation infamante pour Charles VII ; l’idéal était de déshonorer et de discréditer avant de brûler. Un moment on crut y avoir réussi. Épuisée par la fatigue, brûlée par la fièvre, en proie aux ignobles tentatives des soldats qui la veillaient nuit et jour, épouvantée par le feu dont on la menaçait, privée des encouragements de ses protecteurs célestes, obsédée par les instances et les menaces des gens d’église, la pauvre enfant signa enfin une courte abjuration dont elle ne comprenait ni les termes ni la portée, et à laquelle on en substitua frauduleusement une plus longue et plus explicite. Les Anglais triomphaient sans que leur rage en fût diminuée. Mais le lendemain, tout avait changé ; Jeanne réconfortée par ses Voix, s’accusa de sa défaillance avec beaucoup d’humilité ; elle affirma avec plus d’énergie que jamais qu’elle croyait à la divinité de sa mission, qu’elle voulait vivre et mourir en bonne chrétienne
, et que Charles VII était vrai roi de France. Il ne restait plus qu’à la faire mourir.
Le mercredi 30 mai, frère Martin Ladvenu, qui lui avait déjà suggéré l’appel au Pape, vint de bonne heure la préparer au dernier sacrifice. On lui permit de communier, et le moine qui l’assista déclare que les expressions lui manquent pour rendre le céleste spectacle
dont il fut témoin lorsqu’il déposa le corps de Notre-Seigneur sur les lèvres de celle qui allait mourir. Sur le bûcher, la martyre fut si touchante et si sublime qu’elle attendrit les Anglais et les juges eux-mêmes. Dix mille hommes pleuraient en voyant dévorer par les flammes tant de jeunesse, de courage et de grâce. Jésus !
tel fut son dernier cri. Les bourreaux s’en allèrent tête basse, en murmurant : Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte !
Pierre Cauchon et ses assesseurs, un moment troublés, se mirent bientôt à l’œuvre pour tromper le monde, le Pape et la postérité sur le drame de Rouen ; mais la vérité devait être plus forte que leurs mensonges. L’Université, en particulier, a tout fait pour cacher son rôle et ne laisser apercevoir qu’une Jeanne d’Arc amoindrie. Le Journal d’un bourgeois de Paris, rédigé par l’universitaire Jean Chuffard, n’a pas d’autre but que de rabaisser la victime au profit des bourreaux, et ce système de dénigrement a duré jusqu’à la fin.
Quelques-uns trouveront probablement que les chapitres consacrés aux tentatives schismatiques de l’Université dans les conciles de Constance et de Bâle sont des hors-d’œuvre. Le P. Ayroles a cru qu’en dévoilant à fond ces hommes il infirmait leur témoignage. De vrai, jamais l’Université n’a reçu plus directement un coup plus grave, et les historiens à venir devront compter avec ces documents. Ils auront quelque peine à justifier leur cliente.
III
L’heure de la grande réparation devait sonner. Dieu n’avait pas fait cette merveille, peut-être unique dans l’histoire, pour que le souvenir en fût si tôt effacé ou perverti.
Charles VII, rendons-lui cette justice, fut le premier à proposer la réhabilitation de celle qui lui avait mis sur la tête la couronne de France. Une ordonnance datée de Rouen chargeait le docteur Bouillé d’étudier le procès de condamnation et d’en relever les vices. Dans un court mémoire, le judicieux théologien prélude à cette œuvre de patriotisme et d’équité. Mais le vrai procès ne commence que lorsque le Pape, à la sollicitation du cardinal d’Estouteville et à la requête de la mère et des frères de Jeanne, établit une commission, ayant à sa tête le dominicain Jean Bréhal, pour réviser le premier procès, selon toutes les formes et avec toutes les garanties de la jurisprudence canonique.
C’était évidemment une grave et difficile entreprise, car il y allait de l’honneur de hauts dignitaires, de la susceptibilité de corporations puissantes et de la rancune glaise. Elle fut menée à bonne fin avec une sagesse, une persévérance, une ampleur et une loyauté parfaites. C’est absolument à tort que J. Quicherat et d’autres après lui trouvent ce procès inférieur au premier et se plaignent qu’on n’ait pas appelé tous les témoins. La lumière a surabondé. Toutes les questions, toutes les objections, tous les faits ont été discutés selon la méthode un peu lourde, mais large et ferme du temps ; pas un grief n’est resté debout.
C’est à cette occasion que furent composés la plupart des Mémoires que le P. Ayroles traduit ou analyse. Leurs auteurs sont des personnages éminents par leur savoir, leurs vertus et leur situation dans l’Église ou dans l’État, comme le prouvent les notices érudites mises en tête de leur travail. Voici les noms de ces hommes de bien Paul Pontanus, Théodore de Lellis, Ciboule, Jean de Montigny, Thomas Basin, Élie de Bourdeilles, Martin Berruyer, Jean Bochard et surtout Jean Bréhal, dont la Récapitulation confirme, résume et complète tous les autres.
Beaucoup de ceux qui avaient connu la bergère de Domrémy, qui l’avaient suivie dans sa campagne de la Loire ou avaient été acteurs au premier procès, fournirent leur témoignage à la réhabilitation. Nous remarquons en particulier ceux du chevalier d’Aulon, écuyer de Jeanne, du duc d’Alençon, de Dunois, des courageux dominicains Pierre Isambart et Martin Ladvenu. Les procès-verbaux donnent les faits, les Mémoires en font la philosophie et la théologie. Après lecture de ces documents un peu diffus, mais pleins de savoir juridique et d’amour de la vérité, la Pucelle apparaît toute radieuse d’inspiration, de patriotisme et d’innocence. Pas l’ombre de superstition ou de vanité ; pas une tache sur son âme, pas une ombre sur son front, pas un nuage sur sa vie. Si la faiblesse humaine se montre, elle est bientôt généreusement surmontée ou réparée. Les larmes de l’héroïque vierge la rendent plus émouvante sans rien ôter de sa grandeur.
La question capitale, parce qu’elle domine toute cette vie et l’explique, c’est la réalité des apparitions surnaturelles, et par suite la divinité de la mission. Ne voir dans Jeanne d’Arc, comme le font Michelet, Henri Martin, J. Quicherat, Joseph Fabre et les écrivains rationalistes, qu’une paysanne au patriotisme surexcité, c’est lui enlever son auréole et arracher à la France le plus magnifique des hommages qui lui aient été rendus, puisqu’il vient de Dieu ; c’est chercher dans la folie ou la supercherie le secret d’une existence pleine de candeur et d’unité, car jamais bon sens ne fut plus lucide, imagination plus calme et tempérament mieux équilibré. Supposer que Jeanne a cru voir et entendre, de treize à dix-huit ans, ce qui n’existait pas, c’est se lancer dans un labyrinthe sans issue. Pour qui va au fond et ne se laisse pas tromper par les grands mots, il ne peut y avoir que trois hypothèses l’inspiration, l’hallucination ou la fourberie. Quiconque a parcouru les Mémoires n’hésitera pas.
L’âge de la voyante, l’heure des apparitions, le lieu, le mode et les effets sont soigneusement observés et discutés. Tout y est digne des saints et de Dieu. Jeanne, par sa pureté d’âme et de corps, par son humilité, sa discrétion, sa tendre piété envers la Vierge, par sa simplicité et son filial attachement à l’Église, méritait d’être préférée pour ces magnifiques confidences et cette prodigieuse destinée. Saint Michel n’est-il pas le patron et le protecteur de la France ? Un saint effroi d’abord, puis la confiance, le courage, une joie délicieuse, une familiarité pleine de respect et un mélange de clarté dans l’esprit et de force dans la volonté sont d’ailleurs les signes évidents de l’intervention angélique. La Providence ne saurait permettre qu’une âme aussi docile soit le jouet d’une illusion qui s’impose à tout un peuple et défie les règles de la prudence et du discernement.
Aux apparitions se rattachent les promesses et les prophéties de Jeanne. Elles présentent quelques difficultés spéciales qui ont tourmenté et déconcerté plusieurs historiens modernes, plus familiarisés avec la paléographie qu’avec la théologie. Les Mémoires donnent de solides et lumineuses solutions dont on n’avait pas toujours tiré tout le parti possible. Ils distinguent avec soin les prophéties fermes et absolues qui s’accomplissent toujours, puisqu’elles sont l’expression des arrêts irrévocables de la toute-puissance, et les prophéties conditionnelles et hypothétiques qui peuvent être entravées et empêchées, puisqu’elles dépendent, en définitive, de la liberté humaine. Notons encore avec soin que celui à qui le ciel fait une communication peut ne pas en comprendre la portée ni le sens ; il peut mêler, à son insu, ses pensées propres aux idées qui lui viennent d’en haut, surtout ajouter à la substance des révélations des circonstances et des interprétations purement humaines. Enfin l’inspiration est habituellement intermittente et ne supprime pas l’initiative naturelle. Il est parfois difficile de les démêler.
Rappelons quelques applications pratiques de ces principes. Jeanne, dès le début, annonce comme indubitables la délivrance d’Orléans et le sacre de Reims ; ce sont les signes de sa mission. La netteté absolue de ces promesses sur des faits aussi précis ne permettait aucune hésitation. Plus tard, dans sa prison, elle entendit encore ses Voix ; elles lui parlaient d’une délivrance glorieuse. Laquelle ? Sur ce point, la pauvre fille en était réduite aux conjectures. Jeune et confiante, elle espéra longtemps une liberté matérielle, à la suite de quelque fait d’armes ou de quelque mouvement populaire ; ce qu’elle avait vu lui permettait de ne pas hésiter devant un prodige. Mais en réalité, comme elle-même le comprit à la fin, il s’agissait du martyre qui devait lui faire échanger les misères de son cachot contre la gloire du paradis, la compagnie de ses geôliers contre la société de ses sœurs et de ses frères du ciel
, et enfin la rancune astucieuse de ses juges contre l’admiration et la vénération sympathiques de la postérité.
De même, Jeanne parle de temps en temps d’un merveilleux exploit qui devait ajouter au renom des Français et de toute la chrétienté. Est-ce un rêve de nouvelle croisade éclos spontanément dans son esprit chevaleresque, ou bien quelque bataille de Lépante que les péchés publics, les désordres des grands, l’indocilité des peuples et la mollesse de Charles VII ont fait ajourner, et dont l’Espagne a bénéficié plus de cent ans après ? Peu importe ; il ne faut jamais nier le soleil parce qu’il se couche ou se voile. Ces obscurités n’enlèvent rien à la clarté des prophéties absolues faites par la Pucelle et réalisées avec une exactitude qui est le sceau de la divinité.
Évidemment tout le procès était là. Ce n’était que pour la forme qu’on reprochait à la vierge guerrière d’avoir fui la maison paternelle, de porter des vêtements d’homme, d’être arrogante et d’avoir le goût du sang. Ses juges étaient parfaitement convaincus de son orthodoxie, et quelques mots équivoques, dont le mauvais vouloir pouvait abuser, ne les trompaient guère. Ce qui les irritait, ce qui les déconcertait, c’était de se trouver sans cesse en face du surnaturel, de la sainteté et du miracle. La fin répondait au commencement et au milieu dans cette vie sur laquelle flottaient à peine, comme des nuages imperceptibles, quelques défaillances héroïquement rachetées.
IV
Aux procès se rattache encore une question controversée entre catholiques et sur laquelle les Mémoires publiés par le P. Ayroles jettent une nouvelle lumière, pas aussi abondante qu’on le souhaiterait. La mission de Jeanne était-elle finie après le sacre du roi ? Si elle durait encore, en quoi consistait-elle ?
Beaucoup pensent qu’en sortant de Reims la Pucelle aurait dû revenir à Domrémy ; elle ne consentit à rester au milieu des soldats que pour obéir aux prières ou aux ordres de Charles VII et de ses capitaines, qui comprenaient de quel secours pouvait leur être sa présence pour enflammer les courages ; mais l’héroïne était persuadée que sa puissance surnaturelle n’existait plus. Peut-être même y mit-elle quelque vanité ; il est toujours pénible de rentrer dans l’ombre quand on a joué un rôle brillant.
Aux yeux du P. Ayroles, c’est là une erreur complète et les Mémoires doivent faire cesser. D’abord, on ne peut nier que Jeanne, après Reims, n’ait accompli de grandes choses dont une femme n’est pas capable sans une assistance surhumaine. Mais ce qui est plus décisif, c’est son témoignage. On doit la croire.
Jeanne avait un vague pressentiment de sa mort prochaine, et savait qu’elle durerait peu ; c’est pourquoi elle s’impatientait quand on hésitait à profiter d’elle
. La trahison lui apparaissait comme le grand danger de l’avenir. Le jour où elle entrait à Crépy avec Charles VII, le peuple accourut en foule à sa rencontre, en criant : Noël ! Tout émue de ces démonstrations, elle se retourne vers le chancelier et vers Dunois qui chevauchaient auprès d’elle :
— Voici un bon peuple, leur dit-elle, et je n’en ai pas encore vu qui se soit réjoui de si bon cœur de l’entrée du noble roi. Plût à Dieu que j’eusse le bonheur de finir ici mes jours, et de reposer dans cette terre !
Le chancelier l’interroge :
— Jeanne, où avez-vous l’espoir de mourir ?
— Où il plaira à Dieu, répond-elle ; je ne suis pas plus instruite que vous ne l’êtes vous-même du temps et du lieu de ma mort. Je voudrais bien qu’il plût à Dieu, mon créateur, de me faire déposer les armes, et de me ramener auprès de mon père et de ma mère, de mes frères et de ma sœur, qui tous auraient tant de bonheur à me revoir !
C’était donc pour accomplir la mission divine qu’elle ne croyait pas terminée, que la sainte fille immolait son désir le plus cher. Son cœur n’avait pas changé et nous reconnaissons bien celle qui disait en quittant les siens qu’elle préférerait être tirée à quatre chevaux
, plutôt que de les abandonner ; et à Robert de Baudricourt, surpris de la voir résolue à user ses pieds jusqu’aux genoux
pour être près du roi avant la mi-carême :
— J’aimerais mieux filer toute ma vie auprès de ma pauvre mère, car ce n’est pas là mon état ; mais il faut que j’aille et que je fasse mon œuvre, parce que mon Seigneur le veut ainsi.
On ne cite pas une seule parole où elle déclare son œuvre finie ; au contraire, dans ses lettres, dans ses conversations, dans sa prison et devant ses juges, elle se regarde toujours comme la messagère de Dieu. Si elle refuse de quitter ses habits d’homme, c’est, sans compter d’autres motifs plus intimes, parce qu’ils lui sont indispensables pour ce qui lui reste à faire et qu’elle n’y a pas été autorisée. Ses Voix continuent à lui parler ; elle ressuscite un enfant à Lagny. Nul autour d’elle ne pense que son rôle est fini. Aucun mémoire ne semble connaître cette conception injurieuse
.
Bréhal, qui la signale le premier, la repousse énergiquement, et son témoignage est considérable par la valeur de l’homme et par les termes avec lesquels il l’énonce. Il aurait été disposé à croire que les œuvres accomplies après la délivrance d’Orléans et le sacre du roi étaient surérogatoires, s’il n’était pas constant par les paroles de Jeanne, que dans la suite elle a continué à être toujours assistée par ses Voix
. Mais cette mission pouvait être entravée ; la Pucelle le fait entendre quand on lui reproche de n’avoir pas délivré le duc d’Orléans. Gerson avait prévu cette hypothèse et réfuté les conséquences défavorables que des théologiens peu logiques pourraient en tirer.
On fait surtout valoir la déposition de Dunois ; en voici le texte :
Bien que Jeanne ait parfois, en badinant, et pour animer les gens de guerre, parlé de faits d’armes et de beaucoup de choses concernant la guerre qui peut-être ne se sont pas réalisées, cependant, quand elle parlait sérieusement de la guerre, de son fait et de sa mission, elle n’affirmait jamais que deux choses : qu’elle était envoyée pour faire lever le siège d’Orléans…, et pour conduire le roi à Reims, pour le faire sacrer roi.
Il s’en faut que ces paroles soient décisives. Le loyal soldat avoue que Jeanne laissait au moins croire à la durée de sa mission ; il l’excuse par l’intention qu’il lui suppose. C’est être plus au fait des stratagèmes de guerre que des scrupules de la piété. Jeanne eût regardé, et non sans raison, comme une sorte de sacrilège d’user d’équivoque en matière si grave, car c’eût été manquer de respect à la Providence et faire mentir Dieu. Quand on accusera ses Voix de l’avoir trompée à propos de l’attaque de Paris, de Saint-Denis et de Compiègne, elle réclamera énergiquement et déclarera que tout a été fait ni contre, ni par leur conseil
. Elle était la droiture et la simplicité même.
On dira que Jeanne a pu s’abuser et prendre son désir pour une réalité, et la volonté de Charles VII pour un ordre du ciel. C’est revenir à la supercherie ou à l’hallucination.
Certes, si l’héroïne, par patriotisme et par déférence pour son roi, avait consenti à demeurer à la tête des troupes, s’en rapportant à la Providence générale pour son avenir, cette conduite mériterait encore des éloges ; mais elle réduirait aux proportions ordinaires cette période d’une vie toute surhumaine ; elle amoindrirait la beauté d’une mort qui fut un vrai martyre. Nous ne pouvons y croire sans y être forcés par des preuves explicites et contre les déclarations spontanées et suffisamment claires de la sainte fille.
Sans préciser, comme autrefois, en quoi consisterait à l’avenir sa mission, elle a toujours cru et proclamé que cette mission subsistait. Dieu lui cachait le but où il la conduisait et les chemins qu’il fallait suivre pour l’atteindre ; mais cette épreuve ne troubla pas sa foi et n’abattit pas son courage. Elle suppléait aux indications surnaturelles qui lui manquaient par les inspirations de son bon sens avisé et de son âme patriotique, ne promettant plus le succès infaillible, comme à l’assaut des Tournelles ou à la charge de Patay, mais cherchant à faire passer dans tous son courage et donnant au moins l’exemple.
En résumé tout porte à croire que Jeanne après Reims avait une double mission ; l’une, conditionnelle et nationale, dépendant de la conduite de Charles VII et de son peuple ; l’autre, absolue et personnelle. La première ne devait jamais se réaliser ; la seconde n’était autre que le martyre. Cette victoire plus douloureuse, plus pure et plus féconde que les autres, devait couronner sa vie et mettre à son front cette auréole de l’innocence immolée qui ravira toujours les louanges et l’amour des hommes. Tout ce qui lui a été promis s’est accompli elle a délivré Orléans, elle a conduit le dauphin à Reims et elle est morte en affirmant que les Anglais seraient chassés bientôt de toute la France, et qu’elle irait en paradis. Ainsi rien ne lui a manqué, ni la sainteté, ni la gloire, ni le succès, ni le malheur. Elle a pu s’écrier, dans le ravissement de sa reconnaissance, en face du bûcher : Non, mes Voix ne m’avaient point trompée !
Dieu s’entend mieux que les hommes à faire des chefs-d’œuvre. Qu’on essaye de se figurer une Jeanne d’Arc vieillissant en paix dans les soucis vulgaires d’un ménage à Domrémy, ou dans les honneurs princiers de la cour ! L’immolation du cloître ne semble même pas suffire à consacrer tant de gloire. Le martyre sur le Vieux-Marché de Rouen est le seul dénouement digne de cette merveilleuse et divine épopée. Plus on étudie la vie de la Pucelle, plus on se familiarise avec son histoire, sa langue et pour ainsi dire sa physionomie et son âme, plus cette conviction devient évidente et inébranlable.
Ô Dieu ! s’écriait Mgr Pie dans le plus beau panégyrique de la libératrice d’Orléans, ô Dieu ! dont les voies sont belles et les sentiers pacifiques, vous qui marchez par un chemin virginal, soyez béni d’être venu à notre aide par des mains si pures et si dignes de vous ! Soyez béni d’avoir fait Jeanne si belle, si sainte, si immaculée ! Je cherche en vain ce qui pourrait manquer à mon héroïne ; tous les dons divins s’accumulent sur sa tête ; pas une pierrerie à joindre à sa couronne.
Rien ne manque à Jeanne ; mais il nous manque, à nous, la joie de lui élever des autels, de l’invoquer publiquement et de voir briller sur son casque de vierge guerrière l’auréole que l’Église met au front des saints officiellement inscrits dans son martyrologe. Espérons que ce regret cessera. Le P. Ayroles est un de ceux qui auront le plus contribué à la réalisation de ce vœu cher à tout cœur chrétien et français.
Ét. Cornut.
Le Rappel 3 juin 1890
L’article s’inquiète de l’énergie déployée par le clergé français pour obtenir la canonisation de Jeanne d’Arc, attaque déguisée contre le régime républicain
(pour preuve, l’ouvrage Jeanne d’Arc sur les autels du père Ayroles). Il soutient l’initiative du Comité républicain de la fête civique de Jeanne d’Arc auprès du président Carnot, d’instaurer au plus vite une fête laïque (et obligatoire dans les écoles) en l’honneur de Jeanne d’Arc.
Le Rappel est un quotidien républicain fondé en 1869 par Victor Hugo, Henri Rochefort, Paul Meurice et alors dirigé par Auguste Vacquerie.
Liens : Retronews.
Jeanne d’Arc. — Tandis que le clergé essaie d’accaparer la mémoire de la grande martyre de 1431, et que M. Pagis, évêque de Verdun, entreprend une campagne à travers toute la France pour faire canoniser celle que brûlèrent les évêques, un comité républicain s’est formé à Paris sous là présidence du docteur Robinet, ancien maire du 6e arrondissement, pour honorer la mémoire de Jeanne d’Arc, comme il convient à la France républicaine, c’est-à-dire par une solennité purement civile.
Ce comité qui existe d’ailleurs depuis 1880 mais qui a été réorganisé en 1887, vient d’adresser au président de la République une lettre et un mémoire.
Dans ces deux documents qui se complètent l’un par l’autre, le comité expose à M. Carnot qu’il ne songe nullement à entraver M. de Verdun dans son action parallèle. Mais il estime que la France et son gouvernement ne peuvent accepter le patronage d’une manifestation que le clergé considère ouvertement comme dirigée contre le régime républicain.
La mémoire de Jeanne d’Arc sert en effet de prétexte. Un père jésuite. M. Ayroles, l’a dit presque textuellement dans une brochure : Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France, et l’évêque de Verdun lui-même a déclaré au pape qu’il s’agissait de régénérer la France abaissée en lui montrant Jeanne d’Arc.
Dans ces conditions, le comité espère que M. Carnot n’accordera pas un appui officiel à l’œuvre de M. de Verdun.
Mais la France a le cœur pénétré de gratitude pour Jeanne d’Arc. Elle demande de lui rendre un hommage décisif et de sauvegarder des témoins matériels de sa vie…
[Extrait de la lettre au président Carnot.]
En conséquence, le comité demande au gouvernement républicain de vouloir bien décréter que, dans toutes les écoles primaires de la République française, il y aura chaque année une fête de Jeanne d’Arc à l’anniversaire de son glorieux martyre !
Il propose, en outre, l’annexion au domaine public des restes du château de Vaucouleurs.
Nous ne pouvons que nous associer pleinement à ces vœux patriotiques.
[La supplique du Comité au président Carnot est publiée dans la Revue occidentale philosophique, sociale et politique (organe du positivisme), du premier semestre 1890, p. 228 et suiv. Lien : Google.]
Bibliographie de la France 14 juin 1890
Indexation du tome I de la Vraie Jeanne d’Arc.
Source : Journal général de l’imprimerie et de la librairie, 79e année, 2e série, tome 34, n° 24, 14 juin 1890, p. 354.
Lien : Google
5390. Ayroles (J. B. J.). — La Vraie Jeanne d’Arc. La Pucelle devant l’Église de son temps. Documents nouveaux ; par Jean-Baptiste-Joseph Ayroles, de la Compagnie de Jésus. Grand in-8°, 754 pages. Corbeil, imprim. Crété. Paris, libr. Gaume et Ce. 15 fr.
Le Monde 16 juin 1890
Compte-rendu fourni et élogieux de la Vraie Jeanne d’Arc, t. I, par Henri Dac, ouvrage inspiré par deux sentiments très dignes et très justes
:
Venger l’Église des attaques imméritées dont elle est chaque jour l’objet, et prouver par des documents irréfutables la mission divine et la sainteté de Jeanne d’Arc. J’ose affirmer qu’il a atteint victorieusement les deux buts qu’il s’était imposés.
C’est surtout sur le premier but que Dac s’étend. Il fallait prouver que ce n’est pas l’Église qui a pas brûlé Jeanne d’Arc.
Le P. Ayroles nous a rendu le service de nous prouver que [les juges de Rouen] n’étaient ni catholiques, ni Français.
Lien : Gallica
Voici encore un nouvel ouvrage sur Jeanne d’Arc. Le mouvement extraordinaire qui agite la France en faveur de l’héroïque Pucelle s’accentue de jour en jour. Et, chose à jamais remarquable, mais qui ne peut surprendre, c’est de l’Église catholique qu’il est sorti, qu’il sort avec le plus d’intensité. Des évêques font des croisades en l’honneur de Jeanne d’Arc, parcourant les villes et les hameaux, célébrant la grandeur et le sacrifice sublimes de la Pucelle, déclarant hautement que sa mission était divine et que le souvenir de cette mission doit être fixé sur notre sol par de patriotiques monuments. C’est Mgr de Verdun, dont on sait le zèle infatigable ; Mgr de Saint-Dié qui rivalise d’ardeur et d’enthousiasme avec son vénérable frère ; Mgr de Rouen, qui, lui aussi, fait appel au patriotisme et à la foi des fidèles. Et c’est justice.
Il est temps, — comme l’écrivait dernièrement Mgr Thomas, — il est temps de consacrer nos hommages et nos réparations à Jeanne d’Arc par des monuments dignes d’elle et dignes de nous. Pourquoi différer plus longtemps un hommage qui s’impose à tous les cœurs chrétiens en France ? Celle qui a sauvé notre pays à l’une des heures critiques de son histoire saura nous mériter, dans le péril de l’heure présente, de nouveaux miracles de miséricorde.
La France ne peut assez honorer Jeanne d’Arc. Elle a relégué trop longtemps la mémoire de la sainte jeune fille dans un injuste oubli. Elle aurait dû se souvenir qu’elle avait donné pour récompense à sa libératrice une prison et un bûcher. Elle a laissé jeter dans le fleuve les cendres de la martyre, comme s’il ne devait rester aucun vestige d’une vierge immortelle ! Il est vrai, et je rappelle ici un mot éloquent de Mgr Perraud, que,
dans leur rage aveugle, ses ennemis lui ont fait une sépulture qu’envieraient les conquérants les plus illustres. Les flots de l’Océan vont partout et Jeanne a un tombeau grand comme le monde.
L’Église s’est mise en tête de cette croisade pour la glorification de Jeanne d’Arc. Elle ne mérite pas le reproche d’oubli que nous pouvons adresser à nos pères, car, depuis le 8 mai 1429, elle n’a cessé de célébrer chaque année, par des cérémonies pompeuses et touchantes, la délivrance d’Orléans. Aux noms vénérables que je citais à l’instant, ne devons-nous pas ajouter ceux des orateurs sacrés qui sont Mgr Frayssinous, Mgr Parisis, Mgr Freppel, Mgr Le Courtier, Mgr Dupanloup, Mgr d’Hulst, Mgr Bougaud, Mgr Mermillod, Mgr Lagrange, Mgr Besson, le Père Monsabré, et cent autres, lesquels ont dit et redit en paroles admirables les joies et les souffrances de la bonne Lorraine ?
Ce ne sont pas seulement des monuments de pierre, des œuvres d’art, des statues, des églises que le clergé français, dans sa piété et son patriotisme veut élever à Jeanne d’Arc. Il demande, il espère, il attend, avec une impatience respectueuse, une gloire,un honneur plus grands encore pour la pieuse et vertueuse Pucelle. Dès 1869, douze prélats avaient signé avec Mgr Dupanloup une Adresse à Pie IX pour implorer sa canonisation.
Ce n’est pas seulement Orléans et la France, — disaient-ils, — c’est le monde entier qui rend témoignage aux gestes de Dieu par Jeanne d’Arc, à la piété et au zèle de cette jeune vierge, à sa pureté, à l’abnégation infatigable avec laquelle elle a toujours accompli la volonté de Dieu, et enfin à la réputation de sainteté qui a couronné sa vie… Ce serait donner un nouveau titre de noblesse à ce peuple français qui a tout fait pour la religion et pour le siège de Pierre ; ce serait enfin honorer l’Église et égaler à l’ancien peuple le peuple nouveau,en mettant sur ses autels une sainte guerrière comparable aux Judith, aux Déborah et aux femmes fortes de l’ancienne alliance.
Mgr Coullié, successeur de Mgr Dupanloup, a considéré la cause de Jeanne d’Arc comme une des plus nobles parties de son héritage. Il l’a fait instruire dans un procès minutieux, il en a porté les pièces à Rome, et, il y a quatre ans, il entendait Léon XIII lui dire ces paroles solennelles, que le P. Ayroles a placées en tête de son livre :
Notre pressentiment personnel, c’est que Dieu daignera écouter les vœux qui intéressent la gloire de la France entière et surtout de la ville d’Orléans.
J’ai dit un livre
; je devrais dire plutôt un monument
, en parlant de l’ouvrage que le P. Ayroles a consacré, lui aussi, à la gloire de Jeanne d’Arc. Il l’a fait inspiré par deux sentiments très dignes et très justes : venger l’Église des attaques imméritées dont elle est chaque jour l’objet, et prouver par des documents irréfutables la mission divine et la sainteté de Jeanne d’Arc. J’ose affirmer qu’il a atteint victorieusement les deux buts qu’il s’était imposés. On ne saurait jamais trop s’élever contre ce sophisme, que je trouve résumé dans une note haineuse d’un de nos Immortels [Leconte de Lisle] :
Jeanne d’Arc, la bonne Lorraine au cœur héroïque, a été lâchement trahie par la Royauté et brûlée vive, comme sorcière, hérétique et relapse, par l’Église orthodoxe aux gages de l’ennemi national.
S’il est difficile de contester que Charles VII a eu l’indigne faiblesse d’abandonner la Pucelle à ses ennemis, il est facile de démontrer que les juges de la Pucelle ont, pour ainsi dire, dépouillé le caractère sacré dont ils étaient revêtus en se montrant aussi mauvais prêtres que mauvais Français. Je ne m’appesantirai pas longuement, en ce qui me concerne, sur un sujet que je crois avoir traité en partie dans un article paru à cette même place, en cette année, et intitulé : Jeanne d’Arc et la libre-pensée.
On nous jette sans cesse à la face le nom exécrable de l’évêque de Beauvais. Mais on néglige de dire que cet homme indigne s’était mis du parti bourguignon après la mort de Charles VI ; qu’il avait été chassé en 1429 de son siège épiscopal par las habitants eux-mêmes ; qu’il avait juré une haine implacable aux partisans de Charles VII et qu’il n’avait point pardonné à Jeanne d’Arc le soulèvement de Beauvais, dont elle avait été la cause et lui la victime. Que ce juge impitoyable ait été un évêque, qu’est-ce que cela prouve ? C’est que c’était un mauvais évêque et — faut-il le redire pour la centième fois ! — une compagnie tout entière doit souffrir d’avoir dans ses rangs un membre indigne, mais elle ne peut être accusée de partager nécessairement son infamie. On oublie de rappeler encore que ce Pierre Cauchon avait vu saisir son temporel, sur les ordres de Charles VII ; que les Anglais, tenant à profiter de son ressentiment, avaient fait luire à ses yeux la promesse du siège archiépiscopal de Rouen, qui se trouvait vacant à cette époque. On se garde bien d’ajouter que l’ambition et la colère dirigèrent sa conduite, et non la conviction et la foi. Ce n’est pas comme évêque que Pierre Cauchon a instruit le procès et jugé la Pucelle, c’est comme homme politique. Voilà la vérité telle qu’elle sa dégage puissamment de l’œuvre si consciencieuse du P. Ayroles.
Mais ceux qui ont assisté l’évêque de Beauvais dans cet abominable procès de Rouen sont en grande partie des ecclésiastiques. — Je l’accorde, tout en faisant remarquer aussi que leurs vrais mobiles ont été la vengeance, la peur et la cupidité. D’ailleurs, est-ce qu’en sollicitant ou en acceptant une pareille tâche, ils n’étaient pas sortis d’eux-mêmes des rangs de l’Église ? N’avaient-ils pas menti à leur mission, qui est avant tout une mission de charité, de loyauté, de fraternel amour ? Et qui, je vous le demande, dans l’Église catholique les approuve, les soutient, les défend ? Qui les a jamais défendus ?… A-t-on attendu l’année 1889 et l’année 1890 pour réhabiliter la Pucelle, pour casser l’inique jugement de Rouen ? Quand on offense l’Église, comme le faisait tout à l’heure M. Leconte de Lisle, en l’accusant de s’être mise aux gages de l’ennemi national et d’avoir brûlé Jeanne d’Arc, confondant volontairement l’Église orthodoxe avec quelques ambitieux et quelques traîtres, pense-t-on à rappeler l’immortelle sentence de réhabilitation en date du 7 juillet 1456, rendue vingt-cinq ans après le martyre de la Pucelle ?… Non. Et c’est ce qu’on appelle discuter !
Mais, objecte-t-on encore, les juges ont conduit le procès suivant les règles mêmes de l’Inquisition.
Si cela était vrai, que signifieraient, je vous prie, le défaut d’information, le secret de certains interrogatoires, l’absence de défenseurs, le refus de recours au Pape, les omissions et les ratures faites sciemment dans les procès-verbaux ? Il est impossible de soutenir qu’il y ait eu là un procès régulier. Enfin, ceux qui l’ont dirigé en ont porté la peine. Est-ce que cela ne vous émeut pas de voir Pierre Cauchon, excommunié par Calixte IV [!], mourir subitement et ses restes déterrés, puis jetés à la voirie ; Nicolas Midi atteint de la lèpre, Loiseleur frappé également de mort subite, Jean d’Estivet noyé dans un égout ! Ces fins tragiques et méritées ne vous étonnent pas ? Et enfin ce Henri VI, roi de France et d’Angleterre, pour lequel on a brûlé Jeanne d’Arc, n’a-t-il point perdu ses deux couronnes ? N’a-t-il pas été trahi, abandonné et livré aux assassin ?… N’y a-t-il pas là vraiment la marque de la main de Dieu ? Mais on néglige tous ces faits et l’on va répétant la même accusation : c’est l’Église qui a brûlé Jeanne d’Arc, c’est l’Église qui est responsable !
Le P. Ayroles a fait justice de cette accusation, et dans une partie de son considérable travail — suivant moi la partie la plus neuve — il a montré que les juges de Jeanne d’Arc étaient aussi bien les ennemis de la Papauté que les ennemis de la Pucelle.
Le savant Quicherat affirme que l’idée de faire succomber Jeanne devant l’Église se produisit spontanément, non pas dans les conseils du gouvernement anglais, mais dans les conciliabules de l’Université. Les fonctionnaires laïques s’effacèrent. On ne vit paraître que des gens d’église.
Quels étaient ces juges ? Ils appartenaient à l’Université de Paris. Depuis cinquante ans, ils s’efforçaient d’annuler les prérogatives de la Papauté, et, comme on l’a vu au concile de Bâle, où dominait un de leurs chefs, Thomas Courcelles, ils auraient certainement fait subir à Eugène IV le sort de Jeanne d’Arc, si le pouvoir séculier leur eût prêté l’appui que leur avaient donné avec tant d’empressement Bedford, Glocester, Warwick et Winchester.
L’Université s’était rangée du parti de Robert de Genève ou le faux Clément VII, puis de celui de Pierre de Lune, le faux Benoît XIII. Se disant avec emphase le beau clair Soleil de France, voire même de toute la chrétienté
, elle refusait de reconnaître toute obédience, et, s’appuyant sur des antipapes qui cédaient à ses caprices, elle enseignait aux peuples le mépris de l’autorité pontificale. Elle cherchait à dominer Alexandre V et Jean XXIII et faisait de ce qu’on a nomme le grand schisme d’Occident son œuvre personnelle. Enfin Martin V devient seul pape ; les faux Grégoire XII et Jean XXIII reconnaissent sa légitime autorité.
L’Université, tout en n’abandonnant pas son idée de soumettre l’Église à l’État, se jette à corps perdu dans les agitations politiques. Elle avait eu dans son sein des apologistes pour le duc de Bourgogne, assassin du duc d’Orléans ; elle avait favorisé les démagogues cabochiens, partisans de Jean-Sans-Peur. Le P. Ayroles, se fondant sur les historiens spéciaux et sur des documents authentiques, l’accuse formellement d’avoir souscrit à tous les actes anti-nationaux qui permirent à la domination anglaise de devenir, pendant seize ans, maîtresse de Paris.
C’est ainsi qu’elle a fait assurer, par une députation, Bedford et Glocester, de sa fidélité au sang des Lancastre ; qu’elle a promis en février 1423 d’obéir à Bedford, régent de France, et de nuire de tout son pouvoir à Charles, qui se dit roi de francs, et à tout ses alités et complices ! Dans son histoire de la Pucelle, encore inédite, un des docteurs de l’Université, Richer, écrivait que l’Université était devenue toute anglaise et qu’elle avait rué la première pierre de scandale contre la Pucelle
. J’ai démontré plus haut quels sentiments anti-patriotiques animaient les Pierre Cauchon, les Thomas Courcelles, les Érard, les Nicolas Midi et autres.
Eh bien, les mêmes hommes qui, s’étant mis à la remorque de nos ennemis, ont vu que leur politique odieuse était anéantie par les succès d’Orléans et le sacre de Reims, ont naturellement témoigné à Jeanne d’Arc la haine dont ils étaient animés contre Charles VII et contre l’Église. Ils ont négocié activement pour faire remettre la Pucelle aux mains des Anglais, instruit son procès, ordonné sa mort dans des conditions iniques, et se sont montrés en même temps les adversaires acharnés de la Papauté. Cela était logique.
Le P. Ayroles nous a rendu le service de nous prouver qu’ils n’étaient ni catholiques, ni Français. Qu’on cesse donc d’accuser l’Église de la condamnation de Jeanne d’Arc ! Ce ne sont pas des gens d’Église qui en sont responsables, ce sont des rebelles à l’Église. Les actes du grand schisme, les actes du concile de Bâle l’ont victorieusement établi. C’est là que Thomas Courcelles, un des bourreaux de Jeanne d’Arc, a fulminé contre le Saint-Siège et ses prérogatives. C’est là qu’appuyé par l’Université, il a fait rendre un décret (25 juin 1439) qui déposait le pape Eugène IV, l’appelait démoniaque, parjure, incorrigible, schismatique — remarquez la corrélation de ces termes avec ceux de la sentence de Rouen ! — et déclarait qu’il fallait procéder à l’application des autres peines qu’Eugène IV avait encourues… Or, quelles étaient ces peines ? C’était la remise de l’hérétique obstiné au bras séculier, c’était le bûcher… La chrétienté se souleva contre cette sentence aussi ridicule qu’odieuse. Le concile de Bâle, toujours dirigé par les universitaires, nomma un pape, Félix V, qui devait être heureusement le dernier antipape. C’était Amédée VIII, duc de Savoie, qui avait consenti à jouer ce méchant rôle. Et, chose à noter dans toute cette affaire, l’Université de Paris composa des traités en sa faveur.
Mais le roi Charles VII s’interposa. Il força l’Université à abandonner l’antipape et s’employa à faire renoncer Félix V à ses prétendus pouvoirs. Un de ses négociateurs, en cette occasion, fut le célèbre Pierre de Versailles, qui s’était rangé parmi les défenseurs de la Pucelle. Le pape Martin V, qui avait succédé à Eugène IV, félicita Charles VII de son dévouement à la Papauté et de l’heureuse issue de son entreprise. Quelque temps après, le roi de France rentrait à Rouen, et chacun saluait son retour comme un prodige. La réhabilitation de Jeanne d’Arc allait être entreprise et la mémoire de la douce martyre allait être vengée. Le P. Ayroles a donc raison d’appeler les juges de la Pucelle des fratricides et des parricides. Ils ont aussi bien voulu la mort du pays et de sa libératrice que la chute du Saint-Siège. On a dit que Jeanne d’Arc, en répondant à ses juges, avait manifesté des sentiments de rébellion contre l’Église. Accusation ridicule. Elle a dit, un jour où on la tourmentait de mille questions insidieuses et perfides, — et c’est le mot qui résume toute cette histoire, c’est un soufflet appliqué sur la face de ses persécuteurs — Je m’en rapporte à Dieu et à notre Saint Père le Pape !
Le dossier qu’a élevé si laborieusement le P. Ayroles pourra donc, ainsi que l’a dit le cardinal Langénieux,
servir de fondement à une glorification plus haute que celle que Jeanne d’Arc a reçue de la France reconnaissante.
C’est la plus noble récompense que pouvait ambitionner l’auteur. Il faut le féliciter encore d’avoir établi, comme le remarque aussi Mgr de Cabrières, que
s’il y eut des clercs assez aveugles par le prestige du roi d’Angleterre pour calomnier avec lui le caractère et la vertu de la Pucelle d’Orléans, il y eut dans l’Église des hommes de foi, de science et du courage qui la défendirent contre les accusations ineptes et odieuses dont elle fut l’objet.
À ces divers titres, l’œuvre du P. Ayroles est une œuvre grandement méritoire. Si j’avais étudié le livre au point de vue littéraire, j’aurais eu peut-être quelques critiques à faire ; mais qu’importent de petites chicanes ? Ici le fond l’emporte sur la forme et l’on reconnaîtra avec moi que c’est le principal.
Henri Dac.
Revue bibliographique belge 30 juin 1890
Bref compte-rendu de la Vraie Jeanne d’Arc.
Source : Revue bibliographique belge, 2e année, n°6, 30 juin 1890 (Bruxelles), p. 228.
Lien : Retronews
Le P. Ayroles publie des documents ignorés de Quicherat ou méconnus par lui et qui complètent le dossier de l’héroïne de Domrémy. Ces pièces nous donnent l’avis longuement motivé de savants théologiens et canonistes qui, pour la plupart, ont connu Jeanne à Poitiers ou à Rouen.
Il est bien utile, — comme l’écrit à l’auteur Mgr l’évêque de Montpellier, — de faire voir que s’il y eut des clercs assez aveuglés par le prestige du roi d’Angleterre pour calomnier avec lui le caractère et la vertu de la Pucelle d’Orléans, il y eut aussi dans l’Église des hommes de foi, de science et de courage qui la défendirent contre les accusations ineptes et odieuses dont elle fut l’objet.
Nous trouvons dans l’important ouvrage du P. Ayroles la réfutation complète, en fait et en droit, de toutes les calomnies qui conduisirent Jeanne au bûcher.
Que de fois la pauvre fille en appela à Dieu et à N. S. Père le Pape. Les derniers chapitres de la Vraie Jeanne d’Arc font voir que, si Jeanne fut condamnée par des hommes haineux, devenus plus tard les auteurs du schisme de Bâle, la Papauté sut bien retrouver par centaines les témoins sincères de la vie innocente et sainte de l’héroïque jeune fille et faire proclamer l’iniquité d’un procès qui valut à la condamnée la couronne du martyre et à ses juges l’exécration de l’histoire.
J. J. D. S.
La Gazette 1er juillet 1890
Article de Pierre Lespinasse sur l’année de Jeanne d’Arc, qui cite le père Ayroles parmi les trois auteurs de livres à retenir.
Lien : Retronews
À propos de Jeanne d’Arc. — L’année 1890 pourrait s’appeler l’année de Jeanne d’Arc. L’Église, l’histoire, le théâtre et les arts ont accumulé les œuvres en l’honneur de la Pucelle.
Je ne cite que pour mémoire les prédications de Mgr Pagis, les livres de Blaze de Bury, du Père Ayroles et de M. Paul Marin, dont le dernier volume arrivait avant-hier à l’Institut.
Durant tout l’hiver, à la Porte Saint-Martin, Mme Sarah Bernhardt a pu à son gré vociférer, psalmodier ou murmurer les vers de Barbier sans lasser l’admiration des Parisiens.
À peine Mme Sarah Bernhardt a-t-elle d’un pied léger transporté Jeanne d’Arc en Angleterre, avec plus de désinvolture peut-être que de réflexion, que l’Hippodrome à grands frais monte une pantomime où se déroule en tableaux la vie de notre héroïne nationale. Mercredi a eu lieu la première représentation et le succès va aux nues. Hier enfin, Nancy était eu fête et célébrait la vierge lorraine. […]
Le Clairon du Lot 17 juillet 1890
Publication de la Vraie Jeanne d’Arc, par notre compatriote
le révérend père Ayroles.
Lien : Gallica
Bibliographie. — Le R. P. Ayroles, notre compatriote, dont le Clairon a, dans le temps, recommandé l’intéressant livre, Jeanne d’Arc sur les autels, vient de publier, à la même librairie (Gaume, éditeur, Paris, rue de l’Abbaye, 3), un nouveau volume : La vraie Jeanne d’Arc. — La Pucelle devant l’Église de son temps.
S. Ém. le cardinal Langénieux, archevêque de Reims, répondant à l’auteur le 8 avril 1890, apprécie son ouvrage dans les termes suivants : [reproduction de la lettre d’approbation publiée en tête de l’ouvrage].
L’Univers 20 juillet 1890
Le journal publie deux lettres d’approbation :
- Lettre du cardinal Langénieux, archevêque de Reims (datée du 8 avril, déjà reproduite dans les approbations en tête du volume) ;
- Lettre de l’évêque de Rodez (datée du 8 juillet, différente du court message d’encouragement reproduit dans les approbation du volume, et daté du 18 février) ; il y dit avoir déjà lu certaines feuilles avant la publication, et annonce au père Ayroles sa visite au Puy. À noter que l’évêque avait déjà approuvé le premier ouvrage du père (lettre du 1er mars 1886).
Liens : Retronews.
La vraie Jeanne d’Arc. — En attendant que nous revenions au long, comme nous l’avons promis, sur le beau et précieux livre du P. Ayroles, nous donnons deux des lettres épiscopales que l’auteur a reçues. La première, celle de S. Ém. le cardinal Langénieux, se trouve en tête de la Vraie Jeanne d’Arc ; la seconde, celle de Mgr Bourret, le savant évêque de Rodez et de Vabres, est de date toute récente :
Lettre du cardinal Langénieux, archevêque de Reims
Reims, le 8 avril 1890.
Mon révérend Père,
Vous avez pensé avec raison que votre nouveau travail sur Jeanne d’Arc ne pouvait être que favorablement accueilli par un archevêque de Reims. Je l’ai parcouru avec la plus vif intérêt, et je vous félicite de l’avoir si heureusement traité.
Tous vos lecteurs admireront avec moi quelle patience vous avez apportée dans vos recherches, quelle sagacité dans le discernement des documents, quelle intelligence dans l’analyse que vous en avez faite.
Grâce à vous, des pièces ignorées de Quicherat et éditées çà et là depuis la publication de sa collection, d’autres encore non moins précieuses dues à vos investigations personnelles, compléteront le dossier de la pieuse héroïne et pourront servir de fondement à une glorification plus, haute que celle qu’elle a reçue de la France reconnaissante.
L’Église, qui a déjà réhabilité sa mémoire, lui réserve peut-être prochainement de plus grands honneurs.
Votre travail y aura contribué en fournissant tant de nouvelles preuves, non seulement de son innocence, mais encore de sa mission surnaturelle et de ses héroïques vertus ; et ce sera pour vous, mon révérend Père, la plus douce consolation et la meilleure récompense.
Recevez, mon révérend Père, avec mes félicitations sincères, l’assurance de mes meilleurs sentiments.
✝ B. M. Cardinal Langénieux,
archevêque de Reims.
Lettre de Mgr Bourret, évêque de Rodez
Rodez, le 8 juillet 1890.
Mon très cher Père,
Je vais arriver très prochainement au Puy, avec la grâce de Dieu ; mais je veux me faire précéder par cette lettre de remerciements, qui vous dira toute ma reconnaissance pour l’envoi de votre beau volume : La Vraie Jeanne d’Arc.
J’en avais déjà lu les feuilles quand vous l’imprimiez. Je les ai revues maintenant qu’elles forment un tout compact, et non seulement je n’ai rien à retirer aux bonnes impressions que ce bon travail m’avait faites, je n’ai au contraire qu’à vous redire combien je trouve cette étude bien menée, bien creusée, et surtout opportune.
Vous avez incontestablement mis en main de quiconque voudra l’étudier loyalement et sincèrement le dossier de la Pucelle, toutes les pièces de son procès ; il n’y aura plus désormais que la mauvaise foi qui puisse fausser cette grande mémoire, ou la logomachie de notre siècle qui veuille, comme on dit, la laïciser et en faire une sainte laïque.
Croyez-moi, mon très cher Père, votre bien dévoué en Notre-Seigneur,
✝ Ernest,
évêque de Rodez.
Le Clairon du Lot 20 juillet 1890
Bref compte-rendu de la Vraie Jeanne d’Arc.
Terminons en apprenant à ceux de nos lecteurs qui l’ignorent que le P. Ayroles est le savant frère du digne et vénéré curé de Saint-Urcisse.
Lien : Gallica
La Pucelle devant l’Église de son temps, par le R. P. Ayroles. — Nous donnions, il y a quelques jours [le 13 juillet], la lettre de S. Ém. le cardinal Langénieux, archevêque de Reims, au R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, au sujet de son dernier ouvrage.
L’auteur de la Pucelle devant l’Église de son temps, est un Jésuite érudit que la noble cause de Jeanne d’Arc a passionnément occupé.
Son livre est un coup droit porté aux théologiens de l’Université de Paris, qui furent les accusateurs et les bourreaux de l’héroïne de Domrémy et la firent condamner par un tribunal qui viola outrageusement les règles de la procédure ecclésiastique.
Ce n’est pas une vie de Jeanne d’Arc qui a été écrite par le P. Ayroles, vie qu’il suppose connue de tous et dont les récits devraient être dans tous les souvenirs. Le savant Jésuite traduit les Mémoires ou bien les analyse, et de ce labeur sort une Jeanne d’Arc d’un aspect nouveau et vue sous son vrai jour. Ces Mémoires, peu mis en lumière jusqu’ici, sont les œuvres des plus savants théologiens et des canonistes les plus compétents de l’époque.
On a dit que le premier livre de lecture des jeunes Français devrait être l’histoire de celle qui fit du roi de Bourges, bafoué et trompé, le roi de France, respecté et fidèlement servi. Nous appuyant sur cette noble indication, nous recommandons à nos lecteurs la Pucelle devant l’Église de son temps, considérant que, même dans la bibliothèque de ceux qui ne sont que patriotes, elle ne sera pas déplacée à côté des Récits du général Ambert et de la Vie du général de Sonis.
Terminons en apprenant à ceux de nos lecteurs qui l’ignorent que le P. Ayroles est le savant frère du digne et vénéré curé de Saint-Urcisse, qui, modeste pour ses qualités personnelles, a le droit d’être fier de la science et de l’érudition de son frère.
J. M.
L’Univers 21 juillet 1890
Mention du père Ayroles dans un article de l’historien Lecoy de La Marche (alias d’Assigny) sur les cabochiens.
Liens : Retronews.
[…] M. Coville est plus heureux quand il nous montre certains officiers royaux, certains maîtres de l’Université en relations intimes avec les Cabochiens, et les résultats de ses recherches prennent les proportions d’une véritable révélation à propos de l’odieux personnage connu dans l’histoire sous le nom de Pierre Cauchon. Déjà le R. P. Ayroles, dans son dernier et très remarquable travail, dont j’ai entretenu récemment mes lecteurs, avait signalé ce qu’il y avait de bassesse dans l’âme de ce prévaricateur et de hontes dans sa carrière : c’était dire combien son jugement, dans le mémorable procès de Jeanne d’Arc, avait peu d’autorité et de valeur.
Revue des Deux Mondes 1er août 1890
Étude sur le Culte de Jeanne d’Arc, par le critique protestant Victor Cherbuliez (qui signe M. G. Valbert
).
Cherbuliez constate que deux Jeannes
s’opposent, celle des libres-penseurs, illustrée par Michelet, et celle des catholiques, telle que défendue par le père Ayroles.
Il réfute les premiers qui accusent l’Église d’avoir brûlé Jeanne en prenant à leur compte la sentence de Pierre Cauchon
; mais il rejette également la thèse du père Ayroles dans son gros livre un peu indigeste, mais fort instructif
, selon laquelle le procès de Jeanne d’Arc n’était pas seulement politique mais aussi doctrinal, Ayroles désignant comme principal responsable, avant même les Anglais, l’Université de Paris, mère du gallicanisme, lequel a enfanté les jansénistes, Luther, Calvin, Kant, Robespierre, la franc-maçonnerie et la libre-pensée
.
Puis il développe l’idée que Jeanne fut une sainte à part en cela qu’elle mit le spirituel au service du temporel : Elle n’a pas travaillé pour l’Église et sa mission fut toute temporelle ; et c’est là ce qui justifie ceux qui ne veulent lui rendre qu’un culte tout laïque.
Source : Revue des Deux Mondes, 60e année, 3e période, tome 100, p. 688-700.
Lien : Gallica
Telle est la force de cette histoire
, disait Michelet. […] Que dire
, s’écrie de son côté un jésuite, le révérend père Ayroles. […] C’est la destinée de cette incomparable créature de s’imposer à la commune admiration des croyants et des incroyants. […] Nombre d’histoires, longtemps accréditées, se sont évanouies dans la fumée d’une légende convaincue d’imposture ; la légende de Jeanne d’Arc s’est transformée en la plus réelle des histoires. […] Mais, s’il y a un demi-siècle déjà que nous la connaissons telle qu’elle fut, c’est depuis 1870 que son image est entrée dans tous les yeux, que son nom est dans toutes les bouches et que, chacun à sa façon, historiens, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens la glorifient à l’envi. Son supplice avait couronné sa gloire ; ce sont nos malheurs qui nous l’ont rendue si chère. […] Toutefois, sous cet accord apparent, les dissidences subsistent. À l’exception de quelques cerveaux malades, tout Français se croit tenu d’aimer et d’honorer celle qui a délivré la France ; mais les partis se la disputent ; chacun la réclame, la tire à lui, voudrait la confisquer. Il semble vraiment qu’il y ait eu deux Jeannes d’Arc.
[La première est la Jeanne républicaine, animée par ses seuls courage et patriotisme, l’autre est la Jeanne catholique, dont la mission est inspirée de Dieu.]
Chargez un philosophe de prononcer entre les deux partis qui se disputent cette adorable mémoire ; il dira, selon toute apparence, qu’ils compromettent l’un et l’autre par leurs exagérations la bonté de leur cause, qu’ils ont tous deux raison et que tous deux ils ont tort.
Les libres-penseurs qui désirent se mettre en règle avec leur conscience et admirer Jeanne tout à leur aise, sans scrupule, prennent à leur compte la sentence de Pierre Cauchon, son juge et son bourreau, et comme lui, ils la tiennent pour une schismatique, pour une hérétique, sur laquelle l’église n’a rien à prétendre. Quoi qu’ils en disent et malgré qu’ils en aient, cette plante avait crû dans le jardin de l’église du moyen âge ; elle en est un produit aussi naturel que les cathédrales de Reims et de Cologne, que les vierges et les anges de fra Angelico ou que le livre de l’Imitation. Dès son enfance, elle allait volontiers aux saints lieux. Elle se confessait souvent. Si elle soignait les malades, donnait aux pauvres, elle était aussi pieuse que charitable et rougissait quand on lui reprochait d’être trop dévote. Toute sa vie, elle eut le goût des pratiques, des observances, et comme une passion pour le son des cloches.
Les messagères célestes, à qui elle eut affaire, sainte Marguerite, sainte Catherine, étaient des saintes fort authentiques, et elles lui recommandaient de ne point négliger le service divin. Dans les horreurs des derniers jours, elles lui ont dit : Prends tout en gré, ne te chaille de ton martyre ; tu t’en viendras enfin en royaume de paradis.
Jamais personne n’eut l’imagination plus catholique. Jean de Metz et Bertrand de Poulengy, qui s’étaient offerts à Baudricourt pour la conduire à Charles VII et qui à travers mille hasards l’ont escortée de Vaucouleurs à Chinon, ont déclaré qu’auprès d’elle leurs sens recouvraient le calme et la pureté des jours de l’Éden
. Ce fut par la religion qu’elle eut prise sur les vieux brigands Armagnacs, dont elle fit de fidèles champions du royaume des lis. Elle leur commanda de quitter leurs filles de joie, et elle exigea qu’ils se confessassent. Dans la route, le long de la Loire, elle fit dresser un autel sous le ciel ; elle communia et ils communièrent.
— C’est l’Église qui l’a brûlée, dit-on. — N’en croyez rien, répond le révérend père jésuite dont j’ai parlé plus haut, c’est l’université de Paris, à laquelle Cauchon appartenait, et qui jadis avait choisi ce docteur très influent pour conservateur de ses privilèges. Cette thèse revient souvent, presque à chaque page, dans le gros livre un peu indigeste, mais fort instructif, que le père Ayroles vient de consacrer à Jeanne d’Arc ; on y trouve, avec quelques documents inédits, la traduction presque intégrale de mémoires dont Quicherat n’avait donné que la substance. Le père Ayroles hait passionnément l’université du XVe siècle ; il la tient pour la mère du gallicanisme, lequel a enfanté les jansénistes, Luther, Calvin, Kant, Robespierre, la franc-maçonnerie et la libre-pensée.
Le père Ayroles aurait mieux fait de répondre que le procès de Rouen fut tout politique. On ne peut nier que l’université de Paris n’ait considéré Jeanne comme un suppôt du diable, comme la fille de Bélial, de Satan et de Béhémoth
, et qu’elle n’ait poursuivi sa condamnation avec un implacable acharnement. Mais le dogmatisme n’était pour rien dans cette affaire. Ainsi que le peuple de Paris presque tout entier, l’université avait pris parti pour le Bourguignon et pour l’Angleterre, et en poursuivant Jeanne, dont les faits et dits condamnaient son choix, elle ne faisait que servir le maître qu’elle s’était donné. Les Anglais détestaient la Pucelle à ce point que, pour en avoir dit du bien, une femme fut brûlée vive. Chaque fois que les juges parurent mollir ou biaiser, ils coururent danger de mort ; on les prenait à la gorge, on leur criait : Prêtres, vous ne gagnez pas l’argent du roi !
et les épées sortaient du fourreau.
[S’ensuit une brève démonstration montrant que le procès a été orchestré par les Anglais, et que Jeanne n’était pas en conflit avec l’Église sur le plan doctrinal, comme en témoigne l’absence d’objections des juges de la réhabilitation à ses réponses lors du procès de condamnation. Cherbuliez observe néanmoins :]
Ne croit-on pas entendre, cent ans d’avance, le non possumus de Luther ? [… Mais] ne calomnions pas l’église du moyen âge ; si elle a commis de lourds péchés, elle a inspiré et des merveilles d’art et des folies de vaillance ou de tendresse. Elle travailla à sa manière pour la civilisation ; elle travailla aussi, moitié le voulant et le sachant, moitié malgré elle, pour la liberté de l’esprit, car il se fit de grandes choses en ce temps, et quand la liberté manque, il ne se fait rien de grand.
[Puis Cherbuliez développe l’idée que la spécificité de Jeanne est d’avoir subordonné le spirituel au temporel :]
Ce qui la distingue entre toutes [les autres saintes], c’est qu’elle n’a pas travaillé pour l’Église, que sa mission fut toute temporelle, et c’est là ce qui justifie ceux qui ne veulent lui rendre qu’un culte tout laïque. […]
Ses juges tentaient l’impossible en voulant la convaincre d’hérésie. Hérétique, elle ne le fut jamais ; je comprendrais mieux qu’ils l’eussent traitée de païenne. Dans l’antiquité grecque et romaine, le ciel était au service de la terre, les olympiens au service des cités. […] Les saints font des miracles ; elle n’en fit point et jamais elle ne voulut en faire ; […] elle en appelait à l’événement, et c’est sur l’événement qu’on l’a jugée, comme on juge les généraux et les hommes d’état. […] Ce qu’il y eut de miraculeux en elle, ce fut le souverain bon sens, sous un air de folie.
La Science catholique 15 août 1890
Bref compte-rendu de la Vraie Jeanne d’Arc dans le Bulletin d’histoire du chanoine Célestin Douais, en une section consacrée aux dernières publications sur Jeanne d’Arc.
Il termine par une légère critique :
On peut regretter seulement la querelle, à mon sens inutile, faite à Quicherat dans l’Introduction, et aussi certaines expressions trop vives pour flétrir la conduite de l’Université de Paris.
Dans son Introduction père Ayroles loue le travail de Quicherat : Au point de vue paléographique le choix était excellent.
Mais il lui reproche d’avoir retranché, par parti-pris idéologique, les traités théologiques : Les mémoires dédaignés ne méritent pas le mépris dont ils sont l’objet.
Source : La Science catholique : revue des questions religieuses, 4e année, n° 9, 15 août 1890, p. 603-604.
Lien : Gallica
Peu de temps après l’apparition de l’utile ouvrage de M. Lanéry d’Arc, le P. Ayroles, jésuite, mettait au jour un important volume qui, pour avoir suivi, en partie, les textes des Mémoires, ne fait pas double emploi avec eux. Le diligent auteur lui a donné pour titre : La vraie Jeanne d’Arc. La Pucelle devant l’Église de son temps. Documents nouveaux (gr. in-8°, Paris, Gaume, 1890, XVIII-754 pages). Les documents nouveaux
, ce sont les textes contenus dans les Mémoires, et des extraits de la correspondance de Jacques Gélu, archevêque d’Embrun, avec Charles VII, d’après l’Histoire des Alpes Maritimes, par le P. Marcellin Fournier, que M. l’abbé Guillaume va publier. Aussi bien, l’inédit n’est pas ce qui distingue l’œuvre du P. Ayroles. L’auteur s’est proposé, non de mettre au jour les mémoires et les consultations des canonistes et des théologiens du XVe siècle, mais d’offrir au public un résumé substantiel des écrits de ce genre, pour présenter la vraie Jeanne d’Arc dans l’auréole de surnaturel qui entoure sa tête, en effet. L’ouvrage se divise en six livres : Liv. Ier, Pendant la carrière glorieuse (Commission de Poitiers, traité de Gerson sur la Pucelle, écrits-de Jacques. Gélu, etc.) ; liv. II, Les pseudo-théologiens bourreaux de Jeanne, bourreaux de la papauté (L’université de Paris, Pierre Cauchon) ; liv. III, La réhabilitation entreprise. Premiers ouvriers et premiers travaux (Charles VII, Bouillé, le cardinal d’Estouteville, Paul Pontanus, Théodoric de Lellis, Robert Cybole, Jean de Montigny) ; liv. IV, Les Mémoires de quelques savants évêques (Basin, Élie de Bourdeilles, Martin Berruyer, Jean Bochard) ; liv. V, Récapitulation de Jean Bréhal ; liv. VI, La réhabilitation. Juges, procédure, sentence. Ces titres montrent quelle est l’économie de la publication, sans que j’aie besoin d’insister davantage. Elle me paraît donner une idée exacte de l’état de l’opinion sur Jeanne d’Arc parmi les canonistes et les théologiens du XVe siècle. On peut regretter seulement la querelle, à mon sens inutile, faite à Quicherat dans l’Introduction, et aussi certaines expressions trop vives pour flétrir la conduite de l’Université de Paris. À quoi bon ? Tout le monde reconnaît l’erreur de ceux qui firent condamner Jeanne d’Arc, et dont plusieurs étaient assurément de bonne foi.
Journal d’Indre-et-Loire 31 août 1890
Compte-rendu favorable de la Vraie Jeanne d’Arc, signé G. G.
.
Liens : Gallica.
Un livre vient de paraître qui est appelé à avoir, dans le monde religieux et savant, un retentissement considérable non pas seulement à cause des discussions passionnées qu’il ne manquera pas de soulever et des préjugés fortement établis dans certains esprits qu’il s’attache à redresser, mais encore et surtout par la grande vérité historique qui s’en dégage par la haute théologie qui a inspiré son auteur, par le patriotisme enfin dont il est l’expression pare et désintéressée.
Tout a été dit sur Jeanne d’Arc, à ce qu’il semble. Les historiens, de tous les pays et de toutes les religions, ont esquissé la vie de la Messagère de Dieu
; tous, à l’exception de Voltaire, ont été saisis d’admiration devant la grandeur, l’innocence de celle qui est et restera la consolante et sublime image de la France malheureuse et vaincue relevée par la religion et la foi !
On a raconté son enfance, ses voix
, ses luttes, ses triomphes ; on a conté son martyre.
Son martyre surtout a été l’objet de nombreuses et savantes études. On en a donné les plus minutieux détails ; mais de tous les auteurs qui ont traité ce sujet, il en est peu, soit partialité libre-penseuse ou faute de documents précis, il en est peu qui aient saisi le véritable caractère de la situation.
En mettre en lumière les circonstances variées et tragiques, faire connaître les personnages qui y ont pris part, tel est le but que s’est proposé le R. P. Ayroles dans l’ouvrage qu’il vient de publier sous ce litre : La Vraie Jeanne d’Arc, et l’on peut dire qu’il l’a rempli au-delà de toute espérance.
Rassemblant un à un les documents connus du procès de la Libératrice de la France ; étudiant les unes après les autres les dispositions des témoins oculaires ; scrutant les mémoires de ceux des contemporains dont l’intégrité et l’autorité ne sauraient être mises en doute ; commentant les Gerson, Jacques Gélu, cardinal d’Estoutevilie, Élie Bourdeilles, Olivier de Longueil, Jean Bréhal, Théodore de Lellys, Juvénal des Ursins, Paul Pontanus, Guillaume Chartier et tant d’autres, les divers écrits des savants étrangers et français, le R. P. Ayroles a fait non seulement l’histoire du procès de Jeanne d’Arc, mais aussi l’histoire des premières années du siècle où elle vécut et mourut ; il démêle les intrigues si complexes de l’infernale machination dont la mort de Jeanne fut le résultat, dégage les responsabilités de chacun, mot en relief la noirceur d’âme des uns, les complicités, les acquiescements involontaires des autres : des Cauchon, des Thomas Courcelles, des Jacques de Touraine, des d’Estivet, des Loyseleur dont la conduite odieuse a été stigmatisée par la postérité.
L’œuvre du R. P. Ayroles est vaste. Il suffit d’en indiquer les divisions principales pour en faire saisir l’immense intérêt.
Dès l’apparition de la Pucelle, en 1429, la chrétienté tout entière a observé avec admiration cette radieuse Envoyée accomplissant en quelques mois de pareils miracles. Dorant toute la période glorieuse, on écrivit sur la Pucelle en France, en Italie, en Allemagne. La traduction ou le résumé de ces divers écrits et l’histoire de leurs auteurs forment le Livre I.
Le Livre II est consacré au pseudo-théologiens bourreaux de Jeanne. L’Université de Paris, qui se donne toute aux ennemis de la France et du Pape, qui fut l’instrument le plus puissant des Anglais et du schisme, a joué là le rôle principal. Ce livre II est, à lui seul, un traité historique des plus remarquables, des plus saisissants et des plus nouveaux.
Le livre III expose les premiers travaux de la réhabilitation et en fait connaître les premiers ouvriers.
Le livre IV contient les mémoires d’évêques et de théologiens que certains auteurs ont négligés comme inutiles.
Le livre V est consacré à la récapitulation ou mémoire que fît Jean Bréhal, lequel, en qualité d’inquisiteur, eut la part principale à la procédure de réhabilitation.
Le livre VI et dernier expose l’histoire du procès de réhabilitation, les travaux des délégués de Calixte III, le jugement, et enfin il contient un résumé de la situation de Jeanne d’Arc devant l’Église, depuis la sentence de réhabilitation, notamment à notre époque.
Ajoutons que le livre du R. P. Ayroles contient, sur le passage de la Pucelle en Touraine, à Chinon, des documents du plus haut intérêt de nature à piquer vivement la curiosité des lecteurs.
Cet ouvrage, où la science et la théologie, les aperçus et les critiques historiques se mêlent, forme une lecture instructive et attrayante à la fois qui se recommande à tous ceux qui, ne connaissant de Jeanne d’Arc que le côté humain
pour ainsi dire, ignorent le vrai caractère de sa mission ; quant aux fervents de la Vierge de Domrémy, il n’est nul besoin de le leur signaler. Ne l’ont ils pas tous déjà entre les mains ?
G. G.
L’Univers 1er septembre 1890
Mention du père Ayroles, qui fait autorité
, dans un long article sur le Pays de Jeanne d’Arc, signé D’Aulon
.
Liens : Retronews.
[…] Enfin, Bermont, d’après les documents les plus irrécusables et les auteurs les plus profonds, les plus savants, les plus longuement mûris dans l’étude de la délicate et sublime histoire de Jeanne d’Arc, auteurs parmi lesquels il faut surtout citer le R. P. Ayroles, qui fait autorité dans ces matières ardues et faciles cependant à une conscience droite et désintéressée, Bermont fut le lieu de délices de la Pucelle, le lieu où elle laissa au départ une partie de son cœur.
L’Univers 6 septembre 1890
Reproduction d’une lettre de félicitation du cardinal Desprez, archevêque de Toulouse, au père Ayroles.
Le cardinal le félicite particulièrement pour la publication des mémoires de la réhabilitation, puisqu’ils serviront à la béatification.
Car ces mêmes écrits qui ont montré l’iniquité du jugement de Rouen seront les meilleures preuves pour établir sa mission divine et la sublimité de ses vertus. Votre livre, en mettant en relief deux points de la vie de Jeanne d’Arc, aura, j’en suis persuadé, une vraie importance dans les informations canoniques de la Béatification.
Liens : Retronews.
La lettre suivante a été adressée par S. Ém. le cardinal Desprez, archevêque de Toulouse, au R. P. Ayrolles, le chevalier spirituel de Jeanne d’Arc, et qui a tant combattu pour sa cause depuis nombre d’années :
Archevêché de Toulouse,
Toulouse, le 24 juillet 1890.
Mon Révérend Père,
À tout prix il faut arracher notre admirable Jeanne d’Arc au rationalisme et à la libre pensée ; il faut montrer en elle la vierge divinement envoyée à la France pour la préserver de la ruine, et conserver à la défense de la foi la nation si justement appelée la fille aînée de l’Église. À cette œuvre, aussi patriotique que chrétienne, vous apportez un bien utile concours. Quiconque, dégagé des préjugés de l’incrédulité moderne, lira dans votre livre le jugement des docteurs appelés à réviser le procès de Jeanne d’Arc, restera convaincu de la divinité de sa mission ; il remerciera le Dieu des miséricordes du secours qu’il donna à notre misérable patrie sur le point de disparaître du rang des nations ; et, pour l’avenir, il se laissera aller à l’espérance : Qui nous a sauvés jadis du joug des Anglais, saura bien, quand son heure sera venue, nous arracher aux étreintes de la Révolution, fallût-il renouveler le miracle du quinzième siècle.
Les théologiens et les canonistes, dont vous analysez si consciencieusement les écrits, ne se préoccupaient que de justifier la vierge de Domrémy des fausses accusations qui avaient servi de base au monstrueux procès de Rouen. C’était une œuvre de réhabilitation entreprise et continuée au nom de la véritable Église et de l’autorité légitime du Siège apostolique, contre une sentence émanée d’un tribunal dépourvu de toute autorité canonique.
Et voilà que la divine Providence a voulu que le procès de réhabilitation devint la base la plus solide d’un procès de glorification suprême en faveur de l’héroïne d’Orléans. Car ces mêmes écrits qui ont montré l’iniquité du jugement de Rouen seront les meilleures preuves pour établir sa mission divine et la sublimité de ses vertus. Votre livre, en mettant en relief deux points de la vie de Jeanne d’Arc, aura, j’en suis persuadé, une vraie importance dans les informations canoniques de la Béatification.
Recevez , donc, mon Révérend Père, les félicitations que je joins à celles qui vous sont, déjà parvenues depuis la publication de votre ouvrage, et mes vœux pour que le brillant accueil qu’il a reçu du public savant et pieux soit le gage assuré d’un succès toujours croissant.
Veuillez, mon Révérend Père, agréer l’assurance de mes sentiments bien dévoués en Notre-Seigneur Jésus-Christ.
✝ Fl, cardinal Desprez,
archevêque de Toulouse.
L’Autorité 12 septembre 1890
Compte-rendu favorable de Jean Balva.
La Vraie Jeanne d’Arc est un livre que toutes les âmes pieuses, patriotes et sensées doivent s’empresser d’avoir dans leur bibliothèque.
Liens : Retronews.
La Vraie Jeanne d’Arc. — La bonne Lorraine conquiert de plus en plus la popularité qu’elle aurait dû posséder toujours sur cette terre de France qu’elle a tant aimée et qu’elle a sauvée de l’invasion et de la domination anglaises. Mais dans ces témoignages de la reconnaissance publique, la vérité a des droits qu’il ne faudrait pas méconnaître, comme l’a fait dernièrement le recteur universitaire du Nancy, dans une harangue qui a été un scandale et qui reste un mensonge historique.
Jeanne a été héroïne et patriote, mais en même temps elle a été une sainte qui a gardé, à travers les camps et dans sa prison, toutes les délicatesses de la vierge chrétienne et toutes les touchantes pratiques de la piété la plus ardente et la plus éclairée, sans ombre de superstition ou de respect humain. Le bon sens alerte et la foi vibrante allaient de pair chez la merveilleuse guerrière. Nier la divinité de son inspiration et la réalité de ses voix, c’est l’accuser brutalement de mensonge, de supercherie ou de folie pendant toute sa carrière et sur son bûcher, c’est se lancer dans l’inexplicable, l’absurde et l’odieux.
Jeanne a été monarchiste enthousiaste de la France et de son roi. Si le but final de sa mission était de bouter les Anglais hors de toute France
, le moyen principal fut de conduire le dauphin à Reims et d’assurer sur sa tête la couronne royale par le sacre.
Jeanne a été catholique très soumise, et devant ses juges en a plusieurs fois et hautement appelé au Pape de Rome. Ce n’est pas le clergé national, encore moins l’Église, qui l’ont condamnée à être brûlée vive, en violant toutes les formes canoniques ; elle fut victime d’un évêque ambitieux et surtout de la haine de l’Université, devenue anglaise de cœur. La royauté, le clergé de France et la papauté se sont unis pour réhabiliter la martyre, dès que cette grande réparation a été possible. La gloire de Jeanne d’Arc n’a jamais eu et n’a pas aujourd’hui de plus fidèle et de plus intelligent gardien que l’Église et le clergé français.
Toutes ces vérités sont mises en lumière et prouvées invinciblement par des pièces nouvelles et authentiques, traduites par le R. P. Ayroles dans son beau livre : La Pucelle devant l’Église de son temps, magnifiquement édité par Gaume et Ce.
Cet ouvrage remarquable et absolument composé pour la réhabilitation de Jeanne, fait connaître les noms et les œuvres des théologiens célèbres de tous les pays qui se sont spécialement occupés d’elle.
Il est divisé en six livres.
Le premier nous la montre pendant sa carrière glorieuse ; il nous conduit avec elle dans cette cour de Chinon, discréditée, où le dauphin Charles, arrivé au plus complet découragement, songeait à aller cacher sa honte en Castille ou en Écosse. Il était si ruiné qu’il manquait même du nécessaire et qu’il devait se priver de tout, ainsi que la reine, alors que ceux qui s’étaient imposés à son gouvernement dilapidaient les subsides fournis par les provinces fidèles.
Nous y voyons les grandes hésitations de Charles, qui trouvait ridicule de recevoir la fillette
; les nécessités pour lui de se couvrir d’autorités irréfragables ; les conseils de son confesseur Jacques Gélu et de tous les ecclésiastiques de grand renom ; les merveilles de la vie du Jeanne, sa piété. Vient ensuite l’opinion de ce même Gélu (évêque Gerson) [sens obscur ? Gerson n’était pas évêque et vivait à Lyon, Gélu était archevêque d’Embrun], qui, après avoir conseillé au roi une juste défiance, finit par avoir en la divinité de sa mission, la conviction la plus profonde.
Ce premier livre nous montre ce qu’était à cette époque l’Université de Paris et son rôle dans toute l’affaire de la Pucelle ; ce qu’elle fut durant les cinquante année qui précédèrent sa venue et durant les vingt années qui suivirent. Cet aperçu était nécessaire pour savoir à fond cette lamentable histoire, le vrai moyen de comprendre les mémoires de la réhabilitation et de se former une idée du procès de Rouen.
Le second livre est consacré aux pseudo-théologiens bourreaux de Jeanne, ennemis de la papauté.
Le procès même de condamnation fait retomber sur les docteurs parisiens cette formidable accusation.
Le premier coup qui fut dirigé contre la Pucelle vint de l’Université, dit M. Robillard de Beaurepaire avec la compétence qui lui appartient, dans ses Recherches sur le procès de condamnation de Jeanne d’Arc, et par la rapidité avec laquelle il fut porté, on peut juger que cette corporation puissante n’avait point eu besoin d’être excitée par les menaces des Anglais, pas même par les exhortations de Cauchon, auquel, il faut bien le dire, quelques mois après, elle osa bien reprocher sa lenteur dans les négociations engagées pour obtenir la remise de la Pucelle.
Le rôle des Anglais fut odieux, mais celui des théologiens prévaricateurs le fut encore plus.
C’est ce que l’auteur essaie de prouver dans le second livre de cet ouvrage.
Les quatre livres qui suivent sont consacrés à la réhabilitation.
Le troisième nous fait connaître les débuts, les premiers ouvriers, les premiers travaux de cette œuvre gigantesque. Car il était certain que la condamnation devait ébranler la foi à la mission de Jeanne. La calomnie, toujours si puissante, le devient bien plus lorsqu’elle se base sur des faits au-dessus de notre nature, et par eux-mêmes pas croyables. Que n’est-elle pas lorsqu’elle se présente sous couleur de chose jugée ; jugée par des hommes revêtus d’un caractère sacré, s’appuyant sur l’autorité de la première école du monde ? En effet, comment ne pas être ébranlé ? Les lettres du roi d’Angleterre, travestissant l’histoire de l’héroïne, avaient inondé la chrétienté.
L’assemblée de Bâle contribua à répandre l’imposture. L’imposture cependant, avec quelque appareil qu’elle fût ourdie et disséminée, n’obtint pas plein triomphe dans le parti français. On se souvient de l’histoire de cette aventurière qui, pendant quelque temps, se fit passer pour Jeanne échappée miraculeusement au bûcher, et trompa jusqu’aux frères de la Pucelle. Charles VII la démasqua en lui demandant l’objet de ces fameux secrets, qui vainquirent à Chinon sa résistance à la voir.
Dieu ne devait pas faire une merveille unique dans l’histoire pour que le souvenir en fût effacé ou perverti dans la suite des âges. Rome et les théologiens attachés à Rome devaient dissiper tant de ténèbres. Ce sont leurs travaux que le troisième livre fait principalement connaître.
Le quatrième livre est consacré aux mémoires de quelques savants évêques. Thomas Basin entre autres y détaille les vices de forme, la question de fond. Élie de Bourdeilles, dans son mémoire, admet la possibilité des apparitions et des révélations, il en indique la source. Martin Berruyer montre Jeanne dans ce qu’elle disait de sa mission, conduite par un esprit surhumain, il conclut à sa mission dirigée par le doigt de Dieu. Vient ensuite le mémoire de Jean Bochard, concluant à l’innocence du Jeanne.
Le cinquième livre est une récapitulatifs de ce qui précède, par Jean Bréhal.
Le livre sixième nous donne la procédure et la sentence de la réhabilitation de Jeanne.
La Vraie Jeanne d’Arc est un livre que toutes les âmes pieuses, patriotes et sensées doivent s’empresser d’avoir dans leur bibliothèque.
Jean Balva.
Revue des sciences ecclésiastiques septembre 1890
Compte-rendu élogieux du tome I de la Vraie Jeanne d’Arc, signé A. C.
, l’abbé Jean-Arthur Chollet, alors professeur de théologie à l’Université catholique de Lille, et futur évêque de Verdun (1910) puis de Cambrai (1913).
Chollet prend pour point de départ le discours du doyen de la Faculté des Lettres de Nancy, qu’il réfute en s’appuyant sur l’ouvrage du père Ayroles, qu’il conseille tant aux historiens qu’aux théologiens.
Est-il ouvrage plus opportun et qui vienne mieux à son heure ? Est-il une nation qui, plus que la France, ait besoin d’une rénovation morale ?
Source : Revue des sciences ecclésiastiques, volume 62, 1890, t. II, 9, p. 267-274.
Lien : Google
Discours d’Antonin Debidour, doyen de la Faculté des Lettres de Nancy, prononcé le 28 juin 1890 à l’inauguration de la statue équestre de Jeanne d’Arc par Frémiet, sur la place Lafayette à Nancy :
Lien : Google
Pieuse et noble fille…, l’étranger t’envie à la France. L’Église qui t’avait condamnée a dû à son tour s’incliner devant ton héroïsme. Sans doute, et malgré les efforts honorables de quelques-uns de ses membres, elle ne pourra jamais, sans infirmer ses immuables principes, te faire la réparation complète qui t’est due. Tu n’auras voulu reconnaître à aucune autorité sur la terre, pas même à celle que tu révérais le plus, le droit de juger ta mission. Ce n’est pas à nous de le regretter. Pas plus que toi, nous n’admettrons jamais qu’il y ait un tribunal en ce monde dont notre patriotisme soit justiciable. Tu n’en seras pas moins une sainte. Mais tu seras la sainte laïque de la France, la patronne toujours jeune, toujours chérie, d’une nation à qui ton souvenir et ton exemple assurent une éternelle jeunesse. Tu as été à la peine, tu seras à l’honneur ; et si chacun de nos cœurs est ton autel, chacun de nos soldats sera ton prêtre.
(M. Debidour, doyen de la faculté des lettres de Nancy, dans son discours prononcé en cette ville, lors des fêtes de Jeanne d’Arc, le 28 juin 1890. Voir l’Univers du 1er juillet.)
Une sainte laïque ! voilà certes une merveille que nous ignorions jusqu’ici. Voilà un mystère qui nous est révélé par un des grands prêtres de la religion destinée à produire les saintes laïques, — sans doute parce qu’elle en fera des névropathes et des hallucinées. Car, afin de mieux détailler la grandeur de ces saintes laïques, afin de démontrer leur supériorité sur les saintes de l’Église, sur nos saintes, il fait de Jeanne d’Arc, leur modèle et leur patronne, une hallucinée.
Oui, Jeanne d’Arc est une sainte laïque, parce qu’elle fut une malade, une visionnaire.
Écoutez plutôt :
Pour bien comprendre la vocation de Jeanne, il faut se reporter au temps de foi passionnée, presque maladive, où elle était née et où elle avait grandi. Les inspirés n’étaient pas rares, surtout dans le peuple, à une époque où les pauvres gens, proie impuissante d’un brigandage séculaire, abandonnés sans défense à tous les outrages de la guerre, opprimés par leurs seigneurs, délaissés par leurs rois, troublés dans leur conscience par le schisme de l’Église, cherchaient éperdument un secours ou tout au moins une consolation, n’en trouvaient pas sur la terre, tournaient avec une fixité morne et désespérée leurs regards vers le ciel, s’anéantissaient pour ainsi dire dans leurs rêves mystiques, et, le corps exténué par la misère, le jeûne, les macérations de toute sorte, se complaisaient dans cette exaltation nerveuse qui produit les extases et les visions. Les prédications des moines mendiants, surtout des franciscains, alors si populaires, entretenaient ces dispositions dans toute la France et principalement dans les provinces de l’Est. La piété devenait chaque jour plus ardente, plus suggestive.
Telles sont les prétentions rationalistes au sujet de Jeanne.
Prétention politique : Jeanne est une sainte laïque, qui, jusqu’au jour où elle est condamnée par l’Église, n’a rien à voir avec elle, et qui même aurait volontiers bataillé pour la séparation de l’Église et de l’État.
Prétention scientifique : Jeanne est une malade, une névropathe, une hallucinée qui devait à un corps exténué par la misère, le jeûne, et les macérations de toute sorte, cet état d’exaltation nerveuse qui produit les extases et les visions.
Ajoutez à cela une prétention philosophique et religieuse qui fait de Jeanne une illuminée, saluant, adorant au-dessus des idées de dévouement et de patriotisme, un Dieu, un Christ, un Jésus, qu’elle croyait l’ami, le protecteur, le vengeur de la France, dont elle se persuadait être l’envoyée, mais que la science moderne a rayé du nombre des réalités.
Aux yeux de la grande inspirée, dans son âme pleine de foi, dans son cœur plein d’amour, la France et Dieu ne se séparaient pas. On peut même dire qu’ils ne faisaient qu’un…. Ce Christ qu’elle regardait, qu’elle regarde toujours comme son seul maître et son seul juge, était pour elle, avant tout, l’ami, le protecteur, le vengeur de la France…. Elle en vint à croire qu’elle était l’agent choisi par lui pour l’affranchir et la régénérer. Et plus elle se sentait personnellement faible, ignorante, inconnue, plus elle se persuada que son dévouement lui était suggéré par Dieu même, qu’une force céleste la poussait, la rendrait invincible.
Suggestion donc et illuminisme. Création d’un esprit faible, ignorant et trop crédule. Le Dieu qui inspirait Jeanne, qui lui mettait au cœur une flamme si noble, un héroïsme si invincible, une vertu si éclatante, voici comment on nous le décrit :
Oui, certes, pieuse et noble fille, tes voix étaient de Dieu, si Dieu est cet idéal de justice, de dévouement, d’abnégation, que poursuivent les grandes âmes ; si connaître Dieu, c’est atteindre cet idéal ou seulement l’approcher ; si Dieu, c’est la foi créatrice qui donne une vie extérieure à nos pensées et à nos sentiments les plus intimes, l’inspiration souveraine qui nous fait comprendre, aimer et servir cet être abstrait, la patrie ; qui nous fait lutter sans fatigue, souffrir sans plainte, mourir sans regret : Vierge de Domrémy, bonne et grande Française, tes voix étaient de Dieu, elles ne t’ont pas trompée.
Une laïque, une névropathe, une illuminée, voilà tout ce que sait faire de la plus touchante et de la plus sainte figure de notre histoire nationale, un des dignitaires de cette Université qui, au XVe siècle, a le plus contribué au supplice de Jeanne. N’est-ce pas continuer ce supplice, ou plutôt faire subir à sa mémoire un outrage mille fois plus infâme que la torture infligée autrefois à son corps virginal par les adeptes de cette même Université ?
Et cependant il n’est peut-être pas dans l’histoire de figure plus lumineuse que celle de la grande Lorraine, de personnage plus étudié, plus fouillé par les innombrables discussions auxquelles furent soumis tous ses actes, de son vivant et depuis ; il n’en est pas sur lequel ceux qui savent, ceux qui sont sincères, se trouvent plus d’accord.
Chose admirable et providentielle. L’évènement le plus extraordinaire, le plus surnaturel qui figure dans les annales humaines est en même temps le plus authentique et le plus incontestable. Ce n’est pas seulement la certitude historique, c’est la certitude juridique qui garantit jusqu’aux moindres détails de cette vie merveilleuse.
(Mgr Pie, Panégyrique de Jeanne d’Arc, en 1844.)
Il suffit de lire le dernier et très bel ouvrage du R. P. Ayroles pour être convaincu de ce fait. Quiconque se donnera la satisfaction de parcourir les pages de ce superbe monument élevé à la plus méconnue des femmes
en sortira pénétré de la fausseté, de la mauvaise foi des prétentions du rationalisme moderne.
Jeanne, une sainte laïque ! Mais c’est là une erreur vieille de quatre siècles, et clairement réfutée dans les mémoires rédigés pour la réhabilitation de Jeanne par les hommes les plus sincères et les plus estimables.
Un des grands crimes de Jeanne, au dire de ses ennemis, ce serait, nous affirme le théologien Bouillé, d’avoir voulu, pour ses révélations et le vêtement viril, ne se soumettre au jugement ni de l’Église militante ni de quelque homme vivant que ce fût. Imposture, reprend Bouillé ; elle a demandé que ses actes et ses paroles fussent transmis au pape, auquel elle s’en rapporte, et à Dieu d’abord. Cependant, l’eût-elle fait, bien des motifs l’excuseraient. (Ayroles, I, 224.)
Cybole, Montigny, Basin, Bourdeilles, Berruyer, Bréhal, ne parlent pas autrement et nous montrent en Jeanne la plus humble soumission à l’Église, et dans les paroles de cette jeune paysanne sur l’Église, une orthodoxie qui tient du miracle.
Les apparitions de Jeanne, des hallucinations ! Mais c’est de toute son histoire le point le plus éclairci. Lorsqu’il s’agit d’apparitions, les théologiens doivent se montrer et se montrent toujours très incrédules. Il ne se laissent persuader que par l’évidence la plus complète. Or, une pléiade d’évêques et de théologiens ont vérifié, passé au crible les apparitions de Jeanne, et en ont démontré la vérité, le caractère surnaturel et divin.
Grâce au P. Ayroles, nous pouvons nous rendre compte du soin scrupuleux, j’allais dire exagéré, avec lequel ces hommes ont examiné et les personnages qui apparaissaient, et leur manière d’apparaître, et leurs paroles et conseils, et leurs bienfaisants effets dans l’âme de la voyante. Rien n’est mieux prouvé que la réalité de ces apparitions ; et si, après une pareille démonstration, il est encore légitime de les traiter d’hallucinations, il ne reste plus à nos rationalistes qu’à se demander si les actes mêmes de leurs sens ne méritent pas une semblable épithète.
Jeanne, une illuminée, parce qu’elle se persuada que toute autorité doit être soumise à Dieu et que toute nation doit obéir d’abord à Jésus-Christ, son Créateur et son Roi ! Oui, certes, cela, elle le croyait et l’affirmait hautement.
Un jour, la Pucelle demanda au roi de lui faire un présent. La prière fut agréée. Elle demanda alors comme don le royaume de France lui-même. Le roi, étonné, le lui donna après quelque hésitation, et la jeune fille l’accepta. Elle voulut même que l’acte en fût solennellement dressé et lu par les quatre secrétaires du roi. La charte rédigée et récitée à haute voix, le roi resta un peu ébahi lorsque la jeune fille, le montrant, dit à l’assistance : Voilà le plus pauvre chevalier de son royaume ! Après un peu de temps, en présence des mêmes notaires, disposant en maîtresse du royaume de France, elle le remit entre les mains de Dieu tout puissant. Puis, au bout de quelques autres moments, agissant au nom de Dieu, elle investit le roi Charles du royaume de France ; et de tout cela elle voulut qu’un acte solennel fût dressé par écrit. (Ayroles, I, 57 et 58.)
Quoi de plus sublime que cet acte, dans sa simplicité, dans sa naïveté ; et comme il montre bien que tout royaume et toute royauté vient de Dieu et n’est légitime qu’autant qu’il demeure sous sa haute dépendance. Vous serez lieutenant du Roi du ciel qui est Roi de France
, dit-elle à Charles. Elle le répète aux Anglais, au duc de Bourgogne, aux habitants de Troyes ; c’est la signification de son étendard.
Voilà la doctrine politique de Jeanne d’Arc ; telles sont ses idées sur l’origine de la souveraineté, sur l’exercice du pouvoir. Est-ce là de l’illuminisme ? N’est-ce pas plutôt la pure expression de la plus stricte vérité ?
Et si l’on veut à tout prix la proclamer sainte laïque, que l’on commence donc à embrasser ses idées politiques et à rattacher à sa source divine un pouvoir tombé dans l’athéisme et l’impiété.
Que nos modernes critiques et historiens lisent l’ouvrage du P. Ayroles. Ils trouveront à y apprendre. Ils y verront sous son vrai jour cette vierge simple et innocente, cette héroïque martyre, pleine de bon sens, de vérité, de piété, de tendre et humble soumission à son Dieu et à l’Église, d’énergique et inexprimable dévouement à son roi et à la France.
Que les Théologiens eux aussi entreprennent cette lecture. À la suite du R. P. Ayroles, qu’ils parcourent ces nombreux mémoires écrits en faveur de la Pucelle, et pour préparer sa réhabilitation ; qu’ils étudient la magistrale récapitulation de l’inquisiteur J. Bréhal.
Je ne sais rien de plus intéressant, de plus scientifique et de plus instructif que ces longues discussions des faits et gestes de la Pucelle ; que cette application des lois canoniques aux hommes et à la procédure qui l’envoyèrent au bûcher, comme aussi des principes théologiques à ses apparitions, à ses prophéties, à ses réponses sur l’Église. Il y a là un tableau admirable de la prudence, de la réserve, de la loyauté de l’autorité ecclésiastique, lorsque quelque fait surnaturel est soumis à son appréciation et à son jugement ; en même temps que les hommes qui jugèrent Jeanne y sont justement flétris, et la nullité de leur sentence clairement prouvée.
L’ouvrage est divisé en six livres :
Le livre premier fait connaître les hommes et les traités qui saluèrent l’apparition glorieuse de la Pucelle et affirmèrent le caractère surnaturel de sa mission.
Le second livre est consacré aux pseudo-théologiens, bourreaux de Jeanne. Il expose ce qu’ils furent dans l’Église et dans l’État et comment ils procédèrent vis-à-vis de la libératrice.
Les quatre suivants sont consacrés à la réhabilitation :
Le troisième fait connaître les débuts, les premiers ouvriers, les premiers travaux ; le quatrième est réservé aux mémoires de quelques évêques justement célèbres, que l’on trouve dans l’instrument du procès de réhabilitation ; le cinquième à la récapitulation que fit Bréhal des nombreuses consultations écrites ou orales qu’il avait pour la plupart provoquées ; le sixième présente l’histoire du procès de réhabilitation ; il dit ce que furent les délégués de Calixte III, leurs travaux, le sommaire de la procédure ; il relate la sentence et tire, pour l’histoire de Jeanne, quelques conclusions qui semblent acquises par les travaux précédents. Un rapide coup d’œil sur Jeanne devant l’Église depuis la réhabilitation, surtout de nos jours, termine le volume.
Est-il ouvrage plus opportun et qui vienne mieux à son heure ? Est-il une nation qui, plus que la France, ait besoin d’une rénovation morale ? Et quoi de plus propre à atteindre ce but que l’exposé des vertus patriotiques et de l’héroïsme chrétien de la plus française des chrétiennes et de la plus chrétienne des françaises ?
Et à l’heure où la haine de tout ce qui est saint vient arracher à leur cellule et à leur solitude laborieuse des centaines d’âmes destinées au sacerdoce pour les plonger dans la fournaise des passions soldatesques, dans la licence des casernes, était-il possible de donner à ces jeunes âmes effrayées et tremblant pour leur innocence, une plus puissante patronne ? Est-il pour elle un modèle plus approprié que Jeanne, la vierge soldat qui, jetée par sa mission au milieu des armées, y associa les victoires de la vertu aux succès des armes ; qui garda toujours dans le tumulte des camps sa piété modeste et calme ; qui sut faire goûter aux cœurs les plus endurcis et les plus rudes les charmes de la vertu et la paix de l’innocence ?
Le R. P. Ayroles ne pouvait écrire ni mieux ni plus à propos. Il nous reste à exprimer le vœu de pouvoir bientôt lire, en un volume pareillement élégant et soigné, la suite de son bel ouvrage et admirer, grâce à lui, la paysanne et l’inspirée
.
A. C.
Revue de Lille octobre 1890-janvier 1891
Étude en quatre parties : Jeanne d’Arc et la région du Nord, par le chanoine Louis Salembier. Nombreuses références à Ayroles, en notes de bas de page, dans le second article.
Source : Revue de Lille, 1e année, t. II (mai-octobre 1890), 2e année, t. III (novembre-janvier 1891).
Livraisons (Gallica) :
- octobre 1890, p. 624
- novembre 1890, p. 16
- décembre 1890, p. 113
- janvier 1891, p. 263
[T. II, p. 20, note :]
Quicherat, Procès, t. IV, page 202. — P. Ayroles, La Pucelle devant l’Église de son temps, p. 137.
Nous citons souvent ces deux collections, capitales quand il s’agit de Jeanne. Quicherat s’est donné le tort de vouloir jeter le discrédit sur le procès de réhabilitation. Aveugle par je ne sais quelles préventions, il a trop souvent préféré certaines citations d’huissier et certaines formalités juridiques du premier procès aux consultations théologiques du second. Le travail du P. Ayroles vient compléter heureusement les lacunes qu’avait laissées dans son ouvrage l’ancien directeur de l’École des Chartes. Tout en laissant à Quicherat son mérite de paléographe, il sera permis désormais de lui contester ces qualités de discernement, cet art de choisir les documents et même cet esprit d’impartialité qui font l’historien supérieur.
Revue Canadienne octobre 1890
Revue de presse des journaux française sur la Jeanne d’Arc sur les autels.
Source : Revue Canadienne, tome 26, (3e série, tome 3) Montréal, 1890, n° d’octobre 1890 (paraît le 15 du mois), p. 638-640.
Liens : Retronews.
Des lettres d’approbation et de félicitation de NN. SS. les évêques de Rodez, de Montpellier et de Clermont ; les jugements portés dans la presse catholique : les Institutions du Droit, la Gazette de France, l’Univers et la Croix, enfin la bénédiction que le Saint-Père a envoyée au R. P. Ayroles, expliquent le succès de son livre. En huit mois plus de 2.000 exemplaires se sont écoulés.
Mgr l’évêque de Rodez écrivait au R. P. Ayroles, le 1er mars :
En lisant votre livre… [Voir]
Impossible de mieux caractériser le livre ; c’est la théologie de l’histoire de Jeanne d’Arc. Cette théologie est belle ; elle inspirait à Mgr de Montpellier des lignes pleines de chaleur dont voici quelques-unes :
J’ai parcouru, une à une, toutes ces pages… [Voir]
Mgr Lebreton, évêque du Puy, atteint du mal qui devait le ravir à son diocèse, s’en rapportait à l’appréciation donnée par un des prêtres, qu’il déclare justement un des plus compétents de son diocèse, M. l’abbé Peyron.
Le docte aumônier du pensionnat de Notre-Dame de France, l’auteur du beau Mois historique de Notre-Dame du Puy, commençait ainsi l’éloquent compte-rendu du nouveau volume :
Voici un livre comme on n’en écrit plus aujourd’hui, tout vibrant de patriotisme et d’ardente foi et où l’histoire puisée à bonne source, la philosophie sociale et la plus saine mystique se sont alliées pour honorer et glorifier Jeanne d’Arc.
M. Albert Desplagnes, l’éloquent et docte magistrat, dont la république s’est à bon droit jugée indigne, écrivait dans la Revue des Institutions et du Droit
Le livre du R. P. Ayroles séduit et donne la conviction… [Voir]
La Gazette de France, écrivait à son tour :
Je ne saurais suffisamment exprimer le plaisir… [Voir]
Le grand organe de la presse catholique, l’Univers, n’a jamais perdu une occasion de recommander Jeanne d’Arc sur les autels. Un de ses plus anciens rédacteurs, écrivain distingué, fin et spirituel critique, et plus encore éminent théologien, dont Rome avait fait le consulteur de l’une de ses plus importantes congrégations, M. l’abbé Morel, lui consacrait cinq ou six colonnes. Après avoir peint à grands traits, les parties principales de ce grand drame, M. Morel conclut :
Le P. Ayroles a donc raison quand il dit… [Voir]
Les appréciations venues de Rome ont confirmé les jugements portés en France. Un des éminents religieux de la capitale du monde chrétien, le R. P. Cornoldi, S. J., directeur de la Civiltà Cattolica, qui avait bien voulu accepter de présenter un exemplaire au Saint-Père, et de lui en faire un résumé sommaire, écrivait à l’auteur :
Sa Sainteté a reçu le livre avec plaisir… [Voir]
L’Univers 17 octobre 1890
Article 1/2 de l’abbé Vincent Davin, qui part de la Vraie Jeanne d’Arc du père Ayroles pour développer sur la question du secret de Charles VII. (La suite dans l’édition du 20 octobre.)
Article assez indigeste et sans grand intérêt.
Liens : Retronews.
Variétés. — La vraie Jeanne d’Arc, la Pucelle devant l’Église de son temps, documents nouveaux, par Jean-Baptiste-Joseph Ayroles, de la Compagnie de Jésus. 1 volume grand in-8°, XVIII-754 pages, Paris, Gaume, 3, rue de l’Abbaye, 1890.
1er article
Un des événements les plus merveilleux de l’histoire du peuple de Dieu, à l’époque où il était opprimé par les Philistins, alors que les enfants d’Israël continuèrent à faire ce qui est mal aux yeux de Jéhovah, c’est sa délivrance par la main d’une mère de famille, prophétesse, disant avant la victoire au chef de l’armée, Barac, qui, malgré l’ordre de Dieu, ne veut pas marcher sans elle à l’ennemi : J’irai, j’irai avec toi, mais il n’y aura pas de gloire pour toi dans la voie où tu marches, car c’est entre les mains d’une femme que Dieu livrera Siséra, et chantant après la victoire même :
Il ont défailli les chefs en Israël, ils ont défailli,
Jusqu’à ce que je me sois levée, moi Débora,
Que je me sois levée, moi mère en Israël.
Mais combien plus merveilleuse est la répétition de ce fait dans les annales chrétiennes, quand le peuple de Dieu est la France, quand les Philistins idolâtres sont des Anglais catholiques, et que Débora est une fille des champs de dix-sept ans, qui sera brûlée à dix-neuf ans, par les siens autant que par ses ennemis, comme suppôt du démon, entre les premières victoires opérées par sa main et les dernières prophétisées par sa bouche : Jeanne d’Arc appelée du ciel même la Pucelle, comme Marie est appelée la Vierge, Jeanne qui, joignant au rôle de Débora celui d’Élie, peut s’entendre appliquer le mot de l’Esprit-Saint : Vous qui avez sacré les rois pour venger les crimes ! (Eccli., XLVIII, 8.)
Au lendemain de la canonisation de saint Louis, son petit fils, Philippe-le-Bel, s’insurgeant contre Boniface VIII qui l’a faite, a concentré tous les arts néfastes de la politique pour établir dans son royaume l’esprit de sécularisation, importé, il y a trois siècles, par les Manichéens, en Europe. Sa fin prématurée, celle de ses trois fils et d’un petit-fils montant sur le trône après lui, tous les cinq morts en quatorze ans, n’ont pas été une leçon suffisante pour les Valois qui se substituent à la branche aînée foudroyée et éteinte. Charles V, voulant tenir sous la main, avec la Papauté, les bénéfices ecclésiastiques, a contribué au grand schisme d’Occident. Mourant, non sans repentir, d’un poison lent, à quarante-deux ans et demi, il a laissé le trône à un enfant de douze ans. Celui-ci, conduit dans des voies de plus en plus pernicieuses par son confesseur, le chancelier de l’Université, Pierre d’Ailly, qui transforme l’Église divine en une république humaine où l’autorité est aux plus savants, tombera à vingt-quatre ans dans une démence irrémédiable. Le royaume est livré en proie à la guerre civile et aux Anglais. Le roi d’Angleterre, Henri V, devenu le gendre du roi, se fait, d’accord avec le roi et la reine qui exhérèdent leur fils, couronner roi de France en 1421 ; et l’année suivante, le dauphin, montant sur le trône avec le titre de Charles VII, et comptant à peine sur quelques provinces, sera traité dérisoirement de roi de Bourges.
Mais voilà que dans l’été de 1424, à l’extrême frontière de la France, sur la rive gauche de la Meuse, vis-à-vis de la Lorraine, une jeune fille de douze ans a des visions corporelles de saint Michel, prince des milices célestes et patron de la France, puis de sainte Catherine et de sainte Marguerite, illustres vierges martyres, auxquelles elle a été dévote dès sa plus tendre enfance. Ces saints lui disent, de la part de Dieu, d’aller en France au secours du roi, qui par elle recouvrera son royaume. Les visions s’étant répétées quatre ans, et en mai ou juin 1428, les Anglais allant assiéger Orléans, dernier rempart de la royauté française, nous lisons dans Raynaldi, l’annaliste de l’Église, ce passage trop peu connu, relatif à la présentation, le 13 mai, au capitaine de Vaucouleurs, le sire de Baudricourt, de la jeune fille qui, ayant promis aux saintes Catherine et Marguerite de garder la virginité s’est entendue nommer par elles et se dit Jehanne la Pucelle :
Cette année, le duc de Bedford, administrateur du royaume de France pour Henri (VI) entant, s’efforça d’affaiblir et d’anéantir le droit ecclésiastique, ordonnant de réunir au Trésor royal tous les biens qui avaient été donnés aux églises de France pendant quarante ans, et consacrés au culte divin, et cela pour fournir à la paye des soldats, qui devaient, par tous les genres de méfaits, détruire et déshonorer les églises de France. L’Université de Paris, ayant tenu souvent, à ce sujet, diverses assemblées, fit enfin cesser à grand-peine ce sacrilège. Mais les Anglais n’eurent pas à se réjouir d’avoir accru leurs richesses par les rapines faites aux églises ; car, au moment le plus brillant de leur fortune, fut suscitée de Dieu, comme on le crut, Jeanne l’héroïne, du village de Domrémy, entre la Bourgogne et la Lorraine.
Faut-il ajouter, avec Raynaldi, que Martin V va écrire, le 11 août 1429, à Charles, illustre roi de France
, pour se plaindre avec lui de ce que
les Anglais qui étaient équipés pour aller en Bohème combattre les hérétiques, sont entrés dans le royaume de France, [des] gens, (dit le Pape), qui étaient en partie équipés et engagés à nos frais pour une bonne fin.
C’est ici que nous ouvrons le livre du R. P. Ayroles, la Vraie Jeanne d’Arc, la Pucelle devant l’Église de son temps, livre que la Civiltà Cattolica a traité de stupenda opera [œuvre formidable], qui a reçu de deux cardinaux et de plusieurs évêques français un chaleureux accueil, et auquel la librairie Gaume a fait les justes honneurs d’une édition rappelant ses splendides Pères de l’Église.
La Société de l’Histoire de France avait, de 1841 à 1849, publié en cinq volumes, par les soins de Quicherat, les Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc dite la Pucelle. Mais Quicherat, craignant d’augmenter d’un volume le procès de réhabilitation, n’avait donné que quelques lambeaux des mémoires consultatifs et de la récollection de ces mémoires par le grand inquisiteur, le dominicain Bréhal. Libre-penseur, et trop héritier dans l’Université moderne des antipathies de l’ancienne contre une envoyée céleste, il lui sera ainsi plus facile en 1850, dans ses Aperçus nouveaux sur l’histoire de Jeanne d’Arc, de donner cours à ses préférences pour le procès de condamnation par l’évêque de Beauvais, Cauchon, sur le procès de réhabilitation par le Pape, et d’écrire :
Autant l’un est rapide, clair, dégagé, autant l’autre est diffus et confus.
C’est ce dernier que le R. P. Ayroles a voulu venger en le faisant connaître à fond, d’après les textes inédits. Son immense travail était entre les mains de l’éditeur, quand M. Lanéry d’Arc, essayant de combler la lacune de Quicherat, a fait paraître les Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d’Arc, par les juges des procès de réhabilitation, d’après les manuscrits authentiques. Tout l’essentiel de ce nouveau dossier se trouve dans l’ouvrage du docte jésuite, en même temps qu’un ample résumé de l’ancien, et des recherches historiques sur les juges de la victime de Rouen non moins capitales que neuves. Complètement renseignés à cette heure, esquissons le portrait de la vraie Débora française, et le tableau de son temps, si semblable au nôtre par ses tristesses, en attendant hélas ! ses espérances.
Quand la bergère de Domrémy, conduite par la petite escorte que lui avait donnée le sire de Baudricourt, à demi-croyant à sa mission divine, fut, en traversant cent cinquante lieues d’un pays occupé par l’ennemi, arrivée devant Charles VII, son attitude ne fut pas moins que celle d’un prophète, rappelant Moïse devant Pharaon.
Le sieur comte de Vendôme, (dit son confesseur, Jean Pasquerel, d’après le récit qu’il tient d’elle-même), conduisit Jeanne au roi et l’introduisit dans la chambre du roi. Celui-ci, la voyant, lui demanda son nom. Elle répondit :
— Gentil Dauphin, j’ay nom Jehanne la Pucelle ; et vous mande le Roy des Cieulx par moi que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims, et vous serez le lieutenant du Roi des cieux, qui est roi de France.
Et après plusieurs interrogations faites par le roi, Jeanne lui dit encore :
— Je te dis de la part de Messire, que tu es vray héritier de France, et fils du roy, et il m’envoie vers toi pour te conduire à Reims afin que tu y reçoives le couronnement et la consécration si tu veux.
Avant entendu ces paroles, le roi dit à ceux qui étaient présents que Jeanne lui avait dit certains secrets que personne ne savait et ne pouvait savoir que Dieu : c’est pourquoi il avait grande confiance en elle*.
* Quicherat, t. III, p. 102. Les mots soulignés [en italique] sont en français dans la déposition de Pasquerel en latin.
Ces secrets révélés au roi dans l’intimité de
quelque peu de ses gens et en la présence du duc d’Alençon, du seigneur de Trêves, de Christophe de Harcourt et de maître Gérard Machet, son confesseur, lesquels il fit jurer, à la requête de Jeanne, qu’ils n’en révéleroient ni diroient rien*,
seront communiqués plus tard par le roi à Gouffier, seigneur de Boissy, et transmis à l’histoire par le panetier de Gouffier, Pierre de Sala. Il s’agit d’une prière mentale faite dans son oratoire par Charles VII qui, réduit à la dernière détresse, tremblant pour sa vie même, était de plus tourmenté de doutes sur la légitimité de sa naissance.
* Chronique la Pucelle, Quicherat, t. V, p. 203. Cf. Journal du siège d’Orléans, p. 128.
À ce titre de Dauphin donné au fils du roi qui n’a pas reçu l’onction sainte, à ce titre de lieutenant du Roi des cieux qui sera son vrai titre quand le sacre l’aura fait roi, à ce titre de roi de France attribué en propre au Roi des cieux, Jésus-Christ, à la promesse de conduire à Reims le Dauphin pour faire de lui ce lieutenant royal s’il veut, qui n’est stupéfait d’abord d’un langage sublime, à l’unisson de saint Grégoire VII ou de Boniface VIII, dans une jeune fille qui avoue ne savoir ni A ni B, alors que les doctrines les plus anarchiques sur la constitution divine de l’Église triomphent dans l’Université de Paris, qui s’appelle par la bouche de son chancelier Gerson le beau clair soleil de France, voire même de toute la chrétienté ; qui n’est stupéfait, dis-je, et, si ce langage est sérieux, — les faits subséquents écartent tout doute — qui n’est obligé de reconnaître en cette Pucelle un autre Moïse, un autre Élie, en attendant une autre Débora ?
Même avec la marche merveilleuse sur Chinon, même avec la reconnaissance miraculeuse qu’elle a faite du roi parmi ses courtisans où il se déguise, même après le secret qu’elle lui a révélé et qui l’a convaincu, même après l’avis favorable donné par l’archevêque de Reims et une commission de docteurs à l’examen desquels elle a été soumise à Poitiers, ayant été à son témoignage,
interrogée pendant trois semaines dans la ville de Chinon et à Poitiers*,
Jeanne ne peut obtenir ce qu’elle demande pour accomplir sa mission, une armée. Confier une armée à une jeune fille ! Le roi et la cour, n’en fussent-ils pas, comme ils sont, à leurs suprêmes expédients, on comprend leurs hésitations et leurs délais. Arrivée à Chinon le 6 mars, quatrième dimanche de carême, la divine envoyée n’a encore rien obtenu le 17, jour de Pâques, ni peut-être même dans les premiers jours d’avril.
* Quicherat, t. I, p. 75.
Voilà qu’un événement plus miraculeux que les autres va la mettre, vers le 20, à la tête d’une armée qu’elle estimera plus tard de dix à douze mille hommes
. Son meurtrier, l’évêque vendu aux Anglais, dans un procès-verbal à leur bénéfice, qu’il n’a pas osé insérer à sa plaça obligée au procès de Jeanne, et qui a pour seul garant sa triste probité, a réussi à jeter ici sur l’histoire un voile trop accrédité de ses jours jusqu’aux nôtres. Il est temps de le lever avec les déclarations authentiques et surabondantes de Jeanne elle-même. Voici, d’après la minute originale de son procès, sauf l’orthographe et deux textes latins dont la minute manque, ses dépositions solennelles sur une scène capitale de sa vie, qui sera au fond la cause la plus capitale de sa mort. Nous les donnons rangées dans l’ordre chronologique des détails, pour suivre pas à pas la scène. Qu’on prenne garde qu’elles commencent par l’affirmation de la Pucelle que
son roi, avant de la mettre à l’œuvre, a eu lui-même plusieurs apparitions et de belles révélations.
Dixit… quod, antequam rex suus poneret eam in opus, ipse multas habuit apparitiones et revelationes pulchras. (Quicherat, I, 56.)
[Suivent de longs extraits de la minute française du procès de condamnation, d’après Quicherat.]
Interrogée si l’ange qui apporta le signe, fut l’ange qui premièrement apparut à elle… [jusqu’à :] Et du signe baillé au roi, elle l’a dit, pour ce que les gens d’église l’ont condamnée à le dire.
Devant ces dernières paroles tombe la version trop reçue, qui identifie la scène du conseil
secret du roi, à lui révélé par la Pucelle, et qu’elle ne révélera jamais, avec celle de la couronne apportée par l’ange, qu’elle a révélée dans ses plus petits détails. Combien, d’ailleurs, tout est différent dans les deux scènes, à commencer par les témoins nommés, à finir, là par un inviolable mystère, ici par un spectacle donné à plus de 300 personnes et par la cessation des interrogations et contradictions des clercs !
Le tableau de saint Michel apportant la couronne à Charles VII, si amplement fait par la Pucelle devant ses juges et dont elle ne retirera pas une syllabe jusqu’à son dernier jour, sera le désespoir des Anglais, même après son bûcher. Aussi, à huit jours de là, Cauchon, par ses odieux complices et deux témoins meilleurs, que la terreur de la mort, son instrument ordinaire, empêchera longtemps de protester contre les monstrueuses dépositions qu’on leur prête, si tant est qu’ils les connaissent, fera-t-il dire à Jeanne que le matin de son supplice elle a tout désavoué.
Ce qu’elle avait dit et affirmé au sujet de la couronne n’était qu’une certaine fiction, fictio quædam, et l’ange n’était autre qu’elle-même, ipsamet erat angelus.
En même temps on lui fait déclarer qu’elle a été dans toute sa mission le jouet des mauvais esprits, maligni spiritus, et prononcer devant la sainte hostie qu’elle va recevoir en viatique des mains de son confesseur, le dominicain Ladvenu :
— Je crois en Dieu seul et je ne veux plus ajouter foi aux voix, puisqu’elles m’ont ainsi trompée. Nolo amplius fidem adhibere in ipsis vocibus. (Quicherat, t. I, p. 480-481.)
Dès le lendemain du procès-verbal de Cauchon le roi d’Angleterre va attester cette rétractation à tous les souverains de l’Europe et à tous les prélats français, en attendant que l’Université de Paris, sa complice, l’atteste au Pape, à l’empereur, au collège des cardinaux. Mais, un jour, un des deux témoins honnêtes figurant dans le malhonnête procès-ver bal, Ladvenu, étant cette fois bien réellement et bien librement en face de la fameuse pièce, nous donnera la mesure de sa valeur.
Il dit aussi et dépose, de ce interrogé, que toujours jusqu’à la fin de sa vie, semper usque ad finem vitæ suæ, elle (Jeanne) soutînt et affirma que les voix qu’elle avait eues étaient de Dieu, et que tout ce qu’elle avait fait, elle l’avait fait par le commande ment de Dieu, et qu’elle ne croyait pas avoir été trompée par ces mêmes voix et que les révélations qu’elle avait eues étaient de Dieu. (Quicherat, t. III, p. 170.)
Et sur le grand fait de la couronne apportée par l’ange, nous ferions la Pucelle menteuse pour ne pas faire Cauchon faussaire ! Cauchon qui, sans remonter plus haut, a commis quinze jours avant son procès-verbal plus que ténébreux, daté du 7 juin, le faux cynique et indiscuté de l’acte d’abjuration de la Pucelle, soi-disant prononcé et signé par elle le 24 mai, acte qu’elle ne connaîtra jamais, malgré la demande presque unanime du tribunal, et sur lequel, dite relapse, elle sera condamnée au bûcher (!).
Ayant tant fait pour nous donner la vraie Jeanne d’Arc, le R. P. Ayroles ne me blâmera pas d’avoir ajouté cette note à son docte ouvrage, et à tant de bons ouvrages qui, depuis le quinzième siècle n’ont pas été assez en défiance des tours de Cauchon, ni assez pleinement attentifs aux paroles authentiques et si expresses de la Pucelle sur la levée par saint Michel des barrières de la lice où elle devait entrer*.
* Tout en accordant quelque valeur historique au procès-verbal de Cauchon, M. Marius Sepet est obligé d’écrire : Le procès-verbal de cette entrevue, rédigé postérieurement au supplice et dans une forme indirecte et mensongère n’offre aucune garantie. (Jeanne d’Arc, 1885, p. 266.)
Partie de Chinon avec son armée la Pucelle vint à Tours, et là par l’ordre de Dieu
, dira-t-elle (Quicherat, t. I, p. 78), elle se fit faire un étendard, ainsi que Constantin s’était fait faire un labarum, comme instrument certain de victoire. Sur une étoffe blanche de linon, semée de fleurs de lys d’or et entourée d’une frange de soie, elle fit peindre d’un côté le Christ assis sur l’arc-en-ciel, tenant de la main gauche le globe du monde et bénissant de la droite un lys que lui présentait saint Michel, qui formait avec saint Gabriel son escorte d’honneur ; de l’autre, Notre-Dame, ayant près d’elle l’écu de France porté par deux anges. On lisait au flanc des peintures Jhesus, Maria. À cet étendard qui sera l’arme offensive unique de cet ange des batailles, renversant les cohortes et prenant les villes d’assaut, Jeanne joignit un pennon, où était peinte l’Annonciation : Gabriel, un lys à la main, agenouillé devant la Vierge. L’étendard sera béni à Blois, dans l’église Saint-Sauveur.
À Blois, la Pucelle fera faire une bannière représentant le Christ en croix, pour servir de ralliement aux prêtres
qui marcheront en tête de l’armée. C’est ainsi, dit son confesseur, l’augustin Pasquerel, auquel elle se confesse tous les deux jours, entendant la messe chaque matin, communiant chaque semaine
(Quicherat, t. III, p. 81), faisant taire les blasphèmes et cesser l’immoralité dans l’armée, c’est ainsi qu’au chant du Veni Creator et des antiennes et hymnes de la bienheureuse Marie
, on ira à la délivrance d’Orléans (Quicherat, t. III, p. 104). C’est le 28 avril. Le 17 juillet, après une campagne de moins de trois mois où, à la suite d’une sommation aux Anglais, faite au nom du Roi du ciel
d’avoir à vider la France, l’inspiration de la Pucelle lui a fait faire des prodiges sans exemple dans les fastes militaires, et qu’on peut appeler bibliques, le gentil dauphin, entré à Reims, est, à l’ombre de son étendard, sacré roi, c’est-à dire lieutenant du Roi des cieux, qui est roi de France, Jésus-Christ planant sur l’étendard même.
Toujours pusillanime au sein de ces merveilles, et, prêt hier encore, à reculer devant Troyes, Charles VII n’a point porté avec lui dans les camps la couronne que lui a remise saint Michel à Chinon. Elle a manqué à Reims. C’est un regret, parmi tant d’autres, de la Pucelle. Mais la couronne miraculeuse ne tardera pas à revenir au roi pour consommer son sacre. Interrogée si son roi avait une couronne quand il était à Reims, Jeanne, qui parle pour la première fois au tribunal de cette couronne, dont elle ne veut point encore révéler la céleste histoire,
a répondu que, à son avis, le roi prit avec plaisir la couronne qu’il trouva à Reims ; mais une autre bien riche lui fut apportée par après. Et il fit cela pour hâter son fait, à la requête de ceux de la ville de Reims, pour éviter la charge des gens de guerre ; et s’il eût attendu, il eût eu une couronne mille fois plus riche*.
* Quicherat, t. I, p. 91. La minute manque. L’interrogatoire est le cinquième, daté du 1er mars 1431.
L’abbé V. Davin.
L’Univers 20 octobre 1890
Article 2/2 de l’abbé Vincent Davin. (Fait suite à celui du 17 octobre.)
Pas plus nécessaire que le premier.
Liens : Retronews.
2e et dernier article
Après le sacre, et déjà après la délivrance d’Orléans, la renommée de la Pucelle remplissait tous les royaumes de la chrétienté de stupeur : omnia christianorum regna stupebant
, écrira un dominicain allemand, docteur de l’université de Vienne, Nider. Orléans n’était peut-être pas délivré encore qu’en mai 1429, l’archevêque d’Embrun, Jacques Gélu, composait pour son pupille Charles VII un traité où, rappelant la mission de Moïse, de David, de Judas Maccabée, celle de Judith et d’Esther, il est d’avis que le roi, après avoir connu chaque jour le sentiment de la Pucelle, le réduise en pratique, en toute humilité et piété, pour que le Seigneur n’ait pas de motif de retirer sa main, mais bien de continuer sa grâce
. Il fait, d’ailleurs, des envahisseurs de la France ce portrait qu’ils justifient trop et qui explique la mission de Jeanne d’Arc : L’insatiable cruauté de la nation anglaise, inaccessible à tout sentiment d’humanité : par elle la chrétienté entière est bouleversée, bien plus l’univers lui-même. Les ennemis de la croix de Jésus-Christ s’applaudissent en apprenant que de telles guerres règnent parmi les chrétiens : ils savent bien que rien ne peut amener plus sûrement notre ruine.
Orléans est délivré le 8 mai. Le 14, Gerson, l’ex-chancelier de l’Université de Paris, qui, revenu en partie des erreurs de son maître Pierre d’Ailly devenues les siennes, va mourir pieusement à Lyon en juillet, compose en faveur de la Pucelle un traité De Puella, où il la compare à Débora, à Judith, à Judas Maccabée. À Rome, un clerc français, de la cour de Martin V, terminant, à la fin de 1428 ou dans les premières semaines de 1429, son Breviarium historiale, a écrit : Le très chrétien prince, le roi Charles, a beau être abandonné par les siens, le Ciel remettra entre ses mains l’étendard de la victoire… pourvu cependant qu’il s’humilie et qu’il l’implore avec un cœur pur.
Voyant l’exécution suivre de si près son vœu devenu une prophétie, il place la très glorieuse Pucelle
à côté de Débora, de Judith et d’Esther, et démontre que la mission, évidemment surnaturelle, de cette fille de dix-sept ans
est divine, par divers arguments, dont voici les derniers :
Que l’on considère que la Pucelle se confesse tous les jours avant d’entendre la messe ; qu’elle communie fort dévotement une fois la semaine ; que si ses actes sont au-dessus des forces de son sexe, ils tendent à un but utile et juste, à savoir la pacification du royaume des Francs ; que cette pacification amènera le relèvement de la foi qui, à en juger par les services rendus dans le passé par la France à la chrétienté ne fût pas déchue comme elle l’est, si la France n’eût pas comme disparu dans le tourbillon de tant de guerres ; l’on sera forcé de conclure que les œuvres de la Pucelle viennent de Dieu, et ne sont pas l’effet du sortilège, ainsi que le répètent les quelques esprits que la vérité offusque.
Qu’ajouter encore ? Un jour, la Pucelle demanda au roi de lui faire un présent. La prière fut agréée. Elle demanda alors comme don le royaume de France lui-même. Le roi étonné le lui donna après quelque hésitation, et la jeune fille l’accepta. Elle voulut même que l’acte en fût solennellement dressé et lu par les quatre secrétaires du roi. La charte rédigée et lue à haute voix, le roi resta un peu ébahi, lorsque la jeune fille le montrant dit à l’assistance : Voilà le plus pauvre chevalier de son royaume. Et après un peu de temps, en présence des mêmes notaires, disposant en maîtresse du royaume de France, elle le remit entre les mains du Dieu tout-puissant. Puis, au bout de quelques autres moments, agissant an nom de Dieu, elle investit le roi Charles du royaume de France ; de tout cela elle voulut qu’un acte solennel fût dressé par écrit.
Voilà comment sa haute théologie sociale tenait au cœur de la Pucelle, comment elle était ingénieuse à l’inculquer au descendant de Philippe le Bel, au roi très chrétien
ayant une cour fort peu chrétienne, avec La Trémouille pour ministre omnipotent. Quel ravissement a dû causer à Martin V cette anecdote où est le premier mot de la mission de Pucelle et le dernier ! Et quel ravissement aussi à Léon XIII quand, en 1885, le comte Balzani l’a tirée d’un manuscrit du Vatican, et que M. Léopold Delisle l’a publiée !
En juin, avant le sacre encore, Henri de Gorkum, professeur à l’Université de Cologne, examinant six propositions en faveur de la Pucelle et six contre, sans rien décider, laisse bien entrevoir qu’il croit à sa mission divine. Ce même mois de juin, un clerc de Spire, qui complétera son écrit le 17 septembre, exalte, sans toutefois assez de goût et d’exactitude, en la Pucelle la Prophétesse française, Sybilla francisca : c’est le titre du double écrit. Le 31 juillet, au lendemain du sacre accompli le 17, la vénitienne Christine de Pisan, veuve d’un Français, vivant cloîtrée dans une abbaye, où elle unissait la poésie à la religion pour se consoler, signait à soixante-sept ans, en l’honneur de la Pucelle, les derniers vers qu’elle ait écrits. C’est l’ode la plus lyrique sur la nouvelle Hester, Judith et Delbora
, par qui Dieu… miracles… plus a fait
que par ses devancières. Et ces miracles accomplis en France ne sont pour Christine de Pisan que le prélude d’autres en tous genres de croisades : Les hérites (hérétiques) de vie orde (dégoûtante) détruira — Des Sarrasins fera essart (destruction), en conquérant la sainte terre.
Les croisades, en effet, ne sont pas éloignées de la pensée de la Pucelle, puisque le 23 mars 1430 elle sommera, par son confesseur Pasquerel, les hussites de vrais chrétiens devenus hérétiques et semblables aux Sarrasins
— ces hussites, contre lesquels le Pape a armé des Anglais qui, félons, sont venus combattre la France, — de retourner à la foi catholique
, sinon elle leur fera quitter l’hérésie ou la vie
. Quant au sentiment des Français sur leur libératrice, on peut en juger par ce morceau, exagéré d’ailleurs, du réquisitoire que dresseront contre elle dans dix-huit mois les séides des Anglais :
Jeanne a tellement séduit le peupla catholique par ses inventions que beaucoup l’ont adorée en sa présence comme une sainte, et l’adorant encore en son absence, commandant dans les églises des messes et des collectes en son honneur. Bien plus, on la dit plus grande que tous les saints de Dieu après la Bienheureuse Vierge ; on érige ses images et effigies dans les basiliques des saints ; on porte sur soi ses effigies en plomb et autre métal, comme on a coutume de faire des mémoires et effigies des saints canonisés par l’Église ; et l’on prêche publiquement qu’elle est l’envoyée de Dieu et plutôt un ange qu’une femme. — (Quicherat, t. I, p. 200.)
Divers monuments sont venus illustrer de nos jours l’homicide réquisitoire.
Deux médailles datant de 1430 et dont l’une se trouve actuellement au musée de Cluny, portent sur une de leurs faces le buste ou les armes de Jeanne d’Arc. — (M. Lecoy de la Marche, Le Culte de Jeanne d’Arc jusqu’à nos jours, Orléans, 1889, p. 13.)
[Suivent de longs paragraphes… jusqu’à :]
Et maintenant, après trois siècles, au milieu de calamités nouvelles rappelant trop les anciennes, voici que ce bûcher, dont Voltaire a fait un cloaque satanique, est en voie de de venir un autel. Pie IX, à la veille du concile du Vatican, a accueilli avec bienveillance la demande de canonisation. Le R. P. Ayroles a pu donner pour épigraphe à son excellent livre ces paroles de Léon XIII à l’évêque d Orléans :
Notre pressentiment personnel, c’est que Dieu daignera écouter des vœux qui intéressent la gloire de la France entière et surtout de la ville d’Orléans.
Le cardinal ponent de la cause, à qui Léon XIII a donné pour prédécesseur un cardinal anglais, le cardinal-vicaire Parocchi, a, ce 24 mai 1890, montré aux élèves du séminaire français :
Jeanne d’Arc, cette héroïne… qui a été l’ange de la religion et de la patrie… cette grande âme, élevée aux régions célestes. — (L’Univers, 31 août 1890.)
Oh ! puissent bientôt des copies du tableau de Versailles être appendues dans nos temples, avec l’auréole de la Pucelle consacrée par l’Église et la triomphale restitution du Protegis arva !
L’abbé V. Davin.
L’Univers 29 décembre 1890
Jeanne d’Arc sur les autels parmi les recommandations de livres d’étrennes de la maison Gaume.
Liens : Retronews.
Outre les ouvrages spéciaux d’étrennes que nous avons déjà signalés, la maison Gaume en a qui se recommandent au public chrétien et que nous nous faisons un devoir de signaler.
[Abbé Brispot, La Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; Mgr Gaume, Biographies évangéliques et Manuel du chrétien ; Abbé Darras, Les Saints et les Bienheureux du XVIIIe siècle.]
Pourrions-nous oublier la belle étude du R. P. Ayroles, Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France ! Mais la France chrétienne tout entière s’associe actuellement à la campagne entreprise pour la béatification de l’héroïne dont elle est si justement fière.
[Mgr Gaume, La Révolution ; Baron Henrion, Histoire générale des missions catholiques ; Amédée Gabourd, Histoire de Paris, Ch. d’Héricault, Histoire nationale des naufrages et Histoire de la Révolution racontée aux petits enfants ; Frédéric Godefroy, abrégé de l’Histoire de la littérature française en 3 vol.]
Le Figaro 31 décembre 1890
Mention de la Vraie Jeanne d’Arc dans un article sur Domrémy-Vaucouleurs, signé Macé de Challes.
Liens : Retronews.
[Au sujet de la basilique du Bois-Chenu (en cours de construction) :]
De cette vue est née sa mission politique et militaire, en dehors des visions extatiques de sa piété : magistralement exposées par le Père Ayroles, dans sa Vraie Jeanne d’Arc.
Société d’études des Hautes-Alpes 1er trimestre 1891
Compte-rendu du tome I de la Vraie Jeanne d’Arc en mettant l’accent sur les chapitres relatifs à leur compatriote Jacques Gélu, alors archevêque d’Embrun (dans les Hautes-Alpes).
Source : Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes, 10e année, n° 37 (janvier-février-mars 1891), p. 102.
728. Ayroles (Jean-Baptiste-Joseph), de la compagnie de Jésus. La Vraie Jeanne d’Arc. La Pucelle devant l’église de son temps. Documents nouveaux, Paris, Gaume, 1890, gr. in-8°, 28-XVIII-754 p. — Nous n’avons pas à faire ici l’éloge de l’œuvre magistrale que vient de publier le R. P. Ayroles à la gloire de Jeanne d’Arc. Contentons-nous de signaler à l’attention des lecteurs du Bulletin le rôle si beau, si patriotique de Jacques Gelu, archevêque d’Embrun (1427-32), soit après la prise d’Orléans (8 mai 1439), soit après la prise de Jeanne d’Arc à Compiègne (25 mai 1430). Le R. P. Ayroles consacre à l’archevêque d’Embrun un chapitre entier de son bel ouvrage ; c’est le chapitre III, intitulé : Jacques Gelu et ses écrits sur la Pucelle (p. 32-52).
Jacques Gelu ne cessa d’entretenir une correspondance active, au sujet de Jeanne, avec les personnages les plus en vue de son époque, et surtout avec le roi Charles VII et avec la reine Yolande. Cette correspondance nous a été heureusement conservée, en copie ou en analyse, par le P. Fournier, dans son Histoire générale des Alpes Maritimes ou Cottiènes (dans le 2e vol. qui est sur le point de paraître). De plus, Jacques Gelu avait composé, sur la mission providentielle de Jeanne d’Arc, deux traités, l’un en français, qui est perdu, l’autre en latin, qui a été, en partie, publié par M. Jules Quicherat, ancien directeur de l’École des Chartes.
Pour bien les connaître, il faut lire le travail du R.-P. Ayroles. Les écrits de Jacques Gelu, dit cet historien (p. 52), respirent la foi, la piété, un inaltérable dévouement au roi et à la cause française
. Si les conseils par lesquels son traité latin se termine avaient été suivis, il est permis de croire que la délivrance eût été avancée de vingt ans, et que bien d’autres événements heureux s’en seraient suivis
. — C.
Affiches Tourangelles 21 février 1891
Lettre réponse du père Ayroles aux questions adressées par le directeur des Affiches Tourangelles, Henri Destréguil, sur le séjour de Jeanne à Tours.
On apprend que le père Ayroles a passé pendant l’été de 1890 quelque temps à Tours et à Chinon à faire des recherches sur Jeanne d’Arc
.
Source : Les Affiches Tourangelles, journal des fonds de commerce et des propriétés (hebdomadaire paraissant le jeudi), 26 février 1891, p. 2.
Lien : Archives d’Indre-et-Loire
Jeanne d’Arc à l’église des Augustins de Tours, lettre du R. P. Ayroles.
Le 29 décembre 1890 nous avions écrit au R. P. Ayroles qui, en 1885, a publié l’ouvrage suivant : Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France. Nous savions qu’il avait passé pendant l’été de 1890 quelque temps à Tours et à Chinon à faire des recherches sur Jeanne d’Arc et qu’il s’était préoccupé de son séjour à Tours.
Nous avions adressé notre lettre à Toulouse, où nous pensions qu’il se trouvait, mais ce n’est que le 22 février 1891 que nous avons reçu la réponse suivante :
Vals, près le Puy-en-Velay,
21 février 1891.Monsieur Destréguil, directeur des Affiches Tourangelles,
Votre texte me paraît concluant ; il le serait entièrement si les renvois établissaient, ce qui est d’ailleurs très vraisemblable, qu’Éléonore Lapau était devenue dame Jean Dupuy.
Que Jeanne, déjà approuvée à Poitiers, fût descendue dans une auberge, c’est de toute invraisemblance et peu convenable. On eut envahi le lieu pour la voir. Les deux témoins, son page et son confesseur, qui désignent le lieu de son séjour, disent in domo cujusdam vocatæ Lapau (p. 66) ; in domo Johannis Dupuy burgensis Turonensis (p. 101) ; or domus signifie maison particulière, beaucoup plus que hôtellerie.
À l’époque de Jeanne, l’année commençant à Pâques, au lieu du 19 janvier 1429, que porte le texte cité par Quicherat (t. V, p.154), il faut lire d’après notre style actuel 19 janvier 1430.
Il y a dans les archives municipales de Tours d’autres textes qui ont rapport à la vie de Jeanne, plus qu’il n’y en a dans Quicherat. Il y a en particulier plusieurs gratifications faites à Collet, messager royal, l’un des six compagnons de la Pucelle de Vaucouleurs à Chinon.
Au cas où quelque paléographe aurait la patience de parcourir tous les livres de compte ou les registres des délibérations pour les publier, vous m’obligeriez de me les signaler.
Un lieu où Jeanne fit à Tours de très longues stations, c’est l’église des Augustins, dont il serait facile de trouver l’emplacement. La grande dévotion de Jeanne était la Sainte Messe. À Vaucouleurs elle entendait la messe qui se disait le matin à la Collégiale de Notre-Dame ; en passant à Sainte-Catherine-de-Fierbois, elle en oit trois. Nous savons d’ailleurs par F. Paquerel qu’elle se confessait à peu près tous les jours ; par le clerc de Martin V que c’était pour se préparer à assister au Saint Sacrifice ou pour communier. Elle devait donc se rendre au lieu où était son confesseur et entendre ensuite la messe ou les messes. Mais ce confesseur, F. Paquerel, était professeur dans la maison de son ordre, les Augustins de Tours. C’était donc là que la libératrice devait passer une partie notable de ses matinées. Le couvent des Augustins n’était pas loin de la Basilique de Saint-Martin, et il paraît que quelques pans de muraille existent encore.
Je suis, Monsieur,
Votre serviteur in Christo.
R. P. Ayroles,
prêtre à Vals, près le Puy-en-Velay (Haute-Loire).
Dans notre numéro du 19 février 1891, c’est-à-dire avant la réception de cette lettre nous avons dit qu’Éléonore La Pau ou de Paul, était devenue la femme de Jean Dupuy seigneur des Roches-Saint-Quentin. C’est donc un fait historique indiscutable. Quant au couvent des Augustins, il était situé à l’angle de la rue de la Galère et de la rue de la Scellerie, au point où commençait la rue de la Harpe ; mais il faut bien remarquer qu’à cette époque la rue de la Scellerie commençait à la rue de la Galère (aujourd’hui rue Marceau), elle traversait la rue Traversaine (aujourd’hui rue Nationale) pour aboutir à la place Saint-Étienne (aujourd’hui place et square de l’Archevêché). La portion, entre la rue Nationale et la rue Marceau porta depuis le nom de rue l’Ancienne-intendance jusqu’en 1889, époque depuis laquelle elle porte celui de rue des Halles. Par conséquent le couvent des Augustins était situé dans l’emplacement de la maison occupée actuellement par la papeterie Amirault, par l’épicerie Dejault, rue des Halles, et l’école maternelle municipale, rue Marceau, c’est-à-dire à l’angle des rues de l’Ancienne-Intendance (aujourd’hui rue des Halles) et de la Galère (aujourd’hui rue Marceau), Il en reste des vestiges. Que ceux de nos lecteurs qui en douteraient veuillent bien jeter un coup d’œil sur le vieux plan de la ville de Tours (enceinte du XIVe siècle). C’est donc là tout près de la basilique de Saint-Martin, que Jeanne d’Arc passait ses matinées.
Nous remercions le R. P. Ayroles de son intéressante lettre.
H. Destréguil.
L’Univers 6 mai 1891
Mention du père Ayroles dans un compte-rendu de la nouvelle édition de la Jeanne d’Arc de l’abbé Henri Debout (1 vol. de 360 p. avec gravures, 80 centimes).
Liens : Retronews.
Presque à la veille du jour où la ville d’Orléans va se mettre en fête pour célébrer traditionnellement sa glorieuse Pucelle, il nous paraît singulièrement opportun de signaler l’histoire populaire écrite en l’honneur de Jeanne d’Arc par M. l’abbé Henri Debout. Certes, les travaux ne manquent pas sur l’héroïne suscitée par Dieu au XVe siècle pour sauver la France, et, en ces derniers temps surtout, la grande œuvre catholique du R. P. Ayroles, venant après tous les écrits (nommons spécialement M. Sepet et M. Siméon Luce) qui ont fait suite eux-mêmes aux travaux des Wallon et des Quicherat, a mis en pleine lumière la figure rayonnante de l’envoyée de Dieu. Mais ces écrits, s’il ne sont pas faits uniquement pour une élite, ne vont principalement qu’à elle ; or, qui plus que le peuple a besoin d’entrer dans la connaissance détaillée d’une si merveilleuse histoire ? Il y avait là une lacune à combler. […]
Études septembre 1891
Compte-rendu de l’ouvrage Existe-t-il des reliques de Jeanne d’Arc ? de l’abbé Cochard, par le père Ayroles.
En dehors des deux lettres signées Jeanne
, l’abbé Cochard n’a trouvé aucune relique de l’héroïne. Orléans conserva bien pendant des siècles un chapeau qui lui aurait appartenu : en 1792 les révolutionnaires s’en emparèrent pour le brûler.
Le père Ayroles termine par l’affaire curieuse de cet archéologue-pharmacien de Touraine, qui affirme être en la possession d’un flacon étiqueté : Restes trouvés sous le bûcher de Jeanne d’Arc, découvert à Paris vingt-cinq ans plus tôt. Il suggère que le contenu soit confié aux experts pour analyse.
Source : Études religieuses, etc., 1891, tome 56, p. 614-618.
Lien : Gallica
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
Le Nouvelliste des Vosges 22 novembre 1891
L’hebdomadaire annonce une trouvaille archéologique
du père Ayroles concernant les ruines de l’ancienne chapelle du bois chenu sur laquelle est construite la nouvelle basilique. La pièce sera reproduite au prochain numéro du 29 novembre.
Liens : Gallica.
Domrémy. — Nous recevons la lettre suivante :
Une trouvaille archéologique de la plus haute importance vient d’être faite à Nancy par le R. P. Ayroles, dont on connaît les importants travaux au sujet de Jeanne d’Arc.
C’est une pièce relative à la chapelle sur les fondements de laquelle s’élève la basilique, et qui établit de la manière la plus irréfutable la conformité d’intentions entre le monument actuel et celui qui lui sert d’assise.
Véritable brevet d’authenticité, il va pulvériser les objections que certains intéressés s’obstinaient à faire contre le projet de la basilique du bois Chenu.
Nous donnerons ce titre in extenso dans notre prochain numéro.
Le Nouvelliste des Vosges 29 novembre 1891
Communication d’une pièce trouvée par le père Ayroles aux archives de Nancy, qui confirme que les ruines sur lesquelles est bâtie la nouvelle basilique de Domrémy sont bien celles de l’antique chapelle érigée par la famille de Jeanne d’Arc.
On apprend donc que le père Ayroles était fin novembre 1891 à Nancy.
Liens : Gallica.
La Basilique de Domrémy. — Nous recevons de notre excellent ami, M. Jules Michel, une intéressante communication que nous nous empressons de publier :
On se rappelle que la Basilique en construction a pour assises les ruines d’une antique chapelle, dont le constructeur fut Étienne Hordal, grand doyen de la cathédrale de Toul, et petit neveu de Jeanne d’Arc.
On a des documents constatant la dotation de cette chapelle, tant par son fondateur, que par Claude du Lys, curé de Greux et de Domrémy, et autre parent de l’héroïne.
Ceci, joint à la circonstance du lieu dit
de la Pucelleque la tradition a conservé comme dénomination à tout le territoire environnant, paraissait suffisant pour justifier le choix de l’emplacement actuel de la Basilique. Nos lecteurs se rappellent les développements donnés ci même à ce sujet.De fait, on ne pouvait espérer meilleurs titres, ni plus authentiques, de cet effroyable in pace de quatre siècles d’oubli.
Mais, hélas ! saint Thomas n’est point mort, et plusieurs de ses respectables, mais entêtés émules s’obstinaient à infirmer ces probabilités, à combattre ces quasi-certitudes.
Sans doute, disaient-ils, vous avez des indices, de sérieux indices, nous l’avouons, mais enfin vous bâtissez sur des hypothèses, et, si vraisemblables soient-elles, on aura toujours le droit de vous dire… in vanum laboraverunt. D’aucuns, et des meilleurs, n’allèrent-ils pas jusqu’à dire :
Ce qu’on fait à Domrémy n’a pas le sens commun !Or, voici que, par une véritable permission de la Providence, le R. P. Ayroles, dont on connaît les savants travaux au sujet de Jeanne d’Arc, et précisément l’un de ceux qui ont apporté le plus de circonspection et de prudente défiance à l’examen du projet d’un monument au Bois-Chenu, voici que le P. Ayroles lui-même vient de découvrir dans les Archives de Nancy une très curieuse et très intéressante pièce qui dissipe véritablement tous les nuages et lève tous les doutes.
Voici ce document :
Document découvert par le R. P. Ayroles
Le Chapitre de Brixey, par acte du 21 octobre 1623, donne quittance aux exécuteurs testamentaires d’Étienne Hordal, grand doyen de la cathédrale de Toul, de la somme de 120 francs pour la fondation de trois messes qui doivent être célébrées en la fête d’Annonciation, Assomption et Nativité de Notre-Dame, en la chapelle qu’il a fait bâtir sous l’invocation de N.-Dame au finage de Domrémy-la-Pucelle, appelée vulgairement la chapelle de Domrémy, desquelles messes les sus-dits seigneurs vénérables, doyen et chapitre de Brixey sont chargés et effectuellement obligés de célébrer ou faire célébrer aux jours de fêtes sus-désignés, sans y faire faute, et fourniront tous ornements, luminaires, et autres choses nécessaires pour la célébration des dites messes, le tout en suite et conformité de l’intention dudit seigneur défunt et à son entière décharge.
Il est donc dès maintenant établi que la chapelle d’Étienne Hordal était vulgairement appelée Chapelle de la Pucelle de Domrémy ; que la famille de Jeanne d’Arc avait jugé ce lieu plus propre qu’aucun autre à un monument commémoratif ; qu’elle y faisait dire des messes aux principales fêtes de l’année.
Sans rechercher quel poids nouveau cette découverte donne à la légende rapportée par plusieurs historiens, d’après laquelle Jeanne d’Arc aurait eu, en ce lieu même, la première intuition de sa mission surnaturelle, contentons-nous de constater que les PP. missionnaires de Domrémy sont matériellement certains dès aujourd’hui, de continuer, et au-delà, les intentions de la famille de l’héroïne elle-même.
C’est plus qu’il n’en faut pour le Monument national, et, comme le dit le P. Ayroles, la question est donc bien vidée !
J. M.
Études décembre 1891
Compte-rendu de la 3e édition de la Jeanne d’Arc de Marius Sepet, par le père Victor Delaporte.
Marius Sepet est le premier érudit qui ait appelé l’attention sur les documents écartés par Quicherat, et dont le R. P. Ayroles s’est attaché à démontrer l’importance.
Source : Études religieuses, etc., 1891, tome 56, p. 864-866.
Liens : Gallica.
Jeanne d’Arc, de M. Marius Sepet, était déjà un beau livre ; la troisième édition est un superbe volume. Seize artistes y ont prêté leur concours ; et parmi les vingt-neuf compositions hors texte, gravées sur bois par Méaulle, il y en a au moins une douzaine de fort remarquables. […]
Il conclut que Jeanne d’Arc résume le moyen âge
. M. Marius Sepet est le disciple et l’ami de M. Léon Gautier ; et c’est sur l’invitation de son maître qu’il commença jadis son histoire de Jeanne d’Arc. […]
Dernier historien, et, croyons-nous, l’historien définitif de la bonne Lorraine, M. Marius Sepet a mis à profit les recherches consciencieuses et récentes dont Jeanne d’Arc et son époque ont été l’objet ; surtout les travaux de MM. de Beaucourt, Wallon, Siméon Luce, Lecoy de la Marche, Vallet de Viriville, Quicherat, et du R. P. Ayroles. Il est le premier érudit qui ait appelé l’attention sur les documents écartés par Quicherat : documents dont le R. P. Ayroles s’est attaché à démontrer l’importance, dans l’ouvrage connu de nos lecteurs la Vraie Jeanne d’Arc.
L’Univers 28 décembre 1891
La Vraie Jeanne d’Arc parmi les recommandations de livres d’étrennes de la maison Gaume.
L’année précédente, Jeanne d’Arc sur les autels figurait dans la liste.
Liens : Retronews.
[…] Pourrions-nous oublier la belle étude du R. P. Ayroles : La Vraie Jeanne d’Arc, accueillie avec enthousiasme au début de sa publication ?
Études février 1892
Compte-rendu de l’ouvrage : Jeanne d’Arc telle qu’elle est de Jules Doinel, par le père Ayroles.
Long éloge du livre de Doinel, une des œuvres capitales publiées sur la Pucelle, un événement dans la cause de Jeanne d’Arc
.
Le père Ayroles résume (et approuve) les quatre parties du livre, qui tendent toute à attester l’inspiration divine de Jeanne. En spécialiste du sujet, il livre également son opinion sur tel ou tel point ; et renvoie au tome I de sa Vraie Jeanne d’Arc au sujet de la responsabilité de l’Université de Paris :
Dans cette partie, qui est excellente, M. Doinel signale et flétrit les grands coupables. Il omet le plus grand de tous, l’Université de Paris.
En conclusion, Ayroles pressent la conversion prochaine de Doinel (qui est alors maître franc-maçon et chef de l’église gnostique
) :
Celui qui constate la vérité de ses très nombreuses prophéties, qui expose avec tant de chaleur l’ascendant tout divin de l’humble sainte, n’a pas pu ne pas subir à son tour son influence, et s’est placé sur la voie de cette soumission filiale à l’Église. Puisse-t-il aller plus loin encore !
Doinel annoncera sa conversion en 1895, et l’attribuera à Dieu, à Jeanne et à N.-D. de Lourdes (d’après son ami Georges Bois).
Source : Études religieuses, etc., 1892, supplément aux tomes 45, 46 et 47, p. 113-117.
Lien : Gallica
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
Études mars 1892
Compte-rendu de l’ouvrage : La Pucelle d’Orléans, sa vie et sa mission du père Francis Windham, par le père Ayroles.
Critique brève mais élogieuse de cette biographie de Jeanne d’Arc écrite par un Anglais. Le père Ayroles l’apprécie particulièrement pour deux raisons :
1. Il y voit une œuvre de repentance et de réconciliation :
C’est l’Angleterre, dans les plus éminents de ses fils, qui fait une franche et complète amende honorable à la martyre de Rouen.
(Il ne manque pas de rappeler que les Anglais ne furent pas les premiers coupables :)
Et pourtant ceux-là ne furent pas les seuls coupables. Ils trouvèrent parmi nous des complices : les docteurs de l’Université de Paris, alors en révolte contre Rome.
2. Le père Windham soutient comme lui que la mission de Jeanne ne s’arrêtait pas à Reims.
Source : Études religieuses, etc., 1892, supplément aux tomes 45, 46 et 47, p. 191-193.
Lien : Gallica
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
Académie de Sainte-Croix d’Orléans mars 1892
La Pucelle d’Orléans, sa vie et sa mission, par le R. P. Windham, traduction de M. Édouard-Joseph Pelletier.
Cette étude retrace l’histoire de Jeanne d’Arc, de sa condamnation jusqu’à l’ouverture de son procès de béatification, en s’appuyant principalement sur trois sources essentielles : les ouvrages de Quicherat, Ayroles et Taxil/Fesch.
Source : Académie de Sainte-Croix d’Orléans, Lectures et mémoires, tome VII, 1er fascicule, mars 1892.
Liens : Gallica.
Préface
Dans les pages qui suivent, le P. Windham a donné un résumé clair et complet des trois périodes de l’histoire de Jeanne d’Arc. La première, ou époque contemporaine, celle où les faits et les actes surnaturels de sa vie ont été prouvés par des témoignages nombreux, tant civils que judiciaires, et par le jugement de deux pontifes ; la seconde, où l’histoire, falsifiée par les factions de l’Angleterre, élaborée par les calomnies infâmes de Voltaire, souilla la sainteté de son nom et de son héroïsme ; la troisième, où les monuments historiques du XVe siècle ont été recueillis, vérifiés et confirmés avec une évidence indéniable pendant ces vingt ou trente dernières années.
Une tardive mais ample réparation s’accomplit enfin pour la Pucelle d’Orléans par le procès en béatification qui se poursuit devant le Saint-Siège.
C’est un bonheur pour les évêques et les fidèles d’Angleterre de contribuer à effacer le crime et la honte qui ont si gravement entaché, non pas la sainte et la martyre de Rouen, mais les annales de notre pays, à raison des calomnies et des cruautés dont nous nous sommes rendus coupables.
Henri Edward,
Cardinal-Archevêque.
Août 1891.
Introduction
En publiant ces quelques pages, j’espère attirer l’attention de mes compatriotes sur les sources authentiques d’une histoire de Jeanne d’Arc, et leur donner une intelligence plus vraie et plus juste de la vie et du caractère de la Pucelle d’Orléans que celle qui a eu cours communément en Angleterre. À ce propos, on peut se demander quelle doit être l’attitude d’un Anglais au souvenir des défaites infligées à ses ancêtres par le bras de la Pucelle.
Si Jeanne a été suscitée par Dieu, si elle est venue, conformément à la légende inscrite sur sa bannière, de par le roy du ciel, il n’y a rien qui puisse offenser l’orgueil national. En présence de la manifestation de la volonté divine, il n’y a place que pour une joyeuse soumission.
[Il constate que la Pucelle n’aspirait qu’à rétablir la paix en France et fit toujours preuve de compassion envers les Anglais. Pourtant, au lieu de lui témoigner gratitude et admiration, les chroniqueurs anglais l’ont accablée d’insultes.]
Je n’ai à ajouter comme conclusion que celle-ci, en conformité des décrets de Urbain VIII : je soumets avec la plus entière déférence tout ce que j’ai écrit au jugement du Saint-Siège.
Sainte-Marie-des-Anges, Baiswater (Londres, W.), août 1891.
Note du traducteur
Il est intéressant, au point de vue du mouvement de l’opinion en Angleterre, de rapprocher de ces paroles la déclaration que faisait entendre, le 8 mai 1857, dans la chaire de Sainte-Croix, Mgr Gillis, vicaire apostolique d’Édimbourg, chargé de prononcer le panégyrique de Jeanne d’Arc :
Je n’ai, après tout, à faire qu’un aveu, — et cet aveu, on l’accueillera avec indulgence de la part d’un évêque d’Angleterre, quand il ne le dirait pas en bon français : qu’il y a une page que, pour l’honneur de son pays, il voudrait n’avoir jamais trouvé place dans l’histoire, celle qu’éclaire à notre honte le bûcher de Rouen !… Je viens, de parmi ceux qui la brûlèrent, inscrire au temple de sa mémoire, non une apologie de ses vertus, mais l’aveu du crime de mes pères, et comme déposer au pied de sa sainte image l’offrande bien tardive d’une réparation de justice.
La Pucelle d’Orléans à la lumière des documents originaux
Réimprimé, avec autorisation de la Revue de Dublin, janvier 1891.
- Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d’Arc, par Pierre Lanéry d’Arc. Paris, 1889.
- La Pucelle devant l’Église de son temps, par Jean-Baptiste-Joseph Ayroles. (S. J.) Paris, 1890.
- Le Martyre de Jeanne d’Arc, par Léo Taxil et Paul Fesch. Paris, 1890.
Dans le cours de ces douze derniers mois (ceci était écrit en août 1890), trois livres ont été publiés, qui mettent à la portée du public un certain nombre des principaux documents originaux se rapportant à la Pucelle d’Orléans. En 1841, Quicherat entreprit pour la Société de l’Histoire de France la publication des textes latins de la Procédure relative à la Condamnation et à la Réhabilitation de Jeanne d’Arc. Il y eut là toutefois certaines omissions, notamment parmi les avis écrits des théologiens qui furent consultés, lorsqu’en 1455, sous la direction du pape Calixte III, la sentence de condamnation fut soumise aux investigations d’une enquête.
Ces omissions ont été réparées par M. Pierre Lanéry d’Arc, qui a publié le texte original latin des consultations. Elles remplissent un volume in-8° de 600 pages. Parmi elles se trouve la Recollectio ou le résumé de tous les témoignages et consultations, par Jean Bréhal, inquisiteur pour la France.
Conformément au rescrit du pape Calixte III, son assistance avait été requise par les délégués du pape, qui étaient l’archevêque de Reims et les évêques de Paris et de Coutances. Dans cette Recollectio, qui occupe plus de 160 pages, toutes les questions concernant Jeanne d’Arc sont traitées à fond, au double point de vue théologique et légal. Bréhal conclut en affirmant que la procédure, en la forme et au fond, aussi bien que la sentence, contient une injustice manifeste
.
Au moment où le livre de M. d’Arc paraissait, le P. Ayroles, S. J., avait déjà sous presse un ouvrage sur le même sujet général. Son livre contient un historique des recherches relatives à la mission de Jeanne d’Arc, depuis son arrivée, en 1429, à la cour de Charles VII, jusqu’à la clôture du procès de réhabilitation (7 juillet 1456), lorsque la sentence de condamnation fut solennellement révisée et annulée. Il donne plus loin une analyse des consultations déjà citées, reproduisant les passages les plus importants. Pour ramener les lecteurs que le latin pourrait éloigner, tout l’ouvrage est en français.
Dernièrement, les travaux combinés de M. Léo Taxil et de l’abbé Paul Fesch ont donné au public une version française des pièces complètes du procès de condamnation, annotées de nombreux extraits du procès de réhabilitation. On promet une édition in-4° de cet ouvrage, qui contiendra le texte latin à côté de la traduction, et aussi des fac-similé photographiques des plus importants documents.
Le but des pages suivantes est de tracer une peinture fidèle du jugement de Jeanne à Rouen, fondée sur les documents originaux. Pour donner de l’unité au tableau et placer les événements et les arguments en leur ordre véritable, nous adopterons la forme d’une narration continue. Nous devons toutefois nous excuser de présenter bien des points déjà familiers à ceux qui se livrent aux études historiques.
Note. — Excepté lorsque les notes au bas de la page indiquent d’autres sources, les passages cités sont tirés du Procès de condamnation, et on peut s’y référer, soit dans le volume de Léo Taxil, le Martyre de Jeanne d’Arc, ou dans Quicherat, t. I. — Pour la brièveté, nous citerons le Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, édité par Quicherat, par le simple mot Quicherat, avec le numéro du volume et de la page. De même, nous citerons : la Pucelle devant l’Église de son temps, le Martyre de Jeanne d’Arc, seulement par le nom de son auteur, soit Ayroles ou Taxil. N.-B. Les témoignages sont presque entièrement relatés en la forme indirecte, quoique parfois les paroles soient indiquées comme ayant été elles-même prononcées. Pour éviter la monotonie, j’ai transformé les demandes et les réponses en conversation directe, ce qui rend la narration plus vivante.
Noces d’argent de l’archevêque de Rouen 30 juin 1892
Discours sur Jeanne d’Arc du père dominicain Jacques Monsabré (1827-1907) lors des noces d’argent de Mgr Thomas, archevêque de Rouen (30 juin 1892), où il recommande les deux ouvrages du père Ayroles.
Source : Discours sur Jeanne d’Arc (Rouen, Cagniard, 1892, 124 p.), p. 91-117.
Liens : Google.
La Gloire de Jeanne d’Arc. — Discours prononcé en la cathédrale de Rouen par le T. R. P. Monsabré à la cérémonie des noces d’argent de Monseigneur l’archevêque.
[Note, p. 109 :]
Voyez le grand ouvrage du R. P. Jean-Baptiste Ayroles, de la Compagnie de Jésus : La vraie Jeanne d’Arc, la Pucelle devant l’Église de son temps, documents nouveaux. Je remercie ici le R. P. Ayroles des renseignements précieux que j’ai trouvés dans cet ouvrage, ainsi que dans son volume : Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France. Plus cordialement encore, je remercie mon frère en religion, le R. P. Chapotin, qui, dans son ouvrage, Jeanne d’Arc et la guerre de Cent-Ans, a si victorieusement réfuté les accusations de M. Siméon Luce, à l’endroit des Dominicains.
[Dans une autre note, p. 110, Monsabré cite Ayroles sur le rôle central de Jean Bréhal (dominicain comme lui) à la réhabilitation.]
Études avril 1893
Compte-rendu de l’ouvrage : L’Armée anglaise vaincue par Jeanne d’Arc sous les murs d’Orléans de Boucher de Molandon et De Beaucorps, par le père Ayroles.
Critique élogieuse. On y apprend un fait surprenant concernant les archives anglaises en Normandie :
Dans leur fuites, les insulaires négligèrent d’emporter le dépôt des pièces officielles. Il y resta jusqu’en 1762, où il fut transféré à Paris. Là un triage, meurtrier pour l’histoire, anéantit ou livra aux vents bien des pièces qui feraient aujourd’hui les délices des érudits.
Ainsi que sur la langue de ces archives :
Les envahisseurs, dans leurs actes publics, usaient de la langue des vaincus.
Source : Études religieuses, etc., 1893, supplément aux tomes 58, 59 et 60, p. 270-273.
Lien : Gallica
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
Études octobre 1893
Comptes-rendus de deux ouvrages par le père Ayroles : Jean Bréhal et la Réhabilitation de Jeanne d’Arc des pères Belon et Balme ; Jeanne d’Arc et les Franciscains de Léon de Kerval.
Long éloge du livre des pères Belon et Balme, sur un sujet qu’il a traité dans le tome I de sa Vraie Jeanne d’Arc.
Il est particulièrement frappé de la parfaite conformité d’une multitude de jugements, d’appréciations, de notices biographiques, qu’il est facile de constater dans les deux ouvrages.
Il n’en est pas de même pour celui de Léon de Kerval, voué à l’erreur pour s’être appuyé sur la Jeanne d’Arc à Domrémy de Siméon Luce, dont le père Ayroles promet une entière réfutation dans son tome II à venir.
Source : Études religieuses, etc., 1893, supplément aux tomes 58, 59 et 60, p. 749-752.
Lien : Gallica
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]