Documentation : Vraie Jeanne, III (1897-1898)
La Vraie Jeanne d’Arc, t. III 1897-1898
Cosmopolis 1er janvier 1897
Dans sa chronique Notes on new books, Andrew Lang commente Joan of Arc de Francis C. Lowell, et remarque que l’auteur ignore la chronique de Morosini, récemment publiée par le père Ayroles.
Source : Cosmopolis, revue internationale (Paris, Armand Colin), n° 13, janvier 1897, t. V, p. 68.
Lien : Gallica.
Though it is a book in English, not an English book, Mr. Francis C. Lowell’s Joan of Arc
may perhaps be noticed here. It is decidedly the most learned and accurate work on the Maid of Orleans in our language, but it is also almost studiously unpopular. […] For the rest, Mr. Lowell seems to have studied all authorities, except, apparently, Captain Marin, on Jeanne’s campaigns, and Father Ayroles’ translations of the Venetian correspondence.
Lettres d’Uclès 1897
Communication du père Ayroles : Les anciens Jésuites français pendant la Révolution, datée de Paris, le 9 décembre 1896.
À l’occasion de l’introduction de la cause de béatification des 16 carmélites de Compiègne, exécutées par le tribunal révolutionnaire à l’été 1794, le père Ayroles exhorte la Compagnie à s’intéresser à la vie de jésuites, martyrs de la Révolution ou ayant mené une vie édifiante, dont la cause pourrait également être proposée.
Source : Lettres d’Uclès (bulletin des jésuites de Toulouse, exilés à Uclès en Espagne), 2e série, t. IV, 1897, p. 241-243.
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
L’Univers 9 février 1897
Annonce de la parution prochaine du t. III de la Vraie Jeanne d’Arc : La Libératrice, bientôt suivie du t. IV : La Vierge guerrière.
Vente par souscription : coût 15 francs, 10 pour ceux qui auront souscrit avant le 1er mars.
Lien : Retronews
Un Monument à Jeanne d’Arc. — On dresse beaucoup de statues de nos jours ! Bientôt, dans Paris, chaque place, chaque carrefour aura son monument ! Chaque bourg, chaque village même aura sa statue en pierre ou en métal ! Parmi toutes ces idoles encensées dans les pompes officielles, acclamées par la faveur populaire, combien verront leur piédestal se changer en Roche tarpéienne d’où les précipiteront ceux-là mêmes qui les ont élevées.
Il est des monuments plus durables, croyons-nous, moins encombrants, et qui, pour avoir été élevés dans l’ombre, le silence et la retraite, n’en sont pas moins des monuments magnifiques. Tel est celui qu élève patiemment à son héroïne l’auteur de la Vraie Jeanne d’Arc.
Le R. P. Ayroles fidèle à la recommandation de Léon XIII, qui tout en louant si hautement les deux premiers volumes a daigné lui dire de continuer allègrement l’exécution d’un plan que Sa Sainteté a bien voulu bénir, va publier, dès le 1er mars, le troisième volume de son gigantesque travail : La Libératrice, d’après les documents français et anglo-bourguignons et la Chronique inédite de Morosini.
Avec le quatrième volume, qui suivra de près : La Vierge guerrière, d’après les aveux, les témoins oculaires et la chrétienté, ce sera incontestablement le recueil le plus complet qui ait été publié sur la vie guerrière. On y trouvera des pièces inédites du plus haut intérêt, telles que la chronique de Morosini ; d’autres le sont implicitement, disséminées qu’elles sont dans une foule de recueils disparates que l’on ne trouve qu’à la bibliothèque nationale.
Jeanne d’Arc, telle que Dieu l’a faite, ne sera connue que lorsqu’elle sera étudiée dans les sources si nombreuses de son histoire. Le Père Ayroles veut les rendre accessibles à quiconque sait lire. Voilà pourquoi il traduit ou rajeunit les textes, tout en en respectant très scrupuleusement le sens, en mettant au bas des pages ou aux pièces justificatives, les passages plus importants, ou plus rares ; il les ordonne sans les mutiler ; il en fait connaître la valeur et l’autorité, en en faisant connaître la provenance.
C’est le moyen de faire évanouir les récits qui mutilent, voilent ou caricaturent la céleste figure. L’école gallicane et régalienne l’a mutilée et voilée en faisant finir la mission à Reims ; l’école naturaliste est forcée de la travestir sous peine de se donner un coup mortel. Il faut qu’elle apparaisse dans l’intégrité de sa splendeur, preuve irréfragable de notre foi tout entière, livre plein d’enseignements pour toutes les conditions, radieuse manifestation du Dieu incarné, dans sa vie obscure, dans sa vie publique, et plus encore dans sa passion.
L’exécution typographique de la Vraie Jeanne d’Arc, caractères, papier, devait être et est en harmonie avec le plan. Les souscripteurs à tous les volumes les paient 10 francs le volume ; chaque volume formant un tout, ceux qui n’en demandent qu’un seul le paient 15 francs, à moins qu’ils n’aient souscrit dans le délai fixé avant la publication — pour celui que nous annonçons (le 3e) avant le 1er mars.
Les noms de ceux qui auront souscrit à l’entière publication seront dans le prochain volume.
L’Univers 10 février 1897
Encart publicitaire avec plan de la publication des cinq volumes.
Lien : Retronews
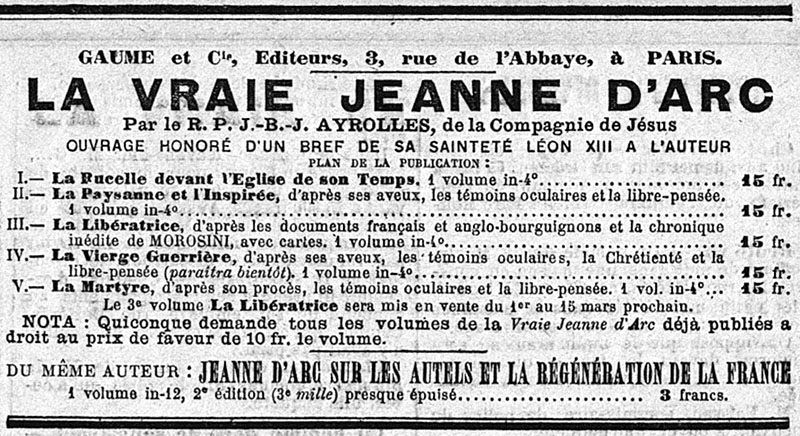
Gaume et Cie, Éditeurs, 3, rue de l’Abbaye, Paris. — La Vraie Jeanne d’Arc, par le R. P. J.-B.-J. Aryolles, de la Compagnie de Jésus. Ouvrage honoré d’un bref de Sa Sainteté Léon XIII à l’auteur.
Plan de la publication :
- La Pucelle devant l’Église de son Temps. 1 volume in-4°, 15 fr.
- La Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée. 1 volume in-4°, 15 fr.
- La Libératrice, d’après les documents français et anglo-bourguignons et la chronique inédite de Morosini, avec cartes. 1 volume in-4°, 15 fr.
- La Vierge Guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la Chrétienté et la libre-pensée (paraîtra bientôt). 1 volume in-4°, 15 fr.
- La martyre, d’après son procès, les, témoins oculaires et la libre-pensée. 1 vol. in-4°, 15 fr.
Le 3e volume La Libératrice sera mis en vente du 1er au 15 mars prochain.
Nota : Quiconque demande tous les volumes de la Vraie Jeanne d’Arc déjà publiés a droit au prix de faveur de 10 fr. le volume.
Du même auteur : Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France. 1 volume in-12, 2e édition (3e mille) presque épuisé, 3 francs.
La Croix 14 février 1897
Annonce de la parution imminente du t. III, et reproduction du bref de Léon XIII. (Un compte-rendu paraîtra dans l’édition du 10 juin.)
Lien : Retronews
Le IIIe volume de la superbe histoire que le R. P. Ayroles de la Compagnie de Jésus, consacre à la Vie de Jeanne d’Arc est sur le point de paraître, chez Gaume et Cie, éditeurs, 3, rue de l’Abbaye à Paris, comme les deux premiers.
Ce volume qui aura pour titre : La Libératrice, d’après des documents français et anglo-bourguignons, et la chronique inédite de Morosini, ne comptera pas moins de 650 à 700 pages et plusieurs cartes. Prix, 15 francs.
C’est sous le plus haut des patronages que ce 3e volume s’adresse aux anciens et aux nouveaux amis de la vraie Jeanne d’Arc. Le Souverain Pontife Léon XIII a daigné, en effet, adressé au R. P. Ayroles, une lettre où Sa Sainteté s’exprime ainsi :
Dans l’œuvre vaste et laborieuse depuis longtemps entreprise par vous, de mettre en lumière là figure de la vénérable vierge, Jeanne d’Arc, vous répondez déjà dignement à l’attente des doctes, et par la richesse de l’érudition et par la sagesse de vos jugements et encore que pour la continuer et la poursuivre, vous n’ayez besoin ni d’exhortations ni d’éloges, il Nous plaît cependant, à raison de l’importance de l’œuvre, de vous départir encouragements et louanges.
C’est qu’en effet, celle qui est l’insigne honneur de votre patrie l’est en même temps de la religion catholique, dont les lumières et la direction, plus que toute autre cause, ont en tout temps fait conquérir à la France les fleurons de la vraie gloire.
Conduisez donc votre travail en sorte que — ce qui est votre but principal — tout ce grand fait de la Pucelle, non seulement ne soit en rien amoindri par les coups des ennemis de la religion, mais en sorte plus constant et plus éclatant.
En tête de ces ennemis, il faut placer ceux qui, dépouillant les exploits de la magnanime et très pieuse Vierge de toute inspiration de la vertu divine, veulent les réduire aux proportions d’une force purement humaine ; ou ceux encore qui, de son inique condamnation, portée par des hommes ennemis très acharnés de ce Siège, osent bien faire un thème d’incrimination contre l’Église.
Réfuter sagement, à la lumière et sur la foi des documents, pareilles assertions et celles qui s’en rapprochent, est de très grande importance ; c’est une excellente manière de bien mériter de la religion et de l’État.
Ne cessez donc pas, bien-aimé fils, de poursuivre allègrement ce travail, maintenant surtout que Notre récent décret a ouvert le cours canonique et régulier de cette sainte cause.
La lettre du Saint-Père se termine par l’envoi de la bénédiction apostolique.
Quand nous aurons le troisième volume, nous nous hâterons de l’analyser, en attendant, nous sommes heureux de féliciter une fois de plus très cordialement le savant religieux qui élève ainsi à la gloire de Jeanne d’Arc un monument plus précieux que ceux de bronze et de marbre.
Annales religieuses du diocèse d’Orléans 5 mars 1897
Institution du tribunal apostolique sur l’héroïcité des vertus, la partie la plus longue et la plus importante de la cause de Béatification
.
Source : Annales religieuses du diocèse d’Orléans, vol. 37, p. 151, vendredi 5 mars 1897.
Lien : Google
Cause de la vénérable Jeanne d’Arc. — La Cause orléanaise de Jeanne d’Arc, introduite en Cour de Rome le 27 janvier 1894, après avoir triomphé du procès de non culte
, entre aujourd’hui dans la période directe, qui, s’il plaît à Dieu, doit avoir pour dénouement le décret de Béatification.
Lundi 1er mars, à 10 heures, dans la chapelle de l’Évêché, a commencé le Procès apostolique, sur l’héroïcité des vertus de la Vénérable Jeanne d’Arc, pucelle d’Orléans. C’est la partie la plus longue et la plus importante de la Cause de Béatification.
Des témoins d’une haute compétence auront à répondre, sous la foi du serment, aux interrogatoires, envoyés de Rome, par le promoteur de la foi, Mgr Persiani, et à cent quarante-six articles, posés par le postulateur de la Cause, M. Hertzog.
Le tribunal est ainsi constitué :
- Juges : Mgr l’Évêque d’Orléans et son grand vicaire M. l’abbé d’Allaines, assisté de MM. Agnès, Dulouart, Génin, Castera, chanoines titulaires.
- Promoteur fiscal : M. Boulet, chanoine honoraire.
- Sous-promoteur : Despierre, Archiprêtre de la cathédrale ;
- Vice-postulateur : M. Clain, directeur au grand séminaire ;
- Notaire : M. Filiol, chancelier de l’Évêché.
Nous recommandons instamment et plus que jamais aux prières du Clergé, des Communautés religieuses et des fidèles, ce nouveau procès : c’est à Dieu d’éclairer juges et témoins ; c’est à Dieu seul qu’il appartient de mettre en lumière les grands
miracles, souhaités naguère par Sa Sainteté, et requis par la Sacrée Congrégation des Rites pour manifester et confirmer l’héroïcité des vertus de la Vénérable.
La Gazette 5 mars 1897
Annonce de la sortie du t. III de la Vraie Jeanne d’Arc.
Lien : Retronews
Questions Religieuses. — Un savant religieux s’applique depuis plusieurs années à élever un monument a Jeanne d’Arc, sous ce titre : La Vraie Jeanne d’Arc. Le troisième volume, intitulé : La Libératrice, paraît en ce moment. Il est précédé d’une lettre que le Pape Léon XIII adressait au P. Ayroles pour l’encourager dans son travail si rempli de sentiments religieux et patriotiques. [Suit la teneur du bref.]
Annales religieuses du diocèse d’Orléans 9 avril 1897
Le père Ayroles témoigne à Orléans dans le procès apostolique sur l’héroïcité des vertus.
Source : Annales religieuses du diocèse d’Orléans, vol. 37, p. 229, vendredi 9 avril 1897.
Lien : Google
Cause de la vénérable Jeanne d’Arc. — Le Tribunal, constitué et installé le 1er mars, pour faire le procès apostolique sur l’héroïcité des vertus de la Vénérable Jeanne d’Arc, Pucelle d’Orléans, a commencé ses audiences, le 12 mars, pour entendre la prestation de serment de plusieurs témoins d’Orléans. Il siège depuis le 1er avril sauf le dimanche, pour entendre les dépositions du R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, l’historien apologétique de la vraie Jeanne d’Arc
.
Les fidèles du diocèse d’Orléans, dont cette Cause est la leur (Aurelianen), n’oublieront pas, dans leur prières quotidiennes, de la recommander à Dieu, et surtout le 30 de chaque mois : ils aideront ainsi puissamment les juges ecclésiastiques et les témoins à mener à bien une instruction aussi délicate que laborieuse.
[Au-dessus, extrait de la Semaine religieuse de Toulouse, sur le voyage de Mgr Touchet dans la ville.]
Nous avons appris que Mgr l’Évêque d’Orléans venait d’être chargé par le Saint-Siège de procéder à de nouvelles informations canoniques en vue de la canonisation de la vénérable Jeanne d’Arc. Cette information portera, croyons-nous, sur la question de l’héroïcité des vertus et peut-être aussi sur les miracles. Elle marque une étape de plus dans la marche du procès. À cette occasion, on demande un redoublement de prières. Mgr l’Évêque d’Orléans désirerait que les amis de la Pucelle fissent une communion, à cette intention spéciale, le 30 de chaque mois ; on sait que la pieuse héroïne fut brûlée le 30 du mois de mai. À défaut de communion, on pourrait réciter quelques dizaines de chapelet. La cause si chère aux cœurs français donne en ce moment de belles espérances. Un personnage qui est à même d’être informé nous disait : Nous avons certains indices desquels on pourrait induire que Jeanne veut se presser.
Polybiblion mai 1897
Compte-rendu critique par Marius Sepet de cinq Ouvrages récents sur Jeanne d’Arc, dont : — 1. le tome III de la Vraie Jeanne d’Arc du père Ayroles, — 2. son allocution à l’église Saint-Denis de la Chapelle, le 8 septembre dernier (voir).
Les quelques réserves méthodologique de l’historien s’évanouissent devant la somme de travail du docte religieux
:
Non seulement, ce qui est son objet principal, il aura mis ainsi en plus vive lumière les caractères surnaturels de l’héroïque vierge de France, mais, par la masse énorme de faits et de textes remués, rapprochés, confrontés, discutés dans ce livre aux proportions gigantesques, il aura certainement ouvert la voie à des progrès importants de la science historique et bibliographique.
Source : Polybiblion, revue bibliographique universelle, 2e série, t. 45, 1897, p. 397-400.
Lien : Google
1. La Vraie Jeanne d’Arc. III. La Libératrice d’après les chroniques et les documents français et anglo-bourguignons, et la chronique inédite de Morosini, par Jean-Baptiste-Ayroles, de la Compagnie de Jésus. Ouvrage honoré d’un bref de Sa Sainteté Léon XIII. Paris, Gaume, 1897, in-4 de XVI-696 p. et deux cartes, 15 fr. Pour les souscripteurs à l’ouvrage entier, 10 fr.
Le R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, poursuit avec une rare intrépidité de labeur le vaste ouvrage de vulgarisation, de recherches et de discussion, qu’il a entrepris sous ce titre : La Vraie Jeanne d’Arc (Cf. Polybiblion, t. LXX, p. 406). Le tome III vient de voir le jour. Il est consacré aux chroniques et autres documents relatifs à la carrière militaire de l’héroïque vierge, provenant soit du parti national, soit du parti anglo-bourguignon, et, en plus, à la chronique vénitienne de Morosini, récemment découverte. L’auteur réserve pour le volume suivant les chroniques et documents provenant d’autres nations étrangères et aussi les témoignages consignés dans les deux procès sur la vie guerrière de Jeanne.
On y entendra, (dit-il), la chrétienté entière du XVe siècle, les témoins oculaires des merveilleux exploits, la libératrice elle-même nous révéler ce que furent les événements de cette période, et surtout la sainteté de celle qui les conduisait.
En ce qui concerne le présent volume, l’auteur en définit ainsi le contenu et la disposition :
C’est d’abord un exposé des deux partis en lutte, et une brève notice des personnages qui étaient à leur tête à l’arrivée de Jeanne. Cela nous évitera des renvois à des notes qui interrompraient la lecture. Un exposé sommaire de l’art de la guerre au commencement du XVe siècle fera mieux comprendre combien fut merveilleuse la jeune fille de dix-sept ans que l’on y vit exceller, sans que rien l’y eût préparée. La description d’Orléans, l’histoire rapide du siège qui durait depuis sept mois, l’état désespéré des habitants, une double carte, l’une de la France à l’arrivée de Jeanne, l’autre d’Orléans, dues à notre confrère, le R. P. Carrez, nous ont paru indispensables pour l’intelligence des chroniques.
Comment disposer ces chroniques ? Une double division s’offre d’elle-même. D’une part les chroniques et les documents venant du parti français ; de l’autre les chroniques et les documents émanés du parti anglo-bourguignon. Pareille disposition s’accommode assez sensiblement à l’ordre chronologique, car le parti français abonde en pièces qui nous font connaître les événements depuis l’arrivée à Chinon jusqu’à la levée du siège de Paris, et il est fort maigre sur ce qui a suivi. Le parti ennemi, au contraire, moins étendu sur la première partie de la vie guerrière, l’est beaucoup plus sur la seconde.
Chroniques et documents sont des deux côtés nombreux et disparates. Ils ont été subdivisés de la manière suivante. Dans le parti français, neuf chroniques plus étendues nous donnent, avec plus ou moins de détails, la suite des faits jusqu’au siège de Paris. Elles forment le second livre. Des chroniques beaucoup plus brèves, des documents de genres divers, des lettres, des pièces officielles ont trait seulement à quelques faits particuliers ; c’est le livre troisième. Autant que cela a été possible, sans les mutiler, elles ont été classées dans l’ordre chronologique des événements sur lesquels elles jettent plus de lumière. Afin de faciliter le rapprochement des divers récits d’un même fait, des divisions communes ont été introduites dans les chroniques. Les principales sont : De Chinon à Orléans ; — La Levée du siège d’Orléans ; — La Campagne de la Loire ; — La Campagne du sacre ; — La Campagne après le sacre. L’ordre dans lequel sont rangées les pièces du troisième livre correspond sensiblement à ces divisions.
Une subdivision différente a été introduite dans les pièces venant du parti anglo-bourguignon. À la froideur près, il est de ce côté des chroniques qui sont peu ou point hostiles : elles ont été groupées dans le quatrième livre. D’autres, au contraire, sont manifestement haineuses elles forment le cinquième livre. Le sixième est consacré à la chronique de Morosini. Le septième livre est réservé aux pièces justificatives et à la table.
Le texte des chroniques ou pièces en vieux français a été rajeuni par l’auteur.
Le travail de rajeunissement a porté d’abord sur l’orthographe, qui a été modernisée. Aux mots que ne comprendrait pas de prime abord un lecteur médiocrement instruit ont été substitués les termes aujourd’hui usités. Un déplacement de mots a suffi parfois pour rendre facile l’intelligence de phrases confuses dans le texte… Ne faire dire à l’écrivain que ce qu’il a dit, tout ce qu’il a dit, a été l’objet d’une préoccupation constante… Sans parler de plusieurs textes originaux reproduits aux pièces justificatives, on trouvera, au bas de la page, ceux qui ont paru amphibologiques ou avoir une importance spéciale.
Sur chacun des textes ainsi rapportés par lui au plan de son livre le P. Ayroles a donné des renseignements et remarques historiques et critiques. En tête des fragments de la chronique de Morosini relatifs à Jeanne d’Arc, qui ne sont pas la partie la moins intéressante de ce volume, se trouvent d’utiles détails sur le caractère de ce document et les circonstances de sa découverte. La traduction offrait des difficultés spéciales. Le P. Ayroles a obtenu pour ce travail le précieux concours de M. Baroncelli, sous-bibliothécaire de la Marcienne
à Venise.
L’idée et la physionomie quelque peu complexes, quelque peu touffues de ce vaste ouvrage, certains excès de jugement et d’expression, ont pu et dû donner lieu à de justes réserves, soit au point de vue de la méthode scientifique, soit au point de vue de la composition littéraire. Mais au degré d’avancement où il est maintenant parvenu, insister sur ces réserves ne serait plus très à propos. Mieux vaut exprimer le vœu sincère que le docte religieux en mène à bien l’achèvement auquel, très volontiers docile au conseil que lui en a donné le Saint-Père, dans un bref conçu en termes des plus favorables, le R. P. Ayroles ne cesse de travailler allégrement. Non seulement, ce qui est son objet principal, il aura mis ainsi en plus vive lumière les caractères surnaturels de l’héroïque vierge de France, mais, par la masse énorme de faits et de textes remués, rapprochés, confrontés, discutés dans ce livre aux proportions gigantesques, il aura certainement ouvert la voie à des progrès importants de la science historique et bibliographique.
2. Jeanne d’Arc à la Chapelle-Saint-Denys. Allocution prononcée à la Chapelle-Saint-Denys, le 8 septembre 1896, par le même. Paris, imp. Léon Parly, in-12 de 20 p. (Se vend au profit de l’église de Saint-Denys de la Chapelle).
Le zèle qui enflamme le P. Ayroles pour la gloire de Jeanne d’Arc ne se manifeste pas seulement dans l’ardeur avec laquelle il secoue la poussière des documents d’érudition et poursuit d’estoc et de taille les détracteurs ou même les admirateurs jugés par lui mal inspirés de cette céleste figure. Il ne néglige pas une occasion de célébrer ses mérites et de préparer son culte futur. C’est ce qu’il a fait avec éloquence, le 8 septembre dernier, dans une allocution vraiment fort belle, prononcée à la Chapelle-Saint-Denys, le 8 septembre 1896, et intitulée : Jeanne d’Arc à la Chapelle-Saint-Denys. Ce discours, profondément nourri d’histoire, n’est certainement pas l’un des moins dignes d’attention et d’estime parmi tant de panégyriques déjà consacrés à la vierge libératrice.
[Les autres ouvrages présentés sont : 3. Jeanne d’Arc modèle et patronne du patriotisme chrétien et français, discours du père dominicain Jacques Monsabré prononcé le 10 mai 1896 à Notre-Dame. — 4. Domrémy et le Monument national de Jeanne d’Arc, par l’abbé Victor Mourot. — 5. Un Compagnon de Jeanne d’Arc, Artur III, comte de Richemont, connétable de France, duc de Bretagne, par Léon Trébuchet.]
Études 5 mai 1897
Compte-rendu favorable du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc, par le père Étienne Cornut.
Une fois achevée, l’œuvre du père Ayroles formera une Somme historique où quiconque voudra parler ou écrire de la Libératrice y viendra puiser à pleines mains
.
C’est d’ailleurs ce que l’on fait déjà beaucoup de discours, de brochures et de livres, en le disant ou en le sous-entendant, empruntent ses traductions, ses aperçus, ses exposés, ses conclusions et parfois ses phrases.
Voir également son compte-rendu du tome I, dans : Études, juin 1890.
Source : Études religieuses, etc., 38e année, tome 88, 20 juillet 1901, p. 412-415.
Liens : Gallica.
Le R. P. Ayroles continue avec une rare ardeur le monument qu’il élève à la Vraie Jeanne d’Arc
. Le troisième volume vient de paraître nous lui souhaitons le même succès qu’à ses aînés. Il le mérite.
Son titre indique ce qu’il contient. Analyser les sept cents pages de ce beau livre serait une fois de plus raconter la vie de l’héroïne. Rappelons plutôt quel est le but poursuivi par le savant auteur : mettre à la portée de tout homme instruit les sources mêmes de cette merveilleuse histoire. C’est à la fois œuvre de science et de haute vulgarisation, de discussion et de recherches.
J. Quicherat avait publié un grand nombre de textes authentiques mais son recueil déjà ancien est incomplet, défectueux et peu abordable. L’illustre paléographe a commis des omissions regrettables. Il ne faut pas s’en étonner. Quicherat ne croyait pas à la mission surnaturelle de Jeanne d’Arc, comme le prouvent les Nouveaux aperçus, où il a consigné ses idées philosophiques. Égaré par cette erreur capitale, l’érudit était logiquement conduit à négliger des documents qui sont, en réalité, de premier ordre. Les défaillances de détail, inévitables dans un travail si considérable, sont ainsi aggravées systématiquement.
À ce travail de Quicherat repris, redressé et mis au point, l’infatigable religieux ajoutera de nombreuses pièces dispersées jusqu’ici dans diverses collections. Mais ce n’est là que le côté matériel et le plus facile de sa tâche.
Les chroniques écrites en latin du moyen-âge ou même en vieux français ne sont pas d’une lecture aisée. Pour en saisir le sens exact et précis, il faut être familiarisé de longue date avec les mœurs, les faits, les institutions, les noms propres, la langue civile, ecclésiastique et militaire de l’époque. La culture générale et la sagacité naturelle ne peuvent suppléer à la préparation technique c’est ce que constate vite quiconque se met à l’œuvre. Le secours des glossaires ne suffit pas car la difficulté ne vient pas uniquement de l’ancienneté des mots, de l’étrangeté de l’orthographe et des variations du sens ; elle vient aussi de l’agencement des phrases où les incises mal liées s’accumulent et s’enchevêtrent.
Le R. P. Ayroles a jeté de la lumière dans ces obscurités par de substantielles notices et par une fidèle traduction. Ce dernier travail présentait deux écueils : altérer les textes ou leur enlever leur pittoresque et leur saveur. L’un et l’autre ont été évités avec un soin minutieux et un rare succès. De ces vénérables documents la rouille seule a disparu. Par surcroît d’exactitude, les passages ambigus, les expressions particulièrement caractéristiques se retrouvent dans leur forme originale au bas des pages, s’ils sont courts, à l’appendice, s’ils ont une certaine étendue. Toutes les inquiétudes seront ainsi calmées, toutes les objections ont été prévenues.
Pour mettre de l’ordre dans cet entassement, l’auteur a divisé les chroniques en deux séries d’abord les documents du parti français, qui donnent la suite des faits jusqu’au siège de Paris ensuite les documents du parti anglo-bourguignon, tantôt peu hostiles dans leur froideur, tantôt manifestement haineux et qui s’étendent principalement sur la seconde partie, de la guerre. Sans dislocation trop violente et sans mutilation on a ainsi l’ordre chronologique.
Le R. P. Ayroles ajoute à tous les documents déjà connus la Chronique inédite de Morosini, dont il est inutile de parler longuement, puisque les Études en ont eu la primeur ; mais le texte et la traduction ont été beaucoup amendés. Non seulement les lettres qui la composent sont l’expression du sentiment que la Pucelle produisait dans la chrétienté et de ce que la renommée publiait sur son compte, mais elles confirment ce qui est écrit ailleurs et donnent quelques nouveaux détails. On y voit notamment que la mission de Jeanne ne devait pas se terminer à Reims, après le sacre, mais qu’à cette première phase devait en succéder une seconde plus profitable à la chrétienté, à condition que le roi, les grands et le peuple suivraient les conseils de l’Inspirée. Cette partie conditionnelle n’a pas été réalisée par la faute des contemporains, comme il est arrivé pour quelques prophéties bibliques. Gerson avait prévu cette hypothèse et déclaré hautement que l’insuccès de la fin ne prouvait rien contre la réalité de la mission.
Un exposé sommaire des événements qui ont précédé, de l’art de la guerre au commencement du XVe siècle et des deux partis en lutte, une carte de la France à l’arrivée de Jeanne et un plan de la ville d’Orléans, de précieuses notes aident à l’intelligence des chroniques.
Grâce il tous ces secours la lecture de ces larges pages, où revit la vraie Jeanne d’Arc, est facile, entraînante et lumineuse. On a la joie de respirer l’atmosphère où se meut l’angélique Libératrice et de suivre pas il pas la radieuse apparition depuis Chinon jusqu’à Orléans, autour de cette ville miraculeusement délivrée et pendant les trois campagnes de la Loire, du sacre et d’après le sacre. Rien n’est plus émouvant pour un Français que ce poème commencé par une virginale idylle, continué par une épopée guerrière et terminé par un drame qui est un martyre. Aucun récit moderne, si habile qu’il soit, ne donne l’impression des faits et des âmes et surtout du surnaturel qui rayonne sur la France, comme ces naïfs témoignages.
En résumé, le R. P. Ayroles a voulu recueillir avec une généreuse abondance et une scrupuleuse fidélité ce qui a été écrit d’important sur Jeanne d’Arc et le mettre en si belle et si pleine lumière que tous puissent directement y contempler et y admirer la Pucelle. Son œuvre complète formera une Somme qui pourra tenir lieu des travaux antérieurs. Si l’on peut discuter plusieurs détails de la mise en œuvre, l’on ne pourra que louer le zèle, la science et la bonne foi du traducteur et de l’érudit. À l’usage, on se convaincra de plus en plus que les textes de la Vraie Jeanne d’Arc ne sont jamais autre chose que des textes authentiques, et quiconque voudra parler ou écrire de la Libératrice y viendra puiser à pleines mains.
C’est d’ailleurs ce que l’on fait déjà beaucoup de discours, de brochures et de livres, en le disant ou en le sous-entendant, empruntent ses traductions, ses aperçus, ses exposés, ses conclusions et parfois ses phrases. Nous sommes persuadé que l’auteur voit dans ces emprunts un hommage, un encouragement et une récompense, car il n’a voulu qu’une chose en poursuivant cette entreprise colossale : être utile à la France et à l’Église en glorifiant dans la Vraie Jeanne d’Arc l’une des plus belles apparitions du surnaturel sur la terre.
Ét. Cornut, S. J.
L’Univers 7 mai 1897
Brève annonce de la sortie du t. III de la Vraie Jeanne d’Arc (juste avant les fêtes de Jeanne d’Arc) et promesse d’un véritable compte-rendu à venir.
Lien : Retronews
Nous voici aux fêtes annuelles en l’honneur de Jeanne d’Arc. De beaux discours pleins de foi et de patriotisme vont rappeler l’œuvre de la Libératrice et de la Vénérable. Nous pourrons en signaler plusieurs ; nous voudrions les signaler tous. En attendant nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui un nouveau volume du grand ouvrage du R. P. Ayroles : La Vraie Jeanne d’Arc. C’est un volume in-quarto de 700 pages. Comme les précédents, il est riche en documents et ces documents sont complétés, éclairés par de savantes observations et dissertations qui en montrent toute la valeur. Le P. Ayroles justifie de plus en plus le titre qu’il a donné à son précieux travail ; nous lui devrons la vraie Jeanne d’Arc
. Grâce à ses recherches, à ses découvertes, la mission et les travaux de la Pucelle, les obstacles qu’elle a rencontrés là où elle devait trouver appui, les jalousies, les ingratitudes, les embûches qui ont entravé sa marche seront bien connus. Il y aura par suite beaucoup à refondre dans son histoire et ce sera à son honneur. La Libératrice grandira encore et l’on verra mieux la Vénérable, la Sainte.
Ce n’est pas seulement sur le caractère et les actes de Jeanne d’Arc que le R. P. Ayroles jette de nouvelles lumières ; il fait voir aussi les sentiments du pays. Il y montre l’esprit public, très vivant, très pieux. Cette pauvre petite bergère, humble fille du peuple, eut tout de suite le peuple pour elle. Tandis que la plupart des courtisans et beaucoup de chefs militaires lui faisaient de l’opposition, elle n’avait dans la foule que des croyants et des admirateurs. Ce contraste est établi d’une manière saisissante par les témoins que fait entendre le docte et laborieux auteur de la Vraie Jeanne d’Arc.
L’Univers rendra bientôt compte de cet important volume. Ceci n’est qu’un premier remerciement.
E. V.
La Vérité 7 mai 1897
Compte-rendu du t. III de la Vraie Jeanne d’Arc, par l’historien Arthur Loth. En tant qu’ancien chartiste, il regrette (tout en le comprenant) le choix du père Ayroles d’avoir publié certains documents inédits dans une orthographe modernisée (sans y joindre le texte original). Cette observation ne l’empêche pas de tenir cette publication pour la plus importante qui ait été faite sur la merveilleuse héroïne
.
Quand l’ouvrage sera achevé, il contiendra certainement un tiers ou un quart de pièces de plus que dans la collection de Quicherat.
Lien : Retronews
Pour la fête de Jeanne d’Arc a paru le troisième volume du grand ouvrage consacré par le R. P. Ayroles à l’héroïque et vénérable Pucelle d’Orléans, ouvrage qui n’en est encore qu’à la moitié, mais qui déjà se présente comme la publication la plus importante qui ait été faite sur la merveilleuse héroïne.
Le présent volume montre en Jeanne d’Arc la libératrice.
On y trouve d’abord un état succinct des doux partis en lutte : le parti français, d’un côté, le parti anglo-bourguignon de l’autre, avec une courte notice sur les personnages qui étaient à leur tête ; puis un exposé sommaire de l’art de la guerre au XVe siècle, pour mieux faire ressortir l’action miraculeuse de la jeune capitaine qui n’avait appris nulle part la technique militaire ; enfin, une histoire résumée du siège d’Orléans, qui durait depuis sept mois, lorsqu’arriva la libératrice.
La partie la plus considérable du volume est consacrée à la publication des documents relatifs à la lutte dont la France fut le théâtre.
Ce n’en est qu’une première série, car dans le volume suivant, qui exposera l’action guerrière de Jeanne d’Arc, figureront les chroniques de provenance étrangère, notamment les chroniques belges, et les témoignages de la chrétienté entière du XVe siècle sur les exploits de la libératrice.
Le tome III contient l’ensemble des documents émanant des deux partis en présence, chroniques, journaux, mémoires, extraits d’ouvrages, registres, et, en particulier la célèbre chronique de Morosini, éditée ici pour la première fois. Ils sont partagés en deux groupes, selon leur caractère et leur provenance.
Le P. Ayroles expose la méthode qu’il a adoptée pour la publication de ses documents. Il a cru devoir, pour les rendre lisibles à tous les lecteurs, les rajeunir dans le fond et dans la forme, substituant des mots modernes à des termes devenus inintelligibles, et modernisant la vieille orthographe.
C’est un parti qui peut très bien se justifier, et qui aura certainement de nombreux approbateurs. Mais, quels que soient le tact et le respect avec lesquels le P. Ayroles a procédé à ces modifications, on pourra regretter aussi qu’il n’ait pas purement et simplement publié, selon les exigences de la critique actuelle, les pièces dans leur teneur originale.
Sous l’une ou l’autre forme, ils présentent le plus grand intérêt et font du présent volume un recueil précieux pour la vie de Jeanne d’Arc. Quand l’ouvrage sera achevé, il contiendra certainement un tiers ou un quart de pièces de plus que dans la collection de Quicherat sur les deux procès.
Le P. Ayroles aura grandement mérité de l’histoire et de la chrétienté par cette belle et utile publication, pour laquelle il dépense tant de zèle, tant de foi, tant de travail et tant de recherches. Ce sera là l’histoire complète de la vraie Jeanne d’Arc.
Arthur Loth.
Bibliographie de la France 22 mai 1897
Indexation du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc.
Source : Journal général de l’imprimerie et de la librairie, 86e année, 2e série, tome 41, p. 342.
Lien : Google
5175. — Ayroles (J. B. J.). — La Vraie Jeanne d’Arc. III : la Libératrice, d’après les chroniques et les documents français et anglo-bourguignons et la Chronique inédite de Morosini ; par Jean-Baptiste-Joseph Ayroles, de la Compagnie de Jésus. In-8°, XVI-696 pages et plan. Corbeil, imprimerie Crété. Paris, librairie Gaume et C. 15 fr.
Revue catholique des institutions et du droit juin 1897
Long compte-rendu du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc par Albert Desplagnes, qui loue l’ouvrage le plus considérable qu’on ait jamais publié sur la Libératrice
.
À propos de Quicherat :
Prétendre parler de Jeanne avec vérité en niant le surnaturel est bien la tentative la plus étrange qu’on puisse faire.
Desplagnes témoigne que la réfutation sans ambages des historiens naturalistes par le père Ayroles a provoqué des remous dans le milieu académique :
Le P. Ayroles ne laisse pas une de leurs allégations sans réponse ; il ne laisse pas debout une seule de leurs hypothèses fantaisistes. Certains esprits qui voudraient qu’on respectât toujours tout, sauf la vérité, prétendent que le savant Jésuite est souvent trop vif et n’a pas assez d’égards pour des savants ses devanciers.
Voir : Comptes-rendus de Desplagnes
Source : Revue catholique des institutions et du droit, 25e année, 28e volume, p. 574-579.
Lien : Gallica
Le R. P. Ayroles poursuit avec une infatigable ardeur son grand ouvrage sur Jeanne d’Arc. En 1885 il avait exposé ses vues et annoncé déjà son beau travail dans un livre intitulé : Jeanne d’Arc sur les autels, synthèse de sa pensée et de ce qu’il faut savoir sur la libératrice. En 1890, un premier volume du grand travail paraissait sous ce nom : La Pucelle devant l’Église de son temps. En 1894, le second volume nous donnait : La Paysanne et l’Inspirée. Trois ans après, le savant jésuite publie : La Libératrice, troisième volume de la série. Il prépare déjà les deux derniers volumes qui compléteront l’ouvrage : La Vierge guerrière et La Martyre.
Ce que nous connaissons du travail déjà si avancé nous permet d’en juger l’ensemble et d’en apprécier les parties terminées.
Le premier volume mous montrait ce qu’ont pensé et écrit de Jeanne les plus grands, les plus savants, les plus dignes représentants de l’Église à son époque. Le P. Ayroles, après une notice complète sur chacun de ses prêtres éminents, nous faisait connaître leurs écrits. Il résulte de ce volume, qu’en dehors des quelques prélats et prêtres hérétiques ou vendus aux Anglais et qui ont brûlé la libératrice de la France, toute l’Église de son temps l’a considérée comme une vierge sans tache, inspirée par Dieu et les saints, qui sous cette inspiration a accompli une mission formelle reçue du ciel, mission qui a été une suite de miracles et d’actes merveilleux fort au-dessus de la puissance humaine ; l’Église de France l’a regardée et vénérée dès son époque comme une sainte et une martyre.
Cette opinion très raisonnée de l’Église du temps est consignée dans de volumineux mémoires, et rien n’est mieux établi dans aucune histoire. Le grand travail du P. Ayroles, quant à ce, a été de faire connaître chacun des écrivains, de montrer leur valeur, et d’extraire de leurs écrits tout ce qui peut intéresser le lecteur, en le donnant traduit en français, du latin, langue dont se sont servis ces prêtres contemporains de Jeanne.
Le volume II, paru en 1894, et dont nous avons rendu compte dans la Revue, contenait tous les documents connus relatifs aux dix-sept premières années de notre sainte, c’est-à-dire à sa vie à Domrémy jusqu’à son départ pour Chinon. Ce volume plein d’un très vif intérêt est l’ensemble de tout ce qu’on sait sur l’enfance de cette vierge incomparable. Rien n’est pur et frais comme cette histoire si simple dont l’humble village de Domrémy a été l’heureux témoin. La plus belle des fleurs qui naissent dans nos vallées, loin de tout contact impur, qui ne voient que le ciel et vivent dans la solitude ignorée des bois ou des montagnes donne l’idée des dix-sept premières années de Jeanne. Mieux encore peut-on les comprendre en pensant aux saintes qui ont été dès leur plus jeune âge favorisées de visions et de communications célestes. La pureté, dans toutes sa candeur, la bonté et la douceur dans leur charme fécond, l’amour de Dieu illuminant cette âme virginale, tout cela est l’essence même de cette fleur sans pareille, éclose aux bords de la Meuse, et que Dieu choisit pour sauver notre patrie.
Le IIIe volume, paru trois ans après le second, contient les documents que l’histoire a gardés, relativement à l’exécution de la mission providentielle de Jeanne. Toutes les chroniques écrites de son temps et qui relatent les faits de guerre, les actes de la libération de notre territoire envahi et conquis, les mentions partielles ou complètes des diverses campagnes de Jeanne, depuis son arrivée à Chinon jusqu’à sa prise à Compiègne, voilà le sujet du volume actuel.
Le P. Ayroles a accompli un travail énorme pour vulgariser les sources de cette histoire nationale et permettre aux lecteurs les moins instruits de les connaître. Il donne d’abord une notice sur l’auteur de chaque chronique ou écrit, pour expliquer dans quelles conditions et dans quelles vues chacun d’eux a rédigé son mémoire. Il relate ensuite, traduit en français ou du moins dépouillé de la forme souvent peu intelligible du langage original, tout ce qui, dans l’écrit, est relatif à Jeanne. Enfin, dans les pièces justificatives, il reproduit le texte même de l’écrivain. Rien ne saurait être plus complet.
Pour faire mieux comprendre les chroniques, l’auteur commence par exposer l’état des deux partis français et anglo-bourguignon à l’arrivée de Jeanne : cet exposé contient une notice sur tous les personnages principaux qui seront mentionnés. Un sommaire de l’art militaire en 1429 permet de mieux apprécier ce qu’a fait la merveilleuse enfant de 17 ans qui du jour au lendemain a commandé des armées, dirigé des batailles et donné des leçons d’artillerie, de stratégie et de politique à de vieux généraux, aux princes et au roi.
Les chroniques sont divisées ainsi qu’il suit :
Les livres II et III contiennent les chroniques et documents du parti français. Le livre IV donne les chroniques et documents les plus modérés du parti anglo-bourguignon. Le livre V relate les documents ouvertement haineux et calomnieux de ce parti. Le livre VI est consacré à la chronique Morosini.
Cette dernière, chronique, à elle seule, donnerait un grand prix à l’ouvrage, car l’une des plus étendues et des plus importantes, elle était restée depuis quatre siècles et demi complètement inconnue et enfouie dans les archives de Venise et de Vienne avant que le P. Ayroles l’en ait tirée. De toutes les chroniques des pays étrangers elle est la plus intéressante. La première par ordre de dates, elle a été écrite au cours même des événements, et consiste en une série de lettres adressées de Bruges à Venise par un noble Vénitien mandant à son père ce qui se passait en France. Justiniani, l’auteur de ces lettres, était dans un lieu où l’on était vite et bien renseigné. Les nouvelles, pourtant, ne sont pas toujours exactes, et nous savons par notre expérience actuelle combien de nouvelles fausses circulent dans les temps troublés. Rappelons-nous seulement 1870 ! Mais il est certain que la série de ces lettres est des plus importantes en confirmant beaucoup de points déjà connus et en révélant quelques faits restés inconnus ou douteux. On y trouve notamment la seule assertion formelle des efforts tentés par Charles VII pour délivrer Jeanne.
Le texte vénitien de cette chronique et la traduction qu’en donne le P. Ayroles sont des documents précieux et qui assignent à son livre un rang exceptionnel. Les difficultés que l’auteur a éprouvées pour obtenir la communication de ces pièces étrangères et dans lesquelles il a été aidé par plusieurs savants français, peuvent donner une idée des travaux de tout genre dont les résultats sont consignés dans ce bel ouvrage, le plus considérable qu’on ait jamais publié sur la Libératrice.
Quicherat avait publié en partie un certain nombre de ces documents. Le P. Ayroles a revu tous les manuscrits originaux et a pu rectifier plusieurs erreurs de son devancier. La partie qui est commune aux deux publications est plus complète et bien plus correcte dans le livre actuel. Je ne parle pas des appréciations et des jugements, qui, chez Quicherat, ont été singulièrement obscurcis et altérés par le scepticisme de cet écrivain et son horreur du surnaturel.
Prétendre parler de Jeanne avec vérité en niant le surnaturel est bien la tentative la plus étrange qu’on puisse faire ; je n’y puis même voir le plus simple non sens, car s’il est dans l’histoire un personnage inexplicable avec les éléments purement humains, c’est assurément Jeanne d’Arc.
Voici les chroniques contenues au présent volume, dans l’ordre de l’auteur :
- La chronique de la Pucelle, des deux Cousinot ;
- le Journal du siège, d’Orléans ;
- la chronique de Jean Chartier ;
- la double chronique d’Alençon, par Perceval de Gagny ;
- le greffier de la Rochelle ;
- la chronique de Tourmay ;
- les chapitres de Thomas Basin sur la Pucelle ;
- le Hérault Berry ;
- les pages de Mathieu Thomassin sur Jeanne ;
- la chronique du Mont Saint-Michel ;
- l’Ordo de Chalons ;
- Pierre Sala ;
- l’abréviateur du procès ;
- Alain Bouchard et le Miroir des femmes vertueuses ;
- Jean Bouchet ;
- Jacques Gélu ;
- Jean le Féron ;
- Jean de Mâcon ;
- Guillaume Girault ;
- les lettres et actes de Charles VII ;
- Jean Rogier ;
- les archives de Reims ;
- lettres des trois seigneurs Angevins ;
- lettre de Jacques de Bourbon La Marche ;
- lettre du sire d’Albret ;
- extraits de divers auteurs du XVe siècle.
- Chronique de Monstrelet ;
- chronique des Cordeliers ;
- Gilles de Roye ;
- Châstelain ;
- le notaire Pierre Cauchon ;
- Clément de Fauquembergue ;
- Forestel ;
- Le Fèvre de Saint-Remy ;
- le faux bourgeois de Paris ;
- Chronique de Morosini.
Le P. Ayroles a complété ces documents par deux cartes ; l’une est un plan d’Orléans en 1429 ; ce plan permet au lecteur de suivre et de comprendre bien mieux les opérations du siège. L’autre carte montre la France au temps de Jeanne, avec l’indication des limites de la conquête anglaise le 29 avril 1429 et le 24 mai 1430. Cette même carte contient le tracé des voyages et campagnes de la Pucelle. Ces renseignements sont excellents ; peut-être gagneraient-ils en clarté s’ils étaient placés dans deux cartes distinctes et coloriées, de façon que l’œil puisse sans peine en embrasser l’ensemble.
Les documents ci-dessus ne sont pas les seuls qui relatent les actes de la Pucelle ; ce sont ceux qui exposent le mieux la suite des campagnes ayant amené la libération du territoire. Il en reste un grand nombre qui révèlent plus particulièrement le caractère, la personnalité de Jeanne ; ce sont notamment les si précieuses déclarations des témoins oculaires de sa vie guerrière ; ces documents auront leur place dans le volume prochain, dont le nom sera, si je ne me trompe : La Guerrière. Les volumes III et IV seront donc le complément obligé l’un de l’autre, puisqu’ils feront connaître les actes, les campagnes et la vie publique et privée de la Pucelle, depuis son arrivée à Chinon jusqu’à sa prise à Compiègne.
J’ai tâché de faire comprendre le sujet précis et l’importance du volume qui vient de paraître. À mesure que l’auteur avance dans l’exécution de sa belle œuvre, on apprécie mieux la vérité de la définition qu’en a donnée M. Marius Sepet, un des grands et populaires historiens de Jeanne. Le travail du P. Ayroles, a-t-il dit, est urne œuvre de vulgarisation, de recherches et de discussion
.
Vulgarisation, car cette œuvre permet à quiconque a la moindre instruction d’étudier la Pucelle dans les sources même de son histoire ; le lecteur a en mains tous les documents connus des savants. Les recherches ont marché depuis cinquante ans, époque où a paru l’ouvrage de Quicherat ; la Vraie Jeanne d’Arc, qui a profité de toutes les découvertes faites depuis ce temps, contient de un quart à un tiers de pièces de plus que le Double procès. Quant à la discussion, elle est d’une logique serrée, et sa vivacité, où la vérité et le bon sens éclatent, est un attrait de plus pour le lecteur. L’histoire de Jeanne frappant toutes les erreurs des derniers siècles, il n’est pas surprenant que les tenants de ces erreurs, tous plus ou moins libres-penseurs, se soient efforcés de voiler, d’altérer, de mutiler les faits les plus certains qui contrariaient leur scepticisme. Le P. Ayroles ne laisse pas une de leurs allégations sans réponse ; il ne laisse pas debout une seule de leurs hypothèses fantaisistes. Certains esprits qui voudraient qu’on respectât toujours tout, sauf la vérité, prétendent que le savant Jésuite est souvent trop vif et n’a pas assez d’égards pour des savants ses devanciers. Il faudrait, pour ces critiques si respectueux des plus grossières erreurs, qu’on mît des gants pour renverser des statues de mensonges et qu’on s’excusât toujours très humblement de dire qu’un chat est un chat et Rollet un fripon. Le P. Ayroles qui est bien la charité personnifiée, n’a pas, fort heureusement, ces ridicules égards pour les fantaisies et les sottises que la libre-pensée a inspirées.
Et fort heureusement aussi le Saint-Père Léon XIII lui a écrit qu’il avait raison. Un Bref du 25 juillet 1894, en louant l’ouvrage dans toutes ses parties, recommande à l’auteur de réfuter toutes les assertions tendant à réduire les actes de la Pucelle aux proportions d’urne force purement humaine, et de ne pas permettre que ce grand fait soit en rien amoindri par les coups des ennemis de la religion. Ne cessez pas, ajoute Léon XIII, de poursuivre ce travail.
En lisant ce Bref, on voit que le Pape connaît bien Jeanne d’Arc, qu’il a en vue la couronne qu’on lui prépare, et qu’il comprend l’importance de Jeanne pour la France, l’importance de l’ouvrage actuel pour la cause de Jeanne. Je ne connais pas de Bref relatif à un livre, qui soit aussi formel, aussi concluant et aussi impératif. On comprend toute la force qu’y puise le savant Jésuite. Espérons que le volume quatrième, complément du volume actuel, ne tardera pas à paraître pour permettre aux lecteurs d’embrasser dans son entier, la physionomie de cette apparition divine que Jésus-Christ a réservée à la France.
Un publiciste qui voudrait, comme plusieurs autres, réduire Jeanne à des proportions romanesques, a parlé de l’obscurité
qui entourait son histoire. Cette façon de jeter le doute sur le plus grand fait de nos annales est d’une perfidie qui peut tromper seulement ceux qui n’ont jamais lu une histoire de la Pucelle. Comment peut-on de bonne foi parler d’obscurité alors que pour toute la période de sa mission, on sait jour par jour ce qu’elle a fait, où elle a été, avec qui elle était ? Il suffit, en effet, d’ouvrir quelque véritable et complète histoire pour suivre pas à pas et presque d’heure en heure la Pucelle, du 23 février 1429 au 24 mai 1430. Si l’on veut aller au-delà, les pièces mêmes du procès nous révèlent tout ce qui s’est passé du 24 mai 1430 au 30 mai 1431. Si l’on veut connaître les dix-sept années de Domrémy, les documents rapportés par le P. Ayroles dans son volume II laissent voir dans tout son éclat virginal la jeune paysanne que les saints formaient pour sa mission. On ne peut avoir l’ombre d’un doute sur ce qu’elle a été et sur ce qu’elle a fait, et un parti-pris de mauvaise foi peut seul prétendre que cette radieuse figure reste entourée d’obscurité : nous avons en ce qui la concerne, non seulement la certitude historique, mais la certitude juridique, car la plupart des documents principaux ont été dressés par des greffiers et des magistrats, lors des deux procès de condamnation et de réhabilitation.
Quel est le personnage historique, fut-ce le plus moderne, Napoléon Ier ou tout autre, sur lequel on ait une si prodigieuse quantité de documents et qu’on puisse suivre jour par jour comme on suit notre libératrice ? Nous avons, pour les personnages contemporains ou récents les plus célèbres, des lacunes considérables pour lesquelles on cherche en vain des renseignements sûrs. Qui peut dire avec certitude ce qu’est devenu Louis XVII ? Qui a trouvé des documents incontestables sur la jeunesse de Napoléon III ? Qui peut même en donner de certains sur nombre d’actes de son règne, et des principaux ? L’histoire la plus moderne est pleine de ces lacunes et de ces obscurités qui laissent un doute complet sur les événements les plus graves. Jeanne, au contraire, apparaît, à travers presque cinq siècles des plus agités, avec une netteté de couleurs et de traits, une précision de contours qu’on chercherait inutilement ailleurs.
Sans doute, nous avons à regretter encore l’absence de certains documents, ou perdus ou enfouis dans quelque bibliothèque ; nous regrettons notamment le registre de Poitiers et nous voudrions des pièces relatives au long séjour de Jeanne en Berry, après le siège de Paris. Mais ces lacunes n’empêchent point la céleste apparition de resplendir avec un éclat sans pareil. Espérons que l’avenir livrera à notre légitime attente les pièces que nous désirons. Depuis vingt ans on a fait plus d’une découverte relative à cette histoire nationale ; Jeanne nous fera découvrir tout ce qui peut servir à nous la restituer tout entière.
J’ai beaucoup parlé de Jeanne et peu du beau livre que le P. Ayroles vient de lui consacrer. J’ai dit, il y a des années, à l’occasion des premiers volumes, que cet ouvrage serait le plus beau monument élevé jusqu’à ce jour à là Pucelle. À mesure que l’auteur y ajoute les pierres qui doivent le compléter, mon opinion se confirme. Sa grande pensée de rendre à la France la vraie Jeanne d’Arc
se précise et prend un corps. On voit se former la statue sous le ciseau de l’artiste, et on admire.
Je ne veux louer aucune partie isolée pour me pas laisser croire que d’autres sont inférieures ; je ne peux pas davantage rappeler chacun des matériaux de cette œuvre. Lisez ce livre si vous voulez connaître à fond le plus grand, le plus merveilleux événement de notre histoire, si vous voulez voir comment Dieu a tiré la France d’une situation bien plus malheureuse et plus désespérée que la situation actuelle.
Un des pires drôles qui nous ont mis où nous sommes aujourd’hui, écrivait récemment qu’il regrettait beaucoup pour la France l’apparition de Jeanne d’Arc, parce que sans elle nous serions Anglais et que notre fusion dans la race anglaise aurait fait un peuple saris pareil. Je laisse au juif franc-maçon ses regrets, mais je prends son aveu. Oui, si Jeanne n’était pas venue de par le Roi du ciel
, depuis quatre siècles, nous serions Anglais, ou plutôt la France serait urne Pologne ou une Irlande écrasée sous le talon de l’Angleterre protestante. Si vous voulez comprendre combien cela est certain, lisez le livre du P. Ayroles. Et si vous êtes vraiment Français, vous crierez à Dieu du fond de votre cœur pour hâter l’heure où la nation entière pourra dire publiquement et d’une voix unanime :
Sainte Jeanne de Domrémy, patronne de la France, priez pour nous !
A. Desplagnes, Ancien magistrat.
La Vérité 1er juin 1897
Fête de Jeanne d’Arc à Notre-Dame, le dimanche 30 mai. Dans l’enceinte réservée au comité Jeanne d’Arc se trouvaient entre autres, Henri Wallon, le père Ayroles et le père Coubé.
Lien : Retronews
La fête annuelle en mémoire de Jeanne d’Arc a eu lieu hier 30 mai, jour anniversaire de la mort de Jeanne d’Arc, à Notre-Dame de Paris, sous la présidence de S. Ém. le cardinal Richard, archevêque de Paris, assisté du vénérable chapitre de Notre-Dame et d’un grand nombre de représentants du clergé de Paris. Un évêque missionnaire avait pris place à un côté de Son Éminence.
Dans l’enceinte réservée au comité de Jeanne d’Arc, nous avons reconnu MM. Chesnelong, Keller, amiral Mathieu, P. Nourrisson, Wallon, sénateur ; Pagès, Rudes, Azambre, Gibon et Pontal. Au banc d’œuvre : l’amiral Lagé, le général de la Rocque, le colonel Perrin, le P. Ayroles, le P. Coubé, le marquis Costa de Beauregard, un grand nombre de notabilités, catholiques de Paris. On attendait avec une certaine curiosité le discours du R. P. Bouvier, appelé à remplacer Mgr de Cabrières empêché, par le renvoi de la fête, de prononcer la panégyrique promise, et que nous espérons entendre l’année prochaine. […]
La Croix 10 juin 1897
Compte-rendu enthousiaste et méticuleux du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc, par E’…
. L’auteur donne le plan complet de l’ouvrage puis en liste les documents inédits et les implications pour la connaissance de l’histoire de Jeanne d’Arc. Il termine en reprenant à son compte la conclusion élogieuse de Marius Sépet dans le Polybiblion.
Lien : Retronews
La Libératrice, c’est, le titre du troisième volume de la monumentale Histoire Jeanne d’Arc, par le R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus.
Il y a trois mois [le 14 février], nous avons reproduit ici même la traduction du Bref que S. S. Léon XIII a daigné écrire au savant Jésuite. On n’a pas oublié en quels termes particulièrement élogieux le Saint-Père engageait l’auteur à se consacrer entièrement à pareil travail
, et daignait ajouter que c’était une excellente manière de bien mériter de la société religieuse et civile
.
En parlant des deux premiers volumes de cette œuvre sans pareille, nous disions que le R. P. Ayroles élevait ainsi à Jeanne d’Arc un monument plus durable que ceux de marbre, de bronze ou d’airain. Et à mesure que nous parcourons ces doctes écrits, il nous apparaît bien que ce jugement n’a rien d’exagéré et qu’il est vraiment celui qui convient. Et il nous est particulièrement agréable de le répéter.
Le R. P. Ayroles a mis à cette œuvre tout son cœur, toute son application, toute son énergie, toute sa patience et tous les trésors d’une érudition merveilleuse, acquise par une vie entière d’incessant labeur.
Il lui reste deux volumes à produire encore. L’un d’eux est presque achevé. Et le cinquième suivra de près.
Et bien mieux et à meilleur droit que le poète païen, bientôt il pourra dire : Hoc erat in votis ! [Voilà ce que je désirais (Horace)] et rendre grâce au Seigneur qui lui a donné la force et les moyens de couronner sa noble entreprise.
Nous avons donné l’analyse des deux premiers volumes. Nos lecteurs attendent celle du troisième. Enfin la voici :
Il y a dans la Libératrice un ensemble de pièces sur la vie de la guerrière que l’on chercherait inutilement dans tout autre recueil. Jusqu’ici, Quicherat était regardé comme l’historien de Jeanne le plus complet. Il y a cinquante ans qu’il a publié ses cinq volumes. Mais on ne connaissait alors ni la Chronique du greffier de la Rochelle, ni celle de Tournay, ni celle des Cordeliers et de Gilles de Roye, ni bien d’autres. On ne connaissait pas davantage la Chronique de Morosini, ce recueil de 23 lettres écrites an cours des événements, par un Vénitien fixé à Bruges et qui renseignait son père sur ce qui se passait en France, à l’époque des nobles prouesses
de la Pucelle.
C’est dans la Libératrice que ces lettres sont aujourd’hui publiées pour la première fois, dans le texte italien, aux pièces justificatives, et en français dans le corps du volume.
Le R. P. Ayroles a étudié partout, en France et hors de France, les auteurs de ces documents et la vie des personnages principaux mêlés à l’histoire de l’héroïne. Toutes ces études, il les a mises soigneusement à profit, et il nous en donne la substance dans ce troisième volume, véritable dossier tout rempli des plus précieuses richesses historiques. Et c’est ainsi, par exemple, que tel document, rejeté d’abord par Quicherat, est mis en pleine lumière et se trouve au premier rang des pièces qui nous font mieux connaître l’héroïne.
Le duc d’Alençon, qui devait mal finir, eut les préférences de la Libératrice. Pourquoi ? Le R. P. Ayroles nous l’apprend. C’est qu’alors, aucun prince ne méritait mieux de la France.
À Orléans, un des personnages qui approuvèrent le plus hautement la sainte envoyée de Dieu fut Jean de Mâcon, Qui était-il ? On l’ignorait. De récentes découvertes ont montré que ce personnage était un des plus savants canonistes du temps.
Et combien d’autres points importants ressortent des pièces retrouvées et reproduites !…
Ainsi, il n’est plus permis de soutenir que la mission de Jeanne d’Arc finissait à Reims. Jeanne avait promis de mettre le roi dans Paris
, tout comme elle avait promis de le conduire à Reims
. Et cela supposait qu’elle serait obéis et secondée. Mais il en coûte tant — et toujours — à la pauvre nature humaine de s’humilier devant Dieu alors surtout que sa force se cache ou ne se manifeste que sous les apparences d’un instrument aussi frêle qu’était alors la fille de Jacques d’Arc. Même à Orléans, la Pucelle engagea le combat décisif des Tourelles contre la volonté des chefs et des capitaines. Sa force, ce furent les bourgeois et le peuple. Les capitaines vinrent se joindre à elle quand ils virent les manières du fier et merveilleux assaut
.
Les triomphes qui suivirent la tirèrent plus complètement de l’ombre. On ne vit plus que la Pucelle.
Mais hélas ! tout cet éclat fit jaillir aussi les jalousies et elles étaient déjà si vives quand le roi et les seigneurs avec la cour arrivèrent aux portes de Reims que Jeanne disait : Je ne redoute plus rien que la trahison !
Après le sacre, les directions de Jeanne furent moins suivies que jamais. Si bien que lorsque le 8 septembre elle donna son assaut à Paris, une trêve, conclue depuis 12 jours, autorisait le duc de Bourgogne à venir détendre la ville ; bien plus on devait rendre les places qui durant la trêve auraient changé de parti. (Le traité est reproduit tout au long dans la Chronique des Cordeliers.)
Rien d’étonnant par suite si l’on a fait échouer l’héroïne. De nombreux chroniqueurs le disent formellement ou le donnent à entendre. Sûrement, c’est bien malgré Jeanne qu’on a brusquement terminé la campagne en retournant vers la Loire alors que des cités comme Amiens, Abbeville et généralement la Picardie, le Ponthieu, la Normandie se demandaient qu’à redevenir Français.
C’est en étudiant tous ces documents qu’il sera permis de voir la pieuse et noble figure de la Libératrice dans toute sa grandeur, de la contempler poursuivant sa mission, non seulement malgré les Anglais, mais au milieu des pièges, des embûches et des trahisons qu’elle trouva dans son propre parti.
C’est pour mettre la Vénérable Pucelle dans son vrai jour, pour la montrer telle que le ciel la fit et la donna à la France que l’auteur a voulu publier tous les documents du XVe siècle qui la concernent. Il les donne en français accessible à quiconque sait lire. Le français du XVe siècle, le latin, l’italien, l’anglais de cette époque sont des langues que la masse ne comprendrait plus.
Le R. P. Ayroles a rajeuni ce français
traduit ces idiomes étrangers ; mais en leur laissant la saveur du temps. Il a apporté tous ses soins à n’en point altérer le sens. Les érudits pourront s’en convaincre en rapprochant les traductions des textes eux-mêmes qui sont aux pièces justificatives.
Aux premières pages du volume, on trouve un magistral coup d’œil sur l’état des deux partis, sur la guerre au XVe siècle.
Puis, à la fin de l’ouvrage, deux cartes qui permettent de suivre les événements avec plus de facilité et de clarté.
Un critique compétent, Marius Sepet, a dit que ce livre aux
proportions gigantesques par la masse énorme des textes remués, rapprochés, confrontés, discutés, ouvrait la voie à des progrès importants dans la science historique et bibliographique. [Voir Polybiblion, mai 1897.]
Ce jugement fort exact sera ratifié.
L’auteur est trop de nos meilleurs amis pour que nous nous permettions d’ajouter rien de plus.
E’…
Les amis de la Libératrice voudront avoir part au mérite de l’auteur loué par le Saint-Père : ils voudront soutenir l’écrivain dans son labeur en mettant en bonne place dans leurs bibliothèques les cinq volumes de la Vraie Jeanne d’Arc. Cet ouvrage devrait être dans toute bibliothèque française vraiment sérieuse.
L’auteur a promis d’inscrire les noms des souscripteurs à la collection entière dans son quatrième volume qui sera, nous le répétons, prochainement publié.
L’ouvrage est édité par la maison Gaume, 3, rue de l’Abbaye, Paris. Chaque volume est un in-4° de 600 à 800 pages, sur beau papier et en beaux caractères.
Pour les souscripteurs à la collection entière, le prix est de 10 francs le volume. Mais il est de 15 francs pour ceux qui ne demandent qu’un volume.
L’Écho du Centre 20 juillet 1897
Article de soutien au père Ayroles par Emmanuel Rivière, fondateur de l’Écho du Centre, co-fondateur de la Fédération des travailleurs chrétiens du Centre et de l’Ouest.
Lien : Retronews
Il y a quelque temps, Sa Sainteté Léon XIII adressait à un savant religieux de la Compagnie de Jésus, la lettre suivante :
[Reproduction de la traduction française du bref de Léon XIII (25 juillet 1894), telle que dans le tome III de la Vraie Jeanne d’Arc.]
En dehors de cette approbation qui, pour nous, catholiques, constitue le plus brillant éloge qu’on puisse faire d’un ouvrage, nombre de journaux et revues ont parlé de ces remarquables travaux.
Dans la Revue catholique des institutions et du droit de juin dernier, M. Desplagnes, dont on connaît la haute compétence, a publié une excellente bibliographie, dont nous ne saurions assez recommander la lecture à nos nombreux amis.
Rien de mieux et de plus étudié ne peut être dit à ce sujet, nous n’y reviendrons pas et nous nous bornerons simplement à donner le plan de la publication faite à la librairie Gaume.
La Vraie Jeanne d’Arc
- La Pucelle devant l’Église de son Temps, 1 volume in-4° : 15 fr.
- La Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la libre-pensée. 1 volume in-4° : 15 fr.
- La Libératrice, d’après les documents français et anglo-bourguignons et la chronique inédite de Morosini, avec cartes, 1 volume in-4° : 15 fr.
- La Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la Chrétienté et la libre-pensée (paraîtra bientôt), 1 volume in-4° : 15 fr.
- La Martyre, d’après son procès, les témoins oculaires et la libre-pensée, 1 volume in-4° : 15 fr.
NOTA. — Quiconque demande tous les volumes de la Vraie Jeanne d’Arc déjà publiés a droit au prix de faveur.
Mais qu’on me permette de citer ici un fait tout personnel et qui explique l’intérêt que nous portons à la diffusion de cet ouvrage dans nos régions du Centre.
Au lendemain de l’hommage au Christ de la province du Périgord, qui résumait nos études sur l’organisation nouvelle de notre patrie, un livre me fut envoyé par un de mes amis.
Il avait pour titre : Jeanne d’Arc sur les autels, et pour auteur le R. P. Ayroles, que je n’avais pas encore l’honneur de connaître.
Au milieu de ces pages consacrées à notre héroïne nationale, le savant historien établissait, d’une manière irréfutable, le véritable but de Jeanne d’Arc : rappeler au peuple de France et à ses chefs que le Christ s’était réservé le souverain pouvoir sur notre patrie.
La royauté sociale du Christ, le R. P. Ayroles y arrivait en étudiant l’histoire du passé ; nous y étions arrivés, nous, par l’étude du présent et des misères imméritées du peuple de France.
Et c’est pourquoi, si nous aimions déjà Jeanne d’Arc, nous l’avons plus aimée encore le jour où nous avons vu en elle une sœur de la B. Marguerite-Marie, toutes deux envoyées de Dieu pour rappeler à notre patrie, sa véritable mission, son but mi-bas sans lequel elle ne saurait prospérer, ni exister.
Emmanuel Rivière.
Journal d’Indre-et-Loire 7 août 1897
Compte-rendu favorable du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc, par Paul Princeteau.
Le troisième volume, la Libératrice, vient de paraître. C’est un véritable événement dans le monde des savants.
Liens : Gallica.
Le R. P. Ayroles, de la Société de Jésus, continue la publication de son grand ouvrage intitulé, la Vraie Jeanne d’Arc.
En 1885, le docte écrivain avait exposé le plan de son œuvre par un livre : Jeanne d’Arc sur les autels. La Vraie Jeanne d’Arc se composera de cinq volumes. En 1890 a paru le premier : La Pucelle devant l’Église de son temps ; en 1894, le second nous donnait : La Paysanne et l’Inspirée ; aujourd’hui, nous avons le troisième sous ce titre : La Libératrice. Bientôt nous pourrons lire les deux derniers : La Vierge guerrière et : La Martyre.
Le succès obtenu par les deux premiers volumes a été immense, ils sont, en effet, venus bien en leur temps. Par des preuves historiques indiscutables, puisées souvent à des sources jusqu’à ce jour imparfaitement connues, ils ont établi que, sauf certains prélats et prêtres hérétiques ou vendus aux Anglais, toute l’Église du temps de Jeanne d’Arc l’a considérée comme une vierge guerrière sans peur et sans reproche, inspirée de Dieu et des saints.
Le second volume, la Paysanne et l’Inspirée, nous a plus spécialement parlé de l’enfant et de la jeunesse. il nous trace, des dix-sept premières années de Jeanne, le tableau le plus intéressant, aussi, le plus exact. Rien de pur et de frais comme la simple histoire de cette vierge formée et gardée par Dieu lui-même pour secourir le dauphin et sauver le royaume de France.
Le troisième volume, la Libératrice, vient de paraître. C’est un véritable événement dans le monde des savants. Quoique ont ait déjà tant écrit sur Jeanne d’Arc, on peut dire que voici une œuvre nouvelle. Elle est nouvelle, en effets, par les documents publics et l’attrait du procédé employé par l’auteur pour les mettre en lumière.
Ce volume, qui montre l’héroïne à son arrivée à Chinon et la suit jusqu’à sa prise sous les murs de Compiègne, contient de nombreuses chroniques qui, sous des aperçus différents et avec des sentiments divers, racontent les hauts faits de Jeanne pendant cette période de sa vie.
Ces chroniques, remises par les soins de l’auteur en un français facile à lire pour tous le monde, sont les suivantes : [énumération]
Chronique de Morosini.
La publication de cette chronique de Morosini constitue le grand progrès historique accompli par le R. P. Ayroles. C’est, en effet, le R. P. Ayroles qui a pu, après les efforts les plus méritoires, et grâce au concours de savants de Venise et de Vienne, faire la découverte de ce document, qui n’avait point encore été livré au public.
Cette chronique consiste en une série de lettres qu’un noble Vénitien, établi à Bruges, écrivait à son père pendant que Jeanne battait les Anglais. On y trouve, dans toute son indépendance et dans toute sa sincérité, le jugement qu’un homme, vivant en dehors des intérêts directs de la lutte et de l’influence des passions alors excitées, porte sur les événements qui se déroulent devant lui, et spécialement sur la mission providentielle de Jeanne.
On peut y constater que les contemporains de la Pucelle savaient que sa mission divine ne devait point s’arrêter au sacre du roi, à Reims, qu’elle avait aussi pour mandat de ramener le Roi dans Paris. Ces mêmes contemporains expliquent que, si Jeanne ne put ramener le roi dans Paris, c’est à cause de la jalousie que conçurent contre elle certains puissants de l’époque, ambitieux de vaincre sans son concours, et aussi à cause des traités secrets conclus par eux avec les ennemis du pays et du Roi.
La chronique de Morosini est douce aux cœurs des Français ; elle nous fait connaître tout ce que tenta Charles VII, par ambassades et par menaces, auprès du duc de Bourgogne et auprès des Anglais, pour délivrer sa libératrice.
Tout le monde comprendra quelle heureuse clarté cette chronique de Morosini répand aujourd’hui sur tant de points restés douteux ou même tout à fait dans l’ombre.
L’Œuvre du R. P. Ayroles est une révélation et une actualité. Elle enrichit l’histoire, elle prouve la sainte, et relève l’espérance en nos temps malheureux. Si elle est faite surtout pour attirer les les érudits, elle doit charmer aussi ceux qui ne demandent aux écrits sur le passé que l’émotion du sentiment. Pour le prouver, il nous suffira de citer ces lignes de l’oratio historialis de Blondel (1449), dans lesquelles l’auteur fait adresser par saint Louis à son descendant Charles VII les paroles que voici :
De tous les États policés, le plus excellent c’est le royaume de France, quand il ne forme qu’un seul et même corps. La Foi chrétienne lui confère un éclat sans pareil. La puissance divine le dirige et le gouverne avec les tempéraments d’une souveraine équité. Ceux qui sont appelés à le régir doivent unir, pour le défendre, le courage d’un grand cœur à une joyeuse ardeur pour le mener des armes. Le corps vit par l’âme, le royaume de France par la vraie religion. La Foi du Christ en est la suprême loi. Ô cher petit-fils, appelé à être à la tête d’un si beau royaume, ce n’est pas pour vous endormir dans le repos et l’inertie ; vous êtes né non pour vous, mais pour le salut et la défense de votre royaume et de la Foi catholique.
Paul Princeteau
La Croix 23 septembre 1897
10e Congrès eucharistique, à Paray-le-Monial du 20 au 24 septembre. Allocution du père Ayroles et de l’un des abbés Lémann.
Lien : Retronews
Article similaire :
Congrès Eucharistique à Paray-le-Monial, (par dépêche de notre envoyé spécial). — Paray-le-Monial, 22 septembre, 10 h. 40 du matin.
Hier soir très belle procession aux flambeaux. De nombreuses maisons sont illuminées et enguirlandées. Au Parc des Chapelains, allocution ardente du R. P. Lemius et acclamation enthousiastes de la foule : Au Sacré-Cœur ! à la bienheureuse Marguerite-Marie ! au Pape ! au cardinal Perraud !
Aujourd’hui à la messe, allocution de Mgr Isoard qui fait un commentaire de l’Évangile, de la promesse de l’Eucharistie. Réunion de la première section qui traite de l’enseignement de la liturgie eucharistique, des moyens pratiques de le propager, de la génuflexion, de l’attitude des fidèles à la messe, du silence et du respect dans les églises à la prière en commun.
Les RR. PP. Tesnière, Lemius, Durand, prennent la parole. Parlent aussi MM. l’archiprêtre de Sancère l’abbé Faivre, le R. P. Ayroles, M. Richard et Mgr de Cléry.
22 septembre, midi 40. À la 2e section, on a lu un rapport important de M. le vicomte de Damas, sur l’hommage solennel à rendre à Jésus-Christ à la fin du XIXe siècle par une adoration nocturne générale, au commencement du XXe siècle, œuvre hautement recommandée par l’épiscopat.
Histoire intéressante des miracles eucharistiques en Bourgogne. M. l’archiprêtre d’Autun résume un rapport sur l’assistance à la messe paroissiale le dimanche. Rapport de M. l’abbé de Bessonies sur les messes célébrées en réparation des sacrilèges maçonniques. S. Ém. le cardinal Perraud et l’évêque de Fiesole (Italie), assistent aux réunions. Mgr l’évêque de Liège dirige les débats avec une grande science.
M. L.
L’Univers 24 septembre 1897
Congrès eucharistique de Paray-le-Monial. Moins détaillé que le compte-rendu de la Croix du 23 septembre, mais fournit quelques informations sur les intervenants.
Lien : Retronews
Le congrès eucharistique de Paray-le-Monial est composé de prêtres et d’un certain nombre d’hommes d’œuvres. On remarque parmi les ecclésiastiques le R. P. Lemius, supérieur des chapelains de Montmartre, les RR. PP. Tesnière et Durand, du Très-Saint-Sacrement ; M. le curé de Saint-Eustache de Paris, M. l’abbé Gaultier de Claubry et un grand nombre d’ecclésiastiques d’Autun.
Mgr Isoard, évêque d’Annecy, a prononcé un éloquent discours sur les promesses de l’Eucharistie. La première section s’est occupée de la liturgie eucharistique. Les RR. PP. Tesnière, Lemius, Durand, ont pris la parole, ainsi que M. l’archiprêtre de Sancere, M. l’abbé Faivre, le R. P. Ayroles, M. Richard et Mgr de Cléry.
M. le vicomte de Damas a lu, à la seconde section, un rapport fort intéressant sur l’hommage solennel à rendre à Jésus-Christ à la fin du dix-neuvième siècle par une adoration nocturne générale. M. l’archiprêtre d’Autun a parlé sur l’assistance à la messe de paroisse le dimanche et M. l’abbé de Bessonies sur les messes célébrées en réparation des sacrilèges maçonniques.
S. Ém. le cardinal Perraud et Mgr l’évêque de Fiesole (Italie) assistent aux réunions. Mgr l’évêque de Liège dirigeait les débats avec une grande science.
Hier soir, une très belle procession s’est déroulée, aux flambeaux, dans la ville dont les maisons étaient illuminées et enguirlandées. La solennité s’est terminée par une allocution du R. P. Lemius qui a été suivie d’acclamations enthousiastes.
La Croix 25 septembre 1897
Congrès eucharistique de Paray-le-Monial. Présence du père Ayroles et du chanoine Lémann.
Lien : Retronews
Congrès eucharistique de Paray-le-Monial. (De notre envoyé spécial.) — On recueille, au fur et à mesure des entretiens, nombre de traits touchants que l’on regrette de ne pas conserver pour l’édification des lecteurs.
[…] Le nombre des congressistes augmente chaque jour. Remarqué M. le chanoine Lémann, le R. P. Ayroles qui a tant et si bien écrit sur Jeanne d’Arc ; Mgr de Saint-Clair, vicaire général de Malines ; M. Franque, du Havre ; M. l’abbé Faivre, auteur de Nos devoirs envers l’Eucharistie ; des Pères Franciscains, un Père Carme, etc.
Revue du monde catholique 1er octobre 1897
Compte-rendu de la Libératrice (Vraie Jeanne d’Arc, t. III), par l’abbé V. Davin.
Source : Revue du monde catholique, 36e année (1897), t. 132 (série 6, t. 16), n° 10 (1er octobre), p. 150-154.
Lien : Gallica
La Vraie Jeanne d’Arc. Tome III, — pp. XVI-696, avec le Plan d’Orléans en 1429, et la Carte de la France au temps de Jeanne d’Arc. Gaume, 3, rue de l’Abbaye.
Le troisième des cinq volumes du grand ouvrage du R. P. Ayroles, la Vraie Jeanne d’Arc, vient de paraître. Après la Pucelle devant l’Église de son temps, et la Paysanne et l’Inspirée d’après les aveux des témoins oculaires et la libre-pensée, voici la Libératrice d’après les chroniques et les documents français et anglo-bourguignons et la chronique inédite de Morosini. Le volume porte en tête un Bref de Sa Sainteté Léon XIII, du 25 juillet 1894. L’intérêt de ce Bref nous invite à le reproduire d’abord intégralement :
Dans l’œuvre vaste et laborieuse depuis longtemps entreprise par vous… [cf. exergue du t. III.]
Ce volume comprend six livres. Le premier : L’état des deux partis — Orléans — Le Siège jusqu’à l’arrivée de la Pucelle, offre en cinq chapitres un tableau de la situation, où les recherches archéologiques les plus approfondies, loin de nuire à l’intérêt, le portent au plus haut degré. Les cinq autres livres : Parti français — chroniques plus étendues ; — La libératrice d’après des chroniques particulières, des lettres et autres documents ; — Parti anglo-bourguignon ; — Chroniques et documents ouvertement haineux ; — La Chronique de Morosini : remarques historiques et critiques, ces cinq livres sont un musée de pièces historiques complet sur la matière, avec les renseignements voulus, et une juste appréciation sur chaque pièce et ses détails notables, vrais, faux ou douteux. Un septième livre : Pièces justificatives, présente le texte original des pièces inédites, peu connues ou plus importantes. Avec la Chronaca de Morosini, offrant, en dialecte vénérien, des renseignements inédits sur la Pucelle dus à des contemporains, on y lit en anglais une lettre du duc de Bedford, régent de France, à son neveu Henri VI, roi de France et d’Angleterre, écrite trois ans après le supplice de Jeanne d’Arc, un an avant la mort du duc.
On eut, — dit-il, — le tort de croire à un disciple du démon et suppôt de l’enfer nommé la Pucelle, et d’en avoir peur ; elle usait d’enchantements mauvais et de sorcellerie, et sous l’empire de ces procédés le nombre de vos partisans diminua, le courage de ceux qui restaient disparut, en même temps-que s’augmentaient la vaillance et le nombre de vos adversaires… Grâce à Dieu, on ne peut dire que, si vous avez perdu ces cités, ces villes et ces contrées, ce soit par ma faute.
Parmi une cinquantaine de pièces dont se compose le volume, il en est huit qui priment les autres par leur valeur comme par leur étendue. Ce sont la Chronique de la Pucelle, comprenant les extraits des Gestes des nobles de Cousinot, chancelier de Charles d’Orléans, petit-fils de Charles V, avec les additions faites par son fils, un des conseillers préférés de Charles VII et Louis XI ; le Journal du Siège d’Orléans par Soubsdan, notaire en cour d’Église
; la Chronique de Jean Chartier, historiographe officiel de Charles VII ; la Chronique de Perceval de Cagny, serviteur durant quarante-six ans de l’hôtel d’Alençon : Perceval que Quicherat n’hésite pas à mettre en tête des chroniqueurs qui ont parlé de la Pucelle
; la Chronique d’Enguerrand de Monstrelet, du parti bourguignon ; la Chronique dite des Cordeliers, d’un inconnu du même parti ; le Journal dit à tort d’un Bourgeois de Paris, de Jean Chuffart, chancelier de l’Université et organe de sa haine contre ce que l’on appelle la Pucelle, créature en forme de femme qui est, Dieu le sait
, mais sur la mauvaiseté ou bonté
de laquelle Chuffart ne sait plus que décider en contemplant les cendres de son bûcher, une partie du peuple, là et ailleurs, disant qu’elle était martyre ; enfin l’Histoire de Venise d’Antonio Morosini, qui de 1374 à 1380, où l’auteur a commencé à écrire, est devenue un journal général. Ce journal contient vingt-trois passages sur la Pucelle tirés de lettres envoyées de Bruges, à partir du 10 mai 1429, par Pancrace Justiniani à son père Marc à Venise, et écrites par lui ou ses correspondants.
Voici les renseignements, les plus saillants qui nous ont frappé dans telles de ces pièces ou des autres moindres du vaste dossier.
Les lettres d’anoblissement, de la Pucelle et de sa famille, données par Charles VII, en décembre 1429, cinq mois après son sacre à Reims, portent : forsan alterius quam liberæ conditionis existant.
Le forsan, dit le R. P. Ayroles, affecte-t-il et la Pucelle et toute la parenté ou la parenté seulement ? Il semble bien que la Pucelle y doit être comprise.
La famille, de Jeanne d’Arc était donc vraisemblablement de condition servile. C’est dans cet état, profondément humiliant au moyen-âge, que Dieu l’a prise pour en faire la libératrice de la France, de son roi, de son orgueilleuse noblesse ; et c’est un trait de plus qu’elle a avec le divin Rédempteur, dont elle doit partager le Calvaire. Saint Paul ne dit-il pas que le Fils de Dieu a pris la forme servile, formam servi accipiens
?
On lit dans Morosini qu’elle était béguine, iera begina, c’est-à-dire membre, de quelque confraternité ou tiers-ordre. On sait que les Franciscains la réclament comme une sœur. Ce texte unique, et qui ne spécifie rien, laisse la question pendante, mais peut-être lui fait-il faire un pas.
Voilà donc cette pauvre serve, cette pieuse béguine, chargée par le Ciel de la mission dont, au lendemain de la levée du siège d’Orléans, le 10 mai 1429, Justiniani écrit :
En réalité, si les Anglais avaient pris Orléans, ils pouvaient facilement se rendre maîtres de la France, et envoyer le Dauphin vivre à l’hôpital, mandar el dolfin per pan à l’ospédal !
Le 30 juin messire Jean de Molins écrira d’Avignon à Pancrace Justiniani :
De même que par une femme, par Notre-Dame Sainte Marie, Dieu a sauvé le genre humain, de même par cette jeune fille pure et sans tache, donzela pura e neta, il a sauvé la plus belle partie de la chrétienté. C’est une grande preuve de notre foi, et il me semble que c’est le fait le plus célèbre, solenne, qui ait eu lieu depuis cinq cents ans.
Elle vint au roi de France, — écrit Jean Chuffart, — et elle lui dit que saint Michel et plusieurs anges lui avaient donné une très riche couronne pour lui, et qu’il y avait en terre une épée pour lui.
L’épée est celle qu’elle fit trouver, marquée de cinq croix, dans la chapelle de Sainte-Catherine de Fierbois, derrière l’autel, à une petite profondeur, et qu’elle illustra par tant d’exploits. La très riche couronne est celle, matérielle comme l’épée, dont elle parlera tant de fois et qu’elle décrira si précisément dans son procès de Rouen : couronne remise par saint Michel à Charles VII, au milieu, de son auguste entourage, Jeanne accompagnant l’archange et disant au roi : Sire, v’là votre signe !
Les Anglais, par un faux procès-verbal, ont fait dire à la Pucelle que la couronne était une simple allégorie. Chuffart, leur homme, les dément, ainsi que le procès authentique.
La lettre du 30 juin 1429 de Jean de Molins, porte :
La glorieuse demoiselle a promis au Dauphin de lui donner la couronne de France, et un don qui vaudra plus que la couronne de France, et ensuite elle lui a déclaré que c’était la conquête de la Terre-Sainte ; elle l’y accompagnera… Vous apprendrez dans peu les grandes choses qu’elle doit accomplir ; elles sont au nombre de trois, outre le roi de France à mettre sur son trône.
Les trois grandes choses sont la délivrance d’Orléans, le sacre du Dauphin à Reims, la délivrance de son cousin, le duc d’Orléans, captif en Angleterre.
Si les Anglais, — dit une lettre de Justiniani du 9 juillet, — ne voulaient pas accorder cette délivrance, elle finirait par passer en Angleterre et les y contraindrait malgré eux en les subjuguant à leur inestimable confusion et dommage.
La quatrième grande chose, est un dono che valerà plu del reame de Franza… la conquista dele tere sancte : la Terre Sainte, cet objectif des regards mourants de saint Louis et celui de toute la chrétienté, arrachée au Croissant et attachée à la France porte-étendard de la Croix ! Orléans et Reims verront la Pucelle triomphante : elle ne pourra mettre le pied ni en Angleterre, où Wiclef, patronné par Édouard III, vient de préluder à Luther, ni à Jérusalem, où Mahomet a supplanté le Christ ; mais à qui la faute ?
Ce n’est pas aux Anglais seuls, ni à leurs alliés les Bourguignons, qu’a fort affaire la Libératrice. Hélas ! la Ville et la Cour
, comme on dira sous Louis XIV.
Paris qui, avec ses treize mille martyrs du fer et de la faim, sauvera un jour la France de l’hérésie, était alors, comme aujourd’hui, loin de ce beau rôle. Un poète normand, le prêtre Robert Blondel, venait, en 1420, dans la Complainte des bons François, d’écrire :
L’horrible sédition de la ville de Paris, si j’ose dire la vérité, est la source et l’origine des maux… Malheur à toi, Paris, qui déchaînes sur nous tous les maux et enfantes pour toi-même des châtiments.
Urbis Parisius, si fas est dicere verum,
Horrida seditio fons est et origo malorum…
Væ tibi, Parisius, nobis mala cuncta ministrans,
Et tibi damna paris !
Le Paris de saint Thomas d’Aquin et de saint Louis est devenu celui des docteurs gallicans de Constance, de Bâle et des Anglais, ennemis très acharnés du Siège Apostolique
. Il fera tomber Jeanne d’Arc blessée dans ses fossés, et il lui fera dresser son bûcher de Rouen. Mais il ne pourrait rien contre elle si elle n’était pas trahie par les siens.
Quand, après avoir, le 17 juillet 1429, à Reims, donné, au Dauphin sa couronne royale, Jeanne d’Arc veut lui donner sa capitale, que rencontre-t-elle ? Une trêve avec le duc de Bourgogne, l’allié des Anglais, ménagée par l’archevêque de Reims, chancelier de France, Regnault de Chartres, jadis opposé au siège de Troyes et aussi à l’entrée à Reims : trêve signée le 28 août par Charles VII, qui constitue le duc défenseur de Paris contre les troupes du roi et la Pucelle elle-même.
Notre dit cousin de Bourgogne, — écrit le roi, — pourra durant la dite trêve s’employer lui et ses gens à la défense de la ville de Paris, et résister à ceux qui voudraient faire la guerre ou porter dommage à cette ville.
Charles VII espère que les Anglais accéderont à la trêve, ce dont ils se garderont bien. Ne vont-ils pas faire marcher contre la Fille aînée de l’Église les troupes des croisés que le pape solde pour combattre les hérétiques ?
Des trêves qui sont ainsi faites, — écrit la Pucelle aux habitants de Reims, — je ne suis pas contente, et je ne sais si je les tiendrai ; mais si je les tiens, ce sera seulement pour l’honneur du roi.
C’est à Compiègne que le roi a mis la dernière main à la trêve.
La Pucelle, — dit Perceval, — fut très marrie du séjour qu’il y voulait faire. Il semblait à sa manière qu’à cette heure il fût content de la grâce que Dieu lui avait faite, sans vouloir autre chose entreprendre. La Pucelle appela le duc d’Alençon et lui dit : Mon beau duc, faites apprêter vos gens et ceux des autres capitaines, et elle ajouta : par mon Martin — c’était son serment — je veux aller voir Paris de plus près que je l’ai vu… Le duc d’Alençon… fit tant que le roi se mit en chemin… Et il n’y avait personne, de quelque état qu’il fût, qui ne dît : Elle mettra le roi dans Paris, si à lui ne tient.
L’assaut est donné le 8 septembre, de midi au coucher-du soleil. À ce moment la Pucelle est frappée à la cuisse d’un trait d’arbalète. Le sire de Gaucourt et d’autres vinrent la prendre
et, contre son vouloir, l’emmenèrent hors des fossés. Et ainsi faillit l’assaut. Elle avait très grand regret d’ainsi se départir, et disait : Par mon Martin, la place eût été prise !
Le lendemain, quoique blessée,
elle se leva bien matin, et fit venir son beau duc d’Alençon par lequel elle donnait ses ordres, et elle le pria de faire sonner les trompilles et de monter à cheval pour retourner devant Paris ; et affirma par son Martin que jamais elle n’en partirait sans avoir la ville.
L’assaut allait recommencer. Le roi, qui était à Saint-Denis, pria la Pucelle de retourner auprès de lui ; puis il fit rompre le pont jeté sur la Seine, vis-à-vis de Saint-Denis, par le duc d’Alençon
pour prendre Paris par l’autre côté.
Le 13 septembre, le roi revenait
sur la Loire, au grand déplaisir de la Pucelle… Quand la Pucelle vit qu’elle ne pouvait trouver aucun remède à son départ, elle donna et déposa tout son harnais complet devant l’image de Notre-Dame, et devant les reliques de l’abbaye de Saint-Denis ; et à son très grand regret, elle se mit en la compagnie du roi… Ainsi fut rompu le vouloir de la Pucelle, et fut aussi rompue l’armée du roi.
C’est le témoignage de Perceval, c’est-à-dire du duc d’Alençon.
Qu’aurait fait Charles VII dans Paris, puisqu’il en a repris, quant à présent, le commandement au duc de Bourgogne qui commande aux Anglais ? Et qu’aurait-il fait plus tard, dominé par La Trémouille, son chambellan et favori, qui, pour le retenir dans l’inaction et les plaisirs, a empêché la prise de Paris, — s’il eût eu à sa cour la vierge victorieuse, l’envoyée céleste, de la gloire de laquelle nombre de ses capitaines ne sont nullement contents
, d’après la Chronique bourguignonne des Cordeliers, la Pucelle qui, d’après la Chronique Morosini,
veut que les capitaines et seigneurs de la cour se confessent de leurs fornications, et exige la même chose des demoiselles ?
La Pucelle n’a plus qu’à continuer sa mission d’expulsion des Anglais de toute France
, et de délivrance du duc d’Orléans de sa prison d’Angleterre, en s’offrant comme victime expiatrice sur le bûcher. Hélas ! le bûcher de Rouen, allumé par Paris, n’a pas encore délivré le Saint-Sépulcre !
D’après Morosini, on racontait, dans la région de Bruges, le 15 décembre 1430, après la prise de la Pucelle, que le Dauphin avait envoyé une ambassade au duc de Bourgogne pour qu’on ne la livrât pas aux Anglais, menaçant même de représailles sur les prisonniers bourguignons. Le 22 juin 1431, on disait que les Anglais, voulant brûler Jeanne comme hérétique, avaient été arrêtés d’abord par les grandes menaces du Dauphin ; et qu’après son martyre, dont il a ressenti une très amère douleur
, il a formé le dessein d’en tirer une vengeance sur les Anglais et les femmes anglaises
. C’est l’unique assertion positive des efforts tentés par Charles VII pour sauver Jeanne d’Arc. Ce qui est trop certain, c’est que son grand chambellan, La Trémouille, et son grand chancelier, l’archevêque de Reims, n’ont fait aucune démarche en faveur de la Pucelle, après avoir contre-carré de toutes manières sa mission, et qu’ils sont responsables de sa mort qui entrait, dit H. Wallon, dans les calculs de ces politiques détestables
.
Terminons en redisant — c’est à propos aujourd’hui — les paroles que le bon Français
Blondel, lors de la rupture des trêves avec les Anglais, en 1449, mettait dans la bouche de saint Louis s’adressant à Charles VII :
De tous les États policés, le plus excellent c’est le royaume de France quand il ne forme qu’un seul et même corps. La foi chrétienne lui confère un éclat sans pareil. La puissance divine le dirige et le gouverne avec les tempéraments d’une souveraine équité… Ô cher petit-fils, appelé à être à la tête d’un si beau royaume, ce n’est pas pour vous endormir dans le repos et l’inertie ; vous êtes né non pour vous, mais pour le salut et la défense de votre royaume et de la foi catholique !
V. Davin,
chanoine de Versailles.
La Croix 5 novembre 1897
Fin de la procédure orléanaise du procès de béatification de Jeanne. Ont été entendus : Henri Wallon, Marius Sepet, Georges Goyau, Henri Debout et le R. P. Ayroles, le savant historien de l’héroïne
. Mgr Touchet portera lui-même les pièces à Rome.
Lien : Retronews
Béatification de la Vénérable Jeanne d’Arc
Orléans, 3 novembre.
On sait que le procès de béatification de la Vénérable Jeanne s’est poursuivi activement à Orléans durant le cours de cette année. On a entendu bon nombre de témoins, parmi lesquels nous citerons MM. Wallon, Marius Sepet, Goyau et le R. P. Ayroles, le savant historien de l’héroïne.
Le dentier témoin comparaît en ce moment : c’est M. l’abbé Henri Debout, un autre savant historien de Jeanne d’Arc. Le procès sera vraisemblablement terminé ce soir 3 novembre.
Mgr Touchet, évêque d’Orléans, va partir sans retard pour Rome, afin d’y porter lui-même les pièces de la procédure.
La Vérité 21 novembre 1897
Extrait du Courrier bibliographique et littéraire d’Édouard Pontal (archiviste-paléographe, diplômé de l’École des chartes en 1875) sur les Compagnons de Jeanne d’Arc de Henri Chapoy.
Pontal regrette que l’auteur ait cherché à désurnaturaliser
Jeanne, et omis de citer l’ouvrage magistral
du père Ayroles : les deux étant probablement liés.
Lien : Retronews
Après les Mémoires, après les Études historiques critiques, voici les livres d’histoire proprement dite, dont la série est brillamment ouverte par les Compagnons de Jeanne d’Arc de M. Henri Chapoy.
Il semble que tout soit dit, écrit et imprimé sur Jeanne d’Arc ; ce volume est la preuve du contraire. Préoccupés de l’héroïne, les auteurs qui ont raconté ses hauts faits ont laissé relativement dans l’ombre ses compagnons : le livre de M. Chapoy, avocat érudit du barreau de Paris, ancien professeur de l’Université, est consacré à nous les faire mieux connaître. C’est un monument élevé à Charles VII, à Richemont, au duc d’Alençon, à Dunois, à La Hire, à Xaintrailles et aux vaillants chevaliers de leur école : de Rais, du Bueil, etc., etc. […]
J’ajouterai pourtant avec quelque regret que l’auteur, bon chrétien d’ailleurs, mais un peu trop féru de théories scientifiques, me paraît un peu porté parfois, si je puis ainsi parler, à désurnaturaliser Jeanne d’Arc.
Cela explique peut-être, sans le justifier, que, dans la Bibliographie qui ouvre son volume, M. Chapoy ait oublié de citer plusieurs ouvrages importants sur Jeanne d’Arc, et notamment les trois volumes du P. Ayroles sur la Vraie Jeanne d’Arc. Après le P. Ayroles on peut parler autrement de Jeanne d’Arc, de son temps, même de ses compagnons, je doute que de longtemps en en puisse rien dire de nouveau. Et c’est pourquoi il est de toute nécessité que, dans l’indication des sources, son ouvrage magistral ne soit pas omis.
Pourquoi ne pas noter encore que l’auteur professe une grande admiration pour la Marseillaise, l’admirable hymne de France
. Il nous semble toutefois qu’il eût mieux fait de réserver cette profession de foi pour une meilleure occasion.
Annales religieuses du diocèse d’Orléans 26 novembre 1897
Mgr Touchet est parti à Rome remettre les actes du procès à la Congrégation des rites.
Source : Annales religieuses du diocèse d’Orléans, vol. 37, p. 763, n° 48, vendredi 26 novembre 1897.
Lien : Google
Chronique diocésaine. — Monseigneur [Touchet] est parti, mardi matin 22 novembre, pour Paris, afin de participer aux délibérations des archevêques et évêques fondateurs de l’Institut catholique de Paris. Puis, Sa Grandeur gagnera Rome, par les voies rapides. Elle descendra à la procure de la Compagnie de Saint-Sulpice. Elle remettra elle-même à la chancellerie de la Sacrée-Congrégation des Rites, deux exemplaires de la procédure canonique du procès apostolique, relatif à la Béatification de la Vénérable Jeanne d’Arc, pucelle d’Orléans.
Annales religieuses du diocèse d’Orléans 24 décembre 1897
Fin de la Cause orléanaise du procès en béatification de Jeanne d’Arc. Le bulletin fournit nombre détails sur la procédure qui vient de s’achever, dont le nom des témoins entendus.
Source : Annales religieuses du diocèse d’Orléans, vol. 37, p. 829, n° 52, vendredi 24 décembre 1897.
Lien : Google
Article reproduit dans :
Cause Orléanaise. Procès apostolique sur les Vertus et les Miracles in specie de la Vénérable Servante de Dieu Jeanne d’Arc, Pucelle d’Orléans.
Ce procès, dont l’instruction, par délégation apostolique, a été conférée à Mgr l’évêque d’Orléans, est terminé. Son dossier — en double copie — a été remis par Monseigneur lui-même, le 30 novembre, à la Congrégation des Rites.
Si pour les juges et les témoins le secret à garder pendant la procédure est levé, la discrétion nous fait encore un devoir de ne pas parler des diverses dépositions faites sur les vertus héroïques et sur les faits miraculeux, et soumises en ce moment au tribunal pontifical.
Nous nous proposons seulement de donner certains renseignements sur le côté extérieur de la procédure qu’il est bon, au point de vue historique, de consigner dans nos Annales diocésaines.
Le procès a commencé le 1er mars 1897 par l’installation du tribunal.
Ce tribunal se composait ainsi :
- Juges délégués : Mgr l’évêque d’Orléans ; MM. H. d’Allaines, vicaire général ; Agnès, Dulouart, Génin, Castera, chanoines titulaires.
- Sous promoteurs de la Foi : MM. Boulet promoteur du diocèse, et Despierre, archiprêtre de la cathédrale ;
- Vice-postulateur : M. Clain, directeur au grand séminaire ;
- Notaire : M. Filiol, chancelier de l’évêché ;
- Cursor : M. Lefort, vicaire de la cathédrale ;
- Copistes assermentés : Il y en eut dix parmi lesquels il est juste de distinguer MM. Gilles et Billard, secrétaires de l’évêché.
Deux notaires adjoints ont été employés pour la collation.
La procédure et l’audition des témoins ont occupé 122 séances. Le dossier comprend 1.876 pages de minutes, y compris les pièces annexes. Une double copie, de 1.741 pages chacune, a été écrite pour la Congrégation des Rites.
Dans les séances, 57 témoins ont été entendus. La mort n’a pas permis à M. Léon Gautier de répondre à la citation : il avait déjà prêté serment.
Il serait intéressant, sans doute, de connaître les noms des témoins : mais les donner tous nous entraînerait plus loin qu’il ne convient à cette heure. Nous nous contenterons de les grouper d’une manière générale.
- 26 témoins ont déposé sur cinq guérisons de la plus haute importance obtenues par l’intercession de la vénérable.
- 11 l’ont fait sur différentes grâces notables, dues également à cette intercession.
- 20 autres témoins ont été interrogés sur l’ensemble de la cause.
De ces 20 témoins, 10 déjà avaient paru dans les procès antérieurs à l’introduction de la cause :
- M. Louis Daudier, chevalier de Saint-Grégoire ;
- M. le comte Maxime de La Rocheterie, lauréat de l’Institut de France ;
- M. Wallon, membre de l’Institut, ancien ministre de l’instruction publique ;
- M. Edm. Séjourné, doyen du chapitre d’Orléans ;
- M. Th. Cochard, chanoine titulaire d’Orléans ;
- M. Bourgault, chanoine honoraire d’Orléans, curé de Domrémy ;
- Mme la supérieure générale des Sœurs de Saint-Aignan ;
- Trois religieuses de la Visitation d’Orléans.
Les dix témoins nouveaux ont été :
- Le R. P. Ayroles, S. J., l’auteur de la Vraie Jeanne d’Arc ;
- M. Herluison, correspondant du ministère des beaux-arts ;
- M. Godefroy Kurth, professeur à l’Université de Liège (Belgique) ;
- M. Goyau, ancien élève de l’école française de Rome ;
- M. Marius Sepet, archiviste-paléographe et historien de Jeanne d’Arc ;
- M. Louis Jarry, correspondant du ministère des beaux-arts ;
- Comte Baguenault de Puchesse, président de la société de l’Histoire de France ;
- M. G. Vié, vicaire général, panégyriste du 8 mai [1886] ;
- M. Debout, missionnaire apostolique à Arras, historien de Jeanne d’Arc ;
- Le R. P. Wyndham, des oblats de Saint-Charles, à Londres, historien de Jeanne d’Arc.
Elle fut solennelle et émouvante entre toutes la 122e séance, qui fut la dernière : elle se tint le 22 novembre, à 9 heures du soir. Tous les membres du tribunal étaient présents : Mgr l’évêque présidait, heureux et radieux de pouvoir clore la longue et laborieuse procédure que le Souverain Pontife lui avait confiée. Après que chacun d’eux eut apposé aux pièces sa signature, munie de son sceau, chaque copie fut enfermée dans un coffret, scellé du sceau de l’évêché, et remis canoniquement à monseigneur, afin qu’il le portât lui-même au secrétaire de la Congrégation des Rites. Enfin tous, s’agenouillant, récitèrent le Te Deum, remerciant Dieu d’avoir pu accomplir, en moins d’un an, le mandat apostolique dont Sa Sainteté les avait investis.
À Poitiers, le tribunal avait déclaré au dauphin Charles, en qui alors se personnifiait la France, qu’il pouvait croire la mission de la Pucelle de délivrer Orléans et la patrie.
À Rouen, le tribunal, institué par le Pape Calixte III, en annulant la procédure inique de l’évêque de Beauvais, avait déclaré que la Pucelle d’Orléans, ayant été injustement condamnée, n’était ni hérétique, ni sorcière.
À Orléans, le tribunal de l’ordinaire, reprenant la même cause, a déjà obtenu du Souverain Pontife que la libératrice fût proclamée vénérable.
Espérons que la récente instance aura le même succès ; et qu’un jour, certain selon nos espérances, prochain selon nos vœux, Rome nimbera la tête virginale de la Pucelle d’Orléans de l’auréole des bienheureux.
En attendant, Orléanais, Français, catholiques de tous pays, prions de concert afin que nous méritions que ce soit Léon XIII qui inscrive Jeanne d’Arc in albo Sanctorum, comme l’ange de la patrie.
T. C.
Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France 1897
Mémoire : Le procès de Jeanne d’Arc et l’Université de Paris, par le père H. Denifle et Ém. Chatelain.
Cette dissertation accompagne la publication du tome IV (sous presse) du Cartulaire de l’Université de Paris (Chartularium Universitatis Parisiensis). En introduction, les auteurs contestent la thèse du père Ayroles, selon laquelle l’Université, avant les Anglais, serait le principal responsable de la mort de Jeanne d’Arc, et que ceux qui l’ont condamnée à Rouen seraient les mêmes qui, quelques années plus tard, condamnèrent le pape Eugène IV lors du concile de Bâle, sur la base de la même doctrine.
En 1902, le père Ayroles répondra à cette critique en publiant l’Université au temps de Jeanne d’Arc, un ouvrage où il réaffirmera et renforcera ses arguments sur le rôle central de l’Université dans la condamnation de Jeanne d’Arc.
Source : Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, t. XXIV, 1897, p. 1-32.
Ce n’est pas à l’instigation des Anglais que l’Université de Paris attaqua Jeanne d’Arc. Évidemment, Jeanne eût été perdue sans l’intervention de l’Université ; la haine des Anglais aurait suffi, puisque devant les murs d’Orléans ils s’étaient bien promis de la faire périr dans les flammes s’ils parvenaient à la prendre ; mais l’Université est la première qui, Jeanne une fois prise, transféra sa cause sur le terrain de la foi. Nous voudrions esquisser à grands traits les raisons qui pouvaient, à notre avis, exciter l’Université contre la Pucelle.
On doit d’abord rejeter l’explication récemment proposée, suivant laquelle les professeurs de l’Université qui ont pris part au procès auraient été des schismatiques. Car le Concile de Bâle, alors convoqué, il est vrai, ne fut pas constitué avant la fin de juillet 1431, et sa première session n’eut lieu que le 14 décembre.
Si Courcelles fut l’âme du Concile, Érard en fut le père
, écrit M. Ayroles (Vraie Jeanne d’Arc, I, 127). Mais Érard n’alla jamais au Concile, Thomas de Courcelles y siégea seulement à partir de 1433 et ne fut pas l’âme du Concile avant 1437. D’autres membres de l’Université de Paris assistèrent au Concile plus tard, ils n’étaient que cinq au début. L’Université est alors si loin d’être schismatique qu’elle reçoit des papes Martin V et Eugène IV les éloges habituels et qu’elle envoie, à la fin de 1431, pour présenter un rôle à Eugène IV, une ambassade dans laquelle figure Jean Lohier, celui qui avait pris à Rouen la défense de Jeanne d’Arc. On ne peut donc pas soutenir que l’Université fut alors plus schismatique que Charles VII, pour qui combattait Jeanne ; au contraire, elle le devint après le transfert du Concile de Bâle à Ferrare, c’est-à-dire à l’époque où l’Université, revenue au parti de Charles VII, n’aurait à aucun prix condamné la Pucelle.
[…]
L’Univers 1er février 1898
Article d’Eugène Tavernier au sujet de la Fête nationale de Jeanne d’Arc et des attaques contre l’Église.
Lien : Retronews
La fête nationale de Jeanne d’Arc. — On arrive à croire qu’elle pourra être établie.
La campagne organisée par le parti de la domination juive et soutenue par une coalition où se rencontrent des protestants, des politiciens radicaux et socialistes, des professeurs, des rêveurs et des sectaires, des esprits généreux et des intrigants, cette campagne provoque un mouvement favorable à l’apothéose publique de la libératrice. Le scandale inouï déchaîné au profit du traître et au détriment de notre prestige pousse une masse de citoyens, différents d’opinions et de croyances, à s’unir en l’honneur de Jeanne d’Arc. […]
[En réponse à ceux qui veulent utiliser Jeanne pour accuser l’Église :]
Ainsi que l’a fait remarquer le R. P. Ayroles, le savant jésuite qui a élevé pour la gloire de l’héroïne un véritable monument historique, littéraire et théologique, nous devons à l’Église la conservation des innombrables pièces des procès. Les juges constitués officiellement pour la réhabilitation nous ont donné l’histoire, telle qu’aucun personnage historique n’en possède de pareille
.
[…]
Et la libre-pensée, perfide ou sincère, aura favorisé le triomphe qui doit réunir autour de ce symbole tous les Français qui veulent rétablir la concorde et sauver le patriotisme, personnifié par la sublime croyante.
Eugène Tavernier.
La Gazette 7 février 1898
Causerie littéraire d’Edmond Biré consacrée à la Vraie Jeanne d’Arc et portant principalement sur le tome I consacré aux mémoires en faveur de Jeanne d’Arc.
Biré loue l’édition des Procès par Quicherat, mais déplore que le paléographe ait, par idéologie, dédaigné ces mémoires théologiques : grave et considérable lacune
. Aussi résume-t-il, de manière brillante, la cause de réhabilitation, en examinant comment chaque mémoire a été commandé, par qui et à qui, afin de mettre en lumière leur importance et la qualité de leurs auteurs.
Il termine l’analyse du premier tome du père Ayroles en étendant son appréciation à l’ensemble de l’ouvrage en cours de publication :
Les cinq volumes du P. Ayroles comprendront deux ou trois fois les matières des cinq volumes du double Procès de Quicherat. On voit combien Sainte-Beuve se trompait lorsqu’il écrivait que le dernier mot était dit sur Jeanne d’Arc. L’ouvrage du P. Ayroles, — ce post-scriptum en cinq volumes, qui a valeur douze ou quinze — est un livre de premier ordre, l’œuvre d’un érudit, d’un historien et d’un théologien.
Lien : Retronews
La Vraie Jeanne d’Arc
Sainte-Beuve, il y a déjà près d’un demi-siècle, dans sa Causerie du lundi 19 août 1850, écrivait à propos de la publication des Procès de Jeanne d’Arc, par M. Jules Quicherat :
Ce jeune et consciencieux érudit a réuni en cinq volumes tous les documents positifs qui peuvent éclairer l’histoire de Jeanne d’Arc, particulièrement les textes des deux Procès dans toute leur étendue, du Procès de condamnation, et de celui de réhabilitation, qui eut lieu vingt-cinq ans plus tard… On peut dire que la mémoire de Jeanne d’Arc était encore à demi enfouie dans la poudre du greffe, et qu’elle en est seulement arrachée aujourd’hui. L’éditeur a pris soin de rassembler, à la suite, les témoignages des historiens et chroniqueurs du temps de la Pucelle, et toutes les pièces accessoires que les curieux peuvent désirer… À ces cinq volumes, M. Quicherat vient d’en ajouter un autre,une sorte d’introduction, dans laquelle il donne avec beaucoup de modestie, mais aussi avec beaucoup de précision, son avis sur les points nouveaux que ce développement complet des actes du procès fait ressortir et détermine plus nettement… On a maintenant le dernier mot, autant qu’on l’aura jamais, sur cette apparition merveilleuse. — (Causerie du lundi, t. II, p. 375.)
Sainte-Beuve se trompait. Le dernier mot n’était pas dit. Depuis 1850, depuis le grand ouvrage publié par Jules Quicherat, sous les auspices et par les soins de la Société de l’Histoire de France, beaucoup de documents nouveaux sur Jeanne d’Arc ont été mis au jour. Des publications nombreuses ont paru, mais aucune qui égale en importance les trois volumes in-4° de 7 à 800 pages chacun, publiés par un membre de la Compagnie de Jésus, le R. P. Ayrolles.
Quicherat, lors de la préparation de son livre, avait eu une assez fâcheuse inspiration, dont il nous rend compte lui-même en ces termes :
Le vœu de la Société de l’Histoire de France était de publier intégralement le procès de réhabilitation. Sans la faire manquer au but qu’elle voulait atteindre, j’ai cru pouvoir lui conseiller une réduction notable, à l’égard des mémoires consultatifs, ainsi que de la recollection de Jean Bréhal ; ces ouvrages en effet, n’ont rien d’historique. On ne fait qu’y discuter l’orthodoxie de Jeanne ou la légalité de sa condamnation, d’après les circonstances consignées au procès. Ouvrages de jurisprudence ou de théologie, ces mémoires auraient grossi, mal à propos, d’un volume, la présente édition ; joint à cela qu’ils sont si mal rédigés la plupart, qu’Edmond Richer, tout théologien qu’il était, avait prononcé leur exclusion, lorsqu’il projetait la publication du procès. — (Procès, t. V, p. 469.)
Quicherat s’est donc contenté d’en citer quelques lambeaux qui n’en donnent pas une idée ; de fournir sur leurs auteurs quelques notes fort incomplètes, et parfois peu bienveillantes. C’est une grave et considérable lacune. Les mémoires dédaignés ne méritent pas le mépris que leur a témoigné le savant directeur de l’École des chartes. Ils jettent le plus grand jour sur la figure de l’héroïne, parce qu’ils la montrent dans sa vraie lumière, le surnaturel. Les traités théologiques composés sur Jeanne sont indispensables à quiconque veut étudier, ou simplement raconter son histoire. Ils font plus que fournir de nouveaux faits ; ils font comprendre ceux qui, faute de ces données, restent travestis dans les histoires, même les moins mauvaises. Ces traités furent écrits par des hommes éminents en savoir, revêtus des plus hautes dignités de l’Église et de l’État, activement mêlés aux plus grands événements de leur temps.
Le premier qui ait composé un mémoire sur Jeanne est Guillaume Bouillé, ainsi qualifié dans le Gallia christiana : theologiæ magister eruditissimes. Proviseur du collège de Beauvais (le collège de Beauvais était un des collèges de Paris ; il fut incorporé en 1704 au collège de Louis le Grand), procureur de la nation de France, il eut son trimestre de suprême magistrature, ayant été élu Recteur le 16 décembre 1439. Il fut aussi doyen de la faculté de théologie. Charles VII avait une telle estime pour son mérite qu’il le nomma membre de son Grand-Conseil, et qu’il l’envoya en mission auprès du Saint-Siège.
Tel est l’homme qui le premier fut appelé à ouvrir une enquête sur le procès de Rouen et l’assassinat de la Libératrice. Ordonnée par Charles VII, celle enquête ne pouvait pas avoir un caractère juridique. Jeanne avait été condamnée au nom de l’Église ; c’était à l’Église à déclarer qu’on avait profané son nom et perverti sa législation ; le travail de Guillaume Bouillé devait servir à la mettre en mouvement.
Laissant aux juristes le soin de relever les vices de la procédure, il s’attache, dans son mémoire, à quatre chefs principaux : les révélations, le port d’habits masculins, la soumission à l’Église, et les douze articles envoyés par l’évêque Cauchon aux prélats et aux docteurs, comme base du jugement à porter.
En 1451 arrivait en France, avec le titre de légat et les pouvoirs les plus étendus, un des personnages les plus influents de la cour pontificale, Guillaume d’Estouteville, cardinal de Saint-Sylvestre et de Saint-Martin des Monte. Le premier, il a pris en mains, au nom de l’Église, la cause de la réhabilitation. Son principal collaborateur, celui qui, plus que tout autre, a conduit ce grand œuvre, fut l’Inquisiteur général de la foi dans la France du Nord de la Loire, le dominicain Jean Bréhal.
Bréhal était normand d’origine. Docteur en théologie, il fut de son temps en grande réputation de doctrine et de vertu. Depuis l’ouverture de la cause de réhabilitation par le cardinal d’Estouteville, le 2 mai 1452, jusqu’à son heureuse issue, le 7 juillet 1456, Bréhal est partout. Il voyage par toute la France pour informer sur la vie de Jeanne d’Arc ; il se met en correspondance avec les plus fameux docteurs du royaume et de l’étranger et leur demande des consultations.
Parmi celles qui lui furent adressées, l’une des plus remarquables est celle de Paul Pontanus, venu en France à la suite de d’Estouteville. Né à Céretto en Ombrie, il était, depuis douze ans déjà, avocat consistorial auprès du tribunal de Rome. Plusieurs jurisconsultes fameux dans l’histoire du droit au XVe siècle ont illustré ce nom de Pontanus. Il appartenait à la même famille et sut prendre, comme eux, une place éminente parmi les hommes de loi de son temps.
À côté du mémoire de Paul Pontanus, se place celui de Théodore de Lellis. Il était né à Thérano dans l’Abruzze, d’une famille à laquelle saint Camille de Lellis devait donner dans la suite un si vif éclat. Théodore, d’abord auditeur, bientôt après juge au tribunal de la Rote, s’y acquit promptement une grande réputation. Pie II ne le fit pas seulement évêque de Feltre, il l’employa aux missions les plus délicates. Transféré au siège de Trévise, il mourut à trente-huit ans, en 1465, avant d’avoir pris possession de la dignité de cardinal, par la quelle Paul II voulait récompenser ses services.
Après les mémoires de Bouillé, de Pontanus et de Lellis, vient celui de Robert Ciboule.
Robert Ciboule était né à Ourches, près de Breteuil, Charles VII l’employa dans les négociations destinées à faire cesser le schisme de Bâle, Nicolas V lui conféra le titre de camérier. À l’époque où il composa son mémoire (1453), il était chancelier de Notre-Dame et de l’Université.
L’auteur du cinquième mémoire était Jean de Montigny, mort en 1471, maître ès-arts et docteur de l’Université de Paris. On ne sait à peu près rien de lui, si ce n’est qu’il fut choisi par ses collègues pour faire partie de l’ambassade que la ville de Paris envoya vers les princes confédérés dans la ligue du bien public.
En revanche, l’auteur du mémoire suivant est des plus célèbres. C’est Thomas Basin, le fameux évêque de Lisieux. Il était né la même année que Jeanne d’Arc, en 1412, à Caudebec, d’une famille de riches bourgeois. Professeur de droit canon à l’Université de Caen, il occupa cette chaire, durant six ans, avec une réputation toujours croissante, qui lui valut l’unanimité des suffrages du chapitre de Lisieux, lorsque, en 1447, vint à vaquer le siège épiscopal de cette ville. Nicolas V ratifia l’élection et Basin ceignit la mitre à trente-cinq ans. Il jouit, durant tout le règne de Charles VII, d’une existence calme et honorée. Mais, sous Louis XI, son adhésion à la ligue du bien public lui valut d’être exilé, il se réfugia à Rome au près de Sixte IV, renonça à son évêché de Normandie et reçut en échange le titre d’archevêque de Césarée de Palestine, in partibus infidelium. Basin mourut à Utrecht le 2 décembre 1491. Il est l’auteur d’une très remarquable Histoire de Charles VII et d’une curieuse autobiographie intitulée : Sommaire de la pérégrination et des domiciles au nombre de quarante-deux de Thomas Basin, d’abord évêque de Lisieux en Normandie, maintenant archevêque de Césarée en Palestine, dans sa marche à travers le désert de la vie vers la vraie terre promise ; écrit à Utrecht en mai 1488.
De tous les mémoires qui figurèrent dans le procès de réhabilitation, celui de Thomas Basin est peut-être le plus complet. Celui d’Élie de Bourdeilles a également une haute valeur. Successivement évêque de Périgueux et archevêque de Tours, Élie de Bourdeilles (1415-1484) y fut un véritable saint. Sixte VI lui conféra la pourpre. Bien qu’il fût en possession de grands revenus ecclésiastiques, il mourut pauvre : tout ce qu’il légua à sa famille, ce fut son chapeau de cardinal. Ce chapeau fut vénéré comme une relique dans l’église de Périgueux.
C’était encore un des plus doctes et des plus dignes évêques de son temps que Martin Berruyer, évêque du Mans, auteur de l’un des mémoires. Le sien porte la date du 7 avril 1456, trois mois avant le jugement réparateur.
Un dernier mémoire est l’œuvre de Bochard, dit de Vaucelles, évêque d’Avranches. Il jouissait d’une grande réputation de savoir et il eut grand crédit auprès de Louis XI. À la suite des États généraux de 1470, ce Roi le choisit pour son confesseur, et l’employa à la réforme de l’Université de Paris. Il a laissé sur tous les livres de la Bible un bref commentaire déclaré excellent par les auteurs du Gallia Christiana.
Les mémoires dont je viens de rappeler les auteurs ne sont pas les seuls. D’autres furent écrits, les uns sur le procès tout entier, les autres sur certaines parties seulement. L’on demanda l’avis de docteurs qui se contentèrent de répondre oralement.
Il fallait présenter un ensemble des sentiments ainsi recueillis, et des raisons qui les motivaient. La Commission chargea de ce travail celui de ses membres qui était le mieux en état de le mener à bien, Jean Bréhal. Le fils de saint Dominique se mit à l’œuvre et rédigea, sous le nom de recollectio, recollection, récapitulation, le plus complet des mémoires insérés dans l’instrument du procès vengeur. D’après Quicherat, le travail de Jean Bréhal n’a rien d’historique, et il s’autorise de cette appréciation pour le supprimer. Le R. P. Ayroles le donne, au contraire, en entier. On ne saurait assez l’on remercier, car cette savante recollection devra désormais servir de flambeau à l’historien de la Pucelle.
Plus de cinq ans s’étaient écoulés entre le jour où Charles VII avait donné l’ordre à Guillaume Bouillé de chercher les éléments d’une réhabilitation, et celui où Calixte III nomma la commission chargée d’instruire et de terminer en son nom le procès réparateur. La lettre du roi à son féal conseiller est du 15 février 1540 ; le rescrit du Pontife du 10 juin 1455.
On s’explique aisément que la décision du Saint-Siège n’ait pas été plus prompte. C’était de sa part un acte exceptionnellement grave que d’autoriser la révision d’un procès en pareille matière, alors que la sentence avait eu sa lamentable exécution. Une erreur, quand elle doit être suivie d’un si atroce supplice, suffit pour entacher la mémoire de ceux qui l’ont commise. Si l’erreur est volontaire, si c’est l’effet de la passion, c’en est assez pour vouer à l’exécration des siècles tous ceux qui y ont volontairement et criminellement trempé. Les criminels, c’étaient avant tous les autres, un évêque mort en communion avec l’Église romaine, et un des représentants de l’Inquisition. Les complices étaient nombreux et puissants. On ne devait pas ignorer à Rome la part si large qu’y avait prise cette Université de Paris, animée envers le Saint-Siège de sentiments si défiants, tant de docteurs trompés ou cédant lâchement à la peur. Les instigateurs du crime c’étaient ceux qui lors du supplice gouvernaient au nom du roi d’Angleterre, alors un enfant de onze ans, maintenant dans la force de l’âge : il n’y avait pas lieu de faire déplaisir à cette nation anglaise qui, durant le Grand Schisme et la sédition de Bâle, avait donné à Rome des preuves multiples de sa fidélité. Les raisons les plus graves pouvaient donc seules déterminer Calixte III à ordonner une révision.
Elles se firent jour dans cet intervalle de cinq ans. Le roi de France avait la révision grandement à cœur. Le légat du Saint-Siège, le cardinal d’Estouteville, secondait de tout son pouvoir le désir de Charles VII. Les docteurs les plus éminents, tant en France qu’à l’étranger, étaient unanimes dans leur sentiment sur l’iniquité du procès. C’en était assez pour déterminer Rome, qui s’est toujours glorifiée d’être la protectrice des opprimés.
Qui devait solliciter la révision ? Jean de Montigny l’indiquait dans son mémoire : c’était avant tout la famille de la victime. Le père, le frère aîné étaient morts de douleur, d’après certains récits. La mère vivait à Orléans, où la ville lui versait une rente mensuelle. Charles VII avait donné la prévôté de Vaucouleurs à Jean, l’aîné de ceux qui restaient, appelé du Lys depuis les lettres d’anoblissement ; Pierre, pris avec sa sœur et longtemps prisonnier, avait, après sa délivrance, reçu en don, de la part du duc d’Orléans, l’île aux Bœufs, près de cette ville.
Tous les trois, en leur nom et au nom de leur parenté, sollicitèrent le Saint-Siège de faire revoir le procès d’une fille et d’une sœur iniquement brûlée, et de laver sa mémoire d’une flétrissure imméritée qui rejaillissait sur tous les siens. Le Souverain Pontife acquiesça à leur demande, et nomma pour juger la cause trois commissaires, qui étaient : l’archevêque de Reims, Jean Juvénal des Ursins ; Guillaume Chartier, évêque de Paris, Richard Olivier de Longueil, évêque de Coutances. Le premier devait avoir la présidence de la Commission. Il leur était ordonné de s’adjoindre un des Inquisiteurs. Le choix était indiqué : ils désignèrent celui qui depuis plusieurs années poursuivait avec tant de zèle la grande réparation qu’il allait faire aboutir, le dominicain Jean Bréhal.
Le procès commença le 7 novembre 1455. Ce jour-là, Isabelle Romée, Jean et Pierre d’Arc, surnommés du Lys par les lettres d’anoblissement, se trouvaient présents à la métropole de Paris. Ils étaient en grands habits de deuil. Des dames en grand nombre se pressaient autour de la digne femme, de la mère appesantie par les ans et plus encore par la douleur. Des seigneurs entouraient les deux fils. L’archevêque de Reims, les évêques de Paris, le grand Inquisiteur Jean Bréhal firent leur apparition. La mère et ses fils tombèrent aux genoux des prélats ; Isabelle présentait l’écrit pontifical. Avec une voix entrecoupée par les sanglots, et aidée par ceux qui l’assistaient, elle dit quelle fille le ciel lui avait donnée, sa foi, son orthodoxie, sa piété ; le supplice qui lui avait été infligé ; le déshonneur qui en rejaillissait sur sa mémoire, sur tous les siens ; l’appel qu’elle avait fait au refuge des opprimés ; le rescrit qu’elle en avait reçu ; la délégation faite aux prélats, délégation qu’elle les suppliait d’accepter et de remplir.
Il fut décidé que le procès s’instruirait à Rouen, et que les parties seraient citées dans cette ville.
Le nombre des témoins entendus dans les enquêtes fut de 121.
La sentence fut rendue le 7 juillet 1456 ; d’abord, en présence de quelques personnes seulement, dans la grande salle de l’archevêché de Rouen ; et immédiatement après, avec le plus grand appareil, au cimetière de Saint-Ouen ; le lendemain 8, avec la même pompe, sur le lieu du forfait, à la place du Vieux-Marché.
Chose singulière ! Ce procès, auquel l’histoire doit d’avoir conservé la plus belle de ses figures, n’a pas trouvé grâce devant Quicherat. Ses préférences sont pour l’œuvre de Cauchon. À l’entendre, l’évêque de Beauvais aurait juridiquement et canoniquement conduit ses poursuites, tandis que le procès de réhabilitation aurait été très mal mené.
Autant, dit Quicherat, l’un (le procès de condamnation) est rapide, clair, dégagé, autant l’autre (celui de la réhabilitation) est diffus et confus.
Et voilà qu’un des disciples du maître, M. Joseph Fabre, écrit à son tour :
L’exposé officiel du procès de réhabilitation, mal ordonné et diffus, ne supporte pas la comparaison avec l’exposé officiel du procès de condamnation, chef-d’œuvre de méthode et de précision.
Cette préférence donnée à l’œuvre de Cauchon ne laisse pas d’être assez étrange. Elle ne se justifie d’ailleurs à aucun titre.
Un procès, c’est un dossier, c’est-à-dire un recueil de pièces établissant que la sentence, à laquelle tout se rapporte, est bien fondée en fait et en droit. Le mérite de ces sortes d’œuvres n’est pas d’être rapides, dégagées : il est au contraire de leur essence d’être massives, surchargées, parfois même peu claires pour ceux qui ne sont pas du métier. L’essentiel, c’est qu’elles ferment toute voie à la chicane qui voudrait infirmer le jugement, en montrent le bien fondé, et le rendent, selon l’expression vulgaire, inattaquable.
Or, le procès de Cauchon manque précisément de certaines pièces essentielles. Ce qu’il renferme de plus clair, ce sont des contradictions ; les douze articles, censés résumer les aveux de Jeanne, jurent avec ces aveux inscrits dans les pages qui précèdent : canoniquement, l’abjuration, la rechute, telles qu’elles sont rapportées, sont une dérision ; il est facile d’être rapide et dégagé en supprimant dans une œuvre ce que les hommes compétents doivent y trouver avant tout.
Les juges de la réhabilitation avaient à dissiper des mensonges, à détruire des calomnies savantes, qui prétendaient s’appuyer sur le droit ecclésiastique. Il fallait venger et la victime et le droit lui-même ; les venger si pleinement, que le verdict fût resplendissant de vérité et de tout point inattaquable. Ils l’ont fait, et magnifiquement. Qu’après cela le procès paraisse diffus, le mal n’est pas grand, puis que cette diffusion tient au nombre considérable des pièces, et qu’il fallait bien que ces pièces fussent nombreuses pour répondre, d’une façon absolument irréfutable, à tous les mensonges et à toutes les calomnies entassées contre Jeanne.
Ce qui, du reste, semble surtout déplaire à Quicherat, ce qui provoque son dédain, ce sont les mémoires insérés au débat avec leurs discussions théologiques, leurs renvois à la jurisprudence canonique et civile. Les questions à traiter étaient fort ardues ; les théologiens et les canonistes se respectaient trop pour les résoudre par l’imagination, ou pour donner leur sentiment personnel, sans l’appuyer du sentiment des maîtres. Quicherat était un paléographe admirable, mais il n’aimait pas la théologie, et il n’était pas sans entretenir, à l’égard de l’Église, plus d’un préjugé fâcheux. Et c’est ainsi qu’il s’est trouvé conduit à élaguer de son œuvre, où se trouve pourtant plus d’une pièce inutile, les mémoires si intéressants que vient de nous rendre le P. Ayroles, les savantes discussions de Guillaume Bouillé, de Bochard, de Berruyer, de Basin et de Bréhal. Ainsi encore, dans les notes qu’il consacre, d’une part, à Cauchon et aux bourreaux, de l’autre aux apologistes de la martyre, Quicherat semble porté à plus d’indulgence pour les premiers que pour les seconds. Tandis qu’il critique volontiers les hommes de Rome, les Lellis, les Ciboule, les Bourdeilles, il laisse deviner une certaine sympathie pour Thomas de Courcelles, recteur de l’Université de Paris, qui prit une si grande et si déplorable part au procès de Rouen.
Comme le P. Ayroles, et après lui, c’est avec un vif regret que je signale ces erreurs du Quicherat. Il était nécessaire de le faire, à cause de la grande autorité dont il jouit si légitimement dans la question même de Jeanne d’Arc. Ce pénible devoir rempli, il faut rappeler, et je le fais avec joie, que l’ancien directeur de l’École des Chartes a bien mérité des amis de Jeanne d’Arc, par le grand nombre de pièces qu’il a recherchées, collectionnées et publiées. Il a mis sur la voie de travaux nouveaux, il a fourni aux historiens venus après lui de précieux, d’incomparables éléments. En dépit de certaines lacunes et de quelques appréciations regrettables, ses six volumes resteront comme un des plus beaux monuments de l’érudition au XIXe siècle.
Et cela aussi on peut le dire du magnifique travail du P. Ayroles. Dans les pages qui précèdent, je n’ai encore parlé que de son premier volume : La Pucelle devant l’Église de son temps. Le second a pour titre : La Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée. Il est consacré à la vie de Domrémy et de Vaucouleurs, jusqu’à l’arrivée à Chinon. Les chroniqueurs parlent peu de cette première période. Ils s’étendent surtout sur la partie guerrière. Il y avait là une importante lacune à combler. Le savant historien n’a rien négligé pour remplir cette partie de sa tâche, la plus délicate et la plus décisive. Il a réalisé, avec un plein succès, dans ce deuxième volume, l’œuvre signalée comme indispensable, il y a quelques années déjà, par celui qui était alors le doyen des évêques et des cardinaux français, le cardinal Desprez, archevêque de Toulouse.
À tout prix, écrivait-il, il faut arracher notre admirable Jeanne d’Arc au rationalisme et à la libre-pensée ; il faut montrer en elle la Vierge divinement envoyée à la France pour la préserver de la ruine et conserver à la défense de la foi la nation appelée si justement la Fille aînée de l’Église.
Le troisième volume, récemment paru, a pour titre : La Libératrice d’après les chroniques et les documents français et anglo-bourguignons, et la chronique inédite de Morosini. De toutes les Chroniques que les pays étrangers à la querelle anglo-française nous ont transmises sur Jeanne d’Arc, celle de Morosini est certainement la plus intéressante. La première par ordre de dates, elle est écrite au cours même des événements, au fur et à mesure qu’ils s’accomplissent. Elle a une forme à part, puisqu’elle consiste en une correspondance, due principalement à un noble Vénitien mandant à son père les événements qui se passaient en France. La chronique Morosini a cet avantage de nous faire saisir sur le fait même l’impression produite dans la chrétienté entière par l’apparition de Jeanne d’Arc. Ce document d’une si haute valeur était jusqu’ici resté inconnu.
Le tome IV sera consacré à la Vierge guerrière d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté et la libre-pensée.
Le tome V et dernier aura pour objet la Martyre.
Les cinq volumes du P. Ayroles comprendront deux ou trois fois les matières des cinq volumes du double Procès de Quicherat. On voit combien Sainte-Beuve se trompait lorsqu’il écrivait que le dernier mot était dit sur Jeanne d’Arc. L’ouvrage du P. Ayroles, — ce post-scriptum en cinq volumes, qui a valeur douze ou quinze — est un livre de premier ordre, l’œuvre d’un érudit, d’un historien et d’un théologien.
Grâce à lui, grâce à ses longues et incessantes recherches, à son infatigable zèle, à son amour pour l’Église et pour la France, nous possédons aujourd’hui, avec tous les rayons de son auréole, la Vraie Jeanne d’Arc.
Edmond Biré.
Revue des sciences ecclésiastiques février 1898
Compte-rendu favorable du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc par Jean-Arthur Chollet.
Source : Revue des sciences ecclésiastiques, tome 77 (8e série, tome 7), n° 458, février 1898, p. 176-178.
Lien : Archive
Obéissant à l’ordre du Pape qui en honorant son entreprise d’un bref d’éloges, lui disait : in quo versari ne cesses [poursuis sans te laisser interrompre], le R. P. Ayroles vient de faire paraître le troisième volume de la Vraie Jeanne d’Arc. Par deux fois déjà (voir les n° de septembre 1890 et août 1894), à l’occasion des deux premiers volumes, nous avons dit avec bonheur tout le bien que nous pensions de cette œuvre de glorification de Jeanne, si précieuse pour l’histoire de l’Église et pour l’histoire de France.
L’auteur suit ici la même méthode, les mêmes procédés de vulgarisation, de recherches et de discussion. Grâce à lui, chacun peut, dans le présent volume comme dans les précédents, lire des chroniques de première importance sur la Pucelle ; grâce à lui l’historien possède des documents nouveaux et inédits qui ajoutent à la lumière toujours grandissante dont s’enveloppe l’apparition merveilleuse de Jeanne aux jours les plus sombres de notre histoire ; grâce à lui le critique apprend à mieux apprécier la provenance et la valeur des pièces que l’on possédait déjà, mais que l’insuffisance des renseignements ou la prévention même avaient entourées d’ombres. Que de chemin fait depuis Quicherat, que d’éléments nouveaux apportés à la cause la plus intéressante, que de rectifications rendant la vue intégrale de la vérité plus prochaine !
On trouvera dans la Libératrice tous les documents que nous ont légués le parti de Jeanne, c’est-à-dire le parti français, et le parti anglo-bourguignon qu’elle combattait. L’abondance de ces documents a contraint l’auteur à rejeter dans le quatrième volume, consacré à la vie guerrière, les chroniques fournies par les nations étrangères à la querelle.
Le parti français, dont les apports historiques concernent surtout la période qui va de l’arrivée à Chinon jusqu’à la levée du siège de Paris, possède la Chronique de la Pucelle, écrite par Cousinot de Montreuil, le Journal du siège d’Orléans, la chronique de Jean le Chartier, celle de Perceval de Cagny, la relation du greffier de La Rochelle, la chronique de Tournay, les chapitres sur Jeanne d’Arc, tirés de l’Histoire de Charles VII de Thomas Basin, la chronique de Gilles le Bouvier ou de Berry, les pages de Mathieu Thomassin sur la Pucelle, la chronique du mont Saint-Michel, et d’autres pièces moins importantes qui éclairent des points particuliers de l’histoire de Jeanne.
Le parti anglo-bourguignon nous offre des documents modérés, peu ou point défavorables, comme la chronique de Monstrelet, celles des Cordeliers, de Gilles de Roye, de Georges Chastellain, du notaire Pierre Cochon, les notes de Clément de Fauquembergues, greffier du parlement de Paris, la brève chronique de Pierre Empis. À côté de ces œuvres, on en trouve, chez les anglo-bourguignons, d’autres nettement hostiles et haineuses. Le R. P. Ayroles les public également : ne fait-il pas un travail de sincérité historique et la Pucelle a-t-elle besoin d’autre chose ? Parmi ces pamphlets à l’adresse de la vierge guerrière, citons la chronique de Jean Wavrin de Forestel, celle de Le Fèvre de Saint-Rémy, le Journal de Jean Chuffart, le faux bourgeois de Paris, les registres du Chapitre de Notre-Dame, le témoignage de Bedford. (Signalons à ce sujet les très intéressantes plaquettes de M. l’abbé Debout : Jeanne d’Arc et les archives anglaises, et Appréciation du duc de Bedford, régent de France, sur Jeanne d’Arc et son œuvre). Tous ces documents l’auteur les publie avec un soin scrupuleux, après avoir collationné ou fait collationner, toutes les fois qu’il l’a pu, le texte sur les anciennes éditions ou les manuscrits originaux.
Mais ce qui donne un prix unique à sa publication, c’est la chronique de Morosini, inédite jusqu’ici et presque inconnue, et livrée à l’impression, pour la première fois, par le R. P. Ayroles.
La chronique de Morosini est une histoire de Venise à partir de la fondation de la ville. Les cinquante premiers feuillets faisant défaut, elle ne commence plus en réalité qu’en 1192. Pour une raison semblable, il est impossible de fixer jusqu’où l’auteur l’avait conduite, elle finit à l’année 1433. Morosini ne se contente pas de rapporter ce qui se passe dans la république ; il inscrit les nouvelles qui lui arrivent du monde connu. Or, Venise était alors la reine des mers, avait partout des comptoirs et des agents. Il n’y avait pas de meilleur centre d’informations.
La chronique contient jusqu’à vingt-trois passages sur la Pucelle. Onze se composent de lettres écrites de Bruges par le vénitien Pancrace Justiniani à son père. Elles sont souvent fort longues et fort intéressantes, c’est la partie vive de la chronique en ce qui regarde la Pucelle. La plupart des autres passages n’ont guère de valeur que comme expression du sentiment que la Pucelle excitait dans la chrétienté et de ce que la renommée publiait sur son compte.
Vienne possède l’original de la chronique, Venise en a une copie ; c’est celle-ci que reproduit le R. P. Ayroles, après l’avoir collationnée avec le manuscrit de Vienne. Il en donne la traduction dans le corps de son ouvrage et le texte original aux pièces justificatives où dix-sept pages compactes in-4° en sont remplies.
Il reste deux volumes à paraître pour compléter cette œuvre vaste et laborieuse
— c’est ainsi que l’appelle le Souverain Pontife. Nous les attendons avec une impatience que la perfection et l’inédit du volume sur la Libératrice ne fait qu’accroître. Aussi disons-nous avec Léon XIII à l’intrépide et savant auteur : In quo tu quidem versari ne cesses alacer. [Poursuis avec enthousiasme sans te laisser interrompre.]
A. Chollet.
La Science catholique 15 mars 1898
Compte-rendu du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc par l’abbé Théodore Leuridan, qui expose le but de la série et le plan de ce 3e volume.
Source : La Science catholique : revue des questions religieuses, 11e année, n° 4, 15 mars 1898, p. 376-378.
Lien : Gallica
XVIII. — Le R. P. Ayroles poursuit, avec persévérance et succès, le gigantesque monument
qu’il s’est proposé d’élever à la mémoire de l’héroïne française, la vénérable Jeanne d’Arc. Le troisième volume vient de paraître. Les deux précédents n’ayant pas été analysés dans la Science Catholique, nous croyons utile d’indiquer à nos lecteurs le but poursuivi par ce nouveau champion de la Pucelle. Voici comment il l’expose lui-même :
Mettre quiconque n’est pas sans quelque culture intellectuelle en état de voir, d’étudier dans son ensemble et dans ses détails l’existence de Jeanne d’Arc,… [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, 1894, préface, p. IX.]
Le premier volume de cet ouvrage a traité de : La Pucelle devant l’Église de son temps ; le second a pour titre : La paysanne et l’inspirée d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée. Le troisième, que nous signalons à nos lecteurs, envisage dans Jeanne d’Arc : La libératrice.
Dans un premier livre, l’auteur étudie l’attitude des deux partis en lutte, d’abord la France et le parti national, puis le parti anglo-bourguignon ou antinational. Il nous fait connaître les personnages mêlés aux événements, expose ce qu’était, au XVe siècle, l’art de la guerre, décrit la ville d’Orléans et fait l’historique du siège qui durait depuis sept mois déjà quand surgit Jeanne d’Arc, l’envoyée de Dieu. Ce premier livre est pour ainsi dire une introduction aux documents nombreux et étendus qui remplissent la presque totalité du volume.
L’auteur divise les chroniques qu’il reproduit ou analyse en deux sections : d’une part, les chroniques et les documents provenant du parti français qui se rapportent surtout à la période écoulée depuis l’arrivée de Jeanne à Chinon jusqu’à la levée du siège de Paris ; d’autre part, les chroniques du parti ennemi qui s’étendent plus longuement sur la seconde phase de la vie guerrière de la Pucelle. Ces documents sont fort nombreux de part et d’autre : le R P. Ayroles a dû établir des subdivisions. Pour les chroniques du parti français, ils les partage en chroniques plus étendues et en chroniques, documents, lettres et pièces officielles spéciales ; pour les chroniques du parti ennemi, il adopte une autre division en deux catégories, selon leur hostilité plus ou moins marquée.
Parmi les chroniques du parti français, nous remarquons la chronique de la Pucelle, le journal du siège d’Orléans, les chroniques de Jean Chartier, de Perceval de Cagny, du greffier de la Rochelle, de Thomas Basin, du héraut Berry, de Mathieu Thomassin. Les anglo-bourguignons sont représentés par Enguerrand de Monstrelet, le chroniqueur des Cordeliers, Gilles de Roye, Georges Chastellain, Pierre Cochon, Clément de Fauquembergues, qui sont rangés parmi les modérés peu ou point défavorables
.
Une seconde catégorie des anglo-bourguignons, ceux-ci ouvertement hostiles et haineux
comprend Jean Wavrin (ou mieux Jean de Wavrin, seigneur de Forestel, bien connu dans notre histoire de Flandre), Jean Le Fèvre de Saint-Rémy et Jean Chuffart ou le bourgeois de Paris
.
On le voit, ce recueil constitue une vaste compilation de documents historiques. Il faut bien le reconnaître, ces chroniques étaient connues déjà par les travaux et les publications de Denis Godefroy, de Vallet de Viriville, d’André Duchesne, du chanoine de Smet, de Buchon, de Douët d’Arcq, de Siméon Luce, de Kervyn de Lettenhove, de Robillard de Beaurepaire, de Mlle Dupont, de Tuetey, et surtout de Quicherat. Mais il importe de le remarquer, le R. P. Ayroles veut surtout faire œuvre de vulgarisation.
Cependant il y a, dans ce troisième volume, des extraits d’une chronique inédite et presque inconnue jusqu’ici. C’est la chronique de Morosini, dont une copie existe à Venise et l’original à Vienne. Le R. P. Ayroles donne le texte italien des passages de cette chronique qui ont trait à Jeanne d’Arc et l’accompagne de remarques historiques et critiques. C’est la partie neuve de son travail et elle n’est pas sans importance.
L’abbé Th. Leuridan.
Revue thomiste mai 1898
Compte-rendu positif du tome III dans les Notes bibliographiques de mars 1898.
Remarque originale : le père Ayroles suit l’opinion du savant Alexandre Tuetey qui attribue le Journal d’un Bourgeois de Paris à l’universitaire Jean Chuffart (dans son édition de 1881). Le critique remarque que le père Denifle rejette cette paternité dans son édition du Chartularium Universitatis Parisiensis (1897), en notant que Jean Chuffart n’était pas à Paris lors d’événements dont l’auteur du Journal dit avoir été le témoin oculaire.
Mais ce n’est qu’un détail.
Source : Revue thomiste (père dominicains), 6e année, 1898, p. 261-262.
Je suis inexcusable de venir si tard parler aux lecteurs de la Revue Thomiste du troisième volume consacré par le R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, à la gloire de la Vraie Jeanne d’Arc. Ce volume a pour titre : La Libératrice, d’après les chroniques et les documents français, anglo-bourguignons et la chronique inédite de Morosini, et ce titre indique de la façon la plus claire le but que s’est proposé l’infatigable Jésuite : il l’a très heureusement atteint.
Montrer enfin Jeanne d’Arc telle que l’ont vue et telle que l’ont dépeinte ses contemporains, amis et ennemis, c’était rendre à la cause de l’héroïne le plus éminent des services, c’était apporter à la glorification de son œuvre miraculeuse le plus précieux des concours. On ne l’avait fait jusqu’ici qu’incomplètement, par des citations, par des fragments, par des interprétations : plaidoyer plutôt que document historique ; la main qui avait agencé les matériaux, ménagé les coupures, on pouvait toujours la soupçonner d’avoir obéi à une pensée préconçue, travaillé pour un but fixé d’avance et qu’il fallait atteindre à tout prix. Il était temps de mettre, sous les yeux de tous, tous les instruments de la cause, pour pouvoir dire à chacun Veni, et vide.
Afin de rendre pour tous l’examen possible, le R. P. Ayroles a livré au grand public ces précieux documents, non seulement groupés dans son volume, mais dégagés de la forme archaïque, qui les rendait jusqu’ici accessibles aux seuls érudits, familiarisés avec la langue latine et avec les dialectes, moins connus encore, du moyen âge. Il y avait bien là un danger : traduttore, traditore, disent les Italiens. Ce danger, le P. Ayroles l’a aperçu et il l’a évité ; il aime à s’en rendre témoignage à lui-même, et il a raison.
Mutiler un chef-d’œuvre de Michel-Ange, (dit-il), altérer le coloris d’un tableau de Raphaël, passe pour un attentat auprès des artistes. Quand il s’agit d’un chef-d’œuvre de Dieu, tel que Jeanne la Pucelle, c’est un sacrilège. Altérer sciemment le sens des textes, c’est s’exposer à le commettre. Notre conscience nous dit que nous sommes innocent de semblables crimes ; c’est avec un vrai scrupule qu’il a été procédé aux changements indiqués. Ne faire dire à l’écrivain que ce qu’il a dit, tout ce qu’il a dit, a été l’objet d’une préoccupation constante.
Le P. Ayroles ne se dissimule point l’espèce de défaveur, qui s’attache aujourd’hui à cette façon de procéder ; mais, s’il n’en a que médiocrement tenu compte, le but qu’il poursuit la justifie à ses propres yeux et la justifiera aux yeux de beaucoup d’autres.
La méthode qui vient d’être exposée, (dit-il), n’est pas celle qui est aujourd’hui en honneur. On s’attache à la reproduction matérielle, parfois photographique des textes. Cela peut assurer la conservation de nos monuments historiques, mais borner là le travail de l’historien, ce serait faire descendre l’histoire au rang du métier. Il est vrai que, le plus souvent, le texte est accompagné de notes, parfois trois ou quatre fois plus étendues que l’écrit original minutieusement reproduit. N’est-ce pas ajouter une difficulté de plus à une lecture déjà fatigante, en interrompant par des renvois, à chaque membre de phrase, celui qui l’a entreprise ? N’est-ce pas faire de l’histoire le domaine exclusif de quelques amateurs, qui s’en partagent les lambeaux ?
Quoi qu’en puissent penser les érudits de profession et les dilettanti irréductibles, c’est sous cette forme, à la fois atténuée et authentique, que le R. P. Ayroles a groupé dans son volume, d’abord les chroniques du parti français, en commençant par les plus considérables, puis celles du parti anglo-bourguignon, en commençant par les documents les plus modérés
et en renvoyant à la fin les documents ouvertement haineux
, source au moins suspecte, et pourtant reflet trop fidèle de certains mouvements d’opinion, de certaines passions, pour que l’histoire ne doive pas s’en éclairer. Viennent enfin les documents étrangers, et parmi ceux-là la chronique de Morosini, jusqu’ici inédite, la vraie perle du livre.
Elle est d’origine vénitienne. Elle se compose, en majeure partie, de
lettres écrites par Pancrace Justiniani à son père. [Ces lettres] sont souvent fort longues et fort intéressantes ; c’est la partie vive de la chronique en ce qui regarde la Pucelle. [La plupart des autres sont] comme l’expression du sentiment que la Pucelle produisait dans la chrétienté et de ce que la renommée publiait sur son compte. [Or,] Pancrace Justiniani, résidant à Bruges, était en situation de savoir, mieux que partout ailleurs, ce qui se passait en France… Justiniani était très sympathique au parti français… Il observe, il prête l’oreille à ce qui se dit, il ne rapporte que ce qui lui semble avoir quelque fondement et attend souvent de l’avenir la confirmation ou le démenti des nouvelles qu’il transmet sous réserve.
Telle est la publication du R. P. Ayroles. Chacune des chroniques qu’il publie est précédée d’observations critiques précieuses. Tout le monde pourtant ne sera pas absolument d’accord avec le savant auteur, pas plus qu’avec M. Tuetey, dont il s’inspire, sur le nom dont il convient de signer le fameux Journal anonyme d’un bourgeois de Paris ; témoin le P. Denifle, au tome IV de son Chartularium Universitatis Parisiensis, p. 370, n° 2141, note 1. Mais ce n’est qu’un détail.
Disons enfin que l’ouvrage c’est une heureuse inspiration s’ouvre par un double exposé, d’abord celui
des deux partis en lutte, avec une brève notice des personnages qui étaient à leur tête à l’arrivée de Jeanne : cela, dit le P. Ayroles, nous évitera des renvois à des notes qui interrompraient la lecture ;
puis, sommairement du moins, celui
de l’art de la guerre au commencement du XVe siècle.
L’auteur veut ainsi, par le contraste avec l’inexpérience, avec l’ignorance d’une jeune fille de dix-sept ans improvisée chef d’armée, faire ressortir le caractère divin de sa mission et de son œuvre.
À ce rapide aperçu que pourrions-nous ajouter autre chose que la parole même adressée au savant et laborieux auteur par le chef de l’Église : In quo tu quidem, dilecte fili, versari ne cesses alacer [Ne cessez pas, bien-aimé fils, de poursuivre allégrement ce travail (extrait du bref de Léon XIII)] ; récompense magnifique d’un long travail, encouragement irrésistible à le poursuivre virilement jusqu’au bout.
A. D. S.