Documentation : Vraie Jeanne, IV (1898-1901)
La Vraie Jeanne d’Arc, t. IV 1898-1901
Le Peuple français 14 avril 1898
Annonce de la parution prochaine du t. IV de la Vraie Jeanne d’Arc.
Vente par souscription : coût 15 francs, 10 pour ceux qui auront souscrit avant le 15 avril.
Lien : Retronews
Sous Presse. — La Vierge guerrière : d’après ces aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes et les registres du temps par, le R. P. J. B. Ayroles. S. J. 1 fort vol. in-4°, en souscription. 10 fr. — Après le 15 avril, le prix de ce 4° volume de la Vraie Jeanne d’Arc, sera porté à 15 fr.
La Réforme sociale 16 avril 1898
Présentation de l’éditeur sur deux pages, et bon de souscription pour le tome IV de la Vraie Jeanne d’Arc (15 fr. le volume, ou 10 fr. si l’on souscrit avant le 20 avril selon la présentation, ou le 30 avril selon le bon).
Après avoir exposé le contenu de ce 4e volume, le texte résume l’idée maîtresse du père Ayroles : l’histoire de Jeanne d’Arc constitue une preuve du surnaturel et du christianisme. Il rappelle que l’ouvrage a été distingué par un bref de Léon XIII, et précise que les noms des souscripteurs à la collection complète figureront dans le prochain volume.
Source : La Réforme sociale, 18e année, tome 35, 4e série, tome V. (Les pages publicitaires, renvoyée en fin de recueil, étaient probablement jointes à la livraison n° 54, du 16 avril 1898.)
Lien : Gallica
Ane Mon Gaume et Cie, X. Rondelet et Cie, éditeurs, 3 rue de l’Abbaye, Paris.
Souscription au 4e volume de la Vraie Jeanne d’Arc : La Vierge Guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes et les registres du temps, la libre-pensée, par le R. Père J.-B. J. Ayroles, de la Compagnie de Jésus.
L’historien de Jeanne d’Arc. — Le R. P. Ayroles S. J., un des principaux témoins entendus par le Tribunal chargé, sous la présidence de Mgr l’évêque d’Orléans, de la procédure relative a la canonisation de Jeanne d’Arc, va publier le IVe volume de son admirable ouvrage : La Vraie Jeanne d’Arc. Il a pour titre : La Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires la chrétienté, les poètes et les registres du temps, la libre-pensée.
La Libératrice et la Vierge guerrière. — Le précédent a présenté, d’après les amis et les ennemis, la suite des événements, et n’a touché qu’accidentellement et comme par l’extérieur à la merveilleuse jeune fille qui les menait. Celui-ci, au contraire, fait surtout connaître la personne et l’effet produit dans la chrétienté par son apparition. Ce que fut la Vierge guerrière, on le saura par les aveux que lui arrachèrent sur cette période de sa vie les tortionnaires de Rouen, et par les dépositions des cinquante cinq témoins qui, au procès de réhabilitation, furent cités pour dire ce que fut celle qu’ils avaient vue, entendue à Chinon, à Poitiers, à Orléans, dans les campagnes de la Loire et du sacre. Qui pouvait mieux la connaître que ceux qui la virent à la cour, la reçurent sous leur toit, combattirent à ses côtés ou faisaient partie de la maison que lui constitua Charles VII . Leurs dépositions sont renfermées dans ce volume. On y trouvera les nombreux écrits des contemporains qui nous ont transmis les impressions de la chrétienté entière.
Au fond, les témoignages sont concordants ; les divergences ne portent que sur des points secondaires ; les ennemis eux mêmes sont forcés d’avouer les faits, et c’est vainement qu’ils essaient d’en calomnier la cause, et de noircir la lumière ; elle brille malgré eux et laisse voir la physionomie dépeinte par les spectateurs non prévenus.
La Pucelle, preuve et exposé du christianisme tout entier. — Dieu n’a pas fait si belle merveille, unique dans l’histoire, pour un siècle seulement. Si l’on considère la France indépendamment de ses destinées surnaturelles, l’on peut même dire que la Pucelle a été faite pour chose plus grande que la résurrection de la France.
Dans le plus beau des panégyriques inspirés par la fête du 8 mai, a Orléans, en 1844, un jeune prêtre qui devait s’appeler le cardinal Pie, proclamait Jeanne, le type le plus complet et le plus large de la religion et de la patrie ; un modèle à offrir à la fille des pâtres et à la fille des rois, aux prêtres et aux guerriers, aux heureux du monde et à ceux qui souffrent, aux grands et aux petits ; un parfum de l’Éden dans notre triste exil ; une apparition du Ciel ; Dieu venant à nous cette fois encore par un chemin virginal.
Qu’est-ce à dire sinon que la Pucelle est le Christianisme entier mis sous nos yeux dans un fait qui en est la preuve la plus irréfragable en même temps qu’un expose plein de charmes ? Nombreuses et irréfutables sont les preuves du surnaturel chrétien qui ressortent de la vie guerrière de la Vénérable. Le volume les expose, en même temps qu’il montre par quels procédés le naturalisme cherche à se débarrasser d’un fait qui le met a néant.
La connaissance de Jeanne d’Arc réservée à nos temps. — Si le XVe siècle subit un instant le charme, on peut dire qu’il ne sut pas ou mieux ne voulut pas tirer les conclusions de ce fait sans pareil. Le bûcher du Vieux-Marché fut pour lui ce que fut pour le monde la croix du Calvaire, un scandale. Dieu, en venant encore à nous par un chemin virginal, condamnait les passions égoïstes et frappait des erreurs dont on voulait faire des dogmes. L’histoire de la sainte fille fut obscurcie, mutilée ; et même parmi les bons l’on se transmit une Jeanne d’Arc incomplète et à moitié voilée.
L’heure est venue de la tirer du cadre étroit qui la rapetisse et la voile, de tirer des faits et des paroles de l’envoyée du ciel les trésors qu’ils renferment pour la réfutation de l’impiété, pour l’encouragement et la sanctification des croyants. Dieu réservait ce secours à nos temps.
Nécessité d’étudier la sainte dans les sources de son histoire. — Les autels que l’Église se prépare à élever à la sainte, et les fêtes en son honneur que chaque année ramènera dès lors, fourniront l’occasion, imposeront le devoir de le faire valoir, à tous les amis de la Sainte, de la France et de l’Église. Il est par suite nécessaire qu’ils possèdent pleinement les faits, et peut être plus pleinement encore les paroles. La Vénérable affirmait à ses prétendus juges, à la 17e séance, n’avoir rien dit que sur le conseil de sainte Catherine. L’inspiration qui en parut manifeste à plusieurs de ses auditeurs, devient évidente quand on reconstitue la situation avec toutes ses circonstances.
Les cinq volumes de la Vraie Jeanne d’Arc ont pour but de reproduire, de vulgariser les faits et les paroles dans toute leur vérité, de les expliquer, de les venger, d’en tirer les principales conséquences.
Approbation de Léon XIII. — L’auteur a reçu la plus douce et la plus haute des récompenses par le bref si élogieux dont le Vicaire de Jésus-Christ a bien voulu l’honorer. Non seulement Léon XIII a daigné lui dire de poursuivre le travail, toute autre occupation cessante, il a proclamé l’œuvre une excellente manière de bien mériter de la Religion et de l’État. Elle recevra son couronnement par le volume du Martyre ; et, Dieu aidant, il ne se fera pas trop attendre.
On a dit que c’était un monument, auquel on a appliqué l’ære perentus du poète. Il doit porter les noms de ceux qui l’auront élevé. C’est pourquoi sans attendre le Ve volume qui sera surchargé, on trouvera dans celui-ci les noms de ceux qui ont souscrit ou souscriront aux cinq volumes. Ils leur seront livrés au prix de faveur de 10 fr. le volume.
Pour le même prix, on peut souscrire à la Vierge Guerrière jusqu’au 20 avril. Passé ce laps de temps, un volume demandé à part sera coté 15 fr.
Plan de la publication de la Vraie Jeanne d’Arc :
- La Pucelle devant l’Église de son temps, 1 vol. in-4° : 15 fr.
- La Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée, 1 vol. in-4° : 15 fr.
- La Libératrice, d’après les documents français et anglo-bourguignons et la chronique inédite de Morosini, avec cartes, 1 vol. in-4° : 15 fr.
- La Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes et les registres du temps, la libre-pensée (en souscription), 1 volume in-4° : 15 fr.
- La Martyre, d’après son procès, les témoins oculaires et la libre-pensée (en préparation), 1 volume in-4° : 15 fr.
Total : 75 fr.
Pour les souscripteurs inscrits avant la publication de chaque volume, 10 fr. le volume.
[Page suivante, le bon de souscription à remplir, similaire à celui-ci.]
La Croix de Saintonge et d’Aunis 17 avril 1898
Bon de souscription pour le 4e volume de la Vraie Jeanne d’Arc.
Lien : Retronews
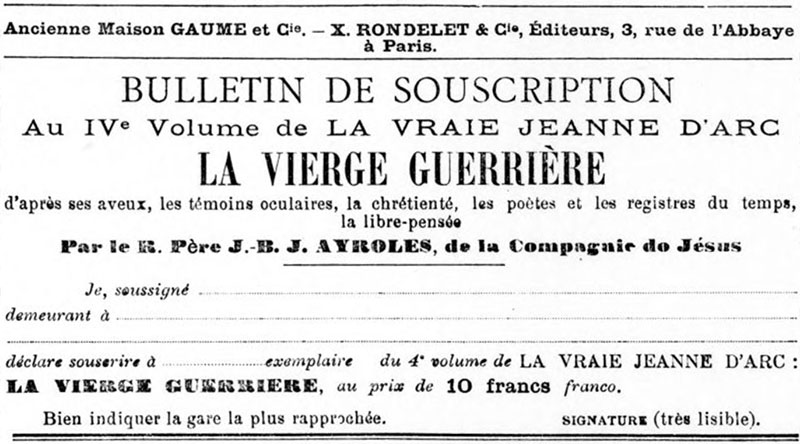
Ancienne Maison Gaume et Cie. — X. Rondelet et Cie, Éditeurs, 3, rue de l’Abbaye à Paris. — Bulletin de souscription — Au IVe Volume de La Vraie Jeanne d’Arc — La Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes et les registres du temps, la libre-pensée — Par le R. Père J.-B-J. Ayroles, de la Compagnie de Jésus.
Je, soussigné … demeurant à … déclare souscrire à … exemplaire du 4e volume de la Vraie Jeanne d’Arc : la Vierge guerrière, au prix de 10 francs franco. — Bien indiquer la gare la plus rapprochée. Signature (très lisible).
[Le bon de commande est précédé d’un plan de publication des 5 volumes :]
Pour les souscripteurs avant l’apparition du volume en souscription, 10 francs.
Le Peuple français 24 mai 1898
Présentation du plan de publication des 5 volumes et du bon de souscription pour le 4e.
Lien : Retronews (p. 3 et 4)
[Similaire au plan et au bon publiés dans la Croix de Saintonge et d’Aunis du 17 avril 1898.]
Revue catholique des institutions et du droit juin 1898
Bon de souscription pour l’Histoire complète de Jeanne d’Arc, du chanoine Dunand. Le père Ayroles est l’une des sources utilisées par l’auteur, aux côtés de L’Averdy, Barante, Quicherat…
Source : Revue catholique des institutions et du droit, 26e année, 2e semestre, 2e série, 21e volume.
Lien : Gallica
[…] Le lecteur y trouvera les résultats des investigations et des travaux de L’Averdy, de l’abbé Dubois, de Barante, de J. Quicherat, de Vallet de Viriville, de Dufresne de Baaucourt, du R. P. Ayroles, de Siméon Luce, de MM.de Bouteiller, de Braux, Boucher de Molandon, J. Loiseleur, Charpentier, Cuissart, Sorel, Charles de Beaurepaire, Lanéry d’Arc, des RR. PP. Belon et Balme.
[…] Le premier volume de l’Histoire complète de Jeanne d’Arc, paraîtra vers juillet prochain. — Le prix de l’ouvrage en souscription est de 4 fr., le volume pris en librairie. Dès que le premier volume aura paru, le prix de chacun des trois sera porté à 6 francs. On peut adresser les demandes de souscription par simple carte signée, soit à l’auteur, M. le chanoine Dunand, rue Nazareth, 29, soit à l’éditeur, M. Paul Édouard-Privat, rue des Tourneurs, 45, à Toulouse. Les volumes ne seront payables qu’après livraison.
Revue catholique des institutions et du droit juillet-août 1898
Long compte-rendu du tome IV de la Vraie Jeanne d’Arc par Albert Desplagnes, qui plus que jamais y voit l’un des plus importants ouvrages de notre temps
.
Une simple histoire de Jeanne d’Arc, si parfaite fût-elle, n’aurait pas, à ce point de vue, la même autorité, du moins pour les esprits difficiles et qui, ainsi que Thomas, veulent voir et toucher avant de croire. Avec le livre actuel, on voit, on touche.
Quelques remarques :
Ce volume IV, ainsi que le II (l’enfance de Jeanne) emporte sa préférence car ils nous dépeignent cette âme idéale de Française et de chrétienne
.
Desplagnes s’interroge sur le cas d’Alençon : le 3 mai 1456 il livrait aux juges de la réhabilitation son témoignage ému sur l’épopée de Jeanne d’Arc, et se faisait arrêter le 27 pour conspiration avec l’Anglais.
Il expose la position du père Ayroles sur des questions historiques (le secret du roi, l’étendue de la mission de Jeanne, les causes de l’échec devant Paris) ainsi que ses conclusions quant à :
1. la royauté non seulement céleste mais terrestre et sociale de Jésus-Christ ; […] 2. la manifestation du surnaturel par toute la vie et les actes de Jeanne.
Desplagnes se fait l’avocat du père Ayroles sur plusieurs points :
1. Le recueil d’Ayroles ne fait-il pas doublon avec celui de Quicherat ? — Non : il contient presque le double de matières, classées dans un ordre logique
, corrige certaines erreurs de transcription, et réfute les systèmes de la libre-pensée
.
2. Admettre ainsi le surnaturel chrétien n’est-ce pas du mysticisme
? — Non ; et pour qui rejette le christianisme, Jeanne d’Arc est incompréhensible et inexplicable
. Desplagnes va plus loin :
L’histoire vraie et complète de Jeanne n’a jamais pu et ne pourra jamais être écrite par un non catholique ou un catholique qui ne l’est que de nom, parce que ou il niera les miracles innombrables de cette histoire, ou bien il devra raconter des faits auxquels il ne croit pas.
2bis. Garantir l’immédiate restauration de la France par la simple canonisation de Jeanne n’est-ce pas du mysticisme
? — Le père Ayroles déclare simplement que
la résurrection de la France ne pouvait venir que du retour à la foi pratique et aux vertus démontrées et inspirées par Jeanne.
Desplagnes reprend l’idée plus loin :
Jeanne vit, elle nous aime et veut nous sauver encore ; seulement pas plus au ciel que sur la terre elle ne peut nous sauver sans nous, et surtout malgré nous.
3. L’ouvrage du père Ayroles ne sera pas lu par le monde érudit parce qu’il ne donne pas les textes purs des documents. — Faux : il les donne.
4. Le père Denifle, dominicain allemand, auteur du Cartulaire de l’Université de Paris rejette dans une dissertation la responsabilité de l’institution dans la mort de Jeanne. — Si, elle a trahi.
On comprend que l’apologie de ce corps traître à son pays, soit faite avec complaisance par un Allemand.
Note. — Le père Ayroles répondra au père Denifle par un ouvrage entier : L’Université de Paris au temps de Jeanne d’Arc (1901), qu’il fera paraître avant le tome V de la Vraie Jeanne d’Arc (1902).
En conclusion, Desplagnes réaffirme son engouement pour l’ouvrage du père Ayroles :
Je voudrais que la France entière pût le lire.
Il l’incite même à composer d’autres livres plus courts, plus à la portée de tous
. Seul point de désaccord : Ayroles estime que la situation de la France était pire au XVe siècle qu’elle l’est au XIXe, Desplagnes pense l’inverse.
Note. — En 1910, Ayroles s’exprimera dans le même sens et parlera de la France d’aujourd’hui, bien plus près de sa ruine que celle du XVe siècle
. (Cf. l’article : La morale chrétienne dans l’histoire de Jeanne d’Arc.)
Voir : Comptes-rendus de Desplagnes
Source : Revue catholique des institutions et du droit, 26e année, 2e semestre 1898, 2e série, 21e volume, juillet (p. 24-40), août (p. 110-123).
24La Vraie Jeanne d’Arc, tome IV : La Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes du temps, les registres publics et la libre-pensée.
I
Jeanne d’Arc est le grand nom, comme le phare national qui illumine pour nous la fin du XIXe siècle. Pourquoi la merveilleuse vierge qui fut la stupéfaction universelle du temps témoin de sa vie, fut-elle si promptement oubliée que, pendant les trois ou quatre siècles qui l’ont suivie, la nation qu’elle avait sauvée semble presque ignorer son histoire, même son nom ? Quand on lit les livres d’histoire des siècles derniers, par exemple le grand dictionnaire de Moréri, qui est de la fin de Louis XIV, on est étonné de voir une pareille ignorance de faits absolument certains et qui ont une telle importance pour la nation. Pourquoi les rois qui lui devaient leur couronne ont-ils paru si ouvertement ignorants ou ingrats ? Et, avant tout, comment le roi dépossédé de tout son royaume avant elle, et qui chaque jour, pendant un an, voyait de ses yeux la puissance surnaturelle dont elle disposait et les miracles qu’elle semait sous ses pas pour le replacer sur son trône, comment ce roi qui était chrétien, intelligent et brave, qui avant Jeanne n’avait connu que le malheur et la ruine, qui avait la double expérience d’une humiliante misère suivie tout à coup, dès l’apparition de la Pucelle, d’éclatants et improbables triomphes, comment ce prince fut-il toujours si aveugle devant cette puissance qu’il reconnaissait cependant, si rebelle à la main qui le tirait du précipice, si faible pour les ineptes ou coupables conseillers qui voulaient perdre sa libératrice ? 25L’indocilité et l’ingratitude de Charles VII surprennent bien plus encore que l’oubli des siècles qui l’ont suivi. Il y a dans ces divers faits un mystère que l’histoire constate, et qu’elle ne peut expliquer.
Ce mystère est vraiment humiliant pour l’esprit français, quand on voit depuis plus d’un siècle vivre encore dans la mémoire des plus ignorants, et jusque dans le cœur de milliers de fanatiques, les noms des scélérats de la Terreur comme ceux des ambitieux qui ont fait le malheur de la France. Sous François Ier, sous Louis XII, même sous Louis XI, qui pourtant l’avait vue, qui se rappelait encore Jeanne d’Arc ? qui s’inspirait d’elle et de ce qu’elle avait dit ou fait pour nous ? Aujourd’hui, par contre, on parle de Robespierre, de Danton et de beaucoup de leurs infâmes complices comme s’ils vivaient encore ; Napoléon Ier est discuté comme s’il prétendait de nouveau ramener le pays sur le chemin des victoires et des désastres. Et cependant, Robespierre, Danton et leurs pareils sont la honte de l’humanité, et Napoléon a été un fléau plus encore qu’une gloire. Jeanne d’Arc non seulement a remporté des victoires autrement surprenantes que tous les autres, mais sans elle la France serait devenue dès 1429 une simple province anglaise. Un ignoble juif, dont je ne veux pas même citer le nom trop connu, regrettait publiquement, il y a quelques mois, la venue de Jeanne, parce que, disait-il, les Français fondus avec les Anglais auraient fait un peuple admirable
!
II
Ces pensées et bien d’autres me venaient à l’esprit en lisant le nouveau volume du grand ouvrage que le P. Ayroles consacre à la plus illustre des Françaises.
Ce volume, le quatrième de ce monument historique, est spécialement relatif à la personne de notre Libératrice. Le volume précédent avait présenté le tableau des événements de 1429 et 1430, des victoires sur les Anglais, du triomphe de notre nationalité, de la résurrection 26de la France. Aujourd’hui, l’auteur nous expose tout ce qui a été dit et écrit par ses contemporains sur la personne même de Jeanne pendant sa vie guerrière. Le volume II nous avait révélé, d’après les mêmes sources, la paysanne de Domrémy, la vierge inspirée qui recevait les enseignements des saints du Paradis. Le volume actuel nous montre la guerrière, la céleste envoyée exécutant sa mission, jusqu’au jour où a commencé son martyre.
Les nombreux témoins qui ont vu Jeanne, qui ont combattu à ses côtés, qui ont même vécu près d’elle, à la Cour, à la guerre, à Chinon, à Orléans, à Bourges, à Reims, partout où elle a été en 1429 et 1430 ; les contemporains qui l’ont connue ou ont entendu parler d’elle, les poètes qui l’ont chantée, les hommes publics qui ont noté les délibérations des villes et les dépenses publiques occasionnées par sa mission et ses campagnes, voilà ceux que le P. Ayroles fait revivre pour nous dire ce que fut la Pucelle. Ici encore, notons une surprise. L’ignorance et le mensonge sont sans limites comme sans pudeur. On dit souvent que l’histoire de Jeanne est bien obscure et pleine de légendes. Or, il n’y a pas de personnage historique, même de nos temps, sur lequel on possède une aussi prodigieuse quantité de documents, d’écrits et de témoignages, et en même temps des écrits aussi absolument authentiques, puisque les plus considérables sont des pièces judiciaires rédigées sous la surveillance jalouse et le haineux contrôle de juges vendus à ses ennemis. On est si complètement renseigné sur la vie publique de Jeanne qu’on a pu dresser jour par jour, de janvier 1429 au 30 mai 1431, un mémorial exposant où elle se trouvait et ce qu’elle a fait. Quel est le personnage, mort ou vivant, sur lequel on soit renseigné de la sorte ? Pourquoi donc prétendre que cette histoire est obscure ? On trouve ce mémorial dans le volume IV du P. Ayroles, et dans d’autres ouvrages. Sans doute il y a quelques divergences, mais ne portant que sur des dates indifférentes ou des points très secondaires. L’histoire elle-même, le portrait de Jeanne sont burinés par ses 27contemporains de façon qu’un homme sensé et de bonne foi n’y peut voir l’ombre d’un doute et s’émerveille d’une pareille lumière.
Notre auteur note et discute chaque divergence, chaque point contesté, de façon à faire juger où est la vérité. Sa discussion est toujours complète, claire et concluante. On pourra remarquer avec quelle agréable vivacité il présente ses arguments et l’on rit volontiers de la piteuse posture à laquelle il réduit certains écrivains dont il démasque la fantaisie ou la mauvaise foi.
III
J’ai dit déjà, lors de la publication des volumes précédents, ce que je pense du monument historique élevé par le P. Ayroles à notre Libératrice. C’est un des plus importants ouvrages de notre temps, un de ceux qui ont le plus d’intérêt pour la nation et comportent pour elle les résultats les plus décisifs. Les documents qu’il produit ou rétablit en pleine lumière nous donnent le mot, la clé de notre histoire nationale, la raison d’être de la France, les conditions de son existence, la cause de ses gloires, de ses épreuves et de ses désastres, le moyen primordial de retrouver sa grandeur et sa prospérité. Jeanne, paysanne ignorante qui n’avait jamais eu idée d’aucune question politique, religieuse ou sociale, a reçu ces révélations et nous les a fidèlement transmises, comme elle en avait mission formelle. Qu’on le veuille, qu’on ne le veuille pas, il faut pourtant s’incliner devant un fait aussi clair. En le niant, on ne prouve ni science ni esprit critique, ni intelligence, mais simplement une sotte vanité ou la mauvaise foi. La valeur du livre du P. Ayroles est de nous exposer par les textes authentiques et une discussion scientifique complète ces vérités nationales. Une simple histoire de Jeanne d’Arc, si parfaite fût-elle, n’aurait pas, à ce point de vue, la même autorité, du moins pour les esprits difficiles et qui, ainsi que Thomas, veulent voir et toucher avant de croire. Avec le livre actuel, on voit, on touche. Tant pis pour 28qui ne veut ni voir ni comprendre. Et l’on prétendrait que cet ouvrage est sans portée ! Lequel donc, nous donne, aussi bien que lui, le secret de nos destinées ?
Le pape Léon XIII a proclamé l’importance de l’œuvre dans le bref qu’il a adressé à l’auteur le 25 juillet 1894 ; de pareils témoignages venant du Saint-Père sont bien rares.
Le volume actuel et le volume II sont, à mon sens, les plus attachants de l’ouvrage. Les volumes I et III sont tout aussi nécessaires, mais ceux qui dépeignent la vierge privilégiée chargée d’accomplir tant de miracles, qui montrent sa personne, cette âme idéale de Française et de chrétienne, ont forcément un charme plus puissant que des dissertations théologiques et le récit d’expéditions, si extraordinaires qu’elles soient.
La jeune paysanne lorraine devenant du jour au lendemain un capitaine plus habile que les plus grands hommes de guerre, sans cesser d’être une vierge douce et pleine de charmes ; voilà, certes, ce qui explique l’admiration et la stupéfaction de l’Europe dès les premiers jours de sa vie publique. L’admiration de nos temps ne le cède pas à celle du XVe siècle. L’auteur a réuni spécialement dans ce volume tous les documents pouvant nous faire connaître la guerrière. On trouve d’abord ses déclarations à Rouen et ailleurs ; on entend ensuite les témoins de sa vie et c’est merveille de pouvoir la juger d’après les témoignages directs de tant de personnes qui ont vécu près d’elle, qui l’ont vénérée comme une sainte et aimée comme la plus attrayante des vierges. On entend cinquante-cinq personnes, des plus recommandables, dont plusieurs illustres, dire ce qu’elles ont vu, ce qu’elles pensent de la Pucelle, et ce surtout pour sa vie publique. Nous avons déjà, au deuxième volume, entendu d’autres témoins, encore plus nombreux, nous dire ce qu’avait été Jeanne à Domrémy. Tous ces témoins la proclament une sainte et une envoyée de Dieu, disposant d’une force supérieure à celle de l’homme. Il n’est aucun personnage, ancien ou moderne, dont l’histoire ait gardé un portrait aussi complet, aussi admirable, tracé par des témoins de sa vie.
29Les relations émanant d’écrivains étrangers, italiens, allemands, espagnols, écossais, etc., les poèmes, les mystères, les romans, les écrits divers et si nombreux de l’époque ont, à mon sens, moins d’intérêt que les témoignages dont je viens de parler. Mais leur valeur incontestable est de montrer l’impression profonde et universelle en Europe, causée par l’apparition et les actes de Jeanne. Il est évident, à lire ces documents, que depuis dix-neuf siècles, nul événement n’a stupéfait à ce degré le monde chrétien.
Il y a un grand charme à lire les témoignages des contemporains. Comment ne pas le ressentir vivement à la déclaration si longue, si détaillée de F. Paquerel, ce religieux qui n’a pas quitté Jeanne de Tours à Compiègne ? Il la connaissait bien, lui qui l’a confessée si souvent, presque chaque jour ! Comme on voit la place imprimée dans son souvenir par cette céleste fille ! Tout ce qu’il rapporte a une importance essentielle pour quiconque veut connaître la Pucelle. Il précise, d’après ce qu’elle lui a dit elle-même, des points fondamentaux. Il la déclare formellement envoyée de Dieu et la juge sans hésitation une sainte.
Il y a d’ailleurs accord complet entre tous les témoins oculaires, et il y en a cent trente, soit pour la vie à Domrémy, soit pour la vie publique. Les déclarations de Jean d’Aulon, du duc d’Alençon, de Dunois, de Gaucourt, de Théobald d’Armagnac, du page Louis de Coutes, du dominicain Seguin, des si nombreux bourgeois et des femmes d’Orléans, de la dame de Bouligny, sont toutes des plus précieuses et composent un ensemble merveilleux. On ne pourrait dépeindre autrement et avec plus d’admiration une sainte et une ravissante vierge. C’est là, on ne peut trop le répéter, qu’il faut prendre le vrai portrait, la physionomie certaine de Jeanne. Le bon sens le crie, et quand on entend cent trente témoins oculaires, d’origines et de pays si divers, se connaissant à peine ou point les uns les autres, rendre le même témoignage sur une femme que tous ont connue, suivie pendant longtemps, vue à l’œuvre 30soit dans son village soit dans une vie si extraordinaire, on a peine à comprendre que des rêveurs, des écrivains fantaisistes ou sectaires viennent, après quatre cent cinquante ans, soutenir que ces cent trente témoins ont mal vu, que Jeanne était tout autre qu’ils le disent, et que ce sont eux seuls, Michelet, Henri Martin, Luce ou Vallet, qui ont connu ou deviné Jeanne. Quand ce qu’on appelle la science
émet de semblables rêves-creux et propose au public des absurdités, des contre-bon sens et des mensonges stupides, comme elle l’a fait pour Jeanne, uniquement en haine du surnaturel, elle mérite dix fois les volées de bois vert que lui a si bien appliquées le, P. Ayroles.
Lorsqu’on étudie cette histoire si belle, si simple, si parfaitement claire et certaine, on ne peut, du reste, que constater à chaque pas la faiblesse de l’homme, qui tout en voyant nettement la vérité, la nie avec impudence ou agit comme si la vérité était l’erreur. Charles VII, mieux que tout autre, ne doutait pas de la mission divine de Jeanne ; comment et pourquoi était-il si indocile, après avoir vu vingt fois, par d’éclatants miracles, qu’elle le conduisait divinement au salut et à la gloire ?
La jalousie, le désir secret de perdre une rivale, pouvait expliquer les résistances et les trahisons de ses détestables conseillers. Mais sa résistance, à lui, qui peut la comprendre et la justifier ? Il est aussi un des personnages le plus en vue, un acteur des plus célèbres du grand drame de notre libération, dont je ne puis m’expliquer le rôle. Ce pauvre duc d’Alençon, ce prince qu’on peut dire aimé de la Pucelle, qui a été son compagnon d’armes le plus fidèle et le plus empressé, qu’elle a sauvé à Jargeau par une intuition miraculeuse, qui avait été prisonnier des Anglais et s’était à moitié ruiné pour payer sa rançon, qui seul peut-être, avec Dunois, a tenté de sauver Jeanne après Compiègne, ne le voit-on pas, vingt-cinq ans après son martyre, trahir sa patrie qu’il avait si vaillamment défendue avec la Pucelle ! Et pourtant, il ne l’avait point oubliée. C’est le 3 mai 1456, 31devant l’Archevêque de Reims et l’Évêque de Paris qu’il rendait de Jeanne le magnifique témoignage que nous possédons, et avant la fin de ce même mois de mai, auquel s’attachaient pour lui tant et de si beaux souvenirs, il était arrêté par ordre de Charles VII, comme traître à la France, et traître pour les Anglais !… Il y a là un des faits les plus incompréhensibles du temps. Comment, le 3 mai, en dictant sa déclaration si digne de la Pucelle, le malheureux prince, déjà à moitié vendu aux ennemis de son pays, n’a-t-il pas retrouvé, dans ces souvenirs de gloire, son honneur d’un temps qu’il rappelait si bien ? On est confondu d’une semblable chute, que le plus sceptique n’aurait jamais osé prévoir. N’a-t-il pas compris son crime, quand il a vu, deux ans plus tard, au nombre des juges qui l’ont condamnée, les deux prélats qui avaient reçu, le 3 mai, son témoignage sur Jeanne, la loyale fille de France ?
IV
En traçant, d’après les documents du temps, le portrait de la Pucelle, l’auteur fait remarquer qu’elle a eu véritablement le don de prophétie, et qu’elle n’a cessé, depuis Vaucouleurs jusqu’à son martyre, d’annoncer des événements fort imprévus et improbables, qui se sont réalisés. Un chapitre du livre IV est consacré à faire ressortir ce don, l’un de ceux qui résultent du surnaturel dont elle était remplie. À chaque pas de sa carrière elle a prophétisé. Le public ne connaît pas assez ce caractère de Jeanne, aussi certain et non moins significatif que l’héroïcité de toutes les vertus.
V
Le travail du P. Ayroles apporte une lumière nouvelle sur beaucoup de points de la merveilleuse histoire. J’en dois citer spécialement quelques-uns. La plupart des auteurs ont été plus ou moins embarrassés pour 32exposer et expliquer le signe donné par Jeanne au roi à son arrivée à Chinon, et qui a décidé presque immédiatement Charles VII. Le premier chapitre de ce volume, consacré à ce point essentiel, le met en pleine lumière. L’inspiration céleste y éclate. L’entrevue de Chinon est un épisode qui ouvre merveilleusement la mission. Le P. Ayroles l’expose de façon à ne rien laisser désirer de plus. La sublime réalité de cette première rencontre du pauvre roi avec celle que Dieu lui envoyait dépasse les poèmes les plus ravissants.
Notre auteur est très complet aussi, et son travail est décisif en ce qui concerne la question de l’étendue de la mission confiée à Jeanne. Jusqu’à nos temps, il était officiellement décidé
que Jeanne n’avait de mission que pour Orléans et Reims, et qu’après le sacre elle était devenue comme une obstinée sans raison, une rebelle qui avait payé sa faute à Compiègne et à Rouen. On assure que Regnault de Chartres l’a écrit à sa bonne ville de Reims, et les écrivains l’ont cru sur parole. Qu’il l’ait écrit, c’est fort possible, et on ne peut pas s’en étonner de la part de ce chancelier, politique et courtisan bien plus qu’évêque, et dont le rôle a été assez louche. Mais la lettre même semble être apocryphe. Aujourd’hui, quelques rares arriérés seulement, qui évidemment n’ont jamais lu les documents originaux, soutiennent encore qu’à Reims la mission avait pris fin. Ils invoquent surtout le préjugé des historiens leurs devanciers, si bien que leur argument se réduit à une erreur successivement copiée par des auteurs de seconde et de troisième main.
Le P. Ayroles démontre à plusieurs reprises que la mission de Jeanne était autrement étendue, que si elle eût été seulement aidée, au lieu d’être perpétuellement combattue, entravée et trahie, les Anglais auraient été entièrement chassés de toute France
, en un an, que Paris aurait été rendu à Charles VII dès le mois de septembre 1429, que le duc d’Orléans serait revenu de Londres, et qu’on aurait vu bien d’autres merveilles. Les entraves opposées à la Libératrice par le roi et quelques 33courtisans jaloux ont retardé de vingt ans la libération du territoire.
L’échec éprouvé à la porte de Paris était resté assez obscur pendant des siècles. Aujourd’hui, on sait tout, depuis qu’on connaît l’absurde traité avec le duc de Bourgogne, accepté on ne sait pourquoi par Charles VII. Ici l’obscurité s’est compliquée d’une vraie trahison. Si Charles VII est devenu plus tard avisé et habile, il était, en 1429, bien incapable et singulièrement facile à tromper. On a peine à comprendre l’empire qu’avaient sur son esprit d’indignes et avides ambitieux et les roueries si grossières du duc de Bourgogne, dont il savait cependant toute la perfidie. Le P. Ayroles refait de main de maître toute cette histoire, si mal établie jusqu’à présent. Les documents et les pièces qu’il étale ne laissent rien de douteux. C’est là tout un côté de notre épopée nationale qui était à peine soupçonné et livré à des hypothèses. Il est dès à présent d’une clarté complète.
Les livres de compte du roi, du duc d’Orléans et de plusieurs villes ont fourni à l’historien de Jeanne des documents précieux. Avec le P. Ayroles nous regrettons que bien des archives restent encore inexplorées. Il paraît certain que beaucoup de documents précieux sont inconnus. Il semble pourtant que les recherches de ce genre sont assez générales et que les savants, comme l’État, s’y livrent avec ardeur. Malgré les destructions du temps, des révolutions et des accidents de tout genre, il y a dans les dépôts publics et dans beaucoup de familles une quantité de papiers précieux pour l’histoire et qu’on devrait dépouiller sans plus attendre. On a vu les découvertes faites relativement à Jeanne depuis peu d’années. Espérons que nous arriverons à reprendre bientôt à la poussière des archives tout ce que nous ignorons encore de cette céleste histoire, le poème national le plus admirable qui jamais ait été une réalité, et auquel ne peuvent être comparés les poèmes légendaires que des chantres immortels ont imposés à l’admiration des hommes. Si Homère, Virgile ou Dante avaient eu cette 34histoire à raconter, ils auraient laissé à l’humanité un chef-d’œuvre autrement puissant que les poèmes qui les ont immortalisés.
Enfin le volume se complète par une bonne carte, très utile pour bien comprendre les voyages et les opérations de guerre de la Pucelle.
VII
Après avoir produit tous les documents propres à faire connaître la Libératrice, le P. Ayroles se demande ce qui ressort de ces nombreuses pièces qui remplissent les deux derniers volumes de son ouvrage. Cet examen est le sujet du livre VI, et on peut dire que c’est la conclusion visée par l’auteur, le point où il voulait arriver pour montrer l’ensemble de son sujet. Ce livre est intitulé : Le surnaturel dans la guerrière libératrice.
Sa première conclusion est la royauté non seulement céleste mais terrestre et sociale de Jésus-Christ. Le Christ est, non pas au figuré, mais très pratiquement, le roi des nations, tout particulièrement de la France, qu’il s’est choisie et où il veut être reconnu comme souverain et vrai roi. La Pucelle n’a cessé de proclamer ce principe ; elle l’a répété cent fois d’une façon formelle, et l’a fait reconnaître par Charles VII, en lui déclarant qu’il recouvrerait son royaume, mais en la qualité par lui accepté de lieutenant du Christ. Saint Louis et Charlemagne avaient reconnu cette loi, et leur grandeur a eu pour cause primordiale la constante soumission qu’ils lui ont montrée. Jeanne était chargée de la rappeler aux Valois, qui l’avaient trop méconnue. Il n’est pas douteux pour nous que si la Maison de France avait été, après Jeanne d’Arc, fidèle à cette loi de son avènement et de sa constitution, elle serait encore aujourd’hui à la tête de notre nation et présiderait toujours à nos destinées. Pour prouver cette volonté, le Christ a fait révéler par Jeanne à Charles VII qu’il était vraiment fils du roi Charles VI, et par conséquent vrai héritier suivant la loi Salique. Le malheureux Dauphin en doutait et se demandait 35secrètement s’il n’était pas un intrus rejeté par Dieu. Jeanne a démontré là, dès la première heure, qu’elle avait une révélation et une mission divines, car aucun prestige, aucun charlatanisme, si habile qu’on le suppose, ne pouvait lui révéler une pensée et une prière secrètes de Charles VII. Elle est si sûre de sa mission, cette paysanne ignorante, qu’à peine en présence du roi, qu’elle n’a jamais vu, elle lui parle avec autorité et comme si Dieu parlait par sa bouche : Je te dis de la part de messire que tu es vrai héritier de France et fils du roi.
Si cette parole plus qu’extraordinaire eut été une simple impudence, le roi aurait fait mettre à la porte l’aventurière assez osée pour se moquer ainsi de lui. Charles VII en ressentit un bonheur que toute sa cour put lire sur son visage.
Une autre conclusion est la manifestation du surnaturel par toute la vie et les actes de Jeanne. La Pucelle est une preuve nouvelle et un exposé de l’Évangile. Le miracle, que la raison dévoyée dit absurde, est jeté par centaines sous les pas de la Pucelle. On ne peut les compter. Et avec les miracles, le don de prophétie, et toutes les vertus de la chrétienne la plus pure et la plus sainte. Le P. Ayroles montre de plus comment la vie publique de Jeanne est calquée sur celle du Christ. Les analogies sont frappantes et la copie ne peut être niée. La Pucelle apporte réellement à la France une révélation nouvelle du christianisme pratique, révélation voulue par Dieu pour la nation qu’il s’est choisie. Dernière ressemblance de Jeanne avec son divin modèle et son maître : elle est devenue comme lui un signe de contradiction.
Le livre VI, tout entier, est une mine d’une incroyable richesse pour l’apologie et la prédication chrétiennes. Il montre quelles ressources l’histoire de la Pucelle présente pour l’exposition de la foi et de la religion tout entière. Nous ne pouvons que le signaler aux prêtres, à tout le clergé enseignant. Il nous semble que ce n’est pas pour rester stérile qu’une semblable histoire s’est déroulée au milieu de nous. Nos prêtres, nos religieux 36sont intelligents et zélés ; qu’ils explorent ce champ, ils y trouveront des perles admirables pour l’Église.
VIII
Une objection ou plutôt une question a été faite au P. Ayroles, quelquefois même par des hommes qui louent le splendide monument qu’il élève à la Pucelle :
Pourquoi tant de travail, ont-ils dit, après Quicherat et les cinq volumes du savant paléographe ? N’est-ce pas une répétition inutile ? Quicherat n’a-t-il pas publié déjà tous les documents relatifs à la Pucelle ? etc.
La question prouve simplement qu’on n’a pas lu, ni même parcouru Quicherat, non plus que le P. Ayroles. Oui, Quicherat a ce mérite incontesté d’avoir, le premier, publié un grand nombre de documents originaux sur Jeanne, et son œuvre, qu’on ne peut trop louer à ce point de vue, a révélé aux Français le trésor inestimable qu’ils connaissaient si peu et si mal. Mais d’abord le célèbre archéologue a négligé une quantité considérable de documents très précieux, et il n’a publié que partiellement les autres. Il faut dire ensuite que l’ordre qu’il a suivi est très peu commode pour les recherches : l’ouvrage est un fouillis dont la lecture est impossible et où l’on ne trouve que malaisément ce qu’on cherche. De plus, il a, outre ces lacunes des fautes nombreuses et changeant parfois le sens du texte, parce qu’il n’a pas toujours copié les meilleurs manuscrits et que sa copie a été souvent mal faite. Voici qui est plus grave : on peut dire que Quicherat, très peu favorable au surnaturel et au catholicisme, a été surpris désagréablement par les découvertes qu’il avait faites sur la Pucelle, et la preuve en est qu’il a voulu, par des réflexions personnelles, en combattre et en détruire l’effet. Après avoir publié, bien ou mal, des documents démontrant que Jeanne était une admirable manifestation du surnaturel catholique, il a comme annulé ou nié tout ce qu’il avait révélé par une œuvre de son cru, dont le sens très net est ceci : ce que 37les documents rapportent est inexplicable ou controuvé, la vérité est que Jeanne est un personnage énigmatique et que je ne comprends pas.
Bien que Quicherat soit encore le moins fantaisiste des historiens libres-penseurs, les diverses causes résumées ci-dessus rendent son œuvre assez équivoque, et ce qui en ressort est de nature à laisser dans l’esprit du lecteur une incertitude fâcheuse, alors que les documents sont au contraire des plus clairs, des plus concluants pour montrer en Jeanne une sainte inspirée par Dieu et ayant reçu de lui une mission formelle.
Pour en finir avec Quicherat, il faut rappeler que son œuvre, bien que datant de moins de cinquante ans, a considérablement et vite vieilli par suite des découvertes faites depuis sa publication.
Toutes ces causes appelaient une œuvre nouvelle, bien plus complète, plus exacte, contenant ce que Quicherat ne connaissait pas, et enfin, qui, tout en rendant au paléographe la justice qui lui est due, montrât l’absurdité des prétendus philosophes dans les explications physiques qu’ils ont voulu donner de la Pucelle.
L’œuvre du P. Ayroles ne fait donc nullement double emploi avec celle de Quicherat. Elle contient presque le double de matières, classées dans un ordre logique qui présente comme une histoire suivie de Jeanne et rend les recherches extrêmement faciles. Elle sera à jour de toutes les découvertes (et il y en a de très importantes), jusqu’à la publication du cinquième volume. Enfin la réfutation des systèmes de la libre-pensée est parfaite, satisfait complètement l’esprit, et ce n’était pas le moins utile du travail qui s’imposait relativement à notre trésor national. La Vraie Jeanne d’Arc était donc un monument nécessaire. On l’appréciera de plus en plus, à mesure qu’il sera mieux connu.
IX
Venons à une autre objection. Il y faut répondre, quelque spécieuse qu’elle soit.
38Mysticisme, a-t-on dit !
C’est un mot, et un mot qu’on lance sans même en comprendre le vide. Ou bien ce mot est la négation de tout surnaturel, ou il n’a aucun sens.
Sans aucun doute, il y a mysticisme si l’on entend par là que l’histoire de Jeanne n’est pas simplement humaine, et que Dieu y a une part prépondérante. Mais ce n’est pas là la pensée de ces critiques, et ils seraient sans doute fort perplexes pour l’exposer avec franchise. Ils ne veulent pas, au fond, admettre le surnaturel et l’intervention divine dans le fait de Jeanne, et en même temps ils n’osent pas le nier formellement. Ils parlent de science
, de saine critique historique
et prétendent écarter toute formule expresse de miracle. Ils admettent l’inspiration
mot vague qui prête à toutes les équivoques. Ils rejettent en se cachant toute intervention surnaturelle, et cela d’un mot vague, équivoque, qui dit trop ou ne dit rien : mysticisme
!
Au fond, c’est toujours la division de ceux qui ont la foi et de ceux qui ne l’ont pas ou n’osent pas l’avouer. Mysticisme
répond à cet autre mot, fort en crédit dans le gouvernement actuel : neutralité
.
Eh bien, je crois depuis bien longtemps ce que je vais dire relativement à Jeanne.
Pour tout homme qui rejette le christianisme comme une erreur ou une fantaisie religieuse, je dis que Jeanne d’Arc est incompréhensible et inexplicable. Et de fait, les écrivains non chrétiens qui ont parlé d’elle et ont prétendu l’expliquer, sont réduits à nier les faits, les paroles, les actes les plus certains de la Pucelle, à rejeter comme légende tout ce qui porte la trace du miracle et à n’admettre que les actes naturellement explicables. On n’a pas idée dans le public de l’impudente fantaisie avec laquelle certains prétendus grands hommes de plume retranchent ou ajoutent dans l’histoire si Bien établie de la Pucelle. Il leur faut cela pour étayer leurs systèmes qui ne tiennent pas debout. C’est de la sorte qu’ils ont imaginé, avec des variantes des plus comiques, des prétendues Jeanne d’Arc, héroïnes, grands capitaines, 39tout ce que l’on voudra, mais, avant tout, soigneusement expurgées de l’idée religieuse. Il en est un qui a fait de la sainte libératrice, une sorte de prêtresse des Druides ; d’autres en font une hallucinée de génie. Il est bon de remarquer que cette école antichrétienne a fait de même pour le Christ. Renan, le chef de la bande, a montré dans Jésus-Christ un homme supérieur à tous les autres, un homme comme il n’y en a jamais eu et comme on n’en verra plus, un être incomparable, tout ce qu’on peut rêver de plus beau et de plus parfait, tout enfin… sauf qu’il est simplement fils d’un homme et non fils de Dieu.
Jeanne devait être traitée comme son maître. Elle l’est, aujourd’hui surtout, et ce n’est pas là la moindre preuve de sa mission divine et des miracles dont elle a semé son court passage.
Par contre, si Jeanne est inexplicable pour un homme non chrétien, elle est parfaitement comprise par un chrétien complet, c’est-à-dire un catholique. Tout catholique sincèrement croyant se trouve entièrement à l’aise dans cette apparition merveilleuse qui lui rappelle et lui prouve tout l’enseignement de sa religion, car l’histoire de la Pucelle est l’exposé et la manifestation intégrale du dogme catholique. Tout y est, Dieu le Père, son Fils le Christ Sauveur, qui est, il faut le reconnaître, au fond de tous les actes de Jeanne ; le Saint-Esprit, la Sainte Vierge, les Saints, le Paradis, l’Église triomphante, l’Église militante, le Pape, les Évêques, les prêtres, les sacrements, le baptême, la confession, la communion, la messe, la prière, la pénitence, le jeûne, la charité, l’immortalité de l’âme et la résurrection, la vie dévote, toutes les vertus chrétiennes, en un mot tout le christianisme. Voilà le monde, l’horizon où se meut la vierge de Domrémy, l’air qu’elle respire, la force qui la fit agir. Jeanne était un idéal de catholique autant qu’un idéal de Française, et en elle ces deux qualités sont inséparables. Comment un incrédule pourrait-il parler de tout cela ? Un catholique au contraire comprend tout, explique tout sans peine, sans 40embarras, comme l’expliquerait Jeanne elle-même. Et de plus son esprit est pleinement satisfait, puisque dans une série de faits historiques absolument certains il trouve l’éclatante manifestation et la preuve irréfutable de toute sa religion, de tout l’enseignement de l’Église depuis Jésus-Christ jusqu’à nos jours.
Une conséquence évidente, nécessaire, est que l’histoire vraie et complète de Jeanne n’a jamais pu et ne pourra jamais être écrite par un non catholique ou un catholique qui ne l’est que de nom, parce que ou il niera les miracles innombrables de cette histoire, ou bien il devra raconter des faits auxquels il ne croit pas. Forcément alors il les voudra dénaturer, tourner, violenter, de manière à pouvoir inaugurer une explication conforme à sa fantaisie. C’est ce qu’on peut vérifier dans beaucoup d’histoires que réfute le P. Ayroles, et qui sont simplement des romans dit historiques, à la façon d’Alexandre Dumas.
Pour écrire l’histoire de Jeanne, il faut de toute nécessité être catholique. Un prêtre y est parfaitement à son aise, et c’est pourquoi, surtout à la fin de ce siècle, on a vu plusieurs histoires et des études historiques excellentes, ayant Jeanne pour sujet et des prêtres pour auteurs. Mais il ne faut pas exagérer ce fait certain ; il n’est pas nécessaire d’être prêtre pour comprendre et dire la vérité sur Jeanne ; il suffit d’être catholique et croyant. Quant à ces deux qualités, elles sont indispensables.
[Numéro d’août 1898 :]
110X
L’objection de mysticisme faite au P. Ayroles, n’a pu tenir longtemps. Mais alors on l’a un peu retournée et l’on a objecté que le savant Jésuite attendait la canonisation de Jeanne parce que Jeanne sur les autels c’était, ipso facto, la résurrection de la France. C’est là du mysticisme et ce serait bien plus encore, car le P. Ayroles, suivant ces objections, promettrait simplement un miracle universel pour le jour où l’Église déclarera Jeanne une sainte. Il garantirait que dès ce jour, la France redeviendra la reine des nations, l’arbitre du monde. Le P. Ayroles, voudrait bien, à coup sûr, pouvoir avec quelque autorité faire une semblable promesse à notre pauvre pays, et il regrette très certainement que l’objection qu’on lui fait soit aussi creuse et imméritée. Jamais et dans aucun de ses livres l’historien de Jeanne n’a soutenu ni exposé une doctrine de ce genre. Ce serait plus que téméraire et confinerait à l’illuminé et à l’absurde. Le P. Ayroles a dit tout autre chose : il a déclaré que la résurrection de la France ne pouvait venir que du retour à la foi pratique et aux vertus démontrées et inspirées par Jeanne. La France ne peut espérer un miracle qui la change et la relève du jour au lendemain, surtout sans sa coopération très formelle. Jeanne, avec sa mission divine, n’a pu faire elle-même tout ce dont elle était chargée parce que la France ne lui a pas donné un concours suffisant et qu’elle a éprouvé à chaque pas des résistances qui l’ont paralysée. Le P. Ayroles montre fort bien, en toute occasion, comment ce manque de concours et cette résistance ont entravé, retardé 111et diminué l’œuvre voulue par Jeanne et pour laquelle elle avait mission. Et l’on voudrait que ce Religieux attende et annonce aujourd’hui pour notre pays une résurrection spontanée, dès que l’Église aura proclamé la sainteté de notre protectrice, et sans même que nous fassions rien pour la mériter ! C’est lui attribuer une pensée contraire à tout enseignement religieux, à l’expérience et au simple bon sens. Tout ce qu’il a écrit va à l’encontre d’une semblable conception, et il suffit, pour s’en convaincre, de lire le quatrième livre de Jeanne sur les autels et la régénération de la France qui est consacré aux réformes nécessaires que le culte de Jeanne doit inspirer à notre nation. Le P. Ayroles y développe le programme de Jeanne
; il y montre comment la Pucelle voyait la France et voulait la faire. Ce programme, dit l’auteur, renferme toutes les réformes nécessaires au relèvement de la patrie dans l’ordre social, moral et politique
(page 248). Il y a loin, comme on peut le voir, de cette nécessité de réformes
à un relèvement spontané, à une sorte de prestidigitation, comme celle que lui prêtent des esprits plus subtils que sensés. Et plus loin (page 296) en parlant de cette réforme : C’est, dit-il, la recette préparatoire exigée par la Libératrice pour relever la France.
Il est inutile, n’est-ce pas, de réfuter plus longuement l’objection faite à l’auteur du monument de Jeanne d’Arc ?
Aux subtils obstinés qui voient du mysticisme partout où l’on montre le surnaturel, nous conseillons de lire et de méditer sincèrement le dernier chapitre du livre VI : La Pucelle devant la théologie catholique. L’auteur montre sans nul doute le surnaturel qui éclate à chaque pas de Jeanne ; mais il est parfaitement pratique et sait que nous n’avons nulle promesse de revoir des miracles comme en 1429. Il promet simplement à la France qu’elle retrouvera toute sa grandeur si elle suit les inspirations de sa sainte Libératrice. Il est absolument dans le vrai et il nous montre notre seule voie de salut.
112XI
Je ne veux rien dire des objections sans nul fondement et qui sont plutôt des critiques de parti pris. Celles-là sont souvent favorables aux ouvrages qu’elles dénigrent. Ainsi, une revue allemande assez en crédit à Paris, prétend que l’ouvrage du P. Ayroles ne sera pas lu par le monde érudit parce qu’il ne donne pas les textes purs des documents. Après cette solennelle condamnation, l’érudite revue ne fait pas la moindre mention des paroles de Jeanne, toujours citées dans le texte original, pas plus que des chroniques inédites ou rares données en double texte ; elle garde le même silence sur beaucoup de dépositions. Je ne connais pas le degré d’érudition du critique, mais je me demande s’il a seulement lu un des volumes de l’ouvrage. Il me paraît quelque peu cousin du vieux Jules Janin qui, avec tout son esprit, se moquait parfois agréablement du public. Un jour il rendait, magistralement et sans appel, au rez-de-chaussée des Débats, compte d’une pièce nouvelle, et il finissait ainsi : Tout Paris passera à cet heureux théâtre, et je ne désespère pas d’aller moi-même, un soir, voir enfin cette merveille dont on parle tant.
Ne désespérons pas que la revue allemande jette un beau jour, enfin, les yeux sur les pages du P. Ayroles. Elle y fera peut-être quelques découvertes.
XII
Puisque je parle de critiques allemandes, je veux noter ici un fait qui, au moins par sa tendance, présente un caractère autrement grave.
Il paraît qu’un Dominicain allemand [le père Heinrich Denifle] employé aux archives du Vatican, publie, aux frais du gouvernement français, un ouvrage considérable, un cartulaire de l’Université de Paris [Chartularium Universitatis parisiensis], dont six volumes in-folio, auraient déjà paru, en précédant huit ou dix autres. Pour rendre moins odieux le rôle de l’Université à l’égard de Jeanne d’Arc, il rabaisse notre Libératrice avec une perfide 113habileté. Discutant avec acharnement des points sans portée où le Père Ayroles a adopté telle ou telle opinion d’anciens historiens de l’Université, il s’efforce de le trouver en erreur, de réhabiliter le corps célèbre qui s’est fait le persécuteur et le meurtrier de Jeanne, et de démontrer qu’il a toujours été bien loin du schisme. La tâche est difficile, mais elle ne saurait déplaire à un Allemand qui veut rabaisser la Grande Française.
L’Université de Paris a trahi la France, la cause nationale, et s’est fait l’agent le plus actif, le plus haineux de l’étranger, de l’Anglais qui nous écrasait. On comprend que l’apologie de ce corps traître à son pays, soit faite avec complaisance par un Allemand. On sait qu’il est dans le programme de nos voisins d’Outre-Rhin, de détruire cette idée que la France avait une mission spéciale pour la propagation du christianisme. Rabaisser Jeanne d’Arc, nier sa mission divine, insinuer tout au moins que la Pucelle n’était qu’une héroïne sans autre autorité que son génie, voilà le thème adopté. Le fait de Jeanne étant une preuve manifeste de notre mission, on comprend la marche de ceux qui l’attaquent.
Nous ne nous étonnerons pas de cette campagne, qui se révèle par tant d’actes et de façons si diverses, de nos jours. Les souteneurs du traître Dreyfus obéissent aux mêmes inspirations, au même commandement des ennemis de la France. Tout cela se tient ; aveugle qui ne le voit pas. Regrettons qu’un des fils de saint Dominique, traîne sa robe dans ce camp. Du temps de Jeanne ils étaient ailleurs. Le dominicain de notre fin de siècle trouvera devant ses élucubrations allemandes le grand Bréhal et les autres religieux du temps de Jeanne.
Nous ne nous étonnons pas davantage que cette triste campagne sous apparence scientifique, se fasse aux frais du gouvernement de la République. Outre qu’ils n’y voient pas de bien loin, nos gouvernants cherchent en tout à rabaisser la France chrétienne. La collaboration d’un Allemand avec eux pour cette œuvre là ne pouvait que leur plaire. Au moins devraient-ils ne pas nous la faire payer.
114Nous en avons dit assez. Nous avons voulu seulement mettre en garde les lecteurs français contre un ouvrage d’apparence si française, et dont les tendances ont déjà ému des Évêques. Nous supposons bien que quelque plume autorisée répondra aux in-folio du dominicain allemand pour rétablir la vérité sur les nombreuses et capitales questions qu’il voudrait trancher contre la France.
XIII.
Le P. Ayroles n’aime pas les infiniment petits
de l’histoire, alors surtout qu’il s’agit d’une messagère céleste. Qu’elle ait été brune ou blonde, grande ou petite, que ses cheveux fussent noirs ou roux, qu’elle ait porté tel jour une robe rouge ou verte, il y voit peu d’intérêt, et il s’attache avec raison à l’âme de notre Libératrice, à ce qu’elle a fait et dit. Il ne néglige pas cependant de recueillir dans un chapitre spécial tout ce que les contemporains ont écrit pour la dépeindre. Il constate, d’après ce, qu’elle était certainement belle et forte, qu’elle avait la voix douce et pénétrante, qu’elle parlait peu, toujours avec justesse et à propos, que la conversation avec elle était pleine de charme et laissait toujours une impression profonde. Un trait spécial à la Pucelle, que notent tous les hommes qui l’ont connue, est que, si belle et pleine d’attraits qu’elle fût, sa vue calmait les passions au lieu de les attiser, et qu’auprès d’elle les hommes les plus dissolus n’ont jamais osé se départir du plus grand respect, sentant toute passion mauvaise comme éteinte par sa présence. Nous ne parlons pas, on le comprend, des ignobles geôliers anglais, lords ou porte-clefs, qui, moins par passion que par calcul politique, ont poussé l’infamie jusqu’à tenter de salir cette vierge du Paradis et en ont fait une martyre.
XIV
Je voudrais que la France entière pût lire l’ouvrage du P. Ayroles, car en faisant le portrait et l’histoire de la Pucelle, il montre, par la logique même de son 115sujet, tout ce qui est le plus nécessaire à la France. La Pucelle est l’idéal de l’âme française, et jamais une patrie n’a été personnifiée, incarnée, comme la notre l’est dans cette admirable fille. Je parle, on le comprend, de la France telle qu’elle a été souvent, telle que Dieu la veut et que Jeanne la voulait aussi. Je ne parle pas de la France qu’ont faite la révolte religieuse du XVIe siècle, les folies royales du XVIIe, les négations et la corruption du XVIIIe, la révolution, enfin les barbares et les Juifs de l’époque actuelle. Entre ces deux Frances, il y a un précipice, et l’on reconnaît cependant, dans la seconde, les traits de la première, mais comme dans une pauvre femme usée par le désordre et une longue maladie on peut retrouver la fraîche jeune fille qu’on avait vue à son printemps, quand son œil bleu reflétait le ciel et son âme l’éternelle beauté qui ne se flétrira jamais.
Je voudrais que l’ouvrage, trop considérable pour devenir populaire, fût du moins la source d’autres livres plus courts, plus à la portée de tous, et qui feraient connaître à la France égarée ce qu’elle a été, ce qu’elle peut être encore, le jour où elle le voudra. Qu’on lui montre son âme, cette délicieuse Jeanne, pure comme un lys, belle de toutes les beautés qu’un poète peut rêver, façonnée par les saints et les saintes du Paradis, et que nous avons reçue, nous Français, des mains de Dieu, seuls bénéficiaires dans le monde entier et dans tous les siècles, de cette inestimable faveur. Nul n’a montré, aussi bien que le P. Ayroles, ce que peut valoir pour un peuple un présent de ce prix, ce que Jeanne peut faire pour nous, pourquoi elle nous a été donnée, et combien la France serait insensée et coupable de ne pas écouter ses enseignements.
XV
Je sais bien, et nous voyons tous qu’un mouvement extraordinaire, imprévu et irrésistible, s’est dessiné depuis vingt ans et nous jette aux pieds de la Libératrice. Je sais que la plupart des Français se sont épris 116d’admiration et d’amour pour elle et que les plus antireligieux ne sont pas les moins fervents. C’est un grand bonheur déjà, et je vois une faveur nouvelle dans cette inspiration si générale, qui est un appel d’en haut. Jeanne y a travaillé. Souvenez-vous de moi qui ai reçu mission de vous sauver, nous dit-elle, et écoutez-moi !
Toute la France a entendu sa voix. Elle se souvient et elle l’aime. C’est un fait certain.
Mais il ne faut pas que la France se contente de l’aimer comme un cher souvenir ou de l’admirer comme une belle statue. Jeanne n’est point une statue, elle est infiniment plus que le plus cher souvenir. Elle vit, elle nous aime et veut nous sauver encore, seulement pas plus au ciel que sur la terre elle ne peut nous sauver sans nous, et surtout malgré nous. Nous devons, de toute nécessité, coopérer à son œuvre.
Comment ? par les réformes dont nous avons tant besoin.
Or, cherchez tant que vous voudrez, vous arriverez forcément à cette conclusion que la première réforme, la base de toutes les autres est la réforme religieuse et morale. Il faut que la France rejette enfin, après plus d’un siècle d’expériences concluantes, le virus de l’athéisme, de la libre-pensée, de la neutralité, de l’anti-religion. Ce poison la tue. Il faut que franchement elle redevienne chrétienne, la nation, l’État, comme les habitants qui les composent. Jeanne a rappelé et proclamé avant tout que Jésus-Christ est le roi des nations, de la France en particulier, et que l’ordre politique et social doit être réglé par la loi qu’il a apportée au monde.
La situation est très simple et très concluante.
La France est aujourd’hui composée de 35 millions de catholiques, 600.000 protestants et 60.000 juifs. C’est pitié d’entendre les prétextes allégués pour respecter le culte de ces 660.000 dissidents en leur sacrifiant celui des 35 millions de catholiques. Il y a quelque probabilité que les républicains ne composent pas à eux seuls tout le peuple français, et qu’il y a au moins une minorité 117monarchiste. Est-ce que la majorité républicaine, à supposer qu’elle soit certaine, a jamais eu souci de garder la neutralité politique par respect pour la liberté des dissidents ? Pourquoi, avec cent fois plus de raison, n’en est-il pas de même pour la religion ? La qualité de catholique, pour l’État, n’implique pas, pour les dissidents, la moindre gêne ni l’ombre de défaveur. Pourquoi, en outre, à l’aide du mot menteur de neutralité
, les catholiques sont-ils persécutés, et suffit-il d’être juif ou protestant pour jouir de toutes les faveurs du gouvernement ? Cette question si simple est tellement défigurée qu’on n’a plus, dans le public, même l’idée de ce qu’elle est.
Tant que la France, qui est née catholique, qui a grandi et prospéré catholique, qui a été faite par des Évêques et sauvée par une envoyée de Dieu, voudra rester la nation impie et athée, et la seule en Europe qu’on flétrisse de ces noms, elle végétera dans les bas fonds de la politique révolutionnaire, descendant toujours, comme depuis un siècle, jusqu’à l’heure où, Dieu lassé, elle disparaîtra après tant d’autres, ce qui d’ailleurs, on le sait de reste, est dans les plans de certains peuples qu’on connaît.
La grande cause du mal, quant à ce, est bien moins le fait de la secte persécutrice des catholiques que la lâcheté de tous les catholiques, qui pourraient voir qu’ils sont seuls dans le monde à ne pas oser avouer et soutenir leur religion. Si les catholiques voulaient, qui pourrait les empêcher d’être maîtres chez eux ?
Il faut avec la réforme de l’État, la réforme sérieuse des personnes. Je n’ai pas la prétention de détruire les passions humaines, qui, jusqu’à la fin du monde, produiront des éclosions des sept péchés capitaux. Mais dans ces conditions inséparables de notre humanité, il est des erreurs, des crimes sociaux qu’on peut empêcher, des tendances qu’on peut favoriser ou prévenir, des directions qu’on peut imprimer. C’est non seulement le fait des prêtres et de l’éducation religieuse, mais aussi celui des gouvernements et des lois qui peuvent beaucoup pour 118ou contre la moralité publique. Il ne s’agit pas ici de contrainte légale, loin de là, mais de directions et de mesures propres à assurer la vraie liberté du bien. Croit-on, par exemple, que la législation sur la famille, le mariage, le divorce, les successions, la presse, etc., n’ait pas une grande puissance pour ou contre la moralité, la famille et d’autres bases sociales ?
Napoléon III, qui a été souvent aussi remarquable dans ses discours qu’il été déplorable et inepte dans sa politique, avait formulé un jour d’une façon simple et merveilleuse l’objectif d’un gouvernement honnête : Il est temps, dit-il, que les bons se rassurent et que les méchants tremblent
(Proclamation du 13 juin 1849). S’il a trop souvent agi à l’inverse, ce qui a amené sa piteuse chute, sa formule n’est pas moins vraie, et il faut la reprendre pour la mettre en pratique sans défaillance.
On peut différer, entre catholiques même, sur les réformes politiques ; il paraît impossible d’avoir deux avis sur la nécessité de la réforme morale.
Mais encore pour ces réformes faut-il que l’union se rétablisse entre tous les catholiques ; elle est aussi nécessaire qu’au temps de Jeanne, et nous en sommes peut-être plus loin qu’alors.
Le P. Ayroles a souvent cherché à comparer notre époque à celle de la Libératrice et il est certain qu’il y a des analogies entre les deux. Le parallèle est bon à étudier, d’ailleurs.
XVI
Notre auteur pense que la France du XIVe et du XVe siècle a été plus malheureuse, plus troublée que la France actuelle et que le désordre y était pire. Il faut distinguer et l’on peut apprécier les diverses causes des 119situations qu’on veut comparer. Il est certain que pendant la guerre de Cent ans, le désordre matériel a été plus grand, par suite des incursions et des violences permanentes des deux ou trois armées, qui étaient en majorité des bandes de vagabonds et de pillards. Toutes les provinces théâtre de la guerre étaient ruinées et presque inhabitables. Aujourd’hui le désordre matériel est rare et dure peu. Mais ce qui est pire qu’alors, c’est le désordre moral. Au XVe siècle, la foi religieuse était encore générale, et le Christ était reconnu comme le souverain maître, même par ceux qui, en pratique, étaient infidèles à sa loi. Aujourd’hui, on ne croit plus à rien, qu’à la force, et la force s’est incarnée dans la force publique mise au service des pires gouvernements et des pires lois. La religion, la moralité, l’honnêteté même ne sont plus rien s’il y a quelque loi allant à l’encontre, et il y en a beaucoup. La démoralisation a été l’œuvre d’abord des doctrines perverses prêchées plus ou moins secrètement, puis et surtout des gouvernements de mal. Rien n’est pire qu’un gouvernement de mal qui s’appuie sur les instincts de la bête humaine. Notre société en sera victime.
Au XVe siècle, il n’était aucun Français qui eût même la pensée de nier Dieu et le Christ. Les plus mauvais reconnaissaient en théorie au moins la loi chrétienne. Le gouvernement était absolument chrétien et, si malhabile, si infidèle qu’il pût être parfois, il avait toujours cette base fondamentale, la seule qui soit solide. Aujourd’hui, les gouvernements que nous subissons prétendent gouverner en dehors de toute religion, de toute loi morale primordiale, et, le plus souvent, contre la religion catholique. Cette exclusion de toute religion est même la seule loi supérieure qu’ils reconnaissent. Tout homme sensé et sincère voit immédiatement l’infériorité essentielle de notre époque, et je n’ai pas à l’expliquer ici. Sur cette base de négation, il n’y a aucune ressource pour les gouvernements combattus, car la légalité si changeante et la force publique n’ont qu’un temps assez court, après quoi il ne reste que l’anarchie ?
120Aussi à l’époque de Jeanne, comme plus tard sous Henri III et Henri IV, la France, bien assise sur la loi catholique, a pu assez vite se relever de ruines lamentables.
Voyez, d’ailleurs, en notre siècle, les nations qui ont gardé la religion, même mutilée ; voyez quelle vigueur et quels ressorts elles montrent. La Russie, la Prusse, l’Angleterre ont leurs gouvernements basés sur la religion, sur les principes essentiels qu’elles ont retenus du catholicisme. Elles n’ont pas chassé dix fois leurs souverains, comme l’a fait en un siècle la France révolutionnaire. Comparez leurs situations respectives ! Un vrai Français a le rouge au front et la mort dans le cœur à cette pensée. Mais il est des choses qu’il faut crier au lieu de les cacher ; il faudrait pouvoir arracher et jeter à l’égout notre gangrène politique au lieu de voiler la hideuse plaie et surtout de la donner comme une gloire.
Faut-il parler d’autres supériorités morales du XVe siècle ?
Jeanne a fait des efforts inouïs pour montrer aux Anglais, avant de les combattre, que leur invasion en France était contraire à tout droit, et pour les convaincre que le saint royaume ne leur appartiendrait jamais. Il est certain que l’invasion anglaise et le traité de Troyes étaient un vrai brigandage. Le duc Philippe de Bourgogne, en le favorisant, avait bien moins en vue de venger la mort de son père, Jean sans Peur, que de mettre la main sur les provinces françaises qui séparaient la Bourgogne de ses possessions des Pays-Bas. Philippe fut un roué impudent, un précurseur des Cavour, des Bismarck et de leurs maîtres, sans plus d’honnêteté et trouvant un roi aussi aisé à duper que l’a été Napoléon III. Qu’aurait dit Jeanne, en présence des brigandages d’Italie, de Prusse, de Turquie et des États-Unis, elle qui s’indignait si fort du brigandage anglais et de l’hypocrisie bourguignonne ? Notre temps, sous ce rapport, ne vaut pas le XVe siècle, quoi qu’en dise le P. Ayroles. Quel peuple, quel gouvernement 121aujourd’hui invoque l’idée du droit et de la justice pour faire une guerre ou pour se défendre ? Le droit du plus fort, le mensonge éhonté, la sauvagerie, ont remplacé tout cela. Quand au peuple victime de ces jeux de la force, il était réduit à se plier successivement suivant son intérêt, au triomphe du plus heureux. On voyait, du temps de Jeanne, les villes françaises rester fidèles au parti du plus fort jusqu’au jour où, la fortune de la guerre changeant, elles se soumettaient au nouveau maître. L’histoire a noté les transactions et les calculs des misérables provinces que trois princes se disputaient et occupaient tour à tour. Cela était forcé ; mais Jeanne a toujours fait appel au droit et à la justice, avant d’en venir à la force de la guerre. Notre temps, nos politiques verraient là une puérilité. C’est un étrange progrès !
L’idée de patrie était, alors, aussi générale et aussi profonde qu’aujourd’hui, sinon beaucoup plus. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire les neuf lettres qui nous restent de Jeanne d’Arc, et de réfléchir que la France s’est battue pendant un siècle, malgré quarante ans de revers désastreux, pour ne pas devenir anglaise. Les efforts des rois et des princes ne suffisent point pour expliquer une résistance si longue, et l’amour de la patrie peut seul la faire comprendre, alors surtout qu’à divers moments le peuple aurait eu matériellement intérêt à se soumettre à un roi étranger qui, pour réussir, avait jugé nécessaire de s’affubler d’un voile, si menteur qu’il fut, de légitimité et de droit. La secte seule a osé prétendre que l’idée de patrie était inconnue sous l’ancienne France, et n’a pris naissance qu’à la Révolution. Nous ne pouvons plus compter ses mensonges.
On ne peut que hausser les épaules quand on lit, par exemple, que les Hoche, les Marceau et les républicains ont créé en France le patriotisme et le culte de Jeanne d’Arc. M. Joseph Fabre et d’autres libres-penseurs ont émis à peu près en ces termes cette pensée. Le P. Ayroles leur répond fort bien dans le 4e volume.
122XVII
On pourrait aisément pousser plus loin la comparaison de notre temps avec celui de Jeanne d’Arc. Ce que nous avons montré suffit amplement pour arriver à d’utiles et pratiques conclusions.
La première est qu’un gouvernement, en France, plus encore que partout ailleurs, est indigne de ce nom et condamné d’avance s’il prétend se passer de Dieu et gouverner sans lui et contre lui. Jeanne l’a dit cent fois le roi de France n’est que le lieutenant du Christ et ne peut être vraiment roi qu’à cette condition. Qu’il s’agisse d’un roi, d’un président, d’un empereur, de tout autre chef d’État, quelque nom que la fantaisie politique puisse inventer, la règle primordiale subsiste. C’est Dieu lui-même qui l’a dit à Jeanne et l’a chargée de le répéter. C’est à nous d’écouter et de comprendre. Les peuples, comme les individus, sont libres, jusqu’au suicide inclusivement. On objectera que si nos maîtres sont athées, la France reste chrétienne. Si la France est restée chrétienne, qu’elle change ses maîtres. Elle le peut, très légalement. Elle le doit, sous peine de mort. Ce n’est point là une phrase, une déclamation à effet. C’est la simple, triste et incontestable réalité. Il semble que le spectacle de l’Europe actuelle devrait suffire pour nous en convaincre. Il faut être bien aveugle ou rudement sectaire et antifrançais pour ne pas comprendre l’enseignement résultant pour nous de la comparaison avec la Russie et la Prusse.
Jeanne nous convie, comme en 1429, à l’union de tous les vrais Français, à l’action franche et vigoureuse contre tous les faux Français, c’est-à-dire les ennemis intérieurs de la France honnête et chrétienne. Elle ne nous convie pas plus à des alliances interlopes avec eux qu’elle ne conviait Charles VII à écouter les perfidies et les traîtrises du Bourguignon. La Vierge du patriotisme agirait autrement que certains habiles du jour contre les révolutionnaires, les sans-Dieu et les sans-patrie.
123XVIII
J’en ai dit assez, et je renvoie à l’ouvrage du P. Ayroles, qui peut nous faire aisément comprendre notre devoir actuel par le fidèle tableau du passé. La méditation de la vie et de la mission de Jeanne, d’après les sources authentiques et sûres, et non d’après des histoires frelatées ou sectaires, fussent-elles l’œuvre de religieux étrangers, est, à nos yeux, un enseignement indispensable à tout homme d’État et aussi à tout Français qui se préoccupe des intérêts de son pays.
Le magnifique monument élevé par le savant Jésuite à la patronne de la France va être bientôt achevé. Nous n’avons plus à attendre que le volume V et dernier, qui nous dira le martyre de la Vierge lorraine. Qui sait si, en même temps que ce volume, ne viendra pas de Rome la couronne céleste qui permettra à la France de se jeter publiquement aux genoux de sa Libératrice en lui criant d’un seul cœur et d’une voix unanime :
Sainte Jeanne de Domrémy, priez pour nous !
A. Desplagnes,
Ancien magistrat.
La Croix 2 juillet 1898
Article consacré à la sortie du 4e volume de la Vraie Jeanne d’Arc sous forme d’hommage au père Ayroles mais sans analyse du fond.
Lien : Retronews
Nous avons la joie d’annoncer aux lecteurs de la Croix, l’apparition toute récente du IVe volume de cette œuvre magistrale dont nous leur avons déjà parlé.
C’est bien le Monument — ære perennius — le Monument à nul autre pareil, qui s’élève dans sa grandeur majestueux et sera bientôt couronné.
[Exegi monumentum ære perennius (J’ai élevé un monument plus durable que le bronze), incipit d’une ode d’Horace.]
On a beaucoup écrit sur Jeanne d’Arc. On formerait une vaste bibliothèque rien qu’avec les ouvrages consacrés à sa mémoire. On a sur elle des volumes et des volumes de panégyriques. On l’a chantée en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Dans toutes les langues, on a célébré sa piété, sa douceur, son courage, ses vertus guerrières, ses triomphes, sa captivité, sa mort. Elle a inspiré les plus hautes et les plus nobles éloquences. Naguère encore, à Notre-Dame de Paris [fête de Jeanne d’Arc du 1er mai 1898], Mgr de Cabrières émerveillait un immense auditoire en lui racontant la mission divine de la Pucelle d’Orléans, en lui rappelant l’héroïsme de cette vie couronnée par le martyre, en invoquant pour elle la fama sanctitatis des premiers âges de l’Église, en ajoutant une page d’un incomparable éclat au plaidoyer universel qui demande à la Sainte Église d’élever là Vénérable aux sublimes honneurs des autels.
Tous les arts, la sculpture, la peinture, la poésie, la musique ont produit des chefs-d’œuvre à la gloire de la pauvre fille des champs, qui par la grâce et la force de Dieu, rendit au roi de France sa couronne et son royaume, et le conduisit triomphant à Reims pour le faire sacrer là même où Clovis fut baptisé, au berceau de cette monarchie chrétienne qui, pendant tant de siècles, fit de notre patrie la reine du monde !
Le R. P. Ayroles a voué sa vie à recueillir tout ce que les chroniqueurs, les historiens, les archives, les dépôts poudreux des greffes, les manuscrits les plus divers, en toutes les langues, pouvaient contenir au sujet de Jeanne d’Arc. Il a mis à ce travail immense toutes les facultés de critique historique, de savoir éminent, de sagacité merveilleuse dont son esprit est si largement doué.
Il est bien l’homme — unius libri — qui ayant appliqué toutes les forces de son intelligence à son noble sujet, a réussi à élever le Monument que la Libératrice, la Paysanne inspirée et la Vierge guerrière attendaient encore.
La Vierge Guerrière, c’est le titre de ce IVe volume de près de 600 pages qui nous montre la Vraie Jeanne d’Arc d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes du temps, les registres publics et la libre-pensée.
Ce beau livre est accompagné d’une carte (dressée par le R. P. Carrez), qui permettra de suivre tous les pas de la Guerrière dans ses campagnes de la Loire, aux abords de Paris, de la suivre de Domrémy à Chinon, à Poitiers, à Tours, à Blois, à Patay, à Reims, à Paris, à Compiègne et jusqu’à Rouen !…
Quelques-uns des titres des chapitres vont indiquer l’étendue de l’ouvrage : […]
C’est un amoncellement de pièces, en leur texte intégral, de documents, d’écrits les plus divers, jugés, analysés, passés au crible de la plus savante discussion.
Le savant historien a justifié une fois de plus la noble définition de Bossuet, disant de l’histoire qu’elle est le tribunal souverain où les rois de la terre, les grands et les petits, les chefs et les peuples viennent, tour à tour, sans cour et sans suite, rendre compte de leurs actes et entendre des jugements sans appel.
Le R. P. Ayroles a été nous l’avons déjà dit et il nous est très doux de le répéter encouragé et loué
par le Saint-Père Léon XIII lui-même, l’exhortant dans un Bref à poursuivre allègrement ce travail, à l’insigne honneur de sa patrie et en même temps de la religion catholique, dont les lumières et la direction, plus que tout autre cause, ont, de tout temps, fait conquérir à la France les fleurons de la vraie gloire.
Combien le P. Ayroles a été profondément touché de ces encouragements et de ces louanges du Saint-Père, nous ne saurions le dire à notre aise, par crainte de blesser la délicate modestie du religieux. Son œuvre, il l’a entreprise sous le regard de Dieu : il l’a poursuivie avec une ardeur dont ses amis et ses confidents les plus intimes ont seuls le secret. Il va l’achever avec le Ve volume auquel il travaille sans repos, et dans lequel il nous dira le Martyre de la Vénérable.
Il aura de la sorte mis en lumière éclatante ce jugement immortel du cardinal Pie disant de Jeanne d’Arc qu’en cette fille d’élection, tous les dons divins se sont accumulés sur sa tête et que pas une pierrerie n’est à joindre à sa couronne
.
Études 5 août 1898
Compte-rendu de la Vie de M. Antonin Chaussinaud (1898) de Césaire Sire, par le père Ayroles.
Source : Études religieuses, 35e année, tome 76, 5 août 1898, p. 412-414.
Lien : Gallica
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
L’Univers 5 septembre 1898
Compte-rendu du tome I de l’Histoire complète de Jeanne d’Arc du chanoine Dunand, par Louis Maisonneuve. Il mentionne les sources utilisées : Quicherat, Ayroles et Edmond Richer.
Voir aussi son article sur le tome II dans l’Univers du 7 août 1899.
Lien : Retronews
Histoire complète de Jeanne d’Arc, par M. le chanoine Dunand. Paris, Poussiegue. Toulouse, E. Privat, éditeurs.
Une histoire de Jeanne d’Arc. — La bibliographie de Jeanne d’Arc, déjà si abondante, s’accroît indéfiniment ; peu de sujets offrent une littérature
plus riche et plus variée. Sous tous les aspects, à tous les points de vue, l’héroïque et charmante figure de la Pucelle a été considérée et présentée ; néanmoins ; il nous semble qu’une œuvre de composition était à faire, intéressante et vivement enlevée comme les meilleures esquisses ; mais, en même temps, développée, complète, donnant le suc de tout ce qu’une érudition patiente et méritoire a en tassé dans de gros volumes.
Il était donc légitime d’entreprendre cette tâche complexe et malaisée, — d’autant plus digne de tenter un historien. M. le chanoine Dunand qui s’y est voué tout entier était parfaitement préparé pour l’accomplir à la gloire de son héroïne, à notre profit et à son honneur. […]
[Sur les sources consultées :]
Et ces faits, il les emprunte aux vraies sources, aux travaux de première main, scrupuleusement consultés et prudemment interprétés lorsque cela est indispensable. Il est bien entendu que les deux procès de condamnation et de réhabilitation restent les mines où il faudra puiser les témoignages, mais non sans distinguer avec soin les actes officiels de procédure et les dépositions des témoins l’objet et l’intérêt de ces différentes pièces sont divers. On ne saurait trop remercier M, Quicherat de les avoir publiées, et il faut garder une vive gratitude au R. P. Ayroles qui les a enrichies de documents et illustrées d’études critiques.
Pourtant d’après M. le chanoine Dunand, la première place revient, parmi les historiens de la Pucelle, à Edmond Richer, le trop célèbre auteur du traité de Potestate ecclesiastica, où Gallicans et Fébroniens trouvèrent des armes contre l’Église romaine, et l’historien trop méconnu de Jeanne d’Arc. […]
L. Maisonneuve,
professeur à l’Institut catholique de Toulouse.
La Gazette 5 septembre 1898
Causerie littéraire d’Edmond Biré (feuilleton) consacrée au tome IV de la Vraie Jeanne d’Arc. Il relève trois points pour lesquels la négation du surnaturel aboutit à d’absurdes contradictions :
I. Jeanne, sa mission et ses voix.
Dépouillée par eux [les historiens naturaliste] de son caractère surnaturel, elle n’est plus qu’une malheureuse fille qui joue une odieuse et ridicule comédie, ou qui, si elle est sincère dans ses déclarations, n’est plus qu’une hallucinée et une folle.
II. Ses qualités militaires (don infus).
Non seulement [Jeanne] paraît général consommé à un âge où adolescent ne le fut jamais ; elle le paraît soudain, sans transition, sans préparation, en passant de l’extrême d’une vie entièrement différente, et cela, alors que pour tout le reste, elle continue d’être, selon le mot de Cousinot, la plus simple bergère qu’on vit oncques.
III. Le Kantisme.
Pour les tenants de cette idée [le Kantisme], tout se réduit à une manière de concevoir les choses : le ciel est tout entier dans l’idéal, c’est-à-dire en nous-mêmes, sans rien d’objectif en dehors de nous. C’est du fond de son être que parlaient les voix qu’entendait la Pucelle.
Biré termine en approuvant l’idée (mais non les arguments) de Joseph Fabre en vue de l’instauration d’une fête de Jeanne d’Arc :
Que M. Joseph Fabre continue donc à demander une fête nationale en l’honneur de Jeanne d’Arc ; mais, de grâce, qu’il renonce à quelques-uns de ses arguments.
Fabre en effet, fait des Révolutionnaires (Danton, Kléber) les enfants de Jeanne d’Arc.
Lien : Retronews
I
Sous ce titre, la Vraie Jeanne d’Arc, le savant père Ayroles a entrepris un ouvrage de proportions colossales, de ceux qui, à juste titre se peuvent dire des monuments
. Nous avons rendu compte des trois premiers volumes. Le quatrième, qui vient de paraître, sera suivi d’un autre, et comme chacun de ces volumes in-quarto équivalent sans peine à trois bons in-octavo, l’œuvre entière, lorsqu’elle sera terminée représentera quelque chose comme quinze volumes. On ne saurait trop admirer un si prodigieux labeur, poursuivi avec une si noble constance. L’auteur a d’ailleurs reçu de toutes les récompenses, la plus haute et la plus méritée, dans le Bref que lui adressait il y a quelques années déjà, Sa Sainteté Léon XIII, et dont voici la teneur :
Dans l’œuvre vaste et laborieuse depuis longtemps entreprise par vous… [cf. tomes III à V de la Vraie Jeanne d’Arc.]
Le cadre du tome IV est entièrement neuf. Il nous présente : La Vierge-Guerrière d’après ses aveux, les témoins oculaires, la Chrétienté, les poètes du temps, les registres publics et la libre-pensée.
Les chroniques et les documents cités dans le volume précédent portaient principalement sur les événements extérieurs, et ne touchaient que secondairement aux qualités de la personne qui les conduisait. C’est le contraire pour la plupart de ceux qui composent le tome IV. Par les aveux qui lui ont été arrachés sur cette partie de sa carrière, Jeanne d’Arc nous fait pénétrer dans le fond de son âme ; elle nous dévoile plusieurs ressorts cachés que n’ont pas aperçus ou indiqués ceux qui ont écrit des documents généraux et publics.
On sait ce que furent les réponses de Jeanne à ses juges et à ses bourreaux. Elles respirent souvent une telle sublimité, que tous les historiens, même les plus hostiles à l’Église, n’ont pu taire leur admiration. Ils se sont inclinés avec respect devant l’héroïne et la martyre. De ces interrogatoires cependant ils n’ont voulu retenir qu’une partie. À chaque instant, Jeanne répète qu’elle a eu et qu’elle a encore des révélations ; elle parle en toute rencontre des anges et des saints qui lui apparaissent, des voix qu’elle entend et qui viennent du ciel. Ses affirmations sont nettes, précises et sans cesse renouvelées.
Dès la première séance du procès, le 22 février 1431, interrogée sur son arrivée à Chinon et sur sa première visite au roi Charles VII, elle répond :
[S’en suivent de longs extraits (du livre I) des réponses de Jeanne à ses juges au sujet de ses voix.]
Nos historiens nationaux (?) MM. Michelet et Henri Martin glissent sur tout cela. Ils laissent dans l’ombre, le plus qu’ils le peuvent, ces affirmations répétées de Jeanne d’Arc, et volontiers ils les tiendront comme non avenues. Comment, en effet, les accorder avec ce qu’ils nous disent de sa grandeur d’âme, de sa noblesse et de sa pureté de cœur ? Si Jeanne disait vrai, elle était l’envoyée de Dieu
, sa mission était surnaturelle, l’œuvre qu’elle accomplissait s’était opérée par des voies miraculeuses. Or, nos historiens n’admettent pas l’action providentielle et divine ; ils rejettent le surnaturel ; ils ne croient pas aux miracles. Force leur est donc de tenir pour imaginaire tout ce que Jeanne a dit de ses visions, des voix qu’elle ne cessait d’entendre, de la mission qu’elle prétendait lui avoir été donnée par Dieu, par la Vierge Marie et tous les benoîts saints et saintes de Paradis et l’Église victorieuse de là-haut.
Pour eux, rien de tout cela n’est vrai ; mais alors qu’est ce que donc que Jeanne d’Arc ? Vainement, pour ne pas heurter le sentiment public, le sentiment national, vainement ils essaieront de célébrer Jeanne, d’en faire une héroïne sans reproche et sans tache. Dépouillée par eux de son caractère surnaturel, elle n’est plus qu’une malheureuse fille qui joue une odieuse et ridicule comédie, ou qui, si elle est sincère dans ses déclarations, n’est plus qu’une hallucinée et une folle. Pour révoltante qu’elle soit, cette conclusion, n’en est pas moins celle qui ressort forcément de leurs livres. Ni de la prudhommie de M. Henri Martin, ni l’éloquence de Michelet n’y peuvent rien changer. En dépit de leurs efforts, leur statue a des pieds d’argile, et ce n’est pas à eux qu’il nous faut nous adresser, si nous voulons connaître la vraie Jeanne d’Arc.
II
Le livre II du tome IV du P. Ayroles a pour titre : La Vierge-Guerrière d’après les témoins oculaires de sa vie publique. L’auteur y résume les dépositions des témoins entendus par la commission pontificale dans le procès de réhabilitation. La plus importante de ces dépositions est celle de Dunois. Nul n’avait vu Jeanne de plus près ; nul meilleur juge de sa vie et de ses actions ne pouvait être entendu. On lui demande s’il lui semble vraisemblable que Jeanne ait été envoyée par Dieu pour accomplir ses exploits guerriers, ou si ces exploits lui paraissent l’effet du génie naturel de la guerrière. Dunois n’hésite pas à répondre :
— Je crois que Jeanne a été envoyée par Dieu, et que ses exploits guerriers sont un effet de l’inspiration divine plutôt que celui du génie naturel.
— Qu’est-ce qui vous porte à le croire ?
— Plusieurs indices que je vais énumérer.
Et il raconte toute une suite d’événements extraordinaires, de faits précis indéniables attestés par nombre de témoignages, qui mettent en pleine lumière le caractère surnaturel de la mission de Jeanne.
Y eut-il jamais, en effet, plus étonnant miracle que celui qui fit soudain un capitaine accompli d’une créature que tout rendait absolument impropre à la guerre : l’âge, le sexe, la vie et les occupations antécédentes ? Rien de mieux constaté cependant. Une paysannelle de dix-sept ans, qui n’avait jusque-là manié que la houlette, la quenouille et le fuseau, paraît sans transition cavalier parfait, général consommé, soldat intrépide, sème une incurable terreur parmi les ennemis, accomplit les plus merveilleux exploits, fait avec une incroyable rapidité les plus magnifiques conquêtes, et cela malgré les obstacles qu’elle trouve dans son propre parti, où l’on finit par la combattre perfidement et l’empêcher de réaliser des œuvres plus grandes encore.
Dès son arrivée à la cour, — elle n’a que dix-sept ans à peine — elle montra qu’elle avait la science d’un métier qu’elle n’avait exercé, ni appris. Cousinot écrit de la nouvelle venue :
Elle traitait merveilleusement des manières de faire évacuer les Anglais du royaume ; il n’y avait pas chef de guerre qui sût tant proprement remontrer les manières de faire la guerre aux ennemis ; ce dont le roi et son conseil furent émerveillés ; car en toutes autres matières elle était autant simple qu’une pastourelle.
Théobald d’Armagnac, bailli de Chartres, qui avait combattu à ses côtés, nous dit :
En dehors de la guerre, elle était simple et innocente ; mais pour ce qui est de conduire une armée, d’ordonner la bataille, d’animer les combattants, c’était le capitaine le plus habile du monde, tel que pourrait être celui qui aurait passé toute sa vie dans le métier des armes.
Le duc d’Alençon était le généralissime de l’armée avec laquelle Jeanne balaya les bords de la Loire. Voici la fin de sa déposition :
Dans toute sa conduite, en dehors de la guerre, elle était simple comme une jeune fille ; mais elle était très experte au fait de la guerre, soit à porter la lance, soit à masser l’armée et à préparer la bataille ; elle excellait à tirer partie de l’artillerie ; c’était pour tous un sujet d’admiration que tant d’habileté et de prévoyance dans l’art militaire ; on eût dit un capitaine ayant trente ans du métier ; et surtout dans la disposition de l’artillerie ; elle excellait en ce point.
Il y a là, certes, quelque chose qui tient du prodige. Ce prodige ou, pour l’appeler de son vrai nom, ce miracle, nos historiens ne veulent pas le voir. Pour Michelet, il n’y a rien que de très naturel, et il nous dit qu’au moyen âge l’on voyait souvent les femmes monter et mourir sur le rempart assiégé. Sans doute l’on a vu, et l’histoire du siège d’Orléans en présente des exemples, l’on a vu, non sans admiration, des femmes s’élever jusqu’à égaler leurs maris et leurs frères en courage militaire.
Expliquer la Libératrice par de tels exemples, dit très bien le P. Ayroles, c’est expliquer Alexandre ou Napoléon par les soldats qui se faisaient tuer à leur suite.
Michelet cite les deux Jeanne de Bretagne, qui ont donné leurs noms à la guerre des maisons de Blois et de Montfort. Le fait qui excita le plus l’admiration est celui de Jeanne de Montfort assiégée dans Hennebont. Du haut d’une tour, elle voit que l’ennemi a déserté le camp pour emporter la place par un suprême effort. Elle sort par une poterne avec une poignée de serviteurs, met le feu au camp, et rentre sans avoir été aperçue. Quel rapport y a-t-il entre cet heureux coup d’audace et les exploits de la Pucelle ? Il ne tiendrait qu’une mince place dans l’histoire de la Vierge-Guerrière.
Les deux Jeanne avaient grandi entourées de proches, de chevaliers, dont la guerre était le métier ; elles avaient été bercées au bruit des récits militaires. Ainsi en fut-il des capitaines dont on admire la précocité guerrière. Alexandre, jeune homme, se plaignait de ce que Philippe, son père, ne lui laisserait rien à conquérir ; Condé, écolier, se plaisait à élever des redoutes de neige avec ses camarades et à simuler des batailles ; Napoléon, à Brienne, s’abîmait dans la lecture des Vies des grands capitaines de Plutarque ; il a eu ses années de garnison avant de faire la première campagne d’Italie.
Rien de semblable dans Jeanne d’Arc. Non seulement elle paraît général consommé à un âge où adolescent ne le fut jamais ; elle le paraît soudain, sans transition, sans préparation, en passant de l’extrême d’une vie entièrement différente, et cela, alors que pour tout le reste, elle continue d’être, selon le mot de Cousinot, la plus simple bergère qu’on vit oncques
. Le P. Ayroles a donc raison de dire :
Qui ne reconnaîtrait là ce que la théologie catholique appelle les dons infus, c’est-à-dire des dons accordés par un miracle de la libéralité divine, à un sujet, ou incapable de les acquérir naturellement, ou qui ne pourrait y parvenir que par un long travail, des exercices, une formation, par lesquels il n’est pas passé. Ces préliminaires sont la condition du génie, du talent ici-bas. Dans quelque genre que ce soit, quelque riche que soit le génie, il n’arrive à son plein épanouissement que successivement, par l’exercice. Les qualités militaires de la Vierge-Guerrière furent des dons miraculeusement infus, parce que tout manque au sexe féminin pour y exceller, et que même le sexe fort n’y arrive jamais, fût-il naturellement doué, que graduellement, à la suite d’exercices auxquels la Libératrice ne se livra jamais. Seule, la théologie catholique explique la Pucelle et les merveilles qu’elle a accomplies.
III
Dans les livres III, IV et V de son tome IV, le P. Ayroles nous montre la Vierge-Guerrière dans la Chrétienté, d’après les poètes du temps et d’après les livres de comptes. On voit que l’érudit et consciencieux historien n’a négligé aucune source d’informations. Nombreux sont les poètes qui ont parlé de Jeanne d’Arc de son vivant même ou dans les années qui ont suivi de près sa mort. On comprend sans peine tout l’intérêt que présentent ces œuvres même au point de vue purement historique ; mais ce qui surprendra le lecteur, ce sont les curieuses découvertes, les précieuses trouvailles que l’auteur a faites dans des documents d’un autre ordre, ceux-là les plus prosaïques du monde, les registres publics des bonnes villes et leurs extraits de comptes et dépenses. À mesure que les archives du XVe siècle sont explorées, l’on voit apparaître là où l’on n’était pas en droit de l’attendre, le nom de la merveilleuse jeune fille. Ce sont des livres de comptes mentionnant les légères dépenses faites pour rendre grâce à Dieu de ses exploits, pour lui faire honneur ; des registres de délibérations qui la mentionnent, et enfin des traditions locales. Rien n’est oublié, non pas même le plus petit détail et avec grande raison. Tout ce qui se rattache au plus sympathique et au plus glorieux des noms de notre histoire a son intérêt.
Le dernier livre du nouveau volume du P. Ayroles a pour titre : La Guerrière-Libératrice travestie et son histoire falsifiée par la libre-pensée. J’aurais voulu pouvoir m’étendre sur ces derniers chapitres les plus remarquables peut-être de l’ouvrage. J’ai eu déjà occasion de le dire : ils déchirent la mémoire de Jeanne d’Arc tous ceux qui ne l’admettent pas telle qu’elle s’est donnée et que l’ont vue les contemporains. Tous les ennemis du surnaturel catholique sont condamnés, qu’ils le veuillent ou non, à découronner de son auréole la noble et pieuse héroïne et à la travestir.
Une idée empruntée au Kantisme, se trouve, en terme plus ou moins formels, au fond des explications que le naturalisme essaie aujourd’hui de donner de la Libératrice. Pour les tenants de cette idée, venue d’Allemagne et qui n’a que trop bien fait son chemin en France, tout se réduit à une manière de concevoir les choses ; le ciel est tout entier dans l’idéal, c’est-à-dire en nous-mêmes, sans rien d’objectif en dehors de nous. C’est du fond de son être que parlaient les voix qu’entendait la Pucelle ; car pour un héros ou pour un saint, comme pour un artiste créateur, obéir au devoir, à l’inspiration c’est entendre en quelque sorte des voix divines. Le mode plus ou moins spiritualisé sous lequel on perçoit ces voix est affaire de milieu, d’éducation et de génie.
La jeune fille, (écrit Michelet, et la même thèse se retrouve chez tous les historiens libres-penseurs), la jeune fille, à son insu, créait, pour ainsi dire, et réalisait ses propres idées, et leur communiquait une splendide et touchante existence.
C’est le Kantisme passant de la philosophie dans l’histoire. Le P. Ayroles réfute avec succès cette prétendue explication, qui n’explique rien, et il fait toucher du doigt les erreurs sans nombre auxquelles elle a conduit M. Michelet, et, après lui, MM. Henri Martin, Siméon Luce, Vallet de Viriville et Joseph Fabre.
Ce dernier s’est fait le promoteur d’une fête nationale, d’une fête civile en l’honneur de Jeanne d’Arc. L’intention est excellente et il en faut louer le sénateur aveyronnais. Mais pourquoi a-t-il mis au service d’une si noble cause de si étrangers arguments ? Pourquoi s’est-il attaché, dans un de ses discours au Sénat, à présenter Jeanne d’Arc comme le Danton de son siècle
? M. Wallon qui n’a pas attendu M. Fabre pour écrire une excellente Histoire de Jeanne d’Arc, une des meilleures que nous possédions, a fort bien répondu que tandis que la vue du sang français faisait dresser les cheveux sur la tête de la sainte fille, le tribun était couvert du sang des victimes de Septembre et du Tribunal Révolutionnaire qu’il a institué. Dans un de ses livres, M. Joseph Fabre donne Kléber comme le fils spirituel de la Vierge de Vaucouleurs. Que vient faire Kléber le renégat du Christ, dans la postérité intellectuelle de celle qui voulait relever la France pour la conduire contre le Croissant ? Comment oublier d’ailleurs, qu’en Vendée, sous les ordres de Kléber, l’Armée de Mayence sema partout sur son passage, la mort et l’incendie (voy. Un nouveau chapitre des Actes des Martyrs, par l’abbé Eugène Bossard), brûlant les chaumières aussi bien que les châteaux, massacrant sans pitié les femmes et les jeunes filles, tant de sœurs de Jeanne d’Arc, coupables de vouloir adorer le Seigneur auquel Jeanne a tout rapporté ? Et M. Joseph Fabre ne s’en est pas tenu à ces étranges rapprochements. La vie de la pieuse héroïne lui est une occasion d’outrager cette Église dont elle disait, devant ses juges : J’aime l’Église, et je voudrais la soutenir de tout mon pouvoir pour notre foi chrétienne.
Enfin, peu s’en faut que M. Fabre ne fasse de Jeanne d’Arc, la bonne loyaliste, une révolutionnaire et une républicaine. D’après lui :
C’est depuis la Révolution que Jeanne est devenue populaire… Ce sont des républicains qui ont, petit à petit, fait pénétrer dans le pays le culte de Jeanne d’Arc.
On croit rêver lors qu’on lit de telles choses. Un des premiers soins de la République, en 1793, a été de renverser la statue élevée à Jeanne par la piété des Orléanais. Les Oratoriens de la ville avaient gardé précieusement un des chapeaux de la Libératrice. Les républicains s’acharnèrent à la recherche de celle relique, obtinrent, à force de menaces, que le dépôt leur fût remis, et ils la livrèrent aux flammes au milieu des danses et des cris de joie. Un membre de la Convention, Léonard Bourdon, présidait à cette fête. Presque à la même heure, la Commune de Paris faisait brûler sur la place de Grève les reliques de Sainte Geneviève et en jetait les cendres à la Seine…
Que M. Joseph Fabre continue donc à demander une fête nationale en l’honneur de Jeanne d’Arc ; mais, de grâce, qu’il renonce à quelques-uns de ses arguments.
En attendant, que le P. Ayroles termine son ouvrage ; qu’il nous donne son cinquième et dernier volume, et il pourra dire alors, en toute vérité : Exegi monunentum.
Edmond Biré.
Études 20 octobre 1898
Compte-rendu du tome IV de la Vraie Jeanne d’Arc, par le père Camille de Beaupuy.
Le critique considère que certaines questions, telles que la limite de la mission de Jeanne et le secret du roi, sont éclaircies. Cependant, il juge que l’utilisation des documents est parfois trop hâtive
.
Source : Études religieuses, etc., 35e année, t. 77 (octobre-novembre-décembre 1910), p. 268-270.
Liens : Gallica.
Dans ce nouveau volume, l’auteur a moins voulu raconter les exploits de la Vierge-guerrière
que décrire sa vie morale, son esprit et son caractère
. Les documents sont nombreux, plusieurs d’un haut intérêt. L’inédit ne manque pas, et il y a bon nombre d’extraits de publications peu connues ou rares et difficiles à rencontrer.
Les problèmes soulevés autour de cette personnalité si attachante et si extraordinaire ont été étudiés, est-il besoin de le dire ? avec amour, et souvent avec un réel succès. Un exemple entre bien d’autres. Au chapitre VIII du livre I (et passim), à propos de ce point d’histoire capital dans l’intention divine, manifestée par les voix, la mission de l’héroïne se terminait-elle, oui ou non, par le couronnement royal de Reims ? En poursuivant sa vie guerrière, a-t-elle, oui ou non, désobéi à ses voix et à Dieu ? la thèse négative est bien mise en relief, et, à notre humble avis, appuyé de preuves décisives.
Ailleurs, il faut le dire, la mise en œuvre des documents a été trop hâtive dans quelques-unes de ses parties, l’ouvrage est d’une lecture un peu difficile ; le fil conducteur fait défaut pour circuler à l’aise parmi toutes ces richesses. Je citerai le chapitre I du livre I (Le signe donné au roi), et le chapitre IV du même livre (Échec du siège de Paris). À travers les questions captieuses des juges, les réponses de l’accusée, les explications proposées, les objections et les solutions, le lecteur peu expert en examen et discussion de textes courra parfois, je le crains, le risque de s’égarer.
Sur le public sérieux, le travail du R. P. Ayroles produira, on ose l’espérer, l’impression que l’auteur a eue en vue. À suivre ces dépositions émanant de toutes les classes de la société française et des peuples étrangers eux-mêmes, on revit pour ainsi dire l’émotion inouïe des contemporains, à ce moment solennel où, le royaume des lis paraissant perdu, si bien perdu que le roi et son financier en chef pouvaient à grand-peine, en réunissant l’avoir de tous deux, réaliser quatre écus (déposition de Marguerite La Touroulde, veuve de Régnier de Bouligny, trésorier général de Charles VII). Dieu envoya au secours cette étrange messagère, une petite fille des champs. Elle était, en toutes choses, ainsi s’expriment les témoins, simple à merveille, hormis au fait de guerre, nisi in facto guerræ (ibid.)
. Là, dès le premier jour, elle étonna les plus vieux capitaines par son habileté à manier le cheval, à brandir la lance, à organiser et à conduire une expédition militaire (déposition de Dunois). D’ailleurs proposant et, au besoin, imposant ses plans avec un admirable mélange de modestie virginale et d’autorité souveraine. Ses messages aux ennemis étaient libellés au nom même du roi du ciel, son droiturier et souverain seigneur
. L’humilité des âmes fortes et saintes ne leur permet pas de diminuer les missions divines ; et Jeanne était, non seulement ce que l’on appelle une femme supérieure, mais une sainte aux vertus dignes des autels. Femme de tous points supérieure, elle l’était par la netteté des vues, l’énergie des résolutions, la constance virile dans une attitude une fois prise. À lui seul, le triste procès de Rouen en fournit la preuve indéniable. Sa sainteté ressemble beaucoup à celle de sainte Thérèse : c’est dire qu’elle est pratique et attirante au premier chef, étant faite de piété tendre, d’obéissance tout à la fois simple et héroïque, de vaillance joyeuse. Frère Jean Pasquerel, son aumônier : Elle se confessait quasi tous les jours, et communiait souvent. Quand elle se confessait, elle pleurait (p. 222).
Ses juges : Si vos voix vous avaient commandé de sortir (de Compiègne) et vous eussent signifié que vous seriez prise, seriez-vous sortie ? — Si j’avais su l’heure et que je devais être prise, je n’y fusse point allée volontiers toutefois, en la fin, j’eusse fait leur commandement, quelque chose qui dût en advenir (p. 85 ; voir aussi p. 97).
D’ailleurs, gaie, vive, alerte et pleine d’entrain à l’œuvre de Dieu, Jeanne est une sainte toute française, et notre vieil esprit gaulois parfois se fait jour jusque sous la tristesse de ses réponses au tribunal inique qui l’a condamnée d’avance, elle le sait.
La Vierge guerrière
avait reçu du ciel, avec les dons de miracle et de prophétie, le rare privilège de gagner les cœurs par une sympathie communicative, tout en inspirant un suprême respect.
On se jetait à ses pieds, on baisait ses mains, on lui présentait des objets pour qu’elle les touchât ; les hommes d’armes l’eussent suivie partout où elle l’eût voulu. Et cependant, déclare Dunois, ils éprouvaient pour elle une telle vénération qu’à son aspect et dans sa compagnie toute pensée moins digne de sa sainteté disparaissait de leurs âmes, ce qui, à mon avis, est chose en quelque sorte divine (p. 186)
.
Telle apparut Jeanne d’Arc aux yeux de ses contemporains ; telle fut, d’après leurs témoignages, sa vie morale, intellectuelle, surnaturelle. Tous les dons divins, s’écriait Mgr Pie, s’accumulent sur sa tête ; pas une pierrerie à joindre à sa couronne. (P. XXIII.)
Le livre du P. Ayroles n’est autre chose que le commentaire, généralement heureux, de cette parole autorisée.
Camille de Beaupuy, S. J.
Revue du monde catholique 1er novembre 1898
Brillant compte-rendu du tome IV de la Vraie Jeanne d’Arc par le père Adrien Munier, S. J.
Ce dernier est admiratif de la logique imparable du raisonnement du père Ayroles, de sa méthode rationnelle qu’il déploie en deux temps : 1. établir d’une manière irréfutable, l’authenticité de ses prodigieux exploits
, 2. en déterminer la cause (alors qu’il y a disproportion manifeste entre l’effet réalisé et la cause qui le produit
).
Sur l’établissement des faits, il constate l’unanimité des historiens :
Tout est sérieusement discuté, constaté, selon les règles de la critique historique la plus sérieuse. […] Mais ce qui ajoute encore à notre admiration, c’est de voir l’authenticité des exploits de Jeanne admise sans conteste par les représentants les plus en vue de la libre-pensée, devenus les archivistes inconscients du surnaturel et du divin parmi nous. […] Jeanne ne compte plus que des admirateurs et des amis ; [et] il faut admettre comme certains, quoique inexplicables aux yeux d’une raison purement humaine, tous les faits extraordinaires dont Jeanne d’Arc à été l’inspiratrice ou l’auteur.
Sur leur cause, en revanche, il raille la multitudes d’explications niaises d’écrivains que le surnaturel a le don d’exaspérer
.
Pour cela, preuves en mains, il les montre, ici, dissimulant les faits, les transposant, y omettant ce qui les gêne, y ajoutant ce qui les peut servir ; là, inventant les moins justifiables hypothèses ou accumulant les incohérences et les contradictions les plus manifestes ; ailleurs, entassant d’une manière puérile, au bas des pages, des références qui concernent des faits minuscules, mais, ne justifient en rien leurs audacieuses assertions. […] Aucun écrivain ne trouve grâce devant cet impitoyable justicier. […] Le P. Ayroles frappe dru, tant pis pour qui tombe sous sa main.
… voire un peu trop dru :
Peut-être certaines vivacités d’expression auraient-elles pu être adoucies.
Mais l’enjeu est important ; le père Ayroles est sévère mais juste :
il sait reconnaître ce que ces adversaires du surnaturel ont fait pour la gloire de Jeanne ; mais quand il les voit vouloir, de parti pris, isoler la noble fille du Dieu qui l’a suscitée et soutenue, il ne croit plus devoir considérer en eux que les détracteurs de son héroïne.
Source : Revue du monde catholique, 37e année, 1898, 6e série, t. XX, n° 11, p. 337-342.
Lien : Gallica
La Vraie Jeanne d’Arc, par le P. Ayroles, t. IV : La Vierge guerrière.
Le quatrième volume de la Vraie Jeanne d’Arc, par le P. Ayroles, vient de paraître. Il a pour titre spécial : La Vierge guerrière, et il est de tous points digne de ceux qui l’ont précédé.
L’infatigable auteur y emploie la méthode rationnelle qu’il a suivie jusqu’à ce jour. Comme son but est surtout de combattre les rationalistes, qui veulent rabaisser l’héroïne à des proportions purement humaines, il était nécessaire qu’il établît, d’une manière irréfutable, l’authenticité de ses prodigieux exploits, et qu’il y fît voir nettement l’intervention divine.
Il divise donc son quatrième volume en deux parties principales. Dans la première, il fait la critique raisonnée des paroles, des actes, des chevauchées militaires de Jeanne, depuis son arrivée à Chinon jusqu’à sa prise sous les murs de Compiègne. Dans la seconde, il fait ressortir l’élément surnaturel dans lequel elle se meut.
Pour établir, d’une manière irréfutable, l’exactitude matérielle des faits relatifs à la vie guerrière de Jeanne, le P. Ayroles en appelle tout d’abord au témoignage que la Pucelle se rendit à elle-même au tribunal de sa conscience et en face de ses bourreaux ; ensuite il invoque l’autorité de ceux qui la virent à l’œuvre, à la Cour et dans les camps, à Chinon, à Orléans, à Troyes, à Reims, sous les murs de Paris et ailleurs ; enfin il cite le témoignage de toute la chrétienté que ses exploits avaient, d’un bout de l’Europe à l’autre, jetée dans une admiration voisine de la stupeur.
Dans cette série de témoignages, rien n’est omis : la personne de Jeanne, sa constitution physique, sa beauté, son costume, son épée, sa bannière, le signe donné au roi, ses réparties toutes françaises à ses compagnons d’armes, ses avertissements aux Anglais, ses lettres ou messages aux amis et aux ennemis de la France, la durée de sa mission, ses combats, ses blessures, ses larmes, enfin sa piété et les sauvegardes dont elle entoure sa pudeur au milieu des camps, tout est sérieusement discuté, constaté, selon les règles de la critique historique la plus sérieuse. Les points les plus obscurs de l’histoire sont éclaircis, les pièges les plus perfides du rationalisme sont déjoués, et partout la prudence et l’intrépidité de Jeanne mises en pleine lumière.
Oui, en vérité, c’est un beau défilé que celui de tous ces témoins d’Occident et d’Orient, hommes ou femmes, princes ou manants, théologiens ou magistrats, poètes ou historiens, Français ou Anglais, Flamands ou Bourguignons, Italiens où Allemands, tous rendant un témoignage unanime à celle que Dieu à suscitée pour le salut de son peuple. Il n’est pas jusqu’aux comptes royaux, jusqu’aux archives des cités visitées, défendues pu délivrées par Jeanne, qui ne viennent, sous la plume de l’auteur, confirmer les dépositions de ces innombrables contemporains.
Aussi lit-on ce quatrième volume avec un profond sentiment d’admiration et de reconnaissance : d’admiration pour la Providence qui, prenant l’avance sur ses ennemis du XIXe siècle, a tenu en réserve tant de témoins irrécusables de la vie et des exploits de sa virginale Envoyée, et de reconnaissance aussi pour l’auteur, qui a cherché, recueilli, groupé, avec une infatigable ardeur et un bonheur inespéré, tant de documents précieux, dont plusieurs jusqu’à lui étaient demeurés inédits.
Mgr Dupanloup a donc eu raison de le dire : Nulle histoire n’eût jamais une authenticité pareille
; car nul fait ne s’offre à nous aussi bien placé en plein courant de l’histoire, ni entouré d’un pareil luxe de preuves irréfutables ; jamais non plus ni monarque belliqueux, ni, capitaine pu chef d’armée n’est entré dans le domaine de l’histoire, escorté d’un pareil cortège de témoins désintéressés, étrangers les uns aux autres, et dont cependant les dépositions se donnent un mutuel appui.
Mais ce qui ajoute encore à notre admiration, c’est de voir l’authenticité des exploits de Jeanne admise sans conteste par les représentants les plus en vue de la libre-pensée, devenus, comme les Juifs pour nos Livres saints, les archivistes inconscients du surnaturel et du divin parmi nous. Car, on voudra bien le remarquer, quoique l’école rationaliste se mette à la torture pour trouver, en dehors du miracle, une explication plausible aux prodigieux exploits de Jeanne, non seulement elle admet tous ces exploits en eux-mêmes, mais, dans son admiration pour l’héroïne, elle écarte, elle rejette tout ce qui la diminuerait, tout ce qui amoindrirait sa grandeur d’âme ou jetterait quelque ombre sur l’éclat de ses œuvres. On peut donc le dire, Jeanne ne compte plus que des admirateurs et des amis ; dès lors, la cause est jugée, et, sous peine de tomber dans l’absurde en niant les faits authentiques de l’histoire du monde, il faut admettre comme certains, quoique inexplicables aux yeux d’une raison purement humaine, tous les faits extraordinaires dont Jeanne d’Arc à été l’inspiratrice ou l’auteur, à la tête de l’armée de Charles VII.
Et maintenant, tous ces exploits guerriers dont nous devons la certitude, non à la légende avec ses vagues rumeurs et ses données incertaines, mais à l’histoire avec ses documents les plus sérieux, à quelle cause faut-il les attribuer ? Faut-il, avec les contemporains de Jeanne et avec tous ceux qui jugent sans prévention, y voir une intervention divine ? ou faut-il, avec tous ceux qu’effarouche la seule idée du miracle, attribuer à des causes purement naturelles des résultats si prodigieux ? C’est ce que le P. Ayroles étudie dans la seconde partie de son ouvrage.
Tout d’abord il déclare s’en rapporter à l’Église pour le jugement définitif à porter sur le caractère des exploits de la Pucelle : l’Église seule ayant mission pour rassurer les âmes, dès qu’il s’agit d’interventions extraordinaires de Dieu dans les choses humaines.
Cette observation faite, l’auteur s’attache à établir la cause surhumaine de tant de merveilles. Pour cela, il présente les faits et les pièces justificatives avec tant de méthode et de clarté, il les discute avec tant de loyauté et de force, qu’il entraîne la conviction de tout lecteur qui le suit jusqu’au bout.
Après avoir, avec une élévation de pensées digne de son sujet, montré la royauté de Notre-Seigneur Jésus-Christ comme le point culminant de la mission de Jeanne, le P. Ayroles fait ressortir le surnaturel dans les vertus privées, qui, à la Cour et dans les camps, mettent Jeanne en rapport continuel avec son Dieu. Nous n’en citerons que deux, parce qu’elles sont le fruit propre de l’Église catholique, et que, entre toutes les autres, elles indiquent une protection particulière du Ciel sur l’incomparable jeune fille : c’est d’abord la pureté toute virginale qu’elle garde au milieu de la licence des camps, pureté si éclatante qu’elle inspire la vénération et la réserve à des guerriers, étonnés de se sentir chastes pour la première fois ; c’est ensuite une humilité profonde au milieu des succès et des triomphes, dans l’admiration qu’elle fait naître à la Cour et dans les acclamations qu’elle provoque au sein du peuple, en un mot au milieu des éblouissements de la gloire la plus éclatante, la mieux justifiée et la plus capable de faire tourner là tête à une jeune fille de vingt ans.
Passant ensuite des vertus privées de Jeanne aux paroles et aux actes de sa vie militaire, le P. Ayroles fait voir, avec une évidence entraînante, le surnaturel se manifestant dans ses prophéties, dans la résurrection de l’enfant de Lagny et particulièrement dans l’expédition militaire qui, contre toute attente, la mène victorieuse de Chinon à Reims : particulièrement, dis-je, car la conception et la réalisation d’une pareille campagne étaient, vu les circonstances, humainement impossibles, non seulement à une jeune villageoise, timide par nature et ne sachant ni A, ni B, mais même aux plus habiles et aux plus entreprenants capitaines de Charles VII.
De l’ensemble de l’expédition, le P. Ayroles en vient aux détails. Les qualités guerrières propres aux plus grands capitaines et soudainement constatées dans une paysanne, ignorante de tout excepté de son Pater et de son fuseau, l’ascendant conquis en quelques jours par l’humble fille sur une Cour légère et sur les théologiens les plus difficiles, la confiance subitement inspirée par elle à des soldats habitués à la défaite, la déférence pour ses avis obtenue bientôt de capitaines ombrageux et depuis longtemps habitués aux choses de la guerre, l’espérance ramenée dans le cœur des Français qu’une longue suite de malheurs avait abattus, la terreur jetée, dès le début, dans le cœur des Anglais dont une longue suite de victoires avait accru l’audace, la délivrance en huit jours de la ville d’Orléans, tout environnée qu’elle est des bastilles puissantes et des nombreux soldats de l’Angleterre, la conquête en trois mois, et contre toute prévision humaine, de l’Orléanais, de la Brie, de la Champagne et d’une partie de l’Île-de-France, malgré la résistance des troupes anglo-bourguignonnes et l’attachement de plusieurs de ces provinces aux ennemis du roi, chacun de ces faits, et d’autres encore, le P. Ayroles les examine, les discute, les démontre comme absolument en dehors du cours ordinaire des choses humaines, puisqu’il y a partout disproportion manifeste entre l’effet réalisé et la cause qui le produit.
Cependant le savant auteur ne se contente pas d’établir directement la thèse du surnaturel dans la vie guerrière de Jeanne, il la confirme encore, en détruisant les travestissements dont l’affuble la libre-pensée, et, pour employer le mot du comte de Maistre, en réfutant les explications niaises d’écrivains que le surnaturel a le don d’exaspérer.
Et ici, il faut l’avouer, le P. Ayroles n’est pas tendre à leur égards. Il démasque, sans pitié ces hommes assez-audacieux pour composer, sans souci des documents authentiques, une Jeanne d’Arc à leur image. Pour cela, preuves en mains, il les montre, ici, dissimulant les faits, les transposant, y omettant ce qui les gêne, y ajoutant ce qui les peut servir ; là, inventant les moins justifiables hypothèses ou accumulant les incohérences et les contradictions les plus manifestes ; ailleurs, entassant d’une manière puérile, au bas des pages, des références qui concernent des faits minuscules, mais, ne justifient en rien leurs audacieuses assertions ; enfin ne reculant nulle part devant aucun moyen, dès qu’ils espèrent en imposer au vulgaire, ou voiler, aux yeux de lecteurs sans défiance, le surnaturel chrétien. Aucun écrivain ne trouve grâce devant cet impitoyable justicier, fût-il Michelet, Vallet ou Henri Martin ; aucun titre ne le met à couvert de ses coups, fût-il professeur à l’École des Chartes, ancien ministre, sénateur ou académicien. Le P. Ayroles frappe dru, tant pis pour qui tombe sous sa main.
Peut-être certaines vivacités d’expression auraient-elles pu être adoucies. Qu’on ne l’oublie pas cependant : dans une bataille dont l’enjeu est si important, on ne mesure pas toujours ses coups. Le P. Ayroles sait reconnaître ce que ces adversaires du surnaturel ont fait pour la gloire de Jeanne ; mais quand il les voit vouloir, de parti pris, isoler la noble fille du Dieu qui l’a suscitée et soutenue, il ne croit plus devoir considérer en eux que les détracteurs de son héroïne.
Peut-être encore l’auteur aurait-il pu, en divers endroits, omettre certaines répétitions de détails, et donner ainsi plus de relief à la pensée principale. Mais observons que dans un ouvrage de polémique et de si longue haleine, il est bien difficile de ne pas revenir une fois ou l’autre sur ce que l’on a déjà dit ; surtout qu’un fait étudié d’abord au point de vue purement historique, peut l’être de nouveau quant à la cause supérieure qui l’a produit.
Enfin on a dit que le livre du P. Ayroles ne soutient pas la lecture publique : aussi bien ne l’a-t-il pas écrit dans ce but. Il a composé un ouvrage fait de documents et de discussions ; il a eu en vue de préparer les voies soit à la cause de béatification de la Vénérable, soit au travail d’auteurs sérieux qui voudront écrire, avec tous les documents en mains, là Vie de Jeanne d’Arc qui nous manque encore ; dès lors, il a gardé la forme et le style qui conviennent à ce genre d’ouvrages, bien que souvent il s’y révèle comme un homme versé dans l’art de bien penser et de bien dire.
Quoi qu’il en soit de ces remarques, le P. Ayroles a, dans la Vierge guerrière, répondu à l’attente de ceux qui saluent le jour, prochain peut-être, où Jeanne d’Arc sera placée sur les autels. Son quatrième volume ira donc, dans toutes les bibliothèques sérieuses, prendre, auprès de ses aînés, la place qui lui est due ; il justifiera une fois de plus la haute approbation et les encouragements significatifs que Léon XIII a daigné donner à l’ouvrage tout entier, et il permettra aux amis du P. Ayroles de lui redire, avec des juges très autorisés, qu’il a bien mérité de Jeanne, de la France et de l’Église.
Ad. Munier S. J.
La Croix de l’Aube 31 décembre 1898
Bon de souscription pour le 4e volume de la Vraie Jeanne d’Arc.
Lien : Retronews
[Similaire au plan et au bon publiés dans la Croix de Saintonge et d’Aunis du 17 avril 1898.]
Revue bibliographique belge 1898
Bref et favorable compte-rendu du tome IV de la Vraie Jeanne d’Arc.
L’œuvre est un habile rapprochement des pièces inédites ou peu connues, disposées dans un ordre propre à favoriser les recherches.
Source : Revue bibliographique belge, 10e année 1898 (Bruxelles), p. 287.
Lien : Gallica
L’œuvre du R. P. Ayroles se continue, avec ce tome quatrième, toujours intéressante, toujours éminente par ses qualités littéraires et historiques. Déjà trois volumes ont paru sur la Vraie Jeanne d’Arc, nous rappelant successivement : la Pucelle devant l’Église de son temps, la Paysanne et l’Inspirée, la Libératrice. L’auteur s’attache maintenant à nous retracer le portrait fidèle de la Vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires, la chrétienté, les poètes du temps, les registres publics et la libre-pensée.
Les documents cités dans le volume précédent portaient principalement sur les événements extérieurs et ne touchaient que secondairement aux qualités personnelles. Ceux qui composent ce volume nous font connaître l’esprit, le caractère de la vierge de Domrémy et la lavent des crimes dont on a voulu flétrir sa mémoire.
Le demi-siècle écoulé depuis la publication du Double procès a permis d’accroître notablement les pièces réunies par Quicherat. La Chronique Morosini, les documents du Corpus historicum medii ævi, les chroniques belges renferment des passages inédits, souvent précieux pour fixer une date ou éclairer un événement. Tous ces textes sont jusqu’ici disséminés un peu partout, dans des revues, dans des plaquettes de quelques pages, difficiles à trouver et plus difficiles encore à réunir. Il importait de fondre eu un seul ouvrage tous ces documents épars, et d’en faire une œuvre de réhabilitation et de patriotisme. C’est ce qu’a fait le Père Ayroles : son œuvre est un habile rapprochement des pièces inédites ou peu connues, disposées dans un ordre propre à favoriser les recherches.
Après ce chef-d’œuvre d’irréfutable démonstration historique, l’auteur n’aura plus à faire connaître que Jeanne d’Arc Martyre. Il nous fait espérer la prompte apparition de son dernier travail, qui sera le couronnement du long poème dû à ses éludes personnelles sur ce sujet. Nous lui prédisons un succès égal pour ce tome cinquième, qui sera certainement digue en tous points de ses prédécesseurs.
La Croix 4 mars 1899
Article Jésus-Christ roi, le programme de Jeanne d’Arc, signé : Un Vétéran, qui a vécu sous une demi-douzaine de Constitutions toutes définitives
: sorte de résumé de Jeanne d’Arc sur les autels, qu’il mentionne en conclusion.
Lien : Retronews
[…] Nous nous permettrons de rappeler que le R. P. Ayroles, S. J., le savant historien de Jeanne d’Arc, a développé ces nobles principes dans son 4e volume : la Vierge guerrière page 441 et suivantes, et dans Jeanne d’Arc sur les autels. Tout cet ouvrage, édité par Plon, est d’un intérêt hors de pair, et nous profitons de l’occasion pour en recommander une fois de plus sa réconfortante lecture.
La Vérité 9 mars 1899
Le père Ayroles a assisté aux disputes scolastiques présidées par Mgr Touchet à l’institut catholique de Paris. (Joutes verbales, en latin, destinées à entraîner les étudiants pour leur futur apostolat.)
Lien : Retronews
La fête de saint Thomas d’Aquin ramène chaque année, pour les trois facultés canoniques de l’institut catholique de Paris, l’occasion de tenir une de ces séances d’argumentation latine où, dans la forme des disputes scolastiques d’autrefois, des thèses théologiques sont exposées, puis attaquées, puis défendues pied à pied, à coups de syllogismes, de distinctions et de sous-distinctions.
La séance d’hier [mardi 7 mars] était présidée par Mgr Touchet, évêque d’Orléans, et avait attiré autour de Sa Grandeur, outre le corps professoral, un grand nombre d’ecclésiastiques, soit élèves, soit amis de l’institut, et un nombre naturellement plus restreint de laïcs.
[Présentation des intervenants et des débats.]
Cette longue séance s’est terminée par une allocution de Mgr Touchet, tour à tour sérieuse et familière, paternelle et apostolique. Félicitant les élèves ecclésiastiques de la bonne fortune qu’ils ont de trouver à l’institut de si précieux matériaux et d’y fourbir des armes aussi puissantes pour les luttes de leur futur apostolat, Sa Grandeur les a conviés à mener de front ces austères et indispensables études de la métaphysique philosophique et théologique, avec le souci de préparer en quelque sorte l’adaptation française des mêmes études, pour le salut des âmes qu’il faudra évangéliser un jour. En même temps, Mgr l’évêque d’Orléans recommandait à ses auditeurs la modestie qui convient à tous les hommes d’étude, mais surtout aux étudiants sacrés, et leur proposait des exemples tirés de la vie d’Albert-le-Grand et de celle de Bossuet. Finalement, et à propos d’une statue de Jeanne d’Arc qui orne la salle, Mgr Touchet s’est tourné vers le P. Ayroles, qui était présent, et a cité le mot de la glorieuse et sainte héroïne sur les gens qui bataillent
et surDieu qui donne la victoire
; et, après cette conclusion vivement applaudie, l’on s’est rendu à la chapelle des Carmes pour la bénédiction du Très Saint-Sacrement.
Paul Tailliez.
Le Peuple français 12 mai 1899
Lancement de la Jeanne d’Arc, journal annuel
qui paraîtra chaque année le jour de la fête de Jeanne d’Arc, et dont le premier numéro contiendra des extraits de la Vraie Jeanne d’Arc du père Ayroles.
Lien : Retronews
La Jeanne d’Arc — C’est le titre d’un journal annuel, que nos amis feront dorénavant paraître chaque année, le jour de la fête de Jeanne d’Arc.
Celui qui paraîtra dimanche [14 mai] et qui sera vendu sur la voie publique contiendra en dehors d’articles intéressants des extraits du livre remarquable du Père Ayroles sur la vénérable Pucelle.
Ce journal dont le numéro est de dix centimes est vendu deux francs le cent aux comités qui en feront la demande.
On pourra s’en procurer dès ce soir, 1, rue Feydeau [adresse du siège du Peuple français] de 9 h. à 10 h. ; et demain, dimanche, de 7 h. à 9 h. le matin, et de 2 h. à 3 h. l’après-midi.
Même annonce le 14 mai, jour du lancement.
Lien : Retronews
Revue des sciences ecclésiastiques juin 1899
Compte-rendu favorable du tome IV de la Vraie Jeanne d’Arc par Jean-Arthur Chollet.
Source : Revue des sciences ecclésiastiques, tome 79 (8e série, tome 9), n° 474, juin 1899, p. 541-544.
Lien : Archive
Le P. Ayroles continue l’œuvre considérable et si vivante entreprise depuis plusieurs années par lui, pour la glorification de Jeanne d’Arc. Déjà nous avons entretenu nos lecteurs des précédents volumes, la Pucelle devant l’Église de son temps (septembre 1890), la Paysanne et l’Inspirée (août 1894), la Libératrice (février 1898). Aujourd’hui nous ne pouvons que leur recommander la Vierge guerrière au même titre. L’auteur apporte dans ce quatrième volume la même érudition, les mêmes qualités de style, de clarté, de chaleur émue, de conviction communicative. La Libératrice et la Vierge guerrière sont, au fond, un sujet identique, et les deux ouvrages renferment tous les documents sur la vie publique depuis l’arrivée à Chinon, le 6 mars 1429, jusqu’au cachot de Rouen, décembre 1430. On sait déjà ce que contient le premier de ces ouvrages. Le second est divisé en sept livres.
Ce sont d’abord (livre I) les aveux et les lettres de Jeanne. On aime à entendre le langage si simple, si ingénu, si spirituel parfois et toujours élevé de la paysanne devenue une guerrière consommée. Elle nous éclaire sur le signe donné du roi, sur son épée, sa bannière, son vêtement viril. On relit avec plaisir ses lettres aux anglais, aux habitants de Tournay, à ceux de Troyes, à ceux de Riom, à ceux de Reims. On sent que la France et Jeanne se comprennent et que la même âme vibre et s’émeut de part et d’autre. Une partie bien intéressante de ce livre I, c’est le chapitre VII, relatif à l’étendue de la mission de la Pucelle. On y voit clairement que cette mission dépassait le sacre de Reims. Il est faux de croire que Jeanne était envoyée uniquement pour faire lever le siège d’Orléans et pour faire sacrer le roi à Reims. Son rôle n’était pas fini le soir du sacre. Seulement sa
mission était essentiellement conditionnelle, subordonnée à la coopération matérielle et morale que les intéressés devaient lui prêter. La coopération a certainement fait défaut (p. 127),
et c’est ce qui explique qu’elle ait interrompu la course victorieuse de Jeanne.
Après la vierge-guerrière elle-même, les témoins oculaires de sa vie publique viennent déposer les uns après les autres en sa faveur. Tous d’un rang honorable dans le clergé, l’armée, la magistrature ou la vie civile, ces témoins cités au nombre de cinquante-cinq par la commission pontificale nous montrent de quelle pureté, de quelle droiture et sainteté était l’âme de la jeune vierge. Ce sont Maître Jean Barbin, Simon Charles, Gobert Thibault, Maître François Garivel, sire Guillaume de Ricarville, Réginald Thierry, le frère Séguin, des frères prêcheurs, Simon Beaucroix, vingt-quatre bourgeois, six ecclésiastiques, neuf bourgeoises orléanaises, Marguerite de la Touroulde, Dame de Bouligny, Dunois, Raoul de Gaucourt, Théobald de Thermes, le duc d’Alençon, Louis de Coûtes, page de la Pucelle et Jean d’Aulon, son maître d’hôtel. Ces deux dernières dépositions nous font pénétrer dans la vie intime de la Pucelle, mais surtout celle de Jean Pâquerel, son aumônier et confesseur, et toujours ils nous révèlent la même pureté et la même innocence d’âme.
Ce que l’univers catholique tout entier pensait de Jeanne, le livre III nous l’apprend. En Italie, outre l’auteur du Breviarium historiale (I, 53-59) et la Chronique de Morosini (III, 567), Raymond de Crémone (la lettre de Jean Cortin d’Arezzo est publiée pour la première fuis en France par le P. Ayroles, d’après le Dr Mercati, Studi e documenti di storia e diritto, 1894), saint Antonin, Lorenzo Buonincontro, Guerneri Berni, Giovanni Sabadino, Jacques-Philippe de Bergame : sur le trône pontifical, Pie II, dans le récit des choses mémorables advenues de son temps, écrit sous sa dictée, par son secrétaire Gobellini ; en Allemagne, Ebérard de Windecken, le comte Vaste et Jean Rottenbot, Jean Desch, Hermann Cornerius, Jean Nider, le doyen de Saint-Thibaud de Metz, le chanoine Koenigshoffen de Strasbourg ; en Écosse, Walter Bower, l’auteur du livre de Pluscardin ; en Angleterre, William Caxton ; en Espagne, l’auteur de la Poncella d’Orliens ; en Grèce, Laonic Chalcondyle, nous apportent de tous les points de l’Europe la preuve de l’amour et de l’enthousiasme provoqués chez les nations étrangères par les exploits de Jeanne.
Il n’est pas jusqu’aux poètes, livre IV, qui n’aient trouvé dans la Pucelle et dans les merveilles opérées à son instigation, matière à de sincères et nombreux éloges. Le P. Ayroles fait justement ressortir qu’au XVe siècle
les poètes n’ont pas généralement pensé à embellir par leurs fictions les réalités merveilleuses dont ils avaient été les témoins, ou qu’ils tenaient de la génération qui les avaient vues. Sous ce rapport ils sont utiles à l’histoire (p. 311).
Ainsi viennent témoigner, de gré ou inconsciemment, en faveur de l’héroïne lorraine, Christine de Pisan, Antonio Beccadelli, Astésan, l’auteur du Mystère du Siège d’Orléans ; Martin Le Franc, Georges Chastellain, Jean Villon, Martial d’Auvergne, Octavien de Saint-Gelais, Valeran de la Varenne.
On est touché à lire au livre V les comptes des villes qui s’imposaient des dépenses pour rendre grâces à Dieu des exploits de Jeanne, pour assister celle-ci, pour lui faire honneur. On y sent battre le cœur de la vraie France ; on y recueille en même temps de précieuses et de très sûres données l’histoire de la Pucelle. Pour épuiser cette source si riche, le P. Ayroles s’est imposé de nombreuses démarches, des recherches difficiles. Il nous met sous les yeux les comptes du roi et du duc d’Orléans, les comptes ou les registres des villes d’Orléans, de Tours, de Poitiers, de La Rochelle, de Périgueux, de Cahors, de Toulouse, d’Alby, de Clermont, de Reims, de Tournay, ces derniers signalés surtout par M. l’abbé Rebout (Jeanne d’Arc, prisonnière à Arras, p. 14). C’est encore dans ce livre V que l’auteur nous fait le portrait de son héroïne forte et robuste, belle, de visage un peu brun avec des cheveux blonds
(p. 412). Signalons enfin au même livre, le chapitre VII qui nous donne pour ainsi dire jour pour jour la carrière de la vénérable.
Le livre VI nous montre comment
le surnaturel divin ressort de toute l’histoire de la vierge libératrice. Il éclate dans ce qui est le point culminant de la mission, la royauté du Christ sur les nations ; dans la sainteté de la vie de la céleste envoyée ; dans les prophéties qui l’ont annoncée, et bien plus encore dans les prophéties qu’elle a semées à tous les pas de sa carrière ; dans les dons surnaturellement conférés pour l’exécution de la mission ; dans la parfaite conformité de la mission avec l’enseignement théologique et ses convenances avec les besoins du temps où parut la merveille (p. 440).
L’ouvrage n’eût pas été complet s’il n’eût rapporté et supérieurement réfuté les erreurs rationalistes au sujet de Jeanne. Les historiens modernes, avec Siméon Luce, prétendent
que la jeune fille, à son insu, créait pour ainsi dire et réalisait ses propres idées et leur communiquait une splendide et touchante existence. [Michelet, Jeanne d’Arc, 1853, p. 10.]
De prétendus amis de Jeanne, comme M. Fabre, tout en travaillant de toutes leurs forces à faire de sa fête la fête nationale française, se servent de la vierge lorraine comme d’un thème de diatribe contre l’Église ; les libres-penseurs suppriment tout surnaturel dans la vie de cette sainte fille. L’auteur démasque tous ces ennemis et Les confond.
Cette simple analyse montre combien est riche l’ouvrage du P. Ayroles. Aucun de ses autres volumes peut-être n’a recueilli plus de sources, n’a rassemblé plus de voix en un concert immense et universel. Il nous fait désirer vivement l’apparition du cinquième volume, dernier chant d’un poème où Jeanne se révèle comme Dieu venant à nous encore une fois par un chemin virginal
.
A. Chollet.
L’Univers 7 août 1899
Compte-rendu du tome II de l’Histoire complète de Jeanne d’Arc du chanoine Dunand, par Louis Maisonneuve. Le critique énumère les avis des historiens sur le terme de la mission de Jeanne d’Arc (Beaucourt, Quicherat, H. Martin, Ayroles) avant de donner celui de Dunand.
Lien : Retronews
J’ai eu l’honneur et le plaisir d’annoncer ici même ; il y a quelques mois, l’ouvrage de M. le chanoine Dunand [édition du 5 septembre 1898]. Le second volume vient de paraître ; le troisième et dernier, qui est complètement achevé, suivra bientôt.
On sait que l’auteur s’est proposé deux choses : combler une lacune qui se retrouve chez les historiens de la Pucelle, même les plus consciencieux ; et mettre à profit les documents ignorés ou négligés jusqu’à présent. De là les proportions de son ouvrage, l’ampleur de cette vie racontée en tous les détails, présentée sous tous les aspects. […]
[Sur le terme de la mission de Jeanne :]
On sait que, pour M. de Beaucourt, après le sacre du roi la mission de Jeanne était remplie
; pour Henri Martin et Jules Quicherat, au contraire, Jeanne aurait dû expulser les Anglais jusqu’au dernier, aussi bien que procurer la délivrance du duc d’Orléans ; et comme elle ne fit ni l’une ni l’autre, sa mission fut manquée
. Le R. P. Ayroles ne borne pas le rôle de l’héroïne à la délivrance d’Orléans et à la reconnaissance du roi, mais il estime qu’une partie de la mission de Jeanne fut conditionnelle ; elle supposait, elle exigeait le concours de Charles et de ses conseillers ; elle ne fut pas accomplie, mais c’est par le fait des auxiliaires que la Providence lui avait ménagés et qui firent défaut.
Pour M. le chanoine Dunand, la mission de la Pucelle fut guerrière et morale, morale surtout : Jeanne devait relever moralement et affranchir réellement son pays. Directement et complètement elle réalisa les deux parties de sa tâche. Aussi bien que ses victoires, ses épreuves, sa captivité, sa mort tragique ont préparé et en un sens très vrai, produit la délivrance de la patrie. […]
Louis Maisonneuve,
professeur à l’Institut catholique de Toulouse.
La Vérité 4 décembre 1899
Compte-rendu d’un mémoire sur Jeanne d’Arc et les Dominicains de Poitiers. L’auteur, dominicain, démontre notamment (et contre l’opinion du père Ayroles) que le père Seguin qui examina Jeanne à Poitiers en 1429 et témoigna à la réhabilitation en 1456, était lui-aussi dominicain.
Lien : Retronews
Également dans la Semaine religieuse de Poitiers (36e année, n° 53, 31 décembre 1899), p. 875 :
Lien : Gallica
Jeanne d’Arc et les Dominicains de Poitiers (1429-1456). Dans cette brochure très documentée, le R. P. Marie-Bernard Ducoudray, des Frères-Prêcheurs, fait revivre la mémoire de trois dominicains qui furent les juges de Jeanne d’Arc au sein de la commission assemblée à Poitiers sur l’ordre de Charles VII, et qui, tous les trois, ont bien mérité de la Pucelle. Il s’agit de Pierre Turelure, prieur de Poitiers ; de Guillaume Aimeri, alias Méri, docteur en théologie, et de Séguin de Séguin, doyen de la faculté de théologie à Poitiers, qui devait en outre rendre à l’héroïne, au procès de Rouen (14 mai 1456) un si solennel témoignage.
L’identité dominicaine du P. Séguin de Séguin semblait avoir été révoquée en doute par le R. P. Ayroles, S. J. Nous pouvons affirmer que le R. P. Ducoudray a fait sur ce point la lumière complète. M. le chanoine Arbellot, président de la Société Archéologique et Historique du Limousin, écrit à l’auteur : J’approuve entièrement vos conclusions.
Le R. P. dom Chamard dit à ce même propos : Votre thèse est parfaitement prouvée, et vous avez assuré à votre saint ordre une gloire qu’il avait droit de revendiquer.
Ce savant mémoire, avec le charme, de tout ce qui touche à Jeanne d’Arc, aura le mérite, nous en sommes sûrs, d’intéresser particulièrement tous les amis de la famille dominicaine.
Fr. Éd. Hugon,
des Frères-Prêcheurs.
Le Bien du peuple de Dijon 7 janvier 1900
Article sur Jeanne d’Arc à travers les âges, par Henri Bernard, en deux parties (dimanches 7 et 14 janvier). L’auteur puise sa matière chez Ayroles, qu’il cite abondamment.
Note. — Il publiera l’année suivante Jeanne la Pucelle, un recueil de 23 articles d’après l’ouvrage du R. P. Ayroles
, (voir).
Lien (Retronews) : 7 janvier, 14 janvier
Lorsque l’on considère comment, pendant plus de trois siècles, la mémoire de Jeanne fut incomprise et parfois oubliée, l’esprit s’arrête étonné. […]
[Début de la partie II :]
La glorification raisonnée et probablement définitive de la Pucelle sera l’œuvre du XIXe siècle. […]
La vieille Université omnipotente était tombée avec l’ancien régime ; l’instruction, par les avantages qu’elle procurait, devenait le goût des masses populaires, des érudits, puis des fouilleurs infatigables groupés en une école destinée a cet usage compulsaient les anciens manuscrits, et une habitude nouvelle de vulgarisation faisait connaître leurs trouvailles au public. Déjà les travaux de L’Averdy, Petitot, Buchon, Michaud avaient précédé ceux de Quicherat, l’éditeur, mauvais juge parfois, du double procès, et le monumental ouvrage du R. P. Ayroles qui est en passe de continuer, de compléter et de rectifier à l’occasion ce dernier. […]
Revue du monde catholique 15 avril 1900
Compte-rendu de l’essai politique du père Blaviel : Questions philosophiques, politiques, sociales, par le père Ayroles, qui signe Un élève de philosophie de M. de Blaviel, J.-B. J.-A.
En effet, le père Timothée Blaviel (1818-1901) fut le professeur de philosophie du jeune Ayroles au petit séminaire de Montfaucon, un demi siècle plus tôt. Un fait saute aux yeux : les idées du père Blaviel et du père Ayroles convergent de manière quasi-mimétique.
L’ordre surnaturel est l’état véritable, l’état réel de l’homme ; l’acceptation des lois de cet état, la soumission à ses lois, les conditions essentielles de la paix dans les individus et dans la société ; l’homme qui cherche à échapper aux lois de cet état est comparable au poisson qui, bondissant hors des flots, se trouve sur la plage où bientôt il sèche, il périt.C’est le programme de Jeanne d’Arc.
La question qui se pose maintenant : qui a influencé qui ? Est-ce le professeur qui a transmis son corpus idéologique à son élève ? Où l’ancien élève, devenu auteur à succès, qui a fini par influencer son ancien professeur ?
Les deux intellectuels semblent même partager jusqu’au ton polémique, puisque Ayroles semble apprécier la juste et sanglante ironie de son maître.
L’extrait suivant, qui traite du destin des peuples séduits par la démagogie des libres-penseurs, pourrait très bien être tiré de 1984 de George Orwell :
C’est s’écarter profondément [de l’enseignement du Christ] que de prôner une égalité chimérique, contre nature, destructrice du bien-être de tous. On va au rebours de ses doctrines en excitant et en aiguisant les appétits, en faisant naître dans les multitudes des besoins qu’elles ne se connaissaient pas. Exciter l’antagonisme entre les classes, appeler la foule à résoudre des problèmes au-dessus de sa portée, c’est être ennemi de l’harmonie, de la paix, de la stabilité, de la force et de la grandeur des États et des sociétés.
Qu’arrive-t-il alors ? Des meneurs sans conscience s’emparent de l’étiquette des mots pour en détruire à leur profit les réalités. Au nom de la liberté, ils font peser sur ceux qui ne veulent pas marcher à leur suite la plus infernale tyrannie ; au nom de l’égalité, ils abattent les supériorités qui les offusquent, et avec les ruines s’élèvent eux-mêmes, du néant d’où ils étaient partis, à de vertigineuses fortunes ; au nom de la fraternité, ils pratiquent l’égorgement et l’assassinat de ceux qui les entravent ou leur déplaisent.
Source : Revue du monde catholique, 39e année, tome 142 (7e série, t. 3), p. 249-252.
Lien : Gallica
Également publié dans la Vérité du 3 mai :
Lien : Retronews
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
La Science catholique 15 juillet 1900
Article sur l’Idée de l’Église au Moyen Âge, par le père jésuite Jean-Vincent Bainvel, dont une note annonce le dernier volume de la Vraie Jeanne d’Arc.
Source : La Science catholique : revue des questions religieuses, 14e année, n°8, 15 juillet 1909, p. 690.
Lien : Gallica
[…] De la nature du procès de Jeanne et de sa légalité, de la part qu’eurent à la condamnation les accusations d’insoumission à l’Église et d’hérésie, il ne saurait entrer dans notre sujet de parler (1).
(1) Aussi bien le R. P. Ayroles nous promet-il sur la question un volume qui couronnera son œuvre monumentale à l’honneur de la Pucelle.
La Gazette 22 septembre 1900
Article sur le congrès de Bourges (du 10 au 13 septembre), par Charles Dupuy. L’auteur rejette l’idée selon laquelle le clergé catholique se tiendrait à l’écart de la science, puis se lance dans une longue énumération de contre-exemples.
Lien : Retronews
Le Congrès de Bourges est clos. […]
À ceux dont nous avons cité les œuvres et les noms faut-il ajouter au cours de ce siècle et à l’heure actuelle des prélats comme les Frayssinous, les Salinis, les Gerbet, les Pie, les Dupanloup, les Bougaud, les Turinaz et parmi les religieux et les prêtres, les pères Cherot, Brucker, de Scorailles, Ayroles, de Johannis, Petetot, Lescœur, Baudrillard, Chorarne, don Chamard, Mgr Baunard, Mgr Méric, les abbés Migne et Cruice, et combien d’autres, et dans les maisons d’éducation que d’ouvrages remarquables qui témoignent à quel point on cultive les études scientifiques et historiques, les abbés Julien, Ragon, Jaugey, Maunoury, Appert, Dementhon, etc.
Revue du monde catholique 15 octobre 1900
Article biographique : Un des saints prêtres français du XIXe siècle : M. Pierre Bonhomme, fondateur de la Congrégation de Notre-Dame du Calvaire, par le père Ayroles.
Source : Revue du monde catholique, 39e année, 1900, 7e série, t. V, n° 2, p. 179-188.
Lien : Gallica
Note. — Le père Ayroles s’est appuyé sur l’ouvrage suivant : Vie de l’abbé Pierre Bonhomme, fondateur de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Calvaire à Gramat (1803-1861), avec lettre d’approbation de Mgr Grimardias, évêque de Cahors. Paris, J. Mersch, Imprimeur, 1892.
Un des saints prêtres français du XIXe siècle
M. Pierre Bonhomme
fondateur de la Congrégation de Notre-Dame du Calvaire
Les grandes merveilles de la France au XIXe siècle ne sont pas à l’Exposition ; et les foules qui les visitent ne pensent pas à des merveilles autrement belles qu’elles peuvent contempler sans déplacement. Ces dernières auront cependant leur exposition parfaitement ordonnée. Les palais qui les renfermeront seront aussi immuables que resplendissants. L’on n’y verra rien de ce que l’on vient admirer aux bords de la Seine, car une parole plus immuable que le ciel et la terre a été écrite : La terre et les œuvres qu’elle supporte seront brûlées (Terra et quæ in ipsa sunt opera exurentur. (2 Petr., III, 10.).
[…]
Le clergé de la première partie du XIXe siècle a été prodigue d’exemples de cette héroïque patience, et a vaincu par là les ricanements des fils d’Arouet, prolongés jusqu’à la chute de celui qui se vantait d’être le premier voltairien du royaume. Les survivants de 48 se rappellent pour qui furent alors les sifflets. L’humble prêtre du Quercy chansonné par la fine fleur des hommes de Juillet, dans la petite ville de Gramat, a créé, dans l’ordre du dévouement, une dynastie autrement stable que celle du roi des Barricades.
Il est à regretter que la biographie de M. l’abbé Bonhomme, un in-8° de 600 pages, imprimée chez Mersch, soit réservée à ses filles. C’est sans doute modestie de leur part, modestie de la part de l’auteur, qui ne se nomme pas. Elle est bien écrite, écrite sur pièces. Les prêtres et les fidèles contempleraient avec grande édification le héros dont la vie fut si bien remplie.
J.-B.-J. Ayroles, S. J.
Le Bien du peuple de Dijon 23 juin 1901
La série d’articles de Henri Bernard fruit d’une étude approfondie du monumental ouvrage du R. P. Ayroles
vont paraître en volume.
Note. — Exemple d’article dans le numéro du 7 janvier 1900. Publicité pour l’ouvrage dans celui du 28 juillet.
Lien : Retronews
Les articles si intéressants que notre ami et collaborateur, Henri Bernard, a publiés dans nos colonnes sur Jeanne d’Arc viennent d’être réunis en un superbe volume. Ces articles, revus et complétés, sont le fruit d’une étude approfondie du monumental ouvrage du R. P. Ayroles (5 vol. in-4°) sur le même sujet. Le volume (in-4° de XIV-90) est en vente chez M. Ratel, libraire, place Saint-Jean, à Dijon ; et chez l’auteur, à Panthier, par Pouilly-en-Auxois. L’exemplaire : 2 fr. 25 ; franco : 2 fr. 65.
Études 20 juillet 1901
Compte-rendu défavorable de la Vie de Jeanne Darc de Joseph-Édouard Choussy, par le père Henri Chérot. La thèse est si novatrice qu’elle classe le père Ayroles parmi les libres-penseurs !
En effet, Choussy soutient que la mission de Jeanne s’achevait à Reims, affirmant que penser autrement reviendrait à prétendre que la mission de Jeanne a échoué et, par conséquent, qu’elle n’est pas d’origine divine, une position que seuls des libres-penseurs pourraient défendre.
Parmi ces libres-penseurs, figurent Quicherat et Henri Martin, mais aussi le P. Ayroles et M. Henri Wallon.
Source : Études religieuses, etc., 38e année, tome 88, 20 juillet 1901, p. 224.
Liens : Gallica.
Note. — Choussy avait déjà consacré un long article pour réfuter le père Ayroles, dans la 2e édition de son ouvrage Jeanne d’Arc, sa vraie mission, en 1896. [Voir]
À propos d’une nouvelle Vie de Jeanne d’Arc :
Vie de Jeanne Darc, par J.-É. Choussy, avec une préface contenant des documents et raisonnements absolument nouveaux
(cardinal Bourret et plusieurs autres prélats et savants) à l’appui de la thèse de l’auteur, en contradiction avec tous les historiens de Jeanne Darc, sans exception. Moulins, imprimerie Bourbonnaise, 1900. In-8, pp. VIII-547. Prix 15 francs.
La réclame ne manque pas au titre de cet ouvrage ; peut-être un peu plus de clarté aurait mieux fait l’affaire. Ce n’est point la Vie elle-même qui contient les documents et raisonnements absolument nouveaux
mais seulement la préface, et ce qu’il y a de nouveau, ce ne sont pas les documents, mais seulement les raisonnements.
Comme l’auteur, en nous adressant un exemplaire, a bien voulu nous prier de prononcer sur son ouvrage notre avis, tel que nous le dicterait notre conscience, nous nous faisons un devoir de répondre à ses intentions en lui disant la vérité et rien que la vérité. Nous espérons, en retour, que, de son côté, il voudra bien agréer nos regrets, si nous nous croyons obligé de ne point accepter ses conclusions.
Avec et malgré ses soixante pages, cette préface, si pompeusement annoncée, peut se résumer en quelques lignes. Certains historiens arrêtent la mission de Jeanne d’Arc (nous gardons l’orthographe conventionnelle, bien que l’auteur ait adopté la forme plus exacte de Darc) au sacre de Reims. D’autres, et le P. Ayroles est de ceux-là, estiment que cette mission s’étendait jusqu’à l’expulsion complète des Anglais par la guerrière. Ces derniers, d’après M. Choussy, se trompent lourdement.
Tout cela en soi est bien simple, bien vieux et bien connu. M. Choussy me paraît donc surtout renouveler le débat par la nouveauté de son style. Dieu le lui pardonne ! Mais quel ton, dans une question plutôt sérieuse et grave. En prolongeant la mission de Jeanne, devinez-vous ce qu’on fait ? Émettre une pareille assertion, c’est outrager l’évidence, nier l’existence du soleil en plein midi à moins que ce ne soit un moment d’aberration ? Hélas ! C’est tout simplement un ordre émané du camp de la libre-pensée Soutenir que la mission de Jeanne est manquée donc elle n’est pas divine !
(P. 12.)
Parmi ces libres-penseurs, figurent Quicherat et Henri Martin, mais aussi le P. Ayroles et M. Henri Wallon, un jésuite et l’auteur de la Croyance due à l’Évangile. Voilà qui est vraiment absolument nouveau
.
[…]
Le P. Ayroles, marchant sur les traces du cardinal Pie, qui lui-même suivait Le Brun de Charmettes, a soutenu, dans la Pucelle et l’Église de son temps (p. 634, sqq.), ainsi qu’en divers endroits de ses trois autres volumes, que la tradition ancienne, celle de la mission terminée à Reims, obscurcit grandement la sainte jeune fille
. J’avoue que cette raison m’est aussi indifférente que celle de M. Choussy. Que l’auréole de Jeanne d’Arc soit assombrie ou non, qu’est-ce que cela peut faire à l’histoire ? […]
Le Bien du peuple de Dijon 28 juillet 1901
Publicité pour l’ouvrage de Henri Bernard : Jeanne la Pucelle, suite de 23 articles séparés contenant toute la vie de Jeanne d’Arc, d’après l’ouvrage du R. P. Ayroles
. [Voir]
Lien : Retronews
Jeanne la Pucelle, par Henri Bernard : suite de 23 articles séparés contenant toute la vie de Jeanne d’Arc, d’après l’ouvrage du R. P. Ayroles.
In-4° de XIV-90 p. — L’ex. : 2,25 fr. ; 2,65 f. franco. — Chez M. Ratel, pl. Saint-Jean, Dijon.
La Vérité 12 août 1901
Extrait du Courrier bibliographique et littéraire d’Édouard Pontal sur le nouvel ouvrage du chanoine Dunand L’abjuration du cimetière de Saint-Ouen, qui est l’occasion de rendre hommage à l’œuvre monumentale
du père Ayroles.
Lien : Retronews
[En visite chez les libraires (fin). Librairie Retaux. — Librairie de la Bonne presse, Douniol et Poussielgue. — Librairie Curmer. — Librairie Privat (Toulouse) et Poussielgue (Paris) :]
Tous les travailleurs connaissent l’excellente librairie Privat de Toulouse, aussi accueillante aux érudits ou aux simples amateurs de lettres comme moi, qu’active et féconde en bons livres. J’en reçois un in-8° de près de 200 pages qui a pour titre : L’abjuration du cimetière de Saint-Ouen d’après les textes, par M. l’abbé Dunand, ancien aumônier du lycée de Toulouse, chanoine de la métropole. M. l’abbé Dunand est l’auteur d’une Histoire de Jeanne d’Arc en trois volumes, la plus récente et je crois aussi la plus complète de toutes celles qui ont été publiées jusqu’à ce jour. Je mets à part, bien entendu, la Vraie Jeanne d’Arc, du P. Ayroles, œuvre monumentale, mais qui n’est pas à proprement parler une histoire. Les deux ouvrages ne font pas double emploi l’un avec l’autre, et les bibliothèques chrétiennes ont un égal intérêt à les avoir tous les deux.