Documentation : Vraie Jeanne, II (1894-1896)
La Vraie Jeanne d’Arc, t. II 1894-1896
L’Univers 22 novembre 1893
Annonce de la parution prochaine du t. II de la Vraie Jeanne d’Arc : La paysanne et l’inspirée.
Vente par souscription : coût 15 francs, 10 pour ceux qui auront souscrit avant le 15 mars.
Lien : Retronews
Ailleurs :
- Le Monde, 14 avril 1894 : Gallica
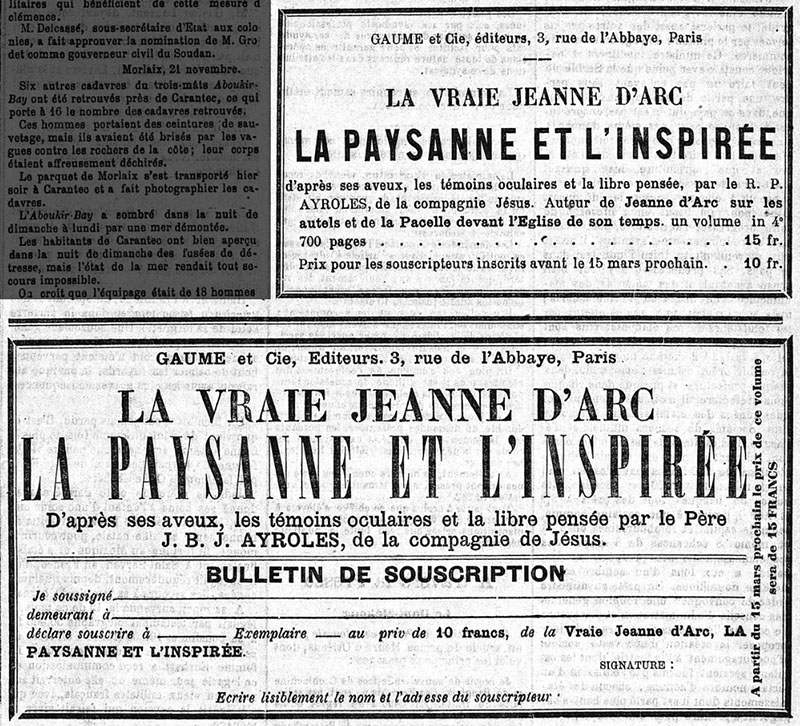
La Vérité, 4 décembre 1893
Article sur Jeanne d’Arc et le droit criminel ecclésiastique au moyen âge, par Raboisson.
Lien : Retronews
Un des signes du temps les plus heureux, c’est la grande place que s’est faite récemment, dans la pensée de tous en France, le soutenir de l’héroïne de Domrémy. Nos défaites, nos malheurs sont sans doute pour beaucoup dans cette reconnaissance générale, un peu tardive, envers l’humble fille des champs qui eut la mission divine de délivrer la France opprimée par la domination étrangère ; pour beaucoup aussi une sorte d’espérance instinctive en un secours divin, de l’âme française qui se sent à cette heure en des conjonctures assez analogues à celles où se trouvait la France dans la première moitié du XVe siècle.
[Le sujet est amené sur le procès de condamnation et la manœuvre des rationalistes
qui cherchent à rejeter l’infamie sur l’Église
.]
De nombreux travaux ont été publiés récemment sur cette matière ; après Quicherat, qui eut l’honneur d’être l’initiateur de telles recherches, mais dont l’état d’âme nuisit à l’équité des appréciations et contribua sans doute à l’empêcher de publier les documents dans leur pleine intégrité, sont venues de nombreuses et savantes publications : Ch. de Beaurepaire, l’abbé André du Bois de la Villerabel, de Beaucourt, Marius Sepet, Fabre, Jules Doinel, Lanéry d’Arc, le R. P. Ayroles ont tour à tour publié plus ou moins complètement, plus ou moins exactement le fonds, et de nombreux détails de la préparation et de la conduite de cet important procès de réhabilitation de Jeanne d’Arc. […]
L’Univers 30 janvier 1894
Mention du t. I, de la Vraie Jeanne d’Arc dans l’article rapportant que Jeanne d’Arc a été déclarée vénérable par Léon XIII (27 janvier 1894).
Lien : Retronews
Elle aura des autels, la douce héroïne ! La France chrétienne pourra s’agenouiller devant la vierge intrépide qui la sauva et qui mourut pour elle. La France qui ne sait plus prier ressentira le doux émoi que produisent la parole et l’action inspirées. Tous les cœurs nobles sont enflammés et saluent le gage de l’union qui va s’accomplir dans un élan de patriotisme, de gratitude, d’enthousiasme et d’amour. Gloire à Dieu qui suscita la vierge lorraine ! Reconnaissance à Léon XIII qui lui décerne l’honneur sublime !
Enfin nous échappons aux misères qui nous étouffaient. Nous pouvons nous relever et nous sentir libres, rafraîchis par le souffle qui rajeunit les âmes, nous retrouver enfin, dignes de notre passé et conscients de notre espoir, invoquer, devant les passions brutales ou perfides la justice et la foi triomphantes.
[…]
Dans ces derniers temps, les précieux documents [les traités du XVe siècle en faveur de Jeanne d’Arc, dont la Recollectio de Bréhal] ont été exposés au grand jour, grâce au travail magistral composé par le R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus. Nous nous abstenons à dessein de mentionner aucun des ouvrages qui ont paru durant l’intervalle : c’est toute une bibliothèque dans laquelle abondent les livres de haute valeur. Les érudits laïques qui ont participé à l’élaboration de cette histoire immense s’appellent Léopold Delisle, Siméon Luce, Lecoy de la Marche, Guillemin, Wallon, Beaucours, Sepet, Bourbon-Lignières, etc.
[…]
La libre-pensée a voulu opposer Jeanne d’Arc à l’Église. Or, précisément, l’héroïne était condamnée par les auteurs de la révolte au sein de l’Église. Une remarque fort intéressante a été faite, entre beaucoup, par le R. P. Ayroles : c’est que les principaux juges prévaricateurs, bourreaux de Jeanne d’Arc, étaient presque en même temps les chefs du brigandage qui se poursuivait dans le pseudo-concile de Bâle, insurgé contre le Pontife suprême. Le Pape et Jeanne d’Arc avaient les mêmes ennemis.
La Vérité 30 janvier 1894
Comtpe-rendu par d’Auteuil, de la 2e édition d’une Étude sur Jeanne d’Arc du comte de Bourbon-Lignières, qui conclut en mentionnant l’analyse des Mémoires par le père Ayroles.
Lien : Retronews
Au moment où s’ouvre, à Rome, le procès de canonisation de Jeanne d’arc on lira, avec un intérêt tout spécial, l’article suivant de nuire savant collaborateur, M. d’Auteuil :
Jeanne d’Arc en face de la science. — En 1874, M. le comte de Bourbon-Lignières avait publié une remarquable Étude sur Jeanne d’Arc et les principaux systèmes qui contestent son inspiration surnaturelle et son orthodoxie. La nouvelle édition qu il vient d’en donner (Paris, Lamulle et Poisson, 1894, in-16) constitue presque un nouvel ouvrage, tant les additions y tiennent de place. C’est que, depuis, la question a fait plus d’un pas. L’opinion des catholiques, qui dès le premier jour ont cru à l’inspiration divine la Pucelle, a gagné en profondeur et en étendue. Les systèmes contraires, depuis celui d’Henri Martin, qui a voulu faire de notre héroïne nationale une héritière de Velléda, jusqu’à celui de Siméon Luce, qui a prétendu expliquer sa mission par des influences ambiantes et des causes d’ordre secondaire, sont allés jusqu’à l’absurde et sont, par suite, tombés dans le discrédit. Un seul reste encore debout. Les phénomènes de l’hypnotisme ont ouvert une nouvelle voie à la libre-pensée : elle s’y est précipitée tête baissée, sans prévoir à quelles impossibilités, à quelles infranchissables barrières elle allait se heurter de ce côté. […] M. de Bourbon-Lignières a senti qu’il fallait porter la butte sur ce terrain.
[Suit un long développement sur plusieurs colonnes.]
À l’appendice de son livre, M. de Bourbon-Lignières a encore ajouté quelques notes d’un haut intérêt. Telle est son analyse des mémoires consultatifs émanés des théologiens qui furent consultés lors du procès de réhabilitation, entrepris par la cour de Rome à la requête de la famille de la Pucelle, mémoires publiés récemment par M. Lanéry d’Arc, et dont j’ai parlé ici même au moment de leur apparition. Il eût pu utiliser également l’important travail exécuté à l’aide des mêmes documents par le R. P. Ayroles, et qui, bien qu’inachevé, jette déjà une vive lumière sur les causes et les auteurs de la condamnation de l’héroïne. Mais, sans avoir besoin d’aucun auxiliaire, il a pu réfuter une fois de plus la thèse audacieuse de ceux qui rejettent sur l’Église la prévarication du tribunal de Rouen, constitué en dehors des règles canoniques et de celles de la justice la plus élémentaire. La politique anglaise a seule voué Jeanne d’Arc au supplice : l’Église l’a réhabilitée, en attendant qu’elle lui rende un hommage plus significatif encore.
D’Auteuil.
L’Univers 4 février 1894
Le journal publie une lettre pastorale de Mgr Coullié, successeur de Dupanloup (depuis 1893 archevêque de Lyon), qui annonce le décret de Léon XIII déclarant Jeanne vénérable et l’introduction de sa cause de béatification. Il cite les ouvrages du père Ayroles et des pères Belon (et Balme, sur la Recollectio de Jean Bréhal), comme réponses victorieuses aux objections du procès devant la Congrégation des rites.
Lien : Retronews
Mgr Coullié, archevêque de Lyon, publie une lettre pastorale, contenant la lettre suivante que Sa Grandeur a reçue de Rome :
Rome, le 27 janvier, 1894.
Monseigneur,
Je me hâte et suis en même temps très heureux d’annoncer à Votre Grandeur que ce matin a eu lieu la Congrégation des Rites sur l’introduction de la cause de la servante de Dieu Jeanne d’Arc ; que la résolution a été favorable, et que le Saint-Père, à qui j’ai eu l’honneur de la soumettre immédiatement, a daigné l’approuver. La cause est introduite, et Jeanne d’Arc a le titre de vénérable.
Le danger que peut courir maintenant cette belle cause c’est le culte qu’il n’est pas permis de prêter à la vénérable. Que NN. SS. les évêques de France tâchent d’empêcher tout signe de ce culte, et même de faire disparaître tout ce qui existe déjà contrairement aux règles du Saint-Siège. Ne le faisant pas, on arrêterait la marche de la cause.
Veuillez agréer, Monseigneur, la nouvelle assurance de mes sentiments respectueusement dévoués.
✝ J. Card. Aloisi Masella,
Préfet de la Sacrée Congrégation des Rites.
Monseigneur ajoute :
Il nous est impossible de contenir la joie qui remplit notre âme à cette nouvelle : La cause de notre Jeanne d’Arc est introduite !
Dieu soit mille fois remercié !
Oui tout d’abord, au Roi immortel des siècles, admirable dans ses saints, gloire, honneur, bénédiction !
À Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui aime les Francs, notre adoration et notre amour !
À Léon XIII, notre Père bien aimé, l’hommage de notre filiale et profonde gratitude !
Héritier de Mgr Dupanloup de vénérée mémoire, nous avions reçu avec un respect particulier ce legs du procès de Jeanne d’Arc, et, nous pouvons l’avouer simplement, notre vie se passait dans la douce compagnie de cette admirable enfant ; mais, parmi les incidents qui composent l’histoire de ces vingt ans, nous n’avions jamais oublié l’audience du 9 décembre 1885, dans laquelle le Pape voulut nous lire lui-même, avant de nous la remettre, une lettre destinée aux fidèles de notre diocèse d’Orléans. Arrivé à la dernière phrase, Léon XIII s’arrêta pour nous la faire remarquer :
J’espère, nous dit-il, que l’on reconnaîtra dans ces lignes la cause de Jeanne d’Arc :
Ultro autem vobis ominamur ut Deus Ipse communibus votis vestris, quæ ad gloriam totius Galliæ atque ad præcipuum urbis Aurelianensis decus spectant, benignus annuat. — La bonté de Dieu, nous vous en exprimons de tout cœur l’augure, exaucera ces vœux que vous faites de concert, ces vœux qui importent à la gloire de la France entière, et spécialement à l’honneur de la cité d’Orléans.
Nous emportions de cette audience ce bon augure. Il fallait sans doute respecter la sage lenteur de l’Église qui, dans les causes de béatification, comme dans tous ses actes, apporte à ses décisions l’étude la plus approfondie et la maturité la plus parfaite. Mais rien ne fut négligé de notre côté pour atteindre le but que nous avions en vue. Les prières succédèrent aux prières ; les travaux considérables destinés à éclairer de leur vrai jour tous les détails de la vie de Jeanne d’Arc furent entrepris*.
* La reconnaissance nous fait un devoir de nommer ici MM. Colin, Boucher de Molandon, Desnoyers, Cochard, Herluison, Jarry, qui sont demeurés si longtemps les gardiens vigilants de la vérité sur Jeanne d’Arc et les défenseurs de sa vertu…
La Providence elle-même se montrait favorable en maintes circonstances, et préparait par son action souveraine et délicate la décision que nous appelions de tous nos vœux. À peine si quelques détails, présentés habituellement d’une manière inexacte, pouvaient fournir matière aux objections recherchées par le promoteur de la foi. Et Mgr le promoteur lui-même, après avoir étudié avec soin la question, aimait à nous redire cette parole :
In hac nobilissima causa ut promotor fidei vincere cupio, sed magis virici desidero. — Dans cette cause, noble entre toutes, je cherche sans doute à vaincre comme promoteur de la foi, mais je désire plus encore être vaincu.
Depuis vingt ans surtout, Jeanne d’Arc, mise en relief par les panégyriques de nos orateurs les plus éminents, et en particulier par la parole éloquente de Mgr Dupanloup, apparaissait dans la vérité de sa mission, dans la sincérité de sa foi, dans l’éclat de sa sainteté. Les contradictions elles-mêmes ont servi à sa gloire, en provoquant des réponses victorieuses (ouvrages du P. Ayroles, du P. Belon).
Enfin, il faut bien que nous le reconnaissions, Léon XIII, dans son amour indomptable pour la nation Fille aînée de l’Église, a vu le triomphe de Jeanne comme une gloire nouvelle pour notre France. Avec sa puissance incontestée, le Pape déchire aujourd’hui les nuages qui obscurcissent l’horizon et fait briller sur nous, à la fin de ce siècle tourmenté, le rayon de la plus douce espérance.
Ô Très Saint Père ! vous avez bien jugé les cœurs de vos enfants de France. Les tempêtes morales qui se succèdent parmi nous n’ont pas brisé les fibres de la vraie foi et du patriotisme. Nous sommes toujours les fils de Clovis par le baptême et les descendants de ce roi des Francs par la vaillance. Vous nous dites tout cela par votre autorité suprême, en nous offrant comme modèle Jeanne la fille de Dieu, Jeanne la libératrice de la France. Vous avez jugé les justices (Ps. LXXIV, 3.) des hommes et vengé la Sainte Église. Saint Père, vous nous avez vaincus par amour. En France tout est vôtre !
L’heure viendra, N. T. C. F., où nous vous appellerons au pied des autels pour offrir à Dieu de solennelles actions de grâces à l’occasion de cette grande et bonne nouvelle. Nous ne voulons aujourd’hui que vous faire partager notre émotion et notre confiance.
Orléans, cité fidèle, tressaille de joie ; prépare les fêtes de ta délivrance et qu’elles soient dignes de ta reconnaissance séculaire !
Conserve surtout le trésor que Jeanne t’a confié, l’union parfaite qui donne à tes solennités tant d’éclat et nous offre le beau et consolant spectacle d’une vraie fête nationale.
Que de tes murs, comme du cœur de la France, cette union, semblable à un sang rajeuni, se répande dans nos villes et nos campagnes, et rende à notre cher pays, avec la force morale, la paix et la prospérité !
Il nous est particulièrement doux de saluer, au milieu de cette joie et de ces espérances, l’élu de Dieu qui doit perpétuer dans le diocèse que nous avons tant aimé, avec le souvenir de sa libératrice, les traditions de la foi et du patriotisme chrétien (Mgr Touchet, vicaire capitulaire de Besançon, nommé évêque d’Orléans).
Vallées de la Meuse, collines du bois Chenu, enfants de Domrémy, bénissez le Seigneur ! Habitants de Vaucouleurs, ce n’est plus une armure que Jeanne vous demande : préparez par vos prières l’achèvement de son triomphe.
Reims, voilà le prélude des fêtes que tu prépares à la France ; c’est à la suite de Jeanne vénérable et sous les plis de son étendard que nous irons bientôt renouveler sur les fonts de Saint-Remi les promesses du baptême national.
Rouen ! Dieu répond aux accents de tes vœux. Et la Sainte Église récompense la zèle de ton illustre pontife et de tes enfants !
La France entière peut se lever pour faire entendre les accents de l’action de grâces, en attendant le jour où il lui sera donné d’acclamer celle qui a été la joie ; la gloire et l’honneur de son peuple, car il est vrai de le dire et de le chanter : Non fecit taliter omni nationi ! — Ce n’est pas à toutes les nations que Dieu a fait de telles faveurs ! (Ps. CXLVII, 20.) Ce n’est pas l’exagération d’un enthousiasme national, qui nous inspire ce cri, c’est là vérité de l’histoire ! c’est la vérité de l’amour de Dieu pour les Francs : Gesta Dei per Francos.
Da pacem, Domine, in diebus nostris : Au souvenir de Jeanne, votre messagère, donnez-nous la paix ; inspirez l’entente, et la conciliation, fondées sur le respect des lois de Dieu et des devoirs de la conscience.
Avec votre fidèle servante nous désavouons toutes les intentions que l’on nous prête et nous déclarons calomnieuses les pensées que l’on nous attribue. Nous demandons la liberté de notre foi, le respect des consciences, les immunités de la Sainte Église, parce que, éclairés par les leçons de l’histoire aussi bien que par les convictions de nos cœurs, nous savons que si Dieu ne bâtit pas lui-même la maison, ceux qui cherchent à l’édifier travaillent en vain ; si Dieu ne garde pas la cité, la vigilance de ses gardiens sera trompée (Ps. CXXVI, 1). Recevez, nos très chers frères, ces déclarations sincères ; nous les confions à vos âmes et nous vous laissons, comme un rayon d’espoir, ce cri d’un évêque et d’un Français : — Par Jeanne d’Arc vénérable, tout pour Dieu et pour la France ! Pro Deo et Patria !
Nous lisons dans la Semaine de Saint-Dié :
La nouvelle du décret qui déclare Jeanne d’Arc vénérable est arrivée par dépêche dimanche dernier à MM. les vicaires généraux. La joie qu’elle a causée s’est répandue aussitôt dans toute la ville. En l’absence de Monseigneur, parti pour Chartres la semaine précédente et rentré seulement hier à Saint-Dié, M. Legros, archidiacre de Saint-Dié, s’est empressé de faire sonner, le lundi à midi, les cloches de la cathédrale et de Saint-Martin. L’exemple a été imité le jour même au séminaire, dans les chapelles de la ville, et jusque dans plusieurs paroisses voisines.
La Semaine publie en outre une éloquente lettre pastorale, par laquelle Mgr Foucault prescrit, pour demain, un salut solennel d’actions de grâces.
Études février 1894
Contribution du père Ayroles : Jeanne d’Arc a-t-elle été brûlée ?
Il s’agit de la réfutation du premier chapitre du livre : Jeanne d’Arc et la pays d’Évreux (Évreux, 1893, 383 p.), de l’abbé de La Balle, curé de La Croix-Saint-Leufroy (Eure), qui soutient la thèse que Jeanne échappa au bûcher pour réapparaître sous le nom de Jeanne des Armoises.
Source : Études religieuses, tome 61 : 15 février 1894, p. 336-343.
Liens : Google
Ouvrage du père Pierre-Émile de La Balle : Jeanne d’Arc et la pays d’Évreux (Évreux, 1893, 383 p.).
Liens : Google
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
Messager du Cœur de Jésus février 1894
Présentation par l’éditeur du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc à paraître.
Note. — Le texte est antérieur à l’introduction de la cause (27 janvier 1894), car il se conclut par un appel à la prière en préparation de cette introduction, en reprenant la prière de Mgr Coullié (3 décembre 1893).
Source : Messager du Cœur de Jésus, tome 65 (janvier-juin 1894), bulletin de février 1894, p. 238-242.
Lien : Google
VII. La Vraie Jeanne d’Arc, La Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée, par le Père J.-B.-J. Ayroles, S. J.
L’auteur de Jeanne d’Arc sur les Autels et de la Pucelle devant l’Église de son temps est bien connu de nos lecteurs. Le Messager a rendu compte jadis de ces deux beaux ouvrages, et il est heureux d’annoncer la prochaine apparition d’un troisième volume, destiné à nous faire de plus en plus connaître la vraie Jeanne d’Arc. Écoutons l’éditeur s’expliquant lui-même sur le but que l’auteur poursuit et le plan qu’il veut réaliser, s’il plaît à Dieu.
I
Le doyen des Cardinaux français, Son Ém. le Cardinal Desprez, a daigné écrire les lignes suivantes à l’auteur de la Pucelle devant l’Église de son temps :
À tout prix, il faut arracher notre admirable Jeanne d’Arc au rationalisme et à la libre-pensée ; il faut montrer en elle la Vierge divinement envoyée à la France pour la préserver de la ruine, et conserver à la défense de la foi la nation appelée si justement la Fille aînée de l’Église.
[Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. XII.]
Des paroles si expressives et tombées de si haut disent assez quel intérêt de premier ordre s’attache à l’histoire de Jeanne d’Arc.
Le volume déjà publié sous le titre de la Pucelle devant l’Église de son temps a fait connaître, avec une ampleur remarquée et louée de bien de manières, ce qu’avait dit et pensé de la Pucelle, non pas un parti antinational et schismatique se targuant d’être l’Église, mais la véritable Église de Jésus-Christ, bâtie sur Pierre.
Celui intitulé la Paysanne et l’Inspirée présentera Jeanne depuis sa naissance jusqu’à son entrée en scène, à Chinon. Ce sont les origines de la mission, les dix-sept premières années de la céleste envoyée, le lever silencieux de l’astre dans le coin le plus reculé de la France, par la plus sombre des nuits qu’eût encore traversées notre pays.
Sera-t-il donné de décrire sur le même plan et avec semblable étendue le midi et le couchant de l’astre sauveur ? C’est sans doute avant tout le secret de Celui qui mesure la vie et fait les jours ; mais c’est aussi le secret de ceux qui veulent connaître et faire connaître la Pucelle telle que Dieu la fit. Leur concours est nécessaire. Il doit suppléer celui que des publications similaires trouvent dans les pouvoirs publics, qui les encouragent, tant par des allocations directes que par des souscriptions imposées, d’office, aux établissements placés sous leur dépendance. On sait bien que semblable appui n’est pas pour les tenants du surnaturel.
Ceux qui, avec l’Éminent Archevêque de Toulouse, penseront qu’avant tout il faut arracher la Pucelle au rationalisme et à la libre-pensée, voudront collaborer avec l’auteur et l’éditeur. On a fort justement loué la magnifique exécution typographique de la Pucelle devant l’Église de son temps. Ce sera celle de la Paysanne et l’Inspirée, de la Libératrice et de la Martyre, s’il est permis de continuer l’œuvre. (Les volumes, cotés 15 francs en librairie, sont livrés pour 10 francs aux souscripteurs. On peut ne souscrire qu’au présent volume ; par lui-même, il formera un tout, comme le fait le précédent et le feront les suivants.)
II
Ajoutons à cette annonce un mot relatif à la canonisation de Jeanne d’Arc. Aucun de nos lecteurs n’ignore que le procès canonique pour introduire en Cour de Rome cette cause de béatification est en pleine voie d’exécution.
Or, à la date du 3 décembre 1893, Mgr l’Archevêque de Lyon adressait aux nombreuses Communautés religieuses de son diocèse une lettre, aussi pieuse que patriotique, pour réclamer le secours de leurs prières et de leurs communions en faveur de la béatification de Jeanne d’Arc.
Cette cause, assurément, intéresse la France entière. Tous nos Associés seront donc heureux de prendre pour eux-mêmes les paternelles invitations du Primat des Gaules ; car, Apôtres de la Prière, ils sont, eux aussi, dans l’armée de la sainte Église, des bataillons d’élite, pour les luttes pacifiques
de la foi et de la religion. Voici la principale partie de la lettre épiscopale aux Communautés religieuses du diocèse de Lyon :
Nous venons, Nos chères filles, faire appel à votre amour pour la sainte Église et pour la France, en donnant à vos prières une intention qui intéresse ces grandes causes. Dans quelques jours, le procès de la béatification de Jeanne d’Arc doit être introduit auprès de la Sacrée Congrégation des Rites.
Vous savez avec quelle sagesse et quelle discrétion la sainte Église traite la question de la canonisation de ses enfants. Si nous devons respecter cette discrétion, il nous est permis de prier. Vos cœurs de Françaises comprennent l’importance de la cause de Jeanne d’Arc et entrevoient les bienfaits admirables et nombreux que notre chère patrie peut recueillir de son succès. C’est l’union de toutes les âmes, c’est le réveil du patriotisme chrétien élevé à la hauteur du sacrifice et du martyre. C’est une nouvelle et puissante protection donnée à la France de Clotilde, de Charlemagne et de saint Louis.
Dans cette attente, Nos très chères filles, il appartient aux âmes vraiment chrétiennes et françaises, et surtout aux âmes religieuses, d’élever vers le ciel les supplications les plus ardentes. Ce pouvoir de la prière, il vous est conféré d’une manière toute particulière, et grâce à votre vocation vous lui donnez pour ainsi dire un nouvel appui et son complément par la pénitence, par le dévouement à vos œuvres et par l’obéissance fidèle à vos constitutions.
Vous êtes dans l’armée de la sainte Église des bataillons d’élite ; c’est à ce titre que je vous appelle à cette lutte pacifique. Quelle joie pour notre France, le jour où Jeanne la Pucelle d’Orléans recevra de l’Église, par la voix de son bien aimé Pontife, le titre de Vénérable ! Ce sera l’aurore du grand jour où la gloire de la bienheureuse et l’auréole de la sainte nous permettront de la regarder comme la patronne de notre patrie, jour de miséricorde et d’espérance que nous appelons de tous nos vœux.
À ces causes, Nos chères filles, à partir du jour de la réception de cette lettre, on récitera dans toutes les Communautés religieuses du diocèse, à l’heure la plus convenable, les prières suivantes :
Une fois Notre Père et Je vous salue Marie, avec les invocations :
Saint Michel, priez pour nous ;
Sainte Marguerite, priez pour nous ;
Sainte Catherine, priez pour nous.
Ces prières seront continuées jusqu’au jour où il nous sera donné de connaître le résultat du procès.
Nous exhortons Nos chères filles à offrir quelques communions à la même intention.
Voilà nos vœux, Nos chères filles ; Nous les offrons au Cœur sacré de Jésus, à Notre-Dame de Fourvière, aux saints patrons de vos familles religieuses. Nous demandons aussi à votre piété filiale un souvenir dans vos prières. En retour, Nous sommes heureux d’appeler sur toutes vos chères Communautés les plus abondantes bénédictions de Dieu.
✝ Pierre,
Archevêque de Lyon et de Vienne.
L’Univers 4 mars 1894
Lettre du père Ayroles en réponse au discours de M. Valès, professeur agrégé d’histoire à Nancy. Ce dernier conteste le décret d’introduction de la cause de béatification de Jeanne d’Arc, qui impute aux mêmes individus la responsabilité du procès de Jeanne à Rouen et du concile de Bâle.
Ayroles démontre, documents à l’appui, que l’Université de Paris était bien l’âme des deux brigandages, dont elle fournit et la doctrine et les effectifs. Il conclut :
L’expression du décret disant que les principaux tortionnaires de Rouen ont pris part au concile de Bâle serait plutôt au-dessous de la réalité. On peut dire qu’ils en sont les auteurs.
Lien : Retronews
Rouen et Bâle
Un professeur agrégé de Nancy, M. Valès, a cru pouvoir relever une erreur historique dans le décret relatif à la cause de Jeanne d’Arc. Il a mis en opposition le passage qui concerne la mort de l’héroïne et celui qui se rapporte au conciliabule de Bâle. Le professeur soutient qu’on ne peut dire que les bourreaux de Jeanne aient été les meneurs de l’autre brigandage, le concile s’étant ouvert, le 22 juillet 1431, soit deux mois après le crime de Rouen et n’étant devenu schismatique qu’à partir de 1437.
M. Valès s’est trompé sur les dates et sur d’autres points. Nous recevons à ce sujet la lettre suivante qui intéressera nos lecteurs et que M. le professeur de Nancy lui-même jugera digne d’attention :
Le décret ne pouvait pas faire l’histoire du conciliabule de Bâle ; mais il devait indiquer, ainsi qu’il l’a fait, la part prise par les principaux tortionnaires de Rouen à la longue bacchanale ecclésiastique ; et rien n’est plus vrai.
L’Université de Paris est au commencement, au milieu et à la fin du brigandage de Rouen ; elle est au commencement, au milieu et à la fin du brigandage de Bâle. Les faux principes émis à Rouen et à Bâle sont les mêmes. Bien plus, ceux qui sont l’âme du prétendu procès de Rouen, Courcelles, Beaupère, Érard, sont l’âme de la schismatique assemblée. Si Eugène IV n’a pas été abandonné au bras séculier comme Jeanne, c’est faute d’exécuteur. La sentence a bien été prononcée ; et bien des imputations sont identiques.
Le procès de Rouen s’ouvre le 21 février. L’ouverture du concile de Bâle était fixée au 3 mars ; il ne s’y trouva que l’abbé de Vézelay, qui se donna le ridicule de gourmander l’univers catholique devant le chapitre de la ville. Mais pourquoi les député de l’Université de Paris, alors vraiment enragée de substituer a l’autorité du Pape celle des clercs et gens en ce connaissant, — c’est-à-dire son autorité à elle, — pourquoi ses députés ne s’y trouvaient-ils pas ? Que M. le professeur d’histoire ouvre le cinquième volume du double procès par Quicherat à la paire 198, il y lira la pièce attestant que Beaupère, en dessus de ses journées de présence à Rouen, payées 20 sous par jour, a reçu 30 livres tournois, en dédommagement des frais inutiles que lui causaient trois chevaux dont il s’était monté pour aller à Bâle. Aussi quitta-t-il Rouen deux jours avant le supplice pour prendre le chemin du concile.
En réalité depuis plusieurs années, et spécialement pendant la captivité et le procès de Rouen, l’Université de Paris faisait déjà le conciliabule de Bâle, en ce sens qu’elle se donnait, selon l’expression de son historien, des mouvements infinis pour triompher de l’indifférence du reste de la catholicité, et y attirer des délibérants, en ce sens qu’elle formulait, appliquait — non seulement à la Pucelle, mais dans son sein, — les doctrines subversives qu’elle voulait faire triompher dans la schismatique assemblée. C’est ainsi qu’en mars 1430, le dominicain Jean Sarrazin, à l’instigation du recteur Guillaume Érard, le faux prêcheur du cimetière de Saint-Ouen, était condamné à une amende honorable pour avoir soutenu la doctrine catholique. Il était contraint de professer la soumission à toutes les ordinations, dispositions, déterminations de l’Université. Cujus ordinatione, dispostione et omnimodo determinationi me submisi et submetto.
N’était-ce pas là revendiquer la suprême autorité dans l’Église ?
Ce sont les doctrines qu’elle essaya d’imposer dans leur plus grande ampleur à Bâle, dépouillant le Pape non seulement du suprême pouvoir doctrinal et législatif ; mais encore exécutif, lui défendant de créer des cardinaux, allant jusqu’à nommer les gouverneurs du Comtat-Venaissin.
M. l’agrégé dit que le concile n’est devenu schismatique qu’en 1437. C’est une erreur. Il était dissous dès 1432 par Eugène IV qui le transférait à Bologne aux cris de fureur de l’Université. L’assemblée qui, dans son immense majorité, fut toujours composée de clercs du second ordre, refusa d’obéir. En 1434, Sigismond obtenait du Pape une prorogation ; mais les décrets faits par semblable assemblée ne devenaient pas pour cela conciliaires ; ils étaient entachés de schisme et d’hérésie par leur teneur même. Non seulement ils ne furent pas approuvés par celui qui a reçu la mission de définir la foi, mais bien annulés, cassés ; et par la bulle Moyses en date de la veille des nones de septembre 1439, avec l’approbation de l’Église d’Orient et d’Occident réunie autour de lui, Eugène IV prononçait ce que l’on doit penser de l’assemblée de Bâle. C’est un ramassis de clercs qui n’étaient pas la plupart dans les ordres sacrés, ignorants, vagabonds, échappés de prison, en révolte contre leurs supérieurs, assemblée infernale. Ut ad illud Basileense Latrocinium totius orbis dæmonia confugisse videantur. (Acta conciliorum du P. Hardouin, t. IX, col. 1004, etc.) La Constitution est loin de porter seulement sur les deux dernières années ; elle porte sur l’ensemble des actes de la néfaste assemblée.
Or, il faut le répéter, d’une part les historiens panégyristes de l’Université, Crevier, du Boulay, revendiquent pour la corporation l’honneur d’avoir été l’âme de l’assemblée de Bâle ; de l’autre, Quicherat, lui-même, avoue ce qui est patent par les actes, que la première idée de faire succomber Jeanne dans un procès en matière de foi se produisit d’abord dans les conciliabules de l’Université et que le gouvernement anglais n’eut qu’à laisser faire, ou si l’on veut, à exécuter les mesures qu’elle conseillait. Elle couvre tout de son autorité ; elle avoue aller contre le sentiment die l’Église tout entière, puisqu’elle écrit que Jeanne a infecté de son virus le bercail jusqu’alors très fidèle de presque tout l’Occident : Per cujus latissime dispersum virus, ovile christianissimum totius fere Occidentalis orbis infectum manifestatum. (Procès, t. I, p. 407).
Que faisait-elle en cela, sinon professer et appliquer à la Pucelle les doctrines qu’elle allait quelques mois après s’efforcer d’ériger en dogme de foi à Bâle, et appliquer, à Eugène IV ?
L’expression du décret disant que les principaux tortionnaires de Rouen ont pris part au concile de Bâle serait plutôt au-dessous de la réalité. On peut dire qu’ils en sont les auteurs. Quicherat ne dit-il pas que Courcelles fut le bras droit de Cauchon, et un peu plus loin qu’il est le père des libertés gallicanes, qu’il les dicta l’une après l’autre à l’assemblée de Bâle ? Cette dernière assertion est presque la traduction de ces mots de l’un des historiens de l’Église, de Sponde, appelant Courcelles
le principal artisan des décrets de Bâle: Decretorum Basileensium præcipuus fabricator.
En voilà bien assez pour réduire à néant les arguties de M. l’agrégé d’histoire. Ceux qui voudront de plus longs développements les trouveront dans le second livre de la Pucelle devant l’Église de son temps : Les pseudo-théologiens, ennemis de Jeanne, ennemis de la papauté
, par le P. Ayroles, chez Gaume.
L’Univers 11 mars 1894
Compte-rendu de la Paysanne et l’inspirée (Vraie Jeanne d’Arc, t. II), par le journaliste Eugène Tavernier.
Le critique s’arrête sur quelques points traité par le père Ayroles : état de la France et de la Chrétienté à la venue de Jeanne, sa nationalité, le parallèle avec la passion du Christ. Puis il se réjouit que le père ait démoli les démentes théories des libres-penseurs pour nier le surnaturel de cette épopée chrétienne
:
L’œuvre de réfutation était nécessaire. Le R. P. Ayroles a su l’accomplir supérieurement ; il aura contribué beaucoup à détourner de cette noble figure, aujourd’hui rayonnante, le souffle empoisonné de l’incrédulité.
Lien : Retronews
Il n’y a point de personnage historique dont le rôle et le caractère soient indiqués par des documents aussi nombreux que ceux qui concernent Jeanne d’Arc. Cette assertion, qui aurait paru fantaisiste à la première moitié de notre siècle, est aujourd’hui une éclatante vérité. La preuve en est faite avec une précision et une abondance prodigieuse par le R. P. Ayroles. Elle va continuer de se développer. Ainsi le savant jésuite aura élevé à la mémoire de la Libératrice un magnifique monument littéraire, pendant que le zèle de nos évêques prépare la glorification de la Pucelle par des édifices de marbre et d’or. Un nouvel ouvrage vient de paraître, non moins important que celui dont nous parlions en annonçant l’espérance donnée à notre pays de voir resplendir sur les autels ce nom de gloire, ce délicieux visage de sainteté, qui jadis proclamèrent et maintenant symbolisent la mission providentielle de la France. Après avoir écrit la Pucelle devant l’Église de son temps, le R. P. Ayroles étudie spécialement deux aspects de la physionomie de l’héroïne : la Paysanne et l’Inspirée. Comme les volumes précédents, celui-ci est de grand format. La matière de plusieurs autres est rassemblée ! On les lira tous avec la surprise de trouver tant d’attrait à une œuvre majestueuse.
L’état horrible de la chrétienté, de la France et de la Lorraine pendant les années obscures de la Pucelle doit être exposé pour que l’on connaisse vraiment les faits extraordinaires qui vont s’accomplir. Dieu a voulu soumettre à d’incroyables épreuves son Église, qui s’est vue déchirée par les compétitions de trois Papes ! Le pouvoir civil profite de ces troubles pour empiéter sur la puissance religieuse. À la faveur du grand schisme, Jean Huss a répandu l’hérésie et le massacre. Les passions brutales et perfides ont triomphé. Il semble que le droit soit aboli. La France est au comble de la misère : le conflit politique des Armagnacs et des Bourguignons a engendré la guerre nationale qui détruit tout ; on ne vit plus, on ne laboure plus que sous la protection des armes. L’éminent historien, résumant les récits de l’époque, mentionne de nombreux traits de ce genre :
On ne cultivait alors la terre que dans les alentours des villes ou le voisinage des lieux fortifiés et des châteaux, à la distance seulement où, du haut d’une tour ou d’un poste d’observation, le regard d’une sentinelle pouvait voir l’arrivée des bandes pillardes. Le tintement d’une cloche, un cor de chasse, tout autre son servait de signal pour avertir les vignerons et les laboureurs de chercher un abri dans des lieux sûrs. Dans bien des endroits le signal d’alarme se fit si souvent entendre, qu’aussitôt donné les bœufs et les bêtes de somme, libres de la charrue, se précipitaient spontanément, par effroi et sans guide, dans des lieux de sûreté. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 58-59.]
Même les provinces qui avaient le moins souffert étaient troublées profondément. Cette peinture des ravages qu’avaient multipliés la guerre civile, la guerre étrangère, toutes les fureurs, est tracée avec une netteté saisissante.
Jeanne vient au monde l’année même où les deux factions rivales se disputent l’appui de l’étranger et livrent le sol de la France à l’Angleterre. La nationalité de l’héroïne a donné lieu, on le sait, à des contestations où se dépense encore la science des feudistes. Le R. P. Ayroles ne pouvait rien négliger de cette affaire où s’enchevêtrent toutes les doctrines de la jurisprudence féodale. La base d’argumentation adoptée par l’auteur, c’est, la formule que Jeanne elle-même approuva :
Jeanne est née à Domrémy-sur-Meuse, au diocèse de Toul, dans le bailliage de Chaumont, dans la prévôté de Monteclere et d’Andelot. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 111.]
La Libératrice serait donc née dans la partie de la Champagne qui, d’après la carte dressée par Courtalon au XVIIIe siècle, s’appelait Champagne-Lorraine. Ce n’est pas à dire que le prestige uni au nom de bonne Lorraine soit exposé à se voiler. Le R. P. Ayroles a soin d’énumérer toutes les raisons qui, en dehors du point de vue administratif ou politique, consacrent la légitimité du titre sous lequel Jeanne a conquis sa gloire. Comme le remarque le savant jésuite, les liens religieux avaient, à cette époque, une importance de premier ordre. Saint Louis aimait à signer, Louis de Poissy, en souvenir du lieu de son baptême. Jeanne est toujours et d’abord attachée à l’église près de laquelle elle avait grandi et qui relevait du diocèse de Toul. Cette dernière ville, dit le R. P. Ayroles, était un centre bien autrement vivant que Chaumont, Langres ou Vaucouleurs. Assurément Toul était Lorrain et, ainsi qu’il le fait observer
le siège épiscopal communiquait quelque chose de lorrain à tous ceux sur lesquels s’étendait la juridiction du prince-évêque. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 276.]
Enfin le père de Jeanne, ayant épousé une Barroise et créé une famille destinée à vivre dans le pays d’adoption, avait cessé d’appartenir à la Champagne, proprement dite.
Une étude comparative des déclarations de la Pucelle durant l’épouvantable procès de Rouen, fournit en abondance des détails qui ajoutent à la netteté de la physionomie. Son caractère charmant et sa puissance extraordinaire apparaissent dans les réponses toutes simples, enjouées, merveilleusement adroites par lesquelles elle déconcerte la fourberie et la méchanceté de ses bourreaux. Paysanne elle l’est, selon ce que cette expression indique de naturel, de candeur, de vigueur aussi ; inspirée, elle l’est jusqu’au dernier moment, ayant, dans son ignorance, triomphé des arguties perfides et féroces ; surmonté, dans sa faiblesse, toutes les violences ; intrépide contre les hommes ; invincible par sa foi en Dieu. À chaque moment de ce drame retentit le cri de l’inspiration :
Plutôt que d’être venue en France sans le congé de Dieu, j’aimerais mieux avoir tous mes membres tirés à quatre chevaux… Tout ce que j’ai fait, tout ce que j’ai fait de bien, c’est par le commandement des voix que je l’ai fait. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 165.]
Il est une comparaison à laquelle le R. P. Ayroles revient plusieurs fois et qui, en effet, par moments, s’impose d’une manière étonnante : ces scènes ne rappellent-elles pas celles qui se sont passées lorsque Jésus était devant les pharisiens ? Il y a des expressions qui ont l’accent de l’Évangile.
Après la puissance de l’inspiration, manifestée dans cette histoire, rien peut-être n’est plus étonnant que l’abondance des preuves d’ordre rationnel. On l’a déjà dit, on doit le répéter à l’exemple de l’éminent écrivain dont on admire la science, le talent et le zèle. Outre les énormes dossiers qui font connaître le procès en partie double, nous avons les lettres écrites par des contemporains tels que Perceval de Boulainvilliers, conseiller et chambellan de Charles VII, sénéchal du Berry et par Alain Chartier, secrétaire du même prince. Bien plus encore, ce qui ne s’est rencontré pour aucun personnage : toute l’histoire de la famille de la Pucelle et les dépositions de trente-quatre témoins qui avaient connu Jeanne avant l’accomplissement de ses terribles et glorieuses destinées. Pendant que les commissaires pontificaux poursuivaient l’enquête à Rouen, à Orléans, à Paris, des délégués se rendaient sur les lieux où était née l’héroïne, où le souvenir de son enfance et de sa jeunesse demeurait pur et charmant ; où restaient encore des hommes qui l’avaient accompagnée de Domrémy à Chinon. Ceux-ci avaient obéi à l’ascendant de la jeune paysanne, qui se disait chargée de vaincre les Anglais, et ils s’étaient groupés pour former une escorte. Oui, en 1445 [1456], Jean de Novilonpont [Nouillonpont], dit de Metz, homme noble, et Bertrand de Poulengy racontaient, sous la foi du serment, les affirmations de Jeanne ; comment s’était organisée la petite troupe qui se rendit près du roi de France, comment s’accomplit ce mémorable voyage de onze jours, exécuté surtout pendant la nuit.
L’autorité historique de l’épopée chrétienne est si grande, que la libre-pensée n’a pu songer à nier les faits. Quelques écrivains se sont appliques à les dénaturer, au prix du dernier abaissement. On ne doit pas mêler Quicherat à la flétrissure que les autres ont encourue ; et pourtant, à quelle obstination lamentable le savant a-t-il cédé en lui, chaque fois que la puissance surnaturelle apparaissait ! Les procédés fantastiques, de M. Siméon Luce ont, fourni au R. P. Ayroles la matière d’une réfutation qui est faite de main de maître. Les procédés honteux de Michelet sont dévoilés avec une sûreté qui ne se dément pas, malgré la répugnance qu’inspire la besogne. On voit en ces pages la preuve du jugement que portait Proudhon :
Prenez un paon, un bouc, un hanneton, un coucher de soleil, de la marjolaine, du poison, des paysages, de l’extase, enfin l’idée de Dieu à la manière des Allemands, mettez le tout dans un vase, pilez, broyez, recouvrez de terreau. Au mois d’avril, il en sortira un vieillard sautillant, vaniteux et lubrique : un Michelet.
L’œuvre de réfutation était nécessaire. Le R. P. Ayroles a su l’accomplir supérieurement ; il aura contribué beaucoup à détourner de cette noble figure, aujourd’hui rayonnante, le souffle empoisonné de l’incrédulité.
Eugène Tavernier.
L’article suivant rapporte la mort du cardinal Thomas, archevêque de Rouen, décédé le 9 mars. Extrait :
[…] De grandes fêtes eurent lieu à Rouen en 1892, pour célébrer le 25e anniversaire de sa consécration épiscopale. Animé envers Jeanne d’Arc d’une admiration toute particulière, à tel point, que dans presque tous ses discours, il évoquait son image, et que, paraît-il, le nom de l’héroïne est le dernier qu’il ait prononcé, il voulut faire coïncider, avec ses noces d’argent, la bénédiction solennelle du monument élevé par lui, sur la colline de Bon-Secours, à la gloire de la bonne Lorraine.
Études 31 mars 1894
Compte-rendu du livre : Campagnes des Anglais dans l’Orléanais, la Beauce et le Gâtinais de 1421 à 1428 de Amicie de Villaret, par le père Ayroles.
Source : Études religieuses, etc., 31e année, supplément aux tomes 41, 42 et 43, p. 200-201.
Lien : Gallica
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
Revue catholique des institutions et du droit avril 1894
Long compte-rendu du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc, par Albert Desplagnes, à qui le père Ayroles avait envoyé les bonnes feuilles avant la parution (19 mars). Après avoir donné le plan général de l’ouvrage et celui détaillé du t. II, il le consacre plus beau livre qui ait été écrit sur Jeanne d’Arc à Domrémy
.
Quelques points :
Desplagnes partage l’espoir du père Ayroles :
Si Dieu a voulu, en 1429, sauver la France, est-il possible de penser que la France de 1894 lui est devenue indifférente et qu’il n’y a rien à tenter ni à espérer de ce côté ?
Il préfère le plan chronologique/thématique du père Ayroles à celui de Quicherat :
[Dans le recueil de Quicherat,] les documents sont plutôt entassés que coordonnés ; les procès-verbaux du procès suivent l’ordre des séances. Les cinq volumes sont un recueil assurément très précieux, mais confus et qu’il est fort difficile de consulter sur telle ou telle époque déterminée de la vie de Jeanne. […] Le P. Ayroles a adopté un plan tout différent et dont les avantages sont évidents.
Il vante le fait que le père Ayroles ait traduit les documents :
Quicherat donne ces documents en latin ou dans la langue du XVe siècle. Le P. Ayroles les donne d’abord en français [puis] dans le texte original tous les passages principaux et ceux qui peuvent prêter à quelque discussion ou difficulté.
Il est saisi de constater que toute cette diversité de témoignage sur Jeanne sont parfaitement concordants :
Toutes les sources contemporaines qui nous donnent l’histoire de la Pucelle sont entre elles d’une concordance complète. Les déclarations de Jeanne, les témoignages, tous les autres documents, ne contiennent rien qui les mette en opposition les uns avec les autres.
Il applaudit à la réfutation des libre-penseurs qui déploient des trésors d’imagination pour nier le surnaturel :
Tout lecteur sincère aura peine à comprendre comment quelque crédit a pu rester aux auteurs de ces étranges inventions.
Et remarque que toutes leurs théories diverges :
Le plus curieux de l’affaire, c’est que chacun de ces beaux esprits a fait une Jeanne différente. Ces héroïnes de fantaisie n’ont entre elles que cette ressemblance de rejeter tout surnaturel et aussi à peu près tout ce qu’ont dit les témoins contemporains de la Pucelle. À part ce point commun, elles n’ont rien qui permette d’en faire une même personne ; celui-ci nous peint une druidesse, celui-là une échappée de la Salpêtrière ; d’autres en font une sorte de sœur maçonne, une de ces coureuses comme en produit la secte, ou bien une simple folle…
Il compare l’œuvre de compilation du père Ayroles, avec la Recollectio de Jean Bréhal, l’inquisiteur chargé par les juges de la réhabilitation de compiler l’ensemble des documents versés au procès.
Le P. Ayroles, dont la recollectio est autrement considérable et complète que celle de Bréhal, sera le vrai rapporteur de la canonisation ; plusieurs évêques le lui ont dit.
Voir : Comptes-rendus de Desplagnes
Source : Revue catholique des institutions et du droit, 22e année, 1er semestre (janvier-juin 1894), 2e série, 12e volume, p. 289-310.
Lien : Gallica
289La Vraie Jeanne d’Arc : La Paysanne et l’Inspirée (Jeanne d’Arc à Domrémy)
À notre époque où il y a tant de questions graves, il en est une qui a une importance toute spéciale, toute catholique et, plus encore, toute française : c’est la question de la véritable histoire de Jeanne d’Arc. On semble énoncer un paradoxe en disant que cette histoire est peu connue. C’est pourtant vrai, bien que nulle histoire au monde ne repose sur de pareils documents, aussi explicites, aussi nombreux, aussi complets, aussi concordants et présentant une certitude aussi absolue. Cette ignorance est telle qu’un savant théologien, un prêtre érudit, publiciste remarquable s’il en est, a pu écrire récemment que toute la vie de Jeanne est enveloppée d’obscurités
, alors au contraire que nul personnage historique, ancien ou moderne, n’a sa vie publique et privée révélée d’une façon aussi claire, aussi complète et par des documents aussi authentiques que la libératrice de la France.
290L’importance de l’histoire de Jeanne n’est pas comprise assez généralement, et bien des catholiques même n’y voient qu’une épopée brillante et poétique, quelque chose comme une Iliade ou une Énéide française, un poème admirable pour des rhétoriciens, et rien de plus. Il y a là un grand aveuglement. On n’en est plus, malheureusement, à compter les aveugles, aujourd’hui.
Oui certes ! cette histoire est un grand poème national. Mais elle est bien plus encore une admirable réalité, et des plus tangibles, puisque sans elle il n’y aurait plus de France depuis près de cinq siècles. Mais son importance n’est pas toute dans un résultat passé et acquis, bien que ce résultat soit le plus considérable, à coup sûr, de toutes nos annales. Il s’agit de savoir, aujourd’hui plus que jamais, à quelle cause vraie est dû ce résultat. Si la France est restée une nation indépendante et qui a connu la grandeur, à qui le doit-elle ? Est-ce à l’action naturelle de l’enthousiasme d’une bergère, à l’ardeur qu’elle a su inspirer à un peuple vaincu et conquis, pour chasser ou exterminer ses vainqueurs ? ou bien est-ce à l’intervention surnaturelle de Dieu lui-même qui, pour sauver un peuple sur lequel il avait des vues, a suscité et employé un instrument d’une éclatante faiblesse, auquel il a communiqué sa puissance irrésistible ? La question est entre ces deux extrêmes, mais la solution ne saurait être entre deux. C’est l’un ou l’autre, et, à cet égard, il n’y a pas de divergence entre les opinions les plus diverses. Ou la paysanne ignorante de Domrémy a été, à dix-sept ans, une femme de facultés naturelles hors de pair, et tout à la fois un général incomparable, un homme d’État dépassant tous les autres, un théologien capable de confondre les sommités du clergé de son temps, un politique tenant la première place dans une cour et dans les conseils du roi, ou bien cette enfant, qui ne savait même pas lire et ne connaissait que ses prières, a été armée par Dieu d’une force surnaturelle à laquelle généraux, armées, hommes 291d’État, théologiens, politiques et rois n’ont pu résister. De son temps, nul ne s’y est trompé, et la pensée que Jeanne agissait par sa seule force n’est venue à personne. L’Église de son époque a vu dans sa vie une mission surnaturelle et l’action de Dieu ; les hérétiques et tortionnaires de Rouen l’ont accusée d’invoquer le démon et de lui obéir.
Est-ce donc, pour un peuple dans la situation où nous sommes, une question accessoire et sans intérêt que celle de savoir si, dans un danger précédent, nous avons été sauvés par l’action fortuite d’une fille de génie ou par l’intervention personnelle de Dieu ?
Cette question est-elle indifférente à la France ? Est-elle sans importance pour l’Église ?
L’Église a commencé, le 27 janvier 1894, à répondre à ce doute plus qu’étrange dans la pensée d’un Français.
Si Dieu a voulu, en 1429, sauver la France, est-il possible de penser que la France de 1894 lui est devenue indifférente et qu’il n’y a rien à tenter ni à espérer de ce côté ?
Comprend-on la gravité et l’importance pratique de la question de Jeanne d’Arc ?
Mais ne considérons que le patriotisme simplement humain, la préoccupation de tout Français qui a quelque connaissance de notre histoire, de nos conditions sociales et politiques, quelque souci de notre avenir ; est-ce que la question de Jeanne d’Arc n’est pas, à ce seul point de vue politique, la plus étrange, la plus considérable par ses résultats, la plus intéressante aussi que puisse étudier un penseur,un historien, un homme d’État ?
Je ne crois pas qu’il existe un doute sur ce point.
Tout devait être extraordinaire pour la vierge de Domrémy, soit pendant sa courte carrière, soit après sa mort.
Pendant les deux années de sa vie publique, les documents les plus complets, les plus précieux et les plus rares se sont accumulés pour constater ses actes. 292Des évêques, des religieux, des hommes politiques écrivent des volumes sur la Pucelle. À Poitiers et à Chinon, on rédige des procès-verbaux considérables constatant ses réponses aux théologiens. À Rouen on compose un dossier criminel d’une rare étendue. Vingt-cinq ans après son martyre, on dresse un nouveau dossier contenant les témoignages de tous les hommes principaux qui l’ont connue, et, sur les pièces de ce dossier, on annule une condamnation dont l’infamie n’atteint que ceux qui l’avaient prononcée. Puis, au moment même où la France était reconstituée et renaissait entière de ses cendres, le souvenir et le nom de celle qui l’avait ressuscitée disparaissaient, comme oubliés de ceux même qui l’avaient vue ! Et pendant quatre siècles nul ne parle des documents sans pareils qui dormaient dans la poussière de nos archives. On fait sans cloute quelques histoires de la Pucelle, mais ce sont des récits plus ou moins fantaisistes, ne ressemblant que de loin à la réalité. On en vient à Voltaire, ce roi d’une nation déchue, qui outrage d’une manière immonde la Vierge libératrice et se voit acclamé par la fange et l’ordure de plusieurs générations !
Et avant l’oubli de la France, il faut noter l’oubli bien plus étrange, l’ingratitude bien plus criante de nos rois.
Peut-on, je ne dis pas excuser, mais comprendre l’ingratitude, presque l’oubli complet de Charles VII, qui avait été le témoin quotidien, en partie l’instrument, et surtout le bénéficiaire de pareils miracles ? Comment Charles VII le Victorieux, le souverain d’une nation reconquise, ne s’est-il pas souvenu du misérable dauphin de 1422 à 1429 qui manquait de tout ? Ce prince a été cependant fort longtemps religieux et bon. Qu’a-t-il fait pour celle qui l’avait sauvée ? A-t-il seulement tenté de l’arracher à ses indignes geôliers, voyant bien pourtant qu’ils allaient être ses bourreaux ? Il s’est contenté, vingt-cinq ans plus tard, de provoquer sa réhabilitation. Et Louis XI, qui bien jeune avait vu la Pucelle et avait été témoin de la 293résurrection nationale, qu’a-t-il fait pour la libératrice ou sa mémoire ? Il a créé l’ordre de Saint-Michel. C’est peu.
Et les autres Valois ? Qu’ont fait pour Jeanne ces rois à qui elle avait rendu leur couronne ? Qu’ont fait les descendants du duc d’Orléans et du comte d’Angoulême que la Pucelle aimait tant et qu’elle voulait tirer des prisons de Londres ? Qu’ont fait les Bourbons, dont les ancêtres étaient dans l’armée de Jeanne ? Quel monument ont-ils élevé à sa mémoire ? Comment ont-ils défendu son nom contre l’oubli d’abord, plus tard contre d’infâmes outrages ? Est-ce que leur devoir n’était pas au moins de faire connaître à la France entière les documents de Poitiers, de Rouen, du procès de réhabilitation ? Ils ont laissé égarer, perdre peut-être sans retour le dossier de Poitiers. Cette publication était un devoir pour la royauté rétablie dans ses droits par la Pucelle. Mais sa dette était plus étendue, croyons-nous. Charles VII devait instituer une commission d’enquête spéciale chargée de consigner jour par jour l’histoire merveilleuse de la vierge que Dieu lui avait envoyée pour le sauver, lui et la France. Il devait faire composer et écrire sur des feuilles d’or la biographie de cet ange, dont lui plus que tous autres savait la mission divine. Le nom de la libératrice n’était-il pas le plus brillant joyau de sa couronne ? Il me semble qu’un roi dépossédé, à qui Dieu lui-même fait rendre son royaume, peut inscrire ce miracle dans ses fastes et en établir pour les générations futures un monument impérissable.
Il n’a rien fait, et son successeur pas plus que lui.
Il a fallu attendre quatre siècles qu’un professeur eût l’idée de publier les documents nationaux du double procès. Et si Quicherat n’eût pas eu cette pensée, en 1840, combien de siècles faudrait-il attendre encore la révélation de cette histoire que tout Français devrait, depuis 1431, apprendre sur les genoux d’une mère, comme l’Histoire Sainte ?
Depuis 1840, un mouvement énergique s’est produit 294quand on a eu la révélation de faits si merveilleux. Et alors un combat s’est engagé entre la vérité religieuse et la libre-pensée. Les vrais Français ont montré Jeanne recevant et accomplissant sa mission divine ; les libres-penseurs ont voulu faire d’elle une femme enthousiaste, hallucinée, une druidesse, une sorte de folle de génie, en tout cas étrangère à toute action surnaturelle. Quicherat lui-même, ne pouvant se résoudre à voir Dieu dans des actes que lui seul avait pourtant la puissance d’accomplir, a tenté de réduire à néant les documents qu’il avait révélés au public. On n’a pas idée de tous les efforts qu’ont faits les libres-penseurs et écrivains anticatholiques pour expliquer humainement la vie et les exploits de la Pucelle, pour en rejeter tout surnaturel, toute intervention divine. Ils ont entassé Pélion sur Ossa, divagations sur contradictions, mensonges sur folies ; c’est une rage qui est réellement grotesque lorsqu’on veut examiner quelque peu les écrits de ces malheureux sectaires.
Voilà donc où en était naguère la science historique en ce qui concerne Jeanne d’Arc. Quelques histoires excellentes, en présence d’autres beaucoup plus accréditées dans le public et qui mentent avec impudeur sur ce point capital de nos annales.
À côté de ces livres luttant, les uns pour la vérité, les autres pour le mensonge, un mouvement puissant et général dans les esprits s’est révélé il y a quelques années, depuis que la France voit où elle est tombée et quel est son malheur. Il semble que la France de 1870 et années suivantes s’est souvenue de la France de 1429, et que ne trouvant aucun sauveur, ni aucun moyen de salut dans ces si tristes vingt dernières années, elle s’est tournée d’instinct vers celle qui l’a sauvée il y a bientôt cinq siècles et qu’elle sait si glorieuse et si puissante.
Depuis quinze à vingt ans surtout, nous assistons à un réveil merveilleux. Partout on invoque la Libératrice ; partout on recherche les moindres traces de sa vie et l’on étudie tout ce qui la touche : les pèlerins se 295pressent plus nombreux et plus religieux à Domrémy et Vaucouleurs ; des publications incessantes, des livres, des journaux, des revues célèbrent cette existence angélique et jettent ce nom béni à tous les vents du ciel, à tous les villages de la patrie ; des évêques ont sollicité sa béatification, les catholiques de toutes les parties du monde l’implorent et l’attendent. Enfin, Rome vient de parler, et déclarant Jeanne Vénérable, nous annonce une grande Sainte et nous fait espérer une puissante Patronne pour la France ! Béni soit Léon XIII qui attache son nom à cet acte, si grand pour notre Patrie ! Et voilà que toute la jeunesse catholique de France s’est enrôlée sous la bannière de notre Sainte Sœur du Paradis ! Allez, jeunes gens, allez bravement refaire une armée à la Vierge guerrière ; comme elle vous serez invincibles, avec elle vous referez la France chrétienne, et plus heureux, plus sages que nos pères de 1430, vous accomplirez plus docilement, jusqu’au bout, la grande mission de salut qui rendra Dieu à notre Patrie, et notre Patrie au monde. Clovis, Saint Rémi, Jeanne d’Arc vont guider ce mouvement unanime de 1896, et la Noël du quatorzième centenaire vous verra, vous tous, jeunes chevaliers de la Pucelle, comme la brillante avant-garde de cette croisade, victorieuse des fléaux qui nous avaient perdus.
Ce rayon lumineux nous apparaît dans la nuit où est plongée la France, livrée pieds et poings liés au naturalisme maçonnique, souverain maître et seigneur de la Patrie de Jeanne. Le surnaturel n’existe pas, clament en triomphe nos maîtres actuels ! Le surnaturel est notre avenir, notre horizon et la seule solution de notre destinée, répondent les chrétiens !
Cette lutte est plus ardente, plus acharnée que partout ailleurs, autour du nom et de la bannière de Jeanne d’Arc.
II
[plan des cinq volumes de la Vraie Jeanne d’Arc]
C’est au plus fort du combat qu’est apparu un livre 296dont je sais l’immense valeur, et dont je veux exposer le plan, parce que pour tout homme sincère, il met fin à la lutte. Ce livre est le second volume du grand ouvrage du R. P. Ayroles la Vraie Jeanne d’Arc. Ce volume est intitulé : La Paysanne et l’Inspirée.
Le recueil composé par Quicherat en 1840, comprend le double procès de 1431 et de 1455, plus un certain nombre de chroniques, de procès-verbaux et de pièces diverses, toutes du XVe siècle. Ces documents sont plutôt entassés que coordonnés ; les procès-verbaux du procès suivent l’ordre des séances. Les cinq volumes sont un recueil assurément très précieux, mais confus et qu’il est fort difficile de consulter sur telle ou telle époque déterminée de la vie de Jeanne. Quicherat lui-même semble avoir peu connu ou bien oublié les pièces les plus importantes de sa publication, quand il a écrit ses Aperçus, où il émet des théories absolument contredites par les documents qu’il avait édités.
Le P. Ayroles a adopté un plan tout différent et dont les avantages sont évidents.
Le volume actuel est relatif uniquement aux dix-sept premières années de Jeanne, c’est-à-dire à sa vie à Domrémy, à Vaucouleurs, à Neufchâteau, jusqu’à son arrivée à Chinon. Sur cette période qui s’étend du 6 janvier 1412 au 6 mars 1429, l’auteur a exposé dans ce volume tous les documents qui peuvent la faire connaître : réponses de Jeanne au procès de Rouen, témoignages de ses compatriotes et chroniques du temps ; les volumes qui suivront embrasseront de même et uniquement, d’abord, la vie guerrière, puis la captivité et le martyre.
Le troisième volume (le prochain) contiendra les chroniques et documents importants relatifs à la vie guerrière, ainsi que la critique de ces pièces. Le tome quatrième donnera, sur cette même période les déclarations de Jeanne à Rouen et les si nombreux témoignages entendus au procès de réhabilitation. Le cinquième volume sera relatif au martyre.
297De la sorte on aura, par ordre chronologique, une histoire sans pareille de la Pucelle, puisque cette histoire sera composée, pour chaque période successive, de tous les documents principaux pouvant l’établir et de la discussion de ces pièces. Le lecteur aura ainsi sous les yeux le dossier complet de ce grand procès et pourra le juger lui-même. L’arrêt ne peut rester douteux.
Quant au volume précédent, paru il y a trois ans : La Pucelle devant l’Église de son temps, son objet spécial peut le faire classer, soit le premier, soit le dernier, puisqu’il contenait les œuvres des grands théologiens du temps de Jeanne qui discutaient sa vie et ses actes. C’était l’opinion de l’Église sur la mission extraordinaire et surnaturelle de la Pucelle.
L’auteur l’a publié le premier pour répondre avant tout à cette vieille et inepte objection que l’Église avait condamné Jeanne, et démontrer que l’Église, au contraire, l’avait exaltée dès son apparition, et que l’arrêt de Rouen n’était le fait que d’hérétiques et de traîtres à l’Église et à la France. Ce premier volume était tout spécial et a pu paraître un peu au-dessus de la portée du public ; il était nécessaire, ses documents sont de premier ordre et absolument indispensables.
Les volumes qui commencent actuellement sont exclusivement historiques, et leur ensemble constituera la seule histoire de Jeanne qui soit complète et indiscutable, puisque tous les documents, toutes les sources y seront intégralement reproduits ; ils sont à la portée de tous les esprits et de tous les lecteurs.
Quicherat donne ces documents en latin ou dans la langue du XVe siècle. Le P. Ayroles les donne d’abord en français, pour que la lecture soit accessible à chacun, puis il donne en latin ou dans le français de l’époque, c’est-à-dire dans le texte original, tous les passages principaux, et ceux qui peuvent prêter à quelque discussion ou difficulté. Il est impossible de faire un livre plus complet, soit pour le public, soit pour les érudits qui voudraient en discuter les éléments.
298Les cinq volumes de l’ouvrage du savant Jésuite contiendront près de trois fois plus de matières que celui de Quicherat.
Tel est le plan de l’ouvrage complet, venons à celui du volume actuel.
Ce volume est exclusivement relatif, je l’ai dit, aux dix-sept premières années de Jeanne, c’est-à-dire à sa vie privée, depuis sa naissance, 6 janvier 1412, jusqu’à son arrivée à Chinon, 6 mars 1429.
III
[plan détaillé du volume II]
J’ai lu et relu plusieurs fois ce volume *.
* Dans les donnes feuilles, que le très bienveillant auteur m’a fait envoyer pendant le tirage. Le volume a paru seulement le 19 mars.
Je n’hésite pas à penser et à dire que l’auteur a mis à exécution son plan d’une façon complète, saisissante et remarquable à tous égards.
Tout ce que Jeanne a dit d’elle-même et de ses premières années, tout ce que les contemporains et le quinzième siècle ont écrit ou témoigné sur ces mêmes années de la Pucelle, est reproduit dans l’ordre chronologique, discuté, commenté et expliqué. C’est la plus complète, on peut dire aussi la seule absolument véridique histoire des dix-sept premières années de celle que Saint Michel a nommée Fille de Dieu
.
Pour qu’on puisse juger de l’étendue et de la valeur de ce travail, je résume les principales divisions de ce volume :
Livre I : La chrétienté, la France et la Lorraine de 1400 à 1429.
- Les déchirements de la France pendant cette période.
- Charles VII, son impuissance, sa détresse, sa moralité.
- Misère effroyable des peuples.
- 299Domrémy, Vaucouleurs, Neufchâteau, alors et aujourd’hui.
Livre II : Jeanne, d’après ses déclarations de Rouen.
- Sa vie extérieure à Domrémy ; incidents divers ; son éducation humaine et sa formation angélique ; Saint-Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite.
- Les Voix.
- Voyages à Neufchâteau, à Vaucouleurs, à Nancy, à Saint-Nicolas. Départ pour Chinon.
Livre III : Jeanne, d’après les témoins oculaires.
- Enquête pontificale à Domrémy.
- Déclarations de ses parrains, marraines et alliés spirituels ;
- id. des jeunes filles et jeunes gens de son âge ;
- id. des prêtres, des nobles et des bourgeois ;
- id. de ses guides à Chinon ;
- id. d’un haut personnage de la Cour.
Livre IV : La famille de la Pucelle.
- Nationalité de Jeanne.
- Les apparitions ; détails.
- Explications sur des faits particuliers. Maxey, Neufchâteau, Toul. Lieux marqués par le passage de la Pucelle. La maison de Domrémy. Notre-Dame-de-Bermont. Vaucouleurs, etc.
- La physionomie morale de la Pucelle.
Livres V et VI : La Pucelle travestie par la libre-pensée.
- Embarras de la libre-pensée.
- La Jeanne d’Arc de Michelet.
- La Pucelle rêvée par Quicherat.
- Henri Martin. — Vallet de Viriville.
- Siméon Luce ; sa Jeanne à Domrémy. Domrémy de 1420 à 1429. Saint Michel ; le Mont-Saint-Michel. Hypothèses absurdes et monstrueuses. Dominicains et Franciscains. Le saint nom de Jésus. Quelques impiétés du livre de M. Luce.
- Conclusions.
Livres VII : Pièces justificatives.
Tables.
300On peut résumer l’objet entier du volume sous ces trois titres :
- Histoire authentique et juridique de Jeanne, de 1412 au 6 mars 1429 ;
- Réfutation des erreurs de ses historiens ;
- Documents originaux relatifs à cette période de sa vie.
J’ai indiqué simplement les grandes divisions. La table complète pourrait seule donner un aperçu exact de ce travail de Bénédictin. Maintenant, je veux essayer de le juger.
La première partie (Livre I) expose dans une série de chapitres la triste situation de la chrétienté et l’effroyable état de la France au commencement du XVe siècle. Ces 95 pages sont un tableau historique de très grande valeur et qui résume de très nombreux documents. Je n’ai rien lu qui fasse connaître aussi bien le temps où Jeanne est née et grandissait, obscure paysanne, élevée par les Saints du Paradis pour relever le royaume de Saint Louis. Ce livre fait penser et l’on cherche spontanément à comparer ce temps au nôtre, avec lequel il a plusieurs traits communs. Les tableaux si détaillés, si variés du P. Ayroles, sont néanmoins coordonnés avec un talent bien rare, de façon que l’ensemble ressorte d’une façon saisissante. Tout est bien réellement perdu, en 1429, lorsque Dieu se montre en suscitant cette paysanne de 17 ans qui s’en va résolument, en son nom, remettre sur son trône un roi vaincu et dépossédé, en présence de l’armée des envahisseurs victorieux.
La situation matérielle de la France était pire que la nôtre. Mais il restait une ressource morale : on croyait en Dieu, et si les mœurs avaient souffert, la foi était debout.
La description soit de la France conquise, soit du petit coin de terre ou naquit notre libératrice, est, à elle seule, un livre achevé, des plus intéressants et qui fait exactement connaître au lecteur le milieu où vont se passer tant d’événements merveilleux. On y remarquera 301la précision avec laquelle est rendu le vrai caractère de Charles VII, a l’époque de la Pucelle. Le malheureux roi a été, pour ce temps du moins, calomnié au point de vue moral. Ses désordres n’ont commencé que plus de dix ans après la mort de Jeanne ; en 1430, Agnès Sorel ne pouvait avoir que 8 à 10 ans. L’auteur démontre bien d’autres erreurs d’historiens plus ou moins en crédit.
Le livre II contient tout ce que Jeanne a dit de sa vie à Domrémy ; c’est l’extrait parte in qua du procès de Rouen ; il n’est pas une ligne qui n’ait sa valeur.
Le livre III comprend les déclarations de 34 témoins, relatives aux 17 années de Domrémy et de Vaucouleurs. Quel ravissant portrait de jeune fille ! tous ces témoins l’ont vue, connue, aimée. Rien n’est plus beau, plus pur, plus virginal que cette âme choisie par Dieu pour nous donner une libératrice sur la terre, une protectrice dans le ciel. Quel est le héros, quelle est la femme célèbre, et on peut dire quelle est la Sainte dont l’histoire ait pu avoir le portrait ainsi buriné par tant de contemporains ? Sur quel personnage illustre avons-nous des documents aussi détaillés, aussi précis, aussi absolument certains ? Il reste, le croirait-on, des esprits qui trouvent obscure l’histoire de Jeanne ! Et nous entendrons plus tard autant d’autres témoins nous rapportant de visu ce que fût la guerrière, comme ceux-ci nous disent ce que fut la jeune paysanne inspirée. Avec quel charme ces témoins nous mènent, à la suite de Jeanne, dans ces chemins, ces prés, ces bois de l’humble village qu’elle a illustré ! Comme on la suit bien sur ces collines, dans ces champs où elle travaillait, dans les Églises où elle priait chaque jour, clans cette délicieuse solitude de Bermont, où pendant des années elle allait une ou deux fois par semaine s’agenouiller devant la Vierge ! Je l’ai vu aussi, moi-même, cet antique oratoire et j’ai vénéré la statue et le crucifix qui furent témoins des prières de la Pucelle. Je n’oublierai jamais ce sanctuaire,et en relisant les déclarations de tant de témoins qui ont vu Jeanne à Bermont, le souvenir 302de ce lieu béni me donnait l’illusion de l’y avoir vue comme eux. Mais en vérité, son âme n’y est-elle pas souvent présente ? Ces nombreux témoignages sont tous d’une grande importance ; il faut signaler particulièrement ceux des ecclésiastiques, de Jean de Metz et de Bertrand de Poulengy. Cette dernière déclaration a une gravité sans pareille ; elle fait connaître que dès son premier voyage à Vaucouleurs, vers l’Ascension de 1428, Jeanne a révélé à Robert de Baudricourt non seulement ce qu’elle ferait dix mois plus tard pour Charles VII, mais la constitution divine de la France, qui regarde le Roi du ciel et non le Dauphin, mais que le Dauphin est désigné pour tenir en commende
. Moins d’un an après, Jeanne redira à Charles VII cette même condition essentielle de son pouvoir, et Charles VII en reconnaîtra authentiquement l’exactitude.
Si Charles VII et ses successeurs étaient restés les lieutenants du Roi du ciel, nous serions encore, à cette heure, gouvernés par un fils de Saint Louis au lieu de l’être par la Franc-Maçonnerie, et le royaume de France serait à la tête des nations de l’Univers. L’oubli de leur mission par les rois, leur césarisme païen, les scandales de plusieurs d’entre eux ont amené nos malheurs, les guerres de religion, l’invasion du protestantisme, le philosophisme athée, la Révolution, le siècle révolutionnaire où la France agonise.
Si Louis XI, Louis XII, François Ier Henri IV, Louis XIV et Louis XV avaient été résolument les lieutenants du Roi du ciel, nulle nation au monde n’approcherait de la gloire, de la paix, de la grandeur de la France, à l’heure où nous sommes. Voyez où la France en est, et comparez, si votre cœur de Français en a le courage !
Je ne doute pas qu’au volume suivant le P. Ayroles ne nous donne sur ce point des explications du plus haut intérêt. Ce sera le moment lorsqu’il rapportera ce que Jeanne en a dit au roi. Les historiens libéraux, ou pires, semblent ignorer ce fait, qui pourtant ne les gêne pas, eux qui ne croient pas à l’inspiration divine 303de la Pucelle et peuvent prétendre qu’elle a été hallucinée pour cela comme pour le reste. Pour tout catholique qui y croit, il y a là un des points les plus graves de notre histoire, une des lumières les plus éclatantes pour notre situation, pour nos malheurs, et aussi pour notre avenir.
Le livre IV donne des documents complémentaires d’une valeur essentielle sur l’histoire de Jeanne, sa famille, sa nationalité, et sur tous les lieux où elle a résidé ou passé pendant ses 17 premières années. On trouvera là des renseignements précis sur Domrémy, la maison, l’église de Jeanne, le bois chenu et enfin sur l’oratoire de Bermont, le plus cher à Jeanne et celui où l’on retrouve si bien sa trace.
Un fait qui ressort de tous les documents de l’époque est d’un caractère bien significatif. Toutes les sources contemporaines qui nous donnent l’histoire de la Pucelle sont entre elles d’une concordance complète. Les déclarations de Jeanne, les témoignages si nombreux que reproduit le P. Ayroles, tous les autres documents qu’il donne de même, ne contiennent rien qui les mette en opposition les uns avec les autres. Nulle contradiction n’existe entre eux, et le même fait est, au contraire, souvent confirmé par tous à la fois. Je ne sais quel autre fait historique, raconté par trente à quarante annalistes ne change pas autant de fois de caractère et de physionomie,non seulement dans ses détails, mais dans ses lignes principales et quant au fond. Pour la Pucelle, il y a accord complet, concordance absolue entre toutes les sources. Ce n’est pas une des moindres merveilles de cette histoire si merveilleuse.
Les livres V et VI sont consacrés à la critique des histoires de Jeanne faites par la libre-pensée. La vérité s’établit non seulement par l’exposition des faits vrais, mais plus encore peut-être par la réfutation des erreurs et des mensonges. Il ne faut jamais oublier ce principe, qui est essentiel dans la plupart des choses humaines. L’auteur expose les théories émises 304par Michelet, Quicherat, Vallet, Henri Martin et surtout Siméon Luce qui a écrit spécialement une histoire de Jeanne à Domrémy. Les 142 pages consacrées à cette critique sont le complément le plus nécessaire des livres précédents qui contiennent l’histoire vraie de la Pucelle.
Le public, on peut le dire, ignore généralement les élucubrations de ces écrivains, mais des milieux plus ou moins lettrés en ont fait leur vade mecum, leur guide pour tout ce qui concerne Jeanne. Or, le vrai, l’incontestable est que les ouvrages désignés par le P. Ayroles sont tantôt ce qu’il y a de plus étrange et de plus absurde, tantôt ce qu’il y a de plus faux, de plus contraire à la réalité la plus authentique, souvent de plus irréligieux. On voit plus d’une fois ces écrivains, pour faire accepter leurs mensonges ou leurs impiétés, recourir au procédé de Renan et délayer leurs audaces dans des pathos romanesques et creux, que nul ne peut comprendre, mais devant lesquels se pâment les névrosés mâles et femelles de nos temps et qu’ils déclarent adorables. Ces stupidités calculées passent souvent pour le dernier mot de la science historique, de la sentimentalité et du haut style. C’est là qu’a mené la littérature lubrique et pourrie de tant d’écrivains à la mode.
La critique du P. Ayroles porte toujours avec une précision et une justesse remarquables. Tout lecteur sincère aura peine à comprendre comment quelque crédit a pu rester aux auteurs de ces étranges inventions. Il est vrai de dire que Henri Martin est complètement démodé et que Michelet n’est plus guère considéré que comme un romancier. Les derniers livres de celui qui traitait Jeanne d’hallucinée révèlent chez le triste auteur un délire sénile, hystérique, où Vénus jouait le grand rôle, comme dans les dernières productions de Renan. Quant à Quicherat, ses Aperçus ont ce sort singulier d’être mis à néant par sa publication antérieure du double-procès. Ce pauvre brave homme a eu peur du surnaturel qu’il avait 305évoqué malgré lui, et il a essayé de mettre la lumière sous le boisseau. Mais la lumière a tout percé et Quicherat reste avec sa sotte tentative. Toutefois, il ne faut pas oublier l’immense service qu’il a rendu en publiant, lui le premier, le double-procès
et les autres documents de son grand ouvrage.
Vallet est le moins connu de tous ces fantaisistes. Mais le livre récent de Siméon Luce avait trouvé une grande faveur et surpris bien des catholiques qui sans doute l’avaient lu à moitié.
Le P. Ayroles montre avec une évidence irréfutable les erreurs, les absurdités et aussi les dangers et l’impiété de ces livres. Il ajoute à ses démonstrations sans réplique un esprit des plus fins, ce qui ne gâte jamais rien, et quand il y a lieu, il exécute les sectaires avec une verve et une raillerie gauloise que leurs hypocrisies ou leurs mensonges ont largement méritées. On ne peut retenir son indignation en constatant certains procédés littéraires, et enlisant certaines phrases que le P. Ayroles a fustigés et flétris comme il le fallait.
On est heureux de voir la volée de bois vert si bien et si justement administrée par l’auteur à ceux qui l’ont incontestablement méritée, notamment à ce maître à l’intuition profonde et au professeur à la méthode rigoureuse
. Leur intuition et leur méthode ne s’en relèveront pas.
Je dirais volontiers que l’auteur a eu plus d’une fois de l’indulgence pour des erreurs où éclatent l’hypocrisie et la mauvaise foi. Mais je sais beaucoup d’esprit aimant à nager entre deux eaux et à s’abreuver de ces affreuses drogues où quelques lambeaux de vérité flottent dans une large coupe de mensonges empoisonnés. Il faut ces breuvages à nos étiolés fin-de-siècle. Ces pauvres gens trouveront sans doute le P. Ayroles sévère, parce que pour eux un chat n’est plus un chat et que souvent un fripon est un gentleman charmant. On ne se figure pas le nombre de jolis messieurs et de petites dames pour lesquels Renan est un idéal de poésie, de cœur, de sentiment, de génie et de pureté !
306Le public n’a pas idée de l’embarras où se trouvent les écrivains libres-penseurs en face de la Pucelle. Le miracle, le surnaturel les aveuglent, les écrasent, et ils se livrent aux contorsions les plus grotesques pour en sortir. On pense toujours à quelque démon plongé dans l’eau bénite, et si ce n’était vraiment triste de voir la misérable créature se révolter aussi impudemment contre son créateur et aller jusqu’à nier son existence ou son pouvoir sans bornes, on rirait volontiers de telle ou telle phrase de M. Luce, de M. Quicherat et autres cabrioleurs littéraires qui emploient leur petit bagage scientifique à tenter d’escamoter le surnaturel pour montrer à sa place, au bon public ignorant ou ahuri, une pauvre névrosée, une hallucinée, une folle de leur invention, qui n’a jamais existé et qui fait peu d’honneur à leur talent.
Le plus curieux de l’affaire, c’est que chacun de ces beaux esprits a fait une Jeanne différente. Ces héroïnes de fantaisie n’ont entre elles que cette ressemblance de rejeter tout surnaturel et aussi à peu près tout ce qu’ont dit les témoins contemporains de la Pucelle. À part ce point commun, elles n’ont rien qui permette d’en faire une même personne ; celui-ci nous peint une druidesse, celui-là une échappée de la Salpêtrière ; d’autres en font une sorte de sœur maçonne, une de ces coureuses comme en produit la secte, ou bien une simple folle… Les types varient suivant les fantaisies de ces rêves-creux, de ces fiévreux, de ces enragés contre le surnaturel, si bien que le naïf qui cherche dans les productions surchauffées de l’école naturaliste l’histoire et le portrait de la Pucelle, y trouve quatre ou cinq Jeannes différentes, se contredisant toutes entre elles et n’ayant rien de commun avec les documents authentiques laissés par l’histoire.
Le P. Ayroles a terminé son volume par une série de pièces justificatives pleines d’intérêt et par une table des plus détaillées, reproduisant tous les sommaires des chapitres, ce qui permet de trouver immédiatement 307ce qu’on cherche. Les documents en vieux français ou en latin du XVe siècle, soit au bas des pages, soit à la fin du volume, aident beaucoup pour reproduire la physionomie de l’époque.
Le livre du savant jésuite a cette supériorité essentielle sur les meilleurs déjà parus, qu’il est le premier ouvrage contradictoire sur les dix-sept premières années de la Pucelle. On a dans ce volume le dossier complet de l’affaire, tous les documents connus, toutes les sources de cette histoire. Le lecteur juge donc le procès lui-même.
De tous ces documents, de tous ces monuments incontestés de son temps, la Pucelle sort radieuse et pure comme une splendide étoile. Il sera impossible désormais de prétendre que Jeanne est enveloppée d’obscurité et que son histoire est restée comme une légende nébuleuse où l’on peut voir ce qu’on veut. Rien n’est au contraire plus clair, plus précis que la biographie et le portrait de celle que plus de cent témoins ont vue et connue et sur laquelle leurs témoignages sont d’une entière concordance. Que les sectaires continuent à inventer et à mentir, c’est leur métier. Mais un esprit sincère ne peut plus refuser de voir une aussi éclatante vérité.
Quand on compare à la Jeanne d’Arc véritable, historique, telle qu’elle nous est montrée par les unanimes déclarations de ses contemporains, la fille hallucinée, insensée, impossible, qu’ont imaginée les écrivains rejetant le surnaturel, on se demande si ces écrivains sont fous ou s’ils prennent leurs lecteurs pour des idiots, en prétendant leur donner pour un personnage réel le produit absurde de leur imagination et de leur rage antireligieuse.
Mais alors, diront les Prudhomme du scepticisme actuel, mais alors le surnaturel est donc vrai !… Mais la science ! la science !…
Oui, le surnaturel est tout ce qu’il y a de plus vrai, et la France a ce privilège d’en fournir une preuve éclatante par le fait le plus remarquable, par le plus illustre personnage de toute son histoire.
308Ce livre du Père Ayroles était le plus indispensable monument à élever à la plus grande des Françaises.
Je ne saurais assez dire quelle satisfaction sans mélange on éprouve en lisant cet incomparable dossier ; on se sent en pleine lumière, en pleine vérité. Le jour éclate de toutes parts, et quand on a fini cet exposé, on sent qu’on est vraiment en présence d’une admirable apparition céleste, d’une vierge pure et sainte, d’une enfant sans tache aux faibles mains de qui le Christ a remis un rayon de sa puissance et de sa gloire en lui disant : Va, fille de Dieu, et sauve en mon nom ce royaume, qui est le mien !
Toute l’histoire de Jeanne est dans ces quelques mots. Et Dieu ajoutera le martyre, pour que le témoignage de son envoyée soit plus glorieux encore. Comment ne voit-on pas que le Christ préparait ainsi à la France non seulement une libératrice pour 1429, mais une patronne sans pareille pour tous les siècles à venir ?
La France coupable ou aveugle l’avait oubliée. Elle s’en est souvenue après de nouveaux malheurs, et l’Église a commencé de tresser la couronne qui doit briller sur le front de notre chère sainte.
À ce diadème splendide que la France verra bientôt, je l’espère, ont travaillé depuis près de cinq siècles des Évêques, des Religieux de tous les Ordres, des Cardinaux, des Papes : les d’Estouteville, les Bréhal, les Pontanus, les Lellis, les Ciboule, les Montigny, les Basin, les Bourdeilles, les Machet, les Gorkum, les Chartier, les Berruyer, les Bochard de Vaucelles, les Gélu, les Gerson, les Longueil, les Bouillé, les Juvénal des Ursins, Pie II, Nicolas V, Calixte III, Léon XIII, des inconnus enfin, de Rome et de Spire, dont les écrits ont traversé les siècles sans nous apporter leurs noms. Il semble que l’Église universelle, par les voix de ses représentants, ait voulu préparer ce triomphe. L’ordre de Saint-Dominique, l’ordre séraphique, celui de Saint-Benoît, les Augustins, les Carmes, les fils de Saint Ignace y ont travaillé comme les Pie, les Dupanloup, les Freppel, les Coullié, les Langénieux 309et les centaines de prêtres et de laïques qui attendent avec impatience et confiance de voir briller au ciel la plus belle étoile de notre patrie.
Avec tous ces grands noms, et aussi bien que les plus vaillants, le Père Ayroles a travaillé à cette œuvre si française. Il y a apporté une des plus belles pierres, je devrais dire un joyau inestimable. Son ouvrage devra être classé à côté du mémoire de Bréhal. Le grand dominicain a résumé, au XVe siècle, tout ce qu’il fallait penser et dire de la martyre après le brigandage et les tortionnaires de Rouen. Le savant fils de Saint Ignace a commencé une somme théologique et historique, une sorte d’encyclopédie de Jeanne d’Arc, contenant tout ce qu’on en peut savoir, tout ce qu’on en doit penser après cinq siècles, au moment où l’auréole de la Sainte prend tout son éclat. Jean Bréhal fut l’âme de la réhabilitation. Le P. Ayroles, dont la recollectio est autrement considérable et complète que celle de Bréhal, sera le vrai rapporteur de la canonisation ; plusieurs évêques le lui ont dit. Son ouvrage portera l’arrêt définitif des générations sur notre sainte martyre, devenue la patronne de la France. Il sera le vrai livre, la grande histoire, le principal monument littéraire élevé à Jeanne d’Arc*.
* Il est bon de rectifier ici une erreur reproduite par tous les journaux et revues qui ont donné la traduction du décret du 27 janvier 1894, déclarant introduite la cause de la béatification. On fait naître Jeanne d’Arc le 6 février 1412. Or elle est née le 6 janvier 1412. Cette rectification était nécessaire, l’erreur existant dans le texte latin venant de Rome, et très probablement dans le texte original de la Congrégation.
Voilà dix ans que le P. Ayroles à commencé sa grande œuvre sur Jeanne. En 1885 il a commencé par Jeanne d’Arc sur les autels, livre qui était comme le résumé, le plan et aussi la conclusion de l’ouvrage détaillé et documenté qu’il méditait. À ce moment déjà, il voyait l’avenir s’ouvrir et apparaître à l’horizon l’astre si beau que Léon XIII semblait y appeler. 310Le P. Ayroles, dans ce premier volume (qu’on recherche aujourd’hui comme une nouveauté) nous montrait ce que serait pour la France Jeanne proclamée Sainte. L’Église a entendu ce vœu ; le livre de l’auteur reste comme la préface de la récente décision de Rome et de celles qui suivront.
Après ce livre préliminaire, le grand ouvrage a commencé, et nous en avons actuellement deux volumes.
Dieu permettra à son serviteur de terminer son œuvre. Il n’en est pas de plus nationale. Celui qui rend ce témoignage au vaillant, au savant, au cher et vénéré Religieux n’a jamais lu un livre avec l’entrain et la complète satisfaction qu’il a connus en lisant ces premiers volumes, il n’en a jamais attendu avec l’impatience qu’il a éprouvée à les attendre et qu’il éprouve à attendre les trois qui manquent encore.
Il ne comprend pas qu’un Français, si peu qu’il soit occupé des intérêts de la Patrie, n’ait pas ces livres, qui devraient être dans toutes les bibliothèques et que la France catholique devrait faire siens. Il y a des funérailles qu’on fait et qu’on doit faire au nom de la Patrie. Il y a des œuvres auxquelles la Patrie ou, à son défaut, les catholiques, devraient ouvrir bien larges les chemins de la vie. L’œuvre du P. Ayroles intéresse au premier chef la France catholique ; la patrie de Jeanne d’Arc ne devrait-elle pas faire pour elle les frais d’une entrée nationale dans le monde ?
Je reviendrai certainement sur cet ouvrage. J’ai voulu, dès que j’ai pu le connaître à fond, le signaler à tous les lecteurs de la Revue, à tous les Français. L’exécution matérielle est fort belle et luxueuse ; les caractères très nets. Le superbe volume est d’une lecture facile. On n’a rien épargné pour donner un vêtement digne de lui au plus beau livre qui ait été écrit sur Jeanne d’Arc à Domrémy.
A. Desplagnes, ancien magistral.
Le Monde 9 avril 1894
Compte-rendu fourni et élogieux de la Paysanne et l’inspirée (Vraie Jeanne d’Arc, t. II), par Henri Dac. Celui-ci relève essentiellement (et approuve) les attaques contre la libre-pensée et le naturalisme qui nie audacieusement le surnaturel
.
Avec une érudition consommée, avec une énergie extraordinaire, avec une fougue inlassable, il s’est jeté dans la mêlée des hommes et des idées ; il a vaillamment couru à l’ennemi, l’a provoqué au combat, l’a renversé à terre après une lutte inouïe, l’a piétiné et littéralement mis en pièces.
S’il apprécie le ton (le P. Ayroles n’a point ménagé Michelet ; il a eu raison
), il le juge trop sévère
contre Quicherat et trop violent
contre Siméon Luce, rangé à tort parmi les apôtres de la libre-pensée
.
Lien : Gallica
J’ai déjà eu l’occasion ici même de féliciter le R. P. Ayroles pour le premier volume de son grand ouvrage sur Jeanne d’Arc [édition du 16 juin 1890]. Il avait pour titre spécial : La Pucelle devant l’Église de son temps. Celui qui vient de paraître, consacré spécialement à la vie de la Pucelle à Domrémy et à Vaucouleurs jusqu’à son arrivée à Chinon, s’appelle : La paysanne et l’inspirée ; il est écrit d’après les aveux de Jeanne d’Arc et les témoins oculaires. Il sera suivi de trois autres volumes qui traiteront de la période guerrière et du martyre, en s’appuyant sur les chroniques de l’époque et les dépositions des témoins.
Exclusivement historiques, nous affirme l’auteur, ils ne seront que la plus complète et la plus véridique des histoires publiées sur la Pucelle qui en compte en si grand nombre et si peu qui nous donnent sa vraie figure. On y trouvera l’héroïne telle qu’elle s’est peinte elle-même et telle que l’ont vue ses contemporains. [Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. XII, But et plan.]
À en juger par les deux premiers volumes, c’est un labeur énorme qui ferait reculer plus d’un hardi écrivain. Mais rien ne peut effrayer le P. Ayroles qui a l’ardeur d’un chevalier et la patience d’un religieux. Il est décidé à consacrer tout ce qu’il plaira à Dieu de lui accorder de vie, après les longues années qu’il en a déjà obtenues pour ramasser des matériaux. L’œuvre est plus qu’à moitié faite. J’ai la conviction que l’auteur la mènera vaillamment à terme et qu’il pourra s’écrier, même avec un auteur profane : Exegi monumentum.
Comme je l’ai déjà dit, le sujet de Jeanne d’Arc est d’une perpétuelle actualité, car Jeanne d’Arc, c’est la France elle-même et qui peut se lasser chez nous d’entendre parler de la France ? J’ajoute que le décret pontifical du 27 janvier 1894 qui a introduit l’héroïne dans la voie sacrée au terme de laquelle se trouve une canonisation si attendue, a ravivé encore ce sujet. La prochaine fête religieuse, dont le vénérable cardinal archevêque de Paris a pris si noblement l’initiative et qui nous réunira tous sous les voûtes augustes de Notre-Dame pour y remercier Dieu et pour implorer ses bénédictions sur notre chère patrie en nous rangeant derrière la bannière de Jeanne d’Arc, cette fête, dont se réjouissent tous les chrétiens et tous les Français, donne encore une valeur nouvelle à tout ce qui nous parle de la Pucelle d’Orléans. Enfin le Parlement s’apprête également à transformer la célèbre date du 8 mai en une fête patriotique en l’honneur de celle qui délivra Orléans et la France. L’ouvrage du R. P. Ayroles arrive donc à son heure et je crois par conséquent qu’il est difficile de trouver un sujet plus à l’ordre du jour que celui-là.
Faisant le procès du naturalisme qui nie audacieusement le surnaturel, qui affirme que Dieu n’a point de commerce avec le monde et que l’histoire est vide de tout ce qui est divin, qui altère ou supprime tout ce qui est contraire à sa thèse, l’auteur rappelle que Dieu a contracté avec l’homme la plus sublime des alliances, qu’il prouve sa présence dans le monde par des faits en dehors de la nature, par la prophétie et par le miracle, par des faits d’un ordre surnaturel certifiés par des milliers de témoins. La Pucelle est un des plus éclatants exemples de cette manifestation de Dieu dans notre histoire. Si jamais la devise, Gesta Dei per Francos, a été vraie, c’est dans les faits et gestes de Jeanne d’Arc et de ceux qui l’ont écoutée et suivie.
C’est là ce qui étonne et irrite surtout le naturalisme. Chez la Pucelle d’Orléans, la trame de sa vie, le fond de son âme, l’intime de son être, tout nous a été révélé avec une abondance de preuves qu’on ne peut trouver chez aucun personnage historique. Une naïve jeune fille entourée de nombreux ennemis, menacée et torturée par eux, leur a tout dit. Ses réponses ont été recueillies mot à mot.
Elles nous sont arrivées, — dit le P. Ayroles, — avec les paraphes des greffiers. Personne qui ne rende hommage à leur accent de sincérité. Il est plus impossible encore de nier la réalisation des prophéties qu’elle y sème et que ses ennemis inscrivent. Vingt-cinq ans après sa mort, cent vingt témoins [… la citation se poursuit jusqu’à :] Où donc est le personnage, s’appelât-il, je ne dis pas Alexandre ou César, mais Louis XIV, Napoléon même, qui entre dans la postérité, porté par une semblable nuée de témoignages irréfragables ? [Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. VIII-IX, But et plan.]
Le R. P. Ayroles a raison de dire que c’est là une chose surnaturelle et qu’il faut renoncer à rien savoir du passé, si on nie la réalité des faits sans analogues qui sont l’histoire même de la Pucelle d’Orléans.
Aussi le but de l’auteur a-t-il été de permettre à tous d’étudier l’existence de Jeanne d’Arc dans ses détails et dans son ensemble, d’aborder toutes les questions qui la concernent et d’en donner la solution la mieux fondée, de mettre en face les objections du naturalisme et d’y répondre, de détruire ses inventions et de relever ses contradictions au point de vue de la raison. Le R. P. Ayroles n’y a point manqué. Avec une érudition consommée, avec une énergie extraordinaire, avec une fougue inlassable, il s’est jeté dans la mêlée des hommes et des idées ; il a vaillamment couru à l’ennemi, l’a provoqué au combat, l’a renversé à terre après une lutte inouïe, l’a piétiné et littéralement mis en pièces. Dans son ardeur impétueuse il a fait pleuvoir les coups sur toutes les têtes et il a quelquefois, avec une vaillance sincère, frappé d’estoc et de taille certains écrivains qui ne s’attendaient pas à recevoir d’aussi formidables horions. Mais on peut dire tout de suite que ceux qui méritaient d’être battus et combattus, l’ont été vigoureusement. L’auteur a suivi à la lettre, et il a bien fait,le conseil du cardinal Desprez :
À tout prix il faut arracher notre admirable Jeanne d’Arc au rationalisme et à la libre-pensée, il faut montrer en elle la vierge divinement envoyée à la France pour la préserver de la ruine et conserver à la défense de la foi la nation appelée si justement la Fille aînée de l’Église.
Dans le second volume qui nous occupe, l’auteur a montré la chrétienté, la France et la Lorraine durant les années obscures de la Pucelle, puis la paysanne et l’inspirée d’après ses propres aveux et d’après les attestations des témoins oculaires. Il a fait ensuite le procès de la libre-pensée qui cherche à exclure le surnaturel de la vie de Jeanne d’Arc, qui lui refuse l’équilibre de ses facultés mentales et la déclare atteinte de mystérieuses hallucinations. Il a attaqué et démoli de fond en comble cette thèse nouvelle qui veut que la libératrice de la France ait uniquement trouvé ses inspirations admirables et son prodigieux héroïsme dans un amour sans mesure de la patrie. Il a montré combien était pauvre et misérable cette hypothèse qui voudrait établir que sa conscience faussée lui faisait involontairement attribuer à des êtres en dehors d’elle ce qui sortait de son propre fond et n’était que le fruit de ses conceptions personnelles.
Depuis quand, — a-t-il dit avec une logique ardente, — l’hallucination donne-t-elle la vue nette de la solution des difficultés les plus inextricables, le courage pour entreprendre de les surmonter et les surmonter en réalité, l’ascendant pour se créer des auxiliaires, la constance pour poursuivre l’œuvre en dépit de l’abandon des intéressés et peut-être de leur trahison ? Qui ne sait que l’hallucination produit des effets diamétralement opposés, qu’elle est, alors surtout qu’elle est persévérante, toute infirmité pour l’esprit, toute faiblesse pour le cœur et un juste sujet de mépris de la part d’autrui ; qu’elle procède par soubresauts et sans suite et vient promptement se heurter aux réalités qui, pour être méconnues, n’en existent pas moins. [Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 342.]
Le R. P. Ayroles n’a point ménagé Michelet. Il a eu raison de convaincre de fausseté celui qui disait que Jeanne d’Arc créait et réalisait ses propres idées à son insu, qui appelait des légendes ce qui n’était que la vie des saints ou des récits sacrés, qui faisait de profondes convictions religieuses je ne sais quelles absurdes sentimentalités, qui ne voyait dans les visions de la Pucelle que des rêves et dans les victoires extraordinaires remportées par une envoyée de Dieu que le triomphe du bon sens, du bon sens élevé à la plus haute puissance
! L’auteur de la Vie de Jeanne d’Arc a fait justice des inventions romanesques de celui qu’on a fait passer pour le voyant de l’histoire. Il a dénoncé et réfuté une à une toutes ses faussetés et toutes ses fantaisies ; il a bien fait.
Quant à Quicherat, dont il relève justement certaines contradictions, je le trouve un peu trop ironique et un peu trop sévère pour le savant auquel nous devons les cinq beaux volumes du Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc, œuvre à l’érudition loyale de laquelle l’abbé Perreyve entre autres rendait un si juste hommage dans son célèbre discours de 1862. Quant à Henri Martin, je conviens sans peine que le R. P. Ayroles a eu raison de contester a figure étonnante qu’il a faite de Jeanne d’Arc. Je conviens que cette figure ainsi tracée a quelque chose d’anormal et d’excentrique et que c’est l’œuvre d’un visionnaire, qui écrit aussi mal qu’il voit, plutôt que celle d’un peintre d’histoire.
Arrivant à l’auteur de Jeanne d Arc à Domrémy, à M. Siméon Luce, le P. Ayroles l’accuse de laisser de côté le surnaturel et de substituer l’influence des milieux aux hallucinations de la libre-pensée. Il qualifie de fables et de fantaisies ses recherches critiques : il lui prête des intentions sournoises, des assertions fausses et de nombreuses impiétés. Il conteste sa science et il va jusqu’à s’écrier :
Quel romancier n’a pas de titres plus sérieux que ceux qu’il a exhibés ?
Il cherche entre les lignes et il y trouve autant d’insinuations et de blasphèmes cafards
. Enfin, il termine par ces mots :
Il est temps qu’aucun homme sérieux n’aille demander la connaissance de la Pucelle à ces trois cents pages de rhapsodies qui outragent la vérité historique, la raison et la foi !
Emporté par un zèle qui se comprend, l’auteur a tenu à défendre la Pucelle d’Orléans contre tous ceux qui, de près ou de loin, ont voulu ou ont, à leur insu, cherché à diminuer son auréole. Mais à mon avis, il a été beaucoup trop violent à l’égard de M. Siméon Luce, qui a pu commettre quelques erreurs de fait ou d’appréciation, mais qui ne l’a pas fait de parti pris. Il le range parmi les apôtres de la libre-pensée et je crois qu’il a tort. Il lui prête des intentions fausses et des réserves hypocrites que certainement cet honorable écrivain et ce savant de mérite n’a jamais eues. Je le dis, en toute liberté, sans crainte d’être accusé par le P. Ayroles, comme il le fait pour les écrivains catholiques (page 481), de vanter à tort certains livres et certains écrivains, de dissimuler leurs faussetés et leurs fantaisies pour s’attirer les faveurs de la renommée et les palmes de l’Institut
! Je ne crois pas que l’on pense et que l’on agisse ainsi parmi les écrivains catholiques. Lorsque ceux-ci ou ceux-là, songent à entrer dans les corps savants qui illustrent la France, ce n’est qu’à bon droit, et en se montrant dignes d’un tel honneur par leurs travaux et non par leurs flagorneries. Ils ne méritent vraiment pas qu’on accuse un seul d’entre eux de s’abaisser à des soumissions honteuses.
Ces réserves faites, je constate une fois de plus et de ma propre volonté, la valeur réelle de l’œuvre du R. P. Ayroles. J’en reconnais toute la solidité et je ne doute pas qu’avec quelques pierres de plus elle ne fasse un jour un véritable monument.
Henri Dac.
La Vérité 13 avril 1894
Compte-rendu de la Paysanne et l’inspirée (Vraie Jeanne d’Arc, t. II), par l’abbé V. Davin.
On se souvient des deux longs articles du même abbé sur le t. I, dans l’Univers des 17 et 20 octobre 1890.
Lien : Retronews
Voilà quatre ans que le R. P. Ayroles donnait le premier volume de la Vraie Jeanne d’Arc : La Pucelle devant l’Église de son temps, qu’un écrivain de la Civiltà Cattolica qualifiait de stupenda opera. Le vaillant écrivain publie le second volume de cet ouvrage aux vastes proportions. Ce volume est consacré à la vie de Jeanne d’Arc à Domrémy et à Vaucouleurs, jusqu’à l’arrivée à Chinon. Un troisième nous présentera la guerrière d’après les documents de l’époque ; un quatrième, d’après ses aveux au procès de condamnation et les dépositions des témoins au procès de réhabilitation. Un cinquième fera connaître la martyre d’après ses réponses et les témoins oculaires, en mettant en regard de la vérité historique les romans trop nombreux et trop accrédités de la libre-pensée.
Un tableau de la chrétienté, de la France, de la Lorraine durant les années obscures de la Pucelle, ouvre le second volume : tableau plus que navrant de ce quinzième siècle, appelé le tombeau des mœurs chrétiennes
! La France a été mise par Philippe le Bel dans la voie de ce manichéisme social — le mot est de Boniface VIII, dans la bulle Unam Sanctam : Sicut manichæus — que la croisade des Albigeois, terminée par saint Louis, a arrêté dans le Midi des Gaules, où Innocent III déclarait en 1198 que Manès comptait plus d’adorateurs que le Christ. Elle a fait, avec Charles V, trop mal appelé le Sage, le grand schisme d’Occident ; avec son Université de Paris, quittant saint Thomas pour Occam, elle a démocratisé l’Église à Constance ; et la papauté n’étant pas encore rassise sur son trône avec Martin V, elle l’a décapitée dès 1398 avec cette Pragmatique Sanction de Charles VI, dont la Pragmatique de Charles VII, les Quatre Articles de Bossuet et les Articles Organiques de Napoléon seront la trop indestructible descendance.
[S’en suit un résumé de l’ouvrage pleine de longues digressions.]
[…] Le lecteur trouvera mis en ordre dans le livre tous les textes fournis par la jeune fille et les témoins oculaires sur sa parenté, sa naissance, son éducation, sa pieuse jeunesse, son inspiration quinquennale à Domrémy et sur la route de Chinon. Le texte français de la minute du procès de condamnation de la Pucelle est au bas des pages contenant les citations en français moderne. Les dépositions des témoins conservées en latin dans le procès de révision sont au nombre de trente-quatre, données intégralement dans les pièces justificatives, offrant les plus importants des autres documents historiques. C’est, accompagnant le livre, un musée également précieux et commode. Une citation, entre cent, donnera l’idée de l’intérêt qui, pour les deux, attend le lecteur. Nous sommes à Chinon, où arrive celle que les saintes Catherine et Marguerite ont marquée d’un surnom immortel, Jeanne la Pucelle (la petite vierge, verginella).
Dunois, dans sa déposition, raconte qu’un jour, [… Jeanne en présence du roi, est interrogée sur ses voix.] Bien plus, continue Dunois, en répétant ces paroles, elle éprouvait de merveilleux tressaillements, et tenait les yeux levés vers le ciel. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 158.]
En regard de ce musée plein de choses divines, ravissantes, — et positives,— le R. P. Ayroles en expose un autre qui semble se rattacher, le lecteur me pardonne ! plutôt à la Salpêtrière ou à Charenton qu’au Collège de France ou aux autres lieux savants.
Pauvre Jeanne d’Arc, (dit Sainte-Beuve), des historiens distingués, Henri Martin et Michelet, lui doivent d’avoir fait des chapitres bien systématiques et un peu fous.
L’atténuation de Sainte-Beuve ayant été ainsi corrigée par Joseph Fabre :
Pour délirer comme Michelet, il faut du génie,
le P. Ayroles conclut logiquement :
L’un peu fous doit se traduire tout à fait fous. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 345.]
Née sous les murs mêmes de l’église, (dit Michelet qui prête à Jeanne son délire), bercée du son des cloches et nourrie de légendes, elle fut une légende elle-même, rapide et pure. De la naissance à la mort, elle fut une légende vivante… La jeune fille, à son insu, créait, pour ainsi parler, et réalisait ses propres idées, elle en faisait des êtres… Si poésie veut dire création, c’est sans doute la poésie suprême. [Michelet, Histoire de France, t. V, 1841, p. 53.]
Et Quicherat, à qui nous serons éternellement redevables d’avoir mis au jour, après quatre siècles du plus honteux ensevelissent, les Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc (1), de s’écrier dans ses Aperçus par trop nouveaux :
Michelet, dans les pages consacrées à la Pucelle, a surpassé les autres et s’est surpassé lui-même !
(1) Le P. Ayrolles a revu le texte de Quicherat sur les manuscrits, et y relève, p. 503-566, nombre de fautes dont plusieurs ont de l’importance. Il donne aussi les éléments de réfutation de Bossuet qui, dictant l’Histoire de France au Dauphin, lui a fait écrire deux assenions insoutenables : Cette fille nommée Jeanne d’Arc… avait été servante dans une hôtellerie et gardait ordinairement les moutons.
Je laisse les extravagances de Vallet de Viriville, professeur à cette école des Chartes dont Quicherat a été le directeur.
Siméon Luce, membre de l’institut, qui dans son volume Jeanne d’Arc à Domrémy, recherches critiques sur les origines de la mission de la Pucelle, contredit avec raison telle fantaisie historique de Michelet, fournit au P. Ayroles six chapitres et quatre-vingts pages sur ses fantaisies à lui-même. Le fond de cet écrivain, à qui les catholiques ont accordé trop de bienveillants est hélas ! ce que le P. Ayroles appelle franchement un athéisme idéalistique et cafard. A-t-il tort ? L’académicien ne nous dit-il pas que Jeanne entendait en quelque sorte des voix divines ; qu’elle sentait palpiter dans son sein, presque un Dieu, puisque c’était le génie de la France ; que toute sa vie et histoire fut un mystère de Dieu, dont les premiers plans dérobent au regard ce qui fait le fond du tableau, l’idéal, ou, pour nous conformer au langage ordinaire, le ciel ? Pauvre Jeanne d’Arc ! De supplice en supplice elle devait avoir à la fin, comme Jésus, son Renan.
Son histoire, triomphant désormais de toutes ces vapeurs agnostiques des cerveaux malsains, et s’imposant comme le soleil, aidera, nous n’en pouvons douter, au triomphe même de l’histoire évangélique. Palpable chez nous dans la plus étonnante résurrection nationale des annales humaines, le surnaturel divin, tant combattu, sera de plus en plus assuré et de plus en plus cher à la France. Dieu soit béni, qui a ménagé à nos jours, non moins désespérés que ceux du pitoyable roi de Bourges, l’inattendue et radieuse réapparition de l’image delà Libératrice ! L’Église vent de la proclamer Vénérable ; elle vient de nous la montrer par avance Bienheureuse et Sainte.
Léon XIII a écrit, le 21 février dernier, à l’institut catholique de Lyon :
Les prières que vous exprimez en vue d’obtenir que les honneurs de la sainteté soient décernés à cette admirable vierge qui, dans l’épreuve la plus critique de la patrie, fut l’instrument efficace du secours divin, répondent de tout point à Notre intime désir. Aussi ne négligerons-Nous aucun des soins compatibles avec la procédure si sage suivie par le Saint-Siège en ces délicates enquêtes, pour que le procès, déjà engagé, de la béatification de l’héroïque Pucelle soit mené à bonne fin. (Dans la Vérité du 17 mars.)
Si nous avons à subir, après l’avoir trop mérité, tel déluge des châtiments divins, tenons ferme l’espérance sous cette vision du retour de l’arc-en-ciel.
Que le fils de saint Ignace poursuive ainsi une nouvelle étape de son travail très utile dans le passé et très utile dans l’avenir : La Vraie Jeanne d’Arc.
Prions, pour nous, afin que l’ange : des saints combats, cette fille des champs qui, ne versant jamais d’autre sang que le sien, redressa la Fille aînée de l’Église oublieuse de sa vaillance comme de sa pureté, apprenne dès ce jour à l’Ennemi de Dieu et des hommes que saint Michel compte des soldats dans sa pauvre France !
L’abbé V. Davin.
Études 30 avril 1894
Comptes-rendus de deux livres par le père Ayroles : Étude sur Jeanne d’Arc du comte de Bourbon-Lignières ; Jeanne d’Arc vierge et martyre de l’abbé Fesch.
Ayroles fait l’éloge des deux ouvrages, — pensée de foi pour le premier, lecture saine et profitable pour le second, — quoiqu’ils ne présentent rien d’inédit. Il leur trouve toutefois à chacun un léger défaut :
Le comte de Bourbon-Lignières soutient une thèse désormais insoutenable
qui veut que la mission finisse à Reims, thèse qui rend Jeanne inintelligible et compromettrait sa canonisation. L’abbé Fesch a beaucoup emprunté au tome I de la Vraie Jeanne d’Arc (1890), sans toujours le signaler.
Source : Études religieuses, etc., 31e année, supplément aux tomes 41, 42 et 43, p. 279-281.
Lien : Gallica
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
Messager du Cœur de Jésus mai 1894
Après le compte-rendu du tome II dans le bulletin de février, nouvel article dont les pages n’en sont guère que des fragments détachés
.
Source : Messager du Cœur de Jésus, tome 65 (janvier-juin 1894), bulletin de mai 1894, p. 541-242.
Lien : Google
(Nous recommandons vivement le magnifique volume du R. P. Jean-Baptiste Ayroles, qui vient de paraître sous ce titre : La Vraie Jeanne d’Arc. II. La paysanne et l’inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée. Comme le précédent, il est de grand format, et la matière de plusieurs autres y est rassemblée. Chez Gaume, Paris.)
La Vénérable Jeanne d’Arc, la paysanne et l’inspirée
Dieu qui, selon la parole de l’Apôtre, appelle les choses qui ne sont pas comme celles qui sont, fit choix, jadis, pour ses desseins, de Débora et de Judith, afin de confondre les puissants. De même, au commencement du quinzième siècle, il suscita Jeanne d’Arc en vue de rétablir les affaires de sa patrie, presque détruites par la guerre la plus cruelle, et en vue de rendre à la religion attaquée sa liberté et sa gloire.
Tels sont les premiers mots du décret par lequel, le 27 janvier 1894, Léon XIII introduisait Jeanne d’Arc dans la voie au terme de laquelle se trouvent les autels, suite d’une régulière canonisation. Un immense cri de joie, parti de tous les cœurs qui ne sont pas voués au mal, a salué cet acte réparateur ; c’est un tressaillement universel dans l’espérance de l’acte dernier qui en sera le couronnement.
La France tout entière acclame et s’apprête à célébrer, par d’extraordinaires hommages, cette fille sublime
qui sera toujours — chacun l’avoue — la plus belle personnification de notre patrie. Jeanne d’Arc est, en effet, l’un des meilleurs présents du Cœur de Jésus au pays de France.
Sache un chacun — disait un grave magistrat contemporain de la Pucelle (Mathieu Thomassin, Procès, IV, 309) — que Dieu a montré et montre chaque jour qu’il a aimé et qu’il aime le royaume de France, et qu’il l’a spécialement élu en héritage pour entretenir, par son moyen, la foi catholique et la remettre du tout sus. Et pour ce, Dieu ne veut pas le laisser perdre. Mais sur tous les signes d’amour qu’il a envoyés au royaume de France, il n’y en a point de si grand et de si merveilleux que cette Pucelle.
L’intérêt qui s’attache, pour l’humanité entière, à la cause de Jeanne d’Arc est plus haut encore. De toutes les questions qui agitent le monde, la question capitale est celle du surnaturel. Le surnaturel est l’unique solution de la destinée humaine, dit le christianisme. — Le surnaturel n’existe pas, disent d’une commune voix les écoles naturalistes de tout degré, et surtout cette contre-façon satanique de l’Église qui se nomme la Maçonnerie. Or, la Pucelle, par son histoire, écrase le naturalisme.
En Jeanne d’Arc — disait au Promoteur de sa cause l’Éminentissime Cardinal Préfet de la Congrégation des Rites (Univers, 1er avril 1894) — ce qui me frappe, c’est le surnaturel : il est partout. Dans sa vie entière, on sent la main de Dieu qui conduit, dirige cette jeune fille, et l’on est émerveillé de sa docilité, de son obéissance, de son absolue soumission à la volonté de Dieu.
C’est aussi la parole de Son Ém. le Cardinal Desprez, Archevêque de Toulouse :
À tout prix — daignait-il écrire à l’auteur de la Vraie Jeanne d’Arc, — il faut arracher notre admirable Jeanne d’Arc au rationalisme et à la libre-pensée ; il faut montrer en elle la Vierge divinement envoyée à la France pour la préserver de la ruine et conserver, à la défense de la foi, la nation si justement appelée la Fille aînée de l’Église.
C’est là ce que montre avec une précision et une abondance prodigieuse
le R. P. Jean-Baptiste Ayroles, dans son majestueux ouvrage la Vraie Jeanne d’Arc, dont les présentes pages ne sont guère que des fragments détachés.
Nous les donnons de préférence au mois de mai, parce que toutes les grandes dates, dans la carrière de Jeanne — et notamment son principal triomphe et son martyre — se rencontrent au mois de mai. Ce n’était pas encore le mois de Marie ; mais il devait l’être au jour où la Pucelle serait pleinement manifestée, et, espérons-le, mise sur les autels. N’est-ce pas pour nous dire que derrière la libératrice de la France, il faut voir la libératrice du genre humain, dont Jeanne n’est que l’ombre ; et que, derrière la Pucelle, il faut voir la Vierge immaculée la colorant de ses rayons ?
[Suit une longue dissertation sur la Paysanne et l’Inspirée. Extraits :]
V
On peut l’affirmer avec une entière certitude, quand on a parcouru les pages de la Vraie Jeanne d’Arc : Jeanne est le surnaturel éclatant d’une manière fulgurante, au beau milieu de notre histoire. […]
VI
Dans celui qui vient de paraître — La Paysanne et l’Inspirée — l’un des sujets sans contredit les plus intéressants, c’est l’étude de la physionomie morale de l’héroïne. […]
XV
Outre la vie de la Paysanne, le nouveau volume nous met sous les yeux la vie de l’Inspirée.
XIX [Conclusion]
Le volume que nous annonçons à nos lecteurs, le deuxième de la Vraie Jeanne d’Arc, est consacré à la vie de Domrémy et de Vaucouleurs, à la vie obscure
de Jeanne, jusqu’à son arrivée à Chinon. Le troisième et le quatrième volume et même, s’il plaît à Dieu, un cinquième traiteront de la Guerrière et de la Martyre.
Jeanne d’Arc vient d’être déclarée Vénérable par le Saint-Siège ; et, pour notre Vénérable sœur, entrer dans la carrière fut plus difficile que de la parcourir. Il lui en coûta plus d’obtenir l’assentiment de Baudricourt, du Dauphin et de son entourage que de rompre les bastilles anglaises, de mettre en fuite l’armée de Talbot, et de conduire le Roi à Reims. Ne nous est-il pas permis de penser qu’il en sera ainsi, pour elle, de la carrière des honneurs décernés ici-bas à la sainteté ? Elle est restée comme en dehors durant près de cinq siècles… Mais Léon XIII vient de la mettre sur la voie ; puisse-t-il lui être donné de la lui faire parcourir tout entière !
Une fois de plus — ajoute Son Éminence le Cardinal Archevêque de Paris dans sa Lettre pastorale du 25 mars dernier — admirons les opportunités providentielles. À aucune autre époque, la glorification de Jeanne d’Arc n’aurait pu exercer sur la France une influence plus salutaire. C’est quand la population, lasse des efforts entrepris par les sectes antichrétiennes pour lui arracher ses croyances séculaires, sent le besoin de se tourner vers Dieu, que Jeanne d’Arc vient à elle pour lui prêcher l’union dans la foi chrétienne et l’amour de la patrie.
Deux ans encore, et la France chrétienne célébrera, avec la splendeur qui convient, le quatorzième centenaire du jour où, sortant des eaux du baptême, elle naissait Fille aînée de l’Église.
Comme la canonisation de l’incomparable fille de Jacques d’Arc arriverait, ce semble, bien à son heure, en cet anniversaire quatorze fois séculaire ! Quel saphir resplendissant unirait ainsi la chaîne de nos annales, tournerait le cœur des fils vers celui des pères, et prouverait à tous que si le Christ aima les Francs dès le commencement, il les aime jusqu’à la fin !
Puissent les prières ferventes de tous nos chers Associés contribuer à la réalisation d’un vœu si universel et si légitime !
La Dépêche de Brest 11 mai 1894
Article anticlérical et antiroyaliste qui raille la récupération de Jeanne d’Arc par les catholiques : la canonisation de la Pucelle ne les intéresse que tous les dix ans, lorsque Joseph Fabre relance son idée d’une fête laïque.
Aussitôt, évêques et journaux cléricaux se ressouviennent de Jeanne, chacun rééditant à sa façon ce plaidoyer du jésuite Ayroles qui, en 1885, accusait les libres-penseurs de vouloir escamoter Jeanne d’Arc à leur profit en proposant de la glorifier par une fête nationale.
Lien : Gallica.
Le mois de Jeans d’Arc.
- 3-5 mai 1429. — Jeanne d’Arc à Orléans. Elle ranime le courage de tous. Ses sommations à l’assiégeant. […]
- 3-5 mai 1431. — Deux ans après. Jeanne est en prison. Lettre de l’évêque de Coutances. […]
- 5 mai 1894. — Quatre cent soixante-cinq ans après. Après quatre cent cinquante ans d’oubli, cléricaux et royalistes tentent de confisquer la Pucelle et d’en faire l’instrument de leur politique.
La Gazette de France reproduit, en tête de sa première colonne, le mot dit par M. de Charette, quelques jours auparavant, dans un banquet royaliste : Jehanne nous conduit au Roi.
Ainsi, l’Église réclame Jeanne d’Arc comme son bien propre ; Marie Alacoque commence à être usée, Lourdes est surtout une vaste entreprise commerciale ; le culte de Jeanne d’Arc donnera à l’Église, pensent les cléricaux, et au parti d’autres profits.
Les monarchistes se demandent si une seconde fois elle ne pourrait pas ramener le roi à Reims et le faire couronner, et, eux aussi étendant la main sur la Pucelle, s’écrient : Jeanne est à nous !
Double tentative de confiscation.
Et l’Église qui a brûlé Jeanne et la monarchie qui l’a abandonnée ont attendu quatre siècles pour se souvenir qu’elle a existé.
Il a fallu qu’un membre républicain du Parlement français, M. Joseph Fabre, commençât un mouvement laïque en vue de l’institution d’une fête nationale de Jeanne d’Arc pour que la jalousie très politique de l’Église s’éveillât. Le 30 juin 1884, M. Joseph Fabre déposait à la Chambre sa proposition de loi ; le 30 novembre 1885, la cause de la béatification de Jeanne d’Arc fut introduite à Rome devant la congrégation des rites. Puis, on ne parle plus de la proposition de M. Fabre, qui ne semble pas près d’être adoptée, et l’Église, les cléricaux et leurs feuilles recommencent à ignorer Jeanne d’Arc.
En janvier dernier, M. Fabre est élu sénateur ; il présente sa proposition de 1884 au Sénat, et le Sénat la prend en considération ; la commission est favorable à l’adoption. Aussitôt, évêques et journaux cléricaux se ressouviennent de Jeanne, chacun rééditant à sa façon ce plaidoyer du jésuite Ayroles qui, en 1885, accusait les libres-penseurs de vouloir escamoter Jeanne d’Arc à leur profit en proposant de la glorifier par une fête nationale. Aux yeux de l’excellent jésuite, les catholiques gallicans doivent porter tout l’opprobre de la condamnation et du supplice de Jeanne ; les catholiques romains peuvent seuls revendiquer et exalter la Pucelle qui, papiste irréprochable, est tout entière de l’école du Syllabus
, et qui, Messie de la contre-révolution, doit présider à la régénération de la France répudiant la satanocratie
pour la théocratie
.
Jeanne d’Arc instrument de la politique cléricale : c’est être brûlée deux fois.
Bulletin de la Société archéologique et historique de l’Orléanais 11 mai 1894
La Société archéologique et historique de l’Orléanais vote l’acquisition des deux premiers volumes de la Vraie Jeanne d’Arc.
Lien (Gallica) : Vote, Acquisition.
[P. 532 :]
Séance du vendredi 11 mai 1894, présidence de M. Baguenault de Puchesse. […]
M. le chanoine Cochard propose à la Société, ce qui est accepté, de souscrire aux deux volumes déjà parus d’un ouvrage du P. Ayroles, sur Jeanne d’Arc.
[P. 634 :]
V. — Acquisitions.
La vraie Jeanne d’Arc. — La Pucelle devant l’Église de son temps, par J.-B.-J. Ayroles, de la Compagnie de Jésus. 2 volumes.
Itinéraire de Jeanne d’Arc de Domremy à Orléans, et d’Orléans à Rouen, par l’abbé Rouette, 2 vol. in-8°.
Revue de Bretagne et de Vendée mai 1894
Compte-rendu du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc, par P. Fleuriais.
On n’est pas loin de partager ses
haines vigoureusescontre les faux amis de la Pucelle, et c’est à peine si l’on remarque un ton peut-être trop constamment railleur…
Source : Revue de Bretagne et de Vendée, t. XI, 5e livraison, mai 1894, p. 426-427.
Lien : Gallica
Le P. Ayroles continue avec ardeur la tâche vaillamment entreprise par lui pour mettre en pleine lumière la sympathique figure de la bonne Lorraine. Deux volumes ont précédé celui-ci. C’est d’abord : Jeanne d’Arc sur les autels, puis : La Pucelle devant l’Église de son temps. Le dernier travail du docte religieux n’est pas inférieur à ses devanciers.
Il peut se diviser en deux parties : dans la première, l’auteur expose ce que fut Jeanne depuis sa naissance jusqu’à son arrivée à Chinon ; dans la seconde, il réfute les erreurs amoncelées sur cette période de la vie de l’héroïne par les écrivains rationalistes dans le but évident d’enlever tout caractère divin à la mission de la libératrice. La lecture de ces pages nous met en face d’une érudition vaste, large, sûre d’elle-même, habituée à se mouvoir à l’aise au milieu des difficultés. Mais ce n’est pas tout. Comme si l’auteur voulait faire oublier ce qu’il y a de sec pour le lecteur dans une accumulation de documents, à l’exposition pacifique il joint la discussion, l’attaque : il se jette avec entrain à la poursuite des ennemis du surnaturel dans l’œuvre de la Pucelle. L’indignation, on le sent, lui soulève parfois le cœur devant les négations audacieuses ou les insinuations doucement perfides et les sous-entendus calculés des écrivains naturalistes ; et cette indignation, il sait la communiquer : on n’est pas loin de partager ses haines vigoureuses
contre les faux amis de la Pucelle, et c’est à peine si l’on remarque un ton peut-être trop constamment railleur, une vigueur de langage qui lui fait pour l’ordinaire appeler un chat un chat, et Rollet un fripon
.
Les volumes promis et annoncés seront, nous l’espérons, un digne couronnement pour cet imposant travail de foi et de patriotisme.
P. Fleuriais.
La Gazette de Château-Gontier 17 mai 1894
Annonce de la Vraie Jeanne d’Arc, t. II, qui reprend les éléments de langage de la préface (But et plan, t. II, p. VII-XV), dont un extrait de la lettre d’encouragement du cardinal Desprez, archevêque de Toulouse (p. XII).
Le texte fut-il fourni par la maison d’édition ? Sa récurrence (au moins dans les numéros des 17 mai et 28 juin) laisse supposer que oui. Aussi des annonces similaires durent paraître dans plusieurs feuilles de province.
Le doyen des cardinaux français, Son Éminence le cardinal Desprez, daignait bien écrire les lignes suivantes à l’auteur de la Pucelle devant l’Église de son temps :
À tout prix il faut arracher notre admirable Jeanne d’Arc au rationalisme et à la libre-pensée ; il faut montrer en elle la Vierge divinement envoyée à la France pour la préserver de la ruine et conserver à la défense de la foi la nation appelée si justement la Fille aînée de l’Église.
Des paroles si expressives et tombées de si haut disent assez quel intérêt de premier ordre s’attache à l’histoire de Jeanne d’Arc. Sans diminuer, bien plus, tout en rehaussant incomparablement le côté patriotique, il est permis d’affirmer qu’une question beaucoup plus haute, celle du surnaturel, est renfermée dans l’histoire de la Pucelle.
Depuis la promulgation de l’Évangile, il n’est peut-être pas de personnage dans lequel le surnaturel éclate d’une manière aussi resplendissante, avec un semblable luxe de preuves irréfragables. De là les efforts vraiment titanesques du naturalisme pour obscurcir l’apparition qui le confond ; de là aussi la nécessité de faire palper l’inanité de ses efforts ; et cela, à tout prix, ainsi que l’affirme l’éminent cardinal de Toulouse.
L’œuvre, ce semble, est facile. Il suffit de montrer l’astre tel qu’il se révèle lui-même, au tribunal de Rouen ; tel que le vil et nous l’a décrit la chrétienté dans la stupéfaction ; de signaler les harmonies de sa course si rapide ; et de mettre en présence les nuages aux teintes blafardes, en lutte avec eux-mêmes, éclos des fantaisies du naturalisme, et qu’il appelle du nom de Jeanne d’Arc.
C’est le but des volumes en voie de publication sous le titre commun de la Vraie Jeanne d’Arc. Chacun de ces volumes traitera de l’une des phases si pleines de contrastes de la céleste apparition, ne laissera sans l’aborder et le discuter aucun des points de quelque importance qui s’y rattache, et montrera par quelles contre-vérités incohérentes la libre-pensée essaye de l’obscurcir. On y trouvera en français moderne, groupés et appréciés, tous les documents qui illuminent la période étudiée. Tel est le plan.
Le volume déjà publié, sous le titre de la Pucelle devant l’Église de son temps, a fait connaître, avec une ampleur remarquée et louée de bien des manières, ce qu’avait dit et pensé de la Pucelle, non pas un parti anti national et schismatique se targuant d’être l’Église, mais la véritable Église de Jésus-Christ bâtie sur Pierre.
Celui intitulé la Paysanne et l’inspirée présentera Jeanne depuis sa naissance jusqu’à son entrée en scène, à Chinon. Ce sont les origines de la mission, les dix-sept premières années de la céleste envoyée, le lever silencieux de l’astre dans le coin le plus reculé de la France, par la plus sombre des nuits qu’eût encore traversée notre pays.
Sera-t-il donné de décrire sur le même plan et avec semblable étendue, le midi et le couchant de l’astre sauveur ? C’est sans doute, avant tout, le secret de Celui qui mesure la vie et fait les jours ; mais c’est aussi celui de ceux qui veulent connaître et faire connaître la Pucelle telle que Dieu la fit. Leur concours est nécessaire. Il doit suppléer celui que des publications similaires trouvent dans les pouvoirs publics, qui les encouragent, tant par des allocations directes que par des souscriptions imposées d’office aux établissements placés sous leur dépendance. On sait bien que semblable appui n’est pas pour les tenants du surnaturel.
Ceux qui, avec l’éminent archevêque de Toulouse, penseront qu’avant tout il faut arracher la Pucelle au rationalisme et à la libre-pensée voudront collaborer avec l’auteur et l’éditeur. On a fort justement loué la magnifique exécution typographique de la Pucelle devant l’Église de son temps. Ce sera celle de la Paysanne et l’inspirée, de la Libératrice et de la Martyre, s’il est permis de continuer l’œuvre.
L’Univers 25 mai 1894
Long compte-rendu de la Paysanne et l’inspirée (Vraie Jeanne d’Arc, t. II), par l’historien Lecoy de La Marche (alias d’Assigny), qui délivre une brillante leçon d’épistémologie en résumant la réfutation, par le père Ayroles, des historiens rationalistes : Michelet, Henri Martin, Quicherat, Vallet de Viriville et Siméon Luce.
Ils n’ont pas voulu croire à la mission divine de Jeanne, bien que l’évidence leur crevât les yeux ; ils se sont condamnés à divaguer, parce que le miracle s’impose et ne s’explique pas.
Lien : Retronews
Les historiens de Jeanne d’Arc.
I
Dans le second volume du vaste travail que le R. P. Ayroles a entrepris de consacrer à Jeanne d’Arc, volume dont l’Univers a déjà parlé, une série de chapitres mérite d’attirer tout-particulièrement l’attention : c’est celle où sont réfutées, de main de maître, les étranges théories émises par les historiens rationalistes pour expliquer, je ne dirai pas la mission, car elles suppriment toute idée de mission divine, mais l’œuvre étonnante de la libératrice de la France. Nous sentons déjà que Michelet était un poète et un visionnaire, qu’Henri Martin était un songe-creux hanté par le fantôme du monde celtique, que Quicherat était un critique timide et inconséquent avec lui-même, que Vallet (de Viriville) était un phraseur, que Siméon Luce était un solliciteur de textes ; mais voir ce que l’on sent démontré en détail, par une plume alerte, impitoyable, impavide, c’est une double jouissance : nous percevons distinctement non seulement que cette plume a raison, mais que nous avions raison nous-mêmes dans nos méfiances et nos réserves instinctives, et c’est une des suprêmes habiletés de l’écrivain de montrer à ses lecteurs qu’ils étaient dans le vrai. Je ne soupçonne nullement le P. Ayroles d’avoir voulu être habile ; il a parlé comme il pensait, il a déchargé son cœur avec une expansion, avec une vivacité de langage qui exclut toute idée de calcul et de préméditation, et il se trouve qu’il a fait œuvre de critique transcendante.
Mais pourquoi, à côté des historiens qui ont altéré la vraie physionomie de Jeanne, n’a-t-il pas signalé ceux qui l’ont restituée, ou du moins respectée ? Wallon, Marius Sepet, de Beaucourt étaient assis, le 22 avril, aux places d’honneur réservées, dans la cathédrale de Paris, aux apologistes de la Pucelle. Ne l’avaient-il pas mérités, et, si leur travail de restitution n’est pas encore complet, s’ils n’ont osé envisager comme une vraie sainte celle que l’Église n’avait pas encore, proclamée vénérable, n’ont-ils pas grandement contribué à préparer cet heureux résultat, avec tous ses corollaires futurs ? Je yeux bien que l’ouvrage du P. Ayroles soit très supérieur aux précédents, en raison même du point de vue où il se place et où la décision de Rome lui permet de se placer ; mais en faut-il moins rendre justice aux ouvriers de la première heure qui ont posé les assises de ce beau monument ? Quelques lignes dans ce sens, n’eussent fait, il me semble, que rehausser la valeur de ses critiques. Peut-être les ajoutera-t-il dans un des volumes suivants, car il nous en promet plusieurs, et sa démonstration est si touffue, son plan si peu sévère, qu’on peut espérer, sans trop présumer de l’abondance de sa verve, qu’il nous parlera de tous à propos de tout.
La grande force du savant hagiographe (je pense que c’est le mot propre et qu’on ne le jugera point prématuré), c’est de s’appuyer uniquement sur les actes du martyre de la vénérable Jeanne d’Arc, c’est-à-dire sur ses deux procès authentiques : la grande faiblesse de ceux qu’il réfute est de n’avoir pas assez puisé à cette source merveilleuse et de s’être égaré dans la voie des hypothèses, des commentaires, des explications impossibles. C’est ici ou jamais le cas de se souvenir d’une parole profonde de Joseph de Maistre :
Il faut toujours se défier de la science qui n’est pas éclairée par la foi.
Les auteurs que je viens de nommer n’ont pas voulu croire à la mission divine de Jeanne, bien que l’évidence leur crevât les yeux ; ils se sont condamnés à divaguer, parce que le miracle s’impose et ne s’explique pas. Un mot résume toutes leurs théories : l’hallucination. Quelles que soient leur déférence, leur sympathie, leur admiration pour l’héroïne, ils ne voient en elle, tout bien considéré, qu’une hallucinée. Les formes de l’hallucination varient suivant la couleur de leur propre esprit : le fond de la thèse ne varie pas. La réfutation se résume également dans une phrase, que le P. Ayroles eût pu prendre pour épigraphe, et cette phrase est celle d’un Père de l’Église :
J’en crois des témoins qui se font égorger.
Il n’y a pas d’hallucination qui tienne devant la mort ; le sentiment du danger suprême dissipe tous les rêves, toutes les erreurs de l’imagination : le condamné à mort se réveille soudain et voit la réalité en face ; celui qui meurt dit la vérité. Or, Jeanne a rendu le dernier soupir en déclarant que ses voix étaient de Dieu et qu’elles ne l’avaient pas trompée. Le seul fait de chercher une autre explication est une insulte à la loyauté d’une mourante.
Mais la critique rationaliste ne veut rien voir ni rien écouter. Pour elle, le miracle n’existe pas ; l’histoire n’en saurait tenir compte. Le surnaturel, disait M. Luce, échappe à l’investigation scientifique. C’est tout le contraire de ce qu’il faudrait dire, car le miracle a besoin plus que tout autre fait d’être établi et prouvé, et, avant de déclarer pompeusement qu’il n’existe pas, il faut au moins l’avoir soumis à une enquête scientifique
. Mais qui s’est soucié de le faire, parmi les pseudo-historiens de la Pucelle ? Lequel s’est dit, a priori : Voici une histoire miraculeuse attestée par des textes et des documents précis ; recherchons la valeur de ces textes, le degré de véracité de ces documents : s’ils sont nuls, rejetons-les ; s’ils sont sûrs, suivons-les. En un mot, traitons cette histoire comme les autres faits, étudions-la à la loupe, disséquons-la en faisan abstraction de notre croyance ou de notre incroyance préconçue, car nous ne sommes pas assez certains que notre opinion personnelle soit la bonne pour la mettre au-dessus des réalités démontrées. Tel serait cependant le devoir essentiel de la critique historique. Or, il n’est pas un de ses prétendus adeptes qui ait eu assez de conscience pour adopter cette méthode rigoureuse.
II
Prenons d’abord, avec le P. Ayroles, le trop fameux Michelet. Il y a encore des gens assez naïfs pour voir dans ce romancier à tous crins un historien sérieux ; j’en ai rencontré, il n’y a pas longtemps. Inutile de demander si, pour cet halluciné, Jeanne d’Arc est une hallucinée. Demandons-lui seulement quelle forme d’hallucination a fait d’elle une inspirée. C’est bien simple :
Née sous les murs mêmes de l’église, bercée du son des cloches et nourrie de légendes, elle fut une légende elle-même, rapide et pure. De la naissance à la mort, elle fut une légende vivante… Mais la force de vie exaltée et concentrée n’en devint pas moins créatrice. La jeune fille à son insu, créait, pour ainsi parler, et réalisait ses propres idées ; elle en faisait des êtres ; elle leur communiquait du trésor de sa vie virginale une splendide et toute puissante existence, à faire pâlir les misérables réalités de ce monde. Si poésie veut dire création, c’est sans doute la poésie suprême.
Ainsi l’ange et les saints qui apparaissaient à Jeanne étaient des êtres réels si l’on veut, mais ces êtres réels étaient créés par elle, grâce à la vertu qu’elle possédait en qualité de vierge. On reconnaît bien là les théories habituelles du vieil érotomane. Vallet (de Viriville) accusait le moyen âge de croire à la puissance mirifique des vierges et des licornes : c’est à Michelet qu’il eût dû adresser ce reproche. Mais, vierge ou non, se figure-t-on la pauvre petite fille de Jacques d’Arc favorisée du don de créer des êtres ? Ce serait un prodige bien plus fort que tous ceux qui lui sont attribués par les catholiques. Et voilà où en arrivent d’un seul bond ceux qui rejettent le surnaturel : à miracle, miracle et demi.
Où est ici la poésie, la création ? (observe le P. Ayroles [p. 347 et suiv.]). Raisonnons froidement ! et pesons les mots. Née sous les murs même de l’église, à cela, près qu’elle en était séparée par le jardin de son père et le cimetière… Bercée du son des cloches : combien y en avait-il à Domrémy ? Perrin, le sonneur, nous a dit qu’il se faisait doucement tancer par Jeannette pour ne pas sonner exactement les complies. Michelet est parti de là pour mettre en circulation dans son école la passion de la jeune fille pour le son des cloches. La falsification est matériellement tangible ; elle peut nous faire apprécier celles qui le sont moins.
(Quicherat développera cette singulière idée en disant que sa perception des voix mystérieuses était favorisée par des bruits mesurés et lointains, comme celui des cloches, celui du vent dans les arbres ; autrement dit, ses voix n’étaient que le bruit du vent.)
Nourrie de légendes : qu’en sait-il et que veut-il dire ? Nourrie de la vie des saints probablement, il nous a dit plus haut, et en cela il est d’accord avec Jeanne, qu’elle tenait tout son savoir religieux de sa mère. Ce savoir, n’allait pas loin puisque son dernier confesseur assure qu’elle savait uniquement Pater, Ave, Credo. Qu’en était-il à douze ans ? Jeannette n’a jamais su lire. Sa mère en savait-elle davantage. D’après Michelet, Jeanne méditait déjà, à douze ans, l’histoire de Gédéon, de Judith, de sainte Marguerite, de saint Michel, se nourrissait des récits qui sont le fond de la légende dorée. Et la trésorière de Bouligny dépose qu’à dix-huit ans, en dehors de sa mission, elle ne savait rien ! Isabelle Romée, chargée d’un nombreux ménage, aurait donc trouvé le loisir d’enseigner ce qu’ignorent les bachelières de nos jours, la partie historique de l’Ancien et du Nouveau Testament, et les Vies des Saints !… La vie de la petite Jeannette ne fut jamais ni exaltée ni concentrée… La force créatrice est tout entière dans celui qui forge de semblables chimères, enjolive si splendidement le brevet de folie qu’il délivre à la fillette de Jeanne d’Arc.
Et cette accusation de folie, un critique célèbre, qui n’était rien moins qu’un croyant, l’a rétorquée à ce propos, contre l’écrivain lui-même :
Pauvre Jeanne d’Arc, (écrit Sainte-Beuve). Des historiens distingués, Henri Martin, Michelet lui doivent d’avoir fait des chapitres bien systématiques et un peu fous.
Le P. Ayroles invoque avec esprit ce jugement significatif d’un libre-penseur. Il achève ensuite Michelet en citant ses divagations sur les prénoms de Jean et de Jacques, son étalage de grands noms historiques, rassemblés pour éblouir le lecteur ignorant et dont chacun presque renferme une erreur, son verbiage malheureux sur les hommes et les choses qui lui sont le plus étrangères, sur le frère Richard, sur Thomas Connecte, sur les processions des Rogations, sur l’arbre des Fées, enfin ses interversions de l’ordre des événements, qui donnent à son récit un caractère de haute fantaisie. Il rétorque, en passant, sa prétention outrecuidante de faire dater de la Pucelle l’amour de la patrie française, alors que dans Froissart, dans Joinville (ajoutons dans la Chanson de Roland), éclatent à chaque page les manifestations de ce noble sentiment. De toutes les autres chimères inventées par cette imagination débordante, il ne reste rien, rien… que le bruit du vent dans les arbres.
III
Au sujet de Quicherat, le terrible critique est moins sévère, et il a raison. Non pas qu’il lui passe rien de ce qu’il réprouve chez les autres, ni que l’explication semi-scientifique de celui-ci lui paraisse plus admissible que les billevesées romanesques de celui-là. Au contraire, il dénonce consciencieusement les plates excuses par lesquelles le savant professeur cherche à se faire pardonner de parler de mission et de révélation :
Je me sers de ces mots sans prétention aucune de leur faire signifier plus que l’état de conscience de Jeanne, lorsqu’elle soutenait avec une fermeté si inébranlable qu’elle était envoyée de Dieu, que Dieu lui dictait sa conduite par l’entremise des saints et des anges. Comme sur ce point la critique la plus sévère n’a pas de soupçon à élever, contre sa bonne foi, la vérité historique veut qu’à côté de ses actions, on enregistre le mobile sublime qu’elle leur attribuait.
Cela revient encore à dire que, si Jeanne était de bonne foi, elle n’était pas moins victime d’une illusion des sens. L’auteur de la Vraie Jeanne d’Arc flétrit justement cette confirmation détournée de la théorie de l’hallucination. Il surprend la même pensée dans certaines phrases trop significatives comme celles-ci :
L’idée que je me fais de la petite fille de Domrémy est celle d’un enfant sérieux et religieux, doué au plus haut degré de cette intelligence à part qui ne se rencontre que chez les hommes des sociétés primitives. Presque toujours seule, à l’Église, aux champs, elle s’absorbait dans une communication profonde avec les saints, dont elle contemplait les images, avec le Ciel, où l’on voyait souvent ses yeux comme cloués. Cette fontaine, cet arbre, ces bois sanctifiés par une superstition vieille comme le monde, elle leur communiquait de sa sublime inquiétude, et dans leur murmure elle cherchait à démêler les accents de son cœur. Mais du jour où l’ennemi apporta dans la vallée le meurtre et l’incendie, son inspiration alla s’éclaircissant de tout ce qu’il y avait en elle de piété et de religion pour le sol natal. Attendrie davantage aux souffrances des hommes par le spectacle de la guerre, confirmée dans la foi qu’une juste cause doit être défendue au prix de tous les sacrifices, elle connut son devoir.
La vue des dévastations commises par les Anglais aux environs de Domrémy ne put être pour rien dans la connaissance de son devoir, attendu qu’elle sont postérieures d’un an à la première audition de ses voix, le P. Ayroles le démontre ; et elle n’était presque jamais seule aux champs, car elle y travaillait avec ses parents et s’y promenait avec ses compagnes, dont elle ne s’écartait par moments que pour prier ; ajoutons que son père la surveillait de près de peur qu’elle ne lui échappât, comme certains songes le lui avaient fait craindre. Tout manque donc ici au raisonnement de Quicherat. Mais il est dur de prendre en faute, celui auquel on doit la révélation des plus précieux documents sur la matière.
Ce n’est pas une médiocre tristesse aux amis de la Pucelle d’avoir à ranger parmi ses caricaturistes, l’éditeur des cinq volumes publiés sous le titre de Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d’Arc. Pourquoi donc a-t-il écrit ses Aperçus nouveaux ? On serait si heureux de n’avoir qu’a louer l’auteur de la première œuvre, de fermer les yeux sur les lacunes qu’il y a laissées, et même sur plusieurs réflexions peu justes qu’il y a semées çà et là. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 374.]
Et puis, Quicherat est un érudit, tandis que Michelet est un pur littérateur ; l’un connaît ses sources bien qu’il en rabaisse la valeur, et l’autre ignore jusqu’à leur existence ; l’un raisonne et l’autre déraisonne. Aussi le premier est-il traité avec une nuance de respect que le second ne mérite pas ; aussi le critique rend-il hommage à la modération du savant comme à sa sincérité relative.
Je me permettrai cependant de faire ici une observation. Pourquoi prononcer aussi souvent, à propos de Quicherat comme à propos de Vallet (de Viriville) et de Siméon Luce, les mots d’Institut et d’École des Chartes. Ces deux institutions sont bien innocentes des torts individuels de leurs membres respectifs ; entre ceux-ci, aucune [unité]. La plus grande variété de doctrines, je dirais presque la plus grande division règne parmi eux. Et puis l’École des Chartes n’enseigne pas que la paléographie, science préliminaire, qui elle-même ne porte pas toujours sur les infiniment petits
. Enfin, ni Luce, ni Vallet, ni Quicherat n’ont occupé la chaire de paléographie, et le dernier, lorsqu’il publiait ses Aperçus nouveaux, n’était nullement directeur de l’École ; je ne sais même s’il y professait déjà. Voilà bien des raisons de ne pas confondre le tout avec la partie.
IV
Sur Henri Martin et sur Vallet (de Viriville), l’auteur passe plus rapidement. Il lui suffit, pour le premier, de reproduire la page amphigourique où il prétend expliquer Jeanne d’Arc par l’influence des fées :
Elle ne les a jamais vues mener, au clair de lune, autour du beau mai, les cercles de leur danse ; mais sa marraine les a rencontrées jadis, et Jeanne croit apercevoir parfois, des formes incertaines dans les vapeurs du crépuscule ; des voix gémissent le soir entre les rameaux des chênes : les fées ne dansent plus ; elles pleurent. C’est la plainte de la vieille Gaule qui expire, etc.
Quel travestissement ! Et c’est là, suivant l’expression de quelques thuriféraires, notre grand historien national
!
Quant à Vallet, qui nous parle des propriétés de la licorne, de la trompe des pâtres qui se fait entendre le soir à Domrémy, des jeûnes et des macérations de la jeune paysanne, laquelle voua sa virginité non pas à une idée d’ascète, mais à sa patrie, et de son bon sens supérieur et de son génie, qu’il compare à celui de Christophe Colomb, il n’est pas pris bien au sérieux. Cependant le critique rend hommage à son érudition et le loue d’avoir rendu à un document de premier ordre, la Chronique de la Pucelle, la place que les autres lui avaient refusée.
Mais c’est sur l’infortuné Luce que le P. Ayroles semble avoir épuisé la coupe des sévérités. Il avait pour cela, du reste, une raison particulière : c’est que, sur la foi des sentiments d’admiration manifestés par cet historien pour l’héroïne dont il a étudié les débuts, certains catholiques l’ont pris pour un des leurs, ou au moins pour un défenseur de la cause de Jeanne. Or, chercher à sa mission des origines purement humaines, attribuer son entraînement à l’empire des circonstances et des milieux, tirer des plus petites-choses des conséquences énormes, faire naître, en un mot, d’une série de hasards la série des prodiges qui compose l’histoire de la Pucelle, ce n’est pas faire œuvre de chrétien, mais œuvre de rationaliste. Or, c’est là tout le livre de Siméon Luce. En invoquant ce qu’il appelle l’incubation morale, l’embryogénie des événements, grands mots absolument creux dans l’espèce, il nie à sa façon l’inspiration divine ; mais, il nie sans nier : pour lui, le ciel, le miracle, Dieu, c’est la patrie, c’est l’idéal, c’est la justice ; en écartant le surnaturel, il pense éclairer les abords de son domaine (!). Au reste, ce savant, s’il ne donnait pas dans les excès de la libre-pensée, et s’il enveloppait ses théories nuageuses dans les voiles d’une religiosité vague, n’était, au fond, rien autre chose qu’un sceptique. Un peu surfait comme érudit, et surtout comme historien, il imposait aux uns par sa solennité doctorale, au autres par l’appareil scientifique de ses écrits. Mais le P. Ayroles l’a pris en faute sur plus d’un point.
Des événements arrivés en 1425 n’ont pas un rapport de cause avec un fait survenu en 1424, ni un blocus imaginaire de Vaucouleurs avec des ravages à Domrémy pas plus qu’une fuite supposée, fixée en juillet, avec une démarche qui avait eu lieu en mai. Les prédications du frère Richard à Troyes, en décembre, n’expliquent nullement comment Jeanne avait, six mois auparavant, si bien parlé de son Seigneur au capitaine de Vaucouleurs. Les contre-vérités débitées par M. Luce sur les Dominicains et les Franciscains n’expliquent pas la dévotion de Jeanne au saint nom de Jésus, et cette dévotion n’est pas un des caractères particuliers à la Pucelle. Les imaginations dont M. Luce a rempli ses pages n’ont pu contribuer en rien a soulever la paysanne vers les sublimes hauteurs dont il parle ; elles l’auraient plutôt empêchée d’y atteindre ; elles l’auraient fait descendre au dernier degré de l’humanité, immédiatement après les criminels et les coupables, puis qu’elles en auraient fait une jeune fille atteinte de démence alors que pour les autres luit l’âge de la pleine raison. [La Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 474.]
Je donne ici le résumé de la réfutation ; il faut en lire le détail pour en comprendre la force. Tout considéré, Jeanne d’Arc à Domrémy n’est qu’un tissu d’hypothèses, et, si l’auteur a réuni, sous le titre de preuves, un nombre considérable de pièces, toutes ou presque toutes sont étrangères à son personnage ; sans compter que plusieurs avaient été déjà publiées et utilisées par d’autres.
Il n’en est pas ainsi de celles que le P. Ayroles a données à la fin de son gros et substantiel volume. Il n’est pas non plus de ces hommes pour qui la critique est aisée et l’art difficile, car lui-même a construit sur les ruines de tous ces échafaudages de carton un édifice solide, qui n’est peut-être pas suffisamment coordonné, mais qui est capable de défier l’action du temps. Exegi monumentum ære perennius. [J’ai élevé un monument plus durable que le bronze. (Horace, Odes, III, 30.)]
D’Assigny.
Semaine religieuse du diocèse de Lyon 1er juin 1894
Jeanne d’Arc et l’Église, par le chanoine Ludovic-Martial Mustel, qui renvoie au père Ayroles pour attester de l’approbation universelle de Jeanne par l’Église de son temps.
Note. — Le numéro de la Semaine est consacré à Jeanne, avec notamment une description des dernières fêtes de Jeanne d’Arc à Lyon.
Source : Semaine religieuse du diocèse de Lyon, 1e année, tome 2 (1er juin 1894 - 23 novembre 1894).
Lien : Gallica.
Jeanne d’Arc et l’Église.
I. La condamnation de Jeanne d’Arc au point de vue juridique.
- Pour condamner Jeanne d’Arc, il a fallu violer toutes les lois ecclésiastiques qui devaient être observées et qui la protégeaient.
- Les deux juges étaient absolument incompétents, justement récusés et régulièrement dessaisis.
- La délégation du vice-inquisiteur était nulle, l’inquisiteur, délégué lui-même, n’ayant pas le droit de subdéléguer. Du reste, il n’intervint que lorsque le procès était en cours, et presque toutes les exceptions qui atteignaient l’évêque de Beauvais lui étaient applicables.
- Quant à Cauchon, il n’avait aucune juridiction sur Jeanne d’Arc, domiciliée de droit à Domrémy, qui ne relevait que de l’évêque de Toul, et qui n’avait d’ailleurs accompli aucun des actes pour lesquels elle était accusée dans le diocèse de Beauvais.
- De plus, contrairement au droit canonique, d’après lequel on prétendait la juger, elle était retenue au pouvoir de ses ennemis. Elle était enfermée dans une prison civile, dans une forteresse, gardée par des’ hommes, par des soldats, au lieu d’être renfermée dans un couvent ou dans une prison ecclésiastique. — Cauchon était suspect de haine contre elle, — et, pour ce motif, elle l’avait récusé en termes suffisamment significatifs. — Elle avait réclamé l’adjonction au tribunal de membres de son parti, en nombre égal aux membres qui appartenaient au parti anglais, ce qu’on ne pouvait lui refuser, non seulement en équité, mais d’après les dispositions expresses des lois de l’Église. — Enfin, à plusieurs reprises, elle en avait appelé au Pape, et cet appel enlevait à ses juges tout droit et tout pouvoir de passer outre, quand même elle eût été justiciable d’eux auparavant. Chacun de ces motifs, nous venons d’en relever sept, rendait nuls tous les actes du procès.
- Bien plus : la cause par elle-même relevait du Pape, comme étant en matière de foi et impliquant des questions ardues, délicates et difficiles.
- Enfin, le principal grief pour lequel Jeanne fut poursuivie et condamnée ne tombait sous la compétence d’aucun tribunal humain, l’Église ne jugeant pas de la réalité des révélations privées, tant que les personnes qui s’en disent ou s’en croient favorisées ne professent aucune erreur en matière de foi et ne donnent aucun mauvais exemple.
- La procédure pèche encore en ce qu’elle ne fut pas précédée d’une enquête sur le mauvais renom de l’accusée en matière de foi, ce que le droit exige strictement.
- Une autre cause de nullité était le refus obstiné d’un défenseur, quoique l’accusée, par son âge, son sexe, son défaut d’instruction, eût un droit spécial aux conseils et à l’appui de défenseurs choisis par elle.
- Dans la conduite du procès, c’était un abus prévu et prohibé par le droit de vouloir contraindre Jeanne à prêter serment de répondre à tout ce qu’on lui demanderait. On ne devait pas non plus faire renouveler le serment sans nécessité.
- Un autre défaut du procès vient de ce que les questions superflues, subtiles, captieuses, équivoques y abondent.
- En résumant ses réponses, on en a perverti le sens. On a refusé de lui laisser entendre la messe, ce qu’on ne doit pas refuser aux pires scélérats.
- Quant au fond, aucune de ses réponses, aucun de ses actes ne peut servir de base à une accusation d’hérésie ; au contraire, elle a toujours professé la foi la plus pure.
- Elle avait de justes raisons de porter un habit viril.
- Ses révélations ne donnaient lieu à aucune poursuite.
- Il est faux qu’elle ait refusé de se soumettre à l’Église, puisqu’elle en appelait au Pape ou au Concile ; mais ses juges prétendaient l’obliger à accepter leur jugement comme s’ils eussent été l’Église, ce qu’elle avait raison de refuser.
- On sait ce qu’il faut penser de la prétendue abjuration de Jeanne d’Arc. Ce fut un acte frauduleux, qu’elle ne comprit pas, auquel on l’amena par dol, tromperie, menaces et violences, et qui était radicalement nul. Aussi la grande majorité de ses juges, à la suite de l’abbé de Fécamp, Jean de Duremort, furent-ils d’avis, lors du second procès, que la formule d’abjuration, qui n’était pas celle qu’on lui avait lue, devait lui être relue et expliquée. Mais en ce cas on ne pouvait pas la condamner comme relapse, ainsi que le voulait Cauchon. Cette condamnation fut donc, à ce titre encore, une illégalité flagrante. En dernier lieu, la loi ecclésiastique fut violée en ce qu’on ne lui a pas proposé l’absolution, et en ce qu’elle a été livrée au supplice sans y avoir été condamnée par la sentence des juges séculiers.
Rappelons, une fois de plus, que, sur tous ces points, et sur beaucoup d’autres mentionnés par les évêques et les canonistes qui examinèrent plus tard le procès de Rouen, le droit canonique fut outrageusement violé.
II. La condamnation de Jeanne d’Arc et le clergé. — Était-ce avec la connivence de l’Église et du clergé que Jeanne d’Arc fut condamnée ?
Évidemment non. Cauchon eut des complices qui partagent justement avec lui la réprobation et le mépris de la postérité ; mais ils ne furent, par rapport à l’Église de leur temps, qu’une infime minorité. Ils avaient été choisis avec soin parmi ceux sur lesquels les Anglais croyaient pouvoir compter.
Les Dominicains de Rouen étaient si manifestement favorables, que ceux qui réprouvaient le supplice de Jeanne les prenaient pour confidents.
C’était à eux que le bourreau et ceux qui, comme lui, se repentaient, allaient se confesser. Le 30 mai, frère Pierre Bosquier, de l’ordre de Saint-Dominique, osa dire qu’en condamnant Jeanne comme hérétique, Pierre Cauchon avait mal fait. Celui-ci sentit si bien que ce jeune frère était l’écho de l’opinion publique qu’il usa envers lui d’une rigueur extrême, en le condamnant à une amende honorable et à la prison où, pendant neuf mois, il dut jeûner au pain et à l’eau.
Que si nous sortons de Rouen et des terres où dominaient les Anglais, le clergé, évêques en tête, vénère la Libératrice de la France. Il faut lire, dans le beau livre du P. Ayroles, ce que pensaient d’elle le chancelier Jean Gerson, Jacques Gélu, archevêque d’Embrun, les évêques de Montpellier, de Grenoble, de Digne, de Poitiers, les juges de Poitiers, etc. En dehors même de France, en Allemagne, à Rome, le clergé admire, acclame l’Envoyée de Dieu. Quand Jeanne tombe au pouvoir de l’ennemi, l’archevêque d’Embrun écrit au roi qu’il faut prier publiquement pour sa délivrance, et l’on récite en effet, à la messe, dans ce but, les Collecte, Secrète et Postcommunion que l’on peut lire à la fin de l’ouvrage si souvent cité du P. Ayroles.
Mais ce sont les ennemis de Jeanne d’Arc qui ont, dans leur aveuglement, rendu le témoignage le plus explicite de cette vérité : la Libératrice de la France était chère à l’Église. Dans la lettre de félicitations adressée par l’Université de Paris à Pierre Cauchon se trouve cette phrase, qui résume la situation :
Per cujus latissime dispersum virus, ovile christianissimum totius fere occidentalis orbis injectum manifestatur. Jeanne est une femme empestée dont le venin s’est répandu si loin de toutes parts que presque tout le monde occidental, ce bercail très chrétien, en est manifestement infecté.
Ce bercail très chrétien, c’est l’Église ; elle est favorable à la Pucelle. L’Université conclut que l’Église presque tout entière est empoisonnée. et que notable et grande réparation est très nécessaire pour que le peuple qui a été moult scandalisé par icelle femme soit réduit à bonne et saine doctrine.
Aussi, après le procès, Cauchon et ses complices furent-ils pris de peur, et ils s’empressèrent de solliciter du gouvernement anglais des lettres de garantie, qu’ils obtinrent. Par ces lettres le roi d’Angleterre se porte comme le défenseur de tous ceux
qui ont pris part au procès de Jeanne à un titre quelconque, depuis les juges jusqu’au greffier ; il se charge des coûts et dépens que leur ferait subir une citation devant le Saint-Père ou le Concile général, et se porte partie avec eux. Ordre est intimé à tous ses ambassadeurs, envoyés, prélats, docteurs, maîtres, procureurs, à tous ses sujets du royaume de France et d’Angleterre, de leur porter aide et secours contre ledit Saint-Père ou le Concile général. Ce n’est pas assez ; ils doivent, y est-il dit, requérir aide des rois, princes et seigneurs à nous alliés et confédérés.
Quel aveu dans ces précautions !
L.-M. Mustel.
La Vérité 3 juin 1894
Article d’Édouard Pontal consacré aux Publications récentes sur Jeanne d’Arc, avec la prééminence donnée à la Vraie Jeanne d’Arc.
Lien : Retronews
Un vieux proverbe, qui celui-là du moins n’est pas, contrairement à la bonne réputation qu’on a faite aux proverbes, l’expression de la sagesse des nations, dit que : Passée la fête, passé le saint. Nous ne devons pas permettre qu’on puisse dire cela de Jeanne d’Arc. Le mois anniversaire de ses victoires et de son martyre est passé, les fêtes sont finies, mais nous devons tout faire, en bons catholiques et bons Français que nous sommes, pour que son souvenir ne s’oublie pas.
[Plan de l’article : I. Tracts ; II. Feuilles éphémères ; III. Albums illustrés (sont cités les ouvrages de l’abbé Henri Debout, de l’abbé Victor Mourot, de Marius Sepet, et celui à paraître d’Émile Keller) ; IV. Propagande (ouvrages de l’abbé Paul Fesch, de Mgr Antoine Ricard, les panégyriques de l’abbé Anselme Mouchard, du père Feuillette, de M. Chesnelong, etc., et toujours les ouvrages d’Henri Wallon et de Marius Sepet ; V. Livres d’érudition :]
À raison de son importance, je dois placer le grand ouvrage du R. P. Ayroles au premier rang. Quand il sera terminé,ce sera un grand monument, le plus considérable qui existe, élevé à la mémoire de Jeanne d’Arc. Quiconque voudra écrire désormais la vie de Jeanne d’Arc ne pourra pas se passer de le consulter. Cette grande œuvre comprend déjà deux gros volumes in-4°, où les sources historiques de l’histoire de Jeanne d’Arc coulent à pleins bords.
Le premier volume de cet ouvrage, qui a pour titre général : La Vraie Jeanne d’Arc, est intitulé : La Pucelle devant l’Église de son temps ; le second : La Paysanne et l’Inspirée (Gaume). L’auteur nous en annonce trois autres, qui nous feront connaître tour à tour la guerrière et la martyre. Souhaitons que l’auteur ait le temps et la force d’achever ce grand travail, dont je ne veux rien dire de plus aujourd’hui pour ne pas répéter ce qui en a été déjà dit ici même par un juge compétent et autorisé.
[Suivent la présentation des ouvrages des pères Belon et Balme Jean Bréhal, grand Inquisiteur de France, et la réhabilitation de Jeanne d’Arc ; du R. P. Chapotin, Jeanne d’Arc et les Dominicains ; de Pierre Lanéry d’Arc Bibliographie raisonnée et analytique des ouvrages relatifs à Jeanne d’Arc, et un article de Marius Sepet dans le Polybiblion de mai 1894.]
La Vérité 5 juin 1894
D’Auteuil, Questions historiques (feuilleton). — Mention du point de vue du père Ayroles dans un article sur la nationalité de Jeanne d’Arc
: Française ou Champenoise.
Lien : Retronews
La question de la nationalité de Jeanne d’Arc a été déjà bien des fois discutée. Était-elle lorraine, la bonne Lorraine
, comme Villon l’a surnommée le premier, comme l’ont répété et le répètent encore de nombreux imitateurs, sans avoir l’air de soupçonner l’importance de la question ? Ou bien était-elle française par sa naissance,…
[…]
Il est vrai que le R. P. Ayroles, en revenant à son tour sur la question dans le deuxième volume de son magnifique ouvrage (La Vraie Jeanne d’Arc), semble avoir adopté un système mixte, d’après lequel le berceau de la Pucelle, rattaché à la Champagne par des liens administratifs et politiques, aurait cependant tenu au pays lorrain par le diocèse d’où il dépendait, et qui était celui de Toul. Cette explication, fondée sur un fait réel, offrirait l’avantage de concilier dans une certaine mesure les deux opinions.
Bibliographie de la France 16 juin 1894
Indexation du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc.
Source : Journal général de l’imprimerie et de la librairie, 83e année, 2e série, tome 38, p. 366, n° 24, 16 juin 1894.
Lien : Google
5743. Ayroles (J. B. J.). — La Vraie Jeanne d’Arc. II : la Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre pensée ; par Jean-Baptiste-Joseph Ayroles, de la Compagnie de jésus. In-4°, 567 p. Corbeil, imp. Crété. Paris, lib. Gaume et Ce. 15 fr.
Seconde indexation parmi les Chroniques.
Source : Journal général de l’imprimerie et de la librairie, 83e année, 2e série, tome 38, p. 148, n° 25, 23 juin 1894.
Lien : Google
9534. — Vraie Jeanne d’Arc (la) ; la paysanne et l’inspirée, par le R. P. Ayroles. In-8°. (Gaume et Cie.)
Bibliographie de la France 23 juin 1894
Indexation du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc.
Source : Journal général de l’imprimerie et de la librairie, 83e année, 2e série, tome 38, n° 25, 23 juin 1894, p. 148.
Lien : Google
9534. Vraie Jeanne d’Arc (la) ; la paysanne et l’inspirée, par le R. P. Ayroles. In-8° (Gaume et Cie.)
Études 30 juin 1894
Compte-rendu du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc par le père Albert de Salinis, qui loue un livre de combat
idéologique (réfutation des naturalistes) et politique (contre la franc-maçonnerie) :
Comme on le voit, le chevalier de Jeanne d’Arc n’y va pas de main-morte.
Il conclut pourtant qu’il manque au père Ayroles des armes mieux affinées et une tactique plus habile
. Qu’entend-il par là ? Plus haut, il écrivait :
Le lecteur est justement effarouché par la dureté du coup de pinceau, et si l’art souvent fait défaut, la sincérité du peintre lui donne une satisfaction méritée.
Source : Études religieuses, etc., 31e année, supplément aux tomes 41, 42 et 43, p. 903.
Lien : Gallica
C’est un monument aux proportions gigantesques que le Père Ayroles tente d’élever à la gloire de Jeanne d’Arc. Déjà un premier in-octavo de plus de cinq cents pages a paru ; un second volume de près de six cents pages succède au premier, et trois autres aussi considérables sont annoncés par le pieux et savant auteur. Le Père Ayroles s’est fait dans notre siècle le chevalier de l’héroïque Pucelle. Il défend cette fois la Pastourelle de Domrémy contre ses nombreux adversaires, et fait tous ses efforts pour repousser toutes les attaques.
La tactique des Michelet, Quicherat et autres adversaires est variée ; de là cette longue réfutation qui ne saurait faire reculer l’infatigable champion de la sainte héroïne. Il ne fait pas grâce à l’ennemi d’un seul coup. Il est là sur tous les points contestés ; il s’escrime avec ardeur et dévisage les mécréants sans sourciller. Les armes défensives sont les documents authentiques sur la vie et la mission de Jeanne, étudiés avec soin, connus dans le détail : véritable arsenal où l’auteur cherche et trouve réponse à tout et à tous. Le bon chevalier ne connaît pas les ménagements, et les coups portés sont parfois pleins de rudesse. Il va à la bataille bien décidé à ne pas faire merci, et l’on sent à sa manière qu’il a fréquenté les hommes d’armes du quinzième siècle.
Le nouveau volume du grand ouvrage sur la Vraie Jeanne d’Arc succède à la Pucelle devant l’Église et son temps ; il a pour titre la Paysanne et l’Inspirée. Le Père Ayroles y étudie Jeanne la Pucelle a Domrémy et à Vaucouleurs jusqu’à son arrivée à Chinon. C’est d’abord un tableau, aux mille traits s’entrecroisant, de la chrétienté durant les années obscures de la Pucelle
, des déchirements de la France, de l’impuissance de Charles VII, de la misère des peuples. Aucun détail n’est oublié, et ce spectacle un peu étourdissant donne bien l’idée de la grande pitié qu’il y avait alors au royaume de France. Le lecteur est justement effarouché par la dureté du coup de pinceau, et si l’art souvent fait défaut, la sincérité du peintre, qui ne cache aucune laideur, lui donne une satisfaction méritée.
On éprouve plus de charme à lire le livre second, consacré aux aveux de Jeanne. Qui n’entend sans émotion les réponses, si claires, si françaises et si chrétiennes de la Pucelle pressée par les questions de ses juges ? Le commentaire de l’historien, bien qu’il diminue l’allure vive et chevaleresque des réparties de Jeanne, cependant, par la sagacité et le bon sens qui l’inspire, intéresse le lecteur et lui fait prendre goût à une polémique à chaque page plus ardente.
Les témoins oculaires des premières années de la paysanne inspirée défilent bientôt sous nos yeux au livre troisième. Ce sont les parrain, marraine, parents par affinité spirituelle
de Jeanne, les anciens du village, les jeunes filles et jeunes gens de son âge, les prêtres, les nobles et les bourgeois, ce sont ses guides. Tous redisent les mêmes choses, et leurs témoignages scrupuleusement rapportés forment, à la gloire de la Pucelle, des litanies d’une monotonie austère, mais d’une éloquence irrésistible.
Le livre IV est consacré aux pièces complémentaires et aux éclaircissements. L’érudit se donne libre carrière le polémiste achève de se revêtir de ses armes, et dans le livre V il part en guerre contre la libre-pensée.
L’auteur déclare d’abord que ce serait être infini que de vouloir relever toutes les incohérences auxquelles la sainte fille sert de thème
(p. 342) ; et passe à Michelet, à ses chapitres systématiques et un peu fous
, puis lâchant la bride à son indignation, il s’écrie : C’est le siècle des idées chaotiques qui reproche aux siècles chrétiens de n’avoir su voir dans la France qu’un chaos de fiefs, d’idée vague !
et se redressant fièrement, il montre du doigt la tourbe calomniatrice des fils de Rousseau et d’Arouet
, et leur lance cette apostrophe victorieuse : Nous avons fait la France de Clovis, de Charlemagne, de Philippe-Auguste et de saint Louis ; ils ont fait la France des trois invasions, des vingt constitutions, de la maçonnerie, de la juiverie, du Panama !
Cette riposte est dans le goût et du style habituel au journalisme, mais elle fait connaître l’idée-mère du grand œuvre du P. Ayroles.
Mettre en regard ce qu’il plaît au naturalisme d’imaginer sous le titre d’Histoire de Jeanne d’Arc ; en montrer la fausseté au point de vue des faits, l’incohérence, les contradictions au point de vue de la raison, faire juger par ce spécimen sa méthode historique, c’est le but des volumes en voie de publication sous le titre commun de la Vraie Jeanne d’Arc. (Préface, p. VII.)
Quicherat est pris à partie dans le chapitre III (liv. V). Il a rêvé une burlesque fillette, dont il falsifie et calomnie les communications surnaturelles.
Fortement houspillé, il est convaincu de déraison pour avoir voulu fuir le surnaturel. Le même sort est réservé à Henri Martin, qui a fait de Jeanne d’Arc un personnage fantastique, impossible et monstrueux
(p. 401). Vallet de Viriville n’est qu’un esprit grisé par le sentiment de son importance
( p. 406), et ce travailleur à la loupe
(p. 403) montre de quelle épaisseur de vue peuvent être atteints ceux qui, écartant de haut le surnaturel, abordent la Pucelle, et manquent d’ailleurs des qualités de style qui peuvent dissimuler h des lecteurs superficiels l’extravagance des conceptions
(p. 404).
Siméon Luce naïf et fantaisiste, se contredit, fait des contes impossibles et présente une histoire ultra-fabuleuse
( p. 431 ) il se permet des hypothèses gratuites, monstrueuses
(p. 437), et nous offre un roman absurde
(p. 447). Il outrage le bon sens, la décence
(p. 449), divague, et ses imaginations bouffonnes et ineptes
( p. 471) sont le fruit d’un athéisme idéalistique et cafard
(p. 475 ) ; il paraît que les catholiques s’y sont mépris, et il est temps qu’aucun homme sérieux n’aille demander la connaissance de la Pucelle à ces trois cents pages de rhapsodies, qui outragent également la vérité historique, la raison et la foi
(p. 477).
Comme on le voit, le chevalier de Jeanne d’Arc n’y va pas de main-morte. Le P. Ayroles frappe d’estoc et de taille. Son livre, tout érudit qu’il est, est un livre de combat. Lui-même l’avoue dans sa conclusion (p. 484) :
Faire connaître la Pucelle, c’est combattre la grande ennemie du genre humain et particulièrement des petits et des humbles la franc-maçonnerie.
Mais pour assurer la victoire au vaillant champion, le lecteur ne lui souhaitera-t-il pas des armes mieux affinées et une tactique plus habile. Peut-être serait-il ainsi plus à même de bouter dehors
la juiverie et la franc-maçonnerie.
A. de Salinis, S. J.
Revue thomiste juillet 1894
Compte-rendu du tome II par le père Marie-Dominique Chapotin, dominicain, historien, lui-même auteur d’une Jeanne d’arc et les dominicains (1888).
Le P. Ayroles entre carrément en lutte avec la libre-pensée. Au fond c’est là le point capital de l’œuvre. C’est la pensée qui l’a inspirée.
Le commentaire est élogieux, et consacré en bonne part à la réfutation par Ayroles de la thèse de Siméon Luce sur la soit-disant rivalité entre les dominicains bourguignons et les franciscains armagnacs. Mais si Chapotin applaudit le fond (lui-même avait réfuté Luce), il désapprouve la forme.
Pauvre M. Siméon Luce ! Dieu sait de quelles précautions respectueuses j’ai constamment enveloppé les objections que j’opposais à une thèse inacceptable au point de vue historique et gratuitement injurieuse pour nous. Mais ici plus de gants d’aucune sorte ; on l’étrille sans façon. J’aurais pourtant préféré dans la critique plus de possession de soi.
Sauf cette réserve, [le père Ayroles] rend à la science historique en même temps qu’à la religion un véritable service.
Source : Revue thomiste (père dominicains), 2e année, n°3, juillet 1894, p. 418-423.
Lien : Google
La Vraie Jeanne d’Arc par le R. P. Ayroles S. J.
Saint-Julien-du-Sault, le 11 juin 1894.
Mon Révérend et cher Père,
Il m’est très agréable, puisque vous le désirez, de parler aux lecteurs de la Revue du nouveau volume donné au public par le R. P. Ayroles, S. J., en continuation de son grand travail : La Vraie Jeanne d’Arc.
Le laborieux écrivain exprime lui-même en ces termes le but qu’il poursuit :
Mettre quiconque n’est pas sans culture intellectuelle en état de voir, d’étudier dans son ensemble et dans ses détails semblable existence (celle de Jeanne d’Arc) ; la produire dans tout son jour en faisant connaître les temps, les lieux dans lesquels elle s’est manifestée ; aborder les questions de quelque intérêt qu’elle fait naître et en donner la solution la mieux fondée ; mettre en regard ce qu’il plaît au naturalisme d’imaginer sous le titre d’Histoire de Jeanne d’Arc, en montrer la fausseté au point de vue des faits, l’incohérence, les contradictions au point de vue de la raison ; faire juger par ce spécimen sa méthode historique ; c’est le but des volumes en voie de publication sous le titre commun de la Vraie Jeanne d’Arc. Chacun de ces volumes formera un tout, parce qu’il présentera une des phases, si pleines de contrastes, de l’astre merveilleux. Ils seront au nombre de cinq, s’il nous est donné de mener à terme l’œuvre entreprise.
Ce nouveau tome, le deuxième, a pour titre particulier : La Paysanne et l’Inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée. Il comprend sept livres.
Le livre Ier présente, d’après les autorités les plus incontestables, l’état de la chrétienté, particulièrement de la France et de la Lorraine, pendant les quelques années où Dieu, par des révélations merveilleuses, préparait la vierge de Domrémy à sa mission. Ce grand cadre une fois tracé, l’humble fille, qui va être bientôt l’héroïne,libératrice de la France, est introduite, et les deux livres suivants nous présentent Jeanne d’Are telle que la peignent ses propres aveux d’abord, puis les témoignages officiels de ses contemporains, parrains et marraines, anciens de son village, jeunes filles et jeunes gens de son âge, prêtres, nobles et bourgeois témoins de sa pieuse enfance, hommes et femmes qui ont reçu d’elle les premières confidences de sa mission, qui l’ont combattue ou favorisée, enfin gens d’armes qui l’ont guidée jusqu’à Chinon. Au livre IV les témoignages, soigneusement discutés, de Boulainvilliers et d’Alain Chartier complètent cette enquête, à laquelle s’ajoutent divers éclaircissements sur la famille et sur la nationalité de Jeanne, l’exposé et la discussion de certaines circonstances ou de certains faits, minces en apparence, mais qui ont été ou trop négligés par l’histoire ou exploités contre la vérité historique.
Au livre V, le P. Ayroles entre carrément en lutte avec la libre-pensée. Au fond c’est là le point capital de l’œuvre. C’est la pensée qui l’a inspirée.
Comme entrée en matière, l’auteur rappelle le singulier embarras dans lequel le premier magistrat de la ville d’Orléans jeta en 1891 le premier magistrat de la République française, en l’invitant aux fêtes traditionnelles du 8 mai. Il montre d’une façon pittoresque la pitoyable satisfaction donnée par le Président et au sentiment patriotique qui l’attendait à Orléans, et aux susceptibilités possibles de la libre-pensée, qu’il eût été criminel et imprudent d’affronter en prenant part à une fête où la religion, inspiratrice de Jeanne d’Arc, garde encore un rôle éminent.
Ce n’est qu’une entrée en matière. Immédiatement après, le P. Ayroles aborde les hommes qui, à côté du fait historique le mieux prouvé dans toutes ses circonstances et le plus rayonnant de surnaturel, ont voulu élever à la mémoire de Jeanne d’Arc un monument, soi-disant historique, où le surnaturel n’eût point de place.
Au premier rang voici Michelet et Henri Martin. Leur œuvre, c’est tout dire, a fait un jour jaillir de la plume la moins suspecte, celle de Sainte-Beuve, ce mot caractéristique :
Pauvre Jeanne d’Arc ! Des historiens distingués, Henri Martin et Michelet, lui doivent d’avoir fait des chapitres bien systématiques et bien fous.
Le P. Ayroles fait sentir tout ce qu’il y a de creux et de faux dans les belles phrases consacrées à la Pucelle et à son patriotisme par ce Michelet, dont l’admiration de parti pris, aveugle, de gens qui n’ont jamais rien contrôlé, est arrivée à faire un historien indiscutable, un voyant ! Ce voyant, on nous le montre se contredisant effrontément lui-même, par exemple s’obstinant à faire de la Pucelle une pure et simple hallucinée, et en même temps glorifiant le bon sens de Jeanne d’Arc comme son caractère original et la cause de son succès. Sous la plume du P. Ayroles les détails abondent, pour montrer si les esprits soucieux de la vérité historique peuvent prendre au sérieux l’histoire, le portrait de Jeanne d’Arc, quand c’est Michelet qui tient la plume ou le pinceau.
Cette exécution est suivie d’une autre, dirai-je hardie ? C’est que personne peut-être n’a donné aux études relatives à Jeanne d’Arc une impulsion plus vive et plus heureuse que le savant qui tombe après Michelet sous les critiques du P. Ayroles. Aussi on ne le frappe pas sans s’excuser en quelque sorte. Il s’agit de Quicherat. N’importe ; magis amica veritas. Le surnaturel dans la mission et dans l’œuvre de la Pucelle, Quicherat a-t-il pu ne pas l’apercevoir, ne pas le reconnaître ? Il n’a pas osé ou pas voulu dire qu’il le voyait. Il professe la neutralité la plus impartiale entre les affirmations de celle qui se disait envoyée de Dieu
et les curieux qui voudront aller plus loin et raisonner sur une cause dont il ne leur suffira pas d’admirer les effets
. Malheureusement, à côté des documents dans leur teneur originale, Quicherat a publié des Aperçus nouveaux, où sa neutralité inviolable subit de singulières défaillances. Il est si difficile d’être neutre ! Demandez-le plutôt aux prôneurs de notre enseignement officiel, neutre en principe, et en réalité Dieu sait quoi !
Du reste, le P. Ayroles ne s’en tient pas à des accusations générales. Il articule des faits. Par exemple, il met en avant, et il a bien raison, l’insinuation de Quicherat au sujet du saut de la tour de Beaurevoir. Jeanne n’a-t-elle pas voulu échapper aux Anglais par la mort
? Impossible, dit Quicherat, de voir autre chose dans le fait et dans les explications données par Jeanne à ses juges.
En d’autres termes, Jeanne désespérée a succombé à la tentation du suicide. Et c’est le même Quicherat qui avait édité la réponse de la Pucelle :
Ego faciebam hoc, non pro desperando, sed in spe salvandi corpus meum et eundi ad succurrendum pluribus bonis gentibus existentibus in necessitate.
[J’ai fait cela, non par désespoir, mais dans l’espoir de sauver mon corps et d’aller secourir plusieurs braves gens qui se trouvaient dans le besoin.]
D’autres spécimens du même genre sont empruntés par le P. Ayroles à l’œuvre de Quicherat ; celui-ci nous suffit.
Après Quicherat, Henri Martin et Vallet de Viriville sont à leur tour passés au crible, et il faut avouer que les reproches qu’on leur fait, pour être âpres dans la forme, n’en sont pas moins parfaitement fondés en raison.
De tous les savants qui se sont occupés de Jeanne d’Arc et dont les ouvrages ont fait fortune, aucun n’excite la verve de l’impitoyable jésuite autant que Siméon Luce. Le livre VI, avec ses six chapitres et ses vingt-quatre paragraphes, est consacré tout entier à l’examen critique de Jeanne d’Arc à Domrémy.
Cette publication, dit le P. Ayroles, a valu à M. Luce de passer pour un des tenants de la Pucelle, et lorsqu’une mort soudaine est venue le frapper, les catholiques ont salué en lui la disparition d’un interprète de Jeanne d’Arc… Il s’agit de montrer ce qu’une lecture souvent réitérée a fait découvrir dans un livre ouvert avec des préventions favorables, auxquelles il a fallu totalement renoncer. La thèse du membre de l’Institut est celle de la libre-pensée, Jeanne était sincère, mais elle était hallucinée. Il fallait expliquer le phénomène… Tant que des hypothèses fantaisistes, contradictoires, en opposition avec les faits les mieux avérés, ne seront pas de l’érudition, ne feront pas partie d’une critique digne de ce nom, il faudra nier que la Jeanne d’Arc à Domrémy de M. Luce soit œuvre d’érudition et de critique.
Pauvre M. Siméon Luce ! J’ai été naguère amené à parler au public d’un simple chapitre de son volumineux travail, non pour l’attaquer, mais pour défendre ma famille religieuse et secouer la boue qu’il s’obstinait à jeter sur notre robe blanche : Dieu sait de quelles précautions respectueuses j’ai constamment enveloppé les objections que j’opposais à une thèse inacceptable au point de vue historique et gratuitement injurieuse pour nous. Et pourtant j’ai conscience de l’avoir attristé, irrité. Mais ici plus de gants d’aucune sorte ; on l’étrille sans façon.
Les efforts de ce malheureux savant pour isoler, autant que possible, du surnaturel, du miraculeux, du divin, la mission et l’œuvre de la Pucelle sont à la fois si naïfs et si impuissants, qu’il suffisait, à mon sens, de les signaler. Certes, l’indignation du catholique se conçoit en face d’une pareille œuvre, et en face du succès invraisemblable que lui ont fait, après une lecture superficielle ou sans l’avoir lu, des catholiques. J’aurais pourtant préféré dans la critique plus de possession de soi. La tentation d’appliquer à Jeanne d’Arc à Domrémy la qualification méritée par la Vie de Jésus de Renan : Livre pieusement impie
se présente d’elle-même à l’esprit ; néanmoins pourquoi ne pas mettre simplement le lecteur à même de juger, de qualifier, de flétrir s’il y a lieu la fausse et hypocrite impiété de l’auteur
, les formes burlesques et bouffonnes, les formes cafardes
sous lesquelles l’impiété idéalistique se déguise
dans son œuvre, les impiétés sournoisement répandues dans le volume tout entier
?
Mais il y avait là tout un nuage gros à la fois d’illusion et d’admiration, que le P. Ayroles a voulu à la fin crever d’un coup. Sauf cette réserve, il rend à la science historique en même temps qu’à la religion un véritable service, en dévoilant le système, inconscient peut-être de ses propres conséquences, qui veut expliquer par un ensemble de circonstances toutes naturelles cette mission de Jeanne d’Are, où l’intervention souveraine d’une inspiration et d’une force surnaturelles est claire comme le jour.
En dehors de cette préoccupation générale qui domine dans l’ouvrage de Siméon Luce, le regrettable savant a laissé échapper de temps en temps des phrases on ne peut plus malheureuses au point de vue religieux. Je n’ai pu moi-même me retenir d’en souligner quelques-unes dans mon opuscule, mais comme un homme pressé, qui ne veut pas faire un gros livre et qui tient à se renfermer strictement dans son sujet. Je sais pour mon compte un gré infini au P. Ayroles d’avoir relevé et réfuté par tant d’erreurs, et d’avoir le fait montré combien cet ouvrage doit provoquer de défiances, en dépit des louanges aveugles que lui ont prodiguées, en même temps qu’à son auteur, des catholiques imprudents.
Vous vous demandez ce que pense le P. Ayroles des questions d’histoire, sur lesquelles j’ai été obligé de m’inscrire en faux contre M. Siméon Luce. Il leur consacre tout le chapitre V. Sur tous les points il est non moins affirmatif que j’ai cru devoir l’être, sauf peut-être au sujet de ce misérable apologiste du régicide, Jean Petit, dont il ferait volontiers un franciscain, mais dont il faut, au nom de l’histoire, débarrasser la famille de saint François, malgré la persistance de certains de ses amis à le revendiquer pour elle : ses annales sont assez riches sans qu’on leur prête cette illustration fâcheuse.
Voici du reste le sommaire de ce chapitre V. Il fera comprendre mieux que tout autre exposé la pensée et la doctrine historique du P. Ayroles sur les points multiples et délicats où il a plu à Siméon Luce d’opposer Dominicains et Franciscains :
I. La thèse de M. Luce : les Dominicains inféodés au parti bourguignon, les Franciscains au parti armagnac. Suite d’assertions outrées ou fausses… Sa totale méprise quand il présente Jean Petit comme un Dominicain… Ses écrits sont condamnés au feu à Paris par un Dominicain, grand inquisiteur. Le Dominicain Martin Porée, qui les défend à Constance, engageait moins son Ordre que le substitut du vicaire général des Franciscains qui les défendait avec lui. C’est un Franciscain qui prêche lors de l’amende honorable ménagée par le Bourguignon triomphant à son apologiste.
II. Il est faux de présenter les Franciscains comme particulièrement solidaires les uns des autres… Contre-vérité par laquelle M. Luce donne les Franciscains, enquêteurs à Domrémy, comme envoyés par Charles VII, lorsqu’ils l’étaient par Cauchon.
III. Rien n’établit que Jeanne ait été affiliée à l’Ordre de Saint-François. Les Frères Mineurs dont on trouve la trace dans l’histoire de la Pucelle. Le rôle des Frères Prêcheurs dans le divin poème.
IV. La dévotion au Saint Nom de Jésus aussi ancienne que le Christianisme. Comment elle fut pratiquée au XIVe siècle par le Dominicain Henri Suzo… Il est faux de dire d’une manière absolue que la dévotion au Saint Nom de Jésus et la prochaine venue de l’Antéchrist furent cause de discorde entre l’Ordre de Saint-Dominique et celui de Saint-François.
V. Les truchemans bouffons imaginés par M. Luce pour faire arriver à Jeanne les prédications de Frère Richard. Ce qu’il donne comme la cause a été précédé par l’effet… Multiples absurdités des hypothèses de M. Luce.
Cette longue citation, si instructive, ne peut que présenter un grand intérêt aux amis de la famille de saint Thomas et de saint Dominique. Rien ne permet mieux de se faire une idée exacte du grand travail du P. Ayroles. Aussi c’est par elle que je termine cette longue épître, en vous priant, Révérend et cher Père, d’agréer mon fraternel et entier dévouement en N.-S. J.-C.
Fr. M. D. Chapotin,
des Fr. Préch.
Revue du monde catholique 1er juillet 1894
Compte-rendu du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc, signé L. B., docteur en philosophie
. Bonne synthèse des points essentiels du volume.
Il est à noter que le critique a parfaitement saisi les motifs et les objectifs de l’enquête à Domrémy, lors de la réhabilitation :
Les délégués pontificaux pour le procès de réhabilitation n’avaient rien omis afin de se procurer les informations sur lesquelles Cauchon avait prétendu appuyer son entreprise contre Jeanne. Peine inutile, non seulement elles ne furent pas retrouvées, mais personne ne les avait vues. C’est alors qu’ils se décidèrent à commander au lieu d’origine une enquête juridique portant sur les points qui avaient servi de prétexte à la condamnation.
Source : Revue du monde catholique, 33e année (1894), t. 119 (6e série, t. III), n° 7 (1er juillet), p. 145-342.
Lien : Gallica
La Vraie Jeanne d’Arc, II : La Paysanne et l’Inspirée d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée, par Jean-Baptiste-Joseph Ayroles, de la Compagnie de Jésus.
La Vraie Jeanne d’Arc, voilà un titre bien choisi et parfaitement justifié dans toute la suite de l’ouvrage. Il ne manque pas de personnes, même parmi les catholiques, qui s’imaginent connaître Jeanne d’Arc et qui cependant n’en ont qu’une idée fort inexacte ou même fausse. La libre-pensée a travesti notre héroïne : ses fantaisies seront pleinement réfutées, et des documents incontestables nous présenteront Jeanne d’Arc telle qu’elle fut, avec des développements d’un intérêt toujours croissant.
Des cinq volumes dont se composera le beau monument que le Révérend Père Ayroles élève à notre sainte et glorieuse Pucelle, celui-ci est le second : il renferme tout ce qui nous a été transmis sur Jeanne depuis sa naissance jusqu’à son arrivée à Chinon. Après les savantes et nécessaires discussions du premier volume, nous abordons ici la plus complète et la plus véridique des histoires publiées sur la Pucelle, qui en compte un si grand nombre et si peu qui nous donnent sa vraie figure.
Mais pour comprendre l’opportunité, l’importance et la portée de la mission que Dieu allait confier à Jeanne, il est nécessaire de se rappeler l’état de la chrétienté et surtout de la France, au moment de l’apparition de la céleste envoyée et durant les années de sa préparation. C’est la raison des premiers chapitres, où nous voyons une suite de tableaux si sombres et si navrants, malgré le grand nombre de thaumaturges et de saints éminents, contemporains de la Pucelle, qui viennent contrebalancer la diminution, toujours si funeste au monde, de l’autorité pontificale, et montrer, sous des formes différentes, comme le fera Jeanne avec non moins d’éclat, que Jésus-Christ est toujours fidèle à sa promesse et qu’il reste avec son Église, en dépit d’immenses scandales.
Aux déchirements de l’Église répondent les déchirements de la France. Démence de Charles VI, guerres abominables, trahisons, assassinats, affreuses dévastations, horribles massacres, le roi d’Angleterre proclamé roi de France, tout porte au comble le malheur de notre pays. Partout une indescriptible misère, d’indicibles calamités. Dans son impuissance, dans sa détresse extrême, dans son désespoir, Charles VII, alors très pieux, adresse au ciel les plus ferventes prières pour son peuple. Ces supplications, auxquelles se joignent celles de tout ce qu’il y a de sérieusement chrétien dans le royaume, sont exaucées. Dieu, qui exalte les humbles et humilie les superbes, a suffisamment formé dans l’ombre et le silence l’instrument de sa miséricordieuse intervention : Jeanne, obéissant à ses ordres, va venir et changer la face des choses.
Encore un chapitre sur la Lorraine durant les jours obscurs de la Pucelle, un chapitre sur Domrémy à cette époque et aujourd’hui, et le R. P. Ayroles, après un coup d’œil préliminaire sur le procès de Rouen, commence, au sujet de Jeanne, ces délicieux détails qui s’opposent avec tant de charme à la poignante horreur des premiers tableaux : Vie extérieure de Jeanne à Domrémy, incidents de cette vie, éducation de Jeanne par saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite, qui lui apparaissent souvent et la préparent à sa mission, aux grands sacrifices et au martyre. Quelles ravissantes scènes ! Et combien, au milieu de ces merveilles, Jeanne est humble, obéissante et pure ! Et quelle parfaite orthodoxie dans tout ce qu’elle dit ! Mais il faut aller à Chinon : Dieu ordonne, Jeanne n’hésite pas, elle demande au capitaine de la châtellenie de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt de la faire conduire au roi. On la traite de folle, peu lui importe,elle s’y attendait,elle insiste, ne tarde pas à faire partager sa conviction que Dieu veut se servir d’elle pour le relèvement de la France. Elle endosse un vêtement d’homme, sur le commandement de son Seigneur du ciel, et la voilà avec ses guides sur le chemin de Chinon, où elle arrive sans encombres malgré tous les dangers qu’il y avait à craindre.
Telles sont les particularités que Jeanne nous a révélées sur ses dix-sept premières années, sur sa vie obscure. Beaucoup ne pouvaient être manifestées que par elle et seraient restées inconnues sans l’inique procès de Rouen. À Domrémy, elle était seule à voir, à entendre les célestes maîtresses et les purs esprits qui faisaient son éducation. Mais tous les habitants du village étaient les témoins de sa vie extérieure : cette vie s’accordait-elle avec une telle éducation ? Voyait-on dans Jeannette les reflets du surnaturel et du divin ? C’est ce que les témoins vont nous dire.
Les délégués pontificaux pour le procès de réhabilitation n’avaient rien omis afin de se procurer les informations sur lesquelles Cauchon avait prétendu appuyer son entreprise contre Jeanne. Peine inutile, non seulement elles ne furent pas retrouvées, mais personne ne les avait vues. C’est alors qu’ils se décidèrent à commander au lieu d’origine une enquête juridique portant sur les points qui avaient servi de prétexte à la condamnation.
Heureuse mesure pour la postérité ! Nous lui devons d’avoir sur les dix-sept premières années de la jeune fille, des détails tels qu’on n’en possède de cette valeur au sujet d’aucun personnage historique. Si la Pucelle avait prolongé sa vie jusqu’à la réhabilitation, elle aurait eu à peine quarante-cinq ans. Lors donc que l’enquête se faisait à Domrémy, la génération déjà adulte au moment de sa naissance se trouvait encore largement représentée, et celle qui était venue à l’existence avec Jeanne était dans la pleine maturité de l’âge. Nous avons autant d’historiens parfaitement informés qu’il y a de témoins, et l’on en compte trente-quatre. Ils déposent sous la foi du serment, en face de Dieu qu’ils savent être le vengeur du parjure, comme on a soin de le leur rappeler.
Rien de plus intéressant que toutes ces dépositions, intégralement reproduites, de paysans et de paysannes, et aussi de prêtres, de nobles et de bourgeois, rendant hommage aux vertus de Jeanne et à l’honnêteté de sa famille. Qui oserait se plaindre d’un accord si parfait, bien qu’il ramène plusieurs fois les mêmes termes et ne laisse place qu’à de légères nuances ? Cette identité de réponses, dans des bouches différentes n’est pas sans charme, et la vérité historique lui doit une évidence de premier ordre.
Nous voilà plus que suffisamment édifiés sur la première période de la vie de Jeanne d’Arc, et nous sommes vraiment stupéfaits que la libre-pensée l’ait trouvée enveloppée de ténèbres, alors qu’elle est éclairée par le jour le plus éclatant. Avec quelle netteté se dégage la physionomie morale de notre héroïne : sa piété, son tendre amour pour le Dieu fait homme, son éloignement du péché, son empressement à rechercher ce qui sanctifie le plus, la messe, la confession, l’eucharistie, la prière, le travail, l’aumône ! Elle a la simplicité d’une jeune paysanne, elle ignore complètement les lettres humaines ; mais elle se montre en tout digne de ses éducateurs célestes.
Le portrait semble achevé : Toutefois, donnons-nous le plaisir de lire et d’apprécier deux lettres du plus haut intérêt. Écrites, durant la période triomphante de Jeanne, à des princes souverains, par des personnages importants de la cour de Charles VII, elles nous présentent un sommaire de la vie de l’héroïne jusqu’au jour de leur date. Elles nous font connaître sur la vie de Domrémy tout ce qui était du domaine public à la cour, où les signataires ont dû voir et entretenir la merveilleuse jeune fille. Elles complètent ainsi fort bien les détails précédents.
Une curiosité fort naturelle et très légitime trouve satisfaction dans les renseignements que nous donne le R. P. Ayroles sur la famille et la nationalité de la Pucelle, sur la date de sa naissance et de la première apparition céleste. On admire la symétrie des principales dates de Jeanne et les raisons de convenance pour que Dieu lui donnât Saint-Michel comme guide principal, et comme maîtresse sainte Catherine d’Alexandrie et sainte Marguerite d’Antioche.
Après l’explication et la coordination de quelques faits particuliers, le Père, voulant toujours ne rien laisser à désirer au lecteur, nous fait connaître l’état actuel des lieux marqués par le séjour où le passage de la Pucelle, depuis sa naissance jusqu’à son arrivée à Chinon, pour ne s’occuper maintenant que des travestissements de la libre-pensée.
Ce n’est pas la partie la moins intéressante de l’ouvrage : il faut voir avec quelle abondance, quelle sûreté et quelle verve, l’auteur réfute les principaux représentants du rationalisme appliqué à Jeanne d’Arc. Comme on comprend bien le mot de Sainte-Beuve, quoique libre-penseur lui aussi !
Pauvre Jeanne d’Arc ! des historiens distingués, Henri Martin et Michelet, lui doivent d’avoir fait des chapitres bien systématiques et un peu fous.
Lisez absolument fous et vous serez dans le vrai : le R. P. Ayroles le montre avec une évidence qui ne peut être surpassée. Et l’on demeure confondu en voyant des esprits qui se croient sérieux nous présenter comme un chef d’œuvre des pages remplies d’insanités.
Tant il est vrai que la raison n’est plus qu’extravagance, quand elle ne veut reconnaître rien au-dessus d’elle-même et qu’elle entreprend d’expliquer un fait aussi surnaturel que toute l’histoire de Jeanne d’Arc. C’est ce que prouve notre auteur d’un bout à l’autre de son livre et spécialement par sa polémique si vive et si entraînante contre les admirateurs naturalistes de l’héroïne.
Mérite fort grand assurément ; mais ce volume, qui forme un tout à part, en renferme bien d’autres, comme on a pu l’entrevoir par ce trop court et trop pâle compte-rendu. Il met dans tout son jour la paysanne et l’inspirée que fut Jeanne d’Arc, sans oublier aucune des circonstances qui mettent en relief sa personne et sa mission : et chemin faisant, toujours fort à propos, il nous rappelle des points de doctrine et de morale chrétienne qui ont bien leur prix. Ajoutons que l’actualité y trouve sa place.
L. B.
Docteur en Philosophie.
Le Canoniste contemporain juillet-août 1894
Bref compte-rendu du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc par l’abbé Auguste Boudinhon, directeur de la revue et professeur de droit canon à l’Institut catholique de Paris.
Boudinhon livre un rapide sommaire de l’œuvre puis, tout en approuvant la critique des interprétations plus ou moins naturalistes
de la mission de Jeanne, il conclue que moins de combativité
dans le ton eut été préférable :
C’est un chevalier qui frappe d’estoc et de taille, et les tempéraments batailleurs trouveront dans l’ouvrage de quoi se délecter. Pour moi, qui professe des allures plus pacifiques, je ne puis m’empêcher de penser que la main est parfois trop lourde et les coups trop écrasants.
Source : Le Canoniste contemporain, 17e année (1894), double livraison 199-200 (juillet-août 1894, paraît le 15 du mois), p. 508-509.
Lien : Gallica
Après avoir étudié dans un tome premier, semblable à celui-ci, la Pucelle devant l’Église de son temps, le R. P. Ayroles entreprend d’écrire l’histoire détaillée de la vie et de la mission de Jeanne d’Arc. Le présent volume comprend l’enfance et la jeunesse de Jeanne et s’arrête à l’arrivée à Chinon de la libératrice.
À ce vaste monument en cinq volumes, il fallait une introduction proportionnée ; c’est le livre I, ou l’auteur nous décrit, en un sombre tableau, la chrétienté, la France et la Lorraine durant les années obscures de la Pucelle
. L’Église était déchirée parle grand schisme, la France par les factions ; Charles VII était réduit à l’extrême détresse ; les peuples dans une indescriptible misère
.
C’est alors qu’apparaît la Pucelle. Nous la suivons à travers sa calme et obscure jeunesse ; nous entendons les voix qui lui décrivent la grande pitié qui est au royaume de France, et qui lui donnent à elle, pauvre petite paysanne, la mission de faire sacrer le roi à Reims, de bouter les Anglais hors de France. Nous assistons à son voyage de Domrémy à Chinon, où elle va se trouver en présence de Charles VII. Tous ces faits sont rapportés et commentés, dans le Livre II, d’après les aveux de Jeanne au cours de son procès ; dans le livre III, d’après les dépositions des témoins oculaires.
Le livre IV complète les renseignements fournis par les précédents à l’aide d’autres sources historiques. Enfin dans le livre V, sous ce titre significatif : La paysanne et l’inspirée travestie par la libre-pensée, l’auteur entreprend une critique détaillée de ce qu’ont écrit sur la première partie de la vie de Jeanne, Michelet, Quicherat, Henri Martin et Vallet de Viriville. La critique de l’œuvre de M. Siméon Luce occupe à elle seule le livre VI, le VIIe étant consacré aux pièces justificatives.
La thèse fondamentale du R. P. Ayroles, le but hautement affirmé de son ouvrage, c’est de mettre en pleine lumière la mission et le caractère surnaturels de la Pucelle d’Orléans ; c’est de la venger des interprétations plus ou moins naturalistes mises en avant par ce que l’auteur appelle d’un seul mot : la libre-pensée. Avec quelle vigueur infatigable, avec quelle fougue ardente et quelle puissante conviction il conduit et poursuit son attaque ! C’est un chevalier qui frappe d’estoc et de taille, et les tempéraments batailleurs trouveront dans l’ouvrage de quoi se délecter. Pour moi, qui professe des allures plus pacifiques, je ne puis m’empêcher de penser que la main est parfois trop lourde et les coups trop écrasants ; il me semble qu’une tactique plus modérée, des manières moins dures, des expressions moins violentes, en un mot, moins de combativité
, auraient rendu le livre d’une lecture plus attrayante et peut-être auraient-elles mieux servi l’excellente cause dont le R. P. Ayroles s’est fait le valeureux champion.
A. B.
Petit Messager du Cœur de Marie juillet 1894
Le bulletin incite ses lecteurs à réciter pour les malades la prière de la Neuvaine à Jeanne d’Arc du père Ayroles (qui n’est pas nommé).
Le numéro de janvier 1895 rapportera des guérisons obtenues.
Source : Petit Messager du Cœur de Marie, tome X, livraison de juillet 1894, p. 212.
Lien : Google
Couronnons ce récit [sur les fêtes nationales de Jeanne d’Arc] par une conclusion pratique.
Tout récemment, la Semaine Religieuse de Cambrai a recommandé à ses lecteurs la prière suivante, approuvée par Mgr l’Évêque du Puy. Elle a pour but d’obtenir les miracles que réclame la canonisation de Jeanne d’Arc.
Nous ne saurions solliciter une faveur plus chrétienne et plus patriotique.
Ô Jésus, roi des nations, pour relever la France humainement perdue, il vous plut un jour d’employer le plus faible des instruments, une petite paysanne. [Texte complet : Petit Messager, janvier 1895.]
Daigne la vénérable Jeanne d’Arc exaucer les demandes de tous ceux qui l’invoqueront ; et puisse bientôt la France dresser des autels, au sein de toutes ses églises, à la plus admirable de ses enfants.
Messager du Cœur de Jésus juillet 1894
Dans un article sur les pèlerinages de jeunes au Sacré-Cœur de Montmartre, le bulletin rapporte que (le dimanche 15 avril sans doute, voir ci-dessous), le père Ayroles a accompagné un groupe de l’Association catholique de la jeunesse française et leur a prêché sous les voûtes de la crypte.
Dans un langage pieux et distingué, le R. P. Ayroles réchauffe ces jeunes cœurs, en leur proposant saint Joseph comme le modèle des pèlerins.
Source : Messager du Cœur de Jésus, tome 66 (juillet-juin décembre), p. 116-117, bulletin d’août 1894.
Lien : Google
Date du pèlerinage ? L’article se termine par extrait du Peuple français du 7 mai 1894, Retronews. Or ce même journal écrivait dans son édition du 15 avril 1894, Retronews :
Aujourd’hui dimanche, 15, à 8 heures et demie, en l’Église du Sacré-Cœur, à Montmartre, pèlerinage de l’Association catholique de la jeunesse française.
Il est fort probable qu’il s’agisse du pèlerinage du père Ayroles.
L’Association catholique de la jeunesse française. — Fondée en 1886 par le légitimiste Albert de Mun, l’association vise à former une élite catholique susceptible de reprendre les rênes du pays ; elle confie l’accompagnement spirituel des jeunes à des aumôniers jésuites.
Le Vœu National. — En janvier 1871, le philanthrope Alexandre Legentil fait le vœu de contribuer à l’érection à Paris d’un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus
. Ce vœu personnel se répand à travers la France, et le 26 février 1871, Pie IX accorde son approbation et bénit ce projet devenu le Vœu National. Le 24 juillet 1873, l’Assemblée autorise l’archevêque de Paris à acquérir un terrain à Montmartre pour y construire l’église. Une souscription nationale est alors lancée, et le comité de l’Œuvre du Vœu National organise un concours d’architecture, remporté par Paul Abadie. Les travaux débutent en 1875, l’adoration eucharistique commence en 1885, suivie des premiers pèlerinages. Le 5 juin 1891, bien que toujours en chantier, la basilique est solennellement inaugurée.
Nouvelles du Vœu National. — Les grandes faveurs accordées par Sa Sainteté Léon XIII au Sanctuaire de Montmartre sont déjà connues de nos lecteurs. Les belles cérémonies qui, depuis deux mois surtout, se succèdent sur la sainte montagne, ne peuvent qu’accroître nos espérances.
Signalons, entre autres, le pèlerinage des cinq cents jeunes hommes de l’École de Sainte-Geneviève, des RR. PP. Jésuites.
Nous l’avons répété bien souvent : nous aimons à voir la jeunesse à Montmartre. Pour rester pur, le jeune homme a besoin d’aimer. Où trouverait-il cette flamme, si ce n’est à la fournaise même du Cœur de Jésus ? Son âme s’ouvre spontanément au vrai, au beau, au bien. La foi, infuse dans le baptême, établit entre ces jeunes cœurs et le Cœur de Dieu une sorte d’affinité secrète. Si la jeunesse catholique est pour la libre-pensée une proie exquise, elle doit éveiller toutes nos sympathies et toute notre vigilance.
Notre-Seigneur a dit : Je bénirai les maisons où mon sacré Cœur sera honoré.
Nous ne sommes pas surpris des succès croissants de l’école Sainte-Geneviève.
L’école offrit mille cinq cents francs pour l’achèvement de la Basilique.
Voici, quelques jours après, un pèlerinage digne de captiver notre intérêt. C’est l’Association de la Jeunesse française. De nombreux jeunes gens sont là, sous le vivifiant regard de Notre-Seigneur, et semblent redire tout bas la parole d’Ozanam : Quand toute la terre aurait abjuré le Christ, il y a, dans l’inexprimable douceur d’une communion, une puissance de conviction qui me ferait encore embrasser la croix et défier la terre.
Et en effet presque tous communient, puis accompagnent le Très Saint-Sacrement, porté en triomphe sous les voûtes de la crypte. Un drapeau tricolore, sur lequel brille le Sacré Cœur, flotte au milieu des rangs. Voilà les chrétiens que l’Église appelle, les Français que la France attend
. Dans un langage pieux et distingué, le R. P. Ayroles, S. J., réchauffe ces jeunes cœurs, en leur proposant saint Joseph comme le modèle des pèlerins, dans les voyages qu’il fit à Bethléem, en Égypte, à Jérusalem.
Mentionnons enfin le pèlerinage de M. l’abbé Garnier, qui est venu, avec les auxiliaires de ses Œuvres, consacrer au divin Cœur son journal le Peuple français. Nous empruntons à cette feuille les lignes suivantes :
À neuf heures, la vaste nef de l’église du Vœu National est comble. La foule de nos amis déborde jusque dans les bas-côtés.
M. l’abbé Garnier célèbre la messe. Les prières montent ferventes vers le ciel. Rédacteurs et amis du journal ne font qu’un cœur et qu’une âme.
L’église du Vœu national nous a dit le R. P. Lemius a déjà vu bien des actes de foi ; mais jamais un Directeur de journal catholique n’était venu, entouré de toute sa rédaction et d’un grand nombre d’amis, consacrer solennellement l’organe qu’il dirige et tous ceux qui y travaillent au sacré Cœur de Jésus.
Signalons enfin le pèlerinage des Belges (retour de Notre-Dame de Lourdes) au nombre de trois cents, les retraitants de Saint-Germain en Laye, les Patrons chrétiens, la Congrégation des Enfants de Marie du couvent des Oiseaux, et enfin les Alsaciens-Lorrains. Un prêtre de ce dernier groupe nous disait : Chaque année, ma station à Montmartre est la plus belle circonstance de mon pèlerinage à Lourdes.
Ces bons chrétiens étaient au nombre de six cents ; ils ont presque tous communié. (Bulletin du Vœu.)
L’Univers 4 août 1894
Le journal publie une lettre du père Ayroles annonçant avoir reçu un bref de Léon XIII (du 25 juillet) saluant son œuvre et l’enjoignant à s’y consacrer, suivi d’une traduction du bref (différente de celle qui figurera en exergue des tomes III, IV et V de la Vraie Jeanne d’Arc, où notamment le vouvoiement remplace le tutoiement).
Le père Ayroles fait par de sa joie et remercie toute la presse catholique pour son soutient, en particulier l’Univers et son directeur à qui il renouvelle l’expression de son ancienne et toujours persévérante sympathie
.
Lien : Retronews
Nous recevons et sommes heureux de publier la lettre et le Bref que voici :
Paris, en la fête de saint Alphonse de Liguori [1er août],
Monsieur le directeur,
Le Bref pontifical que j’ai l’honneur de vous transmettre n’est pas seulement la plus haute et la plus douce récompense que pouvait recevoir ici-bas celui auquel Sa Sainteté daigne l’adresser ; c’est la plus auguste confirmation des encouragements qu’ont voulu lui faire arriver bien des amis de la vénérable Pucelle. La majeure partie de la presse catholique les lui a prodigués ; nulle part ils n’ont été plus empressés et plus constants qu’à l’Univers. Le catholique journal voudra bien, je n’en doute pas, publier un document qui fait plus que combler celui dont il restera le perpétuel honneur.
Il est un gage de la réalisation des espérances si ardentes que nourrissent au fond de leurs âmes les vrais amis de la libératrice, la voir sur les autels ; il nous dit quelle importance à part Sa Sainteté attache à une cause qui n’intéresse pas seulement la France, mais la religion catholique tout entière ; c’est une preuve de cet amour de la France que Léon XIII ne se lasse pas de réitérer ; il nous dit comment ceux-qui écrivent sur la Pucelle doivent non seule ment la venger des travestissements que l’impiété voudrait lui faire subir, venger l’Église des indignes inculpations que cette même impiété cherche dans une inique sentence ; mais retournant ces indignes procédés contre ceux qui y ont recours, montrer la sainte fille plus haute et plus pure, et le Siège apostolique qui l’a tous jours défendue, qui l’a réhabilitée, qui nous a conservé les meilleurs actes de sa merveilleuse existence, toujours plus digne de notre filial amour.
J’ai l’honneur, monsieur le directeur, de vous renouveler l’expression de mon ancienne et toujours persévérante sympathie, et d’être votre bien dévoué serviteur.
P.-J. Ayroles, S. J.
Léon XIII, pape
Bien aimé Fils, salut et Bénédiction,
Dans l’œuvre vaste et laborieuse que tu as déjà depuis longtemps entreprise, de mettre en lumière la figure de la Vénérable Vierge, Jeanne d’Arc, tu réponds dignement à l’attente des hommes doctes et par l’abondance de l’érudition, et par la sagesse de la critique. Pour continuer avec constance ce que tu as entrepris, tu n’as besoin ni d’encouragement ni de louange ; cependant, à raison de l’excellence de l’œuvre, il nous plaît de te décerner exhortation et éloge.
Cette insigne gloire de votre patrie est en effet la gloire de la religion catholique ; de cette religion catholique sous l’inspiration et la conduite de laquelle la France surtout, a conquis en tout temps les magnifiques fleurons de la vraie gloire. Conduis donc toujours ton travail en sorte que, comme c’est ton principal but, tout ce grand fait, de la Pucelle non seulement n’ait rien à souffrir des efforts des ennemis de la religion ; mais que leurs tentatives pour l’obscurcir ne fassent que le confirmer et le rendre plus éclatant.
À la tête de ces ennemis, il faut placer ceux qui, dépouillant des exploits de la magnanime et très pieuse Vierge de toute inspiration de la vertu divine, veulent les réduire aux proportions d’une force pure ment humaine, et ceux qui ne craignent d’imputer à l’Église son inique condamnation, alors qu’elle fut portée par des hommes ennemis acharnés de ce Siège Apostolique.
Réfuter sagement, à la lumière d’indubitables documents, ces assertions et celles qui leur ressemblent est une œuvre de grande importance, une excellente manière de bien mériter, et de la religion et de la société.
Donc, bien-aimé fils, ne cesse pas de te livrer allégrement à semblable travail maintenant surtout que Notre récent décret a canoniquement ouvert le cours de cette sainte cause.
Et, en attendant que la divine bonté te continue son assistance dans le reste de ton œuvre, et dans ton plan tout entier, c’est ce que Nous te souhaitons avec un spécial amour en te départant Notre Bénédiction apostolique.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le XXVe jour de juillet de l’an MDCCCXCIV, de Notre Pontificat, le dix-septième.
Leo PP. XIII.
La Croix 8 août 1894
Le quotidien félicite le père Ayroles pour le bref du pape Léon XIII qui salue les deux premiers tomes de la Vraie Jeanne d’Arc.
Lien : Retronews
Un bref du pape
au R. P. Ayroles, l’historien de Jeanne d’Arc
Le R. P. Ayroles, S. J., le savant historien de Jeanne d’Arc, dont nous avons naguère, ici même, en ce journal, loué à plein cœur les beaux ouvrages consacrés à la gloire immortelle de l’Héroïne sainte, dont la France est si justement fière, vient de recevoir du Saint-Père un Bref superbe, dans lequel il est souverainement félicité de son œuvre et encouragé à la poursuivre jusqu’à complet achèvement.
Ce Bref, dont nous avons le texte sous les yeux, est la plus haute récompense qu’ait pu désirer — si dans l’humilité de son cœur il en a désiré une — le savant et infatigable religieux qui a voué sa vie à mettre en pleine lumière la belle et incomparable figure de la Libératrice.
Le Saint-Père y loue à la fois la belle ordonnance, l’érudition
profonde, l’esprit de justice et de prudence
et proclame que l’auteur ce faisant a bien mérité, à la fois, de la religion et de la société
.
Combien nous en félicitons le très cher Père Ayroles, nous ne saurions pas assez bien le dire ! Mais, avec nous, tous nos lecteurs se réjouiront de la très Auguste approbation dont il vient d’être honoré. Et tous ensemble nous prierons Dieu pour que le magnifique monument — plus durable que ceux qui sont de marbre et d’airain — élevé par ses pieuses mains à notre Jeanne d’Arc, reçoive le plus tôt possible le couronnement que tous les catholiques, et tous les bons Français attendent !
Rappelons à ce propos que l’Histoire entière de Jeanne d’Arc du R. P. Ayroles, doit remplir cinq grands volumes in-8° de 5 à 600 pages chacun, très luxueusement et très correctement édités par la maison Gaume, 3, rue de l’Abbaye, à Paris.
La Vérité 13 août 1894
Publication du bref de Léon XIII dans une version légèrement différente de celle de l’Univers du 4 août : le tutoiement est remplacé par le vouvoiement (qui sera également adopté dans la traduction publiée dans les prochains tomes de la Vraie Jeanne d’Arc).
Lien : Retronews
Le R. P. Ayroles, à propos des remarquables travaux sur Jeanne d’Arc dont la Vérité a rendu compte, a été honoré d’une lettre très élogieuse de Sa Sainteté, que le vaillant défenseur de Jeanne d’Arc a bien voulu nous communiquer.
Voici ce précieux document :
Bien aimé Fils, salut et bénédiction.
Dans l’œuvre vaste et laborieuse que vous avez déjà depuis longtemps entreprise, de mettre en lumière la figure de la vénérable vierge Jeanne d’Arc, vous répondez dignement à l’attente des hommes doctes et par l’abondance de l’érudition, et par la sagesse de la critique. Pour continuer avec constance ce que vous avez entrepris, vous n’avez besoin ni d’encouragement ni de louange ; cependant, à raison de l’excellence de l’œuvre, il Nous plaît de vous décerner exhortation et éloge.
[…]
Donc, bien-aimé Fils, ne cessez pas de vous livrer allègrement à semblable travail, maintenant surtout que Notre récent décret a canoniquement ouvert le cours de cette sainte cause.
Et, en attendant que la divine bonté vous continue son assistance dans le reste de votre œuvre et dans votre plan tout entier, c’est ce que Nous vous souhaitons avec un spécial amour, en vous accordant Notre Bénédiction Apostolique.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le vingt cinquième jour de juillet de l’an mil huit cent quatre-vingt-quatorze, de Notre Pontificat le dix-septième.
Léon XIII, pape.
Le Gaulois 18 août 1894
Annonce du bref de Léon XIII.
Lien : Retronews
Le Saint-Père vient d’adresser au R. P. Ayrolles, de la Compagnie de Jésus, à l’occasion de ses remarquables travaux sur Jeanne d’Arc, une lettre infiniment flatteuse pour leur auteur, et dans laquelle Léon XIII condamne comme ennemis de la religion ceux qui, dépouillant les exploits de la magnanime et très pieuse vierge de toute inspiration de la vertu divine, veulent les réduire aux proportions d’une force purement humaine, et ceux qui ne craignent pas d’imputer à l’Église son inique condamnation, alors qu’elle fut portée par des ennemis acharnés de ce siège apostolique
.
De même dans :
Revue des sciences ecclésiastiques août 1894
Compte-rendu favorable du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc par Jean-Arthur Chollet.
On dirait que le père Ayroles a vécu cette vie qu’il raconte et en vérité il l’a vécue dans son esprit et dans son cœur. Il s’est identifié à son héroïne, la vraie Jeanne d’Arc ; il la raconte, la dépeint avec amour et la défend avec indignation et ardeur.
Sur les réfutations de la libre-pensée :
Le père Ayroles venge vertement et victorieusement Jeanne d’Arc de toutes ces insultes et diminutions. Il réduit à leur juste proportion, c’est-à-dire souvent à néant, les inventions historiques, les exagérations, les erreurs de Michelet, d’Henri Martin, de Quicherat, de Vallet de Viriville, de Siméon Luce. Ce dernier semble définitivement jugé, et déboulonné d’un piédestal où trop de confiance de certains catholiques l’avaient élevé ou conservé.
Source : Revue des sciences ecclésiastiques, tome 73 (8e série, tome 3), août 1894, p. 152-159.
Lien : Archive
Rien n’égale, en histoire, l’importance de l’étude des origines. Dégageant les divers éléments qui ont concouru à créer une situation, les multiples circonstances au milieu desquelles elle s’est peu à peu dessinée, imposée et définitivement établie, l’historien voit mieux la nature et les raisons de cette situation, ses avantages, ses périls, le pourquoi de sa stabilité ou de son rapide évanouissement. Savoir les origines d’un fait, d’un état, d’un homme, c’est savoir tout ce qu’il est intéressant de connaître de lui : ce qui l’a amené, ce qui le constitue, souvent ce qui le maintient, ce qui le fera passer et disparaître. La connaissance des origines est en histoire, ce qu’est en métaphysique la connaissance des causes : de même qu’un être est à peine connu dont on ignore la cause efficiente ou finale, les éléments constitutifs, ainsi un fait est à peu près ignoré dont on n’a pas découvert les origines ; car on n’en sait pas la cause efficiente, c’est-à-dire ce qui l’a amené ; on n’en sait pas la cause finale, c’est-à-dire le pourquoi ; pourquoi il a été voulu par la Providence, qui a bien son mot à dire et qui le dit haut et souvent en histoire ; pourquoi les hommes l’ont provoqué ou subi. La recherche des origines, c’est la philosophie de l’histoire.
Aussi rien d’étonnant qu’on lui attribue aujourd’hui une extrême importance et que de toutes parts on s’y livre avec une louable ardeur et souvent avec un heureux succès.
Cette ardeur louable, couronnée d’un heureux succès, à rechercher les origines du plus grand fait et du plus merveilleux personnage de notre histoire nationale, je la trouve dans les études du P. Ayroles, et en particulier dans le beau travail qu’il vient de nous donner sur la Vraie Jeanne d’Arc, la paysanne et l’inspirée.
Déjà, dans un premier volume que les lecteurs de la Revue connaissent, il nous avait montré la Pucelle devant l’Église de son temps ; — il nous promet, pour un avenir que nous appelons de tous nos vœux et souhaitons prochain, trois autres volumes sur la Pucelle, d’après cent et quelques chroniques et autres documents de l’époque ; — sur la vierge guerrière, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée ; — sur la martyre, d’après les mêmes sources ; — aujourd’hui, il nous transporte à la chaumière de la paysanne. Grâce à lui, nous assistons à son apparition sur la terre. Il la fait grandir sous nos yeux, nous dépeint la simplicité de son jeune âge et la ferveur de sa piété, puis la conduit des merveilles des apparitions célestes jusqu’à l’entrevue de Chinon. Alors la vie de la jeune fille cesse, et commence celle de la guerrière où le P. Ayroles trouvera la matière de nouveaux volumes.
Dans un travail sur les origines d’un personnage et de son rôle social, il faut d’abord étudier le milieu où il a vécu et sur lequel il a exercé son action ; il importe de savoir où en était la société dont il a modifié les destinées. Ainsi, on sait les causes qui ont déterminé sa mission : car tout homme subit nécessairement l’influence de ce qui l’entoure ; on sait aussi le but qu’il s’est proposé ou que la Providence lui a imposé. — Pour connaître entièrement les origines de Jeanne d’Arc, il était donc de la première importance de savoir la situation critique de l’Église, de la chrétienté, de la France surtout, à l’heure où le ciel la donnait à notre pays. Le P. Ayroles a recherché, scruté, exposé largement, savamment, éloquemment cette situation, l’a analysée avec compétence et parfaitement adaptée à la mission de Jeanne. Dans le premier tiers de son volume, il nous dit le malheureux état de l’Église sortant du grand schisme : l’autorité des papes amoindrie, la tête diminuée, pendant que, dans tout le corps, la vie, la sève surnaturelle circule aussi vivace, plus vivace que jamais, et qu’à côté de Pontifes contestés ou affaiblis dans leur prestige et leur puissance morale, les saints se multiplient et paraissent, si j’ose ainsi parler, plus saints et plus grands. La chrétienté est au désarroi, menacée par le Turc et manquant de remparts. La France, le beau royaume de France, est devenu un désert, une ruine. Deux partis la déchirent, la dévastent et la trahissent ; l’Anglais souille ses côtes ; les brigands la pillent ; sauf dans les environs des villes et des châteaux, ses champs ne sont plus ni habités ni cultivés et se couvrent de friches et de forêts ; les villes elles-mêmes se dépeuplent ; les hommes disparaissent et les loups pénètrent jusque dans Paris. Le roi n’a plus de la royauté que le litre : son autorité a disparu et on assassine impunément ses meilleurs soutiens sous ses fenêtres ; les finances sont ruinées et le cordonnier royal, apprenant que son auguste client ne peut payer des bottes neuves qu’il vient de lui essayer, retire de ses pieds la botte déjà mise et le laisse avec ses vieilles chaussures. La royauté et la France sont à l’agonie. Pour leur rendre la vie, il faut Dieu. Dieu paraît.
Rien ne montre mieux que le tableau fait par le P. Ayroles, la nécessité d’une intervention divine dans les affaires de France, rien par conséquent ne justifie davantage et n’explique plus clairement la nature et le pourquoi de la mission divine de la Pucelle.
Mais tout cela, c’est le cadre, c’est l’extérieur : il faut aussi montrer la Pucelle elle-même à l’aurore de sa vie : la faire voir grandissante dans un profond sentiment de la grande pitié qui règne au royaume de France, et dans une parfaite docilité aux inspirations du ciel. C’est l’objet du second tiers de l’ouvrage que nous analysons. Quoi de plus gracieux, de plus touchant et de plus vrai que le tableau de l’enfance de la plus gracieuse des jeunes filles, tracé par elle-même, par ses parents, ses parrain et marraine, les jeunes filles et les jeunes gens de son âge, les prêtres, les nobles et les bourgeois, les témoins de son entrée dans la carrière, ses guides, et de grands personnages de la cour de Charles VII ? Tous viennent déposer et tous n’ont qu’une voix pour attester la pureté, la sincérité de la jeune fille. On croirait lire une vie de sainte.
Aucun des détails de cette enfance merveilleuse n’échappe au P. Ayroles. On dirait qu’il a vécu cette vie qu’il raconte et en vérité il l’a vécue dans son esprit et dans son cœur. Il s’est identifié à son héroïne, la vraie Jeanne d’Arc ; il la raconte, la dépeint avec amour et la défend avec indignation et ardeur. Jeanne eut toujours des ennemis nombreux et acharnés. Elle en eut durant sa vie qui la mirent à mort. Elle en eut plus tard, elle en a encore maintenant, quatre siècles après sa mort, qui veulent lui ravir l’auréole de l’héroïsme, la gloire de l’inspiration surnaturelle et l’honneur du martyre.
Selon les uns, c’est une hallucinée extraordinaire : sa mission est une hallucination inouïe ; ses visions, de purs fantômes internes crées par une imagination surexcitée et malade. Les faits merveilleux qu’elle a accomplis, simple réalisation et création externe des suggestions internes de son cerveau. Une malade, une admirable malade, telle fut Jeanne d’Arc.
D’autres veulent bien en faire une personne saine d’esprit ; ils croient même ; ou feignent de croire à ses visions, au côté surnaturel de sa vie ; mais ils cherchent à ses sentiments, à ses idées, à ses paroles, à ses faits, à tout son état d’âme, tant de causes et d’explications naturelles qu’après les avoir entendus on serait tenté de croire que tout est compris, expliqué en elle, et l’on ne voit plus bien le rôle du surnaturel dans sa mission et ses gestes.
Le P. Ayroles venge vertement et victorieusement Jeanne d’Arc de toutes ces insultes et diminutions. Il réduit à leur juste proportion, c’est-à-dire souvent à néant, les inventions historiques, les exagérations, les erreurs de Michelet, d’Henri Martin, de Quicherat, de Vallet de Viriville, de Siméon Luce. Ce dernier semble définitivement jugé, et déboulonné d’un piédestal où trop de confiance de certains catholiques l’avaient élevé ou conservé.
Le P. Ayroles ne combat pas directement toutes les erreurs sur Jeanne d’Arc : ce serait œuvre interminable. Mais il y a, dans son livre, les éléments de réponse à tout ce qui se peut prétendre de faux au sujet de l’inspiration et de la jeunesse de l’héroïne. L’introduction en cour de Rome du procès de béatification de la Pucelle, la campagne menée en France pour faire de la fête de Jeanne d’Arc, une fête nationale, ont suscité de nouvelles polémiques et fait naître bien des conceptions bizarres sur un sujet éminemment ecclésiastique et français. Plus d’une thèse a de nouveau vu le jour pour démontrer que la vierge de Domrémy appartient à la France uniquement, et nullement à l’Église, et qu’elle ne sera pas et ne saurait être canonisée. J’en rapporterai une qui intéressera par son côté théologique les lecteurs de la Revue, et qui croit opposer à la béatification de Jeanne un obstacle terrible, infranchissable
.
Au fond, dans tous ses actes, elle (Jeanne) procède, — dit-on, — de la façon la plus antithéologique et comme si l’Église avec son autorité absolue n’avait pas existé. À qui obéit-elle ? Non pas aux pasteurs légitimes, mais aux voix qu’elle entend dans le fond de son cœur. Au début de sa carrière, nul intermédiaire entre elle et le ciel. Ce n’est pas un évêque, ce n’est pas même le desservant de l’église où elle va prier qui lui parle : dans une clarté, elle aperçoit des figures, dont l’une lui dit :
Jeanne va au secours du roi de France, et tu lui rendras son royaume.Poussée par ces voix, elle se décide à quitter la maison paternelle, entourée du jardin. Les oiseaux qu’elle aimait, et qui l’aimaient, habitués à venir manger dans sa main, elle les va, au milieu de ses larmes, abandonner. Mais son père résiste. Et quel père eût laissé partir sa fille, une pauvre bergère, avec un pareil dessein ?
Auprès de qui alors trouve-t-elle un appui contre la volonté ferme de son père ? Est-ce l’Église toute puissante qui la soutient ? C’est un de ses oncles qui la mène devant Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs. Ici intervient l’Église dans la personne du curé, mais c’est pour exorciser Jeanne, car on la suppose atteinte de diablerie… Voilà la première partie de la légende absolument laïque et où l’on ne rencontre, que pour faire obstacle à Jeanne, l’intervention du clergé. Tout le reste ressemble à ces débuts. À aucun moment Jeanne ne se réclame de l’autorité religieuse de l’Église.
(E. Ledrain, dans l’Éclair, 18 avril 1894, Retronews.)
Qu’on lise le P. Ayroles (p. 166 et suivantes), l’on verra ce qu’il faut penser de ce roman laïque.
Depuis quand Dieu, saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite sont-ils laïques et hors de l’Église ? Et si l’on distingue, dans les voix, leur caractère surnaturel et l’objet de leur communication, sans doute on verra que cet objet est purement français et patriotique : mais quant au surnaturel il n’est nullement mis par Jeanne en opposition avec l’Église. L’Église doit juger de la valeur, de la vérité de ces sortes de visions, et Jeanne l’a reconnu et l’en a rendue juge. Les saints l’envoient souvent à confesse, elle y va et certainement elle soumet au jugement de l’Église, représentée par son curé, les voix qu’elle entend. Si, à Vaucouleurs, Jean Fournier l’exorcise, elle déclare qu’il n’a pas bien fait, parce qu’il avait entendu sa confession, elle lui avait évidemment parlé de ses voix et lui en avait démontré la vérité. Mais le prêtre, voulant plaire au sire de Baudricourt, par ailleurs voulant dans sa conduite ignorer ce qu’il savait par le confessionnal, avait essayé d’exorciser une âme dont il connaissait toute la sainteté. Elle ne fut donc pas une adepte de l’inspiration privée.
— Que mes réponses soient vues et examinées par les clercs, dit-elle plus tard, et qu’on me dise ensuite s’il y a quelque chose contre la foi chrétienne que Notre Seigneur a commandée : Je ne voudrais le soutenir et je serais bien courroucée d’aller contre.
Et encore :
— Je vous certifie que je ne voudrais rien faire ou dire contre la foi chrétienne, et si j’avais rien fait ou dit qui fût sur le corps de moi que les clercs sussent dire que ce fût contre la foi chrétienne que notre Sire a établie, je ne le voudrais soutenir, mais le bouterais dehors (p. 167).
Rien de plus catholique que cette déclaration, qui exprime la règle de toute sa vie. Puissent ceux qui l’accusent avoir la même orthodoxie !
Le P. Ayroles a fait une grande œuvre historique, théologique, en même temps que très opportune ; il la continuera au plus tôt et ajoutera de nouveaux matériaux à ceux qu’il a déjà apportés et à ceux qu’apportent avec lui d’autres ouvriers, tels que les PP. Belon et Balme. Grâce à ces rudes travailleurs, la cause de Jeanne recevra avancement et profit.
Nous ne saurions mieux terminer que par ce souhait adressé à l’auteur par le Souverain Pontife dans une lettre fort élogieuse du 25 juillet dernier :
Sic igitur procedat opera tua, ut, quod præcipue spectas, hæc tota causa ab hostium religionis ictibus, non invulnerata modo, sed confirmata et auctior emergat.
[Conduisez donc votre travail en sorte que, — ce qui est votre but principal, — tout ce grand fait de la Pucelle, non seulement ne soit en rien amoindri par les coups des ennemis de la Religion, mais en ressorte plus constant et plus éclatant.]
A. Chollet.
Avant de finir, que l’auteur me permette de lui signaler quelques grains de poussière fort minimes dans sa belle œuvre.
Page 10, la première phrase n’aurait-elle pas besoin d’être refondue ?
[L’article ne reproduit pas la phrase.] Thomas a Kempis, des contemporains, tels que le docte Franciscain Bruggmann, attestent avoir vu, qu’une contrée tout entière voyait comme eux, les souffrances de l’Homme-Dieu reproduites dans une contemporaine de Jeanne, où, pour être sous autre une forme, le surnaturel éclatait aussi, et devait éclater plus longuement que dans la vierge de Domrémy.
P. 14, lignes 17 et 18, n’y a-t-il pas un peu trop de répétitions dans ces mots :
Tant d’horreurs, et bien d’autres encore, eussent pris fin si l’envoyée du Ciel dignement secondée eût fait en faveur de la Chrétienté le plus beau fait qui eut encore été fait.
Revue de Lille 1er septembre 1894
Étude en trois parties : Jeanne d’Arc dans la littérature anglaise contemporaine, par Adolphe Sevin. L’auteur mentionne le père Ayroles dans sa notice sur le père Francis Wyndham.
Source : Revue de Lille, 5e année, t. X, 1er septembre 1894, p. 494.
Lien : Gallica
Livraisons (Gallica) :
- août 1894, p. 380
- septembre 1894, p. 469
- octobre 1894, p. 584
Note. — Il semble qu’Adolphe Sevin soit le père du P. Jacques Sevin (né à Lille en 1882), cofondateurs des Scouts de France.
[T. X, p. 494 :]
Le R. P. Francis Wyndham appartient à la congrégation des Oblats de Saint-Charles, établie à Londres, dans le quartier de Bayswater, et qui a eu l’honneur de donner à l’Église romaine dans ces derniers temps, deux cardinaux anglais le grand Cardinal Manning, archevêque de Westminster, et son digne successeur, le Cardinal Vaughan. Le R. P. Wyndham peut être considéré comme le champion de la cause de Jeanne d’Arc en Angleterre, soit par ses propres écrits, soit par ses études et sa divulgation des travaux de nos historiens Johanniques, et particulièrement du R. P. Ayroles, soit enfin par son enthousiasme pour notre héroïne nationale. Je suis un enthousiaste de Jeanne d’Arc
, nous disait-il avec une émotion pénétrante, en nous donnant pour notre travail de précieuses indications que nous avons mises à profit et dont nous tenons à le remercier ici.
Messager du Cœur de Jésus septembre 1894
Annonce du bref de Léon XIII au père Ayroles.
Source : Messager du Cœur de Jésus, tome 65, bulletin de septembre 1894, p. 374-375.
Lien : Google
Un Bref du Pape au R. P. Ayroles, l’historien de Jeanne d’Arc. — Le grand et bel ouvrage sur Jeanne d’Arc que nous avons plus d’une fois recommandé vivement à nos lecteurs, et dont nous leur avons mis sous les yeux des pages nombreuses, vient de recevoir la plus haute et la plus douce récompense
à laquelle le savant et pieux auteur pût aspirer ici-bas. Le Bref magnifique que vient d’adresser au R. P. Jean-Baptiste Ayroles, S. J., notre Saint-Père le Pape Léon XIII, nous dit quelle exceptionnelle importance Sa Sainteté attache à une cause qui n’intéresse pas seulement la France, mais la religion catholique tout entière. Cette insigne gloire de la patrie française — ce sont les expressions de Léon XIII — est en effet, en même temps la gloire de cette religion catholique sous l’inspiration et la conduite de laquelle la France a toujours conquis les splendides fleurons de la vraie gloire.
Le Pontife daigne exhorter le vaillant écrivain à poursuivre son travail […]
[Suit ensuite un extrait de La Croix, 8 août :] Combien — ajouterons-nous ici avec les excellents rédacteurs de la Croix — nous félicitons de ces éloges et de ces encouragements si bien mérités le très cher P. Ayroles, nous ne saurions pas assez bien le dire […]
Revue catholique des institutions et du droit septembre 1894
Annonce du bref de Léon XIII au père Ayroles, dans la Chronique du mois d’Albert Desplagnes.
Le bref vient fort à propos après des appréciations par trop légères qu’une Revue grave et justement estimée [laquelle ?] a laissé publier dans ses colonnes.
Source : Revue catholique des institutions et du droit, 22e année, 2nd semestre 1894, p. 283-284.
[…] L’autre fait est un bref de Léon XIII, en date du 25 juillet dernier, envoyé au R. P. Ayroles, pour son magistral ouvrage, intitulé : La vraie Jeanne d’Arc, dont le 2e volume a paru en mars dernier. Ce bref contient des éloges et des encouragements exceptionnels et bien rares, pour l’excellence de l’œuvre, l’abondance de l’érudition, la sagesse de la critique
. Le pape exhorte l’auteur à continuer vivement
sa grande couvre et notamment à réfuter les assertions de ceux qui prétendent dépouiller Jeanne de l’inspiration divine et la réduire aux proportions de l’habileté humaine. Cette réfutation, dit Léon XIII, est une œuvre de grande importance, une excellente manière de bien mériter de la religion et de la société
.
Ce jugement du Pape intéresse trop la France pour qu’on le laisse ignorer, parce que tout ce qui peut établir le vrai caractère de la mission de Jeanne est d’une valeur capitale pour notre pays. Le bref vient fort à propos après des appréciations par trop légères qu’une Revue grave et justement estimée a laissé publier dans ses colonnes sur l’œuvre si belle du P. Ayroles, appréciations qui ont été isolées dans les jugements de la presse.
Revue des questions historiques 1er octobre 1894
Compte-rendu du tome II de la Vraie Jeanne d’Arc par l’historien Gaston du Fresne de Beaucourt.
Beaucourt porte un jugement globalement favorable sur l’ouvrage, dont il donne le sommaire, et qu’il décrit comme une minutieuse enquête faite de main d’historien
. Néanmoins il y relève quelques défauts : la réfutation des libres-penseurs, bien que justifiée, s’avère trop longue ; les transcriptions de noms comportent des erreurs ; les pièces justificatives apportent peu. Aussi conclut-il :
Il faut louer l’auteur de son infatigable labeur, de sa piété pour la mémoire de Jeanne, tout en regrettant qu’il n’ait pas apporté à son œuvre une méthode plus rigoureuse, une plus grande sobriété, et aussi une expérience plus consommée en matière d’érudition.
Source : Revue des questions historiques, 29e année, tome 56e (nouvelle série, tome 12), livraison du 1er octobre 1894, p. 604-605.
Lien : Gallica
Mettre quiconque n’est pas sans quelque culture intellectuelle en état de voir, d’étudier dans son ensemble et dans ses détails l’existence de la Pucelle ; la produire dans tout son jour en faisant connaître les temps, les lieux dans lesquels elle s’est manifestée ; aborder les questions de quelque intérêt qu’elle fait naître et en donner la solution qui semblera la mieux fondée ; mettre en regard ce qu’il plaît au naturalisme d’imaginer sous le titre d’Histoire de Jeanne d’Arc ; en montrer la fausseté au point de vue des faits, l’incohérence, les contradictions au point de vue de la raison ; faire juger par ce spécimen sa méthode historique, tel est le but des volumes en voie de publication sous le titre commun de : La vraie Jeanne d’Arc.
Ainsi s’exprime, dans la préface, le R. P. Ayroles. Son volume, qui porte le n° II, est en quelque sorte le premier des cinq à paraître et qui formeront chacun un tout, parce que chacun présentera une des phases si pleines de contraste de l’astre merveilleux
. Si le précédent a paru tout d’abord sous le titre : La Pucelle devant l’Église de son temps, il eût dû être le dernier, c’est que l’auteur a pensé qu’il fallait se hâter de tirer de la poussière de l’inédit des œuvres dues à des théologiens du siècle de Jeanne, qui discutaient sa vie, ses actes, ses paroles, sous leur aspect le plus élevé et le plus capital, leur accord avec la révélation, avec l’enseignement catholique
.
C’est uniquement la paysanne et l’inspirée qui apparaît dans le volume que nous avons sous les yeux. Dans le livre I, l’auteur fait un tableau de la chrétienté dans la France et la Lorraine durant les années obscures de la Pucelle ; il y expose fort bien la situation précaire de Charles VII, et se garde de tomber dans les erreurs tant de fois reproduites sur la jeunesse de ce prince, son amour des plaisirs, sa légèreté de mœurs, qu’il réfute avec les détails les plus circonstanciés. — Dans le livre II, nous envisageons Jeanne d’Arc d’après ses aveux, et ici l’auteur a cru devoir introduire une étude sur le procès de Rouen qui est un peu hors de propos, car pour peindre de le milieu où la Pucelle était placée quand elle en eut à s’expliquer sur les faits relatifs à son enfance, point n’était besoin d’entrer dans des détails qui devraient trouver leur place ailleurs. Quoi qu’il en soit, le volume II, qu’on pourrait intituler : Jeanne racontée par elle-même, est plein d’intérêt et l’exposition en est saisissante. — Le livre III nous offre la Pucelle d’après les témoins oculaires. Comme le dit l’auteur, nous devons au procès de réhabilitation des détails tels qu’on n’en possède de semblables sur aucune autre grande héroïne historique
. C’est à l’aide de cette minutieuse enquête faite de main d’historien qu’on peut reconstituer toute la première période de la vie de Jeanne jusqu’à son départ pour Chinon. Nous contemplons donc les traits de la jeune fille d’après ses parents et camarades, d’après les anciens de son village, d’après les jeunes filles et les jeunes gens de son âge, d’après les prêtres, les nobles et les bourgeois, d’après ceux qui lui servirent de guides. — Dans le livre IV, l’auteur emprunte à des personnages du temps, comme Perceval de Boulainvilliers et Alain Chartier, et à toutes les sources connues, des notions sur la Pucelle, sur sa famille, sur sa nationalité, sur ses apparitions, sur certaines circonstances de sa jeunesse, sur les lieux marqués par son séjour ou son passage, enfin sur sa physionomie et sur son caractère.
Les livres V et VI sont consacrés à la critique. Le P. Ayroles y prend d’abord à partie les écrivains libres-penseurs, Michelet, Quicherat, Henri Martin et… Siméon Luce. Nous estimons que l’auteur aurait pu sans inconvénient abréger beaucoup cette partie de son œuvre. Michelet méritait-il l’honneur d’une aussi minutieuse réfutation ? Quicherat, à la bonne heure : celui-là, auquel on doit la publication de tous les témoignages historiques, a plus qu’aucun autre, dans ses Aperçus nouveaux, contribué à fausser l’histoire de la Pucelle. Quant à Luce, il est certain que la fantaisie occupe une large place dans les pages compendieuses de sa Jeanne d’Arc à Domrémy ; mais point n’était besoin de s’appesantir si longuement pour en faire justice, sur les idées fausses dont elles fourmillent.
Le livre VII est rempli d’un certain nombre de pièces justificatives, dont la reproduction n’avait, à vrai dire, que fort peu d’utilité.
Il est regrettable que le P. Ayroles n’ait pas apporté plus de scrupuleuse exactitude dans sa révision typographique et dans ses indications de noms et de sources. Ainsi je trouve le comte des Vertus pour le Comte de Vertus (p. 19, rectifié dans l’Errata) ; Covieille pour Coville (p. 23) ; Tanguy-le-Châtel pour Tanguy du Chastel (p. 38) ; le duc de Langeac pour le sire de Langeac (p. 42) ; 1485 pour 1385 (id.) ; Gouges pour Gouge (id. p. 43) ; le bâtard de Vaurs pour Vaurus (p. 55) ; l’auteur Duverger pour l’auteur du Verger (p. 99, rectifié dans l’Errata). En citant l’ouvrage de Henri Martin, il eût fallu conserver le titre Jeanne Darc, systématiquement adopté par l’historien démocrate (p. 309, 402 et suiv.). Le P. Ayroles a aussi le tort de faire parfois des rapprochements qui conviennent peu à la gravité de l’histoire. Ainsi (p. 48) : La Trémoille, ce Cornélius Herz, ce Reinach du XVe siècle.
Il faut louer l’auteur de son infatigable labeur, de sa piété pour la mémoire de Jeanne, tout en regrettant qu’il n’ait pas apporté à son œuvre une méthode plus rigoureuse, une plus grande sobriété, et aussi une expérience plus consommée en matière d’érudition.
G. de B.
Revue du monde catholique 1er octobre 1894
Article Jeanne la Pucelle dans l’ancienne littérature anglaise, par Louis Robert, du clergé de Paris, qui cite le père Ayroles dans son introduction.
Source : Revue du monde catholique, 33e année (1906), t. 120 (série 6, t. 4), n° 10 (1er octobre), p. 62-86.
Lien : Gallica
Les vierges qui allaient au martyre, un instant avant leur sanglante agonie, s’agenouillaient dans une ardente prière, afin de demander à Dieu pour leurs juges la conversion et la grâce illuminatrice pour leurs bourreaux. Lorsque leur sang ruisselait sous la hache du tortionnaire ou la dent des fauves dans les amphithéâtres, des émotions inconnues, de troublantes clartés pénétraient dans ces esprits aux préjugés féroces, remuaient ces cœurs de marbre. Et, prosternés, ils adoraient le Christ, naguère honni, et leurs larmes inondaient leurs généreuses victimes.
Semblable prodige s’est reproduit pour l’immortelle martyre du Vieux-Marché à Rouen, et dans de plus vastes proportions : c’est un peuple entier qui aujourd’hui reconnaît ses erreurs, son injustice cruelle envers Jeanne d’Arc ; et ceux qui, après l’avoir outragée, l’ont livrée aux flammes, flétrie, sont les plus fervents à ployer le genou devant l’angélique héroïne, la blanche hostie.
Nulle part, en Europe, — assure M. J. Darmesteter, — la divinité de la mission de Jeanne n’a été plus profondément sentie et plus fermement proclamée que par les descendants de ceux qui l’ont brûlée.
D’après une lettre de l’Éminentissime cardinal Manning, — dit à son tour le P. Ayroles, l’érudit historien de la Pucelle, — l’Angleterre rivalise avec la France dans les hommages réparateurs que les deux nations doivent à la céleste envoyée.
Dans une lettre curieuse adressée au journal le Temps, le 8 juin 1894, nous lisons :
Monsieur le Directeur, au moment où l’on s’occupe d’organiser une fête en l’honneur de Jeanne d’Arc, pour laquelle je professe une admiration sans mélange, il me paraît intéressant de vous faire connaître l’opinion de nombre d’Anglais sur la défaite d’autrefois… Si nous n’avions pas été vaincus à Orléans et ailleurs, me disait l’un deux, nous aurions perdu notre nationalité. Nos rois auraient habité Paris avec toute notre aristocratie et nous serions devenus Français. C’est à votre héroïne que nous devons d’être Anglais. Elle a sauvé la France d’abord, mais elle vous a fait perdre l’Angleterre. Nous aurions eu le sort des Francs de Clovis et des Saxons de Charlemagne. Comme eux, nous aurions été absorbés par vous. Jeanne d’Arc nous a préservés de ce malheur.
Réunir, comme en une gerbe, les hommages les plus célèbres que l’Histoire, en Angleterre, a rendus à Jeanne d’Arc ; cueillir les fleurs les plus gracieuses qu’elle a fait éclore dans la poésie d’Outre-Manche ; faire plaider sa grande cause, à travers les âges, par ses ennemis les plus acharnés ; montrer comment l’odieuse sorcière de la légende anglaise s’est transformée, pour les Anglais, dans l’immaculée et sainte Pucelle de la Vérité historique, tel est le but de cette étude et sa justification. […]
La Vérité 7 octobre 1894
Ouverture du procès de non cultu.
Le premier témoin entendu les 21 et 22 septembre a été le R. P. Ayroles.
L’article, qui reproduit la Semaine religieuse d’Orléans (du 6 octobre), explique en détail le but de ce procès puis fournit la composition du tribunal.
Lien : Retronews
De même dans :
Procès apostolique de la cause de Jeanne d’Arc. — Voici la note que publie la Semaine religieuse d’Orléans :
L’introduction de la cause de Jeanne d’Arc n’était qu’une préface. En effet, au lendemain de le promulgation du décret qui déclarait Vénérable la Pucelle d’Orléans, la Congrégation des Rites, sur la demande du postulateur de la cause, ordonnait l’instruction de non cultu.
L’objet de ce nouveau procès, qui se fait au nom du Souverain Pontife et par son autorité, est d’établir authentiquement qu’aucun culte public et ecclésiastique n’a été rendu prématurément à la Vénérable, contre les défenses de l’Église. Le culte privé n’est point interdit : ce n’est donc point aller contre le décret d’Urbain VIII, ni Contre les règles de la Sacrée-Congrégation des Rites, que d’adresser en son particulier des prières à Jeanne d’Arc, pour obtenir de Dieu, par son intercession, des grâces spirituelles et temporelles, même des miracles, qui permettront à la Sacrée-Congrégation de reconnaître que la volonté de Dieu est que sa servante soit élevée à l’honneur des autels. Seul est défendu le culte public : exposer, par exemple dans une église, à la vénération des fidèles la statue de la Vénérable ou la représenter la tête ceinte d’un nimbe ou d’une auréole.
Il est on ne peut plus opportun de faire remarquer que l’autorité ecclésiastique n’est nullement responsable de ce que la fantaisie des artistes ou l’initiative privée de certains éditeurs se permettent, en représentant nimbée la tête de Jeanne d’Arc.
La Sacrée Congrégation des Rites, sans tarder, répondait à la requête de M. le postulateur, en adressant aux évêques d’Orléans et de Saint-Dié des lettres, chargeant ces Ordinaires, dans leur diocèse respectif, de l’instruction du procès apostolique de culto publico et ecclesiastico nunquam exhibito. Voilà pourquoi la Cause n’est plus simplement intitulée : Aurelianensis, mais Aurelianensis, seu Sancti Deodati.
Ces lettres furent adressées à Mgr Coullié, archevêque de Lyon, qui administrait le diocèse, puis transmises à son successeur au moment de son installation, qui eut lieu le 20 juillet 1894. Aussitôt Mgr Touchet prenait en main la cause qui lui est confiée. Son premier acte épiscopal, en effet, fut de signer les lettres qui nommaient postulateur, aux lieu et place de M. Captier, devenu supérieur général de la Compagnie de Saint-Sulpice, M. Herzog, nouveau procureur, à Rome, de la Compagnie. Puis, usant des pouvoirs spéciaux, que lui conféraient les lettres remissorialas, Monseigneur procédait, le 2 septembre 1894, à la constitution du tribunal chargé d’instruire, au nom du Souverain Pontife, le procès de non cultu dans la cause de la béatification de la Vénérable servante de Dieu Jeanne d’Arc !
À Rome, Mgr Parrochi demeure le cardinal ponent, et Mgr Caprara, promoteur de la Foi. Le nouveau postulateur est M. l’abbé Herzog, prêtre de Saint-Sulpice, et l’avocat défenseur de la cause sera M. Minetti, qui avait été adjoint déjà, dans le procès de l’introduction, au célèbre avocat consistorial Alibrandi, décédé le jour même où était signé le décret de vénérabilité.
M. le postulateur ayant donné à M.l’abbé Clain, directeur au grand séminaire d’Orléans, un mandat de vice-postulateur, le tribunal d’Orléans est ainsi composé :
Sa Grandeur s’est réservé les fonctions de juge apostolique et a nommé : juge sous délégué, M. l’abbé Branchereau, supérieur du grand séminaire et vicaire général ; juges adjoints, MM. les chanoines Dulouart et Agnès ; sous-promoteur de la foi, M le chanoine Despierre, archiprêtre de la cathédrale ; notaire, M. l’abbé Fillot, chancelier de l’évêché.
M. le vice-postulateur a déjà désigné un certain nombre de témoins, prêtres et laïcs, qui seront appelés successivement à prêter serment et à faire leurs dépositions.
Le premier témoin entendu les 21 et 22 septembre a été le R. P. Ayroles. Les autres témoins ne tarderont pas à comparaître, car Monseigneur a hâte, avant son premier voyage ad Limina, d’achever le procès de non cultu.
Le Gaulois 9 octobre 1894
Résumé de l’article de la Semaine sainte d’Orléans sur le procès de non cultu. [Voir ci-dessus.]
Lien : Retronews
Article repris dans l’Observateur français du lendemain.
Lien : Retronews
En province. […] Orléans. — La cause de la béatification de Jeanne d’Arc suit son cours normal. En effet, la congrégation des rites, à la demande de M. l’abbé Hertzog, postulateur de la cause, a ordonné l’instruction de non cultu. […] Le vice-postulateur a déjà désigné un certain nombre de témoins qui seront entendus par le tribunal sous la foi du serment. L’un d’eux a déjà été entendu ; c’est le R. P. Ayroles. […]
Résumé, plus court, dans le Petit Moniteur universel du même jour :
Lien : Retronews
La béatification de Jeanne d’Arc. — […] Ce tribunal a déjà commencé à fonctionner ; il a entendu la déposition de R. P. Ayroles. D’autres témoins déjà désignés seront entendus prochainement ; ils déposent sous la foi du serment. […]
La Vérité 15 octobre 1894
Dans un article sur les reliques de Jeanne d’Arc, Louis Robert fait sien l’avis dubitatif du père Ayroles sur l’os calciné et quelques débris de la vierge martyre
qui auraient été signalés.
Lien : Retronews
Jeanne d’Arc, ses reliques, son portrait, ses souvenirs (suite). […] Cependant un notable pharmacien de la Touraine s’est dit possesseur d’un os calciné, de quelques débris de la vierge martyre. Cette assertion a été repoussée par certains auteurs et notamment par M. le chanoine Cochard. […] Nous nous rangeons ici volontiers à l’opinion du R. P. Ayroles, S. J, si compétent en la matière. Il décerne les plus grands éloges à ce notable pharmacien
… [Suivent des extraits de son compte-rendu de l’étude du chanoine Cochard, dans les Études de septembre 1891.]
L’Avenir des Hautes-Pyrénées 21 octobre 1894
Présence du père Ayroles à Lourdes pour la fête du Saint-Rosaire (7 octobre).
Lien : Retronews
[…] Il y avait là, au milieu des bonnes femmes du peuple, un prince de l’Église et deux évêques : Son Éminence le cardinal Persico, préfet de la Congrégation des Indulgences, venait de la Ville éternelle ; Mgr Theuret, évêque de Monaco, était heureux de rehausser, une fois de plus, de sa présence, une de nos principales solennités ; Mgr Billère, évêque de Tarbes, s’était fait un devoir de nous apporter le concours de son éloquente parole.
On remarquait autour de ces vénérés prélats M. l’abbé Lafforgue, vicaire-général de Tarbes ; M. l’abbé Brisset, curé de Saint-Augustin de Paris ; Mgr Quesada, prélat romain de Lisbonne ; le P. Ayroles, bien connu par ses travaux sur Jeanne d’Arc, etc.
L’Univers 30 novembre 1894
La Vraie Jeanne d’Arc donnée comme le plus complet des travaux d’ensemble sur Jeanne d’Arc
en réponse au courrier des lecteurs (rubrique Demande et réponses).
Lien : Retronews
Demande : Quelle est en ce moment la Vie de Jeanne d’Arc la plus complète, la plus intéressante et la plus véridique ?
Réponse : Comme Vie proprement dite de Jeanne d’Arc, il y en a plusieurs de recommandables entre lesquelles il ne nous serait pas facile d’indiquer la meilleure. Comme travail d’ensemble sur Jeanne d’Arc et sa mission, il n’y a rien de plus complet que les ouvrages du R. P. Ayroles, publiés par M. Gaume.
L’Univers 24 décembre 1894
Le journal publie une lettre réponse de l’abbé Misset à une lettre ouverte de Mgr Turinaz, évêque de Nancy, répliquant lui-même à une brochure de l’abbé sur la question de la nationalité de Jeanne d’Arc. Il se place sous l’autorité du père Ayroles.
Lien : Retronews
Également dans la Vérité du 31 :
Lien : Retronews
M. l’abbé Misset, usant du droit de réponse, nous demande l’insertion de la lettre qu’il adresse à Sa Grandeur Mgr Turinaz, évêque de Nancy et de Toul, en réponse à celle du vénérable prélat que nous avons insérée dans notre numéro du 18 de ce mois :
Paris, le 21 décembre 1894.
Monseigneur,
Permettez-moi de répondre, avec toute la déférence dont je suis capable, à la lettre que Votre Grandeur a cru devoir m’adresser, il y a deux jours, par l’entremise de l’Univers.
[…]
Ce n’est pas moi, monseigneur, qui vous ai fait cette réponse, c’est le dernier historien de Jeanne d’Arc, le R. P : Ayroles, de la Société de Jésus. Vous l’avez évidemment lue dans sa Vraie Jeanne d’Arc, tome II, page 147.
[…]
Au point de vue administratif, fiscal, judiciaire, politique, géographique, Jeanne était Champenoise et non Lorraine. Reconnaissez-le loyalement, Monseigneur, non pas, si vous le voulez, pour la Champagne, mais pour la France et pour la vérité.
Daignez agréer, Monseigneur, l’hommage de mon profond respect.
E. Misset.
La Vérité publie également la lettre dans son édition du 31 décembre.
Lien : Retronews
Études 31 décembre 1894
Dans son compte-rendu sur l’ouvrage du père Pie de Langogne Jeanne d’Arc devant la Sacrée Congrégation des rites, Pierre Lanéry d’Arc rectifie une erreur (sans importance) le concernant : ses Mémoires et consultations précèdent de quelques mois la Vraie Jeanne d’Arc du père Ayroles.
Source : Études religieuses, etc., 31e année, supplément aux tomes 41, 42 et 43, p. 904-906.
Lien : Gallica
[…] En parlant de notre volume des Mémoires et consultations en faveur de Jeanne d’Arc par les juges du procès de réhabilitation, le P. Pie le fait paraître un peu après celui du P. Ayroles, alors qu’il était son aîné de plusieurs mois et que son apparition était relatée dans la Vraie Jeanne d’Arc même du P. Ayroles. Cette question de priorité n’enlève d’ailleurs rien au mérite de ce dernier beau livre, puisqu’il est une traduction analytique, alors que le nôtre est le texte latin ; les deux ouvrages sont donc parallèles.
Messager du Cœur de Jésus décembre 1894
Nouvelle Neuvaine à Jeanne d’Arc (du 28 décembre au 6 janvier), avec récitation de la prière du père Ayroles.
Le texte en est suivi d’une lettre attestant des guérisons obtenues suite à la neuvaine de juillet dernier. [Voir]
Un Nota bene rappelle qu’il faut éviter, avec grand soin, dans l’exercice de cette Neuvaine, toute manifestation de culte public
.
Source : Petit Messager du Cœur de Marie, bulletin de janvier 1895, p. 1-6.
Lien : Google
Texte d’abord publié dans le Messager du Cœur de Jésus de décembre 1894, tome 65, p. 695, bulletin de décembre 1894.
Lien : Google
Une neuvaine à Jeanne d’Arc : du 28 décembre au 6 janvier.
Le 6 janvier ramène une date doublement chère au cœur des catholiques français c’est la fête de l’Épiphanie, jour où le Sauveur Jésus se manifesta aux nations ; c’est aussi le jour où naquit Jeanne d’Arc, la Libératrice de la France.
Quand l’infortuné Charles VI descendit au tombeau, en 1422, sur le cercueil même du monarque français, du fils de saint Louis, le héraut anglais avait poussé ce cri étrange :
Vive Henri de Lancastre, roi de France et d’Angleterre !
En est-ce donc fait du beau royaume de France ? Non. J’enverrai mon Ange pour le sauver
, avait dit le Seigneur ; et de fait, dans la nuit du 6 janvier 1412, était née à Domrémy une humble et douce enfant, qui répondra au nom de Jeanne la Pucelle ; c’est l’enfant prédestinée par le Cœur de Jésus à sauver le beau royaume de Marie. Regnum Galliæ, Regnum Mariæ !
Or, n’est-il pas opportun, au grand jour de l’Épiphanie, de remercier Jésus et Marie d’un si merveilleux bienfait ? Oui, assurément. N’est-il pas également opportun, saint et patriotique, de prier Jésus et Marie, en ce grand jour, afin d’obtenir la canonisation de Jeanne d’Arc ? Oui encore.
Aussi, pour répondre à ce double vœu, chrétien et français, nous venons de publier séparément, en une feuille de quatre pages, la Neuvaine que voici.
I
Neuvaine à Jeanne d’Arc
Pour demander à Dieu des faveurs extraordinaires, en vue de la Canonisation de la Pucelle.
Avant-propos
La belle prière de la Neuvaine, que nous offrons à tous les amis de Jeanne d’Arc, a été composée en 1888, sous les regards de Notre-Dame de France, au berceau même de notre sainte Ligue du Cœur de Jésus.
L’auteur de cette prière si pieuse et si patriotique est le R. P. Ayroles, de la Compagnie de Jésus, le vaillant champion de Jeanne d’Arc sur les autels. Léon XIII, en le félicitant, par un Bref très élogieux, des grands et beaux ouvrages qu’il a composés en faveur d’une cause qui lui est extrêmement chère, l’a exhorté à poursuivre, sans défaillir, un si noble labeur.
Mais Jeanne d’Arc elle-même paraît applaudir au monument que son zélé serviteur élève à sa gloire. Des guérisons, des faveurs multiples sont obtenues par la prière qu’il a composée en son honneur. Nous enregistrons avec reconnaissance toutes ces grâces dans le Livre d’or de Jeanne d’Arc. Puissions-nous bientôt y recueillir les grands miracles qui, dans les desseins de Dieu, doivent amener la canonisation de l’Héroïne de la France.
En attendant, nous serons heureux de déposer aux pieds de la statue de Jeanne d’Arc toutes les requêtes qu’on voudra bien nous adresser, et dont on désire obtenir le succès par son intercession.
N. B. — Il faut éviter, avec grand soin, dans l’exercice de cette Neuvaine, toute manifestation de culte public.
On est prié d’adresser les demandes de prières et les actions de grâces au Directeur de l’Apostolat de la Prière, Toulouse, rue des Fleurs, 16.
Prière de la neuvaine
Approuvée par Mgr l’Évêque du Puy, le 31 juillet 1888.
Ô Jésus, roi des nations, pour relever la France humainement perdue, il vous plut un jour d’employer le plus faible des instruments, une petite paysanne, Jeanne la Pucelle. Prosternés à vos pieds, nous vous supplions de renouveler le souvenir de ce miracle, en glorifiant l’héroïque Libératrice de la France.
Veuillez donc, ô Cœur sacré de Jésus, manifester le crédit dont jouit auprès de vous la céleste Héroïne, en nous accordant, malgré notre indignité, la faveur miraculeuse que nous sollicitons en son nom. (La spécifier : par exemple, telle guérison.)
Ô Jeanne, ô fille de Dieu, comme vous appelaient les Voix, vous si compatissante aux maux qui vous entouraient, pour l’amour que vous portez à votre Seigneur, qui est aussi le nôtre, obtenez-nous l’insigne bienfait que nous demandons.
Sainte Vierge, mère et modèle de la Pucelle, glorifiez l’enfant qui fit ses délices de vos autels, et ne sépara jamais votre nom béni du nom adorable de votre Fils.
Prince des célestes milices, saint Michel, montrez que c’est bien en toute vérité que la sainte jeune fille s’est constamment donnée comme suscitée et conduite par vous, sans que vous ayez jamais fait défaut à sa prière.
Sainte Catherine, sainte Marguerite, maîtresses de la Pucelle, Église victorieuse de là-haut, et vous surtout, saints protecteurs de la France, par le commandement desquels Jeanne disait être venue, obtenez-nous le miracle que nous sollicitons, pour que l’Église associe votre digne sœur aux honneurs qu’elle vous rend ici-bas.
Ô mon Dieu, ne considérez pas nos démérites, mais écoutez vos anciennes miséricordes et les souvenirs d’ineffable bonté que nous rappelons.
Nous promettons d’user de vos bienfaits pour travailler, dans la mesure de notre pouvoir, au triomphe de la cause à laquelle votre fidèle envoyée se dévoua jusqu’au martyre : le règne social de votre Fils Jésus-Christ, Vrai Dieu et vrai homme, qui avec vous, ô Père, et avec le Saint-Esprit, vit et règne dans les siècles des siècles. Amen.
Ajouter les prières si chères à Jeanne :
Pater, Ave, Credo.
Nota. — J’ai nom Jeanne la Pucelle
, disait la Libératrice. Cette appellation lui venait du ciel, et les contemporains la lui conservèrent fidèlement. Elle doit lui être rendue, et à cause de son origine, et aussi parce qu’elle signifie la virginité dans sa délicate fraîcheur.
Daigne la Vénérable Jeanne d’Arc exaucer les demandes de tous ses pieux clients, et puisse bientôt la France dresser des autels, au sein de toutes les églises, à la plus admirable de ses enfants !
Imprimatur : Fl., Card. Desprez., arch. Tolos.
II
(Lettre d’une sœur du Sacré-Cœur relatant plusieurs guérisons obtenues après avoir prié la Neuvaine)
Au mois de juillet dernier, nous avions déjà publié, dans le Petit Messager du Cœur de Marie, la prière de cette Neuvaine, et nous la recommandions à la confiante piété de nos lecteurs. Leur confiance et notre espoir n’ont pas été déçus. À la date du 21 septembre 1894, nous avons reçu de Paris la lettre suivante :
Mon Révérend Père,
La reconnaissance envers la Vénérable Jeanne d’Arc fait un devoir, à une Communauté de Paris, de publier les faveurs qu’elle a obtenues après plusieurs Neuvaines, adressées à l’humble servante de Dieu.
Deux religieuses étaient très sérieusement atteintes ; mais l’une d’elles surtout, qui a une maladie cancéreuse, souffrait des maux de tête intolérables ; son mal était arrivé à un tel paroxysme, que le docteur ne savait plus quel remède employer.
On commença pour ces deux malades une Neuvaine à Jeanne d’Arc, récitant la prière composée par le P. J.-B. Ayroles, et approuvée par Mgr l’Évêque du Puy. Dès le commencement, les malades éprouvèrent un léger soulagement, et chaque jour le mieux s’accentuait davantage. À la fin des deux Neuvaines, nos chères malades ont pu reprendre les exercices communs de leur vie religieuse.
La seconde faveur obtenue fut pour un séminariste, auquel le Conseil d’administration avait signifié que son mauvais état de santé ne permettait pas qu’on le reprît, à la rentrée de 1894.
Après une Neuvaine à la Vénérable Jeanne d’Arc, le Supérieur, ayant consulté l’Archevêque, changea de décision, et s’empressa de faire connaître au clerc tonsuré son maintien au Séminaire.
Nous demandons à Dieu que ces grâces obtenues augmentent la confiance en celle qu’on voudrait pouvoir déjà invoquer comme Bienheureuse.
Veuillez agréer, mon Révérend Père, l’hommage de notre religieux et profond respect.
Sœur du Sacré-Cœur.
Écrit avec l’autorisation de notre Très Révérende Mère Prieure, ce 21 septembre 1894.
Depuis ce jour, nous avons reçu d’autres attestations, qui proclament la puissante efficacité de la Neuvaine à Jeanne d’Arc. Nous ne saurions donc mieux conclure notre appel et ces récits, qu’en reproduisant ce vœu déjà formulé par nous dans la Neuvaine : Daigne la vénérable Jeanne d’Arc exaucer les demandes de tous ceux qui l’invoquent, et puisse bientôt la France dresser des autels, au sein de toutes les églises, à la plus admirable de ses enfants !
Neuvaine à Jeanne d’Arc : Feuille de 4 pages. — Prix : 5 cent. ; 50 exempl., 50 cent. ; 100 exempl., 75 cent. — Chez le Directeur du Messager du Cœur de Jésus, à Toulouse, rue des Fleurs, 16.
Jeanne d’Arc et la Compagnie de Jésus 1894
Dans cet écrit, initialement non destiné à la publication, le père Ayroles célèbre le décret d’introduction de la cause de béatification en exposant quinze raisons établissant le lien entre l’histoire de Jeanne d’Arc et celle des Jésuites.
Source : Jeanne d’Arc et la Compagnie de Jésus. Paris, Schneider, 1894. — Typographie M. Schneider, 185, rue de Vanves. — 31 pages.
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
Petit Messager du Cœur de Marie janvier 1895
Article identique à celui du Messager du Cœur de Jésus de décembre 1894.
Source : Petit Messager du Cœur de Marie, bulletin de janvier 1895, p. 1-6.
Lien : Google
Notes d’art et d’archéologie janvier 1895
Réponse de l’historien Émile Eude à un lecteur indigné par sa description de Domrémy comme appartenant ethnographiquement à la Lorraine. Il persiste et cite le père Ayroles.
Source : Notes d’art et d’archéologie, 2e série, 7e année, n° 1, janvier 1895.
Lien : Gallica
Monsieur le Directeur,
D’après ce que vous m’écrivez, un des lecteurs de la Revue se plaint amèrement à vous de ce que, dans mon article intitulé À propos d’un tombeau de la cathédrale de Toul, j’ai écrit que Domrémy se trouvait ethnographiquement en Lorraine. J’ai écrit et je maintiens le mot. […]
Quand Villon a dit : Jehanne la bonne Lorraine / Qu’Angloys breuslèrent à Rouen
, il n’entendait nullement trancher la question provinciale, qui sans doute le préoccupait fort peu. Il parlait ethnographiquement, à la manière populaire ; et tout le monde comprenait, parce que les divisions administratives ne signifient rien pour le peuple, tandis qu’une dénomination rappelant la race est aussitôt saisie et gravée dans l’esprit.
Le R. P. Ayroles, dans son beau livre La vraie Jeanne d’Arc, a écrit avec raison :
C’est bien au-delà de l’ancien duché de Lorraine que s’étend la région signifiée par le mot Lorraine. Metz, Toul et Verdun sont des pays lorrains, et n’ont cependant jamais fait partie du duché…
Tel est bien le sentiment du grand historien lorrain, Dom Calmet,… […]
Émile Eude,
Paris, 18 déc. 1894.
Polybiblion 1894
Compte-rendu des tomes I et II de la Vraie Jeanne d’Arc dans la chronique de Marius Sepet sur les Ouvrages récents sur Jeanne d’Arc.
Sepet se borne ici à donner son impression générale
. Il doute que l’ouvrage puisse abolir tout ce qui l’a précédé
ou s’imposer avec une autorité quasi obligatoire auprès des historiens futurs
. Il conclut néanmoins :
[Les travaux du père Ayroles], très dignes d’estime, ont contribué et contribueront à mettre les traits surnaturels de [la Pucelle] en plus vive et plus abondante lumière.
Source : Polybiblion, tome 70, 2e série, tome 39, p. 406-408.
Lien : Google
Ouvrages récents sur Jeanne d’Arc. — [Les trois premiers sont : 1. le Livre d’Or de Lanéry d’Arc, 2. les Mémoires et consultations du même, 3. Jean Bréhal et la réhabilitation de Jeanne d’Arc des pères Belon et Balme.]
4 et 5. — La Compagnie de Jésus, qui a déjà fortement contribué à la défense, à la glorification de la Pucelle, lui a récemment produit un nouveau et fougueux champion dans la personne du R. P. Ayroles. Mû par un zèle d’ailleurs tout spontané, ce docte et fervent religieux a résolu de consacrer les dernières années d’une carrière qui, nous l’espérons, se prolongera longtemps encore, à une œuvre qu’il ne pense pas pouvoir accomplir à moins de cinq forts volumes du format in-quarto. Voici comment il en a défini lui-même le but et le caractère :
Mettre quiconque n’est pas sans quelque culture… [Vraie Jeanne d’Arc, t. II, But et plan, p. IX.]
Des cinq volumes en préparation deux ont déjà vu le jour. Le premier a pour sujet : La Pucelle devant l’Église de son temps. L’auteur, dans son Introduction, en a ainsi analysé le contenu :
Les mémoires composés pour la réhabilitation forment le plus riche fonds du présent volume… [Vraie Jeanne d’Arc, t. I, Introduction, p. XII.]
On ferait tort aux mérites du R. P. Ayroles si l’on ne remarquait que ce premier volume était achevé, quoique non encore publié, quand parut le recueil précité : Mémoires et consultations de M. Lanéry d’Arc. Ajoutons que les RR PP. Belon et Balme reconnaissent, dans les notes de leur ouvrage, avoir tiré excellent profit du livre du docte jésuite.
Le second volume du R. P. Ayroles, tout récemment publié, a pour sujet : La Paysanne et l’inspirée d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre-pensée. Il est divisé en cinq livres dont voici les titres, qui en feront connaître le contenu et le caractère : [titre des sept (et non pas cinq) livres.]
Si nous procédions à un examen critique de ce qui a déjà paru du vaste ouvrage du R. P. Ayroles, nous aurions, disons-le, le droit et le devoir de présenter à son auteur plusieurs sérieuses observations, soit au point de vue historique, soit au point de vue littéraire. Mais nous nous bornerons, pour aujourd’hui, à énoncer notre impression générale.
Nous ne sommes point, nous l’avouons, convaincu que l’œuvre dont il s’agit, abolissant tout ce qui l’a précédée, s’impose avec une autorité quasi obligatoire aux historiens futurs, comme l’unique source où ils devront désormais puiser leurs informations sur l’héroïque vierge. Nous ne croyons pas que le R. P. Ayroles ait été, comme il ne paraît pas éloigné, dans son ardeur un peu naïve, de le proclamer lui-même, le premier, le seul à discerner les traits exacts, la pure et sublime physionomie de la vraie Jeanne d’Arc
. Mais nous estimons que ses travaux, très dignes d’estime par le zèle qui les inspire, par le labeur dont ils portent la marque, par les renseignements, les indications, les rectifications, les réflexions, les aperçus qu’ils nous apportent, ont contribué et contribueront d’une façon notable à mettre les traits surnaturels de la fille de Dieu
, de la fille au grand cœur
, en plus vive et plus abondante lumière. Nous n’hésitons donc pas, toutes réserves faites, à les recommander sincèrement à nos lecteurs.
L’Univers 4 janvier 1895
Réplique de Mgr Turinaz, manifestement piqué par la lettre de l’abbé Misset publiée dans l’Univers du 24 décembre.
Lien : Retronews
Mgr Turinaz nous demande l’insertion de la lettre suivante qu’il adresse en réplique à la réponse de M. l’abbé Misset, parue dans l’Univers du 24 décembre.
La question offre un intérêt historique ; nos lecteurs seront aises de connaître les arguments que peuvent invoquer les deux opinions :
Nancy, le 31 décembre 1894.
Monsieur l’abbé,
Je ne puis laisser sans réponse votre lettre du 21 décembre, et que l’Univers a publiée dans le numéro du 24. Vous m’avez attaqué dans votre brochure ; je vous ai répondu une première fois. Vous m’écrivez de nouveau, j’ai le droit évident de la réplique.
[…]
Vous me citez le P. Ayroles, il parle
des textes, mais il n’en cite même pas un seul.[…]
En terminant, vous avez l’audace de me donner une leçon de loyauté, car, après avoir répété que Jeanne d’Arc était Champenoise et non Lorraine, vous, ajoutez :
Reconnaissez-le loyalement, Monseigneur, non pas, si vous le voulez, pour la Champagne, mais pour la France et pour la vérité.Ici, l’injure dépasse vraiment toutes les limites. Par charité, je ne vous dirai pas ce que la loyauté m’imposerait de vous dire, mais je vous demande de ne pas m’obliger à aller plus loin.J’aime mieux terminer en vous déclarant que je regrette vivement que vous m’ayez condamné à vous combattre et en vous affirmant que je vous pardonne de grand cœur les injures que vous m’avez adressées.
✝ Charles François,
Évêque de Nancy.
La Vérité 20 janvier 1895
Mention d’un compte-rendu de la Vraie Jeanne d’Arc par Ellen Clerke (femme de lettres irlandaise) dans la Dublin Review d’octobre 1894 (revue catholique basée à Londres).
Lien : Retronews
La Dublin Review publie sous le litre : La Vraie Jeanne d’Arc à propos du beau travail du R. P. Ayroles et d’un livre du P. Wyndham, prêtre anglais, sur l’héroïque libératrice de la France, un article fort intéressant. L’auteur, miss Clerke, a évidemment étudié avec passion la vie de Jeanne d’Arc. Et le volume du P. Ayroles surtout lui inspire des aperçus qui, pour un public français, paraissaient tout naturels, mais qui sont du nature à faire impression sur un public de lecteurs anglais.
Miss Clerke commence par déclarer que la figure rayonnante de la fille inspirée que le Ciel chargea de la délivrance de la France aux plus tristes heures de son histoire, occupe une place unique dans l’histoire du monde
. Et, appuyée sur les travaux dont elle cite les titres en tête de son article, l’écrivain de la Dublin Review n’a point de peine à établir l’irréfutable évidence de sa déclaration de début.
L’Univers 23 janvier 1895
Fin des procès diocésain de non cultu à Orléans et à Saint-Dié.
On y apprend que le père Ayroles a été entendu à Orléans, à la requête du vice-postulateur, l’abbé Clain.
Lien : Retronews
La cause de Jeanne d’Arc. — Comme nous l’avons annoncé, nous empruntons aux Annales religieuses d’Orléans l’article suivant sur la cause de Jeanne d’Arc :
Les Annales, dans le numéro du 6 octobre 1894, ont déjà parlé du commencement de ce procès, fait au nom du Souverain Pontife, dans le diocèse d’Orléans.
Après en avoir rappelé l’objet, elles ont donné les noms des membres qui devaient constituer le tribunal diocésain. Durant la procédure, celui-ci a été pourvu d’un autre sous-promoteur de la foi, M. l’abbé Boulet, par le fait même de sa nomination à la charge de promoteur du diocèse.
Le Tribunal a tenu vingt-six séances ; les témoins entendus ont été au nombre de onze : neuf à la requête de M. l’abbé Clain, vice-postulateur : le R. P. Ayroles ; M. l’abbé Rocher, vicaire-général ; M. l’abbé Duchâteau, curé-doyen de Chécy ; M. le chanoine Cochard ; MM. L. Jarry ; Ed. Pelletier ; Ch. Cuissare ; Herluison ; G. Vignat ; deux à la demande de MM. Boullet et Despierre, sous-promoteurs de la foi : M. l’abbé O. Rivet ; chanoine honoraire ; Mme la chanoinesse de Villaret.
Dans la vingtième séance, 17 décembre 1894. Monseigneur a levé le secret promis et juré tant par les membres du tribunal que par les témoins.
Dans la séance suivante, 7 janvier 1895, Sa Grandeur a prononcé sa sentence définitive, à savoir, que : d’après les témoignages recueillis, aucun culte ecclésiastique et public n’a été rendu, dans le diocèse, à Jeanne d’Arc ; puis, elle a publié les actes du procès.
Cette transcription faite, la copie a été collationnée avec l’original par les deux notaires assermentés, MM. Filiol, chancelier de l’Évêché, et Billare, secrétaire de l’Évêché, en présence du tribunal et de l’un des sous promoteurs. Les actes du procès et ses annexes comprennent trois cent sept feuillets, et la copie deux cent cinquante. C’est cette copie qui est destinée à la Congrégation des Rites.
La Sacrée Congrégation aura alors à se prononcer prochainement sur cette question : An sententia judicis delegati… sit confirmanda, vel non ? Y a-t-il lieu de confirmer ou non la sentence du juge délégué, ès-diocèse d’Orléans, pour l’instruction du procès de non-cultu ?
Enfin, dans sa vingt-sixième et dernière séance, tenue le 14 janvier, la copie des actes a été placée sous enveloppe scellée et remise officiellement à Sa Grandeur, qui a bien voulu être le portitor, c’est-à-dire se charger sous serment de la transmettre à la Sacrée Congrégation des Rites.
Si, comme il y a lieu de l’espérer, la Sacrée Congrégation confirme la sentence de NN SS. les Évêques d’Orléans et de Saint-Dié, le procès de béatification suivra son cours conformément aux règles canoniques.
On sait que les procès de canonisation entraînent pour les diocèses postulateurs de la Cause, des charges considérables.
Jusqu’au décret d’Introduction de la Cause de Jeanne d’Arc, c’est notre diocèse qui seul les a supportées. Les abonnés des Annales, ce nous semble, apprendront avec plaisir qu’ils ont coopéré et qu’ils sont appelés à coopérer à ces frais, jusqu’à ce que la Cause soit terminée. Mgr Coullié avait décidé, et, après lui, Mgr Touchet s’est empressé de confirmer, que le boni de notre semaine religieuse ne pouvait mieux être affecté qu’aux dépenses occasionnées par la poursuite, en cours de Rome, de la canonisation de la Pucelle d’Orléans.
Puisse donc sur cette pieuse et patriotique considération, le nombre des abonnés des Annales s’augmenter ! Ils viendront, à coup sûr, en aide à l’administration diocésaine, à qui déjà incombent bien d’autre charges.
Il te faut, France nouvelle,
Prendre pour patronne et sœur,
Jeanne, la bonne Pucelle,
Et lui donner tout ton cœur.
Eude, Le nouveau mystère du Siège d’Orléans.
Les Annales religieuses donnent également quelques renseignements sur le procès instruit dans le diocèse de Saint-Dié et dont les lecteurs connaissent depuis longtemps les résultats.
Les témoins entendus ont été au nombre de onze : sept à la demande du vice-postulateur, deux à la requête des sous-promoteurs de la foi, et deux autres à l’occasion de la visite de la maison de la Vénérable, de l’église de Domrémy et de la crypte du Bois-Chenu.
Le tribunal a dû se transporter deux fois à Domrémy : une première fois pour l’audition des témoins et une seconde pour l’inspection des lieux. Parmi les témoins entendus, se trouve la sœur Hermance, ancienne gardienne de la maison Jeanne d’Arc et supérieure du pensionnat de Domrémy.
Le dossier du procès forme un volume de 200 pages in-folio environ.
Le mercredi 31 octobre, a eu lieu, sous la présidence de Mgr Foucault, la dernière séance du procès de non cultu, pour la mise sous scellés des actes et leur remise officielle à celui qui doit les porter à la S. G. des Rites avec les lettres d’envoi de Sa Grandeur, du juge délégué et des sous-promoteurs de la Foi. Le Portitor a été M. l’abbé Gérard, élève du séminaire français à Rome.
Affiches Tourangelles 7 février 1895
Lettre d’un Admirateur du P. Ayroles
, au ton amphigourique.
Note. — L’auteur anonyme en est probablement le directeur du journal, Henri Destréguil. Elle est en effet suivi de plusieurs autres identiques, qui se répondent l’une l’autre. La dernière est précédée d’un acrostiche composant : Père Ayroles
) ; or deux acrostiches publiés les 3 et 10 janvier, et signés d’un Petit commerçant dévoré par les Grands-Bazars
, formaient : Destréguil
.
- 7 février
- 21 février
- 28 février
- 7 mars (acrostiche)
Lien : Archives d’Indre-et-Loire
La lettre du 7 février fut reproduite par la Croix (de Touraine) dans son édition du 10 mars :
Lien : Gallica
Jeanne d’Arc. — Nous nous empressons de publier la lettre suivante. Nous nous associons de tout cœur à l’éloquent hommage de notre correspondant au R. P. Ayroles dont nous avons su apprécier les travaux à leur valeur. Nos lecteurs, nous l’espérons, répondront à l’appel que nous sommes si chaleureusement invité à leur adresser. Dictée par un cœur éminemment français et catholique, la généreuse communication dont nous sommes honoré a droit à notre reconnaissance et à notre publicité. Jeanne d’Arc couvre l’anonymat de la signature.
Nous n’omettrons pas de féliciter MM. Gaume d’être les éditeurs du R. P. Ayroles : la vieille renommée de leur maison en reçoit un nouvel éclat.
H. D.
Orléans, 1er février 1895.
Monsieur le Directeur des Affiches Tourangelles,
Je vous loue tort d’ouvrir votre journal à des questions dont le caractère historique et religieux soulève votre patriotisme et votre foi. Je me plais, en effet, à croire que votre appel à
toute communication relative à Jeanne d’Arcs’inspire de ce double sentiment : vous êtes enfant de Touraine, et Jeanne a foulé votre sol ; cela se comprend.Et je me prévaux bien volontiers de cet appel. Lecteur occasionnel des Affiches Tourangelles, auxquelles un récent débat des Chambres et votre opiniâtre campagne en faveur des petits ont donné quelque notoriété, j’ai pu constater que leur circulation n’est point limitée à votre département, à vos voisins même de la Beauce et de l’Anjou, du Berry et du Poitou, mais s’étend à presque toutes nos provinces. N’êtes-vous pas, du reste, l’
organe de la défense du commerce national? C’est, au fait, sur la table d’un gentilhomme de l’Artois, en route pour la Touraine, où il va peut-être vous acheter un château, une villa, que j’ai vu le numéro du journal qui me met la plume aux doigts. Je ne m’étonne pas d’avoir trouvé là vos Affiches Tourangelles. Je comprends que le nombre considérable de vos annonces et leur diversité vous aient acquis une clientèle de riches propriétaires autant que de commerçants, clientèle dont votre notoire expérience des matières foncières et fiscales, et votre généreuse défense des intérêts du commerce, vous assurent le développement et méritent les sympathies.Vous demandez, Monsieur, qu’on vous parle de Jeanne d’Arc, et vous nommez le R. P. Ayroles : vous serez servi à souhait. (Nous avons eu, on se le rappelle, l’honneur de correspondre avec le R. P. Ayroles, relativement à Jeanne d’Arc. Voir les Affiches Tourangelles du 29 mars 1894.) Il est tout simple qu’un Tourangeau, épris de Jeanne d’Arc et maître d’un journal, soit jaloux de faire les honneurs de sa publicité à la céleste héroïne dont l’histoire est si étroitement liée à celle de son pays.
Jeanne d’Arc ! C’est elle qui m’a arraché du train qui me portait au Midi, c’est elle qui m’a retenu dans la ville de la Délivrance. On se plaît à rêver de Jeanne dans cette vieille cité d’Orléans où l’image de la Pucelle court les rues sous les aspects les plus divers. Avant de tourner le dos à la Place du Martroi, cependant, je veux, — et c’est là le principal, l’unique objet de ma
communication, — je veux vous exhorter à signaler à vos lecteurs, à vos compatriotes, l’œuvrestupéfiante, — je traduis fidèlement le terme dont l’a si énergiquement qualifiée le grand organe catholique, la Civittà cattolica, l’œuvrestupéfiante, je le répète, du P. Ayroles. Signalez-leur ces deux in-quarto de l’illustre Jésuite : La Pucelle devant l’Église de son temps et La Paysanne et l’Inspirée, dont la presse catholique s’est émerveillée, honorés d’un Bref particulièrement élogieux et significatif de Léon XIII. Signalez-leur ces trois autres in-quarto annoncés par l’éditeur, et impatiemment attendus du monde catholique, du monde des érudits : La Libératrice, La Vierge guerrière, La Martyre. Quel majestueux monument de labeur, de science et de foi, l’auteur de la Pucelle devant l’église de son temps et de la Paysanne et L’Inspirée a déjà élevé à la vierge de Domrémy, et combien plus superbe encore jugerons-nous l’œuvre déjà grandiose du P. Ayroles, lorsqu’il nous aura donné la Libératrice, la Vierge guerrière, la Martyre ! Oh ! alors, l’œuvre sera plusstupéfianteencore ! Singulièrementempoignantce stupendo italien ! et comme il dit vrai !Il est probable que tous vos lecteurs n’ont pas, au même degré, le goût de travaux de pareille haleine, le même souffle de patriotisme, le même élan de foi. Le premier venu, du reste, — le P. Ayroles le sait bien, — ne digère pas cinq in-quarto, si fécondes qu’en soient les recherches, si curieux, si probants, si nouveaux qu’en soient les multiples documents, si belle que soit la langue qui les revêt ; mais qu’ils lisent du moins, vos lecteurs, — je ne saurais trop les y engager, — qu’ils lisent, pour leur plus complète instruction, pour le plus grand bien de leur âme, ce simple in-douze du maître, un chef-d’œuvre que précède une Introduction de trois pages, chef-d’œuvre elle-même, Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France ; et, nourris de ce petit volume, ils ne reculeront pas devant les cinq in-quarto. Grande lumière, évidente inspiration que cette Jeanne d’Arc sur les autels, qui date de dix ans, et que nous relisons avec une croissante admiration.
C’est la somme catholique et française du siècle… Toute une bibliothèque, dit un éminent théologien.Théologie de l’Histoire, dit le cardinal Bourret.Œuvre magistrale, disent le P. Monsabré, Mgr de Cabrière et Mgr Ricard.Jeanne d’Arc découvertese sont écriés d’autres juges non moins compétents. J’occuperais une page de votre journal si je ne me bornais à ces citations. Jeanne d’Arc sur les autels, me permettrai-je d’ajouter, c’est l’écrasement du Naturalisme, c’est le livre le plus actuel de nos temps : il s’impose.Il date, ai-je dit, de 1885, ce livre sublime. Qui de nous, alors, eût osé espérer qu’elle serait la
Vénérablede 1894, Jeanne d’Arc ? que l’heure serait proche peut-être, heure d’immense allégresse, heure d’immense honneur à la Patrie française, où Rome la livrerait à notre piété catholique, Jeanne d’Arc ? Prions pour la voirsur les autels. Prions pour les évêques qui ont si noblement attaché leurs noms à cet ineffable triomphe de la béatification. Rendons grâce au grand Pape qui en hâtera le jour, dont le nom demeurera si cher à nos cœurs français.Dans cette merveilleuse
cause de Jeanne d’Arc, notreVénérabled’aujourd’hui, le P. Ayroles ne nous paraît-il pas un instrument de Dieu ? La véhémence de son patriotisme, la vigueur de sa volonté, la fermeté de ses jugements, la patience de son labeur, la clarté de sa foi, la fougue de ses enthousiasmes, ne nous semblent-elles pas les signes d’une vocation à l’œuvre entreprise ? Saluons de notre profonde vénération, de notre profonde gratitude l’éminent religieux, gloire de la Compagnie de Jésus, gloire des lettres françaises. Soyons les apôtres de ses écrits : Jeanne nous tiendra compte d’honorer son incomparable historien.Veuillez agréer, etc.
Un dévot à Jeanne d’Arc,
un admirateur du P. Ayroles.
Notre concours. — Nous rappelons aux archéologues et à nos lecteurs que, dans notre dernier numéro, nous avons ouvert un concours pour la découverte de l’emplacement de l’hôtel de Jehan Du Puy, seigneur de la Roche-Saint-Quentin, conseiller du roi, époux d’Éléonore La Pau, chez qui Jeanne d’Arc a séjourné à Tours.
C’est, selon le R. P. Ayroles, en janvier 1430 et non 1429, que notre immortelle Héroïne a fait faire son étendard par James Pauwer.
Nous offrons un plat artistique d’une valeur de 50 francs, ou cette somme en espèces, à l’auteur d’une notice qui indiquera, d’une façon précise et indiscutable, cette maison ou son emplacement, c’est-à-dire la rue et le numéro.
H. D.
[On lisait dans le numéro du 31 janvier 1895 :]
Disons, à ce propos [la cause de béatification], que nous ouvrons de nouveau un concours pour la découverte de l’emplacement de l’hôtel de Jehan Dupuy […]. Les colonnes des Affiches Tourangelles demeureront ouvertes à toute communication relative à Jeanne d’Arc. Pour faciliter les recherches des archéologues, nous leur signalons le n° 611 des Affiches Tourangelles du 29 mars 1894, où il est prouvé que c’est bien en 1430 et non en 1429, qu’elle a séjourné ; à Tours, d’après le R. P. Ayroles.
Affiches Tourangelles 21 février 1895
Nouvelle lettre d’un autre admirateur du P. Ayroles
, qui s’associe au premier (édition du 7 février).
Voir la série (février-mars).
Lien : Archives d’Indre-et-Loire
L’historien de Jeanne d’Arc. — Nous insérons d’autant plus volontiers la lettre suivante d’un nouveau correspondant d’Orléans, qu’il se montre aussi enthousiaste que le premier des œuvres du R. P. Ayroles, et qu’il professe un égal amour de Jeanne d’Arc. Nous accueillerons avec empressement, nous le répétons, toute communication relative à la Vénérable
.
Orléans, 15 février.
Monsieur le Directeur,
Le sol de la Délivrance appelle à le visiter les cœurs français, les âmes catholiques. Je me trouve en ce moment dans la ville de la
Pucelle. Je m’y suis souvent arrêté. Autant que j’admire Jeanne d’Arc, j’aime ceux qui la glorifient. Je vous fais donc juge de l’impression que j’ai reçue de la lettre d’undévot à Jeanne d’Arc, d’un admirateur du Père Ayroles. C’est au Messager d’Indre-et-Loire que je dois de l’avoir lue, cette belle lettre, probablement reproduite par d’autres feuilles catholiques. Saurions-nous trop louer l’œuvre considérable que signale votre correspondant à vos lecteurs de Touraine, et ces lecteurs sauraient-ils, à l’heure où nos regards se portent sur la Vénérable Libératrice, à l’heure où Rome se prépare àlivrer la Céleste Envoyée à notre piété catholique, sauraient-ils se défendre de répondre à votre appel ? Non, non, notre patriotisme et notre foi nous commandent de l’écouter.J’admets bien que les modérément curieux de grands travaux historiques, que les tièdes à ces opiniâtres, à ces
fécondes recherchesqu’une foi puissante seule inspira, — s’effraient un peu de volumineux écrits tels que la Pucelle devant l’Église de son temps, la Paysanne et l’Inspirée, la Libératrice, la Vierge guerrière, la Martyre, mais j’estime aussi qu’aucun catholique, je pourrais dire aucun Français, ne doit plus tarder aujourd’hui de lire, de méditer la Jeanne d’Arc sur les autels et la Régénération de la France del’éminent religieux, livre sublime dont votre correspondant a pénétré les profondeurs en l’appelantune grande lumière, une évidente inspiration. Il est de toute évidence, en effet, que les travaux du Père Ayroles témoignent d’une véritablevocation à l’œuvre entreprise. J’ajoute, d’ailleurs, — et ledévot à Jeanne d’Arcn’en doute pas, — que le simple in-douze Jeanne d’Arc sur les autels et la Régénération de la France conduit nécessairement ceux qui s’en serontnourrisaux magistrales études dont le Père Ayroles a enrichi nos Annales.Je sais l’insigne humilité du savant Jésuite, mais loin qu’elle m’interdise de proclamer l’exceptionnelle autorité de son œuvre, elle m’enhardit à le
signaleraussi à vos compatriotes.Agréez, Monsieur, tous mes compliments et mon cordial salut.
Autre dévot à Jeanne,
autre admirateur du père.
Affiches Tourangelles 28 février 1895
Troisième lettre, signée cette fois l’abbé L. D.
, dans le même ton que celles des 7 et 21 février.
Voir la série (février-mars).
Lien : Archives d’Indre-et-Loire
Tribune des lecteurs. — Un vénérable ecclésiastique du diocèse de Tours nous fait l’honneur de nous adresser quelques chaudes et flatteuses lignes au sujet de la lettre de l’admirateur du R. P. Ayroles, l’historien de Jeanne d’Arc
.
La lettre du digne prêtre témoigne de trop hautes sympathies envers notre honorable correspondant pour que nous ne nous plaisions pas à citer textuellement ses appréciations dans leur familier abandon. En voici un extrait :
Monsieur le rédacteur,
C’est beau, cette dévotion à Jeanne d’Arc ! J’aime ces âmes pénétrées d’une idée patriotique capable de nous sauver. J’ai rarement lu un article qui parle tant au cœur, qui excite tant à lire les livres dont il parle. L’auteur est du petit nombre de ceux qui voient comment on peut sauver un peuple. Je l’aime beaucoup. Je désire énormément le connaître. Voilà un vrai Français !
Je vous félicite de vous passionner pour cette belle cause de Jeanne d’Arc et de publier de si beaux articles. Celui-ci dit beaucoup, mais fait supposer dans le cœur de l’auteur bien des choses très belles qui ne sont pas écrites.
Bravo ! Bravissimo ! Veuillez agréer, etc.
L’abbé L. D.
Affiches Tourangelles 7 mars 1895
Acrostiche et nouvelle lettre du dévot
.
Voir la série (février-mars).
Lien : Archives d’Indre-et-Loire
L’auteur de la Vraie Jeanne d’Arc
. — Nous sommes heureux de constater que la lettre d’Un dévôt à Jeanne d’Arc
, écrite d’Orléans le 1er février, et publiée dans notre numéro du 7, a été suivie d’une autre lettre, empreinte des mêmes sentiments de dévotion à la Pucelle et d’admiration de son historien. Nous nous félicitons aujourd’hui d’avoir reçu les vers suivants d’un autre des nombreux enthousiastes de l’illustre religieux. Jeanne d’Arc, on le voit, empoigne
nos lecteurs. Que notre journal soit leur tribune : nous ne demandons que cela.
Dans un modeste et spirituel post scriptum, l’auteur s’excuse près de nous d’avoir fait ce qu’il nous demandait de faire
. Nous le remercions bien volontiers de nous avoir dérobé l’honneur
de la terrible prison de l’acrostiche. N’y entre pas qui veut.
Puisque Jeanne sur vos Affiches
Est couchée en longs acrostiches,
Rendez aussi, c’est mon conseil,
Et rimant de, mode pareil,
A son illustre apôtre hommage.
Y trouverez votre avantage :
Rien ne refuse, sachez, rien, —
Or je le dis d’expérience, —
La Sainte à qui l’historien,
Etonnant de foi, de science,
Sut inspirer sa confiance.
Un de ceux-là
Sans m’en apercevoir, je viens de vous dérober l’honneur de faire ce que je vous demandais, mais que la politesse ne vous interdise pas de faire mieux.
Nous nous empressons de publier la lettre suivante. Le vénérable
abbé appréciera, comme nous, le délicat esprit et le généreux cœur qui l’ont dictée.
Orléans, 18 février.
Monsieur le rédacteur,
Je dois un particulier témoignage de révérence et de gratitude au
vénérable ecclésiastiquedont votre journal m’apporte aujourd’hui le trop bienveillant jugement. Si honoré que je m’estime, cependant, des termes dans lesquels il l’a formulé, si touché, si flatté que je sois des chaleureux élans de son grand cœur, que le digne prêtre me permette de lui dire qu’il me loue trop. Je suis tout simplement un catholique et un patriote qui sut, jeune encore, comprendre, admirer, aimer Jeanne d’Arc, Inspirée, Envoyée, Libératrice, Martyre, et qui, soulevé plus tard par l’œuvre grandiose de son incomparable historien, s’attache à la faire connaître. Voilà tout le secret de mon amour de Jeanne d’Arc, tout le secret de mon enthousiasme des écrits du Père Ayroles. Je relisais ses imposants volumes, et ne pouvais me défendre du stupendo italien, à mesure que j’en tournais les feuillets, quand m’est arrivé votre journal.Votre
vénérable ecclésiastiquetrouve que j’excite à lire les livres dont je parle. Je me plais donc à espérer qu’il voudra bien, pour la plus grande grande gloire de Jeanne, pour le plus grand honneur du Père Ayroles, dire à ceux de ses confrères et de ses amis qui ne les ont pas encore lus, deux mots des ouvrages du docte Jésuite.Je remercie cordialement votre digne correspondant de m’honorer de son
amitié, dedésirer me connaître. Je le prie d’agréer ma ferme intention de l’aller saluer à mon retour en Touraine, où Jeanne a laissé de si profondes traces. Je veux, toutefois, me présenter à lui avant de franchir sa porte. Je date du temps où la jeunesse croyante de Paris, — quorum pars, — se dérobait aux dissolvantes campagnes du rationalisme, du voltairianisme, du matérialisme, — la libre pensée préludait alors au formidable épanouissement dont nous sommes témoins, — en se groupant autour de la chaire de Notre-Dame sous la parole des Ravignan et des Lacordaire. Je connaissais fort bien à vingt ans le chemin de la rue de Sèvres. Voilà ma carte, cher Monsieur : veuillez la faire passer au saint prêtre dont je me dis le très respectueux serviteur et qui la jugera, je l’espère, une suffisante introduction. Et merci de vous charger du message.Jeanne, vous l’avez dit, couvre la signature de
son dévot.
L’Univers 30 mars 1895
Annonce de l’Histoire de Jeanne d’Arc du père Dunand, d’après Quicherat et Ayroles.
Lien : Retronews
[…] L’auteur nous promet dans le titre, une Histoire de Jeanne d’Arc d’après les travaux les plus récents
, et il tient parole. Il a trouvé dans Quicherat, dans le R. P. Ayroles une foule de particularités saisissantes et à peu près inédites, il nous les donne.
La Croix de Touraine 8 avril 1895
Sous le titre, La Pucelle, soldat et capitaine accompli, le journal reproduit le chapitre des extraits de Jeanne sur les autels, livre II, chapitre IV, p. 101-105.
Lien : Gallica
Au rapport de chroniqueurs, témoins oculaires, voici ce que contempla la cour à la première arrivée de la jeune villageoise…
La Dépêche du Puy-de-Dôme 4 mai 1895
Le quotidien propose une très intéressante revue de presse des critiques des deux premiers tomes de la Vraie Jeanne d’Arc. Après avoir souligné l’engouement unanime de la presse catholique, il fait remarquer :
La presse libre-penseuse n’a pas même tenté une réfutation : son silence équivaut à un aveu.
Lien : Gallica
Bibliographie. — La Vraie Jeanne d’Arc.
À tout prix, il faut arracher notre admirable Jeanne d’Arc au rationalisme et à la libre-pensée.
Ainsi écrivait, il y a quelques années, le cardinal Desprez au R. P. Ayroles de la Compagnie de Jésus. Et les paroles du regretté cardinal ont reçu la plus haute confirmation qui put lui être donnée. Le Pape a daigné écrire, en ces termes particulièrement expressifs et paternels, au R. P. Ayroles :
Bien aimé fils, salut et bénédiction apostolique. [Bref de Léon XIII, jusqu’à :] Que la Bonté divine vous continue son assistance pour le reste de l’œuvre et l’exécution de votre pian tout entier ; c’est ce que Nous vous souhaitons bien affectueusement en vous donnant Notre bénédiction apostolique.
Le plan du R. P. Ayroles comprend cinq volumes in-quarto de six à neuf cents pages chacun, d’une belle exécution typographique : La Pucelle devant l’Église de son temps ; La Paysanne et l’Inspirée ; La Libératrice ; La Vierge guerrière ; La Martyre.
Chaque volume forme un tout, parce qu’il présente une phase particulière de l’astre libérateur. Il peut être acquis séparément. Mais, tandis que pour les souscripteurs à la collection entière, le prix est seulement de dix francs, il sera de quinze francs ou même plus, pour ceux ; qui ne demanderaient qu’un seul volume ; à moins toutefois qu’ils ne demandent six exemplaires des volumes déjà édités : ce qui donne droit au prix de faveur. Ont paru :
I. La Pucelle devant l’Église de son temps, in-4° de huit cents pages, 15 fr.
On ignorait que la vénérable Pucelle, depuis son apparition sur la scène jusqu’à sa réhabilitation, avait été théologiquement étudiée par l’élite des docteurs de l’époque. Ce Volume n’a pas seulement fait connaître, ces docteurs ; il renferme, traduits en français, où scrupuleusement analysés les traités composés sur la sainte fille. On n’était pas plus fixé sur les bourreaux de la martyre ; les plus odieux ne furent pas les Anglais ; pièces en mains il a été démontré que les plus acharnés étaient les ennemis des prérogatives de la Chaire apostolique, non moins que de la divinité de la mission de la céleste envoyée.
Le R. P. Cornoldi, directeur de la Civiltà Cattolica, qualifiait l’œuvre de stupenda, et la savante revue la disait, grandiose, chrétienne, non moins que patriotique
. [Voir]
Je ne sais rien de plus intéressant, de plus scientifique, de plus instructif que ces longues discussions des faits et des gestes de la Pucelle. Le P. Ayroles ne pouvait l’écrire, ni mieux, ni plus à propos
, disait, dans la Revue des sciences ecclésiastiques, un savant professeur de l’Université catholique de Lille [Voir].
Tant de mémoires sur la même question, remarque M. d’Assigny, devaient se répéter. Là était l’écueil. L’élément biographique, introduit avec beaucoup d’art, interrompt suffisamment la monotonie des raisonnements.
[Voir]
L’académicien qui signe Valbert dans la grande revue rationaliste, la Revue des Deux-Mondes, qualifiait ainsi le volume : Gros livre, un peu indigeste, mais fort instructif.
[Voir]
Tous vos lecteurs admireront avec moi, voulait bien écrire à l’auteur S. E. le cardinal Langénieux, quelle patience vous avez apportée dans les recherches, quelle sagacité dans le discernement des preuves, quelle intelligence dans l’analyse que vous en avez faite.
S. É. le cardinal Bourret : Je n’ai qu’à vous redire combien je trouve cette étude bien menée, bien creusée et surtout opportune.
Le livre, comme daignait le consigner dans un de ses mandements Mgr Coullié, renfermait des réponses victorieuses aux objections que, selon son office, devait faire contre l’introduction de la cause le promoteur de la foi. Les actes prouvent combien il a été mis à contribution.
II. — La Paysanne et l’inspirée, d’après ses aveux, les témoins oculaires et la libre pensée, in-4° de six cents pages, 15 fr.
Il n’y a que l’embarras du choix dans les éloges prodigués presque unanimement par la presse, tant à l’ensemble de l’œuvre qu’à ses diverses parties : à la partie de l’exposition et à la partie polémique.
Un digne magistrat démissionnaire, l’âme de la catholique Revue des institutions et de Droit de Grenoble, M. A. Desplagnes, a écrit : Tout est parfait, l’histoire et la réfutation des libres-penseurs. Si le temps était plus français, ce serait le grand événement de l’année. C’est un magnifique monument. L’ouvrage restera et sera la base fondamentale de notre grande et merveilleuse histoire nationale.
[Voir] [Étrangement, les citations n’y sont pas retrouvées.]
L’Univers, parlant des gros volumes déjà publiés, affirme qu’on les lira avec la surprise de trouver tant d’attraits à une œuvre majestueuse
[Voir], et, dans un article subséquent, par la plume de M. d’Assigny : Le P. Ayroles a déchargé son cœur avec une expansion, une vivacité de langage qui exclut toute idée de calcul et de préméditation, et il se trouve qu’il a fait œuvre de critique transcendante, œuvre solide, capable de défier l’action du temps : Exegi monumentum are perennius.
[Voir]
Le Monde : Le P. Ayroles a l’ardeur d’un chevalier et la patience d’un religieux. Avec une érudition consommée, avec une énergie extraordinaire, avec une fougue inlassable, il s’est jeté dans la mêlée des hommes et des idées. Il a vaillamment couru à l’ennemi, l’a renversé à terre, et littéralement mis en pièces.
[Voir]
La Vérité, rendant compte de plusieurs ouvrages sur Jeanne d’Arc : À raison de son importance, je dois placer le grand ouvrage du P. Ayroles au premier rang. Quand il sera terminé, ce sera un grand monument, le plus considérable qui existe, élevé à la mémoire de Jeanne d’Arc. Quiconque voudra écrire désormais sur Jeanne d’Arc ne pourra s’empêcher de le consulter.
[Voir]
Le Polybiblion : Nous estimons les travaux du P. Ayroles très dignes d’estime par le zèle qui les inspire, par le labeur dont ils portent la marque, par les renseignements, les indications, les rectifications, les réflexions, les aperçus qu’ils nous apportent.
[Voir]
La Revue du Monde catholique : Il faut voir avec quelle abondance, quelle sûreté et quelle verve l’auteur réfute les principaux représentants du rationalisme appliqué à Jeanne d’Arc.
[Voir]
Il serait facile de multiplier les citations. Mais nous en avons suffisamment indiqué pour montrer que le bref de Sa Sainteté n’a fait que confirmer avec une autorité sans pareille le jugement déjà porté par la presse catholique. La presse libre-penseuse n’a pas même tenté une réfutation : son silence équivaut à un aveu.
La Vérité 7 mai 1895
D’Auteuil, Questions historiques (feuilleton). — Mention du père Ayroles dans un article sur les Publications relatives à Jeanne d’Arc.
Lien : Retronews
[Article en deux parties : I. sur la question du pays d’origine de Jeanne d’Arc ; II. sur l’ouvrage de l’historien Lecoy de La Marche, À la gloire de Jeanne d’Arc, où on lit :]
Sachons blâmer nos rois dans les cas où ils le méritent ; mais ayons, d’autre part, le courage de les défendre au besoin contre les vieilles rengaines populaires qui n’ont d’autre fondement que les versions aventurées des historiens libre-penseur.
Ces historiens, M. Lecoy de la Marche leur dit carrément leur fait dans une étude finale, où il s’inspire principalement du récent ouvrage du R. P. Ayroles : La paysans et l’inspirée. Mais s’il adopte, en général, les conclusions du hardi polémiste, ce n’est pas sans relever les erreurs de détail où celui-ci se laisse parfois entraîner, au sujet de Quicherat, de Vallet (de Viriville), de Siméon Luce,etc. Sans doute le livre de ce dernier, Jeanne d’Arc à Domrémy, est inspiré surtout par une pensée rationalise. Chercher à la mission de la Pucelle des origines purement humaines, attribuer son entraînement aux influences ambiantes, tirer des plus petites choses des conséquences énormes, faire naître, en un mot, d’une série de hasards ou d’hypothèses la série des prodigues dont se compose l’histoire de l’héroïne, ce n’est pas, à proprement parler, faire œuvre de chrétien, ni même d’érudit sérieux…
[Note. — cette réflexion de Lecoy est tirée d’un article paru dans l’Univers du 25 mai 1894.]
Société de l’histoire de France 4 juin 1895
Léopold Delisle, administrateur de la Bibliothèque nationale, informe la Société de la découverte de la Chronique de Morosini par le père Ayroles. Face à l’importance historique du document, l’historien Germain Lefèvre-Pontalis se propose de suspendre ses travaux en cours afin de se consacrer à son édition, si la Société décidait de la lui confier.
Source : Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France, année 1895, tome 32 (Paris, Renouard), p. 118.
Lien : Gallica
Séance du 4 juin 1895.
[…] M. Delisle, au nom du même Comité [de publication], annonce que M. Germain Lefèvre-Pontalis avait l’intention de proposer la publication du texte historique, de la première partie du XVe siècle, connu sous le surnom de Chronique du manuscrit des Cordeliers et faisant une sorte de suite aux Chroniques de Monstrelet, mais qu’une découverte toute récente a attiré son attention sur un texte encore plus digne, à tous les points de vue, d’être proposé à la Société. M. Delisle lit la note qui suit :
Une Chronique vénitienne, encore inédite, et renfermant de très intéressants renseignements sur l’histoire de Jeanne d’Arc, a été rédigée, à la fin du XIVe siècle et dans le premier tiers du XVe, par un vénitien, Antonio Morosini, dont le nom n’a point été relevé jusqu’ici dans les grands répertoires biographiques ou bibliographiques. Un manuscrit de cette Chronique, copié au XVe siècle, peut-être l’original, est conservé à la Bibliothèque impériale de Vienne, et la bibliothèque de Saint-Marc de Venise s’en est récemment procuré une transcription.
Le manuscrit de Vienne fait partie de la grande collection historique formée au XVIIIe siècle par Foscarini ; il a été l’objet d’une notice très exacte et assez détaillée, insérée en 1843 dans le Catalogue des manuscrits de Foscarini rédigé par M. Tommaso Gaz (tome V de l’Archivio storico italiano). Cette notice nous apprend que, pour la période comprise entre 1374 et 1433, la Chronique de Morosini est un véritable journal vénitien, dans lequel le compilateur a fait entrer les nouvelles de tous les pays avec lesquels la république de Venise entretenait des relations. L’auteur de la notice a appelé l’attention sur les pages de la Chronique qui se rapportent aux guerres de la France et de l’Angleterre, et notamment aux faits de la Pucelle d’Orléans mais cette indication, passée inaperçue, n’a pas été jusqu’ici mise à profit par nos compatriotes.
En 1892, dans une brochure publiée à Trieste, Mme Adèle Butti signala expressément des correspondances relatives à Jeanne d’Arc que renfermait la Chronique d’Antonio Morosini. Le R. P. Ayroles, mis en éveil par ces indications, pria M. Delisle de lui procurer une copie des passages cités par Mme Butti. Grâce à l’intervention de M. C. Castellani, préfet de la bibliothèque de Saint-Marc, les passages du manuscrit de Venise, visés par Mme Butti, ont été copiés par M. le sous-bibliothécaire Vittorio Baroncelli. Ils sont aujourd’hui entre les mains du R. P. Ayroles, qui se propose d’en tirer parti pour la continuation de son livre intitulé la Vraie Jeanne d’Arc.
M. Delisle, qui a eu quelques instants sous les yeux les copies de M. Baroncelli, a pensé qu’une telle découverte devait être, sans le moindre retard, portée à la connaissance de la Société de l’Histoire de France, qui, en publiant le recueil de Quicherat, a ouvert des voies nouvelles aux historiens de la Pucelle.
Les révélations que la Chronique de Morosini nous apporte à ce sujet sont contenues dans des lettres et des bulletins des années 1429, 1430 et 1431, que des Vénitiens se faisaient adresser périodiquement par des correspondants résidant à Avignon, à Marseille, et surtout à Bruges. C’est ainsi que nous a été conservée une série de dépêches où sont rapportées, pour ainsi dire au jour le jour, les nouvelles qui se propageaient avec une grande rapidité dans tous les pays de l’Europe sur les faits merveilleux de la Pucelle. (Quelques citations ont permis au Conseil d’entrevoir tout l’intérêt que présentent ces dépêches.)
Mais, d’après ce que le catalogue de la collection Foscarini nous a appris de la Chronique de Morosini, il y a lieu de croire que cette compilation renferme beaucoup d’autres informations utiles pour l’histoire de France sous les règnes de Charles VI et de Charles VII. On en pourrait, selon toute apparence, tirer les éléments d’une publication qui ferait honneur à notre Société. Notre confrère M. Germain Lefèvre-Pontalis, qui, par ses travaux antérieurs, a montré combien nos annales du XVe siècle lui sont familières, serait tout désigné pour entreprendre la publication que semble appeler chez nous la Chronique d’Antonio Morosini. Si cette tâche lui était confiée par le Conseil, il la remplirait avec le soin dont elle est digne, et il ajournerait le projet d’édition de la Chronique du manuscrit des Cordeliers dont il avait été question précédemment.
L’Univers 11 juin 1895
Communication du père Ayroles : Jeanne d’Arc, d’après une correspondance de l’époque jusqu’ici inédite.
Le père annonce de la découverte d’un document inédit sur Jeanne d’Arc, la Chronique de Morosini. Il en dévoile les principaux éléments et annonce sa publication prochaine.
Lien : Retronews
Également reproduit dans :
- La Semaine religieuse (Lyon), 14 juin 1895 : Google ;
- La Dépêche du Puy-de-Dôme, 2 juillet 1895 : Gallica.
Note. — La Chronique de Morosini fera l’objet d’une première publication (20 lettres, traduites en français) dans les Études (quatre livraisons, d’octobre 1895 à février 1896) ; puis d’une seconde publication plus complète (23 lettres, traduction française et original en vénitien du XVe siècle) au t. III de la Vraie Jeanne d’Arc (1897).
Nous recevons du savant et pieux auteur de la Vraie Jeanne d’Arc, le R. P. Ayroles, une communication que nous insérons avec empressement et qui sera lue avec un vif intérêt. Elle nous annonce que l’histoire de Jeanne d’Arc, déjà si riche, va s’enrichir d’un joyau de grand prix.
Jeanne d’Arc, d’après une correspondance de l’époque jusqu’ici inédite
Le ciel fait de plus en plus surabonder la lumière sur la figure de la libératrice. On savait bien que son apparition avait jeté la chrétienté dans la stupeur ; on possédait quelques lettres écrites sous le coup des événements […]. Aujourd’hui c’est une suite de lettres écrites au fur et à mesure que se déroulaient les faits, depuis l’apparition jusqu’au martyre, qui va être mise au jour. En voici la provenance.
[Texte complet publié dans les Écrits du père Ayroles.]
Que tous ceux qui ont contribué à mettre l’auteur de la Vraie Jeanne d’Arc en possession de ce joyau en soient publiquement remerciés.
La Vérité 4 juillet 1895
D’Auteuil, Questions historiques (feuilleton). — Rapporte la découverte et la publication prochaine de la Chronique de Morosini par le père Ayroles.
Lien : Retronews
Encore Jeanne d’Arc. — On ne s’en lasse pas, de la vénérable Jeanne. Tout ce qui se rattache à elle, de près eu de loin, excite la curiosité des érudits aussi bien que celle du public. Les brochures, les volumes continuent à déverser sur nous le trop plein des grandes idées on des petites découvertes… Et la pluie tombait toujours.
Cette fois, je prends l’avance, et je n’attends pas, pour l’annoncer aux lecteurs de la Vérité que la publication dont je veux parler d’abord ait vu la lumière. Il s’agit, en effet, d’un document inédit de premier ordre (il y en a encore, paraît-il), qui n’était pas tout à fait inconnu, mais dont la communication n’avait pu être obtenue avant l’intervention de l’administrateur général de notre Bibliothèque Nationale, et dont le texte nous est promis maintenant dans un assez bref délai. Le R. P. Ayroles, l’historien attitré de la Vraie Jeanne d’Arc, l’a signalé dernièrement, dans l’Univers [du 11 juin], à l’attention des fidèles clients de notre future sainte nationale. C’est une suite de lettres de l’époque, adressées à Venise au fur et et à mesure des événements et recueillies par un contemporain habitant cette ville. Leur ensemble forme, par conséquent, une sorte de relation complète.
Au XVe siècle, dit le P. Ayroles, Venise, avec ses quatre mille vaisseaux de tout bord, [… jusqu’à :] le chroniqueur a fait généralement preuve de discernement dans le choix des pièces.
Dans cette correspondance d’une si haute valeur et d’une authenticité incontestable, Jeanne est considérée comme une vraie sainte ; il ne vient pas un instant à l’idée des rédacteurs quelle puisse être une sorcière ou un imposteur en jupons, encore moins une hallucinée, car l’hallucination était inconnue de son temps. Decotissima, pientissima, simplicissima, toua plana de spiritual Sancto, telles sont les épithètes qui lui sont prodiguées. On lui attribue la connaissance des mystères les plus cachés.
Un prêtre crut pouvoir s’assurer du fait en violant les prescriptions les plus formelles et les plus légitimes de la liturgie. Jeanne devait communier. Le prêtre met de côté une hostie non consacrée et la présente à la vierge, agenouillée à la sainte table. Elle la refuse vivement en disant : Cela n’est pas le corps du Christ notre Rédempteur.
De tels prodiges, s’ils sont avérés, sont certainement faits pour abréger les délais qui nous séparent encore du beau jour de la canonisation.
Mais un des points les plus remarquables qui nous soient signalés par les correspondants des Vénitiens, c’est l’attitude de Charles VII à l’égard de la Pucelle. J’ai déjà soutenu ici et ailleurs, après le savant marquis de Beaucourt, que ce prince avait été accusé à tort, sinon à dessein, d’ingratitude et d’abandon envers celle qui lui avait rendu miraculeusement sa couronne. J’ai même été critiqué, à ce sujet, par certains ralliés
. Eh bien, ces précieux documents, ces témoins irrécusables me donnent raison. D’après leurs indications,
le roi n’aurait pas mérité, par son indifférence pour la captive de Beaurevoir et de Rouen, les virulents reproches dont l’accablent à l’envie les écrivains et les orateurs. Fidèle aux recommandations de Jacques Gélu, qui lui écrivait de mettre tout en œuvre pour la délivrance de la prisonnière, il aurait envoyé des ambassadeurs au duc de Bourgogne, afin de s’opposer de toutes ses forces à ce qu’elle fût remise entre les mains des Anglais, et l’aurait menacé de représailles. Il aurait fait les mêmes efforts auprès des Anglais pour la soustraire au dernier supplice. Consterné de douleur à l’annonce du martyre, il aurait formé le dessein d’en tirer une terrible vengeance sur les Anglais et sur les Anglaises.
On ne voit pas trop comment Charles VII aurait pu se venger sur les femmes d’Angleterre ; mais ses luttes ultérieures contre les ennemis de sa couronne, sa poursuite acharnée de l’envahisseur jusqu’au jour où il l’eut bouté hors
, attestent bien chez lui le dessein arrêté de châtier les bourreaux de la Pucelle. Le rôle attribué ici au roi de France est, d’ailleurs, tout à fait d’accord avec le coup de main tenté sur la ville de Rouen par un de ses plus vaillants capitaines, qui s’avança jusqu’à Louviers, mais ne put aller plus loin en raison des forces considérables accumulées sur ce point par les Anglais, dans le but de défendre leur proie. Il était impossible que la vérité ne se fît pas jour, à un moment donné, sur cette invention si invraisemblable de l’oubli et de l’indifférence de Charles VII.
La publication du recueil de Morosini fera sans doute la lumière sur d’autres détails importants. Souhaitons qu’elle ne tarde pas trop, et qu’elle soit entreprise par un homme compétent, avec cette connaissance approfondie de la langue du moyen âge et cet admirable sens de la critique historique qui distinguent à un si haut degré, depuis plusieurs années, l’infatigable école de l’érudition française.
[Suivent trois parties : II. Sur l’abbé Misset pourfendeur toujours heureux des adversaires de l’origine champenoise de Jeanne d’Arc
. — III. Sur l’ouvrage de Léon Mougenot, Jeanne d’Arc, le duc de Lorraine et le sire de Baudricourt, 1895. — IV. Sur l’ouvrage de Francis André, La vérité sur Jeanne d’Arc, lequel nous révèle que la fausse Jeanne d’Arc, Claude des Armoises, était en fait la vraie sœur de Jeanne : Claude d’Arc.]
Semaine religieuse (Lyon) 9 août 1895
Compte-rendu de l’Histoire de Jeanne d’Arc du chanoine Dunand, par Albert Desplagnes, qui y voit une œuvre complémentaire à celle du père Ayroles.
Le R. P. Ayroles publie toutes les sources connues de l’histoire de Jeanne, et discute la valeur et la portée de chacun de ces documents. M. Dunand reconstitue, à l’aide de ces documents, l’histoire, on peut dire le journal de la Pucelle.
Source : Semaine religieuse du diocèse de Lyon, 2e année, tome 2, (4e volume de la série), 31 mai 1895 - 22 novembre 1895, p. 307-308.
Lien : Google
Histoire de Jeanne d’Arc, d’après les travaux les plus récents, suivie du décret de Rome qui la déclare Vénérable, avec notes et pièces justificatives, par Ph.-H. Dunand, ancien aumônier du lycée de Toulouse, chanoine honoraire. 1 vol,in-8 de XVI-524 pages, 1895, chez Poussielgue, éditeur, Paris, rue Cassette, 15, et à Toulouse, chez E. Privat, libraire-éditeur, rue des Tourneurs, 45.
La vérité religieuse arrache parfois aux pires sectaires les plus surprenants aveux. Jean Macé, qui a pendant quarante ans poursuivi l’œuvre diabolique de la Ligue de l’enseignement avec toutes les ressources de la rouerie spéciale prêchée par Voltaire, a écrit cette phrase, incroyable de sa part :
Le prêtre seul n’aura rien à renier en se faisant l’historien de Jeanne d’Arc.
M. le chanoine Dunand, un admirateur fervent de notre sainte Libératrice, a peut-être dû à cet aveu du sectaire la pensée d’écrire cette histoire.
[…]
Tout ce que les travaux de ce siècle ont permis de découvrir et d’affirmer avec certitude, M. Dunand l’a mis en ordre et en a fait ce qu’on savait déjà, un récit chronologique complet, plein du plus vif intérêt. Le R. P. Ayroles a commencé et déjà publié en partie (2 vol. sur 5) un travail considérable contenant toutes les sources connues de l’histoire de Jeanne, et discutant la valeur et la portée de chacun de ces documents. M. Dunand a un objet différent : il reconstitue, à l’aide de ces documents, l’histoire, on peut dire le journal de la Pucelle. Le point de vue de M. Dunand et du P. Ayroles est le même ; l’un et l’autre voient en Jeanne une grande française et une grande sainte, et il y a accord complet entre leurs conclusions.
[…]
Des notes et pièces justificatives placées à la fin (près de cent pages) contiennent tous les éclaircissements et souvent la discussion nécessaire de certains documents. Cette partie scientifique et documentée suffit largement pour les lecteurs qui ne peuvent recourir aux sources ou aux travaux si complets du savant Père Ayroles.
[…]
Je ne parlerai pas des opinions de l’auteur sur divers points plus ou moins controversés ; il n’en est guère que je ne croie absolument fondée et irréfutable. Je ne puis douter du succès de ce livre et du grand nombre d’éditions qu’il aura. L’auteur pourra, sans doute, compléter d’une page, rectifier ou ajouter plus d’un détail, notamment quand auront paru les trois volumes qui manquent encore au travail du Père Ayroles. Mais dès à présent, ma pensée est que nulle autre histoire de Jeanne d’Arc, ne vaut celle-ci, et qu’à n’en lire qu’une, c’est celle de M. Dunand qu’il faut choisir. […]
Journal des savants août 1895
Communication de Léopold Delisle au sujet de la découverte de la Chronique de Morosini.
Le R. P. Ayroles est aujourd’hui en possession de tout ce que Morosini nous a transmis sur les faits de Jeanne d’Arc. Espérons qu’il ne tardera pas à nous faire jouir du trésor dont il a le mérite de nous avoir révélé l’existence !
Source : Journal des savants, année 1895, p. 511-518.
Lien : Archive
La Chronique d’Antonio Morosini.
Au mois de mai dernier, le R. P. Ayroles, qui poursuit avec ardeur ses recherches sur l’histoire de Jeanne d’Arc, voulut bien m’entretenir d’un opuscule publié à Trieste en 1892, dans lequel Mme Adèle Butti avait signalé l’intérêt d’une chronique italienne d’Antonio Morosini. Cette chronique, d’après les indications de Mme Butti, devait contenir vingt et une pages in-folio relatives à la Pucelle, et il en existait deux copies modernes : l’une à la Bibliothèque impériale de Vienne, en caractères illisibles ; l’autre à la bibliothèque de Saint-Marc à Venise ; cette dernière avait été faite d’après l’exemplaire de Vienne, et l’exactitude en avait été vérifiée par feu M. le commandeur Bartolomeo Cecchetti.
Le R. P. Ayroles me pria de lui faire copier les passages du manuscrit de Venise (t. II, p. 983-1004) que Mme Butti avait mentionnés comme se rapportant à Jeanne d’Arc. Je m’adressai à mon savant et obligeant collègue M. Gario Castellani, préfet de la bibliothèque de Saint-Marc, qui, peu de jours après, m’envoya la transcription des passages visés par Mme Butti. M. le sous-bibliothécaire Vittorio Baroncelli, qui avait exécuté la copie avec le plus grand soin, voulut bien m’avertir que l’exemplaire vénitien, classé à Saint-Marc sous la cote Ital. cl. VII, n° MM. XLVIII, était la copie de l’exemplaire conservé à la Bibliothèque impériale de Vienne sous les nos 6586 et 6587. Il ajoutait que Mme Butti n’avait pas renvoyé à tous les articles de la Chronique de Morosini qui concernent Jeanne d’Arc, et il m’offrait de compléter son travail en transcrivant tout ce qui touchait à un sujet si cher aux Français. J’acceptai sa proposition avec empressement, et, grâce à M. Vittorio Baroncelli, le R. P. Ayroles est aujourd’hui en possession de tout ce que Morosini nous a transmis sur les faits de Jeanne d’Arc. Espérons qu’il ne tardera pas à nous faire jouir du trésor dont il a le mérite de nous avoir révélé l’existence !
Je me suis empressé de faire part de cette découverte à la Société de l’Histoire de France, qui, en publiant le recueil de Quicherat, a ouvert des voies nouvelles aux historiens de la Pucelle. C’est d’ailleurs cette compagnie qui paraît devoir être appelée à mettre en lumière, non pas le texte complet de la Chronique de Morosini, mais au moins les parties de cette chronique qui intéressent directement notre pays. Il y aura là, n’en doutons pas, la matière d’une très curieuse publication, dont s’occupe déjà M. Germain Lefèvre-Pontalis, et que ce jeune savant saura mener à bonne fin.
[…]
La Vérité 30 septembre 1895
5e livraison de Jeanne d’Arc vengée de Jules Doinel (œuvre signée Jean Kostka
, qui paraîtra en 20 chapitres entre le 2 septembre 1895 et le 13 janvier 1896). Il cite abondamment le père Ayroles.
Voir aussi la 16e livraison du 16 décembre.
Lien : Retronews
[Sur l’information posthume du procès de condamnation :]
Or, ces témoignages, arborés avec tant de complaisance par la pseudo-critique et le simili-science, sont extraits de l’enquête posthume abominable, imaginée par le schismatique évêque de Beauvais, Pierre Cauchon, pour flétrir la mémoire de sa victime. Cette misérable enquête est totalement dénuée d’authenticité. Le R. Père Ayroles en a fait justice avant nous après M. Wallon, qui la stigmatise du nom d’odieux pamphlet.
[Sur le fait que Jeanne affirma que ses saintes sentaient bon :]
Le promoteur du tribunal de Rouen, dans le quarante-deuxième article de son factum, représente ce privilège d’avoir senti l’odeur paradisiaque des saintes, comme une preuve de la culpabilité de Jeanne d’Arc. Il aurait dû savoir cependant que beaucoup de saints ont été favorisés de cette grâce insigne. Mais, à quoi bon demander à ce misérable d’être juste, ou d’être vrai ? Tout son réquisitoire a été caractérisé par un mot du R. P. Ayroles : une infamie.
Idem, partie II, chapitre IV (16 décembre).
Lien : Retronews
[Sur la lettre de l’archevêque de Reims Regnault de Chartres aux habitants de Reims après la prise de Jeanne, qu’il justifie : elle aurait désobéi à Dieu
:]
Le R. P. Ayrolles, dans le premier volume du magnifique monument qu’il élève à la gloire de la Pucelle, en fait bonne et sévère justice (p. 81-84). Il nous permettra de chercher à compléter sa discussion vengeresse, mais trop respectueuse peut-être pour le politique habile qu’a été Regnault de Chartres, politique dont le cœur n’a pas égalé le talent, dont la sainteté n’a pas égalé la valeur intellectuelle. […]
Nous croyons même que, comme son complice La Trémouille, il a été satisfait de sa prise et heureux de ses insuccès. C’est un politique froissé dans son amour-propre
, comme le R. P. Ayroles le dit si justement. C’est, de plus, un diplomate entravé dans sa diplomatie humaine, orgueilleuse et présomptueuse. […]
La lettre est douloureuse. Elle accuse nettement Jeanne d’Arc d’orgueil, de présomption, de désobéissance. Et le R. P. Ayroles a grandement raison de protester. Il a raison aussi de faire observer que le chancelier de France est un politique bien plutôt qu’un prêtre, qu’il négligea singulièrement sa charge épiscopale et qu’il soigna singulièrement aussi sa fortune et celle des siens. Jeanne, dit ce pieux et savant jésuite, ne demanda à ses Voix que le salut de son âme. Regnault donna à une de ses nièces, le comté de Vierzon qu’il avait acquis au prix de 16,000 livres. […]
Jeanne a désobéi a Dieu, parce qu’elle a désobéi à Regnault de Chartres. Le personnage est tellement infatué de lui-même, de son omnipotence, de son autorité, qu’il ne voit pas qu’une telle accusation, dépassant toutes les bornes, retombe sur lui et ajoute le ridicule à l’odieux. Vraiment, le R. P. Ayroles est trop doux pour ce politique qui n’eut rien des vertus d’un évêque et dont la figure antipathique rappelle quelque peu celle de ces pharisiens qui accusaient le Sauveur…
Idem, partie II, chapitre V (23 décembre).
Lien : Retronews
[Sur l’Université de Paris au temps de Jeanne d’Arc :]
Le R. P. Ayroles a fixé d’une plume et d’une pensée magistrales les contours du tableau de l’Université de Paris au XVe siècle.
Il faut lire le savant jésuite pour nous bien comprendre. Nous ne pouvons, en effet, qu’esquisser dans cette rapide étude les traits généraux du complot de l’Enfer. Le P. Ayroles nous fait merveilleusement connaître les hommes et les choses. Et Lucifer devant se servir de ces hommes et utiliser ces choses, il est de toute nécessité de s’enquérir à fond des uns comme des autres. L’Université a le cœur anglais. L’Université est en état de révolte contre la chaire apostolique. Elle enseigne la lettre de la doctrine. Elle en fausse l’esprit. Elle condamne Jeanne, mais elle a commencé par condamner la Papauté. Elle eût poursuivi Eugène IV comme elle a poursuivi la Pucelle. À Constance et à Bâle, elle a joué le grand rôle…
Études octobre 1895-février 1896
Contribution du père Ayroles : La Chronique Morosini : Un document contemporain sur Jeanne d’Arc.
Première publication (en quatre parties) des lettres de Morosini dans leur traduction française.
Source : Études religieuses, 32e année, tome 66 : 15 octobre, 15 novembre, 14 décembre 1895 ; 33e année, tome 67 : 15 février 1896.
Liens :
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]
[…] De toutes les chroniques qui nous viennent de pays étrangers à la querelle, aucune n’a certainement la valeur de la chronique Morosini. Elle mérite une étude approfondie. Cette étude sera faite. Elle fera disparaître, nous l’espérons, les lacunes, les incertitudes et les erreurs d’une traduction entreprise dans les conditions signalées dans notre premier article.
Moniteur universel 18 novembre 1895
Article riche en science et en réflexion de Marius Sepet sur la découverte de la Chronique de Morosini.
L’historien relate les différentes étapes qui ont permis la mise au jour du document (grâce au père Ayroles) et qui laisse présager d’autres trouvailles, notamment dans les archives étrangères.
Il en détache deux points l’un intéressant, l’autre important
pour l’histoire de Jeanne d’Arc : le 1er renforçant l’idée qu’une fois la France libérée, Jeanne comptait poursuivre et libérer la Terre-Sainte ; 2. sur la douleur de Charles VII après sa prise à Compiègne, ses tentatives pour la récupérer, et sa colère à l’annonce de sa mort.
Enfin, il conclut sur la question capitale
:
L’existence de l’ordre surnaturel, si légèrement supprimée d’un trait de plume par des esprits qui se croient torts, parce qu’ils sont superficiels, se présente ici de la façon la plus nette, et, on peut le dire, dans les conditions les moins contestables. Dans l’histoire de Jeanne d’Arc, elle est invinciblement posée, et, selon nous, pour tous les hommes de bonne foi, authentiquement résolue.
Lien : Retronews
Une découverte récente sur Jeanne d’Arc
Le solide fondement de l’histoire de Jeanne d’Arc, c’est le recueil de documents publié par Jules Quicherat, de 1841 à 1849, pour la Société de l’histoire de France. Les trois premiers volumes sont occupés par les deux procès, de condamnation et de réhabilitation, source authentique, source incomparable pour connaître et pour restituer la vraie physionomie de l’héroïque vierge. Toutefois, une partie importante de ce qu’offrent les manuscrits du second procès avait été volontairement laissée de côté par le savant éditeur. Imbu de quelques préventions en ces matières, il ne s’était pas rendu compte de l’intérêt, non seulement théologique, mais historique, des mémoires composés par un certain nombre de docteurs contemporains, consultés au sujet de la Pucelle, soit avant le procès de réhabilitation, soit au cours de ce procès même, et n’avait cru devoir en reproduire que fort peu de chose. On avait lieu notamment de regretter l’absence dans son édition de la récollection, ou mémoire récapitulatif, dans lequel l’un des juges du second procès, le grand inquisiteur de France, Jean Bréhal, avait passé en revue et discuté tous les points en cause.
Ces vides importants ont été comblés dans ces dernières années par le R. P. Ayroles, qui a analysé et commenté les documents dont il s’agit dans le premier volume du vaste travail de vulgarisation, de recherche et de discussion entrepris par lui sous ce titre général : La Vraie Jeanne d’Arc ; par M. Pierre Lanéry d’Arc, qui en a publié les textes avec un zèle louable mais avec une correction insuffisante dans le recueil intitulé : Mémoires et consultations en fureur de Jeanne d Arc ; enfin, par les RR. PP. Belon et Balme, qui nous ont donné une excellente édition de la récollection de Jean Bréhal, accompagnée d’une remarquable étude historique, dans leur ouvrage distingué par l’Académie des inscriptions et belles-lettres : Jean Bréhal, grand inquisiteur de France et la réhabilitation de Jeanne d’Arc. Peut-être aurons-nous l’occasion de revenir ici sur quelques-uns des résultats obtenus ou des vues énoncées dans ces diverses publications. Mais, pour aujourd’hui, nous nous contentons de les signaler, et nous passons outre.
Les deux derniers volumes du recueil de Quicherat contiennent les extraits des historiens et chroniqueurs du quinzième siècle relatifs à Jeanne d’Arc, ceux des poètes du même temps, enfin les documents divers : lettres, comptes, etc., sur le même sujet. C’est naturellement cette partie qui avait surtout chance d’être ultérieurement enrichie par des découvertes nouvelles. Quicherat lui-même y a plus tard fourni quelques additions, dont la plus importante est l’intéressante relation consignée sur ses registres, au temps des victoires de Jeanne, par le greffier de l’Hôtel de Ville de la Rochelle. Les archives départementales ou municipales nous réservent encore, à cet égard, il faut l’espérer, quelques agréables surprises.
Mais ce sont peut-être les bibliothèques et les archives étrangères d’où il y a le plus lieu de s’attendre à voir successivement sortir de nouveaux témoignages relatifs à la Pucelle, dont la renommée, on s’en aperçoit de plus en plus, fut vraiment européenne. La Bibliothèque du Vatican a déjà livré, il y a quelques années, un texte curieux et précieux, signalé par le comte Ugo Balzani, et communiqué, avec tous les renseignements qu’il comportait, à l’Académie des inscriptions et belles-lettres et au public français par M. Léopold Delisle (Bibliothèque de l’École des Chartes, année 1885, p. 649 et suiv.). C’est une note additionnelle, ajoutée par un clerc français résidant à Rome à un ouvrage qu’il venait d’achever et auquel il avait donné le titre de Breviarium historiale. Cette note fut écrite après que l’on eût appris à Rome la délivrance d’Orléans et avant qu’on y sût le sacre de Charles VII à Reims, c’est à dire dans l’été de 1429. En voici le début, selon la traduction de M. Delisle :
Pendant que je demeurais à Rome, après l’achèvement de ce travail, parmi les nouveaux événements qui sont survenus dans l’univers, il s’en est produit un si grand, si considérable et si inouï qu’il ne paraît pas en être arrivé de pareil depuis l’origine du monde. Je ferai donc une addition à mon ouvrage pour en dire quelques mots.
Une pucelle, nommée Jeanne, est entrée dans le royaume de France ; elle y est seulement arrivée quand le royaume était à la veille d’une ruine complète et au moment où le sceptre de ce royaume devait passer dans une main étrangère. Cette jeune fille accomplit des actes plutôt divins qu’humains…
Le caractère de l’héroïque vierge est tracé et apprécié d’une façon simple et touchante et la note se termine par une piquante et significative anecdote, qui, si l’on peut douter de l’exactitude absolue de tous ses détails, n’en repose pas moins certainement, on le sait d’ailleurs, sur un fondement réel :
La Pucelle est âgée de dix-sept ans ; la force et l’adresse dont elle est douée lui font supporter les fatigues avec autant et plus de vaillance que les hommes les plus robustes. Elle ne recherche aucun avantage temporel. De l’argent qu’on lui donne, elle ne dépense rien, elle en fait des cadeaux ; ses réponses sont très simples ; elle est très prudente au fait de sa mission. Ses mœurs sont irréprochables ; elle est sobre, nullement superstitieuse, ni adonnée aux sortilèges, quoique les envieux l’en aient accusée.
Qu’elle soit exempte de superstition et de sortilège, c’est ce qu’on reconnaîtra aisément à trois caractères qui empêchent de confondre les miracles accomplis par les bons avec ceux des mauvais. Les premiers, quand même ils paraissent dépasser les forces de la nature humaine, s’opèrent avec le secours de la puissance divine ; ils ont toujours une véritable utilité, tandis que les autres aboutissent à des maux ou à des futilités, comme quand on vole dans les airs ou qu’on plonge les membres d’un homme dans l’engourdissement. Un dernier caractère des vrais miracles, c’est qu’ils ont pour but le développement de la foi et l’amélioration des mœurs.
Or, il faut remarquer que ladite Pucelle se confesse tous les jours avant d’entendre la messe ; elle communie chaque semaine ; ses actions dépassent, il est vrai, les forces de son sexe ; mais elle combat pour une cause utile et juste, puisque c’est pour pacifier le royaume de France, ce qui entraînera le relèvement de la foi, qui, à en juger par l’expérience des siècles passés, n’aurait pas tant souffert si la France n’avait pas été entraînée dans un tourbillon de guerres désastreuses. Il faut donc nécessairement conclure que les succès de la Pucelle sont dus à la volonté divine et non pas à des sortilèges, comme le prétend la jalousie.
Que dire de plus ? Un jour, la Pucelle a demandé au roi de lui faire un présent. Cette prière fut aussitôt agréée. Jeanne ne demanda rien de moins que le royaume de France. Le roi, étonné, fit le cadeau après un instant de réflexion. Jeanne l’accepta, et s’en fit faire, par les quatre secrétaires du roi, une charte dont il fut donné une lecture solennelle. Le roi en était un peu ébahi, et Jeanne, en le montrant à l’assistance, tint ce propos :
Voilà le plus pauvre chevalier de son royaume !Presqu’en même temps, par devant les mêmes notaires, elle livra au Dieu tout puissant le royaume de France, qu’elle venait de recevoir en don. Puis, au bout d’un instant, obéissant à un ordre de Dieu, elle investit le roi Charles du royaume de France ; et de tout cela elle fit dresser un acte solennel.
Telle est la découverte faite à Rome. Plus récemment, cette année-ci même, nous a été révélée l’existence simultanée, à Venise et à Vienne en Autriche, d’un document nouveau, fort important, sur Jeanne d’Arc. La première origine de cette découverte est une remarque communiquée au R. P. Ayroles par son jeune et docte confrère, le R. P. Rivière, de la Compagnie de Jésus. Il lui signala, d’après une mention sommaire relevée dans une revue, un petit ouvrage publié en 1892, à Trieste, par Mme Adèle Butti, sous ce titre : Di Giovanna d’Arco ressuscitata dagli studi stori, etc. Dans ce livre était indiquée par l’auteur une chronique inédite, rédigée par un Vénitien, du nom de Morosini, et où il était longuement parlé des merveilles accomplies en France par la Pucelle. Un double exemplaire en était conservé, l’un à la Bibliothèque impériale de Vienne, l’autre, copie du précédent, à la bibliothèque de Saint-Marc, à Venise.
Le P. Ayroles, justement préoccupé du désir de posséder le texte ainsi révélé à son zèle, fit, tant à Vienne qu’à Venise, pour en obtenir copie, des démarches demeurées infructueuses. Il résolut alors de s’adresser à l’obligeance de M. Léopold Delisle, dont la haute situation administrative, en même temps que scientifique, assurait à son intervention, s’il l’accordait, un résultat plus heureux. M. Delisle obtint en effet sans peine de M. Castellani, préfet de la bibliothèque de Saint-Marc, la copie, exécutée par M. Baroncelli, des pages de la chronique en question indiquées par le P. Ayroles, et d’autres extraits plus étendus, qu’il remit au docte religieux. Lui-même, vivement intéressé comme il était naturel, par la découverte de ce document nouveau, dont l’utilité ne se borne pas à l’histoire de Jeanne d’Arc, mais s’étend à l’histoire de France durant une période de cinquante années, se livra à quelques recherches dont il a exposé les résultats dans le Journal des savants (août 1895). Depuis lors, le P. Ayroles, en attendant la suite de son grand ouvrage, a commencé à communiquer au public, dans le recueil mensuel intitulé : Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires (livraison du 15 octobre 1895), les extraits de la Chronique de Morosini relatifs à Jeanne dont il est en possession. Ajoutons que la Société de l’histoire de France a résolu en principe la publication de toutes les parties de la chronique de Morosini relatives à notre pays et qu’elle en a confié le soin à un jeune savant très digne de cette honorable commission, M. Germain Lefèvre-Pontalis.
La copie conservée à Venise est récente. Vienne possède l’original, c’est à savoir un manuscrit en deux volumes, d’une écriture du quinzième siècle, dont la lecture est un véritable exercice de déchiffrement, comme on peut en juger par la photographie d’une page qu’a fait exécuter M. Delisle, et qu’il a jointe à l’extrait, distribué par lui, de son article dans le Journal des savants [Voir]. Ce manuscrit faisait partie de la bibliothèque de Marco Foscarini, doge de Venise, mort en 1703, bibliothèque qui fut acquise au commencement de ce siècle par le gouvernement autrichien. La chronique qu’il renferme, et dont l’auteur lui-même se fait connaître sous le nom d’Antonio Morosini, allait de la fondation de Venise à une date indéterminée du quinzième siècle. Les premiers et les derniers feuillets faisant défaut, elle comprend, dans son état actuel, le temps écoulé entre 1192 et 1433.
La partie qu’on peut appeler originale commence à la date de 1374. À partir de ce moment, la chronique prend un caractère et une valeur toute spéciale. Elle semble, dit M. Delisle, être
beaucoup moins un récit suivi qu’un recueil de relations adressées soit aux magistrats de la Sérénissime République, soit à de notables Vénitiens, pour les tenir au courant des événements qui s’accomplissaient dans les pays avec lesquels ils entretenaient des rapports de commerce.
Les guerres dont la France était le théâtre devaient jeter une grande perturbation dans les opérations des négociants de Venise. De là, nécessité pour eux d’être exactement renseignés sur la situation des partis, sur la marche des armées et sur les intrigues diplomatiques. À cette fin, ils avaient organisé un système de courriers qui leur apportaient des dépêches rédigées par des agents généralement bien informés ; ils se faisaient, en outre, communiquer les nouvelles arrivées dans différentes cités de la haute Italie.
Les lettres et les bulletins de ce genre qu’Antonio Morosini a rassemblés forment un véritable journal, dont j’ai pu apprécier le caractère et l’importance en parcourant une partie des pièces relatives à Jeanne d’Arc. Ce sont généralement des lettres privées, écrites d’Avignon, de Marseille et surtout de Bruges en dialecte vénitien.
La chronique de Morosini, (dit aussi le P. Ayroles), est un journal, au moins pour les pages consacrées à la Pucelle, journal tel qu’il était possible, à cette époque. L’auteur insère les lettres qui concernent la libératrice, et qu’il croit les plus véridiques. Il en rapporte les dates et, comme on le verra, les noms de ceux qui les ont écrites, avec le jour de l’arrivée de ces missives. Il était d’ailleurs admirablement placé pour être renseigné, Venise se trouvant alors le centre du commerce de tout le monde connu. D’après César Cantu, le nombre des vaisseaux de la République s’élevait à 3,500. Ils cinglaient vers l’Orient et vers l’Occident, parcouraient la mer d’Azow et la mer du Nord. Dans l’intérêt même de son commerce, la Sérénissime République devait être informée des événements politiques et militaires qui se déroulaient aux pays où abordaient ses vaisseaux.
Il est facile de voir que les correspondants de la chronique n’insèrent pas indifféremment tous les bruits que la renommée répandait sur l’héroïne ; cependant si, actuellement encore, avec les moyens d’information perfectionnés que nous possédons, les journaux les plus sérieux donnent tant de nouvelles que les télégrammes du lendemain déclarent erronées, combien le phénomène analogue devait être plus fréquent en un temps où il y avait entre Venise et Bruges une distance plus grande qu’aujourd’hui entre Paris et Shanghai.
En lisant les extraits de la chronique vénitienne, relatifs à Jeanne, déjà communiqués au public par M. Delisle et par le R. P. Ayroles, nous avons surtout été frappé de l’éclaircissement qui en peut résulter sur deux points, l’un intéressant, l’autre important, de la carrière de l’héroïque vierge.
Le premier point, ce sont ses intentions pour l’avenir, au cas où il lui aurait été donné d’achever elle-même la libération du territoire. Un indice à cet égard se trouve dans sa célèbre et magnifique lettre aux Anglais :
Vous, duc du Bedford, dit-elle au chef de l’invasion et de l’occupation étrangère, la Pucelle vous prie et vous supplie que vous ne vous fassiez détruire. Si vous lui faites raison, vous pourrez encore venir en si compagnie, là où les Français feront le plus beau fait d’armes qui ait jamais été accompli pour la chrétienté.
On peut rapporter à une pensée du même genre une phrase de la lettre de Jeanne au duc de Bourgogne, dictée le jour même du sacre de Charles VII (17 juillet 1129) :
Haut et redouté prince, duc de Bourgogne, Jeanne la Pucelle vous requiert de par le Roi du ciel, son légitime et souverain seigneur, que le roi de France et vous, vous fassiez bonne paix ferme, qui dure longtemps. Pardonnez-vous l’un à l’autre de bon cœur, entièrement, ainsi que doivent faire loyaux chrétiens, et s’il vous plaît de guerroyer, allez contre les Sarrasins.
Il semble tout naturel de rapprocher de ces deux textes le passage suivant d’une lettre écrite d’Avignon, le 30 juin 1429, et insérée par Morosini dans sa chronique :
La glorieuse demoiselle a promis au dauphin de lui procurer, avec la couronne de France, un don qui vaudra plus que son royaume ; elle lui a promis la conquête de la Terre-Sainte, où elle l’accompagnera.
Il y a là, croyons-nous, un écho, grossi sans doute par l’opinion publique, de certaines paroles de Jeanne, exprimant des vues éventuelles, distinctes d’ailleurs de sa mission positive et formelle.
L’autre point, très important, se rapporte à la conduite de Charles VII envers Jeanne d’Arc, après sa capture à Compiègne ; question délicate, encore obscure, qui laisse peser sur la mémoire de ce prince une ombre pénible et lourde. Que pourtant certaines tentatives aient été faites pour la délivrance de Jeanne, c’est ce qui résultait déjà des plaintes adressées, le 14 juillet 1430, par l’Université de Paris, alors toute bourguignonne et tout anglaise, au duc de Bourgogne et au comte de Ligny. Elle y exprime en effet, la crainte
que, par la fausseté et la séduction de l’ennemi d’enfer, et par la malice et subtilité des mauvaises personnes, vos ennemis et adversaires, qui mettent tout leur soin, comme on dit, à vouloir délivrer cette femme par voies détournées, elle ne soit mise hors de votre pouvoir par quelque manière, ce que Dieu ne veuille permettre.
Il faudra désormais tenir compte, dans le même sens, de deux passages au moins de la chronique de Morosini :
1. Nouvelles de Bruges, en date du 15 décembre 1430 :
La Pucelle serait aux mains du duc de Bourgogne, et beaucoup en tirent la conséquence que les Anglais l’auraient pour de l’argent ; et le dauphin, l’ayant su, envoya une ambassade dire au duc que pour rien au monde il ne devait consentir à un tel marché.
2. Lettre du 22 juin 1431, relative au supplice de l’héroïque vierge :
La noble damoiselle avait été gardée à Rouen dans une très étroite prison ; on disait que, par deux ou trois fois, les Anglais l’avaient voulu faire brûler comme hérétique, n’eût été messire le dauphin de France, qui a envoyé moult menacer les Anglais ; mais, nonobstant cela, à la troisième fois, beaucoup d’Anglais, avec l’aide de quelques Français, la firent ardre à Rouen. Elle, avant le martyre, était bien contrite et très pieusement disposée ; on dit qu’alors lui apparut Madame sainte Catherine, vierge, qui la réconfortait, en lui disant :
Fille de Dieu, reste ferme dans ta foi, et avec cela tu seras au nombre des vierges du Paradis dans la gloire.Et après, elle mourut avec contrition. De quoi messire le dauphin, roi de France, mena un deuil très amer, annonçant l’intention de tirer une vengeance terrible des Anglais… On prétend que les succès des Français sont la cause du supplice de la Pucelle, les Anglais disant :La damoiselle une fois morte, l’entreprise du dauphin ne réussira plus.Plaise à Dieu que ce soit le contraire !
On voit l’intérêt du document nouveau sur Jeanne d’Arc, dont la découverte permet d’en espérer d’autres analogues, à mesure que l’attention sera de plus en plus attirée sur cette radieuse figure. Entre autres heureux résultats de sa gloire, chaque jour grandissante, il est permis de se féliciter du fruit qu’en tireront et la science historique et la science théologique, et les rapports, trop méconnus, de l’une et de l’autre. La question capitale de ce temps-ci : l’existence de l’ordre surnaturel, si légèrement supprimée d’un trait de plume par des esprits qui se croient torts, parce qu’ils sont superficiels, se présente ici de la façon la plus nette, et, on peut le dire, dans les conditions les moins contestables. Dans l’histoire de Jeanne d’Arc, elle est invinciblement posée, et, selon nous, pour tous les hommes de bonne foi, authentiquement résolue.
Marius Sepet.
La Vérité 16 décembre 1895
16e livraison de la Jeanne d’Arc vengée de Jules Doinel qui cite à nouveau le père Ayroles. Voir aussi la 5e livraison du 30 septembre.
Lien : Retronews
[À propos de la lettre de Regnault de Chartres aux habitants de Reims, imputant la prise de Jeanne à son orgueil et son faste.]
Voilà une formidable accusation et qui tombe de haut. Le R. P. Ayroles, dans le premier volume du magnifique monument qu’il élève à la gloire de la Pucelle, en fait bonne et sévère justice (Vraie Jeanne d’Arc, t. I, p. 81-84).
Lien : Retronews
[Sur l’Université de Paris.]
Le R. P. Ayroles a fixé d’une plume et d’une pensée magistrales les contours du tableau de l’Université de Paris au XVe siècle (Vraie Jeanne d’Arc, t. II, p. 5-8, 99-109 ; t. I, p. 87-204). Il faut lire le savant jésuite pour nous bien comprendre.
La Croix 22 juillet 1896
Bref et élogieux compte-rendu sur la Vraie Jeanne d’Arc et l’entreprise du père Ayroles.
Lien : Retronews
Nous recommandons volontiers de nouveau ce bel ouvrage.
Imprimer dans l’esprit et le cœur des jeunes Français et des jeunes Françaises l’image non pas fantastique, non pas altérée, non pas mutilée, mais réelle et complète de la vénérable Jeanne d’Arc, c’est y graver le christianisme tout entier dans la forme, la plus attrayante peut-être, qu’il ait revêtu depuis les apôtres. La Pucelle tout entière, avec tous ses enseignements, ne se trouve que dans les sources si riches de son histoire.
Rendre ces sources accessibles à quiconque sait lire, les montrer dans leur limpidité, en les étalant à la lumière des faits de l’époque, faire disparaître les appareils de mensonge, par lesquels les erreurs des cinq derniers siècles ont cherché à les obstruer ou les corrompre, c’est te but des volumes publiés par le R. P. Ayroles, S. J. sous le titre commun de La vraie Jeanne d’Arc.
Ce sont de magnifiques prix d’honneur que les volumes publiés déjà sous ce titre : La Pucelle devant l’Église de son temps et : La paysanne et l’inspirée d’après ses aveux, les témoins oculaires et La libre-pensée. Ils ont valu à l’auteur, de la part de Sa sainteté, un Bref d’éloges des plus expressifs. En lui ordonnant de s’occuper uniquement de continuer l’œuvre, Léon XIII semble se constituer l’historien officiel de la libératrice, l’assurant que c’est une manière excellente de bien mériter de la société religieuse et civile. La découverte de la chronique Morosini, qui jette tant de jour sur l’ apparition de la céleste envoyée, est sans doute un effet de cette mission. Nous savons que l’obéissant religieux est fidèle à la prescription de Sa Sainteté, et met la dernière main à sa période de la vie guerrière.
Les volumes déjà parus forment un tout. Entre les mains de la jeunesse au sein des familles, ils sont un monument authentique et permanent de la libératrice. Aux maîtres et aux maîtresses qui l’y érigent, on peut dire qu’ils méritent bien de la société religieuse et civile.
La vraie Jeanne d’Arc, in-4°, beau papier, beaux caractères, de 600 à 800 pages, est éditée par la maison Gaume, rue de l’Abbaye, 3, prix fort 15 francs.
À la même maison, Jeanne d’Arc sur les autels et la Régénération de la France ; par le même auteur, un volume in-12, 3 francs, 2e édition bientôt épuisée. On écrit : Que tout catholique de France devrait le savoir par cœur, comme le catéchisme des devoirs envers le Christ, la patrie, envers la société, imposés par l’honneur d’être Français.
La Croix 6 septembre 1896
Église Saint-Denis de La Chapelle (Paris). — Inauguration, mardi 8 septembre, d’un sanctuaire en l’honneur du passage de Jeanne d’Arc à La Chapelle en 1429. Le matin (9 heures), allocution du père Ayroles.
Lien : Retronews
[…] Le pieux et zélé curé de Saint-Denis de la Chapelle, M. l’abbé de Bonniot, voulant glorifier Jeanne d’Arc et sainte Geneviève, vient de faire construire au fond de l’église, dont la nef subsiste, un chœur vaste et richement décoré et derrière ce chœur une spacieuse chapelle de la Très Sainte Vierge à gauche, se trouve une autre chapelle d’un style roman très pur, élevée en l’honneur de sainte Geneviève et que décorent deux beaux vitraux sortis des ateliers Champigneulles.
Le vitrail qui va être placé au-dessus de l’autel de la Très Sainte Vierge résumera l’histoire de la France sauvée par Jeanne d’Arc.
M. le curé nous écrit :
Vous savez notre intention de compléter un jour le plan qui n’est que commencé ; nous voulons une chapelle de Jeanne d’Arc devant faire pendant à celle de sainte Geneviève. Nous attendons qu’une main généreuse nous donne les moyens d’acheter la propriété voisine sur laquelle nous construirons cette chapelle. Il faudra peut-être attendre quelques années, c’est-à-dire le temps que l’Église mettra à canoniser la sainte héroïne, et alors chez nous la Sainte Vierge apparaîtra accompagnée de ces deux libératrices et patronnes de la France dont elle est elle-même la Reine bien-aimée.
L’inauguration de ce beau et grand sanctuaire a lieu mardi prochain, jour de la Nativité de la Très Sainte Vierge.
Les amateurs de notes historiques intéressantes iront le matin, à 9 heures, entendre le P. Ayroles, qui donnera la primeur d’un chapitre de sa grande Histoire de Jeanne d’Arc, qu’il pourra intituler Jeanne d’Arc à la chapelle.
Le soir, à 8 heures, grand office ; conférence populaire sur Jeanne d’Arc, et Salut solennel du Très Saint-Sacrement.
Le Parisien.
[Voir également les articles de la Vérité (7 sept.), du Peuple français, et de la Libre Parole (8 sept.).]
La Vérité 7 septembre 1896
Sur l’inauguration du nouveau sanctuaire Jeanne d’Arc en l’église Saint-Denis de la Chapelle (cf. la Croix du 6 septembre).
Lien : Retronews
Saint-Denis de la Chapelle. — Mardi 8, commémoration du séjour de Jeanne d’Arc à La Chapelle ; à 9 h., messe solennelle avec chants, allocution par le R. P. Ayroles, S. J. Le soir, à 8 h., vêpres de la Sainte Vierge et discours sur Jeanne d’Arc, par M. l’abbé Poulin, vicaire de Sainte-Clotilde, salut solennel. La cérémonie sera présidée par M. l’abbé de Bonniot, chanoine titulaire de Paris.
Les travaux d’agrandissement sont terminés, les pieux pèlerins de Jeanne d’Arc seront reçus dans une vaste chapelle de la Sainte Vierge, aussi remarquable par le fini de l’exécution que par l’ampleur qu’elle ajoute a la petite église de La Chapelle, qui sera déformais suffisamment grande, en attendant sa complète reconstruction.
La Gazette 7 septembre 1896
Lien : Retronews
Mardi, 8 septembre, Nativité de la vierge.
Soleil : lev. 5 h. 28 ; couch. 6 h. 26. Lune : lev. 6 h. 36, couch. 6 h. 31. […]
Fêtes religieuses. — Adoration perpétuelle, chapelle des Carmélites, rue d’Enfer (et les 9 et 10). — Commémoration du séjour de Jeanne d’Arc, à Saint-Denis la Chapelle ; à 9 h. messe solennelle, allocution du R. P. Ayroles ; à 8 h. vêpres de la Sainte-Vierge, discours sur Jeanne d’Arc par M. l’abbé Poulin, vicaire à Sainte Clotilde. — Pèlerinage à N.-D. de Tout-Remède, à Rumengol (Bretagne). […]
Le Peuple français 8 septembre 1896
Sur l’inauguration du nouveau sanctuaire Jeanne d’Arc en l’église Saint-Denis de la Chapelle (cf. la Croix du 6 septembre).
Lien : Retronews
Jeanne d’Arc à La Chapelle, fête commémorative. — Aujourd’hui sera célébrée en l’église Saint-Denys-la-Chapelle, agrandie et restaurée, la fête de la commémoration du séjour de Jeanne d’Arc à La Chapelle, le 8 septembre 1429. Le matin à neuf heures, une messe solennelle sera chantée ; le R.P. Ayrolles, l’historien distingué de Jeanne d’Arc, y prononcera une allocution qui promet d’être fort intéressante. Le soir, à huit heures, sous la présidence de M. de Bonniot, chanoine titulaire de Notre-Dame, vêpres de la Sainte Vierge, avec sermon de M. l’abbé Stauder, vicaire de Notre-Dame-de-Clignancourt, et suivies du salut solennel du Très Saint Sacrement.
La Libre Parole 8 septembre 1896
Sur l’inauguration du nouveau sanctuaire Jeanne d’Arc en l’église Saint-Denis de la Chapelle (cf. la Croix du 6 septembre).
Lien : Retronews
Aujourd’hui, la vielle église de Saint-Denys-la-Chapelle sera en fête ; on y célébrera, en effet, la commémoration du séjour de Jeanne d’Arc à la Chapelle, le 8 septembre 1429.
Cette petite église, située 94, rue de la Chapelle, est un des plus anciens monuments de l’ancien Paris, et à elle s’attachent les plus glorieux souvenirs. Saint Denis, l’apôtre des Gaules, a prêché là ; sainte Geneviève est souvent venue prier au petit oratoire sur l’emplacement duquel fut bâtie l’église actuelle. Enfin, c’est la seule église de Paris où se soit arrêtée Jeanne d’Arc, dans les circonstances que nous allons rappeler en deux mots.
Après le sacre de Charles VII à Reims, les Anglais, que commandait le régent anglais Bedford, tenaient encore Paris. Le 28 août 1429, le roi de France prenait possession de Saint-Denis et venait ensuite attaquer Paris devant lequel il échouait le 8 septembre. Dans cette attaque, Jeanne eut la cuisse traversée d’un coup d’arbalète ; on la ramena au camp français à La Chapelle où elle prit quelque repos avant de renouveler l’attaque.
C’est ce souvenir que, depuis sept ans, le vénérable curé de Saint-Denys-la-Chapelle, M. l’abbé de Bonniot, a eu la pieuse pensée de perpétuer dans le quartier ouvrier de La Chapelle.
Aujourd’hui donc, à neuf heures du matin, à la messe solennelle, le R. P. Ayroles, l’historien de Jeanne d’Arc, donnera un chapitre inédit de Jeanne à La Chapelle et aux environs de Paris. Le soir, à huit heures, M. l’abbé Stauder viendra ajouter encore à tout ce qu’il a dit d’intéressant les années précédentes sur son illustre compatriote. Et, cette année, la cérémonie sera plus brillante encore, car, grâce au zèle de M. l’abbé de Bonniot, l’église vient d’être considérable ment agrandie et embellie.
Ce n’est plus, nous disait hier le vénérable curé que nous avons trouvé dans son sanctuaire, la soutane blanchie par le plâtre, donnant les derniers conseils aux ouvriers, ce n’est plus la petite église étroite, noire et nue que vous avez connue il y a quelques années.
Et, escaladant les gravats, il nous montre, au fond de l’église dont la nef subsiste, un chœur vaste et richement décoré, derrière le quel se trouve une spacieuse chapelle consacrée à la Vierge. Sur un des côtés du chœur s’élève une autre chapelle de pur style roman, consacrée à sainte Geneviève ; deux beaux vitraux retracent des épisodes de la vie de sainte Geneviève et le passage de Jeanne d’Arc à la chapelle. Une autre chapelle doit lui faire face, qui sera consacrée, celle-là, à la grande héroïne française quand elle aura enfin été canonisée.
L’inauguration de ce beau et grand sanctuaire aura lieu très prochainement, sous la présidence de Mgr Richard, cardinal archevêque de Paris. Une pareille initiative fait le plus grand honneur au vénérable abbé de Bonniot qui s’est donné à tâche de rehausser le culte que tous les bons Français doivent à celle qui sauva la France des Anglais.
Hervé Breton.
La Science catholique 15 octobre 1896
L’abbé Théodore Leuridan annonce un compte-rendu à venir du tome III de la Vraie Jeanne d’Arc dan son Bulletin d’Histoire.
Source : La Science catholique : revue des questions religieuses, 11e année, n°11, 15 octobre 1896, p. 1038.
Lien : Gallica
NOTA. — Nous avons reçu des éditeurs ou des auteurs les ouvrages suivants pour le Bulletin d’Histoire ; nous en donnerons prochainement le compte-rendu détaillé.
[…] R. P. Ayroles, La vraie Jeanne d’Arc. — III. La Libératrice.
De même dans le numéro du 15 novembre.
Source : La Science catholique : revue des questions religieuses, 11e année, n°12, 15 novembre 1896, p. 1133.
Lien : Gallica
Les ouvrages suivants ont été adressés à la Revue ; il en sera rendu compte dans un prochain bulletin :
Ayroles, La vraie Jeanne d’Arc. III. La libératrice.
Études 24 décembre 1896
Compte-rendu par le père Ayroles de la thèse de l’abbé Chassagnon : Les Voix de Jeanne d’Arc en face de la science et de la raison, soutenue en juin 1896 à Lyon, sous la présidence de Mgr Coullié.
Source : Études religieuses, partie bibliographique, 24 décembre 1896, dans vol. 64-69, p. 888.
Lien : Google
[Texte publié dans les Écrits du père Ayroles.]